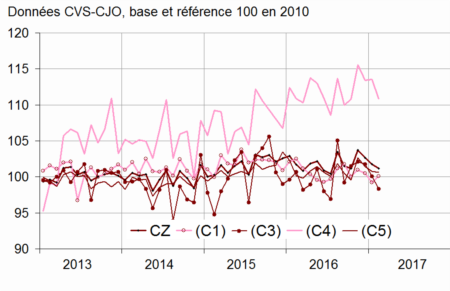Rebond de la création d’entreprise en mars !
Selon l’INSEE, au mois de mars 2017, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus a augmenté de 2,4 % contre un recul de 1 ù en février en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les immatriculations de micro-entrepreneurs se redressent (+2,7 %) et les créations d’entreprises classiques continuent d’augmenter (+2,2 %).
Créations d’entreprises (CVS-CJO *)
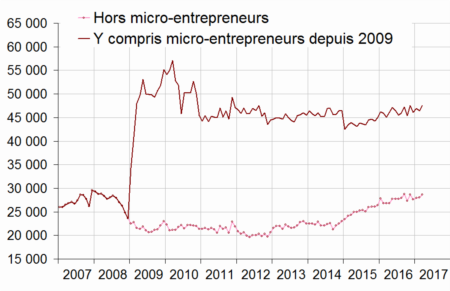
Comparé à la même période un an plus tôt, le nombre cumulé de créations au cours des trois derniers mois accélère en mars (+6,2 % après +4,2 %, en données brutes). Tous les types d’entreprises augmentent nettement : les sociétés (+8,2 %), les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+7,0 %) et les micro-entrepreneurs (+3,9 %). Les transports et le soutien aux entreprises sont encore une fois les secteurs qui contribuent le plus à la hausse globale.
En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois reste en nette hausse (+5,8 % après +5,6 % en février et +6,2 % en janvier). Cet accroissement est principalement dû aux créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+8,7 %) et de sociétés (+8,4 %). Dans une moindre mesure, les immatriculations de micro-entrepreneurs continuent elles aussi d’augmenter (+1,9 % après +1,6 % en février).
En mars 2017, en données brutes, la part des demandes d’immatriculation de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois est de 40,0 %. Elle est en recul depuis plusieurs années. En mars 2016, ce ratio était de 41,5 %.
L’inflation confirmée à 1,1 % au mois de mars
En mars 2017, l’indice des prix à la consommation s’est élevé, selon l’INSEE, à +0,6 % sur un mois après 0,1 % en février. Corrigé des variations saisonnières, il est stable après un recul de 0,2 % en février. Sur un an, les prix à la consommation ralentissent de nouveau légèrement (+1,1 % après +1,2 %).
Sur le mois, l’accélération provient d’un rebond du prix des produits manufacturés après la fin des soldes d’hiver et d’une hausse des prix du tabac. En revanche, les prix de l’alimentation se replient du fait des produits frais. De même, les prix de l’énergie reculent du fait des produits pétroliers. Enfin, les prix des services marquent le pas.
L’indice d’inflation sous-jacente (hors prix subissant de fortes fluctuations – énergie- matières premières…) progresse de +0,2 % sur le mois après un repli de 0,4 % le mois précédent. Sur un an, il accélère légèrement (+0,4 % après +0,2 %) mais demeure faible.
La Commission européenne travaille sur un plan d’épargne retraite européen
Mentionné par l’AGEFI le 12 avril dernier, la Commission européenne travaille sur un projet de plan d’épargne retraite européen. Une proposition devrait être présentée d’ici la fin de l’été et viserait donc à créer un Pan European Personal Pension Product (PEPP). Selon le président de l’Autorité européenne des assurances et des pensions (Eiopa), Gabriel Bernardino, ce projet serait une pierre importante pour l’union des marchés de capitaux et pour favoriser l’investissement à long terme.
Le PEPP serait un produit ’épargne retraite pan-européen, distribué dans tous les pays et souscrit sur une base volontaire. Quel que soit le distributeur, il comporterait quelques éléments standards : l’information de l’épargnant, une option d’investissement par défaut, et un nombre limité de choix d’investissement. Les autres facteurs seraient de la responsabilité des distributeur. Cela pourrait concerner les éventuelles garanties, le plafonnement des frais de gestion, et les conditions du passage d’un fournisseur à un autre. Il pourrait reposer sur une sortie en rente ou en capital. Pour le moment, ce point n’a pas été tranché.
Le régulateur européen, l’Eiopa, souligne la nécessité pour le PEPP de disposer du même traitement fiscal dans un pays donné que les autres produits de retraite nationaux.
Les épargnants et l’élection présidentielle
A quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, les épargnants doivent-ils avoir peur ? Philippe Crevel répond aux questions de Guillaume Sommerer pour BFM Business
La déclaration des revenus en ligne expliquée par Philippe Crevel
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne était l’invité de la rédaction de RTL à 6H15 le 12 avril 2017 afin d’expliquer les modalités de la déclaration en ligne des revenus 2016.
Ecouter l’interview sur le site de RTL
Les ménages profitent des taux bas pour s’endetter
Selon l’enquête mensuelle de la Banque de France, en mars, la demande de crédits par les entreprises est assez étale. En revanche les banques interrogées soulignent que la demande de crédits à l’habitat et à la consommation est en progression
14 024 638 retraités au régime général
Le régime général comtait au 31 décembre 2016 14 024 638 retarités qui recoivent soit une pension de droit direct soit une pension de réversion. 43 % d’entre eux ont cotisé à plusieurs régimes de retraite durant leur carrière professionnelle. L’âge moyen du retraité du régime général a légèrement augmenté : il est de 73,9 ans contre 73,8 ans en 2015.
Le montant de base mensuel moyen servi pour une carrière complète au régime général est de 1041 € contre 1037 € en 2015.
Le nombre de nouveaux bénéficiaires de pensions directs a diminué de 6,6 % par rapport à 2015. 613.506 personnes ont pris leur retraite. La décrue s’explique notamment le recul de l’âge légal à 62 ans. Le nombre de départs en retraite anticipée « longue carrière » a également diminué passant de 171 557 en 2015 à 167 659 en 2016. Plus de 97 % de ces nouveaux retraités ont un âge compris entre 60 ans et l’âge légal. Le nombre de retraite progressive monte légèrement avec 8 895 attributions au cours de l’année 2016 contre 3 871 au cours de l’année 2015. Parmi l’ensemble des retraités en paiement au 31 décembre 2016, 11 561 sont en retraite progressive contre 5 208 au 31 décembre 2015.
Déclaration des revenus 2016 : c’est parti !
A compter du 12 avril, les Français sont appelés à faire la dernière déclaration dans le cadre de l’ancien système de prélèvement de l’impôt sur le revenu sauf si la retenue à la source est supprimée par le nouveau Président. Les Français devront déclarer leurs revenus de 2016 qui serviront de base au paiement de l’impôt en 2017.
Pour la version papier, la date limite a été fixée au mercredi 17 mai. Néanmoins, les contribuables dont le revenu fiscal de référence a été supérieur à 28.000 euros pour l’année 2015 et dont domicile est connecté à Internet doivent déclarer en ligne.
2 millions contribuables supplémentaires sont concernés par cette obligation. L’an prochain, ce seuil sera de nouveau réduit et l’obligation étendue aux foyers dont le revenu de référence est supérieur à 15 000 euros. L’année suivante, le dispositif devrait concerner l’ensemble des imposables.
Les dates d’envoi limites pour les déclarations par Internet sont
- jusqu’au 23 mai minuit pour les départements compris entre 1 et 19 et les non-résidents,
- jusqu’au 30 mai pour les départements entre 20 et 49 (Corse comprise)
- jusqu’au 6 juin pour les départements 50 à 974/976.
Passées ces dates, les retardataires s’acquiteront, comme chaque année, d’une majoration de 10%. Pour rappel, la date limite de paiement du solde de l’impôt sur le revenu est fixé au 15 septembre. Concernant le paiement en ligne, l’échéance s’étend jusqu’au 20 septembre. Si vous constatez une erreur dans votre déclaration ou avez besoin de la retoucher et/ou la corriger, sachez que vous pourrez le faire à partir du 1er août.
Pour déclarer en ligne sur impôt.gouv.fr, soit vous disposez déjà d’un compte auprès de l’administration fiscal et il suffit pour atteindre son espace privé de mentionner son numéro fiscal et son mot de passe, soit vous ne disposez pas de compte et vous devez vous en constituer un en indiquant votre numéro fiscal, votre numéro d’accès en ligne qui figurent sur la première page de votre déclaration papier et votre revenu de référence tel qu’il est mentionné sur votre dernier avis d’imposition reçu.
Les contribuables bénéficient de la déclaration pré-rempli. Les revenus communiqués par les employeurs et les autres « tiers déclarants » (Pôle emploi, la sécurité sociale et autres organismes sociaux) sont mentionnés sur la déclaration par l’administration. Cela concerne les salaires, les allocations chômage, les pensions et les autres revenus de placement. Il faut simplement vérifier que les informations saisies par le fisc sont correctes . Il faut en revanche intégrer les revenus imposables de certaines personnes à charge du contribuable comme les enfants. Il faut également indiquer certaines charges déductibles comme les frais réels, les pensions alimentaires,, les réductions et crédits qui n’auraient pas été préremplies.
Le cotribuable devra également le cas échéant remplir les déclarations annexes (Cerfa 2044 pour les revenus fonciers, 2074 pour les plus-values immobilières, 2042 QE pour le CITE, etc.) qui sont disponibles sur le service de déclaration en ligne.
Le Plan d’Epargne Retraite Entreprise (article 83) en petite hausse en 2016
selon la Fédération Française de l’assurance, en 2016, les cotisations des Plans d’Epargne Retraite Entreprises (nom du dispositif article 83) ont enregistré une hausse de 6 % et se sont élevées à 2,4 milliards d’euros, dont 163 millions d’euros de versements volontaires (+11 %).
L’encours des PER Entreprises s’élève à 54,3 milliards d’euros, en croissance de 4 %.
Les prestations ont atteint 2,1 milliards d’euros, en progression de 9 %. De ce fait, la collecte nette s’établit à 300 millions d’euros sur l’année 2016.
À fin décembre 2016², les PER Entreprises couvrent 4,1 millions d’assurés, enregistrant une progression de 3 % sur un an.

Une croissance très moyenne prévue en 2017 par la Banque de France
Pour 2017, la Banque de France prévoit une croissance de 1,3 %, de 1,4 % en 2018 et de 1,5 % en 2019. Elle a légèrement revu à la baisse ses prévisions pour le premier trimestre du recul de la production industrielle en janvier ou février. Elle a ainsi révision à 0,3 % la croissance du premier trimestre contre 0,4 % initialement. La Banque de France ne semble pas s’enivrer des bons indicateurs de confiance publiés ces dernières semaines. Certes, sa révision du premier trimestre n’a pas d’incidence sur celle de l’année 2017. Cette dernière reste néanmoins inférieure de 0,2 point à la prévision du Gouvernement (1,5 % qui est considérée de la part de nombreux spécialistes très optimiste)/
Pour l’inflation, la Banque de France a retenu un taux de 1,2 % en 2017, de 1,4 % en 2018 et de 1,5 % en 2019. Pour la prévision hors énergie et alimentation, les prévisions d’inflation sont de 0,8 % pour 2017, de 1,1 % en 2018 et de 1,3 % en 2019.
Les crédits aux entreprises ont toujours le vent en poupe
À fin février 2017, les crédits mobilisés par les entreprises s’élevaient, selon la Banque de France, à 897,5 milliards d’euros, en augmentation de 3,9 % sur un an. Cette progression concerne toutes les catégories d’entreprises : +2,8 % pour les PME, +2,3 % pour les ETI et +5,5 % pour les grandes entreprises.
L’augmentation de l’encours des crédits mobilisés concerne la majorité des secteurs de l’économie. Elle s’élève sur un an à 6,1 % dans les activités de soutien aux entreprises, à 3,7 % dans l’industrie, à 3,1 % dans l’hébergement et restauration. En revanche, l’encours des crédits mobilisés recule de 2,2 % dans le secteur de la construction.
Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux d’un montant unitaire inférieur à 1 million d’euros est quasi stable (1,68 % en février, après 1,69 % en janvier).
La production industrielle rechute
Sur un an, la production manufacturière en recul de 0,5 %, ce qui contraste avec les bons indicateurs de confiance publiés ces dernières semaines.
La production baisse depuis trois mois. février marque, en effet, selon l’INSEE, le troisième mois consécutif de recul de l’industrie manufacturière (−0,6 % après −0,9 % en janvier). Pour l’ensemble de la production industrielle, la chute est plus sévère (−1,6 % après −0,2 %).
Au cours des trois derniers mois, la production baisse légèrement dans l’industrie manufacturière (−0,3 % par rapport aux trois mois précédents) ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (−0,2 %).
Sur cette période, la production décroît dans les industries agroalimentaires (−1,0 %) et dans les biens d’équipement (−0,8 %). Elle diminue fortement dans la cokéfaction et raffinage (−7,0 %). En revanche, elle augmente légèrement dans les matériels de transport (+0,4 %). Elle est stable dans les « autres industries » ainsi que dans les industries extractives, énergie, eau.
Dans l’industrie manufacturière, la production des trois derniers mois diminue par rapport aux trois mêmes mois un an plus tôt (−0,5 %). Elle est stable dans l’ensemble de l’industrie.
Sur cette période, la production baisse dans les « autres industries » (−1,0 %) et dans les industries agroalimentaires (−1,9 %). En revanche, elle croît fortement dans les industries extractives, énergie, eau (+3,5 %) et dans les matériels de transport (+2,3 %). Elle augmente légèrement dans les biens d’équipement (+0,3 %) et nettement dans la cokéfaction et raffinage (+1,4 %).
Indices mensuels de la production industrielle
- Légende : CZ : industrie manufacturière - (C1) : industries agro-alimentaires - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries
- Sources : Insee, SSP, SOeS
Les actifs des compagnies d’assurance de la zone euro dépassent 7 800 milliards d’euros
Au quatrième trimestre 2016, selon la Banque de France, le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro s’élève à 7 768 milliards d’euros, après 7 878 milliards au trimestre précédent
Sur la même période, le total des actifs des fonds de pension de la zone euro a était de 2 422 milliards d’euros, après 2 462 milliards au trimestre précédent
S’agissant de la ventilation de l’actif du bilan agrégé des sociétés d’assurance de la zone euro, les avoirs en titres de créance représentaient, à fin décembre 2016, 44 % du total des actifs de ce secteur. Les parts de fonds d’investissement constituaient le deuxième poste le plus important (24 %), suivies des actions (10 %) et des prêts (8 %).
Au quatrième trimestre 2016, le total des provisions techniques d’assurance des sociétés d’assurance représentait 5 891 milliards d’euros, dont 91 % pour l’assurance vie.
Les prix de l’immobilier profite des taux bas
L’INSEE a publié le 3 avril 2017 l’évolution des prix de l’immobilier. Il en ressort qu’au quatrième trimestre 2016, les prix des logements anciens ont augmenté de +0,7 % par rapport au trimestre précédent (données provisoires corrigées des variations saisonnières). Ce trimestre, la hausse est surtout due aux prix des appartements (+0,9 %). Les prix des maisons s’accroissent plus modérément (+0,5 %).
Sur un an, la hausse des prix se confirme : +1,8 % par rapport au quatrième trimestre 2015, après +1,3 % au trimestre précédent. Cette hausse est quasiment de même ampleur pour les appartements (+1,9 %) et pour les maisons (+1,7 %).
C’est l’Ile de France qui continue à porter le marché. Au quatrième trimestre 2016, les prix des logements anciens en Île-de-France augmentent de nouveau : +0,9 % par rapport au troisième trimestre, après +0,7 %. Ainsi, sur un an, la hausse des prix s’amplifie encore : +3,1 % par rapport au quatrième trimestre 2015, après +2,0 % et +1,5 %. Dans la région francilienne, cette hausse est principalement tirée par les prix des appartements (+3,5 %), notamment des appartements parisiens, qui augmentent de 4,4 % en un an. Les prix des maisons en Île-de-France augmentent également, mais de façon moins marquée (+2,3 % sur l’année).
En province, la hausse des prix des logements anciens est modérée avec un gain de 0,6 % entre le troisième et le quatrième trimestre 2016. Ils restent plus élevés qu’un an auparavant (+1,3 %). Contrairement à la région francilienne, la hausse est surtout tirée par les prix des maisons, qui s’élèvent de 1,6 % entre fin 2015 et fin 2016 ; ceux des appartements augmentent de 0,6 %.
Variation des prix des logements anciens en France métropolitaine sur un an
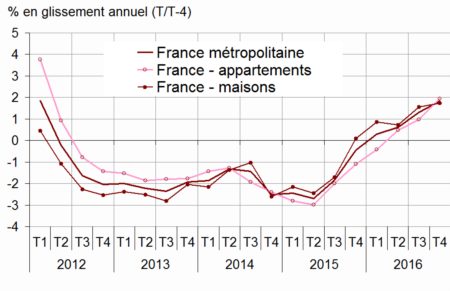
Indices des prix des logements anciens en Île-de-France
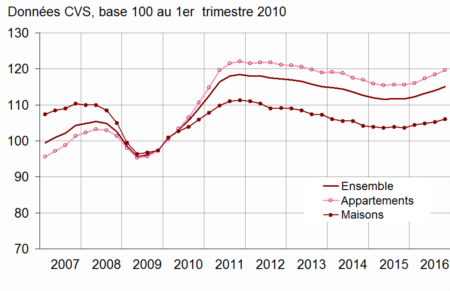
Les taux de l’usure et les taux moyens constatés au cours du dernier trimestre
Chaque trimestre, la Banque de France calcule les taux effectifs moyens pratiqués des différentes catégories de prêts pour lesquelles sont calculés les seuils de l’usure. Ces taux, augmentés d’un tiers, établissent les seuils de l’usure correspondants.
Les seuils de l’usure sont publiés sous la forme d’un avis au JO à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant. Le 29 mars dernier ont été publiés par avis au Journal officiel les taux applicables depuis le 1er avril 2017 et qui resteront en vigueur jusqu’au 30 juin 2017.
| Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2017 |
||
| Contrat de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||||
| – prêts d’un montant inférieur ou égal à 3000 euros (1): | 15,20% | 20,27% | ||
| – prêts d’un montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros (1): : | 10,00% | 13,33% | ||
| – prêts d’un montant supérieur à 6000 euros (1): : | 4,94% | 6,59% | ||
| Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1eravril 2017 |
||
| Contrats de crédit consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||||
| – prêts à taux fixe (3) : | ||||
|
2,47% | 3,29% | ||
|
2,36% | 3,15% | ||
|
2,40% | 3,20% | ||
| – prêts à taux variable : |
2,06 % |
2,75 % |
||
| – prêts-relais |
2,44 % |
3,25 % |
||
| Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1eravril 2017 |
||
| Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
| – découverts en compte : | 10,16% | 13,55% | ||
| Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1eravril 2017 |
||
| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
| – prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament : | 4,55% | 6,07% | ||
| – prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable : | 1,82% | 2,43% | ||
| – prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe : | 1,91% | 2,55% | ||
| – découverts en compte : | 10,16% | 13,55% | ||
| -autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans: | 1,76% | 2,35% | ||
- pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
- incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit
- ’s’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité: moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus
Un beau premier trimestre pour la bourse de Paris
Avec les bons indices qui se succèdent, les marchés financiers veulent croire à l’accélération de la croissance. A l’exception de Londres qui avaient fortement augmenté au second semestre et qui commence à pâtir du Brexit, les autres places financières ont connu une forte croissance au cours du 1er trimestre. Le CAC 40 a gagné 5,35 % en trois mois et même 5,72 % pour le seul mois de mars. La place de Paris fait néanmoins moins bien que Francfort.
| Résultats mensuel et trimestriels | |
| CAC
Évolution en mars Evolution depuis le 1er janvier |
+5,72 % +5,35 % |
| DAXX
Évolution en mars Evolution depuis le 1er janvier |
+4,15 %
+7,25 %
|
| Footsie
Évolution en mars Evolution depuis le 1er janvier |
+0,96 %
+2,52 % |
| Euro Stoxx
Évolution en mars Evolution depuis le 1er janvier |
+ 5,79 % + 6,39 % |
| Dow Jones
Evolution en mars Evolution depuis le 1er janvier |
-0,84 % +4,56 % |
| Nasdaq
Evolution en mars Evolution depuis le 1er janvier |
+0,85 % +9,82 % |
Cette progression fait fi de la montée des incertitudes politiques. Aux Pays-Bas, la victoire aux Pays-Bas du Parti populaire libéral et démocrate du premier ministre, Mark Rutte aux élections législatives au détriment du candidat populiste Geert Wilders a contribué à rassurer les investisseurs sur la pérennité de l’Union Européenne, et cela malgré le déclenchement officiel du Brexit le 29 mars dernier. Pour autant, un certain nombre de dangers rodent. L’échec de l’abrogation de l’Obama care du fait de l’absence de majorité au Congrès peut être considéré comme un point positif mais il est le signe d’un pays divisé et de plus en plus ingouvernable. Les échéances électorales françaises sont également un sujet de préoccupation. Il est à souligner que, depuis plusieurs mois, le poids des non-résidents sur le marché français tend à se réduire, ce qui limite d’autant les à-coups en fonction des résultats des sondages.
Au mois de mars, la bourse de New York qui avait fortement progressé en janvier et février a connu une expansion plus mesurée influencée par les premiers déboires de Donald Trump.
L’inflation aurait-elle fait long feu ?
Après avoir crié à la désinflation, certains ont craint le retour de l’inflation. Si une notable accélération des prix a été constatée depuis la fin de l’année dernière, cela était avant tout la conséquence d’une augmentation des prix de l’énergie. Il suffit que la hausse du baril s’arrête et que l’effet base ne joue plus (les prix étaient au plus bas il y a un an quand le baril du pétrole était à 27 dollars rendant la hausse d’autant plus visible) pour que nous retrouvions des taux d’inflations plus modestes. Au sein de l’Union européenne, l’indice des prix en base annuelle est revenu de 1,8 à 1,5 % du mois de février à celui de mars
La rémunération des dépôts bancaires toujours orientée à la baisse
| févr-16 (f) | déc-16 (f) | janv-17(e) | févr-17 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
| Ménages | 1,06 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| dont : – dépôts à vue | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,58 | 1,28 | 1,26 | 1,29 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,49 | 2,11 | 2,08 | 2,06 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,54 | 0,34 | 0,32 | 0,31 |
| – plan d’épargne-logement | 2,73 | 2,74 | 2,73 | 2,72 |
| SNF | 0,65 | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
| dont : – dépôts à vue | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,84 | 0,50 | 0,46 | 0,47 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,14 | 1,86 | 1,83 | 1,79 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,18 | -0,32 | -0,33 | -0,33 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,13 | -0,20 | -0,13 | 0,01 |
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.
François Héran publie « Avec l’immigration » Editions La découverte
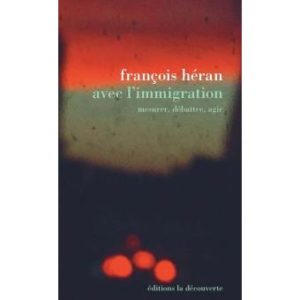 François Héran, membre du Conseil scientifique du Cercle de l’Epargne, ancien directeur de l’Institut national d’études démographique vient de publier un livre sur un sujet éminemment d’actualité, l’immigration. L’auteur en s’appuyant sur de nombreuses données et sans dramaturgie analyse les évolutions de l’immigration en France. Il démonte les propositions, les arguments et surtout les postures des différents candidats à l’élection présidentielle.
François Héran, membre du Conseil scientifique du Cercle de l’Epargne, ancien directeur de l’Institut national d’études démographique vient de publier un livre sur un sujet éminemment d’actualité, l’immigration. L’auteur en s’appuyant sur de nombreuses données et sans dramaturgie analyse les évolutions de l’immigration en France. Il démonte les propositions, les arguments et surtout les postures des différents candidats à l’élection présidentielle.
François Héran rappelle que le nombre d’immigrés arrivant en France est assez stable, autour de 200 000 sachant q’avec les sorties, le solde migratoire n’est que de 100 000 en moyenne. L’immigration est responsable d’une augmentation de 0,3 % de la population. Il indique que la différence c’est qu’au fil des années les arrivants se concentrent essentiellement en ïle-de-France où résident 38 % des populations immigrées. Par ailleurs, « la part des origines européennes au sein des immigrés a décru de 66 % à 37 % entre 1975 et 2012 », au profit notamment des Subsahariens.
François Héran juge impossible de réduire à 10 000 le solde migratoire. il s’agit à ses yeux d’une « promesse hors sol ». Il faudrait remettre en cause certains principes du droit protégés par la Constitution ou par la Convention internationale des droits de l’enfant…
François Héran souligne le rôle positif de l’immigration dans la croissance démographique. Sans sa présence, le pays risquerait de connaître un processus de vieillissement accéléré.
Les véritables sujets qui mériteraient d’être abordés à l’occasion d’une élection présidentielle seraient ceux concernant l’intégration, la répartition, l’emploi ou l’éducation.
Le chiffre d’affaires des services est en hausse de 1,1 % en janvier
Selon l’INSEE, au mois de janvier, la production des services a progressé de 1,1 % contre une baisse de 0,2 % en décembre. Sur les trois derniers mois, la hausse atteint 1,5 % par rapport aux trois mois précédents. Elle augmente fortement dans les activités immobilières (+4,3 %). Elle croît aussi dans les activités de soutien aux entreprises (+1,2 %), en particulier dans les activités de services administratifs et de soutien (+1,9 %). En revanche, elle se contracte légèrement dans l’information et la communication (−0,2 %).
Sur un an, la production dans les services des trois derniers mois augmente nettement sur un an (+3,5 %). Sur cette période, elle augmente dans l’ensemble des secteurs. Elle croît vivement dans les activités de soutien aux entreprises (+4,0 %), notamment grâce au dynamisme des activités de services administratifs et de soutien (+6,3 %). Elle augmente nettement dans les activités immobilières (+3,8 %), l’information et la communication (+2,7 %), le transport et entreposage (+2,9 %), les services aux ménages (+4,9 %) et l’hébergement et la restauration (+2,7 %).
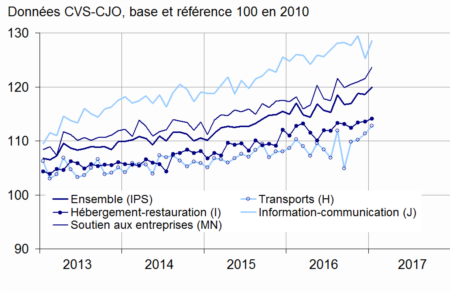
- Source : Insee
Fort Recul en janvier de la production manufacturière mais hausse sur un an
Selon l’INSEE, l’industrie manufacturière a connu un creux en janvier avec un repli de 3,3 % après +1,3 % en décembre. C’est l’exportation qui a pesé sur les résultats de l’industrie, -9,1 % après des ventes exceptionnelles en décembre (+7,8 %). Dans l’ensemble de l’industrie, le chiffre d’affaires se contracte également (−2,9 % après +1,2 %). Ce résultat était attendu du fait des faibles exportations d’avion en janvier.
Au cours des trois derniers mois, le chiffre d’affaires augmente nettement dans l’industrie manufacturière (+2,1 %) ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (+2,4 %). Il croît dans la plupart des grands secteurs de l’industrie manufacturière : les « autres industries » (+1,8 %), les matériels de transport (+4,2 %), la cokéfaction et raffinage (+6,7 %), les biens d’équipement (+2,0 %). Il est stable dans les industries agro-alimentaires.
Le chiffre d’affaires des trois derniers mois croît nettement sur un an dans l’industrie manufacturière (+3,6 %). La croissance est encore plus vive dans l’ensemble de l’industrie (+4,6 %), portée par un bond des industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution (+9,3 %). Sur un an, le chiffre d’affaires augmente dans tous les grands secteurs de l’industrie manufacturière : les matériels de transport (+10,1 %), les « autres industries » (+1,8 %), la cokéfaction et raffinage (+11,2 %), les industries agro-alimentaires (+1,7 %) et les biens d’équipement (+2,6 %).
Le chiffre d’affaires dans l’industrie manufacturière par secteur
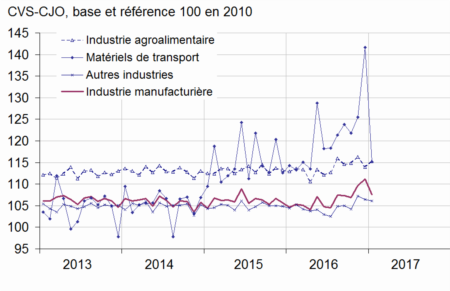
La consommation déçoit en février
Selon l’INSEE, en février 2017, les dépenses de consommation des ménages se sont contractées de 0,8 % après avoir connu une hausse de 0,6 % en janvier. Cette baisse est imputable avant tout à la réduction des dépenses en énergie.. Les dépenses alimentaires et les achats de biens fabriqués sont en hausse mais n’ont pas pu empêcher la contraction de la consommation totale.
La consommation totale de biens
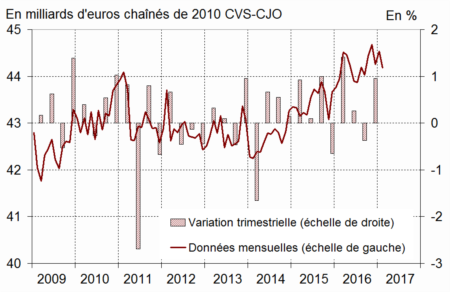
La consommation d’énergie a connu une contraction des achats de la part des ménages de près de 11 %(−10,9 % après +5,1 %), Ce repli s’explique par les températures clémentes de février qui a été le mois plus chaud depuis 2007 succédant à un mois de janvier marqué par un période de grand froid. ce dernier a été le plus froid depuis 2010.
L’inflation en pente douce
Avec l’arrêt de la hausse des prix pétroliers, la progression des prix se ralentit. Au mois de mars, sur un an, les prix à la consommation ralentiraient de nouveau légèrement avec une hausse de 1,1 % contre 1,2 % en février et 1,3 % en janvier selon l’INSEE.
Sur un mois, les prix à la consommation sont orientés à la hausse avec un gain de 0,6 % après +0,1 % le mois précédent. Cette hausse plus marquée proviendrait d’un rebond du prix des produits manufacturés après la fin des soldes d’hiver et d’une nouvelle hausse des prix du tabac. En revanche, les prix de l’alimentation se replieraient du fait des produits frais. De même, les prix de l’énergie reculeraient du fait d’un repli des prix des produits pétroliers. Enfin, les prix des services ralentiraient.
Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 1,4 %, comme le mois précédent. Sur un mois, il accélèrerait nettement à +0,7 % après +0,2 % en février.
L’assurance-vie passée au crible !
La Fédération Française de l’Assurance a publié ce jeudi 30 mars une étude poussée sur l’assurance-vie. Cette étude aborde des sujets comme les motivations des épargnants, leur appétence aux actions, à la prise de risque, la fiscalité.
La FFA souligne qu’en France 54 millions de contrats ont été suscrit et que 37 millions de bénéficiaires sont décomptés. L’encours de 1 l’assurance-vie est de 632 milliards d’euros faisant de ce produit le premier placement financier des Français.
Selon l’étude FFA – Ipsos, 56 % des Français ont épargné durant les six derniers mois. Ce ratio est de 46 % pour ceux gagnant moins de 2000 euros et de 69 % pour ceux gagnant plus de 4000 euros. Par ailleurs 61 % des Français ont l’intention d’épargner durant les 6 prochains mois. Les Français considèrent qu’en matière d’épargne, la priorité, c’est la sécurité (41 %) devant la disponibilité (31 %) et le rendement (16 %). 72 % des Français recherchent le zéro risque en terme de placement. 26 % sont prêts à prendre une légère prise de risque pour avoir un même rendement. Parmi les détenteurs de l’assurance-vie, ce taux monte à 32 %.
Le focus sur l’assurance-vie
L’assurance vie est détenue dans toutes les classes d’âges (48% des moins de 35 ans, 51% des
35-59 ans et 62% des 60 ans et plus) et dans toutes les catégories de la population (48% des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, 61% des cadres, 53% des professions intermédiaires, 46% des employés, 44% des ouvriers et 61% des retraités).
53 % des Français connaissent les fonds euros et 26 % les unités de compte. Ils sont 14 % à avoir entendu parler de l’euro-croissance.
Avec une durée de détention moyenne supérieure à 11 ans, l’assurance vie permet aux Français de répondre à plusieurs motivations :
- Préparer leur retraite, pour 55% des détenteurs âgés de 35 à 59 ans.
- Aider leurs proches dans l’avenir, pour 55% des moins de 35 ans.
- Faire face à une perte d’autonomie, pour 64% des 60 ans et plus.
74 % des Français ne sont pas intéressés par l’instauration d’un nouveau contrat d’assurance essentiellement investi en actions et bénéficiant d’une fiscalité incitative. Parmi les détenteurs d’assurance-vie, 31 % seraient susceptibles de souscrire à un tel produit.
Les Français sont opposés à une remise en cause de la fiscalité de l’assurance-vie. 66% déclarent qu’ils se détourneraient alors de leurs contrats. Une réforme qui consisterait à aligner le taux d’imposition de l’assurance vie sur celui des autres produits d’épargne (Flat tax) est perçue comme une « mauvaise chose » par 77% des Français. Ce chiffre s’élève à 92% chez les détenteurs de contrats de 8 ans et plus.
Quand la pierre va tout va ou presque ?
En un an, de mars 2016 à février 2017, 463 400 logements ont été autorisés à la construction (en données brutes cumulées sur douze mois), soit une augmentation de 14,4 % par rapport au cumul des douze mois précédents. Sur la même période, 387 000 logements ont été mis en chantier, en progression de 13,0 %.
Depuis 2015, les mises en chantier progressent. Depuis l’année dernière, les ménages ont retrouvé le chemin de l’investissement immobilier. Le nombre de permis de construire délivrés l’année dernière s’est élevé à 463.900, soit une hausse de 16 % par rapport à 2015. La construction de logements individuels a progressé de 14,5 % sur un an. La promotion immobilière enregistre de bons résultats avec 119 005 logements mis en vente, soit 16 % de plus qu’en 2015. Cela ne permet pas néanmoins de compenser le point bas atteint en 2014 avec 297 532 logements. Nous étions alors très loin de l’objectif de 500 000 logements que François Hollande s’était fixé.
Calme complet pour la confiance des ménages
Pour le troisième mois consécutif, la confiance des ménages reste, selon l’INSEE, stable avec un indice 100 ce qui est sa moyenne de longue période. Les ménages français face aux échéances électorales sont en mode attentiste. Les craintes ne gagne pas de terrain mais pas d’euphorie non plus. Cette prudence se traduit par une diminution des intentions à réaliser des gros achats. Par ailleurs, une dégradation sur les capacités financières futures est constatée. Le calme avant la tempête ou avant la reprise….
Indicateur synthétique de confiance des ménages
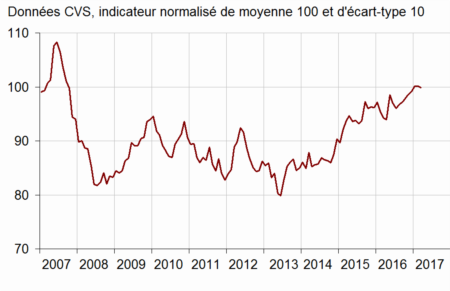
En mars, l’opinion des ménages sur leur situation financière future se détériore un peu. Le solde correspondant perd 2 points et se situe en deçà de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages sur leur situation financière personnelle passée est quasi stable (+1 point), à son niveau moyen de long terme.
En mars, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants baisse nettement (−6 points), après une progression de 4 points en février. Le solde correspondant demeure cependant bien supérieur à sa moyenne de longue période.
En mars, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne varie peu : le solde sur leur capacité actuelles’améliore d’un point et celui sur leur capacité future en perd un. Les deux soldes se situent au-dessus de leur moyenne de long terme.
Les ménages estimant qu’il est opportun d’épargner sont un peu plus nombreux : le solde correspondant gagne 2 points. Bien que celui-ci augmente depuis trois mois, il reste bien inférieur à son niveau moyen de longue période.
Soldes d’opinion sur la situation financière personnelle et le niveau de vie en France
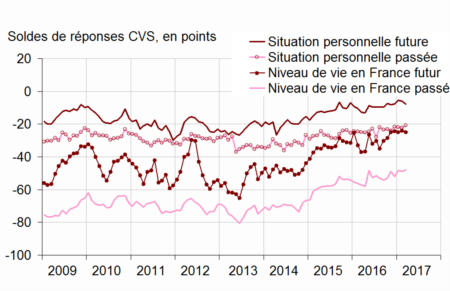
Les craintes des ménages sur le chômage sont quasiment inchangées (+1 point en mars). Le solde correspondant est bien inférieur à sa moyenne de long terme depuis novembre 2016.
En mars, les ménages sont plus nombreux qu’en février à anticiper que les prix augmenteront au cours des douze prochains mois : le solde correspondant gagne 4 points et s’écarte à nouveau de son niveau moyen de long terme.
Les ménages sont aussi nombreux qu’en février à estimer que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois. Le solde correspondant demeure inférieur à sa moyenne de longue période depuis février 2014.
Opinion des ménages sur le chômage
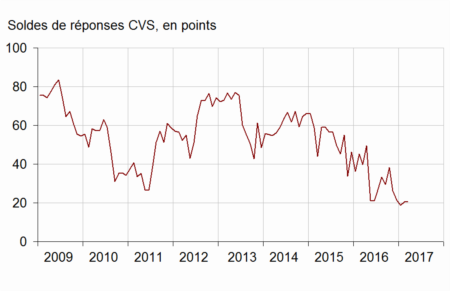
Opinion des ménages sur les prix
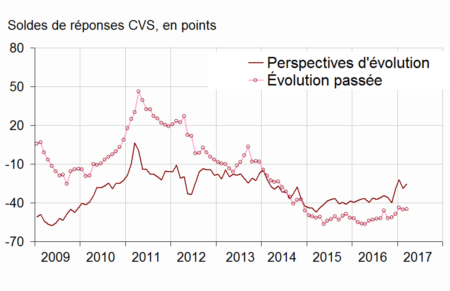
Les femmes accouchent de leur premier enfant de plus en plus tard !
Selon l’INSEE, en France, l’âge moyen des mères à la naissance de leur premier enfant s’élève à 28,5 ans en 2015. En 1974, cet âge était de 24,0 ans en moyenne, soit 4,5 ans plus tôt. Entre 1910 et 1974, l’âge moyen à la première maternité était passé de 25,0 ans à 24,0 ans. À cette lente diminution a succédé un accroissement rapide : l’âge moyen au premier accouchement a atteint 27,3 ans en 1998. En un quart de siècle (entre 1974 et 1998), les femmes ont donc reporté leur première maternité de 3,3 ans, soit une hausse de deux mois en moyenne chaque année. Cette évolution est imputable à la montée du taux d’emploi des femmes et à la généralisation de la contraception. Par ailleurs, la stabilisation de la vie professionnelle et sentimentale intervient plus tardivement en raison notamment de l’allongement des études. La crise économique aurait peu d’incidence sur l’arrivée du premier enfant. En revanche, il y a une volonté des jeunes de pouvoir vivre sans contrainte un peu plus longtemps aujourd’hui que dans le passé.
Tous rangs de naissance confondus, les femmes accouchent en moyenne à 30,4 ans en 2015. Cet âge suit globalement les mêmes tendances que l’âge à la première maternité : il a baissé jusqu’au milieu des années 1970 avant d’augmenter, d’abord fortement, puis à un rythme plus modéré. La diminution du début du XXe siècle jusqu’au milieu des années 1970 s’explique principalement par la raréfaction des familles nombreuses, qui rend les naissances aux âges maternels avancés moins fréquentes. Elle est aussi due à la baisse de l’âge moyen à la maternité à chaque rang de naissance. Ainsi, l’âge moyen à l’accouchement passe de 29,2 ans en 1910 à 26,8 ans en 1974 (– 2,4 ans). Cette diminution est donc bien plus forte que celle observée pour l’âge au premier enfant sur la même période (– 1 an).
L’encours du PERCO atteint 14 milliards d’euros
Selon l’Association Française de Gestion, l’encours des PERCO a atteint, en 2016 14 milliards € d’encours (+13% sur un an). 2,2 millions de personnes disposent d’un PERCO (+9% en un an); 213.000 entreprises sont équipées (+5%).
A fin 2016, 39% des salariés sont en gestion pilotée sur leur PERCO. Le nombre de salariés en gestion pilotée a fortement progressé (+66%) grâce aux nouvelles mesures qui en font l’option par défaut du PERCO. Cette gestion pilotée représente désormais près du 1/3 du total des encours. Le nombre d’entreprises équipées et le nombre de salariés détenteurs d’un PERCO continuent à progresser, avec des taux de croissance de respectivement 5 et 9%. La progression des encours s’explique principalement par le bon niveau des versements nets qui atteignent 1,4 milliards d’euros, équivalents aux flux nets de 2015.
Les versements bruts ont atteint 2,2 milliards d’euros sur un an, soit une légère progression par rapport à 2015, et se répartissent de la façon suivante.
Les marchés actions ont fait le succès de l’épargne salariale en 2016
Selon l’Association Française de Gestion au 31 décembre 2016, les encours d’épargne salariale se sont établis à 122,5 milliards d’euros. Sur un an, la progression a été de 4,3 %. Cette progression est avant tout imputable à la bonne tenue des marchés en fin d’année
Les encours se répartissent entre :
- les fonds d’actionnariat salarié à hauteur de 47,2 milliards d’euros, soit 39 % du total ;
- les fonds « diversifiés » , investis eux-mêmes largement en actions, qui atteignent 75,3 milliards d’euros, soit 61 % du total.
Les fonds ISR représentent près de 24 milliards, en progression de 7% sur un an. Un euro sur trois est donc ISR (hors actionnariat salarié). Les fonds solidaires poursuivent leur progression à 6,2 milliards d’euros, soit + 19% sur un an.
Le nombre de comptes de porteurs d’épargne salariale reste stable à près de 10,2 millions. Le nombre d’entreprises équipées progresse de 3%à 305.000, dont 300.000 PME de moins de 250 salariés souscripteurs d’épargne salariale.
Les flux d’investissement dans les PEE et PERCO ont augmenté de plus de 9%.
Les versements se sont élevés à 13,7 milliards d’euros en 2016 (+1,2 milliards par
rapport à 2015).
Ils se répartissent de la manière suivante :
- 3,5 milliards € au titre de la participation
- 4,6 milliards € au titre de l’intéressement (+21% sur l’année)
- 3 milliards € au titre des versements volontaires des salariés
- 2,6 milliards € au titre de l’abondement des entreprises
Les versements d’intéressement sont supérieurs de près de 800 millions d’euros à ceux de 2015, soit une hausse de 21% grâce notamment aux effets de la loi Macron de 2015.
Selon l’AFG, le montant des rachats s’élève à près de 14 milliards (+8,5%). Le dispositif de rachat anticipé pour l’achat de la résidence principale a concerné près de 144.000 foyers en leur permettant de
financer leur projet à hauteur de 11.700 euros en moyenne.
Au total, la collecte nette présente un solde légèrement négatif de 300 millions d’euros, comparable à 2015.
Le chômage en mode poussif
Depuis le début de l’année et malgré les bons indicateurs économiques, le chômage fait, en France, du surplace. Le nombre d’inscrits en catégorie A (sans aucune activité) a diminué, pour l’ensemble de la France, au mois de février, de 2 600 pour atteindre 3,7 millions de personnes. Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi a progressé de 0,2 % m ais enregistre une baisse de 3,1 % sur un an. Pour la France métropolitaine, le chômage a diminué de 0,1 % (-3 500 personnes). Le nombre de demandeurs d’emploi s’établit à 3,464 millions. Il est en hausse de 0,2 % sur trois mois mais baisse de 3,2 % sur un an.
Comme les mois précédents, le chômage diminue chez les jeunes et ceux âgés de 25 à 49 ans mais il continue d’augmenter chez les plus de 50 ans (+1,3 % sur trois mois).
Le taux de marge des entreprises en légère progression en 2016
La compétitivité des entreprises françaises ne se sont pas améliorées à la fin de l’année dernière. Au quatrième trimestre 2016, le taux de marge des sociétés non financières (SNF) est resté quasi stable, à 31,5 % (après 31,6 %). Les salaires réels augmentent légèrement plus vite que les gains de productivité tandis que la prime à l’embauche dans les PME monte en charge.
En moyenne sur l’année, le taux de marge des SNF augmente de 0,3 point, à 31,7 % en 2016. L’amélioration des termes de l’échange due à la baisse des prix de l’énergie ainsi que les baisses de cotisations sociales le soutiennent. À l’inverse, les salaires réels augmentent plus que la productivité, limitant sa progression.
Étiolement des gains de pouvoir d’achat en fin de l’année dernière
En raison des impôts, le revenu disponible brut (RDB) des ménages ralentit au quatrième trimestre 2016 (+0,4 % après +0,7 %), L’impôt sur le revenu repart à la hausse (+1,3 %) après s’être replié au troisième trimestre (–1,1 %) avec l’aménagement du barème de l’impôt pour soutenir le revenu des ménages modestes. Les prestations sociales en espèces se sont ralenties en fin d’année (+0,3 % après +0,5 %), la montée en charge de la prime d’activité arrivant progressivement à terme. Les cotisations sociales à la charge des ménages augmentent quasiment comme au troisième trimestre (+0,7 % après +0,6 %).
À l’inverse, les revenus d’activité sont un peu plus dynamiques : la masse salariale accélère ce trimestre (+0,7 % après +0,5 %), du fait de l’emploi et du salaire moyen par tête.
Les prix de la consommation des ménages augmentent légèrement plus vite au quatrième trimestre (+0,3 % après +0,1 %), de sorte que le pouvoir d’achat ralentit plus nettement que le RDB (+0,1 % après +0,6 %). La hausse des prix de l’énergie a commencé à se faire sentir. Cependant, sur l’ensemble de l’année, il accélère (+1,9 % après +1,6 % en 2015). Mesuré par unité de consommation pour le ramener à un niveau individuel, il croît de 1,4 % en 2016, après +1,2 % en 2015.
Comme la consommation des ménages est plus dynamique que leur pouvoir d’achat, leur taux d’épargne diminue au quatrième trimestre : il s’établit à 14,5 % de leur revenu, après 14,9 % au troisième trimestre. En moyenne sur l’année, il est stable à 14,5 %.
Le PIB et ses composantes en volumes chaînés
| 2016 T1 | 2016 T2 | 2016 T3 | 2016 T4 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB | 0,6 | −0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,1 |
| Importations | 0,4 | −1,4 | 2,7 | 0,9 | 6,4 | 3,6 |
| Dép. conso. ménages | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 1,8 |
| Dép. conso. APU* | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
| FBCF totale | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2,8 |
| dont ENF** | 2,1 | −0,1 | −0,1 | 0,8 | 2,7 | 4,0 |
| dont ménages | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | −0,8 | 2,1 |
| dont APU* | −0,9 | −0,6 | 0,3 | −1,1 | −3,9 | −0,7 |
| Exportations | −0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 6,0 | 1,2 |
| Contributions : | ||||||
| Demande intérieure finale hors stocks | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 1,9 |
| Variations de stocks | −0,3 | −0,7 | 0,7 | −0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Commerce extérieur | −0,1 | 0,4 | −0,6 | 0,1 | −0,3 | −0,8 |
- *APU : administrations publiques
- **ENF : entreprises non financières
- Source : Insee
Le taux d’épargne des ménages en 2016 : 14,5 % du revenu disponible brut
Le taux d’épargne des ménages français a été de 14,5 % du revenu disponible brut en 2016 selon l’INSEE soit au même niveau qu’en 2015. le taux d’épargne financière a été de 5,4 % en légère hausse.
Revenu disponible brut et ratios des comptes des ménages
| 2016 T1 | 2016 T2 | 2016 T3 | 2016 T4 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDB | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 1,9 |
| RDB (pouvoir d’achat) | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,9 |
| RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 1,4 |
| RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,8 |
| Taux d’épargne (niveau) | 14,3 | 14,4 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Taux d’épargne financière (niveau) | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
- * uc : unité de consommation
- Source : Insee
Bilan 2016 : déficit 3,4 % du PIB, dépenses publiques 56,2 % et prélèvements obligatoires 44,3 %, dette publique 96 % du PIB
C’est officiel le déficit public pour 2016 s’est élevé à –75,9 milliards d’euros, soit −3,4 % du produit intérieur brut (PIB) contre −3,6 % en 2015.
La réduction de 0,2 point est relativement faible. le déficit 2016 est supérieur aux prévisions. Le Gouvernement avait prévu un déficit de 3,3 % du PIB Il aurait du être de 3,3 % du PIB ; le Gouvernement a espéré un temps qu’il puisse tomber à 3,2 %. Le niveau atteint en 2016 rend plus difficile le franchissement de la marche de 2017. Cette année, le déficit prévu est de 2,7 % du PIB ce qui apparaît, surtout en année électorale, très difficile à atteindre.
En part de PIB, les recettes passent de 53,1 % à 52,8 %. Le poids des dépenses dans le PIB baisse de 0,5 point (de 56,7 % à 56,2 %). Le taux de prélèvements obligatoires diminue de 0,1 point et s’établit à 44,3 % du PIB.
Ratios de finances publiques
| (en % du PIB) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Déficit public | –4,0 | –3,9 | –3,6 | –3,4 |
| Dette publique (brute) | 92,3 | 94,9 | 95,6 | 96,0 |
| Dette publique nette* | 83,5 | 86,1 | 86,9 | 87,5 |
| Recettes publiques | 52,9 | 53,2 | 53,1 | 52,8 |
| Dépenses publiques | 57,0 | 57,1 | 56,7 | 56,2 |
| Prélèvement obligatoires | 44,8 | 44,6 | 44,4 | 44,3 |
| (évolution en %) | ||||
| Dépenses publiques | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
| Dépenses publiques hors charge d’intérêt | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,3 |
| Dépenses publiques hors crédits d’impôt | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
- * La dette publique nette est égale à la dette publique brute moins les dépôts, les crédits et les titres de créance négociables détenus par les administrations publiques sur les autres secteurs.
- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2017.
L’ensemble des dépenses décélère en 2016 : +1,1 % après +1,4 %. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 0,7 % en 2016 (après +1,2 % en 2015). Les consommations intermédiaires ralentissent (+0,2 % après +1,9 %), ainsi que les rémunérations (+0,8 % après +1,0%). La charge d’intérêt de la dette diminue de nouveau nettement (−5,1 % après −4,5 % en 2015) sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt.
Les prestations sociales augmentent de 1,8 %, après +1,6 % en 2015. Les prestations en nature accélèrent (+2,8 % après +1,8 %) du fait notamment des dépenses d’assurance maladie en médicaments et médecine de ville. Les prestations en espèces augmentent de 1,5 %, comme en 2015.
Dépenses et recettes des administrations publiques
| 2015 Md€ | 2016 Md€ | 16/15 (%) | |
|---|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement** | 399,2 | 401,9 | 0,7 |
| dont conso. intermédiaires** | 107,2 | 107,5 | 0,2 |
| dont rémunérations | 281,2 | 283,6 | 0,8 |
| Intérêts** | 48,6 | 46,1 | –5,1 |
| Prestations sociales | 565,9 | 576,2 | 1,8 |
| Autres transferts et subventions | 151,6 | 154,7 | 2,0 |
| Acquisition nette d’actifs non financiers | 78,7 | 78,2 | –0,6 |
| dont investissement | 76,2 | 76,1 | –0,1 |
| Total des dépenses | 1244,0 | 1257,2 | 1,1 |
| Ventes et autres recettes | 88,3 | 88,6 | 0,4 |
| Revenus de la propriété | 15,5 | 15,0 | –3,1 |
| Impôts | 628,7 | 638,9 | 1,6 |
| dont impôts courants sur le revenu et le patrimoine | 274,5 | 276,2 | 0,6 |
| dont impôts sur les produits et la production | 347,5 | 355,6 | 2,3 |
| Cotisations sociales effectives | 369,9 | 375,5 | 1,5 |
| Autres recettes* | 62,9 | 63,3 | 0,6 |
| Total des recettes | 1165,3 | 1181,3 | 1,4 |
| Besoin de financement | –78,7 | –75,9 |
- * Y compris cotisations sociales imputées
- ** Hors correction au titre des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)
- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2017.
Les recettes augmentent de 1,4 % contre +2,0 % en 2015. Les impôts sur le revenu et le patrimoine ralentissent (+0,6 % après +1,3 %). Les prélèvements sociaux y compris la contribution sociale généralisée (CSG) bénéficient d’une masse salariale plus dynamique. En revanche, les prélèvements sociaux sur les revenus de placement diminuent en lien avec la baisse des taux d’intérêt et de faibles rendements de l’assurance-vie. L’impôt sur le revenu des personnes physiques augmente de 0,8 Md€ (après +0,5 Md€ en 2015). L’impôt sur les sociétés diminue de 0,5 Md€ en raison de la suppression en 2016 de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés.
Les impôts sur les produits et la production augmentent de 2,3 % (après +3,1 %). Les rentrées de TVA sont en hausse de 2,5 Md€ (après +3,2 Md€). La taxe intérieure de consommation de produits énergétiques augmente de 1,7 Md€ sous l’effet de la montée en charge de la taxe carbone, les droits de mutation à titre onéreux de 1,0 Md€ et la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1,5 Md€. Inversement, la contribution sociale de solidarité des sociétés diminue de 0,8 Md€ par suite du relèvement progressif de l’abattement de cette taxe.
Les cotisations sociales perçues accélèrent (+1,5 % après +1,0 %) sous l’effet d’une masse salariale plus dynamique en 2016. Les cotisations des ménages augmentent de 2,3 % (après +1,7 %) et les cotisations employeurs de 1,1 % (après +0,6 %). Ces dernières sont cependant affectées par la baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales pour les salaires compris entre 1,6 et 3,5 Smic.
Capacité (+) ou besoin (-) de financement par sous-secteurs
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| État | –69,6 | –74,6 | –71,6 | –74,1 |
| Organismes divers d’administration centrale | 1,4 | 2,6 | –2,2 | –1,9 |
| Adm. publiques locales | –8,3 | –4,6 | –0,1 | 3,0 |
| Adm. de sécurité sociale | –8,8 | –7,8 | –4,7 | –2,9 |
- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2017.
La réduction du besoin de financement des administrations publiques en 2016 provient des administrations publiques locales et dans une moindre mesure des administrations de sécurité sociale. Quasiment à l’équilibre en 2015, les administrations publiques locales enregistrent un excédent de 3,0 Md€ surtout du fait d’un nouveau recul de leur investissement et d’un ralentissement de leurs dépenses de fonctionnement. Le déficit des administrations de sécurité sociale se réduit de 1,8 Md€.
Le déficit de l’État se dégrade de 2,5 Md€ et celui des organismes divers d’administration centrale s’améliore de 0,3 Md€. La budgétisation de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) rehausse fortement les dépenses et les recettes de l’État et abaisse celles des Odac.
Fin 2016, la dette des administrations publiques (dette brute consolidée en valeur nominale) s’élève à 2 147,2 Md€. Elle s’accroît de 49,2 Md€ en 2016, après +60,2 Md€ en 2015. Elle atteint 96,0 % du PIB fin 2016, après 95,6 % fin 2015, soit +0,4 point. La hausse de la dette publique nette est du même ordre : elle s’établit à 87,5 % du PIB, après 86,9 % en 2015.
La dette publique (Maastricht) et la dette nette
| Dette publique | Dette nette | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| Ensemble | 2098,0 | 2147,2 | 1906,6 | 1957,3 |
| dont | ||||
| État | 1661,3 | 1709,9 | 1556,0 | 1607,9 |
| Organismes divers d’administration centrale | 19,6 | 12,7 | 2,7 | –1,4 |
| Adm. publiques locales | 196,7 | 199,6 | 184,7 | 187,4 |
| Adm. de sécurité sociale | 220,4 | 225,0 | 163,2 | 163,4 |
- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2017.
2490 euros, le salaire net moyen dans la fonction publique d’Etat
Selon l’INSEE, in 2015, dans la fonction publique de l’État (FPE), tous statuts confondus (hors militaires) au sein des ministères ou d’établissements publics nationaux, le salaire net moyen en équivalent-temps plein (EQTP) augmente de 0,4 % en euros constants entre 2014 et 2015. Sa hausse est identique en euros courants, l’inflation étant quasi nulle. Il atteint en moyenne 2 490 euros par mois.
Dans la fonction publique territoriale (FPT, hors militaires, assistants maternels et familiaux), le salaire net moyen en EQTP augmente de 0,8 % entre 2014 et 2015, en euros constants comme en euros courants. Il s’élève à 1 890 euros par mois en 2015.
Dans la fonction publique hospitalière (FPH), qui regroupe les personnels des hôpitaux et les établissements médico-sociaux (hors internes et externes des hôpitaux), le salaire net moyen en EQTP croît de 0,6 % en euros constants (+0,7 % en euros courants) entre 2014 et 2015. Il est de 2 240 euros par mois en 2015.
En 2015, les différences d’évolution entre salaire net et salaire brut (environ −0,4 point) s’expliquent notamment par l’augmentation des taux de cotisations salariales de retraite de l’ensemble des agents de la fonction publique (alignement progressif avec les taux du secteur privé). Les écarts de niveaux salariaux entre les trois versants de la fonction publique résultent principalement des différences de structure en termes de catégorie hiérarchique, de statut et de type d’emploi occupé. Ainsi, dans la FPE, près de six agents sur dix appartiennent à la catégorie A, contre trois sur dix dans la FPH et un sur dix dans la FPT. À l’inverse, les trois quarts des agents de la FPT et la moitié de ceux de la FPH sont de catégorie C contre un agent sur cinq dans la FPE.
5,6 millions de personnes travaillent au sein des trois fonctions publique.
L’INSEE a publié une étude sur le nombre de personnes travaillant dans la fonction publique.
Au 31 décembre 2015, il y avait 5,6 millions de salariés travaillant dans la fonction publique en France. Les effectifs sont stables par rapport à 2014 (+ 0,1 %) et ce dans les trois versants de la fonction publique. Avec la hausse du nombre de contrats aidés, l’évolution du volume de travail dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale est plus dynamique que celle de leurs effectifs. Malgré la quasi-stabilité de l’emploi dans la fonction publique de l’État, l’évolution des effectifs est contrastée dans les différents ministères et les établissements publics. Les femmes sont majoritaires dans la fonction publique.
Climat des affaires : petite alerte pour le moment sans gravité
L’INSEE a publié ce jeudi 23 mars son indice sur le climat des affaires. Pour mars, cet indice perd un point ce qui constitue une légère inflexion par rapport aux résultats de ces derniers mois. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité, reste néanmoins quatre points au-dessus de sa moyenne de long terme (100). Il est stable ou quasi stable dans les services, le commerce et le bâtiment. En revanche, Il perd trois points dans l’industrie manufacturière.
Cette inflexion se traduit également par l’entrée en zone d’incertitude conjoncturelle de l’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie.
La campagne présidentielle en cours avec le débat sur l’euro ainsi que la montée de la tentation protectionniste à l’échelle internationale peuvent expliquer ce léger retournement de tendance qui pour le moment reste léger mais qu’il conviendra de surveiller.
Indicateur de climat des affaires France
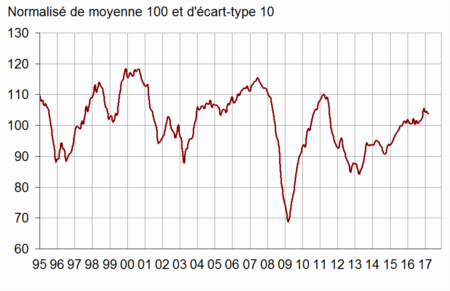
Tableau – Indicateurs du climat des affaires et de retournement France et sectoriels
| Nov. 16 | Déc. 16 | Jan. 17 | Fév. 17 | Mars 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicateurs du climat des affaires | |||||
| France | 102 | 105 | 104 | 105 | 104 |
| Industrie | 102 | 106 | 106 | 107 | 104 |
| Bâtiment | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 |
| Services | 102 | 106 | 102 | 104 | 104 |
| Commerce de détail | 104 | 107 | 106 | 104 | 105 |
| Commerce de gros | 98 | – | 103 | – | 103 |
| Indicateurs de retournement | |||||
| France | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,1 |
| Industrie | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | –0,5 |
| Bâtiment | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| Services | –0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| Commerce de gros | 0,0 | – | 0,9 | – | 0,8 |
- Sources : Insee, enquêtes de conjoncture
Indicateur de retournement France
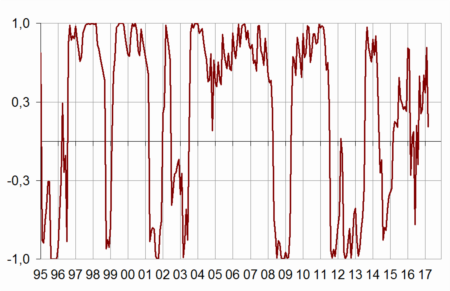
Résultat février 2017 : L’assurance-vie à petit train de sénateur
L’assurance-vie avance à petit train de sénateur
La collecte nette s’est élevée à 600 millions d’euros au mois de février contre 400 millions d’euros au mois de janvier. Ce résultat est néanmoins en retrait par rapport à celui du mois de février 2016 (+2,8 milliards d’euros). Traditionnellement, le mois de février est un bon mois pour l’assurance-vie (collecte nette en moyenne supérieur à 3 milliards d’euros ces dix dernières années).
Les cotisations brutes ont atteint 11,1 milliards d’euros ce qui est au regard des évolutions passées un résultat moyen. Les communications sur le rendement des fonds euros ont certainement dissuadé certains épargnants à placer une partie de leurs disponibilités sur l’assurance-vie. La collecte en unités de compte est, en revanche, en progrès à 3,2 milliards d’euros soit près de 29 %. Il faut remonter au mois de janvier 2008 pour avoir un montant d’UC aussi important.
Les prestations versées sont en léger recul à 10,5 milliards d’euros tout en restant à un niveau assez élevé sur moyenne période. L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 636 milliards d’euros à fin février 2017 en progression de 3 % sur un an).
Ces résultats sont en phase avec ceux de l’enquête annuelle du Cercle de l’Epargne/Amphitéa de 2017 qui montrent que si l’assurance-vie demeure le deuxième placement préféré des ménages après l’immobilier locatif, elle recule légèrement (59 % des sondés, en 2017, jugent ce placement intéressant soit -3 points par rapport à 2016). En revanche, toujours ce même sondage, l’appréciation positive est en forte hausse en ce qui concerne les actions (38 % soit + 9 points).
L’assurance-vie évolue en mode poussif sur fond de modification de sa structure, un peu plus d’unités de compte, un peu moins de fonds euros. La remontée des taux ne devrait pas modifier la donne bien au contraire. Premièrement, les taux demeurent toujours à des niveaux historiquement bas, deuxièmement le léger retour de l’inflation érode les rendements, troisièmement, la remontée des taux rend le pilotage des fonds euros un peu plus complexe et coûteux. Le débat sur la fiscalité de l’assurance-vie lancé par Emmanuel Macron peut conduire, par ailleurs, les épargnants à demeurer prudent et mobile.
Le Livret A confirme et signe son retour en force
Au mois de février dernier, la collecte du Livret A a été positive de 1,4 (1,39) milliard d’euros. Il fallait remonter à février 2013 pour retrouver pour le deuxième mois de l’année un aussi bon résultat. En règle générale, le mois de février est assez mauvais pour le Livret A du fait du paiement du 1er tiers provisionnel et de l’absence de versements de primes.
Cette troisième collecte positive consécutive traduit la volonté des ménages français d’accroître leur poche d’épargne liquide dans un contexte politique incertain. Le sondage du Cercle de l’Epargne/Amphitéa publié le 21 mars confirme que les Français sont plus nombreux en 2017 qu’en 2016 à juger le Livret A intéressant (22 % contre 19 %). En revanche, l’assurance-vie paie tout à la fois la baisse du taux de rendement des fonds euros et le débat sur un durcissement de sa fiscalité lancé par Emmanuel Macron. Malgré son taux de 0,75 %, toujours selon le sondage 2017 du Cercle de l’Epargne, le Livret A est jugé un peu plus attractif financièrement cette année que l’année dernière. Ce résultat peut apparaître d’autant plus surprenant que l’augmentation de l’inflation érode son rendement réel. Les épargnants français semblent avoir accepté bon gré mal gré le faible niveau de rémunération du Livret A.
Le Livret de Développement Durable et solidaire enregistre, au mois de février, également une collecte positive de 520 millions d’euros.
Au niveau de l’encours, les deux produits, Livret A et LDDs totalisent 365,7 milliards d’euros soit un plus haut depuis octobre 2014.
Compte tenu des incertitudes liées aux échéances électorales et de leurs conséquences sur la fiscalité de l’épargne, il est fort probable que e Livret A maintienne un niveau de collecte positive sur moyenne période.
L’enquête 2017 du Cercle de l’Epargne – Amphitéa
LES FRANÇAIS, L’ÉPARGNE, LA RETRAITE EN 2017
Enquête Cercle de l’Épargne -Amphitéa
en collaboration avec AG2R LA MONDIALE*

- La plaquette de présentation de l’Enquête 2017
- Les tableaux de la conférence de presse
- Le Communiqué de presse du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa en version Word
- Le Communiqué de presse du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa en version PDF
- L’infographie de l’Enquête en version Word
- L’infographie de l’Enquête en version PDF
- Les résultats complets de l’Enquête
****
***
À l’occasion de l’édition 2017 de l’enquête du Cercle de l’Épargne / Amphitéa, réalisée en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, les Français se sont exprimés contre tout changement brutal de la fiscalité de l’épargne et du patrimoine tout en se prononçant en faveur de la donation.
Au niveau des placements préférés, la hiérarchie des années précédentes est confirmée avec l’immobilier locatif en tête, suivi de l’assurance-vie. La nouveauté provient de la montée en puissance des actions.
Dans le domaine des retraites, les Français considèrent que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement. S’ils sont opposés à un report de l’âge légal à 65 ans, à l’augmentation des cotisations ou à la diminution des pensions, ils sont, en revanche, favorables, à l’unification des régimes de retraite et au développement de l’épargne retraite.
LES CHIFFRES CLEFS 2017
- 71 % des Français considèrent que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement
- 76 % des Français sont favorables à la donation
- 66 % des Français sont favorables à un prélèvement libératoire de 15 % applicable aux revenus de l’épargne
- 45 % des épargnants jugent les actions intéressantes
LA DÉLICATE RÉFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE
Pour une taxation libératoire de l’épargne mais à un taux faible
Les Français se déclarent à 66 % pour un prélèvement libératoire sur les revenus de l’épargne mais limité à 15 %. Seuls 6 % sont favorables au taux de 30 % proposé par Emmanuel Macron et 28 % sont pour la taxation des revenus du patrimoine au même niveau que ceux du travail ce qui a été, en partie, réalisé par François Hollande.
Contre la modulation de la fiscalité en fonction du risque
La réduction de la fiscalité sur les produits d’épargne risqués, compensée par une augmentation sur les produits non risqués, ne reçoit l’assentiment que de 22 % des sondés (78 % y étant opposés). Les Français tiennent au régime fiscal dont bénéficie l’épargne réglementée (Livret A, LDDs, etc.) et à celui dont bénéficient les fonds euros de l’assurance-vie.
Les Français divisés sur l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
L’ISF, acquitté par moins de 350 000 contribuables, donne toujours lieu à des débats passionnés. Si 56 % des Français estiment qu’il s’agit d’un bon impôt, 44 % pensent qu’il nuit à l’économie et qu’il convient soit de le réduire soit de le supprimer. 24 % se déclarent favorables à son augmentation.
Plus des trois-quarts des Français pour la donation
76 % des Français se déclarent favorables à la donation aux enfants et aux petits enfants. Cette préférence n’est pas sans lien avec le fait qu’avec l’allongement de l’espérance de vie, les ménages héritent de plus en plus tard de leurs parents.
LES ATTITUDES DES FRANÇAIS FACE AUX PRODUITS D’ÉPARGNE : RETOUR EN GRÂCE DES ACTIONS
Le retour en force des actions parmi les placements intéressants
En 2017, les Français considèrent à 68 % que l’immobilier locatif est un placement intéressant (en hausse de 3 points par rapport à 2016). Les taux d’intérêt pratiqués ces derniers mois pour les crédits et la baisse du rendement des autres produits d’épargne expliquent sans nul doute cette évolution. L’immobilier devance toujours l’assurance-vie (59 %) qui est en léger recul (-3 points) certainement en raison de la baisse du rendement des fonds euros et de la polémique, née de l’adoption de la disposition de la loi Sapin II, prévoyant le blocage temporaire des contrats en cas de crise systémique. L’assurance-vie demeure, de loin, le placement financier préféré des Français.
Le fait marquant de l’enquête 2017 est la forte remontée des actions. 38 % des sondés considèrent que ce type de support est intéressant (+ 9 points par rapport à 2016). Les détenteurs de produits financiers plébiscitent à 45 % les actions. Ce taux monte même à 68 % pour ceux qui ont souscrit un Plan d’Épargne en Actions. Cette progression des actions est imputable aux bons résultats, ces derniers mois, de la bourse et de la baisse de rendement des autres placements. Les souvenirs de la crise financière de 2008 et de celle des dettes souveraines de 2011 s’estompent. Il est à signaler que le Livret A malgré son faible rendement progresse légèrement (22 % des sondés le jugent intéressant en 2017 contre 19 % en 2016).
Question rentabilité, l’immobilier locatif et l’assurance-vie toujours en tête mais les actions progressent
En interrogeant les Français plus précisément sur la question de la rentabilité, ces derniers placent toujours en tête l’immobilier locatif et l’assurance-vie. Néanmoins, par rapport à 2016, ces deux produits sont perçus un peu moins rentables (respectivement -5 points et -12 points). En revanche, pour 23 % des sondés, les actions sont jugées rentables, en progression de 6 points sur un an.
Il faut souligner que plus d’un Français sur quatre (29 %) considèrent qu’aucun placement n’est rentable. Ce taux est en nette progression par rapport à 2016 (+7 points). La baisse des rendements des produits de taux explique évidemment cette évolution.
La préférence pour la garantie en capital n’a pas de prix
La sécurité constitue toujours un élément de choix important pour les Français. Interrogés sur un éventuel placement dans un contrat d’assurance-vie, 41 % des Français privilégient le fonds euros quand seulement 18 % optent pour les unités de compte. 41 % ne souhaitent pas investir dans l’assurance-vie. Les fonds euros arrivent largement en tête chez les seuls épargnants (51 %). Pour ceux qui sont déjà détenteurs d’un contrat d’assurance-vie, ce taux est encore plus élevé (59 %). Seulement 40 % de ceux qui déclarent les unités de compte comme placement intéressant sont disposés à placer une partie de leur épargne sur ce type de support.
L’épargne retraite, un objectif contraint par le contexte économique et social
Le pourcentage de Français déclarant épargner pour améliorer leur retraite diminue depuis deux ans. Il est passé de 57 à 54 % de 2015 à 2017. La baisse est marquée chez ceux qui déclarent épargner régulièrement. Ils ne sont plus que 9 % contre 13 % en 2015. Les difficultés de pouvoir d’achat pèsent sur les capacités des ménages à épargner à long terme. Il est à souligner que la faculté d’épargner en vue de la retraite est fonction du niveau de revenu. Pour autant, plus de 60 % de ceux qui disposent d’un revenu mensuel supérieur à 3000 euros déclarent épargner pour améliorer leur retraite quand ce ratio est de 37 % parmi ceux gagnant moins de 1 200 euros.
40 % des sondés jugent souhaitable que l’épargne retraite collective (régimes à cotisations définies, à prestations définies ou PERCO) soit encouragée avec, le cas échéant, un abondement de l’employeur quand 36 % souhaitent que les avantages fiscaux de l’épargne retraite individuelle (PERP, Préfon, Corem, etc.) soient maintenus voire renforcés. 24 % des sondés ne souhaitent ni l’un, ni l’autre.
RETRAITE, UNE FORTE DEMANDE D’ÉQUITÉ
Les Français inquiets pour leur niveau de vie à la retraite
Pour près des trois-quarts des Français, (71 %), la pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement. Pour les non-retraités, ce taux est de 79 %. Ce résultat, sans appel, traduit non seulement le profond malaise des Français en ce qui concerne l’appréciation de leur pouvoir d’achat actuel et à venir, mais aussi leur anxiété vis-à-vis de l’évolution des régimes de retraite.
Même si les retraités sont un peu plus optimistes, la moitié considère tout de même que leur pension ne leur suffit pas pour vivre correctement.
Réforme des retraites, une forte demande d’équité
Aucune réforme paramétrique du système de retraite ne reçoit l’approbation des Français. Néanmoins, 43 % sont favorables à une accélération de l’application de la durée de cotisation à 43 ans (prévue de s’appliquer à partir pour la génération 1973). Le report de l’âge de la retraite ne bénéficie que du soutien de 40 % des sondés. L’augmentation des cotisations et surtout la diminution des pensions sont fortement rejetées (respectivement 65 % et 95 % des Français sont contre).
Les Français se déclarent favorables à 70 % au régime unique de retraite (fusion du régime général et du régime de la fonction publique). Ils sont à 61 % pour la suppression des régimes spéciaux. 60 % des Français se déclarent, par ailleurs, favorables au développement des fonds de pension.
Les Français, à titre personnel, favorables à travailler un peu plus pour avoir une meilleure retraite
Si les Français sont hostiles à l’idée de travailler à temps plein jusqu’à 65 ans, ils n’y sont pas opposés mais à temps partiel pour améliorer leur niveau de vie (62 % d’appréciation positive). Ils sont, à une petite majorité (51 %), contre le cumul emploi-retraite.
Les Français opposés à l’alignement de la CSG des retraités sur celle des actifs
En fonction de leurs revenus, les retraités sont soit exonérés de CSG, soit acquittent, sur leurs pensions, une CSG au taux de 3,8 ou de 6,6 %. Pour rappel, celle des actifs est de 7,5 %. 49 % des Français sont opposés à tout alignement du taux de CSG entre les retraités sur celui des actifs quand 38 % y sont favorables mais seulement pour les retraités dont les revenus sont supérieurs au salaire moyen. Seulement 13 % des sondés se sont prononcés pour un alignement. 68 % des retraités sont contre tout alignement (6 % étant pour).
LES FRANÇAIS ET LA DÉPENDANCE
De manière assez prononcée, les Français souhaitent que les régimes sociaux prennent en charge le coût de la dépendance en ayant recours aux cotisations sociales (37 %). 24 % préféreraient que son financement soit assuré par les entreprises. 21 % se prononcent en faveur d’une intervention directe de l’État via l’impôt. Enfin, 18 % considèrent que la dépendance relève des individus à charge pour eux d’en financer le coût via leurs économies ou par la souscription d’une assurance dépendance.
71 % des Français jugent que le financement de la dépendance relève de la solidarité nationale et intergénérationnelle quand 29 % sont favorables à ce qu’elle ne soit financée que par les seuls les retraités.
****
**
* À la demande du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa, le Centre d’Études et de Connaissances sur l’Opinion Publique (CECOP) a conduit une étude sur les Français, la retraite et l’épargne.
L’enquête a été réalisée sur Internet du 7 au 10 février 2017 auprès d’un échantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’IFOP.
À propos du Cercle de l’Épargne
Centre d’études et d’information indépendant partenaire d’AG2R LA MONDIALE, le Cercle de l’Épargne est présidé par Jean-Pierre Thomas. Il mène des études à dimension économique et sociale et des actions de formation pour comprendre les grands enjeux de la protection sociale.
Animé par Philippe Crevel, le Cercle bénéficie, pour réaliser ses travaux, de l’appui d’un Conseil scientifique composé de Robert Baconnier, ancien Directeur général des impôts et ancien Président de l’Association Nationale des Sociétés par Actions ; Jacques Barthélémy, Avocat conseil en droit social et ancien Professeur associé à la faculté de droit de Montpellier ; Philippe Brossard, Chef économiste d’AG2R LA MONDIALE ; Jean-Marie Colombani, Fondateur de Slate.fr et ancien Directeur du Monde et; Jean-Paul Fitoussi, Professeur des universités à l’IEP de Paris ; Jean-Pierre Gaillard, Journaliste et Chroniqueur boursier ; Christian Gollier, Directeur de la Fondation Jean-Jacques Laffont – Toulouse Sciences Économiques, membre du Laboratoire d’Économie des Ressources Naturelles (LERNA) et Directeur de recherche à l’Institut d’Économie Industrielle (IDEI) à Toulouse ; François Héran, Directeur de recherche à l’INED, ancien Directeur du département des sciences humaines et sociales de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) ; Jérôme Jaffré, Directeur du CECOP ; Florence Legros, Directrice générale d’ICN Business School de Nancy ; Jean-Marie Spaeth, Président honoraire de la CNAMTS et de l’EN3S et Jean-Pierre Thomas, Président de Thomas Vendôme Investment, ancien député.
À propos d’AMPHITÉA
AMPHITÉA, association d’assurés, souscrit auprès d’AG2R LA MONDIALE au nom et au profit de ses adhérents, des contrats répondant à leurs besoins de protection sociale et patrimoniale (épargne, retraite, santé, prévoyance, dépendance, obsèques). AMPHITÉA, grâce à ses correspondants, est une force de proposition.
Contacts presse :
| Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48 |
Philippe Crevel
06 03 84 70 36 |
Croissance française, un léger mieux en vue !
La France pourrait, cette année, renouer avec une croissance proche de la moyenne de la zone euro ; cela est du moins ce qu’espère l’INSEE dans sa dernière note de conjoncture. La croissance devrait atteindre 0,3 % au 1er trimestre puis 0,5 % au 2e. L’INSEE, pour établir ses prévisions, se fonde sur les bons indices publiés depuis le début de l’année, climat des affaires et confiance des consommateurs. Les économistes de l’institut statistique français croient en la reprise de l’investissement des entreprises qui serait favorisée par le régime de suramortissement en vigueur jusqu’à mi-avril. Ils pensent également que le commerce extérieur devrait moins peser négativement sur la croissance. En revanche, la hausse des prix de l’énergie devrait freiner la hausse de la consommation des ménages. Ils parient sur la poursuite de la progression de l’investissement des ménages en logement. L’emploi total devrait augmenter de 93 000 sur le premier semestre, soit à un rythme plus rapide que celui de la population active permettant ainsi une baisse du taux de chômage qui passera de 10 à 9,8 % de décembre 2016 à juin 2017.
Le prélèvement libératoire Macron revu et corrigé
Emmanuel Macron a, dans le cadre de son projet présidentiel, prévu de réintroduire un prélèvement libératoire sur les revenus de l’épargne. Les ménages auraient le choix entre le barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 %. Cette mesure concernait dans sa version initiale l’assurance-vie. Jeudi 16 mars, Jean Arthuis qui soutien Emmanuel Macron a confirmé que ce taux ne s’appliquerait que pour les nouveaux versements et il a précisé que les contrats d’un montant inférieur à 150 000 euros ne seraient pas concernés. 44 % des ménages disposent d’un contrat d’assurance-vie. Seulement 3 % auraient un encours supérieur à 150 000 euros sachant que 10 % des ménages détiennent 50 % de l’encours de l’assurance-vie.
La Banque centrale américaine continue sur sa lancée
Comme prévu, la FED a décidé lors de sa réunion du 15 mars de relever ses taux d’intérêt de 0,25%. Le principal taux directeur, le son taux interbancaire au jour le jour sera désormais compris dans la fourchette de 0,75% à 1%. Elle poursuit ainsi son processus de remontée des taux décidé en décembre. Cette augmentation avait été anticipée par les marchés. Il s’agit de la deuxième hausse des taux depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et de la troisième seulement depuis la crise financière de 2008. Trois augmentations sont prévues cette année avec comme objectif de faire le taux directeur à 1,4 %. Pour 2018, deux autres augmentations sont prévues avec un objectif fixé à 2,1 %. Cela devrait conduire à une augmentation des taux aux Etats-Unis avec un léger effet de contagion en Europe. Le maintien de la politique non conventionnelle européenne devrait permettre de limiter la hausse des taux.
Petit Guide à l’attention de ceux qui croient au Frexit
Philippe Crevel était l’invité d’Intégrale Placement le mercredi 15 mars 2017 et est intervenu sur les conséquences éventuelles d’un départ de la France de la zone euro pour les épargnants.
L’inflation au mois de février en France reste au-dessus de 1 %
L’INSEE a confirmé que l’inflation au mois de février s’était élevé en rythme annuel à 1,2 %. En rythme mensuel, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de +0,1 % après une baisse de 0,2 % en janvier. Corrigé des variations saisonnières, il se replie de 0,2 %, après avoir augmenté de 0,7 % en janvier. Sur un an, les prix à la consommation ralentissent légèrement (+1,2 % après +1,3 %).
Sur le mois, la légère hausse résulte d’un rebond du prix des services et d’une hausse du prix du tabac. Les prix de l’alimentation freinent légèrement du fait des produits frais. Les soldes d’hiver ayant perduré en février, les prix des produits manufacturés baissent encore, atténuant ainsi le rebond global. Enfin, les prix de l’énergie sont stables après cinq mois de hausse soutenue.
En février 2017, les prix des services se redressent sur le mois à +0,3 % après un petit repli le mois précédent. Sur un an, ils accélèrent à +1,1 % après +0,9 % en janvier. Sur le mois, le rebond s’explique principalement par celui des prix des transports aériens et des communications. En effet, les services de transport aérien rebondissent (+1,8 % ; +0,8 % sur un an) après la baisse saisonnière de janvier (−11,8 %). Les prix des services de communications se redressent également (+0,7 % après −3,4 % ; −0,3 % sur un an), du fait de la hausse de certains forfaits de téléphonie mobile. Les prix des services d’hébergement augmentent nettement (+2,1 % après −0,3 % ; +3,0 % sur un an). Les prix des services de santé croissent de nouveau légèrement (+0,2 %, comme en janvier ; +0,3 % sur un an).
L’inflation sous-jacente (inflation calculée sans prendre en compte les biens et services soumis à de fortes fluctuations) recule. En février 2017, l’indice d’inflation sous-jacente (ISJ) se replie de 0,4 % sur le mois après un rebond de même amplitude en janvier. Sur un an, il ralentit nettement (+0,2 % après +0,7 % le mois précédent). L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) se redresse (+0,2 % après −0,3 % sur un mois) ; sur un an, il croît un peu moins vite qu’en janvier (+1,4 %, après +1,6 %).
Hausse de 3,8 % des crédits mobilisés par les entreprises
À fin du mois de janvier, selon la Banque de France, les crédits mobilisés par les entreprises atteignent 895,7 milliards d’euros, en augmentation de 3,8 % sur un an. Pour les PME, l’augmentation est de 2,9 %. Elle est de 2,5 % pour les ETI et de 4,3 % pour les grandes entreprises.
L’augmentation de l’encours des crédits mobilisés (tirés) concerne la majorité des secteurs de l’économie. Elle s’élève sur un an à 5,7 % dans les activités de soutien aux entreprises, à 2,9 % dans l’industrie, à 3 % dans l’hébergement et restauration. En revanche, l’encours des crédits mobilisés recule de 1,1 % dans le secteur de la construction.
Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux d’un montant unitaire inférieur à 1 million d’euros est quasi stable (1,69 % en janvier 2017, après 1,68 % en décembre 2016), après une baisse continue depuis décembre 2015.
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com