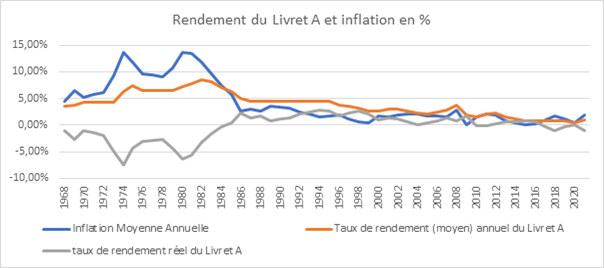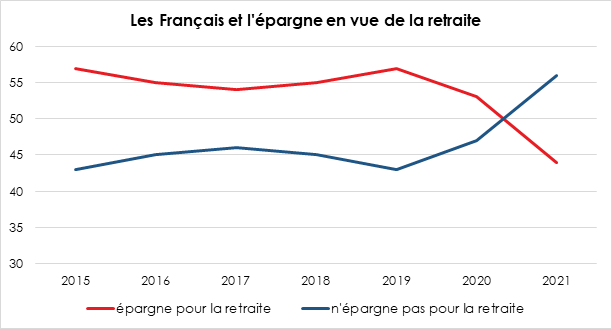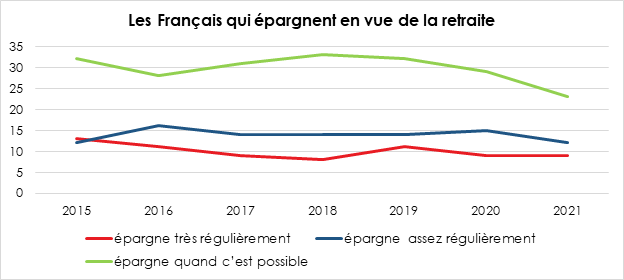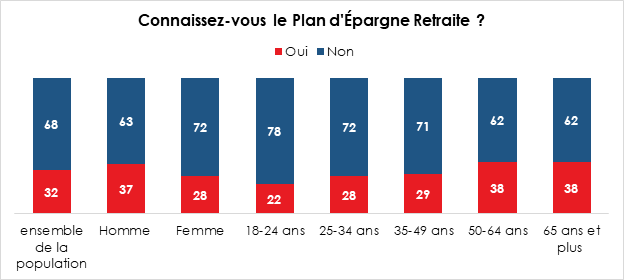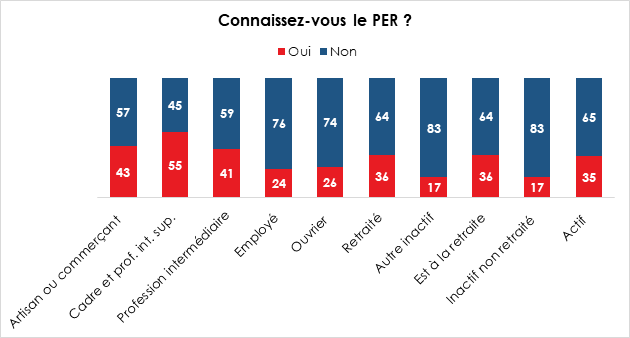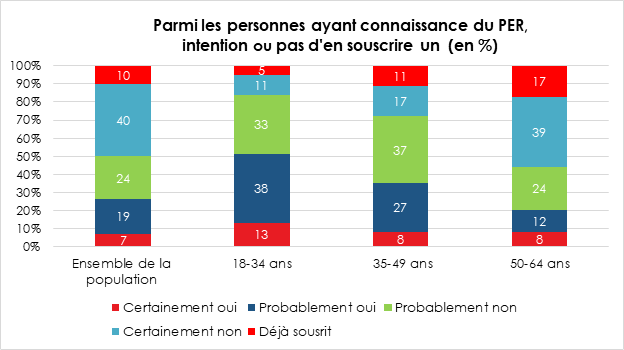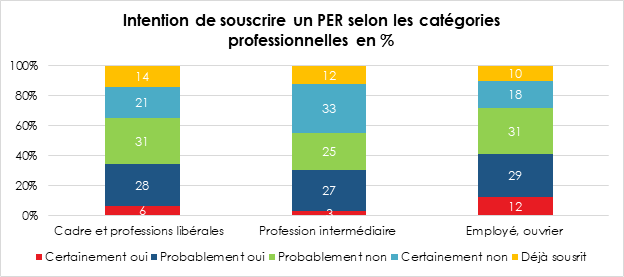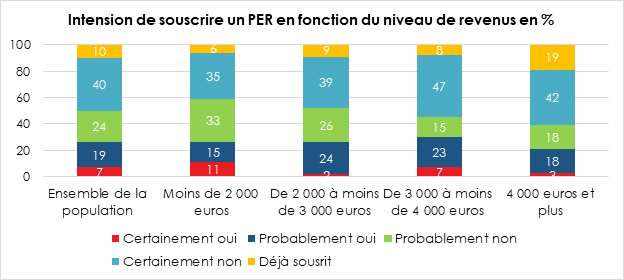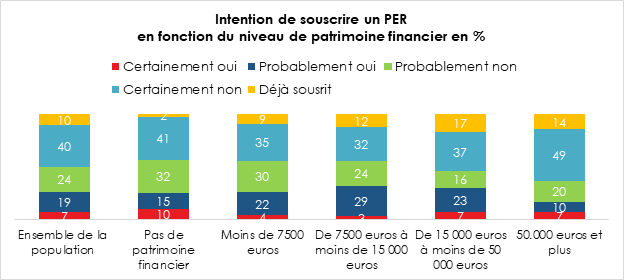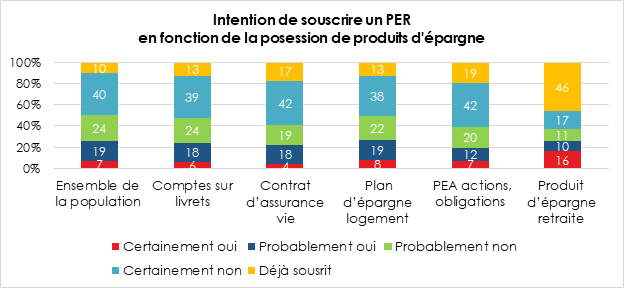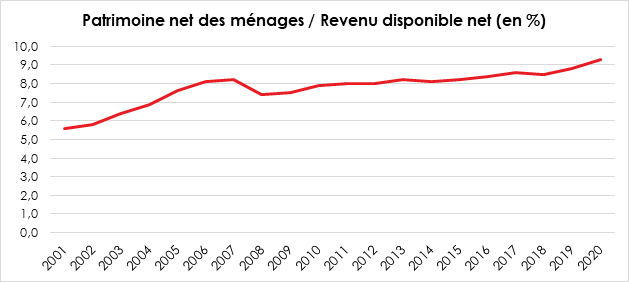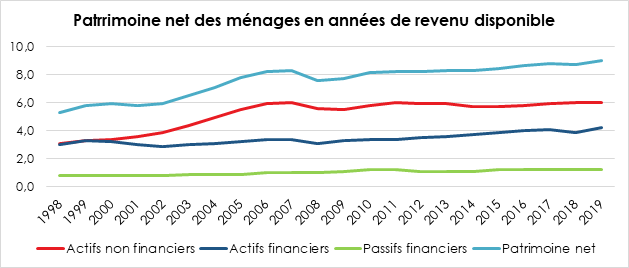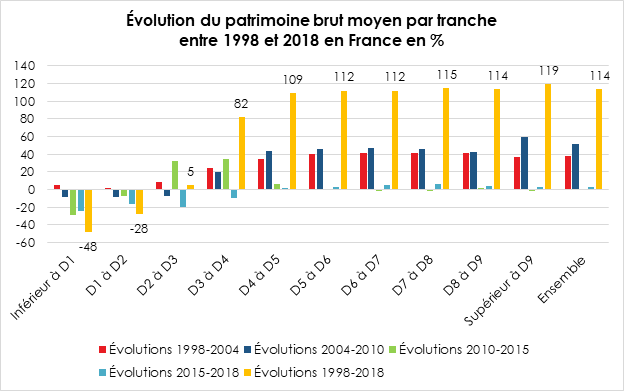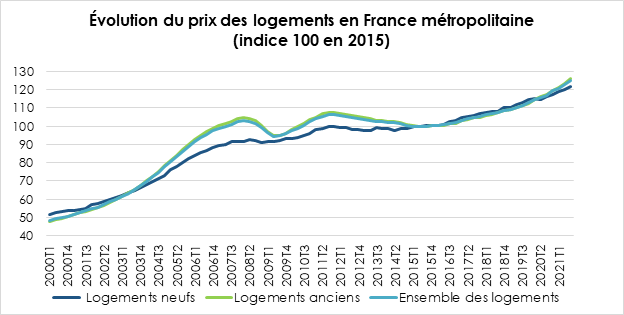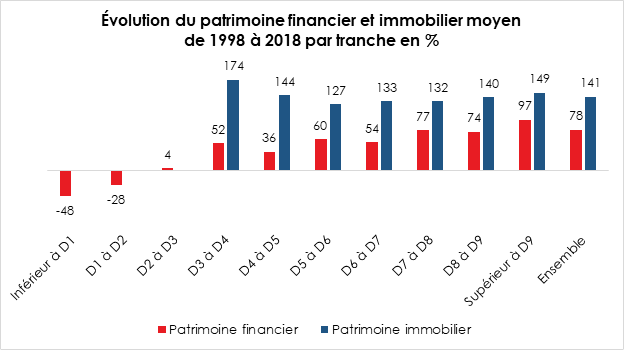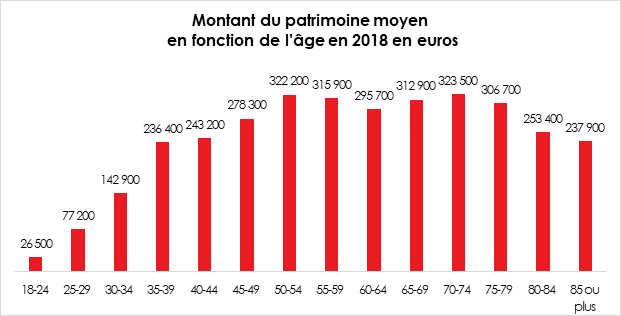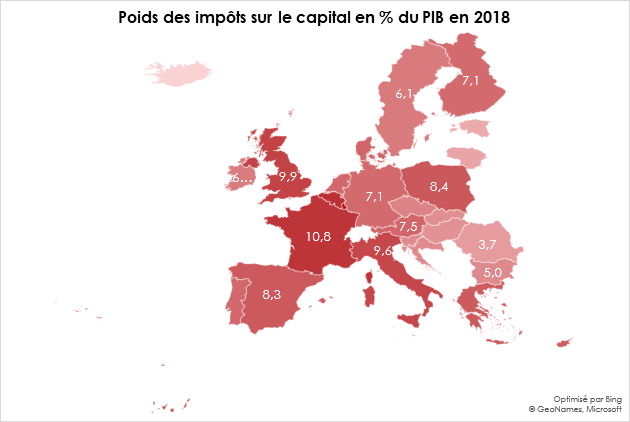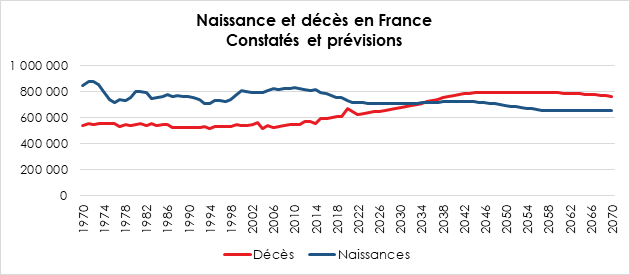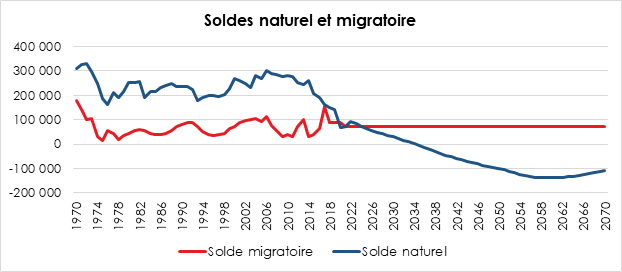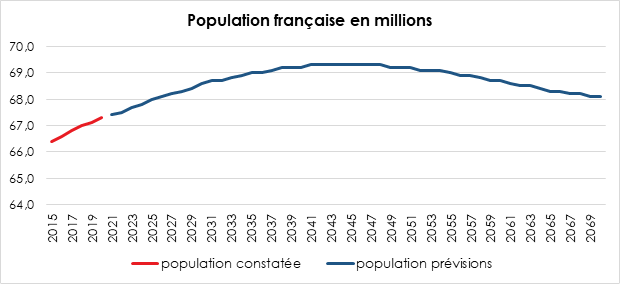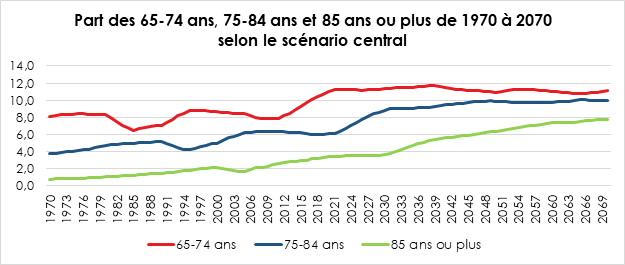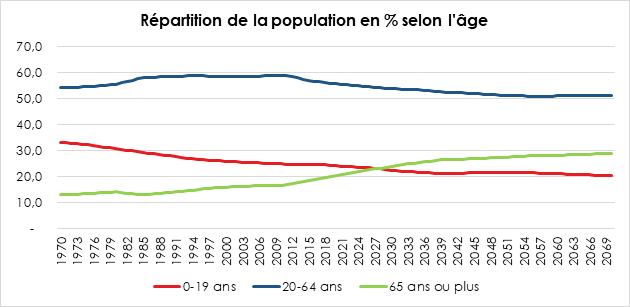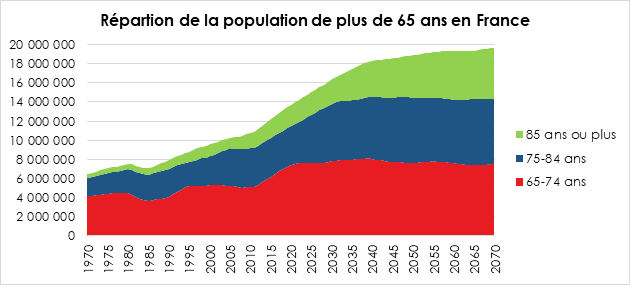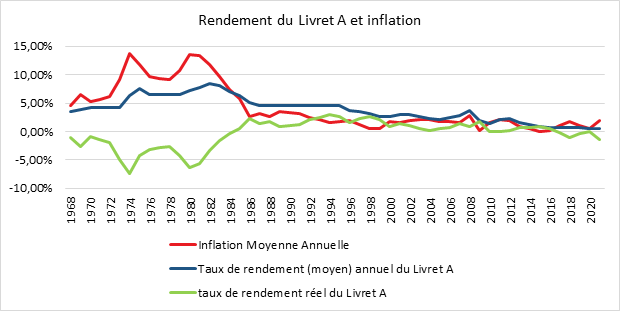Pouvoir d’achat : le taux du livret A enfin relevé… à 1%
Dans le journal Investir, Philippe Crevel commente la hausse à 1 % du taux du Livret A. Le directeur du Cercle de l’Épargne rappelle que le rendement du Livret « avait depuis constamment baissé au point d’atteindre 0,5%, ce qui constituait le niveau le plus bas de son histoire. » et considère que « la remontée de l’inflation depuis le milieu de l’année 2021 a conduit le gouvernement à opérer le relèvement, qui en outre, intervient à quelques semaines de l’élection présidentielle ».
Le taux du livret A grimpe à 1 % au 1er février
Appelé à réagir à la suite de l’annonce du relèvement du taux du Livret A, Philippe Crevel estime que cette décision constitue « un geste à l’approche des élections ».
Hausse du taux du Livret A : « Malgré un faible rendement, les Français plébiscitent ce type de placement »
Retrouver l’interview de Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’Épargne après l’annonce de la hausse du taux du Livret A. Il revient sur l’attrait de ce placement et l’impact potentiel du relèvement de sa rémunération.
Le taux du Livret A doublé à 1% : va-t-il redevenir un placement intéressant ?
En complément du reportage consacré sur le Livret A réalisée par TF1, LCI, évoque les travaux du Cercle de l’Epargne sur l’épargne réglementée. La chaîne d’information continue rappelle notamment que le taux n’a pas été relevé depuis 11 ans et évoque les projections du directeur du Cercle de l’Epargne qui anticipe « hausse durant deux à trois mois » de la collecte, un phénomène fréquent après l’annonce d’une revalorisation du livret.
Livret A, une hausse à forte portée symbolique
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Livret A, une hausse à forte portée symbolique
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire a annoncé, vendredi 14 janvier qu’à compter du 1er février 2022, le taux du Livret A passera de 0,5 % à 1,0 % en application de la formule adoptée en 2017.
Première augmentation du taux du Livret A depuis 2011
La hausse de 2022 est la première depuis près de 11 ans. Le taux du Livret A avait été, en effet, remonté de 2 à 2,25 % le 1er août 2011. Il avait depuis constamment baissé au point d’atteindre 0,5 % ce qui constituait le niveau le plus bas de son histoire. La remontée de l’inflation depuis le milieu de l’année 2021 a conduit le Gouvernement à opérer le relèvement, qui en outre, intervient à quelques semaines de l’élection présidentielle.
La hausse du taux, décidée par le gouvernement, concerne le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire ainsi que le Livret Jeune.
| Taux du Livret A | |
| 22 mai 1818 | 5,00% |
| 1er janvier 1851 | 4,75% |
| 1er janvier 1881 | 3,50% |
| 1er janvier 1905 | 3,00% |
| 1er janvier 1916 | 3,50% |
| 1er janvier 1929 | 3,50% |
| 1er janvier 1946 | 1,50% |
| 1er janvier 1960 | 3,25% |
| 1er janvier 1966 | 3,00% |
| 1er janvier 1968 | 3,50% |
| 1er juin 1969 | 4,00% |
| 1er janvier 1970 | 4,25% |
| 1er janvier 1974 | 6,00% |
| 1er janvier 1975 | 7,50% |
| 1er janvier 1976 | 6,50% |
| 16 octobre 1981 | 8,50% |
| 1er août 1983 | 7,50% |
| 16 août 1984 | 6,50% |
| 1er juillet 1985 | 6,00% |
| 16 mai 1986 | 4,50% |
| 1er mars 1996 | 3,50% |
| 16 juin 1998 | 3,00% |
| 1er août 1999 | 2,25% |
| 1er juillet 2000 | 3,00% |
| 1er août 2003 | 2,25% |
| 1er août 2005 | 2,00% |
| 1er février 2006 | 2,25% |
| 1er août 2006 | 2,75% |
| 1er août 2007 | 3,00% |
| 1er février 2008 | 3,50% |
| 1er août 2008 | 4,00% |
| 1er février 2009 | 2,50% |
| 1er mai 2009 | 1,75% |
| 1er août 2009 | 1,25% |
| 1er août 2010 | 1,75% |
| 1er février 2011 | 2,00% |
| 1er août 2011 | 2,25% |
| 1er février 2013 | 1,75% |
| 1er août 2013 | 1,25% |
| 1er août 2014 | 1,00% |
| 1er août 2015 | 0,75% |
| 1er février 2020 | 0,50% |
| 1er février 2022 | 1,00 % |
Le Livret A, le produit d’épargne le plus diffusé en France
La forte portée symbolique du relèvement du taux est liée à la place qu’occupe dans la population le Livret A qui demeure le produit d’épargne le plus diffusé en France.
Au 31 décembre 2020, le nombre de livrets A s’élevait, selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, à 55,7 millions, dont 54,9 millions détenus par des personnes physiques et 0,82 million détenus par des personnes morales. Plus de quatre Français sur cinq détiennent un Livret A.
Au 31 décembre 2020, le nombre de LDDS s’élevait, de son côté, à 24,3 millions. Le taux de détention de ce produit est de 46 %.
L’encours du Livret A était au 30 novembre 2021 de 343 milliards d’euros et celui du LDDS de 125,2 milliards d’euros. Ces deux produits ont connu, malgré un faible taux de rémunération, une vigoureuse collecte depuis le début de la crise sanitaire. La collecte du mois de mars 2020 à novembre 2021 atteint, pour le Livret A 38 milliards d’euros et 11,5 milliards d’euros pour le LDDS.
Si le Livret A est le produit d’épargne le plus largement diffusé en France, son encours est nettement inférieur à celui de l’assurance vie (plus de 1800 milliards d’euros), ce dernier produit n’étant pas plafonné.
La première hausse avec la nouvelle formule de calcul
La fixation du Livret A reste une décision discrétionnaire du Gouvernement. En 2003, dans un contexte de très légère augmentation des prix, le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin, a décidé la mise en place d’une formule de calcul du taux du Livret A. Cette formule a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de la situation économique et financière. En 2017, le gouvernement d’Édouard Philippe a décidé de retenir une nouvelle afin de mieux prendre en compte la baisse des taux d’intérêts.
En vertu de la formule de 2017, le taux du livret A correspond à la moyenne du taux d’inflation des six derniers mois et des taux interbancaires à court terme à 6 mois, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %.
L’inflation hors tabac a atteint en moyenne 2,2 % entre juillet et décembre dernier et le taux €STR des marchés interbancaires était de -0,571 % sur la même période. L’application de la formule aboutit donc à un taux de 0,8145 % (2,2 – 0,571)/2). Le gouvernement a décidé de porter le taux à 1 % ce qui constitue un petit coup de pouce par rapport au taux issu de la formule. Ce geste prend en compte l’accélération de l’inflation de ces derniers mois. Par ailleurs, il s’agit aussi un petit geste électoral. Pour le Livret d’Epargne Populaire, le Gouvernement a relevé le taux au niveau de l’inflation des six derniers mois conformément à la réglementation, 2,2 %.
Des gains et des coûts
Des gains limités pour les épargnants
Du fait du passage du taux à 1,00 % pour un titulaire d’un Livret A dont l’encours est de 15 000 euros, sa rémunération annuelle totale passera ainsi de 76,5 à 153 euros. Pour un détenteur d’un Livret A doté de 22 950 euros, sa rémunération annuelle totale passera de 114,75 à 220,5 euros.
Malgré la hausse de son taux, le rendement réel, après prise en compte de l’inflation, reste négatif de plus d’un point. Cette situation est sans précédent depuis le début des années 2000. Il faut remonter aux années 1980 pour avoir des rendements réels plus importants.
Le lien complexe inflation et épargne
Sur un plan financier, il n’est pas logique de comparer le rendement d’un placement financier avec les prix à la consommation, sachant que l’épargne est la renonciation justement à la consommation.
Logiquement, un regain d’inflation devrait inciter les ménages à moins épargner sur des produits de taux qui répercutent mal cette dernière. Dans les faits, le phénomène inverse est souvent constaté. Par effet d’encaisse, les épargnants, au contraire, mettent plus d’argent de côté afin de compenser la perte de rendement provoqué par la hausse des prix. Les faibles taux du Livret A n’ont pas dissuadé les épargnants français. Leur objectif n’était pas la recherche d’un rendement mais la sécurité et la liquidité.
Des charges pour les banques et la Caisse des Dépôts
La collecte du Livret A est centralisée à hauteur de 60 % à la Caisse des Dépôts, le solde étant conservé par les établissement financiers.
Le coût pour la Caisse des Dépôts et les banques de la majoration de 0,5 point est évalué pour le seul Livret A à 1,7 milliard d’euros. En prenant en compte le LDDS, le coût serait de 2,34 milliard d’euros. Le coût fiscal et social de cette mesure en prenant en compte le manque à gagner pour l’État et les régimes sociaux est de 700 millions (en retenant le principe d’une taxation au prélèvement forfaitaire unique).
Des prêts plus chers pour les bailleurs sociaux et les autres bénéficiaires des ressources des livrets réglementés
Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et les organismes collecteurs au profit des bailleurs sociaux, des collectivités locales et des entreprises entrant dans le champ du LDDS seront légèrement plus chers du fait du relèvement de taux. Le coût restera limité car les prêts en question sont, en règle générale, des prêts à long terme.
La hiérarchie des taux mise à dure épreuve
Le relèvement du taux du Livret A pourrait poser un problème de hiérarchie des taux, les rendements de certains produits longs passant en-dessous de celui du Livret A. Après fiscalité, le rendement des fonds euros en 2021 seraient proches de celui du Livret A, or ces derniers sont censés être des produits de moyen et long terme. Le relèvement du taux du Livret A peut inciter les compagnies d’assurances à puiser dans leurs réserves pour atténuer la baisse en cours depuis plusieurs années.
Le taux du Livret A n’obéit pas qu’à des considérations d’ordre économique et financière, il est de nature politique et sociale.
Quels effets sur la collecte ?
La hausse du taux du Livret A conduit, en règle générale, à une hausse durant deux à trois mois, de la collecte. En 2011, celle-ci a dépassé un milliard d’euros en juillet, août et septembre avant de retrouver son rythme d’avant l’annonce de la hausse (collecte de 2,07 milliards d’euros en juillet 2011, de 2,91 en août, de 1,13 en septembre et de 0,41 en octobre).
Le Livret d’Epargne Populaire, un réel coup de pousse
Le Gouvernement a décidé de porter le taux du Livret d’Epargne Populaire de 1 à 2,2 % permettant à ses bénéficiaires d’avoir un rendement réel nul. Ce produit qui est réservé aux ménages modestes (revenu fiscal de référence pour un célibataire inférieur à 20 000 euros) est plafonné à 7 700 euros. Sur les 15 millions de personnes susceptibles d’avoir un LEP, seuls millions en disposent d’un. À l’exception de 2020, le LEP enregistre une décollecte depuis une dizaine d’années.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Livret A, LDDS, LEP… Coup de pouce en vue pour les produits d’épargne réglementés
Avant l’annonce du taux de rendement à venir du Livret A, Philippe Crevel est invité à réagir dans les colonnes du Figaro sur le taux qui pourrait être retenu. Estimant qu’il serait logique de porter à 0,8 % le rendement du produit d’épargne réglementée, il s’interroge néanmoins sur un possible coup de pouce supplémentaire à la veille des élections, malgré le coût pour les banques et la Caisse des Dépôts.
Retraite : ce qui attend les Français en 2022
A la veille des élections présidentielles, Philippe Crevel estime que « derrière, le rapport remis cette semaine au ministre de la Santé par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie se profile le débat sur comment aider les retraités à avoir une complémentaire à moindre coût ».
Le gouvernement devrait annoncer une hausse du taux de rémunération du Livret A
Europe 1 revient sur la hausse annoncée du Livret A et cite dans cet article le Directeur du Cercle de l’Epargne.
Epargne 2022 : les meilleurs placements passés 60 ans
Planet.fr passe au crible les principaux produits d’épargne et évoque, avec Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne les placements à privilégier passé 60 ans.
Epargne : Faut-il (vraiment) se réjouir de la hausse à venir du taux du livret A ?
Dans 20 Minutes, Philippe Crevel revient sur la hausse à venir du Livret A décidée par Bercy afin de limiter l’impact de l’inflation sur ce produit actuellement rémunéré à 0,5 %. Il précise que « certains pensent que l’inflation va se calmer mi-2022, tandis que d’autres estiment que la flambée va se poursuivre et que les salaires vont suivre ».
Qui osera réformer l’épargne réglementée ?
A quelques jours de la hausse du taux du Livret A, le directeur du Cercle de l’Epargne publie une tribune dans laquelle il interroge les pouvoirs publics sur la nécessaire réforme de l’épargne réglementée dont le coût et l’utilité économique peuvent faire débat.
Nouveau guide sur l’épargne et la retraite du Cercle de l’Epargne et d’Amphitéa
Interview croisée des auteurs
Philippe Crevel – Avec Yvan Stolarczuk, Directeur d’Amphitéa, vous publiez, en ce début d’année 2022, un guide sur le Plan d’Épargne Retraite. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous préoccuper de la question du financement de la retraite et de l’épargne retraite ?
Depuis 1991, je travaille sur l’épargne retraite. J’ai découvert ce sujet grâce à un voyage d’études aux États-Unis et en Europe au cours duquel j’avais rencontré des experts de la retraite par répartition et par capitalisation. Dans le prolongement de ces rencontres, j’ai ainsi participé à la rédaction des premières propositions de loi sur l’épargne dont celle déposée par Jean-Pierre Thomas adoptée en 1997 par le Parlement.
La publication, en 1991, du Livre Blanc sur la retraite de Michel Rocard m’a également convaincu de la nécessité de trouver des solutions pour préserver le pouvoir d’achat des retraités. Renforcer la répartition par un volet capitalisation m’est apparu logique, et même nécessaire afin non seulement d’améliorer le niveau de vie des futurs retraités, mais aussi pour faciliter le financement des entreprises françaises. Sensibilisé au problème de fonds propres auxquels ces dernières sont confrontées, j’étais alors étonné par les réticences des gouvernements de droite comme de gauche d’avancer sur le sujet des fonds de pension. Si la fonction publique disposait de plusieurs produits d’épargne retraite, les salariés du privé et les indépendants n’avaient pas, à l’époque, la possibilité d’y souscrire. Le non-engagement des gouvernements sur ce sujet a eu comme conséquence l’adoption, par voie d’amendements, au fil de l’eau, de multiples produits d’épargne retraite, sans plan d’ensemble. Il a fallu attendre 2018 et la présentation de la loi PACTE afin d’obtenir un cadre cohérent sur l’épargne retraite. Le retard pris en la matière est coûteux. De nombreuses entreprises françaises ont été contraintes de trouver des ressources financières en dehors du territoire, ce qui a accentué leur inclination à la délocalisation. La faiblesse des fonds propres disponibles a pu également peser sur la croissance des entreprises de taille intermédiaire. Ironie de l’histoire, les dividendes des entreprises françaises financent non pas les retraités français mais ceux de nos partenaires. Nous entrons dans une période délicate du financement des pensions avec un handicap. Sur la question des retraites, depuis trente ans, nous savons, en effet, tous que les années 2020/2050 seront difficiles pour des raisons démographiques incontournables. Nous savons tous que le pouvoir d’achat des retraités est susceptible de diminuer dans les prochaines années avec l’arrivée des classes d’âge des années 1960 à l’âge de la liquidation des droits. Une très large majorité des Français est consciente du risque de perte de revenus à la retraite et souhaite pouvoir l’éviter du moins en partie. C’est pourquoi, après avoir publié un ouvrage général sur la retraite en 2014 (La retraite, juste un autre monde chez Temporis), à la demande du directeur d’Amphitéa, j’ai été très heureux de pouvoir participer à la rédaction d’un guide sur le Plan d’Épargne Retraite, qui, par ses caractéristiques permet de franchir une grande marche en matière d’épargne retraite.
Yvan Stolarczuk – En tant que directeur d’Amphitéa, une association qui rassemble plus de 400 000 souscripteurs de produits d’assurance, comment appréciez-vous le marché de l’épargne retraite en France ? Quelles sont les attentes de vos adhérents ?
Nos adhérents sont à l’image des Français : l’avenir de notre système de retraite les inquiète et ils se demandent ce qu’ils pourraient faire pour sauvegarder leurs revenus après leur cessation d’activité. Selon la dernière enquête de septembre 2021 du Cercle de l’Épargne/AMPHITÉA (*), 64 % de nos concitoyens pensent que ce système de retraite tombera en faillite d’ici quelques années, s’il n’est pas profondément réformé. Les plus inquiets sont les jeunes (69 %), car ils pensent qu’ils n’auront pas de retraite, ainsi que les plus de 65 ans (70 %), qui craignent pour le niveau de leurs pensions. Globalement, près des deux tiers des sondés estiment que leur pension, actuelle ou future, ne leur permet pas, ou ne leur permettra pas, de vivre correctement. Conséquence directe de cette vision plutôt pessimiste de l’avenir, la moitié des Français déclarent mettre de l’argent de côté pour leur retraite. Ils étaient 61 % en février 2019, mais la crise du Covid est passée par là et incite nos concitoyens à privilégier aujourd’hui l’épargne de court terme. Il n’empêche, le malaise est là et bien là !
Cette inquiétude aurait pu être apaisée par la réforme annoncée des retraites, même si les interrogations étaient encore nombreuses sur son contenu et les contestations de plus en plus difficiles à contenir. Cette fois-ci, le projet a été repoussé dans le temps du fait de la situation sanitaire et la réforme des retraites se fera très certainement un jour, mais difficile de dire quand et quelle forme elle prendra…
Rien d’étonnant si, dans ce contexte, la loi PACTE a été perçue comme une ouverture positive. En redonnant un rôle à la retraite par capitalisation, le gouvernement a voulu responsabiliser les Français, tout en orientant leur épargne vers l’économie réelle et les outils de production. D’abord en leur faisant comprendre que la répartition – même si elle a été sanctuarisée comme un principe fondamental de notre pacte social – ne peut répondre, à elle seule, aux futurs enjeux du financement des pensions. Ensuite, en les invitant à bien bénéficier des opportunités qu’offre le nouveau Plan d’Épargne Retraite (PER), dans ses déclinaisons individuelles ou collectives.
Philippe Crevel – En pleine crise sanitaire, pensez-vous réellement que les Français sont prêts à souscrire à un Plan d’Épargne Retraite et de geler une partie de leur patrimoine ?
Les Français sont inquiets pour leur niveau de vie à la retraite. Même si avec la crise sanitaire, le court terme tend à l’emporter sur le long terme, ils restent évidemment favorables à l’épargne retraite. Avec le Plan d’Épargne Retraite (PER) ils ont trouvé un produit qui correspond à leurs attentes. Les différents types de sortie (capital ou rente) les rassurent tout comme la possibilité de récupérer, avant même la retraite, l’argent capitalisé pour acquérir une résidence principale. Les avantages fiscaux associés au produit sont également appréciés. L’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa souligne que 32 % des Français ont déjà entendu parler du PER. Ce taux de reconnaissance atteint même 55 % chez les cadres et 43 % chez les indépendants qui sont ceux qui sont les plus susceptibles d’y souscrire à titre individuel. Faisant partie de ceux dont le taux de remplacement (le rapport entre leurs pensions et leurs revenus d’activité avant liquidation) est le plus faible, ils figurent également parmi ceux qui traditionnellement épargnent. Parmi ceux qui ont déjà entendu parler du PER, 10 % en ont déjà un et 26 % entendent en souscrire un prochainement. Signe encourageant, 51 % des jeunes de moins de 35 ans sont disposés à passer à l’acte, ce qui témoigne d’une prise de conscience de la part de ce public face au risque de baisse des pensions traditionnelles. 14 % des cadres ont en déjà souscrit un et 34 % pensent le faire prochainement. Il convient également de souligner que 41 % des ouvriers et des employés qui en ont entendu parler seraient susceptibles d’en ouvrir un.
Au-delà de ces intentions, les résultats de la Fédération Française de l’Assurance témoignent des bons débuts du PER. Fin octobre, les PER individuels comptabilisaient 2,4 millions d’assurés pour 26,1 milliards d’euros de provisions mathématiques. En prenant en compte les plans collectifs en entreprise, le nombre de souscripteurs serait de 4 millions et l’encours se rapprocherait de 40 milliards d’euros.
Yvan Stolarczuk – Par rapport à ses prédécesseurs, quels sont les principaux atouts du PER Individuel ?
AMPHITÉA a souscrit au profit de ses adhérents auprès d’AG2R LA MONDIALE, deux sortes de PERI : l’un dédié à tous les particuliers, quels que soient leur statut et leur situation professionnelle, l’autre destiné aux travailleurs non-salariés (TNS), comme précédemment dans le cadre de la loi Madelin. Ces deux solutions d’épargne retraite offrent bien entendu les avantages du PER définis par la loi PACTE et qui ont été particulièrement appréciés par les Correspondants régionaux de notre association.
Ainsi, ils ont identifié comme principal atout la liberté au terme entre la rente ou le capital, voire la combinaison possible de ces deux modes de sortie. Ils ont aussi noté les autres avantages comme la portabilité facilitée de l’épargne déjà existante et le regroupement des anciens produits vers le PER ; la déductibilité des versements du revenu imposable ; la gestion financière dynamique et qui s’oriente davantage vers des unités de compte ; les cas de rachat anticipé de l’épargne constituée avant la retraite en cas d’accidents de la vie, et auquel se rajoute même l’acquisition de la résidence principale… Bref, un ensemble de caractéristiques qui existaient souvent dans les anciens produits mais de manière diffuse et hétérogène. Avec le PER, on retrouve à présent la plupart de ces atouts au sein d’une seule et même enveloppe.
Par ailleurs, s’agissant avant tout de solutions destinées à compléter les pensions, il faut noter que les PERI que nous avons souscrits auprès de notre partenaire assureur, spécialiste depuis toujours en matière de retraite, proposent toujours des options intéressantes en cas de sortie en rente : nombre d’annuités garanties en cas de décès prématuré à la retraite, montants de réversion pour le conjoint survivant, montants adaptés en fonction des différents « cycles de vie » à la retraite, garantie en cas de dépendance…
Philippe Crevel – Pourquoi faut-il acheter ce guide de l’épargne retraite ?
Le principe du Plan d’Épargne Retraite est simple, vous épargnez afin de vous constituer un complément de revenus ou de capital en vue de la retraite. Au-delà de cette idée, le législateur a souhaité instituer un cadre unique permettant de regrouper sous la même bannière la quasi-totalité des formes d’épargne retraite existantes. Le PER offre ainsi de multiples possibilités de versements et de sorties. Le souscripteur a en main une véritable machine qu’il est nécessaire d’apprivoiser pour en tirer le maximum. Ce guide a pour objectifs de répondre, de la manière la plus pédagogique possible, du moins je l’espère, à toutes les questions que les épargnants peuvent se poser à son sujet, et même à celles auxquelles ils n’ont pas pensé…
Yvan Stolarczuk – et pour vous ?
Avec la loi PACTE, le Gouvernement a souhaité simplifier le paysage de l’épargne retraite. Néanmoins, il peut paraître encore bien complexe à appréhender. Une bonne information et un conseil renforcé sont nécessaires pour saisir les enjeux de la réforme et en tirer le meilleur parti, notamment en ce qui concerne la fiscalité du PERI pour les versements comme pour les options de sortie au terme.
Leader en France de l’épargne retraite dans le domaine de la retraite d’entreprise et des indépendants, notre partenaire assureur, AG2R LA MONDIALE, a fortement mobilisé ses équipes sur ce dossier et la raison d’être d’AMPHITÉA trouve alors tout son sens avec ce guide. Parce qu’un futur retraité bien averti en vaut deux, nous nous devions de mettre à la disposition de chacun une information claire, fiable et la plus exhaustive possible. C’est le principal objectif de cet ouvrage.
(*) Enquête 2021 Cercle de l’Épargne/AMPHITÉA en partenariat avec AG2R LA MONDIALE.
A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne
Les actionnaires l’épargne et la retraite
Jusqu’au troisième trimestre 2019, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) comptait près d’un million d’investisseurs actifs. L’autorité administrative indépendante note que le nombre de détenteurs d’actions s’est – contre toutes attentes – accru depuis le début de la pandémie qui a commencé au mois de mars 2020 avec l’arrivée d’un nouveau type d’investisseurs. Leur nombre par trimestre qui évoluait autour de 1 million jusqu’au troisième trimestre 2019, a atteint les 2,5 millions et se maintient au-dessus de ce niveau depuis trois trimestres. Ces données confirment les résultats du baromètre 2021 de l’épargne et de l’investissement de l’AMF. Cette enquête met en exergue le regain d’intérêt des placements en action, en particulier chez les plus jeunes. La part des sondés prêts à prendre un peu de risque, dans l’espoir d’avoir une meilleure rémunération que celle des produits de taux, progresse ainsi de cinq points en un an. Les travaux de l’AMF sont en phase avec ceux de l’enquête « Les Français, la retraite, l’épargne et la dépendance » menée par l’IFOP et le CECOP pour le compte du Cercle de l’Épargne et Amphitéa en septembre 2021. Jugés intéressants par près de 4 Français sur 10 les actions conservent, en septembre 2021, la troisième place du podium après le bien immobilier locatif (62 % de citations) et l’assurance vie (48 %). Elles devancent de 13 points le Livret A, malgré un retour en grâce de l’épargne liquide dans le cœur des épargnants avec la crise. Parmi les sondés déclarant avoir les moyens d’épargner et indiquant avoir épargné plus depuis le début de la pandémie, la part de ceux considérant ce placement intéressant franchit même la barre des 50 % (54 % parmi ceux ayant « beaucoup plus » épargné et 52 % parmi ceux ayant « un peu plus » épargné).
Au sommaire de cette étude
À quoi ressemble un actionnaire sous l’ère covid ?
- Les actions, « un placement d’homme » ?
- Les jeunes davantage séduits par les actions que leurs aînés
- L’attrait des cadres et des indépendants pour les actions non démenti par la crise
- Les détenteurs de hauts revenus et de patrimoine élevé surreprésentés parmi les détenteurs d’actions
Les détenteurs d’actions et leur épargne face à la crise covid
- Les détenteurs d’actions davantage prêts à consommer que la moyenne des Français
- priorité à l’épargne malgré tout !
- Les actionnaires, partagés entre sécurisation et valorisation de leur épargne
Les Actionnaires et la retraite : le pragmatisme domine
- Un diagnostic partagé, mais pas les solutions
- Les actionnaires, un public déjà familiarisé à l’épargne retraite et au PER
Le taux du livret A pourrait grimper à 0,8 %
Le Télégramme s’intéresse au taux du Livret A applicable à compter du 1er février prochain et interroge le Directeur du Cercle de l’Epargne.
Le difficile combat contre les déserts médicaux
Le médecin de famille, tout à la fois médecin et conseiller, ou le médecin de campagne fait partie, avec l’instituteur et le prêtre, de l’imaginaire des Français. Cette image d’Épinal a vécu. Avec l’urbanisation du pays et la réduction du temps de travail qui concerne également les professionnels de santé, il est devenu difficile d’obtenir, dans certains territoires, un rendez-vous médical. Contrairement aux idées reçues, les déserts médicaux ne se limitent pas au seul milieu rural. Ils existent au sein des grandes agglomérations et notamment en Île-de-France. Le vieillissement de la population conduit à de nombreux départs à la retraite de praticiens et génère, dans le même temps, des besoins croissants en matière de santé amenant à des difficultés pour l’obtention de rendez-vous médicaux. Ce problème n’est pas spécifique à la France. Tous les pays occidentaux sont confrontés à la problématique des déserts médicaux. Les solutions financières pour inciter les professionnels de santé à s’implanter sur des territoires à faible densité médicale donnent des résultats décevants conduisant les pouvoirs à porter leur attention sur la structuration de l’offre.
Le choix d’implantation des médecins
La Direction de la Recherche, des Études, des Évaluations et des Statistiques du ministère de la Santé, dans une note du mois de décembre 2021, souligne que les aspects financiers ne seraient pas les seules motivations des médecins dans leur choix d’implantation. Ces derniers prendraient également en compte les conditions d’exercice de leur métier, la qualité des services publics et notamment la présence d’établissements scolaires de qualité. Dans les faits, les territoires les plus attractifs sont ceux où le pouvoir d’achat de la population est le plus élevé, autorisant les dépassements d’honoraires.
Les experts de la DREES précisent dans leur note que les incitations financières ne suffisant pas pour conduire des praticiens à opter pour des déserts médicaux. Les expériences menées en la matière à l’étranger corroborent cette appréciation. De plus en plus, les médecins, notamment les jeunes, privilégient les conditions de vie. Ils estiment que l’installation dans une zone à faible densité médicale les expose à un nombre d’heures élevé et à des temps de transports plus importants.
Parmi les autres moyens permettant de réduire les déserts médicaux figurent l’augmentation du nombre de médecin en veillant à un recrutement sur l’ensemble du territoire, la régulation (contraintes sur le choix de localisation) et le soutien professionnel et personnel.
La gestion de l’offre de médecins
Le numerus clausus introduit en France en 1971 visait à garantir le niveau des médecins à réduire l’offre dans un souci d’équilibre des comptes publics. En desserrant voire en supprimant le numerus clausus, la formation d’un plus grand nombre de médecins devrait, en théorie, aboutir à réduire les déserts médicaux. Or, en l’état, rien ne prouve que la distribution géographique des médecins soit plus équilibrée, d’autant plus que les besoins sont croissants dans tous les territoires. Pour obtenir une répartition équilibrée, le recrutement des futurs professionnels de santé devrait être diversifié. Ces derniers devraient venir des différentes catégories de territoires ce qui suppose une sensibilisation en amont des jeunes, en particulier en milieu rural. Plusieurs études semblent prouver l’influence de l’origine des médecins sur leurs choix d’installation. Une discrimination positive en faveur des étudiants issus des territoires à faible densité médicale pourrait être instituée. Une telle discrimination poserait, en revanche, un problème d’égalité entre les candidats. Une autre solution serait de sensibiliser les lycéens de ces territoires aux études médicales. La création d’antennes décentralisées des facultés de médecine pourrait être également imaginée.
La révolution de la régulation
Les pouvoirs publics pourraient décider de restreindre la liberté d’installation. Plusieurs solutions sont envisageables. La première viserait à obliger les jeunes médecins à effectuer un passage obligé dans des zones déficitaires. Cette solution a comme inconvénient de faire de ces territoires des zones de passage avec des praticiens sans expérience. Un système d’ouverture de postes pourrait être institué. Les médecins ne devraient choisir leur lieu d’implantation qu’en fonction des postes vacants. Ce système reprendrait le principe en vigueur pour certaines professions réglementées, à l’instar des notaires, des pharmaciens, etc. La gestion de la mobilité devrait alors être traitée. Une régulation poussée pourrait dissuader un certain nombre d’étudiants d’opter pour médecine.
Le soutien aux professionnels en place
À défaut de mesures contraignantes, les pouvoirs publics pourraient améliorer les conditions de vie des praticiens acceptant de s’installer dans des déserts médicaux. Ces derniers pourraient bénéficier de dispositifs de remplacement pour leur permettre de partir en vacances ou de se former. Une meilleure prise en compte des sujétions, gardes, transports, pourrait également être prévue.
Les expériences menées dans les pays étrangers appellent à la modestie, aucun n’ayant réellement trouvé la martingale. En France comme ailleurs, les médecins aspirent à une « vie normale » et à des conditions de vie correctes. La concentration des cadres et des professions libérales au sein des grandes agglomérations n’épargne pas les médecins. Ces derniers sont moins nombreux que dans le passé à vouloir exercer en libéral. Le salariat, autrefois impensable, est de plus en plus plébiscité, tout comme l’installation au sein de centres médicaux permettant de mutualiser les moyens administratifs. Même si la profession récuse l’idée de la fonctionnarisation, celle-ci est de plus en plus marquée. Pour le moment, nul n’imagine que le ministère de la Santé ou les Agences régionales de santé gèrent l’emploi en dehors des hôpitaux mais le débat sur une meilleure adéquation de l’offre à la demande est ouvert.
A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne
Les nouveautés de 2022 pour la retraite et l’épargne retraite
Mesures concernant la retraite
Revalorisation des pensions de base de 1,1 %
Les pensions de base ont été revalorisées de 1,1 % ce 1er janvier 2022. Cette hausse intervient après celle de 0,4 % appliquée le 1er janvier 2021. Seules les pensions de base des avocats ne sont pas concernées par ce taux, ces dernières n’augmentant que de 1 %.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’ancien minimum vieillesse, a progressé également de 1,1 % et s’élève désormais (hors Mayotte) à 916,78 euros par mois pour une personne seule (+9,97 euros) et à 1 423,31 euros pour les couples (+15,49 euros).
Les revalorisations des pensions complémentaires
La revalorisation annuelle intervient également le 1er janvier dans de nombreux régimes de retraite complémentaire, mais les taux diffèrent selon les régimes.
La hausse est, par exemple, de 1,1 % pour les artisans et commerçants, ainsi que pour les agents non titulaires de la fonction publique (affiliés à l’Ircantec), de 1 % pour les avocats, de 1,9 % pour les fonctionnaires en ce qui concerne les pensions délivrées par le Régime additionnel de la fonction publique, et de 0,50 % pour les médecins affiliés à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (leur pension d’allocation supplémentaire vieillesse, n’augmentant pas). Les libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse ne bénéficient pas de revalorisation.
Les pensions complémentaires des salariés du secteur privé relevant de l’AGIRC/ARRCO ont quant à eux déjà bénéficié d’une revalorisation de 1 % intervenue le 1er novembre 2021.
Amélioration du régime de retraite pour les agriculteurs
Depuis le 1er janvier 2022, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ont droit à la même pension majorée de référence (PMR) que les chefs d’exploitation (montant 2021 : 699,07 euros), alors qu’ils se voyaient jusqu’ici attribuer un montant moindre (montant 2021 : 550,50 euros). Le montant de cette PMR est relevé à hauteur du minimum contributif majoré des salariés, soit 713,11 euros à compter du 1er janvier 2022. Cette PMR est l’équivalent, chez les agriculteurs, du minimum contributif des salariés. Elle permet de porter leurs pensions de base à un niveau minimal s’ils ont leur retraite à taux plein (sans décote). Selon le gouvernement, 178 000 personnes bénéficieraient de cette mesure, applicable aux nouveaux comme aux anciens retraités.
Par ailleurs, si jusqu’ici, la PMR ne pouvait amener l’ensemble des pensions d’un non-salarié agricole à dépasser un plafond de 874,76 euros, ce plafond est relevé au niveau du minimum vieillesse, donc 916,78 euros en 2022. Environ 17 500 retraités supplémentaires pourraient, grâce à cette mesure, bénéficier de la PMR, d’après le gouvernement.
Validation de « trimestres Covid » pour certains indépendants
Les indépendants, micro-entrepreneurs compris, travaillant dans des secteurs fortement touchés par la crise sanitaire (restauration, hôtellerie, tourisme, événementiel…), et qui prennent leur retraite à compter du 1er janvier 2022, pourront se voir attribuer des trimestres gratuits s’ils n’en ont pas validé, en 2020 et 2021, autant que les années précédant la crise sanitaire. Les modalités d’attribution doivent être précisées par décret. Sont également concernés les artistes auteurs et les mandataires sociaux.
Le régime des « Conjoints collaborateurs »
Le statut de conjoint collaborateur des indépendants n’est désormais ouvert que pour cinq ans maximum. Ce statut s’ouvre en outre, en 2022, aux concubins des chefs d’entreprise, en plus des conjoints et des partenaires de pacs, comme c’était déjà le cas chez les agriculteurs.
Le montant des revenus nécessaires pour valider du trimestre
Pour valider un trimestre en 2022, le revenu brut devra être au moins de 1 585,50 euros (soit 150 fois le montant du SMIC horaire brut), contre 1 537,50 euros en 2021. Pour valider quatre trimestres, il faudra donc cotiser sur la base d’au moins 6 342 euros dans l’année, quel que soit le nombre de mois vraiment travaillés.
La retraite progressive possible pour les « forfaits jours »
Les salariés en forfait jours (rémunérés sur la base d’un nombre de jours travaillés par an, sans décompte en heures du temps de travail), essentiellement des cadres, n’avaient jusqu’ici pas accès au dispositif de la retraite progressive, système qui permet de diminuer son temps de travail tout en bénéficiant d’une fraction de ses pensions de retraite. À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à l’exclusion de cette catégorie de salariés du dispositif de retraite progressive, jugée contraires à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
Mesures concernant l’épargne retraite
La fin du dispositif incitatif de transfert de l’assurance vie vers le PER
La loi Pacte de 2019 a institué un avantage fiscal temporaire afin d’inciter les titulaires de contrat d’assurance vie de plus de 8 ans à transférer tout ou partie de l’épargne capitalisée sur un Plan d’Épargne Retraite. Les assurés bénéficient, sous certaines conditions, notamment d’âge, d’un doublement de l’abattement fiscal sur les gains prévu pour les rachats. Celui-ci passe ainsi de 4 600 à 9 200 euros pour une personne seule et de 9 200 à 18 400 pour un couple. Les sommes transférées sur le PER sont déductibles des revenus dans les limites classiques. Cette possibilité prendra fin le 31 décembre 2022.
L’amélioration des informations données aux détenteurs de plans d’épargne retraite
À compter du 1er juillet 2022, le compte retraite, sur Info-retraite.fr (et sur l’application mobile liée) intégrera les informations relatives aux plans d’épargne retraite souscrits par les assurés. Ce dispositif devrait permettre de réduire le nombre de plans non réclamés dont l’encours est évalué à plus de 5 milliards d’euros.
A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne
Avantages et inconvénients de la gestion automatique des régimes de retraite
L’OCDE plaide pour la généralisation de système de correction automatique afin d’équilibrer en temps réel les régimes de retraite. L’organisation prend acte qu’il est de plus en plus difficile pour les gouvernements de réformer leur système de retraite. L’ajustement automatique est censé dédramatiser la question du financement des retraites et d’éviter des phénomènes d’à-coups. Compte tenu de l’acuité du problème de financement des régimes de retraite, cette solution serait la mieux à même pour garantir leur équilibre sur moyenne et longue période.
Des régimes de retraite sous tension
Pour l’OCDE, la situation financière des régimes de retraite s’est compliquée avec la survenue de la crise sanitaire. En revanche, l’organisation souligne que les retraités n’ont pas, sauf rares exceptions, été financièrement touchés par la crise. Elle indique que le nombre de retraités a néanmoins diminué de 0,8 % ; ceux-ci étant les principales victimes de l’épidémie en cours. Sur le long terme, cette dernière aurait peu d’incidence sur la progression du nombre de retraités. Malgré la réduction de l’espérance engendrée par le covid-19, au sein de l’OCDE, le vieillissement des pays occidentaux se poursuit, en effet, à vive allure. D’ici 2035, sans réforme, les dépenses de retraite augmenteront de 3,5 % du PIB au sein des États membres. Dans les pays d’Europe du Sud, d’Europe orientale ainsi qu’au Japon et en Corée, les populations d’âge actif se contracteront d’au moins 25 %. Ces dernières années, peu de pays ont adopté des mesures d’âge en raison d’une crispation des populations sur ce sujet. Les Pays-Bas et l’Irlande ont décidé de reporter ou d’abandonner le report de l’âge initialement prévu. La Suède a prévu néanmoins de relever l’âge minimum de la retraite pour les pensions publiques contributives et prévoit de l’indexer sur l’espérance de vie. Le Danemark, l’Italie ou la Lituanie ont élargi les mécanismes de retraite anticipée. Plusieurs États dont l’Allemagne ont amélioré le niveau des petites pensions. Compte tenu des mesures prises dans le passé, l’âge normal de la retraite devrait continuer de reculer, en moyenne de deux ans au sein de l’OCDE, d’ici 2060. Cet âge sera de 69 ans au Danemark, en Estonie, en Italie et aux Pays-Bas.
De nombreux États occidentaux ont opté pour une gestion pilotée de leur système de retraite
Deux tiers des États de l’OCDE ont mis en place des mécanismes d’ajustement automatique afin de limiter le recours à des réformes anxiogènes. En fonction de l’évolution d’indicateurs financiers, économiques ou démographiques, des dispositifs de compensation s’appliquent automatiquement. Le recul de l’âge de la retraite, l’allongement de la durée de cotisation, les modalités d’indexation, les taux de cotisations, etc., figurent parmi les facteurs pouvant être ajustés pour rétablir l’équilibre financier. Parmi les États ayant mis en œuvre de tels mécanismes :
- 6 se sont dotés de régimes notionnels (prise en compte de l’espérance de vie pour calculer le montant des pensions) ;
- 6 ont opté pour des systèmes dans lesquels l’âge de liquidation des droits varie en fonction de l’espérance de vie ;
- pour 7 autres, c’est le montant des prestations qui peut varier.
La Suède conjugue un mécanisme qui prend en compte l’espérance de vie et un système de rééquilibrage des comptes financiers. La Finlande a adopté un ajustement automatique qui repose à la fois sur l’âge de liquidation et sur le montant des pensions.
La France, à la recherche de son modèle
La France depuis 2014 n’a pris aucune mesure significative sur les retraites. En raison de la crise sanitaire, la réforme instaurant le système universel par point a été suspendue. Son adoption aurait conduit à un pilotage non pas automatique mais simplifié. Les valeurs d’achat et de rachat du point auraient conditionné en grande partie l’équilibre du régime. Le Gouvernement d’Édouard Philippe avait, par ailleurs, prévu de retenir un âge d’équilibre qui aurait pu fluctuer en fonction de l’espérance de vie. Pour l’OCDE, une des faiblesses du système français de retraite provient de l’absence de dispositif de correction automatique des déséquilibres financiers. Elle estime que son introduction passe par une plus grande convergence des 42 régimes existants.
Le pilotage automatique permettrait une meilleure maîtrise des dépenses et un report plus facile de l’âge effectif de départ à la retraite. L’Organisation souligne que les dépenses de retraite hexagonales se sont accrues de 2,2 points de PIB depuis 2000, contre 1,5 point en moyenne chez les pays membres, malgré plusieurs réformes engagées depuis 1993. Elle remarque que seuls 33 % des 60-64 ans sont en emploi, contre 51 % dans l’OCDE, et l’âge moyen de sortie du marché du travail est de 60,6 ans contre 63,1 ans. Après 2035, date à laquelle l’augmentation de la durée de cotisation à 43 ans sera achevée, plus aucun mécanisme ne fera monter l’âge moyen de départ. Indiquant qu’ « en 2050, les personnes âgées de 65 ans devraient vivre 8 ans de plus qu’au début des années 1980 lorsque l’âge de la retraite fut abaissé à 60 ans. », les économistes de l’OCDE estiment qu’« un âge minimum qui serait maintenu à 62 ans (60 ans pour le dispositif carrières longues) paraît très bas ».
En France, les mécanismes de gestion automatique ont mauvaise presse, liant les mains des pouvoirs publics à des considérations plus ou moins techniques. La loi Fillon réformant les retraites de 2003 avait instauré une règle de partage des gains d’espérance de vie, deux tiers devant conduire à un allongement de la durée de cotisation et un tiers à l’allongement de la durée de la retraite. Cette règle a conduit au passage de 40 à 42 ans de la durée de cotisation. Elle a été abandonnée sous la présidence de François Hollande. Compte tenu de l’importance des retraites au sein de l’opinion publique, il a été jugé nécessaire que toute modification considérée comme substantielle donne lieu à un débat public et à une discussion parlementaire. Le Gouvernement d’Édouard Balladur qui, en 1993, avait allongé la durée de cotisation de 37,5 à 40 ans, retenu pour le calcul de la pension du régime de base, les 25 meilleures années en lieu et place des 10 meilleures et modifié les règles d’indexation, avait opté pour la voie réglementaire, ce qui lui avait été reproché. En France, par ailleurs, la fixation de règles automatiques n’empêche pas les gouvernements de s’y soustraire. Il en est ainsi fréquemment avec le taux du Livret A. À défaut, les gouvernements changent les règles en fonction de considérations politiques ou économiques. Que ce soit sur l’âge de la retraite ou sur le montant des pensions, les gouvernements étrangers sont également obligés de composer avec leur opinion publique et parfois de contourner les règles. Compte tenu des enjeux, la gestion des régimes de retraite suppose un minimum de souplesse même si l’existence d’un cadre prédéfini permet d’atténuer les tensions et de dédramatiser les mesures à prendre. La mise en place d’un système de gestion pilotée suppose un minimum de consensus au sein de la classe politique sur le sujet des retraites. Un tel consensus n’existe pas en France. L’opposition, quelle qu’elle soit, critique les réformes proposées par les gouvernements. Certains partis défendent même l’idée d’un retour à la retraite à 60 ans ou d’une annulation pure et simple des différentes mesures prises depuis 1993. Ces différents facteurs rendent difficile l’instauration d’un dispositif de guidage automatique des dépenses.
A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne
Le Plan d’Épargne Retraite deux ans après
À l’occasion de la sortie du guide d’Yvan Stolarczuk et de Philippe Crevel sur le Plan d’Épargne Retraite, la rédaction du Mensuel du Cercle de l’Épargne propose de revenir sur les résultats de ce nouveau produit ainsi que sur ceux de l’enquête 2021 qui le concernent.
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est commercialisé depuis le 1er octobre 2019. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie lui avait fixé des objectifs ambitieux lors de la discussion de la loi PACTE qu’il a l’a créé : 300 milliards d’euros d’encours et 3 millions de souscripteurs en 2022. Sur l’encours, ce montant devait être atteint en reprenant l’ensemble des produits d’épargne retraite. Durant ces deux premières années, le PER a dû faire face à la pandémie qui n’est pas propice à l’épargne de long terme. Malgré tout, les résultats sont encourageants. À la fin du mois de novembre 2021, les PER individuels comptaient 2,5 millions d’assurés pour un encours de 27,1 milliards d’euros (+149 % sur un an), investi en unités de compte (UC) à hauteur de 48 %. La collecte nette atteint sur onze mois près de 4 milliards d’euros. En intégrant les PER collectifs, l’encours dépasse 40 milliards d’euros et le nombre d’adhérents, 4 millions. Cette montée en puissance a été rendue possible dans un premier temps par d’importants transferts en provenance des anciens produits d’épargne retraite. Depuis le second semestre 2021, les nouvelles adhésions sont devenues majoritaires. Malgré tout, l’objectif global de 300 milliards d’euros d’encours ne sera pas atteint au mois de mai. Il devrait se situer autour de 260 milliards d’euros.
Une épargne retraite, toujours souhaitée mais mise à mal par la crise sanitaire
Selon le baromètre 2021 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa, un recul de la propension à épargner en vue de la retraite était a été remarqué. 51 % des Français déclarent le faire en septembre 2021, contre 61 % en février 2019.
Si la part de ceux qui indiquent épargner régulièrement reste très stable autour de 30 %, une baisse notoire est enregistrée parmi ceux qui épargnent « quand c’est possible » : 34 % en 2019, 29 % en 2020, et 22 % seulement en septembre 2021. Ce recul de la pratique d’épargne touche également les différentes tranches de revenus, à l’exception des revenus moyens inférieurs. Les sondés qui estiment que leur pension sera insuffisante pour vivre correctement épargnent moins pour leur retraite. Ils ne sont plus que 41 % à épargner à cette fin (-16 points depuis février 2019), quand 75 % de ceux qui pensent que leur pension sera suffisante déclarent le faire, pourcentage quasi stable par rapport à il y a deux ans et demi. La crise sanitaire explique sans nul doute ce recul. Par son caractère hautement anxiogène, elle conduit les ménages, et en priorité les plus modestes, à privilégier l’épargne de précaution au détriment de l’épargne de long terme dans laquelle se loge l’épargne retraite.
Le PER, un produit qui atteint sa cible
Créé il y a deux ans, le nouveau plan d’Épargne Retraite, le PER, est déjà connu de 32 % des Français. Assez naturellement, sa notoriété s’accroît avec le niveau de revenus, de 28 % parmi les personnes gagnant moins de 2 000 euros par mois à 51 % parmi celles qui gagnent plus de 4 000 euros. Ce ratio atteint 57 % parmi les détenteurs d’actions, de PEA et d’obligations. C’est aussi le cas de 55 % de ceux qui ont déjà un produit d’épargne-retraite. Le produit est connu par les plus de 50 ans et par les hommes plus que les femmes.
Une majorité des cadres supérieurs et professions libérales connaissent le PER. En raison de leur niveau de revenus, de la faiblesse de leur taux de remplacement à la retraite et de l’incitation fiscale associée au produit, ils en constituent la cible numéro 1. Il est moins connu en revanche, des ouvriers voire des employés.
Qui veut souscrire un PER parmi ceux qui le connaissent ?
Concernant la souscription du PER ou l’intention de le faire, un peu plus d’un tiers des personnes qui en ont entendu parler pourrait y souscrire, voire l’ont déjà fait. Calculé sur l’ensemble de la population, 3 % déclarent avoir déjà souscrit un PER, 2 % l’envisager « certainement » et 6 % « probablement », ce qui représente au total un Français sur dix souscripteur effectif ou potentiel. Selon le placement que l’on effectue déjà pour sa retraite, c’est parmi ceux qui épargnent régulièrement que le PER est le plus susceptible de faire des émules. Toutefois, une petite partie des épargnants occasionnels ou encore des non-épargnants pourrait y souscrire.
Sans surprise, ceux qui se rapprochent de la retraite sont ceux qui ont le plus souscrit de PER ou qui sont le plus susceptibles de le faire. Avec la montée en âge, le taux d’épargne tend à augmenter. Par ailleurs, la prise de conscience des besoins à la retraite est également plus fine à 50 ans qu’à 35 ans.
S’il y a plus d’ouverture de PER chez les cadres et les professions libérales, en matière d’intention de souscription, les professions intermédiaires arrivent en tête. L’inquiétude des cadres vis-à-vis de la retraite est assez élevée expliquant sans nul doute leur souhait de souscrire un PER.
Le niveau de revenus joue un rôle important dans la souscription d’un produit d’épargne retraite. Il faut être en mesure d’épargner à long terme et de ne pas être contraint pas des obligations financières (remboursement d’emprunts, éducation des enfants, etc.). 61 % des sondés gagnant plus de 4 000 euros ont ouvert un PER ou sont susceptibles d’en ou d’en ouvrir un, contre 41 % pour ceux gagnant moins de 2 000 euros (sachant que la question n’a été posée qu’à ceux qui connaissaient le PER).
Les détenteurs de patrimoine financier sont, sans surprise, les plus susceptibles d’avoir ou d’ouvrir un PER.
Parmi les épargnants, le PER s’impose en particulier chez les détenteurs de PEA et de produits d’épargne retraite. Ce sont donc des personnes disposant déjà de produits d’épargne de long terme et qui ont déjà acquis un produit retraite. De nombreux PER qui ont été ouverts en 2020 et 2021 l’ont été par transfert d’anciens produits d’épargne retraite. Sachant qu’avec l’application par défaut de la gestion profilée pour le PER, une partie de l’épargne investie est placée sur les marchés (avec une sécurisation progressive avec l’âge), il est assez logique que ce soit les épargnants qui possèdent des actions qui aient la plus forte appétence dans le PER. Ce sont également ceux qui épargnent le plus.
Le Plan d’Épargne Retraite s’est installé dans un contexte chahuté dans le paysage de l’épargne et de la retraite. Il permet aux Français de se constituer un complément de revenus ou de capital en vue de la retraite tout en finançant l’économie. L’instauration d’une sortie en capital est plébiscitée par les souscripteurs qui entendent pouvoir gérer avec souplesse leur épargne capitalisée.
A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne
Honni soit le patrimoine
Dans une note dénommée, « Repenser l’héritage », publiée à la fin du mois de décembre, le Conseil d’Analyse Économique, souligne la montée des inégalités au niveau de la détention du patrimoine entre les ménages français. Il propose une remise en cause de fond en comble de la taxation des droits de succession afin de lutter contre la montée des inégalités liées à la détention du patrimoine.
Le fantasme du grand retour du rentier
En France, le mot rente est connoté négativement. Le rentier est souvent dépeint comme un inactif, un oisif profitant du travail des autres. En France, le terme de rentier renvoie à une image sociale, les possédants, les détenteurs de capitaux qui exploitent les masses laborieuses. Honoré de Balzac, dans ses romans, aime à fixer l’importance de ses personnages au montant de rentes perçues, rentes issues alors des obligations émises par l’État. Ainsi, dans son roman « La cousine Bette », Balzac fait dire à son héros, « Crevel », « depuis trois ans, j’ai fait valoir mes capitaux, car mes fredaines ont été restreintes. J’ai trois cent mille francs de gains en dehors de ma fortune… ».
Avec l’augmentation rapide des prix de l’immobilier et la valorisation des actifs financiers, les rentiers seraient de retour. Si une montée des inégalités au niveau de la détention du patrimoine est indéniable, les nouveaux rentiers ne sont en rien comparables à ceux du XIXe siècle. Les obligations d’État rapportent peu. Par ailleurs, le capital comme les revenus que ce dernier génère sont soumis à une kyrielle d’impôts (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, taxation des plus-values, IFI, droits de succession, taxes foncières…).
Une formidable augmentation du patrimoine
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le montant du patrimoine s’est accru, en lien avec la progression du PIB et l’accumulation de génération en génération de biens immobiliers et de biens mobiliers. L’augmentation de la valeur du capital est le symbole de l’enrichissement global de la France depuis plus de 70 ans. Pour les seuls ménages, fin 2020, le patrimoine s’établissait à 13 440 milliards d’euros, soit 9,3 fois leur revenu disponible net. Cette comparaison par rapport aux revenus est sujette à caution car d’un côté figure un stock quand de l’autre est retenu un flux. L’héritage joue un rôle croissant dans la constitution du patrimoine. Les transmissions patrimoniales représentaient 15 % du revenu national en 2020, contre 5 % en 1950. La fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine des ménages en 2020 contre 35 % en 1970.
La croissance du patrimoine des ménages est avant tout le résultat de l’appréciation du prix des biens immobiliers. En vingt ans, leur valeur a été multipliée par deux. L’immobilier représente en France plus de 60 % du patrimoine total.
Le patrimoine non financier des ménages représentait, en 2020, 9 095 milliards d’euros, les biens immobiliers (constructions et terrains bâtis) en constituant 91 %. De son côté, le patrimoine financier net des ménages s’élevait, toujours en 2020, à 4 345 milliards d’euros.
Des inégalités patrimoniales en hausse
Les inégalités patrimoniales ne sont pas comparables à celles du XIXe siècle. L’impôt sur le revenu, la taxation des plus-values et les droits de succession jouent un rôle redistributif certain même si, ces dernières années, une inflexion est constatée en la matière du fait de la forte appréciation des actifs immobiliers et financiers.
En France, 1 % des ménages les mieux dotés en patrimoine détiennent 25 % du patrimoine contre 15 % en 1985. En 1914, les ménages du premier décile possédaient plus de 80 % du patrimoine. Ce taux est tombé à 50 % dans les années 1980 avant de remonter à 58 % dans les années 2010 (étude Banque de France de juin 2017). Aux États-Unis, en 2017, les 10 % les plus riches possédaient alors 80 % du patrimoine. En 1970, les 10 % les plus riches possédaient aux États-Unis 70 % du patrimoine contre 65 % au niveau européen. La montée des inégalités est avant tout concentrée sur les 1 % voire les 0,1 % les plus riches. Les 1 % les plus riches aux États-Unis détenaient 40 % du patrimoine américain en 2014 contre 30 % en 1970. En Europe, les 1 % les mieux dotés possédaient 22 % du patrimoine en 2014 contre 20 % entre 1970 et 1980.
Depuis 1998, le patrimoine des ménages les plus aisés a fortement augmenté. Pour ceux se situant au-dessus des 50 % les mieux dotés, la valorisation atteint plus de 100 %.
Les détenteurs de biens immobiliers, en particulier ceux qui sont propriétaires au sein des grandes agglomérations ou à proximité du littoral, sont les grands gagnants du processus de valorisation, même si, dans les faits il vaudrait mieux évoquer le terme d’inflation immobilière. Le propriétaire d’une résidence principale située dans une ville ayant connu une forte augmentation ne s’est pas réellement enrichi. S’il la vendait et s’il souhaitait en acquérir une autre de même nature, sa plus-value serait totalement absorbée dans le cadre de l’opération de rachat.
Le vieillissement de la population française participe, par effet d’accumulation sur la durée de la vie, à la progression du montant moyen des patrimoines des ménages. La majorité de celui-ci est détenue par les plus de 55 ans. Par ailleurs, nous héritons de plus en plus tard. L’âge moyen des héritiers dépasse 50 ans quand il y a cent ans, il était de 30 ans. Le montant des successions tend également à augmenter. 50 % des Français héritent de moins de 70 000 euros quand 10 % héritent de plus de 500 000 euros, 1 % plus de 4,2 millions d’euros et 0,1 % plus de 13 millions d’euros.
La fiscalité et l’égalisation des situations patrimoniales
Entre 1914 et 1980, les inégalités patrimoniales, au sein des pays occidentaux, ont fortement diminué. Pour des économistes comme Thomas Piketty, l’introduction de l’impôt sur le revenu et des droits de succession ont fortement contribué à ce processus. Les deux guerres mondiales, l’inflation et la crise de 1929 ont également joué un rôle non négligeable. En France, en 1945, le patrimoine des ménages ne représentait que quelques mois du PIB.
Le premier objectif de la fiscalité est d’assurer des ressources pour les pouvoirs publics de manière aussi neutre que possible sur le plan économique. La France se démarque par un niveau élevé de prélèvements obligatoires. Si les mesures prises en 2017 ont atténué la taxation du patrimoine, celle-ci demeure néanmoins parmi les plus élevées de l’OCDE. Selon un rapport de 2020 de cette organisation internationale, le poids des impôts sur le capital, en pourcentage de PIB, est le plus élevé en France, tant au sein de l’Union européenne que de la zone euro. Après avoir atteint un point bas à 9,4 % en 2009, le taux constaté en France s’est progressivement accru pour représenter 11 % du PIB en 2017 avant de baisser légèrement à 10,8 % en 2018. À titre de comparaison, le taux moyen constaté dans l’UE à 27 et dans la zone euro est de 8,5 % en 2018 quand celui de l’Allemagne est de 7,1 %. Le même constat est fait par la Commission européenne.
Selon Thomas Piketty ou le Conseil d’Analyse Économique (CAE), les impôts ne joueraient plus leur rôle de nivellement des inégalités patrimoniales en raison des dispositifs spéciaux qui ont été institués et dont profiteraient en particulier les ménages les plus aisés. Aux États-Unis, une très grande majorité des successions sont ainsi exonérées. En France, 40 % du patrimoine transmis chaque année, ne seraient pas soumis à des droits de mutation. Les petites successions en ligne directe échappent à l’impôt par le jeu de l’abattement de 100 000 euros et des exonérations dont bénéficie le conjoint survivant. Le montant moyen des successions est en France inférieur à 150 000 euros et le montant médian qui partage les héritiers en deux parts égales est inférieur à 50 000 euros.
Les droits de mutation connaissent, comme le reste de la fiscalité française, de nombreuses exceptions et autant de niches. Parmi les mécanismes permettant de réduire l’assiette des droits de mutation figure pour les biens professionnels le pacte Dutreil (coût fiscal de 2 à 3 milliards d’euros), le démembrement de propriété (coût fiscal de 2 à 3 milliards d’euros), l’assurance vie (coût fiscal de 4 à 5 milliards d’euros) et l’effacement des plus-values au moment du décès. Ces dispositifs qui bénéficient essentiellement aux contribuables les plus aisés accentueraient, selon le CAE, le processus de concentration du patrimoine.
Pour un changement des règles fiscales ?
Pour arrêter le processus de concentration du patrimoine, certains réclament le durcissement de la fiscalité, d’autres au contraire souhaitent sa réduction, notamment pour les donations. Le sujet de la fiscalité des successions est, en France, très sensible. Les Français craignent son augmentation. Surestimant son montant, ils pensent, pour une grande majorité d’entre eux, y être assujettis. Les Français, selon l’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa, réclament une baisse des impôts sur les donations parents-enfants. Cette idée avait été un temps soutenue par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Il l’a abandonnée car elle a été jugée par une partie même de la majorité actuelle comme peu sociale. Les donations étant réalisées par les contribuables les plus aisés, elles confortent la situation patrimoniale des enfants de ces derniers. Pour autant, la fiscalité ne peut pas tout. Il faut agir sur la spéculation en particulier dans le domaine de l’immobilier. La raréfaction du foncier, l’accumulation des normes, les politiques de soutien au logement favorisent la hausse de l’immobilier.
Les propositions du Conseil d’Analyse économique, la tentation du tour de vis
Le CAE propose une série de mesures dont l’adoption aboutirait à une forte augmentation de la fiscalité sur le patrimoine. Si certaines ne manquent pas d’intérêt, le parti pris est de relever le niveau des prélèvements en considérant que c’est la seule solution permettant de lutter contre les inégalités. Le CAE suggère de passer d’une taxation effectuée lors de la transmission à une taxation sur le flux successoral durant toute la vie. Les contribuables qui reçoivent plusieurs héritages seraient plus lourdement taxés qu’aujourd’hui. Cette mesure aurait un effet égalitaire évident. La remise en cause du Pacte Dutreil pourrait, en revanche, avoir des conséquences sur le plan des entreprises. Elle pourrait inciter des dirigeants d’entreprise à s’expatrier afin que leurs enfants puissent conserver la détention de l’entreprise familiale. Elle pourrait favoriser le rachat des PME par les grandes entreprises ce qui n’est pas, en soi, la meilleure solution pour densifier un tissu économique. Le CAE propose également de réduire l’avantage des démembrements qui aboutit à une réduction de l’assiette des droits de succession. S’il est indéniable que des montages sont réalisés dans un but purement fiscal, ils peuvent l’être également afin d’organiser une succession. Le Conseil suggère également de supprimer les avantages de l’assurance vie en matière successorale. Le processus de banalisation a déjà été entamé. Les exonérations les plus massives concernent les vieux contrats, ceux datant d’avant 1991 et les versements effectués avant 1998. Au fur et à mesure de l’avancement en âge des titulaires des contrats, le poids des exonérations diminuera. Il faut, par ailleurs, des espaces de liberté permettant de déroger au Code civil et au Code fiscal. Le CAE reprend à son compte l’idée de doter chaque Français, à sa majorité, d’un patrimoine de départ de 100 000 euros. Après l’hélicoptère money, l’hélicoptère patrimoine, après le revenu minimum pour tous, le patrimoine minimum pour tous. Si l’idée peut paraître séduisante, il faut néanmoins mettre en parallèle son coût et sa finalité. Nous vivons dans un monde où toute ressource est rare. La socialisation du patrimoine donne l’impression que la gratuité est possible pour tous et à tout moment. Néanmoins, cette idée pourrait jouer un rôle pédagogique et offrir pour de nombreux jeunes un potentiel économique pour développer une entreprise ou pour reprendre des études. Il serait également possible de prévoir l’ouverture d’un Plan d’Épargne en Actions ou d’un Plan d’Épargne Retraite afin d’inciter les Français à détenir des actions.
Les propositions du Conseil des Prélèvements Obligatoires
En 2018, le Conseil des Prélèvements Obligatoires avait dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine souligné son inefficience et son caractère peu lisible. Il avait demandé une plus grande prévisibilité et une meilleure prise en compte des intérêts économiques. Ces propositions concernaient l’ensemble de la fiscalité du patrimoine. Elles visaient à accroître la fluidité du patrimoine, à réduire les inégalités de traitement et à contribuer à réorienter l’épargne vers des placements longs. Les auteurs du rapport souhaitaient une refonte de la fiscalité des plus-values immobilières en supprimant le système d’abattement qui est fonction de la durée de détention. Le dispositif était jugé contre-productif en favorisant la rétention des biens. Le Conseil proposait que les plus-values soient calculées en prenant en compte l’érosion liée à l’inflation.
Le Conseil des Prélèvements Obligatoires envisageait l’unification de la taxation des revenus fonciers en supprimant le dispositif de loueur en meublé non professionnel. Sans surprise, il préconisait la révision des valeurs locatives qui n’a pas été effectuée depuis les années 70. Pour les droits de mutation à titre onéreux, le Conseil demandait leur allégement pour diminuer le coût des transactions, de les rendre progressifs voire de les associer à la taxe foncière. Pour l’assurance vie, le Conseil proposait alors de supprimer les abattements de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple et de supprimer le seuil de 150 000 euros d’encours à partir duquel le prélèvement forfaitaire unique de 30 % s’applique en lieu et place du taux de 24,7 %. Il souhaitait également que les taux d’imposition prennent en compte non plus la date de souscription des contrats mais celle des versements. Avec l’application du PFU, cette modification serait en l’état sans effet. Dans un souci d’harmonisation et afin d’encourager l’épargne longue, la durée du PEA serait portée de 5 à 8 ans. Du fait que les ménages héritent de plus en plus tard, après 50 ans, soit huit ans de plus qu’en 1980, le Conseil proposait d’encourager les donations en rapprochant les abattements de ceux en vigueur pour les successions. En contrepartie, il suggérait d’augmenter les droits de succession à titre gratuit et de limiter les avantages associés en matière de succession à l’assurance vie.
Les impôts sont tout à la fois honnis par ceux qui les paient ou ceux qui pensent un jour ou l’autre les payer et chéris par ceux qui ne les acquittent pas. La réinstauration de l’ISF est souhaitée par une majorité des Français considérant qu’il est logique de taxer les contribuables les plus aisés. Si l’assiette de cet impôt venait à englober tout le patrimoine des ménages quel que soit son montant, l’appréciation serait fort différente… Le patrimoine est un sujet de passion et donc de division. Il n’en finit pas de nourrir les fantasmes. Si de nombreuses études sont consacrées à sa fiscalité, en revanche, peu s’enquièrent de son rôle économique. La mobilisation du capital afin de garantir une croissance forte et pérenne serait un thème sans nul doute intéressant à développer.
A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne
Edito du mois de janvier 2022 de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne « Droit dans le mur ? »
En 1993, le Premier Ministre avait, quelques mois après sa nomination, réformé le système de retraite, au cœur de l’été, par voie réglementaire. Pour les réformes suivantes, les gouvernements ont opté pour la voie législative, plus longue, permettant une cristallisation des oppositions. La discussion des projets de loi tend à s’allonger et donne lieu à de multiples compensations mettant à mal les objectifs initiaux. La Cour des Comptes avait ainsi souligné que le gain de la refonte des régimes spéciaux de retraite avait été fortement réduit par les avantages consentis aux salariés concernés. Face à la retraite, tous les gouvernements ont peur. Lionel Jospin refusa de toucher à un cheveu de notre système de retraite de peur d’entamer ses chances de remporter l’élection présidentielle de 2002, précaution superfétatoire au vu du résultat final. Pour justifier son inaction, il multiplia les rapports de complaisance. Après l’adoption de la loi Fillon, en 2003, le Premier Ministre estimait à l’époque que celle-ci avait distendu les liens sociaux et demandait à ses ministres de restreindre leurs ardeurs réformatrices. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, dut ainsi reporter la refonte de l’assurance-maladie malgré de nombreuses séances de travail avec ses équipes. En 2010, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, limita le report de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, refusant de suivre son Premier Ministre et de nombreux experts qui auraient préféré fixer l’âge légal à 65 ans. Ensuite, François Hollande ne s’est rangé à l’idée de toucher au système de retraite qu’à contrecœur. En 2014, sa ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, opta ainsi pour un allongement différé de la durée de cotisation à 43 ans, son application complète ne s’appliquant qu’aux générations nées après 1972. Emmanuel Macron avait surpris en mettant en avant durant la campagne électorale sa volonté d’instituer un système unique par points avec comme slogan « un euro cotisé doit donner les mêmes droits pour tous ». L’unification des régimes et le recours à un système par points, portés de longue date par la CFDT et par feu l’UDF, étaient devenus une belle arlésienne des débats publics. En optant pour une réforme systémique, le nouveau Président de la République souhaitait, sur ce terrain miné, faire preuve d’audace. En lui adjoignant des mesures paramétriques, avec la fixation d’un âge pivot à 64 ans, et en laissant filer en longueur la discussion, celle-ci est devenue un chemin de croix. La crise sanitaire a eu raison de ce projet de loi. Le Président de la République, le 15 décembre dernier, l’a définitivement enterré, en dressant les grandes lignes d’un nouveau projet qui pourrait être présenté s’il était réélu au mois d’avril prochain. Il a abandonné la création du Gosplan de la retraite et s’est rangé, fort sagement, en faveur d’un système comportant trois régimes prenant en compte les spécificités des fonctions publiques, des salariés et des indépendants comme Le Cercle de l’Épargne le préconise depuis de nombreux mois. Le Président semble ainsi privilégier la convergence progressive en lieu et place l’unification technocratique. L’expérience vient avec la pratique, mais comme le souligne l’OCDE, la France est un des rares pays qui n’aura pas réformé son système de retraite depuis 2014. À force de laisser le temps au temps, le mur de la retraite et de la dépendance se rapproche à grande vitesse. D’ici le milieu de la décennie, les générations les plus nombreuses du baby-boom arriveront à l’âge de la retraite quand les premières atteindront les 80 ans, âge marqué par une forte progression du risque de dépendance.
Jean-Pierre Thomas
A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne
Les taux de rémunération du livret A et du livret d’épargne populaire augmenteront en février
A quelques jours de l’annonce du taux de rémunération du Livret A applicable à compter du 1er février prochain, le Parisien rappelle l’estimation réalisée en novembre par le Cercle de l’Epargne. Ainsi selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, le taux du livret A pourrait être rehaussé aux alentours de 0,7 ou 0,8 %.
Epargne : Faut-il (vraiment) se réjouir de la hausse à venir du taux du livret A ?
Cité dans 20 Minutes, Philippe Crevel estime que le relèvement du taux du Livret A ne fera pas que des heureux. il précise ainsi qu’«il engendre des frais importants pour la Caisse des dépôts [l’organisme public qui centralise environ 60 % de l’épargne réglementée], car les titres monétaires qui permettent d’assurer la liquidité du Livret A sont actuellement rémunérés à – 0,5 %. »
L’assurance-vie continue à attirer l’épargne des Français
Sur Investir, dans un article consacré à la collecte de l’assurance vie en novembre, le directeur du Cercle de l’Epargne explique que le maintien à haut niveau de la collecte en unités de compte par « la bonne tenue des marchés et la baisse du rendement des fonds euros expliquent , explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne. Collecte qui est encouragée, par ailleurs, par les assureurs. »
Deuxième mois consécutif à découvert pour le livret A
Invité à commenter la décollecte du Livret A constatée en novembre, Philippe Crevel indique que « le mois de novembre est traditionnellement un mois de décollecte. Avec la proximité des fêtes et notamment le « black Friday , les Français se sont faits plaisir. En outre, en novembre, ils ont dû s’acquitter des impôts locaux (taxe d’habitation pour les 20 % des ménages qui y sont encore assujettis et taxe foncière) ».
Une décollecte plaisir de fin d’année
Paris, le 21 décembre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats du Livret A – novembre 2021
Une décollecte plaisir de fin d’année
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Comme au mois d’octobre, sur fond de rebond de la consommation, les ménages ont, le mois dernier, puisé dans leur Livret A. La décollecte a ainsi atteint, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, 90 millions d’euros, contre -2,83 milliards d’euros en octobre. Ce résultat n’est pas une surprise. Le mois de novembre est traditionnellement un mois de décollecte. Lors de ces dix dernières années, le mois de novembre a, donné lieu, à cinq reprises, à une décollecte ou à une toute petite collecte (autour de 200 millions d’euros). Avec la proximité des fêtes et notamment le « black Friday », les Français se sont faits plaisir. En outre, en novembre, ils ont dû s’acquitter des impôts locaux (taxe d’habitation pour les 20 % des ménages qui y sont encore assujettis et taxe foncière).
La décollecte du Livret A traduit la baisse du taux d’épargne des ménages qui est passé de 21 % du revenu disponible brut à 17 % de la fin 2020 au troisième trimestre 2021. Malgré tout, l’encours du Livret A en novembre, s’établit à 343,4 milliards d’euros. Il reste supérieur de 40 milliards d’euros à son niveau d’avant crise. Les ménages puisent avec parcimonie dans leur cagnotte.
Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte cumulée du Livret A a atteint 16,87 milliards d’euros, contre 27,83 milliards d’euros sur la même période en 2020. Pour l’année 2019, avant la crise sanitaire, la collecte cumulée s’était élevée à 14,24 milliards d’euros.
Pour les prochains mois, l’évolution du Livret A risque d’être affectée par la résurgence de l’épidémie. La baisse du moral des ménages pourrait conduire au retour de fortes collectes pour le Livret A et cela d’autant plus si des mesures sanitaires restrictives étaient mises en œuvre. Les premiers mois de l’année prochaine devraient donc être favorables à la collecte du Livret A qui devrait, en outre, bénéficier d’une légère revalorisation de son taux. Compte tenu des taux des marchés monétaires et de l’inflation, le Gouvernement pourrait retenir un taux entre 0,8 et 1 %. Le rendement réel du Livret A resterait malgré tout négatif. Si le taux était fixé à 1 %, le gain sur un an pour un Livret A de 5 000 euros serait de 25 euros. Pour un Livret A au plafond, 22 950 euros, le gain serait de 114 euros. Le coût global pour les banques et la Caisse des dépôts du surcroit de rémunération pour le seul Livret A serait de 1,7 milliard d’euros.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Les Français ont continué à surépargner en 2021
Cité dans le Figaro, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne estime que «le dégonflement de la cagnotte covid n’a pas encore commencé».
Assurance-vie, livrets : comment préserver votre capital?
Dans les colonnes de Paris Match, Philippe Crevel explique comment inflation et taux bas entament la rentabilité des produits de taux. Il précise en en effet que « sur des produits de taux, comme des livrets, lorsque l’inflation augmente, le rendement réel du placement diminue ». Pour contrecarrer cet état de fait, il préconise une plus grande prise de risque
Taux du Livret A : 3 scénarios pour une hausse
Quel sera le taux du Livret A à compter du 1er février 2022 ? Dans cet articles, Philippe Crevel est invité à s’exprimer sur les différents scénarios possibles. Il évoque notamment l’impact pour les épargnants et pour les comptes publics des différentes hypothèses.
Retraite à 60 ans : les solutions de financement de Jean-Luc Mélenchon sont-elles viables ?
Invité à réagir à l’annonce du candidat de la France Insoumise de revenir à la retraite à 60 ans s’il était élu Président, le directeur du Cercle de l’Epargne chiffre cette mesure à 30 milliards d’euros minimum.
Le taux du livret A augmentera en janvier, annonce Bruno Le Maire
Souhaitant prendre en compte le retour de l’inflation, le ministre de l’économie et des finances a indiqué que le taux du Livret A serait relevé au 1er février prochain. Selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, cité dans le Nouvel Observateur, le nouveau taux du Livret A devrait se situer « entre 0,7 % et 1 % ».
Augmentation du taux du Livret A en janvier : réelle bonne nouvelle ?
Bruno Le Maire vient d’annoncer une hausse du taux de rendement du Livret A au 1er février 2022 afin de compenser le retour de l’inflation. Dans un interview publiée sur Planet.fr, Philippe Crevel commente cette décision.
Dans un article consacré à la hausse à venir du Livret A, Challenges cite le directeur du Cercle de l’Epargne qui estime que le nouveau taux devrait se situer « entre 0,7% et 1% ».
La longue marche de la prévoyance
Cet article est tiré de l’intervention de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, prononcée le 15 novembre 2021 dans le cadre de la réunion « Culture Branches », organisée par la Direction des Branches Professionnelles d’AG2R LA MONDIALE, réunion qui a donné lieu à la publication d’un rapport, « Prévoyance : état des lieux et perspectives » rédigé par un groupe de réflexion placé sous l’autorité d’André Renaudin.
La prévoyance existe depuis la nuit des temps. Nous la pratiquons sans trop le savoir comme le fait Monsieur Jourdain avec la prose. Elle est associée à l’assurance et à la providence. Cette dernière est l’action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu’il leur a assignée. La providence est une personne ou un événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation. Elle est ainsi assimilée à un secours exceptionnel. De manière plus technique, la prévoyance désigne l’ensemble des contrats et garanties qui couvrent les risques sociaux liés à une personne en cas de décès ou d’arrêts de travail causés par une invalidité, une incapacité ou une maladie. Elle permet de garantir un niveau minimal de revenus et peut également comporter des services (aides à domicile, gardes d’enfants, rente éducation, etc.). La prévoyance comme l’assurance sont des très bons indicateurs du niveau de développement économique et social d’une nation. Elles sont une condition et une conséquence de la croissance. En contribuant à réduire les risques, à diminuer les effets des accidents de la vie, elles favorisent l’initiative et la création de richesses.
3 500 ans de prévoyance
L’histoire de la prévoyance remonte à l’histoire Antique. Les premiers contrats visant à pérenniser l’activité et la situation financière des agents économiques datent de plus de 3 500 ans. En Mésopotamie avec le prêt de bonne aventure, les marchands phéniciens mettent en place un dispositif de solidarité. En cas de perte de marchandises lors d’une infortune de mer, les marchands prêtent dans des conditions privilégiées une somme d’argent afin que la victime puisse continuer son activité. Ce système de mutualisation s’organise alors au sein d’une branche professionnelle, celle des marchands au long cours.
Quelques milliers d’années plus tard, en 1670, la prévoyance prend une forme plus directe. Le Roi de France, Louis XIV décide, en effet, avec la création de l’institution des Invalides de secourir les militaires âgés ainsi que les blessés. Pour les accueillir, l’hôpital des Invalides est édifié. Le soutien apporté à ces soldats, qui est tout à la fois pécuniaire et sanitaire, correspond bien à l’image que l’on se fait aujourd’hui de la prévoyance, à savoir la faculté de couvrir les personnes en cas de pertes de revenus, d’incapacité, d’invalidité ou de décès. La décision du Roi Soleil est liée au changement de nature de la guerre. Celle-ci mobilise un nombre croissant de soldats qui sont confrontés aux dangers d’armes plus dévastatrices que dans le passé avec l’usage massif de l’artillerie. En 1673, Colbert décide la création d’un régime de protection sociale en faveur des marins. L’objectif est de sécuriser une profession pénible dont les membres sont parfois tentés d’exercer en dehors de tout cadre légal. Toujours dans un souci d’attractivité, Louis XIV fait de même avec les danseuses de l’Opéra. Il s’agit alors d’attirer les meilleurs talents d’Italie en leur promettant une couverture sociale. Ces deux régimes ont perduré jusqu’à nos jours.
La Révolution de 1789 et la Révolution industrielle ont eu d’importantes conséquences sur l’organisation de la protection sociale. La première met fin aux mécanismes traditionnels de solidarité (église, compagnonnage, guildes) en interdisant, avec la loi Allarde et la loi Le Chapelier, la constitution de groupements professionnels et de corporations. Le conflit avec l’Église catholique, qui ne se dénouera qu’au début du XXe siècle, a fortement influencé la conception de la protection sociale tout autant que la peur que provoquait, à l’époque, le phénomène syndical. La seconde contribue également à détruire les anciennes solidarités, les paysans quittant leur campagne pour se rendre dans des usines. Si auparavant les familles étaient le cœur de la solidarité en cas d’incapacité d’un de leurs membres, avec la révolution industrielle, les salariés se trouvent isolés, sans revenus, en cas de problèmes. Le salaire n’a alors pour objectif que le maintien de la force productive. Quand l’ouvrier cesse d’être apte au travail, il perd ses revenus. Malgré les interdictions de regroupement syndical, des mutuelles des sociétés de secours, des bourses du travail, des entreprises – sous l’égide de patrons dits sociaux – mettent en place des garanties, des couvertures sociales au cours du XIXe siècle. Encore très incomplètes, elles ne couvrent qu’une petite partie des actifs. En parallèle de la montée en puissance de la mutualisation des risques, l’épargne est également encouragée au nom de la prévoyance. Le Livret d’épargne qui deviendra plus tard le Livret A est pour ses initiateurs tout autant un outil d’épargne qu’un outil pédagogique visant à encourager les ménages à tenir une comptabilité et à mettre de l’argent de côté pour faire face à d’éventuels problèmes. C’est ainsi que se mettent en place les caisses d’épargne et de prévoyance. Ce nom perdurera jusqu’en 2000 avec la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance.
La prévoyance en évolution permanente
La prévoyance s’adapte en permanence au contexte économique et sociétal. Elle est comme l’ensemble de l’assurance un miroir de la société. Avec le XXe siècle, elle a été amenée à couvrir des risques de plus en plus nombreux. Après deux guerres mondiales et une grande crise économique, celle de 1929, les partenaires sociaux décident ainsi de mettre en place un système global de protection sociale couvrant la quasi-totalité des Français. Une partie de la prévoyance se retrouve englobée dans le nouvel ensemble que constitue la Sécurité sociale. Néanmoins, surtout en ce qui concerne les conséquences des incapacités professionnelles, l’égalité de traitement entre les différentes catégories sociales et les différents statuts professionnels n’est pas réalisée. Les indépendants, les fonctionnaires ne sont pas traités comme les salariés du privé. La prévoyance a été un espace qui a été laissé à la négociation de branche après la Seconde Guerre mondiale. L’hétérogénéité des situations et les divergences entre les partenaires sociaux expliquent cette spécificité. Le travail dans les mines, dans les entreprises sidérurgiques n’est pas de même nature que celui dans les banques ou dans le commerce. Le principe d’une personnalisation des accords de branche s’imposait en matière de prévoyance.
La prévoyance est, par nature, un droit évolutif, c’est une vis sans fin. Elle suit les mouvements de la société, les injustices et leur ressenti. La prévoyance ne peut pas rester statique. Elle tient compte du changement de perception de l’égalité.
L’égalité de droit qui fut le combat des premiers révolutionnaires a été complétée au XXe par la recherche d’une égalité de protection matérielle. Ainsi, à l’égalité devant la loi, il a été ajouté une « égalité matérielle relative » avec l’octroi par exemple de prestations en fonction des revenus. Avec les années 2000, il est admis que l’égalité matérielle ne suffit plus pour corriger les inégalités. L’instauration des discriminations positives vise à corriger des situations inscrites dans les sociétés et jugées injustes. L’obtention de l’égalité de traitement est une notion de plus en plus complexe. Elle est à multiples entrées comme le prouve le mouvement « woke ». Elle est centrée sur l’individu mais prend en compte des facteurs culturels, sociologiques, historiques qui le dépassent. La prévoyance ne peut pas rester indifférente à cette évolution. Les couvertures sociales se doivent tout à la fois de prévenir, de garantir le niveau de revenus et le cas échéant de corriger des injustices comme l’exposition par exemple à des activités pénibles durant la vie professionnelle. La correction des inégalités prend de plus en plus en compte tout à la fois les origines, le lieu d’habitation, la formation, le sexe, etc.
La société évolue à grande vitesse. Elle est moins patriarcale qu’auparavant, même si d’importants progrès restent à réaliser. La prévoyance ne peut pas demeurer indifférente à cette mutation. En 2020, en France hors Mayotte, 68 % des femmes de 15-64 ans participent au marché du travail contre 75,8 % des hommes de la même classe d’âge. Sur longue période, l’écart de taux d’activité entre les femmes et les hommes s’est considérablement réduit : il est passé de 31 points en 1975 à 8 points en 2018. Les inégalités entre les hommes et les femmes apparaissent d’autant plus injustifiées que ces dernières sont désormais plus diplômées que les premiers. 60,7 % d’entre elles ont au moins le baccalauréat, soit 6,7 points de plus que leurs homologues masculins. Au niveau de l’enseignement supérieur, 26 % des femmes sont diplômées contre 23 % des hommes. L’écart des salaires hommes/femmes baisse mais demeure de 16 % en 2020 (contre 20 % en 2009). Le droit social reste encore marqué par ses origines masculines même si ces dernières années, la recherche d’une plus grande égalité est à mettre au crédit du législateur.
Le rapport au travail, à la vie familiale est également modifié par les évolutions des structures familiales. 60 % des enfants naissent hors mariage en 2020, contre 10 % en 1978 ; 25 % des familles sont monoparentales en 2020, contre 8 % en 1975. Ces familles monoparentales sont très majoritairement composées d’une mère de famille et de ses enfants. La mère doit tout à la fois exercer un travail et s’occuper, seule, d’un ou plusieurs enfants. Avec la concentration des emplois au sein des grandes agglomérations, cette dernière n’est pas automatiquement soutenue par sa famille.
L’urbanisation qui s’est accélérée après la Seconde Guerre mondiale n’est pas sans influence sur la structuration des solidarités. Selon l’INSEE, en 2020, plus de neuf Français sur dix, soit 93 % de la population, vivent dans l’une des 699 aires d’attraction d’une ville. 63 % de la population vit dans une agglomération de plus de 200 000 habitants. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 50 % de la population vivait en milieu rural (moins de 2000 habitants par commune). Certains disent que l’épidémie de covid a mis un terme au processus d’urbanisation et que les ménages souhaitent revenir à la campagne. Si les rêves de changement de vie, de retour à la terre sont réels, le passage à l’acte est loin d’être majoritaire. Les Français aspirent certes à des logements plus grands et à des villes de taille plus humaine, ils font néanmoins de l’accès à des services de qualité (santé, éducation, moyens de transport) une priorité. Ce souhait, qui était déjà exprimé avant la crise sanitaire, se confirme après. C’est avant tout les agglomérations entre 100 000 et 200 000 habitants comme Angers, La Rochelle, Le Mans, Niort, Reims ou Ajaccio qui bénéficient de ces aspirations.
La prévoyance et le travail, unis pour la vie
La prévoyance a pris une tout autre dimension avec la révolution industrielle du XVIIIe siècle. En modifiant la nature du travail, l’industrialisation, avec le développement des mines, de la sidérurgie et la construction d’usines avec des milliers d’ouvriers, a dessiné les contours de la prévoyance. Depuis 250 ans, la mutation du travail n’en finit pas, obligeant les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à revoir en permanence les modalités de la prévoyance.
En France, la population agricole ne représente, en 2019, que 2,5 % de la population active, contre 40 % à la sortie de la guerre. L’industrie occupe 12 % de la population, active contre 40 % au début des années 1970. Le secteur tertiaire occupe 76 % de la population active, contre 50 % il y a 50 ans. Le secteur tertiaire couvre de larges secteurs et un grand nombre d’emplois très différents. Il regroupe, en effet, le secteur financier, les services aux entreprises, les administrations publiques, la distribution, les transports, etc. Il comprend des emplois à faible valeur ajoutée et des emplois exigeant de très fortes qualifications. Les métiers du service ont profondément évolué à compter des années 1980 avec l’informatisation. La taylorisation avec une répartition des tâches a été effectuée. Le management est devenu plus horizontal, plus informel. La notion d’équipe est à géométrie variable. La montée en puissance du secteur tertiaire et la désindustrialisation ont modifié la nature des emplois. Tout un symbole, Eurodisney est devenu le premier lieu touristique de France et le premier site en termes d’emploi.
La digitalisation du travail, un nouveau défi pour la prévoyance
La digitalisation accélère l’autonomisation du travail. Elle change le contenu du travail salarié et conduit également à modifier la structure de l’emploi avec le recours croissant aux micro-entrepreneurs dans le cadre des plateformes de services en ligne.
Le télétravail, qui s’est largement diffusé avec l’épidémie de Covid-19, s’inscrit dans ce processus. Le travail devient hors-sol, déconnecté du lieu dans lequel il s’accomplit. Le développement du flex office, le salarié n’ayant plus dans ce système de bureau attitré, symbolise cette évolution. Au sein de Vinted, une entreprise lituanienne de vente de biens d’occasion en ligne, la directrice juridique n’a pas de bureau. Elle travaille où elle le souhaite et supervise une équipe de juristes aux quatre coins de la planète. Elle les réunit dans des hôtels une à deux fois par an à Berlin ou ailleurs. Ce type d’emploi qualifié de « full remote » concerne, en premier lieu, le monde digital mais commence à se diffuser au-delà de ce secteur d’activité. Cette évolution modifie les rapports, les liens professionnels. Les frontières entre vie privée et vie professionnelle s’estompent. Le domicile devient un bureau, un lieu de travail. Où s’arrête alors la responsabilité de l’employeur ? Quels sont ses devoirs, ses obligations ? Les régimes de prévoyance, en cas d’accident du travail à domicile s’appliquent-ils et comment ?
L’autre grande mutation du monde du travail est l’essor, depuis une dizaine d’années, des micro-entrepreneurs, essor qui a été facilité par la montée en puissance des applications digitales (VTC, livreurs à domicile). Depuis la sortie du premier confinement, le rythme de création d’entreprises est en forte hausse, plus d’un million en rythme annuel, un record absolu dont la moitié est constituée de micro-entrepreneurs. Fin 2019, les auto-entrepreneurs représentent près d’un indépendant sur deux (47,6 %) parmi les inscrits. 68,4 % sont dits « économiquement actifs » parce qu’ils génèrent un chiffre d’affaires positif sur l’année. Il convient néanmoins de relativiser la situation. En 2020, 90 % des actifs ayant un emploi sont des salariés. Trois quarts bénéficient d’un contrat à durée indéterminée et 10 % d’un CDD ou d’un contrat en intérim (stable depuis de nombreuses années). Les indépendants, dont le nombre était en baisse constante de 1945 à 2009, représentaient 20 % de la population active en 1970 et 10 % en 2016 avant de remonter autour de 11 %. Depuis dix ans, leur proportion est en hausse en raison de l’essor des micro-entrepreneurs.
Le défi du vieillissement de la population
La révolution démographique en cours a de multiples conséquences sur la prévoyance. La France, comme ses partenaires, vieillit. L’âge médian est de 42 ans en 2021, contre 37 ans en 1991 et 35 ans en 1971. En 2050, il devrait être de 50 ans. Le Baby-boom se transforme fort logiquement en papy-boom, papy-boom qui est d’autant plus marqué que l’espérance de vie à 65 ans s’est fortement accrue depuis 1945. L’espérance de vie à l’âge du départ à la retraite a fortement augmenté passant de 1950 à 2020 de 15 à 25 ans.
Avec le vieillissement de la population, les dépenses liées aux incapacités ne peuvent que s’accroître. Les actifs sont les premiers concernés. Le report de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans a généré en matière de prévoyance plus de 2 milliards d’euros de dépenses supplémentaires, soit l’équivalent de 20 % des gains de la réforme. Un passage de l’âge légal à 65 ans aurait évidemment un coût supérieur. L’espérance de vie en bonne santé à 65 ans augmente mais faiblement. Il était, en 2020, de 12,1 ans pour les femmes et de 10,6 ans pour les hommes. Le développement de la prévention durant la vie active constitue une priorité. Or, en France, la prévention n’a pas été jugée prioritaire par les pouvoirs publics. L’adaptation du travail afin de pouvoir maintenir en emploi une population plus âgée constitue également une nécessité. Faut-il prévoir des mécanismes assurantiels pour lisser les effets de l’ancienneté sur les rémunérations ? Comment faciliter les départs progressifs à la retraite ?
Les baby-boomers nés en 1945 auront 85 ans en 2030. Le nombre des 75-84 ans va enregistrer une croissance inédite de 49 % entre 2020 et 2030, passant de 4,1 millions à 6,1 millions. Le nombre de personnes dépendantes devrait, de ce fait, doubler d’ici 2050. 4 millions, contre 2 millions aujourd’hui. La création d’une 5e branche est un début de réponse qui demeure néanmoins incomplète. La montée en puissance du nombre de personnes dépendantes exigera un effort financier et un effort en termes de main-d’œuvre important. Sur la couverture dépendance, les Français sont un peu perdus. Selon l’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa/AG2R LA MONDIALE, 48 % des sondés sont favorables à une couverture obligatoire collective quand 52 % préfèrent des mécanismes assurantiels individuels.
Faut-il demander un effort aux actifs qui doivent déjà financer les retraites de leurs parents et l’éducation de leurs enfants ? Faut-il mettre en place une solidarité au sein des retraités à travers une assurance obligatoire souscrite dès le départ à la retraite ?
Aujourd’hui, on compte près de 4 millions d’aidants dont 2 millions sont les enfants des personnes concernées. Cumuler travail, éducation éventuelle des enfants et aide à une personne dépendante est un véritable défi. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement marque un véritable progrès avec une reconnaissance du rôle des aidants. Elle prévoit notamment un droit au répit pour les proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes atteintes de handicap et des congés proches aidants. La reconnaissance du rôle des aidants est un progrès. Il n’en demeure pas moins qu’avec l’éclatement des familles, l’éloignement géographique, l’augmentation du nombre des personnes dépendantes, les aidants pourraient se faire de plus en plus rares dans les prochaines années. Ce problème s’ajoutera à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé.
Nouveaux risques, nouvelles prévoyances
Au-delà de l’approche professionnelle et démographique, la société doit faire face à la résurgence de risques ou à l’émergence de nouveaux.
Les épidémies provoquent des ruptures dans le continuum temps. Sur le plan des idées, des politiques économiques et des arts, les épidémies par leur brutalité, par leur soudaineté, génèrent des inflexions. Elles accélèrent des tendances de fond. La grande peste du XIVe déboucha sur des gains de productivité au niveau de l’agriculture et sur la Renaissance. La recherche d’un nouveau monde mobilisa au XVe siècle les grands navigateurs. L’épidémie de choléra durant la monarchie de Juillet déboucha sur la mise en place de politiques de santé publique. La réalisation de l’assainissement et l’amélioration de l’hygiène en furent des conséquences. La grippe espagnole, couplée à la Grande guerre, amena, en Europe, la taylorisation, les Années folles… L’épidémie de covid n’échappe pas à la règle. Elle accentue des tendances qui avaient cours avant dont, évidemment, la digitalisation des activités. Elle s’inscrit dans un cadre plus large d’évolution de la société qui n’est pas sans conséquence sur le concept de prévoyance. L’épidémie de covid a conduit des millions de personnes à ne plus pouvoir exercer leur travail, soit car celui-ci était soumis à des fermetures administratives soit parce qu’elles devaient garder leurs enfants privés d’école. Les mécanismes d’assurance ne peuvent pas couvrir ce type d’aléa, surtout en cas de sinistre généralisé. Malgré tout, cette épidémie amène à réfléchir sur les niveaux de couvertures et sur leurs modalités de déclenchement.
Le réchauffement climatique avec la multiplication des évènements météorologiques extrêmes peut également provoquer des arrêts subis de travail (température excessive, inondations, tempêtes), des problèmes de santé, etc. Pour un ouvrier du bâtiment, pour un livreur, les canicules à répétition ne sont pas sans conséquence.
Le risque cybernétique est de plus en plus à prendre au sérieux. Ces derniers mois, des hôpitaux ont été piratés avec des demandes de rançon, ce qui les a obligés à réduire leur activité. En 2020, plus de 10 000 entreprises ont été concernées, avec des possibles arrêts d’activité et des préjudices importants.
Les nouvelles formes de travail, les nouvelles organisations de travail, les nouveaux risques ainsi que l’apparition de nouvelles demandes de la part de la population, amènent la prévoyance à évoluer, à se moderniser. En tant que miroir de la société, elle est obligée de s’adapter. C’est une vieille idée qui a vocation à rester jeune.
La prévoyance vit au rythme des mutations économiques et sociales. Les acteurs économiques doivent, de ce fait, se remettre, en permanence, à l’ouvrage pour la refaçonner et répondre aux besoins ainsi qu’aux attentes de la population. Déjà le Cardinal De Richelieu soulignait, en son temps que « Rien n’est plus nécessaire au gouvernement d’un État que la prévoyance, puisque par son moyen, on peut aisément prévenir beaucoup de maux, qui ne se peuvent guérir qu’avec de grandes difficultés quand ils sont arrivés. ».
Le Conseil d’Orientation des Retraites et les hypothèses économiques
Depuis des années, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) est jugé optimiste en matière de prévisions économiques, sachant que ces dernières conditionnent les équilibres des régimes de retraite. En 2017, le COR avait abandonné son hypothèse haute de 2 % de gains de productivité. L’éventail avait été ainsi réduit entre 1 et 1,8 %. Compte tenu des dernières données économiques disponibles, le COR a retenu de nouvelles valeurs plancher et plafond. Désormais, ses scénarii s’étageront entre 0,7 et 1,6 %, faisant de l’ex-plancher de 1 % le scénario médian. La France rejoint ainsi l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, où la productivité attendue dans le futur évolue autour de 1 %.
La variable des gains de productivité influe sur le niveau des salaires et donc des rentrées de cotisations. Une moindre évolution de la productivité accroît les déficits, sachant que les pensions sont plus ou moins indexées sur l’inflation et non aux salaires moyens. L’ensemble des mesures prises lors des réformes des retraites successives adoptées depuis 1993, hors désindexation des pensions sur l’inflation, aurait réduit la part des dépenses de retraite dans le PIB de 2,4 à 2,8 points à horizon 2070, quand la seule désindexation aurait un effet de 3,5 à 5,5 points. Avec des gains de productivité moindres, les gains seront encore plus faibles dans les prochaines années.
Les économistes consultés par le COR ont retenu pour le chômage de long terme un taux de 7 %, même si certains appelaient à retenir un taux de 8 % voire 9 %. Quant aux hypothèses de durée du travail et de partage de la valeur ajoutée, ils ont trouvé plus raisonnable de ne rien changer.
Démographie, de quoi sera fait demain ?
Selon les dernières prévisions de l’INSEE, au 1er janvier 2070, si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, la France compterait 68,1 millions d’habitants, soit 700 000 de plus qu’en 2021. Dans ce scénario dit « central », le taux de mortalité par sexe et âge diminuerait au même rythme que sur la décennie 2010, la fécondité se stabiliserait à 1,8 enfant par femme et le solde migratoire serait de 70 000 habitants en plus par an. Jusqu’en 2035, la population continuerait d’augmenter de 116 000 personnes en moyenne par an, pour atteindre 69,0 millions d’habitants, du fait d’un solde naturel positif qui s’ajouterait à l’excédent migratoire.
Un solde naturel négatif à compter de 2044
Cette croissance correspondrait à un rythme de +0,2 % par an, nettement inférieur à celui connu depuis 50 ans (+0,5 % en moyenne depuis 1970). En 2035, le solde naturel de la France deviendrait négatif, les décès devenant plus nombreux que les naissances.
Jusqu’en 2044, le solde migratoire compenserait ce déficit naturel permettant la poursuite de l’augmentation de la population qui atteindrait 69,3 millions d’habitants. À partir de 2044, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population française diminuerait à un rythme moyen de 45 000 personnes par an, soit -0,1 % par an, pour atteindre 68,1 millions d’habitants en 2070.
De 58 à 79 millions d’habitants en fonction des scénarii
L’évolution du nombre d’habitants en France d’ici 2070 dépend surtout des hypothèses sur la fécondité et le solde migratoire. Si l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) augmentait à 2,00 enfants par femme, le solde naturel resterait positif jusqu’en 2046 et en 2070 la France compterait 4,1 millions d’habitants de plus que dans le scénario central bâti à partir d’un ICF stabilisé à 1,80 enfant par femme. Si l’ICF baissait à 1,60 enfant par femme, le solde naturel deviendrait négatif dès 2027 et il y aurait 4,0 millions d’habitants de moins en 2070. Les hypothèses migratoires induisent une aussi forte variation du nombre d’habitants d’ici 2070 si le solde migratoire en France était supérieur de 50 000 à celui du scénario central. Ainsi, dans le cas d’un excédent migratoire de 120 000 personnes par an, il y aurait 4,1 millions d’habitants de plus en 2070 et s’il était inférieur de 50 000 (le solde migratoire passant alors à +20 000 personnes par an), il y en aurait 4,0 millions de moins. Si en 2070, l’espérance de vie à la naissance était supérieure de trois ans et demi à celle du scénario central, ou de trois ans et demi inférieure, il y aurait respectivement 2,4 millions d’habitants en plus ou en moins en 2070. Si toutes les évolutions défavorables à la croissance de la population (fécondité, espérance de vie et solde migratoire plus faibles) se conjuguaient (scénario de « population basse »), la population diminuerait dès 2027 et serait de 58,0 millions d’habitants en 2070, soit son niveau de 1990. Au contraire, si toutes les évolutions favorables se combinaient (scénario de « population haute »), la population augmenterait à un rythme soutenu sur toute la période et atteindrait 79,1 millions en 2070.
Un vieillissement rapide de la population
D’ici 2070, le nombre d’habitants de 75 ans ou plus devrait croître de 5,7 millions sur cette période, tandis que celui des moins de 60 ans diminuerait de presque autant (-5,0 millions). Quant au nombre de personnes de 60 à 74 ans, il resterait stable.
La France vieillira, ces prochaines années, non seulement en raison de l’augmentation du nombre de personnes âgées, mais aussi parce que le nombre d’enfants et d’adultes de moins de 60 ans diminuera. La population française comptera plus de personnes âgées de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 20 ans d’ici quelques années.
Même si l’espérance de vie tend à se stabiliser, les gains passés auront un effet sur le vieillissement de la population dans les prochaines décennies. Les personnes de 75 ans ou plus en 2070, nées en 1995 ou avant, font presque toutes partie de générations plus nombreuses que celles de ces mêmes âges en 2021 (nées avant 1946 et donc avant le baby-boom). Le nombre de personnes de 60 à 74 ans serait quant à lui similaire en 2021 et en 2070, car la hausse de l’espérance de vie compenserait la moindre taille de ces générations. Les personnes d’âge actif seront moindres dans les prochaines décennies car elles sont nées dans les années 2010 marquées par une baisse de la natalité. La pyramide des âges de 2070 devrait par ailleurs être plus équilibrée entre hommes et femmes : 50,8 % de femmes, contre 51,7 % en 2021. Ce rééquilibrage s’effectuerait surtout aux âges de forte mortalité. La part des femmes parmi les 85 ans ou plus passerait de 68 % à 59 %. De même, la part de femmes parmi les centenaires diminuerait de 84 % à 71 %. En effet, dans les hypothèses retenues, les écarts d’espérance de vie entre femmes et hommes continueraient de se réduire comme ils l’ont fait entre 2010 et 2019, puisque les femmes ont gagné 0,9 an d’espérance de vie et les hommes 1,7 an.
D’ici 2040, la part des 65 ans ou plus devrait augmenter au même rythme que précédemment. La hausse serait portée par les seniors de plus de 75 ans. La progression des 65 ans ou plus ralentirait à partir de 2040, la dernière génération du baby-boom, née en 1974, entrant alors dans cette classe d’âge. En 2070, la part des 65 ans ou plus serait de 29 %, soit une hausse de 8 points par rapport à 2021. Cette hausse serait identique à celle observée entre 1972 et 2021, période de même durée.
Une dégradation du rapport de dépendance
Selon le scénario central, le rapport de dépendance démographique (nombre de personnes de plus de 65 ans par rapport à celles âgées de 20 à 64 ans) passerait de 37 en 2021 à 51 en 2040. Même dans les scénarios de moindre vieillissement, il augmenterait dans des proportions quasi similaires d’ici 2040. Il atteindrait 49 dans le scénario où l’espérance de vie est gelée à son niveau de 2019, ou encore 48 dans le scénario de « population jeune », qui combine de faibles progrès d’espérance de vie avec un apport migratoire plus élevé de personnes de 20 à 64 ans. Dans le scénario de « population âgée », le vieillissement de la population serait également proche de celui du scénario central en 2040, avec un rapport de 53. Entre 2040 et 2070, l’évolution du rapport de dépendance démographique est beaucoup plus incertaine. Il pourrait croître un peu selon le scénario central (rapport de 57 en 2070), de manière plus soutenue selon le scénario de « population âgée » (70) ou diminuer légèrement selon le scénario de « population jeune ».
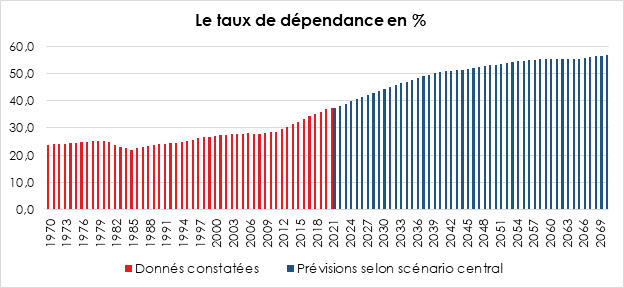
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Conséquences pour le financement des retraites
En raison d’une baisse de la natalité, constatée depuis une dizaine d’années, d’un solde migratoire réduit, le vieillissement de la France s’accélère. Le nombre d’actifs en valeur relative a commencé à diminuer. En valeur absolue, ce déclin devrait intervenir d’ici 2035. Moins d’actifs et plus de retraités qui vivent plus longtemps, engendrent, toutes choses étant égales par ailleurs, une charge plus importante sur les premiers. La nécessité d’améliorer le taux d’emploi et d’obtenir des gains de productivité constitue les deux moyens les plus efficients à défaut de jouer sur le volant migratoire. L’autre voie est la diminution des pensions ou l’augmentation des cotisations au risque de baisser le niveau de vie des retraités ou de peser sur la compétitivité de l’économie française. L’amélioration du taux d’emploi peut passer par une réduction du sous-emploi qui est élevé en France, à tous les âges, par une participation plus forte des femmes au marché du travail et par un maintien en emploi des seniors.
Retraite : comment faire valoir ses droits à pension ?
Selon une récente étude réalisée avant la crise sanitaire, par l’Institut Harris Interactive pour le compte d’AG2R LA MONDIALE[1], le passage de la retraite constitue, pour nombre de Français, une source majeure de préoccupation et d’inquiétude. La méconnaissance du fonctionnement de notre système de retraite, la succession des réformes et des crises contribuent certainement à la construction de ce sentiment. Près de 60 % ignorent à quel âge ils pourront partir à la retraite, 75 % ne savent pas comment leur pension sera calculée et 71 % ignorent quel en sera le montant. Pourtant, la retraite, demeure, enquête après enquête, une étape que les Français aspirent à franchir le plus tôt possible car ils y voient la fin des contraintes de la vie professionnelle et la possibilité de s’investir dans de nouveaux projets. L’attribution de la pension ne se faisant pas automatiquement, il convient de s’informer et de se préparer en amont afin que cette étape importante soit vécue avec sérénité.
La retraite, avant tout une question d’information
Depuis la réforme des retraites de 2003, les assurés disposent d’outils destinés à les informer sur les droits constitués au cours de leur carrière et leur permettre de se faire une idée de ce qu’ils seront susceptibles de percevoir une fois à la retraite. Qu’ils soient salariés, non-salariés ou fonctionnaires, les assurés sont destinataires de divers documents en vue de renforcer leur connaissance de leur situation. De 35 ans à 55 ans, chaque assuré reçoit, tous les 5 ans, un relevé de ses droits connus dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. Ce document, intitulé « relevé individuel de situation » (RIS) synthétise les droits connus et restitue le nombre de trimestres acquis dans les régimes de base, la durée d’assurance totale de l’assuré, et les droits qu’il s’est constitué dans les éventuels régimes complémentaires dont il a pu dépendre. À partir de 55 ans, une estimation du montant de la retraite future est adressée aux assurés tous les 5 ans. Ce document, intitulé « estimation indicative globale » (EIG) comporte les mêmes éléments que le relevé de situation individuelle, auxquels s’ajoute une estimation des droits « retraite ».
Ces informations ont été complétées, en 2010, avec la possibilité offerte à chaque assuré, dès 45 ans, d’avoir accès à un « entretien information retraite » (EIR) auprès d’un ou plusieurs régimes de retraite dont il relève. Cette rencontre individualisée permet de fournir aux assurés des informations sur leurs droits constitués, ainsi qu’une estimation de leurs possibilités d’évolution compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels. Ce rendez-vous est également l’occasion pour les assurés d’obtenir des renseignements sur des dispositifs permettant d’améliorer le montant de la future pension, tel que le cumul emploi-retraite.
La réforme 2010 des retraites a renforcé le devoir d’information des assurés. Elle prévoit notamment la mise en place du relevé individuel de situation dématérialisé à la demande des assurés (RIS en ligne), ainsi que la délivrance d’une information spécifique à destination des futurs expatriés. Afin d’améliorer leur connaissance sur le fonctionnement général des retraites en France, un document d’information générale sur le système de retraite est adressé à tous les assurés ayant validé deux trimestres d’assurance retraite.
L’ensemble de ces outils permet tout à la fois aux assurés de préparer cette étape importante qu’est la cessation d’activité et de vérifier s’il n’y a pas eu d’erreur ou d’omission dans les relevés de carrière transmis. Il est recommandé de procéder à des demandes de rectification pendant la vie active plutôt qu’au moment de la liquidation des droits à pension afin de faciliter et d’accélérer les démarches le moment venu.
Pourquoi le passage à la retraite ne s’improvise pas ?
Limiter les risques d’erreurs dans le calcul des pensions
Selon un récent rapport de la Cour des comptes, un dossier retraite sur six est concerné par des erreurs dans le calcul de sa pension. Ces erreurs, se feraient, dans les trois quarts des cas, au détriment des retraités. Le manque à gagner « médian », pour les affiliés de la CNAV, était, en 2020, de 123 euros par an ce qui signifie que la moitié des individus lésés ont subi un préjudice égal ou supérieur à cette somme. L’appel à la vigilance n’est pas spécifique aux affiliés du régime général. Les magistrats de la Cour des comptes notent ainsi dans leur rapport que le calcul des pensions des travailleurs indépendants donne également lieu à de nombreux dysfonctionnements. Pour limiter les risques d’erreurs, il est ainsi recommandé aux actifs de conserver l’ensemble des documents permettant de retracer leur parcours professionnel : fiches de paie, relevés de points AGIRC/ARRCO pour un salarié du régime général et toutes autres éventuelles attestations professionnelles, sont autant de justificatifs qui pourraient s’avérer précieux au moment de faire valoir ses droits à pension.
Percevoir sa pension dans des délais raisonnables
La CNAV conseille à ses assurés de réaliser leur demande de retraite 6 mois avant la date de départ choisie. Cette recommandation fait écho au décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 prévoyant le versement garanti de la pension à la date prévue du départ en retraite si la demande a été réalisée au moins 4 mois avant. En vertu de ce texte, les caisses de retraite qui ne parviennent pas à respecter ce délai sont, en principe, tenues de verser une pension fondée sur une estimation et ce même s’il manque certains éléments au dossier transmis pour déterminer le calcul définitif de la pension. Le montant de la pension sera naturellement actualisé quand le dossier aura été complété et traité par les services compétents.
Quand faire valoir ses droits à retraite ?
À quel âge peut-on prendre sa retraite ?
Depuis la loi de réforme des retraites de 2010, l’âge légal de départ à la retraite est fixé pour les salariés du régime général à 62 ans (applicable pour les salariés nés après le 1er janvier 1955). Dans certains cas, il est néanmoins possible de prétendre à la retraite avant cet âge. C’est notamment le cas des actifs ayant effectué une carrière longue, se trouvant en situation de handicap ou atteints d’une incapacité permanente d’origine professionnelle reconnue par l’Assurance maladie (retraite anticipée pour pénibilité).
La date du départ est fixée du 1er du jour du mois choisi par l’assuré. À titre d’exemple, un assuré désireux de faire valoir ses droits dès ses 62 ans pourra retenir le 1er jour du mois qui suit son 62e anniversaire. Si l’assuré est né le 1er jour d’un mois, il pourra alors partir dès le jour de son anniversaire. Fort logiquement, la date retenue ne pourra pas être antérieure à la date de dépôt de sa demande de retraite.
Privilégier un départ en fin d’année
L’âge légal de départ à la retraite correspond à l’âge minimum requis pour pouvoir faire valoir ses droits à pension auprès du régime de base. À partir de cet âge, il est alors possible, mais non obligatoire, de partir à la retraite. Liquider ses droits à retraite à l’âge légal n’implique pas, pour l’assuré qu’il pourra nécessairement prétendre à une retraite à « taux plein ». Pour bénéficier de cette dernière, l’assuré devra satisfaire également une durée d’assurance qui est variable selon sa date de naissance. À défaut, les pensions allouées sont minorées. La décote est fonction du nombre de trimestres manquants ou de l’écart en trimestres entre l’âge de liquidation et l’âge d’annulation de la décote. Réciproquement, un dispositif de surcote a été introduit en 2003 afin d’inciter les actifs à retarder leur départ à la retraite. Les assurés justifiant d’une durée d’assurance suffisante et poursuivant une activité professionnelle après avoir atteint l’âge légal, continuent à accumuler des droits et bénéficient d’une majoration de pension, qui dépend du nombre de trimestres supplémentaires travaillés.
Un départ en fin d’année est généralement recommandé car pour valider quatre trimestres, la dernière année, il est nécessaire d’avoir travaillé durant l’ensemble de la période considérée à la différence des autres années. Compte tenu des règles de calcul des pensions, il convient de maximiser les trimestres validés en fin de carrière, ces derniers étant généralement mieux rémunérés.
Comment demander sa retraite ?
Des démarches simplifiées
Quel que soit leur statut, les actifs doivent formaliser leur demande de mise à la retraite. Celle-ci peut être réalisée en ligne, sur leur compte retraite, ou être adressée par courrier à leurs caisses de retraite. Grâce aux efforts de rapprochement et d’harmonisation opérés entre les différents régimes de retraite, à travers notamment les travaux menés dans le cadre du groupement GIP info retraite, devenu, en 2014, GIP union retraite, les actifs voient leurs démarches fortement simplifiées. Ainsi, depuis le 15 mars 2019, les assurés ont accès à un formulaire de demande unique prérempli des informations relatives à leurs régimes d’affiliation et de leurs informations personnelles. La demande peut être effectuée, en ligne, sur le portail inter régimes info-retraite.fr ou sur l’un des sites internet des régimes auxquels l’assuré est affilié. Cette demande sera ensuite automatiquement transmise à tous les régimes auxquels il a cotisé. Il est généralement recommandé de déposer sa demande auprès de la caisse de la dernière activité de l’assuré ou au point d’accueil retraite le plus proche de son domicile.
Afin d’accompagner les assurés dans leurs démarches, l’assurance retraite a mis en place un nouveau service en ligne gratuit et personnalisé « mon agenda retraite » qu’il convient de consulter en amont de la liquidation des droits. Les personnes inscrites sur ce service reçoivent par mail ou SMS des conseils et des informations personnalisés à échéances régulières entre cinq ans et six mois avant la retraite.
Les documents à fournir
Que la demande soit réalisée en ligne ou adressée par courrier, pour être recevable, elle exige la transmission, par l’assuré, d’un ensemble de pièces à sa caisse de retraite. En complément du formulaire prérempli, le cas échéant, complété ou amendé et signé, l’assuré aspirant à faire valoir ses droits à pension doit notamment transmettre :
- Une pièce d’identité (Carte d’identité nationale, passeport ou autre) en guise de justificatif d’état civil et de nationalité ;
- Le livret de famille à jour ;
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) ;
- Une photocopie du dernier avis d’imposition,
- Les bulletins de salaire des douze derniers mois ou une attestation rédigée et signée par l’employeur ;
- Une attestation de Pôle emploi des périodes de chômage pour les douze derniers mois ;
- Une attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou un document détaillant les indemnités journalières de vos deux dernières années.
Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés, en particulier en cas de demande de départ à la retraite anticipée. Les assurés concernés doivent dès lors fournir, en complément des documents précités :
- Pour un départ en retraite au titre de l’inaptitude : un certificat médical attestant de l’état de l’assuré et une notification d’attribution ou de rejet de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) devront être communiqués ;
- Pour un départ en retraite au titre de la pénibilité : la fourniture d’une notification de consolidation médicale ainsi qu’une notification de rente de l’Assurance maladie ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), ou tout autre justificatif sera demandé ;
- Pour un départ anticipé au titre d’une carrière longue ou au titre d’un handicap : il sera nécessaire de transmettre une attestation de droit fournie par la caisse de retraite de base ;
- Pour une retraite progressive : une attestation, stipulant la durée du temps complet et celle du temps partiel, délivrée par votre employeur, mais aussi une copie du contrat de travail à temps partiel ;
- Départ en retraite d’ancien combattant, de déporté, de prisonnier de guerre ou d’interné : une carte de combattant, un état signalétique et un état des services devront être fournis ;
- En cas de handicap ou de maladie invalidante : toutes les pièces permettant de prouver et d’évaluer le handicap ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 50 % ou d’un handicap avec un niveau d’invalidité similaire.
Bon à savoir : Un service téléphonique a été mis en place pour permettre aux assurés de s’informer sur leur situation, poser une question sur leur dossier et accéder à leurs informations personnelles (suivi du dossier, derniers paiements, etc.). Accessible au 39 60 (ou 09 71 10 39 60 depuis un mobile, une box ou l’étranger) ce service est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Les voies de recours en cas de désaccord avec sa caisse
Si le calcul réalisé par la caisse de retraite est réputé « définitif », il existe dans les faits de multiples voies de recours en cas de contestation. Après réception d’un dossier complet, et liquidation de la pension, la caisse de retraite transmet à l’assuré une notification de sa retraite appelée, pour les agents de la fonction publique, « titre de pension ». En cas de désaccord quant au montant de la pension calculée, l’assuré doit dans un premier temps saisir, par courrier, la caisse concernée. En cas de réponse défavorable de cette dernière, il dispose alors d’un délai de deux mois pour réaliser un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse avec laquelle il est en litige.
Pour les anciens salariés, si la contestation concerne le calcul réalisé par le régime de base, ils sont invités à adresser leur demande de révision à a Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) s’ils habitent en Île-de-France, de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) de leur région s’ils vivent en province ou de leur Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) pour les ressortissants des départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, Mayotte). Il est conseillé de transmettre sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant les éléments de votre dossier. La CRA dispose d’un délai d’un mois pour remettre sa décision.
En cas de silence de la CRA ou de désaccord avec sa décision, l’assuré peut saisir le médiateur de sa caisse et/ou (selon les cas) le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Ce dernier n’est compétent à agir que si la CRA a été préalablement sollicitée. L’assuré dispose d’un délai de 2 mois après la notification de la décision de la CRA, ou après l’expiration du délai de réponse de la CRA pour adresser sa demande au Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Si la contestation porte sur le calcul réalisé au titre de la retraite complémentaire, l’ancien salarié doit se rapprocher du groupe paritaire de protection social (GPS) auquel il est affilié. Comme pour les caisses des régimes de bases, les GPS disposent généralement d’un médiateur auquel l’assuré peut faire appel. En cas d’échec de la médiation, les fédérations Agirc-Arrco peuvent être sollicitées. L’assuré peut enfin saisir le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance (TGI), en cas de rejet de ses demandes.
Pour les anciens agents de la fonction publique d’État, le recours doit être réalisé auprès de leur centre de retraite. Les agents territoriaux et hospitaliers doivent s’adresser à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Le cas spécifique du trop-perçu
Si l’assuré dispose de voies de recours en cas de désaccord avec le montant de sa pension liquidée, les caisses de retraite peuvent également demander le remboursement du trop-perçu de pension aux retraités, même si elles sont à l’origine de l’erreur de calcul. L’assuré ayant fait l’objet d’un trop perçu peut saisir la CRA afin d’obtenir un étalement des sommes à restituer. Les assurés disposant de ressources inférieures au plafond de revenus exigé pour percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ne seront pas appelés à restituer l’éventuel trop-perçu qu’ils auraient reçu.
Si l’erreur porte sur le montant versé au titre de la pension de base, la caisse dispose d’un délai de deux ans pour agir. Passé ce délai de prescription, le retraité ne pourra plus être tenu de rembourser les sommes indues. En matière de retraite complémentaire, le délai de prescription est fixé à cinq ans.
Compte tenu des règles en vigueur en matière de liquidation des droits à pension, les assurés sont invités à effectuer leurs démarches le plus en amont possible. Avec la pandémie, les délais de traitement se sont allongés, au point que le versement des pensions peut intervenir plus de six mois après le dépôt de la demande de liquidation. Quand le dossier est finalisé, un versement rétroactif est réalisé. Compte tenu des délais d’obtention de la première pension, l’assuré se doit de disposer d’une petite réserve d’épargne afin de pallier la disparition de ses revenus d’activité.
[1] 2e édition de l’enquête sur « Les préoccupations des français en matière de protection sociale » réalisée en ligne du 29 octobre au 12 novembre 2019 par Harris interactive pour AG2R LA MONDIALE. Échantillon de 3081 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
Nouveaux Placements, les jetons non fongibles, de quoi s’agit-il ? par Philippe Crevel directeur du Cercle de l’Epargne
Pouvons-nous imaginer un monde sans Livret A, sans fonds euros, sans unités de compte ? Les épargnants de 2030 placeront-ils tout leur argent sur la blockchain en s’affranchissant des intermédiaires ? La percée du bitcoin chez les jeunes de moins de 35 ans, 20 % jugeant, selon l’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa, ce placement comme intéressant, traduit une évolution rapide des comportements. De plus en plus de jeunes s’entichent des NFT, (non fungible token), des jetons non fongibles qui sont des éléments de la blockchain. À la différence des dollars, des euros ou des bitcoins, une unité n’a pas obligatoirement la même valeur qu’une autre. Les jetons stockent certaines données, notamment le nom du NFT et un lien vers une image numérique. Chaque jeton est unique et ne peut être conservé que dans un seul portefeuille en ligne. L’image, cependant, peut être visualisée, copiée ou téléchargée par n’importe qui. Les NFT appelés également « cryptokitties » ont été inventés par Anil Dash, un entrepreneur, et Kevin McCoy, un artiste, pour faire comprendre qu’un article sur Internet était un original numérique méritant une protection et une reconnaissance spécifiques. Les NFT offrent la preuve que son détenteur est à l’origine de l’image ou du texte. Ils permettent de distinguer l’original des copies. L’usage des NFT dépasse désormais celui de l’art en se diffusant notamment dans la sphère de l’immobilier.
Un marché en plein développement
Les NFT connaissent un essor rapide. Sur les dix premiers mois de l’année 2021, la valeur totale des NFT émis sur la blockchain Ethereum est de 14,3 milliards de dollars, selon DappRadar, une société de recherche, contre environ 340 millions de dollars en 2020. Selon une récente enquête réalisée par l’institut Louis Harris, 11 % des adultes américains auraient acheté un NFT (soit juste un point de moins que ceux qui investissent sur le marché des matières premières). Les volumes mensuels de NFT-trading sur des plateformes d’art désignées comme « Nifty Gateway » et « Foundation », ont atteint 205 millions de dollars en 2021. Les analystes de Jefferies, une banque d’investissement américaine, parient sur un doublement de la valeur des NFT en 2022. Leur valeur pourrait dépasser 80 milliards de dollars en 2025.
Les atouts des NFT
Les NFT, logés sur la blockchain, permettent à leurs créateurs et aux acheteurs de suivre l’historique des transactions. Les créateurs peuvent également conserver une participation dans leur travail, même après la vente de l’original. Dans un système de vente traditionnelle, les artistes ont peu de moyens pour veiller au respect de leurs droits. Un NFT peut être lié à un texte comprenant un contrat juridique qui confère un type spécifique de droit de propriété. Sur la plateforme « Foundation », le règlement précise que l’acheteur d’un NFT a des droits qui s’apparentent à une licence d’utilisation d’une image de manière limitée. La vente peut par exemple interdire l’usage du NFT à des fins commerciales par l’acheteur en limitant le droit d’usage à un affichage public et à la possibilité de le copier pour un usage personnel.
Les atouts des NFT n’intéressent pas que le monde de l’art. De nombreux investisseurs en capital-risque et développeurs informatiques estiment qu’ils peuvent servir de base aux échanges en ligne. Ils tentent de créer un nouveau type d’économie numérique, dans lequel toutes les opérations en ligne seront exécutées par des applications « décentralisées ». Ces dernières appartiendraient à leurs inventeurs et seraient exploitées par leurs utilisateurs, sans avoir besoin de recourir à des intermédiaires comme Google ou Apple. La distribution de toutes sortes de contenus numériques, comme des images, des vidéos et même des articles, pourrait se faire en passant par les NFT. Le monde des jeux vidéo qui a toujours été en pointe en matière informatique s’intéresse de plus en plus aux jetons. « Axie Infinity », un jeu avec plus de 250 000 utilisateurs actifs quotidiens, recourt aux NFT. Dans ce jeu, les participants collectent, élèvent, combattent et échangent des petites créatures, qui sont numérisées en tant que NFT. Ils peuvent gagner des jetons en fonction de leurs scores. La valeur de ces NFT est liée au résultat des ventes du jeu. Supdrive, une plateforme de jeux vidéo, vend ces derniers sous forme de NFT. Plusieurs mondes en ligne immersifs, les métavers, proposent l’achat de terrains virtuels grâce à des NFT.
Les NFT comme outil de financement
Au-delà du monde virtuel, les jetons pourraient également être utiles pour des activités menées dans le monde réel. Certaines universités américaines expérimentent leur utilisation pour financer la recherche. L’Université de Californie à Berkeley a collecté 50 000 dollars en vendant un NFT fondé sur des documents relatifs à des recherches sur l’immunothérapie contre le cancer réalisées par le prix Nobel de médecine, James Allison, en tant qu’objet de collection. Saint-Marin a approuvé l’utilisation de jetons comme passeports numériques pour le vaccin contre le covid.
Les NFT de l’immobilier virtuel à l’immobilier réel
Tout comme ils rendent possibles les transferts de terres virtuelles, les NFT pourraient devenir un moyen d’échanger des actes de propriété réels ou d’autres types de contrats. En juin, Michael Arrington, le fondateur de TechCrunch, une société de médias, a ainsi vendu un appartement à Kiev. Les NFT permettraient également aux acheteurs et aux vendeurs d’exploiter un nombre croissant d’applications financières décentralisées fondées sur des blockchains. Ils permettraient l’octroi de prêts sans passer par des intermédiaires financiers.
Les NFT sont utilisés également dans le cadre de transactions immobilières réelles. Un propriétaire peut, en effet, juxtaposer le droit de propriété d’un bien donné sur un NFT, afin que ce jeton représente la contrepartie numérique dudit bien. Le NFT peut ensuite être transigé par l’entremise de la chaîne de blocs, en contrepartie de cryptomonnaies. Ce phénomène également nommé « numérisation » – « tokenization » – permet la représentation de tout actif du monde réel par un cryptoactif au sein de la chaîne de blocs. La numérisation permet de fractionner la valeur d’un actif de manière infinie. Ainsi, un individu qui n’a pas les moyens d’acheter un tableau à lui seul pourra, par exemple, acquérir un NFT qui représente un dixième de ce tableau. Ce faisant, il peut s’agir d’une manière de rendre liquide des biens qui, autrement, sont loin de l’être, comme c’est notamment le cas pour les œuvres d’art et les immeubles.
Un investisseur américain Ivan Malpica a mis en vente la moitié d’une maison située à Saint-Louis, dans le Missouri, sous forme de NFT. La chaîne de blocs permet d’horodater et de vérifier les transactions. Elle contribue à la certification des opérations, l’authentification demeurant de la compétence selon les pays des notaires, des avocats ou de l’administration. Certains souhaitent une évolution du droit pour faciliter les ventes en NFT. La blockchain pourrait rendre plus liquide le marché immobilier avec des gains de temps non négligeables.
Les NFT, les outils de financiarisation des jeux vidéo
Les applications de jeux vidéo deviennent des portails multi-services. En plus des forums, des messageries instantanées, elles permettent à leurs membres d’accéder via les NFT à des quasi produits financiers. La société française de jeux de football en ligne, Sorare, dispose de 30 000 clients sur 350 000 qui détiennent au moins une carte NFT. Elle a ainsi récupéré, pour l’émission de ses cartes de joueurs de football, 40 000 ethers, soit plus de 60 millions de dollars fin novembre. La valeur de ces cartes fluctue en fonction de la valeur accordée aux joueurs ainsi représentés. Ces cartes sont échangeables ou cessibles en ligne en ayant recours à la blckchain.
Les limites des NFT
Les NFT ne sont pas sans faille. Ils ne sont que des liens vers des images. Des hackers peuvent modifier à leur profit les liens après la réalisation d’une transaction. L’identité d’un acheteur de NFT et la provenance de ses fonds ne peuvent pas toujours être connues, l’organisation d’opérations frauduleuses en serait facilitée. Les technologies blockchain consomment de manière importante de l’électricité. La vente d’un NFT sur une plateforme correspond à l’émission de gaz à effet de serre d’une personne empruntant un vol long-courrier. Certaines solutions sont à l’étude comme un système de stockage décentralisé et un suivi des liens rompus. Certaines applications essaient de toucher le moins possible à la blockchain afin de réduire l’empreinte carbone.
Trois question à Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne: Placements, épargne, comment bien finir l’année ?
L’année 2021 se termine avec un rebond de l’inflation qui cohabite, pour le moment, avec des taux d’intérêt très bas. Les épargnants ayant investi en produits de taux sont ainsi mis à la diète. Est-ce que cette situation qualifiable en économie de « répression financière » est amenée à perdurer ?
En cette fin d’année, les épargnants qui ont privilégié, depuis le début de la crise sanitaire, les produits comme les livrets bancaires, les livrets d’épargne réglementée ou les fonds euros sont confrontés tout à la fois à la faiblesse récurrente des taux d’intérêt et à la hausse des prix. Les faibles taux sont la conséquence des politiques monétaires exceptionnelles ont mises en œuvre par les banques centrales au début de l’épidémie. Elles sont censées s’achever avec le retour à la normale de la situation tant sanitaire qu’économique. Si, aux États-Unis, une réduction progressive des rachats d’obligation doit intervenir à compter du mois de décembre, pour la zone euro, elle ne devrait débuter, au mieux, qu’en 2023. Pour la hausse des taux directeurs, les banques centrales se montrent, pour le moment, très prudentes. Depuis le milieu de l’année, avec le rebond économique qui se nourrit des plans de relance et de l’épargne stockée depuis le début de la pandémie, les prix sont orientés à la hausse. L’à-coup brutal de la demande génère des frictions car l’offre est encore pénalisée par la désorganisation des circuits d’approvisionnement engendrée par l’épidémie. Des pénuries de matières premières et de biens intermédiaires pèsent sur la production de biens de consommation. Elles provoquent des allongements des délais dans les livraisons. Dans ce contexte, l’inflation a dépassé, en octobre, 5 % aux États-Unis et 4 % au sein de la zone euro. Cette situation est une mauvaise nouvelle pour les épargnants qui ont investi dans des produits non-indexés.
Le CAC40 a battu au mois de novembre un record vieux de 21 ans. Les actions ne sont-elles pas surévaluées avec un risque de krach non négligeable ?
Les records sont faits pour être battus mais certains durent plus longtemps que d’autres. Le record du CAC40 de 2000 a tenu 21 ans. Parmi les grands indices boursiers, le CAC40 était le seul à ne pas avoir effacé les conséquences de l’éclatement de la bulle Internet. Les déboires de Vivendi et d’Orange, des valeurs financières après les crises de 2008 et de 2012 expliquent, en partie, cette anomalie. La désindustrialisation française, marquée par le recul du secteur automobile et le nombre réduit de grandes entreprises de haute technologie, a également pesé sur l’indice. Les politiques monétaires accommodantes, le fort rebond de l’économie après le confinement et les bons résultats des entreprises ont permis au CAC40 de dépasser, le 3 novembre 2021 le record de 6 944,77 points, établi le 4 septembre 2000. Il a depuis franchi la barre des 7 000 points.
Un krach est par nature difficile à prévoir. En l’état, la valeur des entreprises n’est pas exagérée au vu de leurs résultats. Les cours restent, par ailleurs, soutenus par la faiblesse des taux d’intérêt. Avec le regain d’inflation, des hypothèses de remontée plus rapide des taux ont été lancées. Il convient en la matière de ne pas surréagir. L’inflation est en hausse en lien avec les plans de relance engagés au sein de nombreux États et en particulier aux États-Unis. Dans ce pays, la consommation a connu un gain de 15 % par rapport à la période d’avant pandémie. Un tel bond ne peut conduire qu’à des tensions sur l’offre. Nous aurons une idée plus précise de la réalité durable de l’inflation dans le courant de l’année 2022. De toute façon, il faudra à un moment ou un autre sortir des politiques monétaires exceptionnelles. Les banques centrales sont conscientes que cette sortie sera un exercice périlleux afin d’éviter tout dérapage financier. Le cours des actions dépendra de la croissance européenne et mondiale, de l’évolution des relations entre les grandes zones économiques ainsi que de celle la pandémie. Ces facteurs d’incertitude incitent à opter pour une diversification de bon aloi au niveau de ces placements en privilégiant des valeurs résilientes.
Une part non négligeable des ménages se détourne des produits d’épargne traditionnels en optant soit pour le compte courant, soit pour des placements alternatifs comme le bitcoin. Comment appréciez-vous cette évolution et quelles sont les conséquences à terme ?
De nouveaux placements apparaissent en lien avec la blockchain. Les jeunes de moins de 35 ans sont de plus en plus attirés par ce type de placements digitaux alternatifs, ainsi que par les actions. Ils plébiscitent les ETF et le bitcoin. Selon l’enquête Cercle de l’Épargne/ Amphitéa, 20 % placent ce dernier parmi les placements les plus intéressants. En soi, ce cryptoactif ne rapporte ni intérêt, ni dividende. Le gain potentiel est purement spéculatif. Les jetons non fongibles (nft) constituent également un nouvel espace pour l’épargne. Un nft est un enregistrement, généralement sur la blockchain Ethereum, qui représente sous forme numérique, une image, un texte, ou une vidéo.
Le monde des cryptoactifs est propice à toutes les dérives et toutes les spéculations. Il est, cependant, indéniable qu’ils seront amenés à jouer un rôle croissant au sein de l’économie. En raison du système peu normé et peu encadré des cryptoactifs, les risques pris par les acquéreurs sont importants. Les banques centrales réfléchissent à la mise en place de monnaies digitales qui leur permettront de superviser l’espace financier digital. Si des gains sont réalisables avec le bitcoin et les nft, ils ne doivent pas masquer le fait que les risques sont importants et que le poids de ce type d’actifs dans une allocation se doit d’être marginal sous peine d’être exposé à d’importantes déconvenues.
Edito décembre 2021 de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne « Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! »
Dans la dernière enquête « les Français, la retraite l’épargne et la dépendance », réalisée par l’IFOP pour le compte du Cercle de l’Épargne et Amphitéa, une large majorité de Français considère que le système de retraite fera faillite si aucune réforme n’est mise en œuvre. Ces mêmes Français refusent, par ailleurs, tout changement. Le goût de l’indépendance d’esprit, l’art raffiné des contradictions habitent les Français ; en matière d’épargne, ils aiment couvrir des risques longs avec des produits courts. Détestant la prise de risque, ils peuvent s’enticher du bitcoin, des manuscrits ou de l’or. L’immobilier est devenu le premier sport pratiqué par les épargnants qui refusent de prendre en compte que ce n’est pas un placement sans aucun risque. Face à la remontée de l’inflation qui pourrait perdurer plus longtemps que prévu, ils restent attachés à des produits, le Livret A ou les fonds euros de l’assurance vie, qui les protègent mal, par nature, de la dépréciation monétaire. Que ce soit pour préparer sa future retraite ou pour se protéger de la hausse des prix, les actions cotées ou non sont plus adaptées. À la différence du bitcoin ou de l’or, les actions génèrent des revenus, les dividendes qui sont issus des bénéfices réalisés par les entreprises. Or, celles-ci ont, en règle générale, les capacités de répercuter les augmentations de prix qu’elles subissent. La valeur des actions est fonction de la valeur supposée des entreprises, valeur qui dépend notamment du chiffre d’affaires, et des bénéfices potentiels à venir. Le taux d’une obligation est celui fixé à l’émission et, sauf en cas d’indexation à l’inflation, il ne suit pas cette dernière. Par ailleurs, les taux d’intérêt ont tendance à suivre la hausse des prix, ce qui aboutit à déprécier la valeur des anciennes obligations sur le marché secondaire. De leur côté, les rendements des produits d’épargne réglementée sont actualisés avec retard et seulement partiellement en période d’inflation. Au début des années 1980, le rendement réel du Livret A était négatif de près de 5 points. À la fin du premier trimestre 2021, les Français détenaient pour 3 689 milliards d’euros de produits de taux pour un patrimoine financier évalué à 5 870 milliards d’euros. Les Français, depuis une vingtaine d’années, perdent beaucoup d’argent sans le savoir. En une génération, la valeur capitalisée des actions (dividendes inclus) a été multipliée par plus de trois en France. La capitalisation des entreprises technologiques du Nasdaq a été multipliée par plus de huit. Il ne sert à rien de regretter les tergiversations des pouvoirs publics en matière de fonds de pension. Le temps perdu ne se rattrape pas ! Si les assurés qui prendront leur retraite dans les prochaines années sont les principales victimes de cette inaction, il est, en revanche, possible de travailler en faveur des retraités des années 2040 ou 2060 en incitant au développement rapide du Plan d’Épargne Retraite. Afin que ce produit, créé par la loi PACTE, ne soit pas réservé aux seules grandes entreprises et aux contribuables aisés, les partenaires sociaux devraient s’emparer de ce sujet et le promouvoir au sein des accords de branche. La réorientation de l’épargne vers des placements longs est également une nécessité pour financer la transition énergétique. Pour la décarbonation de l’économie, d’ici le milieu du siècle, des milliers de milliards d’euros devront être mobilisés. Le déploiement des énergies renouvelables, la modernisation des réseaux électriques, l’adaptation de plusieurs secteurs d’activité dont ceux de l’automobile et de l’aéronautique, exigeront un effort financier de grande ampleur. Le recours à l’endettement notamment public n’est pas le meilleur moyen pour assurer cette mutation énergétique. Le financement par le marché offre plus de flexibilité et expose moins fortement les entreprises en cas de retournement conjoncturel.
Jean-Pierre Thomas
Augmenter ou pas le taux du Livret A: le gouvernement va devoir trancher en janvier
Dans un article consacré à la possible hausse du Livret A du fait du retour de l’inflation, Philippe Crevel souligne qu’une hausse du taux du Livret A « augmenterait par ailleurs les coûts des banques car ce taux sert de référence pour les autres placements liquides comme les livrets bancaires ou le Livret Jeune » et précise que « Les rendements de certains produits longs passeraient en-dessous de celui du Livret A. » De ce fait « la hausse du taux du Livret A irait à l’encontre de la politique du Gouvernement de réorienter l’épargne des ménages vers des placements longs comme les actions, les unités de compte ou le Plan d’Epargne Retraite afin de faciliter le financement des entreprises par fonds propres ».
La hausse du livret A nuirait aux banques ? Pas grave, le petit épargnant en profiterait
Dans Marianne, Philippe Crevel explique pourquoi taux bas sur longue période et inflation vive ne font pas le bonheur des épargnants.
Le taux du Livret A, le débat cornélien
Paris, le 9 décembre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le taux du Livret A, le débat cornélien
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Mercredi 8 décembre, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré à RTL que « le calcul du taux du livret A «intégrera l’inflation des six derniers mois», a-t-il assuré. «Nous ferons le calcul de la formule qui intégrera l’inflation des six derniers mois (…) mi-janvier».
Selon la formule de calcul en vigueur, Le taux du livret A est égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation des six derniers mois et des taux interbancaires à court terme à 6 mois, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %. En vertu de cette formule, le taux du Livret A pourrait être relevé le 1er février 2022, et se situer entre 0,7 et 1 %. L’inflation devrait sur les six derniers mois être voisine de 2 % quand les taux des marchés monétaires évoluent autour de -0,5 %.
Avec la remontée du taux d’inflation, le rendement réel du Livret A est en territoire négatif, autour d’un point.
Un gain limité pour les épargnants
Pour un épargnant ayant un Livret A au plafond (22 950 euros), sur un an, le passage à 0,8% du taux permet un gain de 69 euros. Pour un Livret doté de 15 000 euros, le gain est de 45 euros.
À 0,8 %, les épargnants pourraient estimer qu’au vu de l’inflation, autour de 2 %, le compte n’y est pas. L’épargne ne serait toujours pas préservée des effets de l’inflation. La cote serait donc mal taillée.
Un coût élevé pour les établissements financiers et pour la Caisse des Dépôts
La revalorisation du taux du Livret A à 0,8 % s’applique automatiquement sur le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et a des incidences également sur le Livret d’Epargne Populaire (LEP) ainsi que le Livret Jeune. Son coût en rythme annuel pour le Livret A et le LDDS serait d’au moins 1,4 milliard d’euros pour les banques et la Caisse des Dépôts.
Une augmentation du taux du Livret A augmenterait les coûts des banques d’autant plus que ce taux sert de référence pour les autres placements liquides (livrets bancaires par exemple). Un taux à 0,8 % coûte avec les frais de gestion au minimum 1,1 point aux établissements financiers. Or, la rémunération des produits monétaires demeure toujours négative au sein de la zone euro.
Le faible taux de rémunération de l’épargne réglementée n’a pas eu d’incidence sur la collecte surtout en période de crise sanitaire. L’encours du Livret A et du LDDS a progressé de plus de 50 milliards d’euros du mois de mars 2020 au mois d’octobre 2021. Compte tenu de la rareté du foncier et des délais de réalisation des projets immobiliers, cette collecte n’a pas, loin de là, profité au logement social. Elle a été reversée en grande partie dans le Fond d’épargne de la Caisse des Dépôts.
Un problème de hiérarchie des taux et de cohérence au niveau de la politique de l’épargne
Le relèvement du taux du Livret A poserait un problème de hiérarchie des taux. Les rendements de certains produits longs passeraient en-dessous de celui du Livret A. Après fiscalité, le rendement des fonds euros en 2021 devrait être proche de 0,7 % or ces derniers sont censés être des produits de moyen et long terme. La hausse du taux du Livret A irait donc à l’encontre de la politique du gouvernement de réorienter l’épargne des ménages vers des placements longs comme les actions, les unités de compte ou le Plan d’Epargne Retraite afin de faciliter le financement des entreprises par fonds propres.
Une solution populaire : le doublement du taux du LEP
À défaut d’augmenter le taux du Livret A, le gouvernement pourrait modifier la formule de calcul du Livret d’Epargne Populaire qui est réservé aux épargnants les plus modestes (essentiellement les non imposables à l’impôt sur le revenu soit la moitié des ménages). En déconnectant son taux de celui du Livret A, le gouvernement pourrait décider de le placer au niveau de l’inflation, c’est-à-dire à 2 % contre 1 % actuellement. L’épargne populaire serait ainsi protégée de l’inflation pour un coût relativement réduit, autour de 200 millions d’euros. Cela permettrait de rendre plus attractif ce produit qui a été souscrit seulement par la moitié des bénéficiaires potentiels (7 millions de LEP ouverts en 2020).
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Retraite à l’étranger : pourquoi elle peut parfois être un cadeau empoisonné
Retrouvez l’interview de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne publié dans Planet.fr. Il revient sur les mirages de l’expatriation pour la retraite et explique que certaines incitations fiscales sont à examiner avec précaution avant de se décider.
L’inflation est de retour : serez-vous gagnant ou perdant ?
Dans Sud-Ouest, Philippe Crevel explique qui seront les gagnants et les perdants en cas de retour affirmé de l’inflation sur la durée. C’est ainsi que le directeur du Cercle de l’Epargne précise que l’inflation peut être favorable aux emprunteur
s quand les allocataires de pension pourraient figurer parmi les perdants en cas d’indexation partielle des prestations.
Epargne: après le livret A pendant la crise, les Français se tournent massivement vers l’assurance-vie
Dans un article consacré à la collecte du Livret A et de l’assurance vie en octobre, Challenges cite le directeur du Cercle de l’Epargne. Pour Philippe Crevel « si les ménages ont retiré plus d’argent qu’ils n’en ont mis sur le Livret A, ils n’ont pas encore réellement puisé dans le bas de laine qu’ils avaient constitué durant la crise sanitaire« .
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com