Dossier familial – Assurance vie : pour la première fois depuis trois ans, les retraits ont excédé les versements en octobre 2016
Retrouvez l’analyse de Philippe Crevel sur la décollecte enregistré en octobre par l’assurance vie, reprise dans le Dossier familial.
Les Echos – Quelle épargne retraite dans un contexte de taux bas ?
Dans cet article consacré à l’épargne retraite, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne revient notamment sur l’atrait de la pierre « voie de passage obligée » pour préparer sa future retraite.
Les Echos – L’assurance-vie dans le rouge pour la première fois en 3 ans
Retour de la décollecte pour le placement préféré des Français. Retrouver dans cette article des Echos qui cite le Cercle de l’Épargne, les explications de Philippe Crevel.
Gestion de Fortune – L’assurance vie bascule dans le rouge en octobre 2016
Après une collecte à l’équilibre, l’assurance vie trébuche en octobre et redécouvre la décollecte. Les explications de Philippe Crevel sur ce mauvais résultat pour le placement fétiche des Français.
Recettes fiscales : La France championne d’Europe
D’après une étude d’Eurostat, la France détient en 2015 se distingue en Europe avec le ratio global recettes fiscales /PIB le plus élevé parmi les 28 Etats membres. Ce ratio est de fait de 47,9 % en France contre 40 % au sein de l’UE et 41,4 % dans la zone euro.
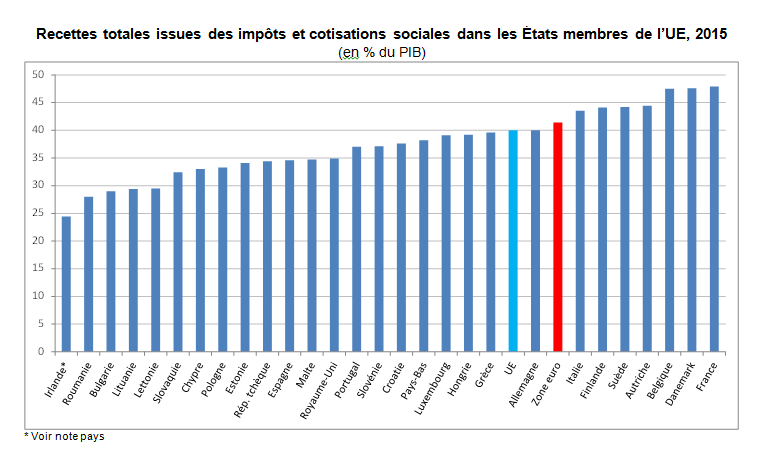
La France est suivie de près par le Danemark et la Belgique où la somme des impôts et des cotisations sociales nettes en pourcentage du PIB atteint respectivement 47,6 % et 47,5 % du PIB quand l’Allemagne est dans la moyenne de l’UE. A l’inverse, c’est l’Irlande, souvent accusé de réalisé du dumping fiscal, qui détient le record du plus faible ration (24,4 %) suivie des pays de l’Est de l’Europe avec la Roumanie (28,0%), la Bulgarie (29,0%), la Lituanie (29,4%) et la Lettonie (29,5%).
Dans le détail, les recettes fiscales qui sont constituées des impôts sur la production et sur les importations, les impôts sur le revenu et le patrimoine ainsi que les cotisations sociales. La France est en tête pour les cotisations sociales qui représentaient en 2015, 18,9 % du PIB. Elle se situe dans la moyenne haute au titre de la part des impôts sur la production et sur les importations qui représente 16 % du PIB (contre 22,1 % en Suède et 13,3 % de la zone euro). En revanche, elle est conforme à la moyenne européenne au titre des impôts sur le revenu et le patrimoine avec 12,6 % de PIB.
Si la hausse n’ a été que de 0,1 % entre 2014 et 2015, en 10 ans, le ratio des recettes/ PIB a enflé de 3,4 % en France contre une hausse plus limitée en Allemagne +1,5 % de PIB. Les plus fortes hausses sur l’intervalle de 10 ans sont constatées en Grèce (+6,1 % de PIB) – une hausse concentrée sur 5 dernières années du fait de la crise économique – et en Italie (+4,3 %). A l’inverse l’Irlande a réduit de près de 7 points la poids des recettes fiscales dans le PIB.
Chômage : nouvelle baisse en octobre
Avec 11 700 demandeurs d’emplois de catégorie A en moins, la France métropolitaine compte à présent 3 478 800 demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s’établit. La baisse est ainsi de 0,3 % sur le mois d’octobre est de de 0,8 % (- 27 800 personnes) sur les trois derniers mois.
Cette baisse profite d’abord au moins de 25 ans dont le nombre de demandeurs recule de 1,5 % sur un mois et de 8,2 % sur un an, quand pour les classe d’âge intermédiaire (25-49 ans) ce recul est respectivement de 0,4 % et 3,3 %. La situation des seniors, restent en revanche, problématique avec un nombre de demandeurs d’emploi qui continu à s’accroître (+0,4 % sur le mois d’octobre, +1,4 % sur 3 mois et +1,6 % sur un an).
Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C qui atteint 5 460 800 fin octobre 2016,est également en retrait sur un mois (-0,4 %). Il reste, en revanche en progression sur 3 mois (+0,3 %) et sur un an (+0,4 %) pour l’ensemble des tranches d’âges.
Dans la France entière, avec prise en compte des Département et les régions d’outre mer, le nombre de demandeurs de catégorie A s’élève à 3 733 800, également en recul de 0,3 % également par rapport à septembre. Toute catégorie confondus, la France on compte à présent 5 760 600 demandeurs.
Résultat de l’assurance vie en octobre 2016 : Accès de faiblesse confirmé
Résultat de l’assurance vie en octobre 2016 :
Accès de faiblesse confirmé
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Après une collecte nulle en octobre, l’assurance vie enregistre pour la première fois depuis décembre 2013, une décollecte qui s’élève à 100 millions d’euros.
La rupture amorcée en septembre est donc confirmée. La polémique liée à la loi Sapin II avec les mesures exceptionnelles en cas de crise financière a sans nul doute pénalisé, au mois d’octobre, la collecte de l’assurance vie. La communication sur l’éventuelle baisse du rendement des fonds euros, doublée des nombreuses incertitudes politiques et économiques ont incité les détenteurs à accroître en octobre, les rachats sur ce placement.
De fait, nous n’assistons pas à une crise des cotisations puisque la collecte brute de l’assurance vie a progressé en octobre pour s’établir à 10,1 milliards d’euros contre 9,6 milliards d’euros en septembre. En revanche, les rachats sont passés de 9,6 milliards d’euros en septembre à 10,2 milliards en octobre. Une hausse qui tient à la fois à la polémique suscitée par le débat de la loi Sapin II et à l’engouement retrouvé pour l’immobilier.
Par ailleurs, les épargnants Français commencent à prendre en compte l’attrait des unités de compte (UC) et du rendement qu’elles peuvent générer. Les montants versés dans les supports en UC s’établissent ainsi à 2,5 milliards d’euros en octobre contre 1,8 milliard le mois précédent. Toutefois, la barre des 20 % semble difficile à franchir puisque les cotisations versées sur ces supports restent sur les 10 premiers mois de l’année, comme en septembre, à 19 %.
L’encours de l’assurance vie atteint 1 621 milliards d’euros en octobre. Pour la fin de l’année nous devrions rester sur une collecte nette faible mais positive, sachant qu’en décembre, le versement des primes salariales permet un mois correcte pour l’assurance vie.
Contact presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
BFM Business – « Intégrale Placement » spécial épargne sociale et solidaire
Le Livret A chute en octobre 2016
Le Livret A chute en octobre 2016
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Après sept mois consécutifs de collecte positive, le Livret A enregistre, au mois d’octobre, une décollecte de 1,02 milliard d’euros. Il fallait remonter au mois de novembre 2015 pour enregistrer un tel recul. Avec le LDD, la décollecte est de 1,55 milliard d’euros soit un niveau qui n’a pas été rencontré depuis le mois d’octobre dernier. Ce mouvement de décollecte efface presque tous les gains des sept derniers mois. Sur l’année, la collecte reste positive de 140 millions d’euros pour le Livret A et le LDD (et de 1,23 milliard d’euros pour le Livret A).
Le mois d’octobre n’est généralement pas un bon mois pour le Livret A, avec 7 collectes négatives depuis 2006.
À l’automne, les ménages doivent faire face à des dépenses incontournables comme le paiement du dernier tiers provisionnel (en septembre) et celui des impôts locaux (octobre et novembre). Les ménages doivent également absorber les coûts des rentrées scolaires et le cas échéant préparer la succession des vacances (Toussaint et fin d’année).
Les Français prennent également en compte le ralentissement des gains de pouvoir d’achat générés par la baisse du prix du pétrole. La polémique sur les règles de fixation des taux n’a pas eu d’incidence sur les résultats d’octobre car elle est intervenue en novembre.
Avec les dépenses de fin d’année, le processus de décollecte pourrait se poursuivre en novembre, décembre étant un mois atypique du fait du versement des primes de fin d’année.
Contact presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
Les Français épargnent de plus en plus pour leur retraite
La retraite, comme le révèlent les enquêtes annuelles du Cercle de l’Epargne, constitue l’une des préoccupations prioritaire des Français. Pourtant, la place de l’épargne retraite reste marginale en comparaison avec le poids considérable des prestations servies par les régimes obligatoires (retraite de base et complémentaires).
De fait, les Français privilégient l’assurance vie – pour les placements financiers – pour préparer leur retraite. La récente étude sur l’épargne retraite en France publiée par l’ Observatoire des Retraites Européennes Eres met en avant les chiffres 2015 dans ce domaine et insiste sur le fait que l’assurance vie représente 46% de l’épargne en vue de la retraite.
L’épargne retraite atteindrait ainsi – assurance vie en vue de la retraite comprise -, à la fin 2015, 767 Mds d’euros. L’épargne collective représente 12,5 % du total quand l’épargne individuelle 9,3 %. L’étude qui intègre par ailleurs l’épargne salariale dans sa comptabilité, considère que cette dernière compte pour 7,3 % de l’épargne retraite.
Les versements réalisés en vue de l’épargne retraite, auraient quant à eux progressé de 40 % en 2015 et atteignent 55,7 Mds d’euros.
REVENUS, ÉPARGNE ET RETRAITE
Les Français épargnent et ils déclarent le faire afin de préparer leur retraite mais évidemment cette appétence est fonction de leur niveau de revenus. L’équipe du Cercle a repris les résultats de l’enquête 2016, les Français, leur épargne et leur retraite en prenant en compte leurs revenus.
Si les Français sont, pris dans leur moyenne, globalement épargnants, dans les faits, l’effort d’épargne se concentre sur les 20 % des Français les plus riches.
Au sommaire de l’étude
Epargne : des attentes différentes selon les revenus
- Le risque : l’apanage des plus aisés
- placement immobilier : les classes moyennes sont les seules à privilégier la transmission aux héritiers
- Épargne financière : l’importance du rendement croît avec les revenus
- L’assurance-vie devance l’immobilier au sein des classes populaire
- Assurance-vie : la garantie du capital une priorité pour les petits épargnants et les classes moyennes
perception et préparation de la retraite selon les revenus
- La retraite une source d’inquiétudes pour les revenus modestes…
- …Qui justifierait de travailler plus longtemps
- La peur de faillite du système de retraite est d’autant plus forte que les revenus sont faibles
- Les titulaires de revenus modestes très opposés au report de l’âge légal de départ à la retraite
- Les classes moyennes favorables à l’unification des régimes et au développement de l’épargne longue
- L’épargne-retraite : Une question de moyens avec des finalités différentes selon ses revenus
- Les principales vertus de la capitalisation selon le niveau de revenus
- L’épargne longue pour préparer la retraite des classes moyennes et des ménages à faibles revenus
Moins d’entreprises défaillantes en août 2016
D’après les chiffres de la Banque de France, le nombre de défaillances enregistrées sur les douze derniers mois s’établit à 60 142 à la fin août. Sur un an il recule de 4,4 % toutes entreprises confondues. Dans le détail, la baisse est de 4,3 % pour les PME. Elle est lus notable encore pour le segment des ETI-grandes entreprises (-20 %).
Si la situation semble globalement s’améliorer partout (ou presque) , ce sont les secteurs de la construction et de l’industrie, principalement touchées par la crise, qui enregistrent le plus fort recul du nombre de défaillances cumulées sur 12 mois (respectivement 8,3 % et -8,0 %). A l’inverse le secteur des transports continu à être en difficulté avec un cumul des défaillances toujours e n hausse (+1, 9 %).
D’après les premières estimations réalisés par la Banque de France, le cumul des défaillances diminuerait de nouveau à fin septembre 2016 (-5,7 %). L’évolution de l’indicateur de defaillance des entreprises met en évidence une amélioration de la situation, depuis près de 2 ans et demi, même s’il reste à près de 10 point au dessus de sa moyenne sur longue période.
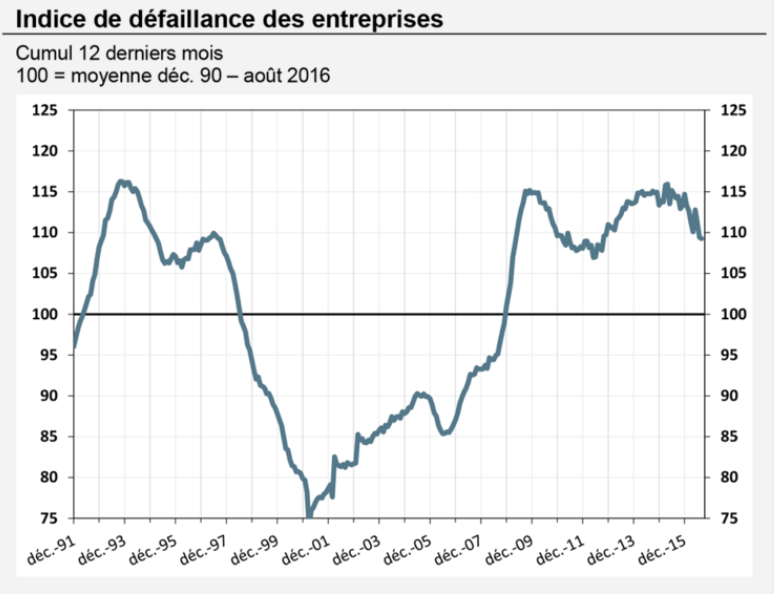
France : un troisième trimestre encourageant sur le terrain de l’emploi
Porté par l’intérim qui rebondit sur le 3e trimestre après un deuxième trimestre étale, le marché de l’emploi non marchand continue sa progression. Entre juillet et septembre, le nombre de créations d’emplois dans les secteurs marchands non agricoles enregistre une hausse de 0,3 % (+52 200 créations nettes après + 29 500 le trimestre précédent).
| données CVS en % en fin de trimestre | |||
| Champ : ensemble de l’économie hors agriculture et emploi public dans les secteurs non marchands (administration, éducation, santé et action sociale) | |||
| * Les intérimaires sont comptabilisés dans le secteur tertiaire quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leur mission. | |||
| Sources : Insee et Dares | |||
| Évolution en pourcentage | |||
|---|---|---|---|
| sur 3 mois | sur un an | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | |
| T2 | T3 | T3 | |
| Secteurs principalement marchands | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| Industrie | –0,3 | –0,3 | –1,1 |
| Construction | –0,2 | 0,0 | –0,5 |
| Tertiaire | 0,4 | 0,5 | 1,6 |
| dont intérim* | 0,0 | 5,1 | 8,6 |
Si ces chiffres sont encourageant, ils cachent des disparités selon les secteurs d’activité. Ainsi, dans l’industrie les destructions d’emplois se poursuivent (-9100 après -9500) et dans le secteur de la construction avec seulement 300 emplois nets créés la situation reste stable. En revanche, le secteur tertiaire, sur lequel la France s’est spécialisé tire nettement son épingle du jeu avec près de 61 000 emplois créés. La progression est, hors intérim, de 1,2 % sur un an (+136 300 quand l’industrie a perdu 33 100 emplois et la construction 7100.
De plus le poids de l’intérim dans le nombre de création nette, en données corrigées des variations saisonnières, témoigne du caractère précaire des emplois crées.
Donald Trump : le wait and see des marchés
Le 8 novembre 2016, Donald Trump arrive contre toute attente largement en tête à l’élection présidentielle américaine en ayant réussi à s’imposer dans la quasi-totalité des États pivots tels que l’Arizona, la Floride, la Pennsylvanie ou encore la Virginie.
Sans surprise, l’annonce de la victoire de Donald Trump crée, dans un premier temps, une onde de choc planétaire provoquant la chute des marchés financiers à leur ouverture. La victoire attendu du candidat Républicain a fait dégringoler le Nikkei (qui clos à -5,36 %), le dollar, le peso mexicain et a provoqué le repli des cours du pétrole. L’or, valeur refuge, s’est en revanche nettement apprécié, à 1 302,85 dollars l’once, contre 1 268,30 dollars en début de matinée.
En Europe, l’effet Trump est plus mesuré ainsi, le CAC 40 cédé environ 1,3 % dans la matinée après avoir ouvert en baisse de 2,83 quand le Dax allemand a reculé 2,9% à l’ouverture.
Dans son premier discours, Donald Trump se veut rassembleur et être « le président de tous les Américains.». Pour autant, avec le soutien de 279 grands électeurs, 55 millions de votants, la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat le 45e Président des États-Unis, disposera de moyens importants pour appliquer son programme économique.
Adressant également un message aux pays étrangers, il indique vouloir travailler « avec tous les pays qui le voudront », chercher « le compromis plutôt que l’hostilité ». Un discours en décalage avec les déclarations de campagne dans lesquelles il prônait de nombreuses mesures protectionnistes et indiquait vouloir se retirer du partenariat transpacifique conclu en 2015 par Barak Obama, et renégocier l’ALENA qui aurait, notamment, engendré de nombreuses délocalisations d’usines américaine vers le Mexique.
L’effet réel sur les marchés se fera ressentir dans les prochaines semaines, quand le Président Trump aura précisé ses orientations. Il pourrait conduire la FED à décider, à nouveau, de reporter un relèvement de ses taux directeurs.
Principales propositions de Donald Trump
Fiscalité
Particuliers: Donald Trump souhaite s’aligner sur ce que la majorité républicaine du Congrès et mettre en place trois tranches au lieu de sept actuellement, avec réduction du taux maximal de 39,6 à 33% :
- moins de 75.000 dollars: 12 %
- entre 75.000 et 225.000 dollars : 25 %
- plus de 225.000 dollars par an : 33 %
Parents: le candidat propose de permettre la déduction fiscale «complète du coût moyen de la garde d’enfants», sans plus de précisions.
Successions: répondant à une grande revendication des conservateurs, Donald Trump souhaite supprimer l’impôt sur les successions, qui ne frappe plus aujourd’hui que celles supérieures à cinq millions de dollars pour un particulier.
Entreprises: baisse de l’impôt sur les sociétés à 15% contre 35 % aujourd’hui. Toutefois, selon une étude de Goldman Sachs, le taux réel que paient actuellement les sociétés du S&P 500 se situe plutôt à 29%.
Cette mesure réduirait les recettes de l’État et engendrerait, selon, le Tax Policy Center, un accroissement la dette à près de 80% du PIB d’ici à 2036 (contre 71,8% actuellement) si rien n’est fait pour réduire les dépenses.
Taxe de 10% sur le rapatriement des bénéfices réalisés à l’étranger. Moratoire sur toute nouvelle réglementation économique et élimination de celles «qui ne sont pas nécessaires, n’améliorent pas la sécurité et détruisent inutilement des emplois».
Budget
éduire les dépenses publiques, à l’exception des programmes sociaux et militaires, de 750 milliards de dollars, par le biais de baisses annuelles de 1 %.
Politique monétaire
Le mandat de Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, arrive à son terme en février 2018. Donald Trump a là aussi martelé dans sa campagne qu’il s’opposerait à la prolongation de son mandat, pour lui préférer un candidat plus en phase avec son programme.
Santé
Suppression de l’Obamacare
Echanges commerciaux
Partenariat transpacifique: Donald Trump se retirerait du partenariat transpacifique (PTP) conclu en 2015 par Barack Obama avec 11 pays du pourtour pacifique, et dont la ratification est actuellement bloquée au Congrès américain.
ALENA : Donald Trump souhaite renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) et revoir principalement les relations avec le Mexique qui auraient engendré de nombreuses usines américaines ont été délocalisées, qui est visé par le républicain.
Le candidat souhaite inclure de nouvelles protections contre la manipulation monétaire et prévoit des sanctions douanières contre «les pays qui trichent en subventionnant leurs produits».
Chine: Il souhaite poursuivre les Chinois pour le vol de propriété intellectuelle, lutter contre le dumping commercial chinois et la manipulation de la monnaie chinoise.
Énergie
Climat: annulation du plan climat de Barack Obama. Annulation de l’accord de Paris sur le climat.
Charbon: relance de l’extraction de charbon en supprimant des réglementations environnementales qui rendaient les anciennes centrales thermiques au charbon obsolètes.
Pétrole et gaz: relance de l’extraction offshore. Demander à la société TransCanada de renouveler la demande de permis pour son projet d’oléoduc Keystone XL entre le Canada et les États-Unis, rejeté par l’administration Obama en 2015.
ALENA : Donald Trump souhaite renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) et revoir principalement les relations avec le Mexique qui auraient engendré de nombreuses usines américaines ont été délocalisées, qui est visé par le républicain.
Le candidat souhaite inclure de nouvelles protections contre la manipulation monétaire et prévoit des sanctions douanières contre «les pays qui trichent en subventionnant leurs produits».
Chine: Il souhaite poursuivre les Chinois pour le vol de propriété intellectuelle, lutter contre le dumping commercial chinois et la manipulation de la monnaie chinoise.
Immigration
Triplement du nombre d’agents de police aux frontières
Érection d’un «mur» à la frontière mexicaine, financé par le Mexique sous menace de supension des transferts d’argent des travailleurs mexicains illégaux.
Actualité de l’épargne – novembre 2016
Le retour des livrets et les dépôts à vue en forme
Le mois de septembre a été marqué par la progression de l’épargne de court terme quand, dans le même temps, l’assurance-vie faisait du surplace. L’épargne de précaution avec la garantie en capital conserve de nombreux adeptes malgré la baisse des rendements. L’assurance-vie a souffert de la polémique excessive concernant les dispositions que le Gouvernement a introduites dans le cadre de la discussion du projet de loi Sapin II afin de disposer de moyens techniques de geler temporairement les contrats d’assurance-vie en cas de force majeure.
L’encours des dépôts à vue de l’ensemble des agents économiques financiers continue à augmenter, en septembre, assez rapidement, plus de 10 % en un mois pour s’élever à 804 milliards d’euros. Une petite décélération est néanmoins enregistrée. En effet, la progression dépassait 12 % au mois de juillet dernier.
Les comptes sur livret sont en progression de 0,3 % en septembre et leur encours atteint 611 milliards d’euros.
Le Livret A maintient de justesse le cap
Le Livret A a signé, en septembre, un septième mois consécutif en collecte nette positive mais de peu. En effet, elle ne s’élève qu’à 140 millions d’euros contre 1,14 milliard d’euros au mois d’août dernier. Certes, cela est nettement supérieur à la décollecte record de 2,38 milliards d’euros du mois de septembre 2015. Mais, l’année dernière, cette décollecte s’expliquait par la baisse à 0,75 % du rendement du Livret A.
En prenant en compte le Livret A et le Livret de Développement Durable, une décollecte de 410 millions d’euros est enregistrée (la décollecte atteint 560 millions d’euros pour le LDD). Le décalage entre ces deux produits s’explique par le fait que le LDD est plus souvent lié aux comptes courants des ménages que le Livret A. Les ménages, en fonction de leur solde de compte courant, effectuent des arbitrages avec le LDD quand le Livret A est utilisé avant tout comme un produit d’épargne. Cette différence de comportement résulte, par ailleurs, de la distribution du LDD, dès sa création, par les banques du LDD (pour le Livret A, elles ont dû attendre le 1er janvier 2009).
Dans un climat économique incertain, les Français devraient maintenir leur effort d’épargne de précaution dans les prochains mois. Néanmoins, du fait de la disparition des gains de pouvoir d’achat générés par la baisse des prix de l’énergie, la collecte nette devrait être faible en octobre comme en novembre. Durant ces deux mois, les ménages doivent acquitter les impôts locaux.
Les livrets fiscalisés de nouveau en hausse
Malgré des taux extrêmement bas, les livrets fiscalisés semblent avoir stabilisé leur encours. Ils avoisinent depuis le début de l’année les 179 milliards d’euros.
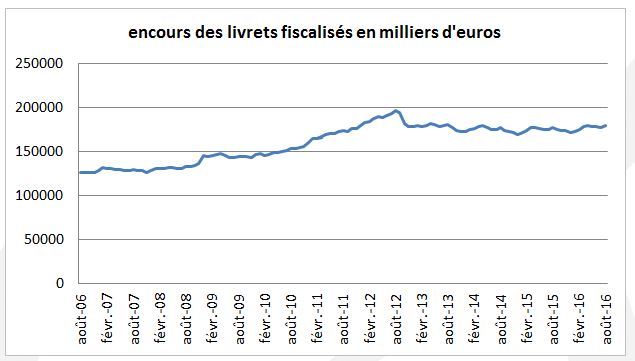
L’assurance-vie à la croisée des chemins
En septembre, l’assurance-vie a connu une petite contre-performance sur fond de polémique avec les dispositions de précaution (voir infra) contenues dans le projet de loi Sapin II.
La collecte nette a été nulle au mois de septembre mettant ainsi un terme à 32 mois de collecte nette positive. Cette baisse s’inscrit dans la décélération des collectes nette de ces derniers mois (à l’exception de celle du mois de juillet, +3,5 milliards d’euros).
Le montant des cotisations a été, en septembre, en léger retrait à 9,6 milliards d’euros par rapport à la tendance de ces derniers mois (11 milliards d’euros par mois en moyenne sur les 9 premiers mois de 2016 et 10,4 milliards d’euros en septembre 2015). En revanche, les rachats sont en hausse à 9,6 milliards d’euros et sont légèrement au-dessus de la moyenne (9,4 milliards d’euros sur les 9 premiers mois).
Les épargnants ne renforcent pas le poids des unités de compte au sein de leurs contrats. Ces dernières représentent toujours 19 % du total des cotisations (pour le mois de septembre comme pour les 9 premiers mois de l’année).
Dans les prochains mois, la question du rendement des fonds euros devrait être au cœur de l’actualité d’autant plus que le Gouverneur de la Banque de France qui préside également l’autorité de régulation a, à plusieurs reprises, demandé que les compagnies d’assurances abaissent leurs taux. Les épargnants seront de plus en plus incités à investir sur les unités de compte. Il conviendra alors de regarder si leur appétence en la matière s’accroît.
Le Plan d’Épargne Logement, une hausse plus modeste
L’encours du PEL a atteint un sommet historique au mois d’août 2016 à 251 milliards d’euros. Néanmoins, même si la baisse du taux à 1 % ne concerne que les contrats ouverts après le 1er août, une inflexion dans la croissance des primes est intervenue à partir du mois de juillet. La croissance qui était de plus de 10 % est repassée en deçà. Il n’en demeure pas moins que ce produit a enregistré une hausse de 49 % de 2006 à 2016.
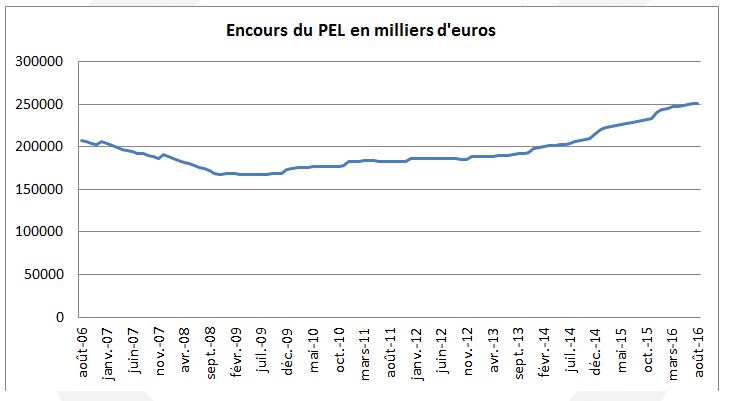
Des instruments non-conventionnels pour des temps extraordinaires
Du fait que la phase de taux bas est amenée à durer, il y a une prise de conscience générale que cela modifie en profondeur de nombreux équilibres au sein du système financier. Après des années de taux élevés, nous devons nous habituer à des taux nominaux négatifs ou proches de zéro dans un contexte de faible inflation. Les risques auxquels peuvent être confrontés les acteurs financiers changent. Les pouvoirs publics, régulateurs en tête, surveillent avec attention les conséquences de la mise en œuvre dans la durée de politique monétaire appelée non-conventionnelle.
Dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit loi Sapin II, plusieurs mesures visant à garantir la pérennité des contrats d’assurance-vie ont été prises par voie d’amendements. Bernard Delas, vice-président de l’ACPR a récemment déclaré sur ce sujet « qu’en l’absence de mesures adaptées prises avec une anticipation suffisante, les taux bas deviendront, à moyen et long terme, une menace pour la rentabilité et la solvabilité du marché. Et feront peser sur les assureurs des risques qu’ils auront de plus en plus de difficultés à assumer ». Il a ajouté que « les taux bas agissent comme un poison dont les effets sont inéluctables ».
Action sur les taux
Les pouvoirs publics demandent que les rendements des fonds euros des contrats d’assurance-vie qui pèsent plus de 1 300 milliards d’euros prennent mieux en compte la baisse des taux d’intérêt.
Le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré au mois de janvier 2016, « il faut poursuivre résolument la baisse des rendements de l’assurance-vie investie en fonds euro ». Il a souligné au mois d’octobre « qu’ils ont été réduits de 25 points de base en 2015 par rapport à l’année précédente. Cependant, cette baisse reste encore insuffisante. »
La loi Sapin II prévoit que le Haut Conseil de la Stabilité Financière puisse, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices des compagnies d’assurances. Par cette mesure, en cas de taux non conformes à la réalité du marché, les autorités pourraient peser sur leur niveau en obligeant les compagnies d’assurances à maintenir des niveaux de provision plus élevés.
Le gel des contrats en cas de circonstances exceptionnelles et pour éviter un « assurance-run »
En cas de remontée des taux, les épargnants pourraient être tentés d’abandonner leurs vieux contrats d’assurance-vie et leurs vieux fonds euros au profit de fonds mieux rémunérés. Des rachats massifs pourraient déstabiliser l’assurance-vie au moment même où par le jeu de l’augmentation des taux, les fonds propres des compagnies pourraient être mis à mal.
En cas de faiblesse de fonds propres, du fait de la garantie en capital applicable aux fonds euros, plus de 1 300 milliards d’euros sur 1 620 milliards d’euros pour l’ensemble de l’assurance-vie, le problème de liquidités pourrait se transformer en problème de solvabilité.
La loi Sapin II prévoit qu’en cas de crise grave mettant en danger le système financier, le Haut Conseil de Stabilité Financière, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, peut, pour une période de 3 mois reconductible sur avis motivé :
- Empêcher totalement ou partiellement les versements ;
- Empêcher totalement ou partiellement les arbitrages ;
- Empêcher totalement ou partiellement les rachats.
Le Haut Conseil sera amené à fixer les modalités d’application du dispositif et en particulier, par exception, les possibilités d’accès, pour les assurés modestes ou dont les revenus sont majoritairement issus de leur assurance-vie. Par ailleurs, la loi prévoit que « dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires »
En gelant les contrats d’assurance-vie, le Gouvernement ne fait pas, contrairement à ce que certains ont pu souligner, main basse sur l’épargne des ménages. C’est avant tout une mesure de précaution pour éviter une panique et une implosion du système financier. C’est une mesure qui a vocation à ne s’appliquer qu’en cas de crise grave. C’est une mesure qui ne remet pas en cause les contrats. C’est une mesure qui ne spolie pas les assurés.
L’Autorité de contrôle de régulation dispose déjà d’un pouvoir de gel des contrats d’assurance-vie mais compagnie par compagnie. Il n’est pas en revanche de son pouvoir ni de sa compétence de bloquer d’un coup tous les contrats. C’est pourquoi, le gel revient au Haut Conseil de la Stabilité Financière qui dépend du Ministère de l’Economie et des Finances.
Tout savoir ou presque sur les contrats d’assurance-vie luxembourgeois
En 2011/2012, en pleine crise des dettes souveraines, les contrats d’assurance-vie luxembourgeois avaient connu une forte croissance, il semblerait que cela soit à nouveau le cas avec la loi sapin II.
Les Français sont, avec les Allemands, ceux qui disposent du plus important portefeuille de contrats luxembourgeois. Le tiers de la collecte luxembourgeoise d’assurance-vie serait français. L’encours des contrats luxembourgeois détenus par les Français atteindrait 40 milliards d’euros.
Cet engouement repose sur des craintes plus ou moins réelles portant sur la sécurisation des contrats de droit français et de manière bien plus positive sur la souplesse de la législation ainsi que le savoir-faire luxembourgeois.
Mais qu’est un contrat luxembourgeois ?
C’est un contrat d’assurance-vie soumis au droit luxembourgeois et non au droit français. Ce sont des contrats gérés par des établissements basés au Luxembourg. Il peut s’agir de filiales d’établissements financiers français.
Quels sont ces avantages par rapport à des contrats de droit français ?
Plusieurs avantages !
Les contrats luxembourgeois sont recherchés au nom de la sécurité qu’ils sont censés procurer à leur détenteur et au nom des innovations en matière de gestion que le droit de notre voisin favorise.
La sécurité
Les souscripteurs d’assurance-vie placent la sécurité parmi leurs priorités. Le Luxembourg, en jouant sur la protection des droits des assurés, s’est créé une réputation sur le sujet.
Le Superprivilège
La notion de super privilège introduite par la loi modifiée du 6 décembre 1991 (article 39 et suivants) sur le secteur des assurances, garantit que l’épargne capitalisée dans les contrats d’assurance-vie luxembourgeois est complètement protégée.
Les clients bénéficient en effet d’une sécurité exceptionnelle en cas de défaillance de la compagnie d’assurances car ils sont légalement privilégiés par rapport aux autres créanciers de la compagnie afin de récupérer en priorité les créances relatives à l’exécution de leurs contrats d’assurance.
La sécurisation des fonds
Le Luxembourg dispose du régime de protection des investisseurs le plus strict d’Europe. Cela se traduit par une exigence légale qui impose que tous les actifs des clients soient détenus par une banque dépositaire approuvée par le Commissariat aux Assurances, contribuant ainsi à renforcer la solidité financière des compagnies. Il y a cantonnement des actifs des clients vis-à-vis de ceux des actionnaires et créanciers de la compagnie d’assurances. Le client peut même choisir la banque dépositaire.
Pour mémoire, en France, l’assuré ne bénéficie que d’une garantie à hauteur de 70 000 euros.
Stabilité du droit et du système politique du Luxembourg
Le Luxembourg met en avant que la législation y est plus stable que dans de nombreux autres pays.
Est-ce que la sécurité est totale ?
Tout est relatif en la matière. En cas de fin du monde, nul ne peut rien garantir. Compte tenu de l’importance des bilans des banques luxembourgeoises, la garantie accordée par l’État est avant tout psychologique.
Au niveau de la gestion : une diversité et du sur-mesure
Le titulaire d’un contrat luxembourgeois a la possibilité de placer sous une autre devise que l’euro ses avoirs. Cela permet de diversifier ses risques et de jouer sur les variations de change de manière plus directe que dans le cadre de contrats multisupports en euros.
Via son contrat luxembourgeois, l’épargnant a la possibilité d’accéder à un très grand nombre de supports et à différentes formules de gestion. Il est à signaler que la législation française s’est récemment adaptée pour permettre aux professionnels d’offrir à leurs clients des produits qui étaient réservés auparavant aux contrats luxembourgeois.
En plus du traditionnel fonds euros, les assurés peuvent accéder à des unités de comptes et à des fonds spécifiques.
Les fonds externes :
Il s’agit d’une offre multisupport telle qu’on la connaît dans les contrats d’assurance-vie français donnant l’opportunité aux clients d’investir dans une large gamme de fonds externes des plus importants gestionnaires financiers. Le choix peut s’effectuer sur des centaines de fonds d’investissement.
Les fonds internes collectifs (FIC) :
Les Fonds Internes Collectifs sont accessibles à un groupe d’investisseurs n’ayant pas nécessairement de liens familiaux. Ils fonctionnent comme des OPCVM. C’est un véhicule idéal pour une gestion collective des contrats.
Les fonds internes dédiés (FID)
Sans doute la spécialité du Luxembourg, les Fonds Internes Dédiés. Ces fonds donnent l’accès à une gamme complète de produits sophistiqués, innovants pouvant inclure des obligations, actions (cotées ou non), fonds internationaux, produits structurés, et des fonds non agréés AMF comme les Hedge Funds et fonds de Private Equity. La gestion des actifs est déléguée à un gestionnaire financier que le souscripteur aura préalablement désigné. Le mécanisme s’apparente un peu à celui d’un trust du point de vue du choix qui est laissé au souscripteur vis-à-vis de la désignation du gestionnaire, du mandataire, et du dépositaire.
Les fonds assurance spécialisés (FAS)
Le FAS ouvre la possibilité d’investir dans des titres vifs sans avoir recours à un gestionnaire financier comme c’est le cas dans un FID. C’est le souscripteur qui décide de la composition du fonds soit lors du versement de la prime initiale, complémentaire ou lors d’un arbitrage.
L’apport en titres
Les contrats luxembourgeois offrent la possibilité au souscripteur d’alimenter son contrat en titres vifs cotés ou non. Cela permet pour un chef d’entreprise, par exemple, de loger les parts de sa société. Cela a été autorisé par la loi Macron pour la France.
Quels sont les frais ?
Les mêmes que pour les contrats français. Ils sont négociables et dégressifs en fonction des montants.
Quelle fiscalité pour ces contrats ?
Il y a application de la règle de la neutralité fiscale. C’est le droit du pays de résidence qui s’applique. Les Français doivent indiquer qu’ils disposent d’un contrat d’assurance-vie au Luxembourg.
Avantages en matière d’ISF
Pour les expatriés sur le point de revenir en France, ouvrir une assurance-vie au Luxembourg pour y placer une partie du capital permet de le soustraire de l’ISF pendant 5 ans.
Ainsi, en vertu de l’article 885 A du CGI, le fait d’avoir été non-résident pendant au moins 5 ans permet d’exclure de l’assiette de l’ISF les biens situés hors de France jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit le retour en France. Cela peut représenter une économie majeure.
Pour les Français s’expatriant, ils restent soumis à l’ISF sur leurs biens situés en France. Un contrat d’assurance-vie au Luxembourg permet d’échapper à l’imposition en sortant le capital de l’hexagone.
Qui peut investir ?
C’est avant tout réservé à des épargnants importants !
Il faut en moyenne 250 000 euros pour accéder à ces contrats. Mais désormais, certains contrats sont accessibles à partir de 100 000 euros. Pour accéder aux contrats plus sophistiqués, il faut disposer de plusieurs millions d’euros.
Près de 600 000 décès en France en 2015
L’INSEE a publié les résultats détaillés des décès en France au cours de l’année 2015. Ils se sont élevés à 594 000. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis l’après-guerre. Par rapport à 2014, 34 000 personnes supplémentaires sont décédées, soit une hausse de 6,1 %. Cette augmentation s’explique par un effet de génération, ce sont des générations plus nombreuses que les précédentes qui arrivent dans les âges de forte mortalité et par des événements épidémiologiques plus marqués. Sur ce dernier, il faut souligner qu’une population plus âgée est plus sensible aux épidémies.
De 1985 jusqu’aux premières années du XXIe siècle, ce sont les classes d’âge, dites « creuses », nées entre 1915 et 1919 qui sont arrivées aux âges où l’on meurt le plus. De ce fait, il a été constaté de manière logique une baisse du nombre de décès. Au début de la décennie 2010, l’effet des classes creuses ne joue plus. En outre, les premières générations nombreuses de baby-boomers entrent dans des âges où le risque de décéder est plus élevé (en 2011, les personnes nées en 1946 ont 65 ans).
La hausse importante des décès en 2015 s’explique aussi par des raisons conjoncturelles : une épidémie de grippe importante est survenue entre mi-janvier et mi-mars, à laquelle se sont ajoutés plusieurs épisodes de canicule en juillet et août.
Sans surprise, le nombre de décès s’accroît au cours de l’hiver, néanmoins la saisonnalité des décès est moins marquée que dans le passé en raison notamment des canicules.
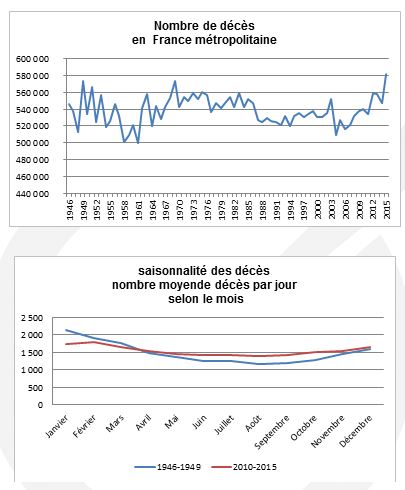
L’ascenseur social est-il en panne à cause des seniors ?
La pyramide des âges au sein des entreprises est déséquilibrée avec beaucoup de plus de 50 ans et peu de moins de 35 ans. De ce fait, les promotions sont plus difficiles ; les places à responsabilité étant occupées par les aînés. Certes, des places peuvent se libérer du fait de la mobilité externe mais en période de crise, cette dernière a tendance à se ralentir. Avec le report de l’âge de la retraite, le maintien en activité des cadres jusqu’à 67 ans est amené à s’accroître. En outre, la digitalisation et les nouvelles techniques de management raccourcissent les chaînes de commandement. De nombreux postes de direction sont amenés à disparaître ou à évoluer. De ce fait, les probabilités de promotion se réduisent ce qui est une source de frustration sociale qui s’ajoute à celle liée aux faibles augmentations salariales. Sont particulièrement victimes de cette réduction des promotions, les générations de la fin du baby-boom et celles nées juste après dans les années 70. En effet, n’étant pas « digital native », elles se retrouvent en concurrence avec ces dernières. Il n’est pas rare que des sauts de générations se produisent pour des raisons technologiques et sociologiques que ce soit au niveau des entreprises qu’au niveau politique.
La population active sous la double contrainte de l’âge et du digital
Si la question du financement des retraites est, depuis des années, au cœur du débat public, celle liée au vieillissement de la population active l’est moins. Pour autant et comme le signale une récente note du Conseil d’Orientation des Retraites, ce vieillissement aura des effets importants en matière économique. Il en aura également au niveau social.
Un vieillissement accéléré de la population active
La part des actifs de plus de 50 ans est passée de 16 % en 1995 à 27 % en 2012 (dernier chiffre connu) quand celle des plus de 55 ans est passée de 8 à 13 %. Cette augmentation s’explique par le fait que dans les années 90 toutes les classes d’âge du baby-boom sont en activité professionnelle et que les premières atteignaient la cinquantaine. Par ailleurs, prenaient alors leur retraite les actifs issus des classes creuses de l’entre-deux-guerres. Au tournant du siècle, le vieillissement s’est accéléré car les classes d’âge des années 75/80, moins larges que les précédentes, sont entrées sur le marché du travail. Par ailleurs, les premières générations du baby-boom ont commencé à prendre leur retraite.
Aujourd’hui, pour un actif de plus de 55 ans, il y a 6,5 actifs de 15 à 54 ans. Ce ratio devrait se stabiliser autour de 4,5 à partir de 2030.
Les actifs de plus de 65 ans représentent 0,8 %, en 2012, de la population active contre 0,36 % en 2006. Cette proportion est en constante augmentation en raison notamment de l’assouplissement du cumul emploi/retraite intervenu en 2009. L’INSEE prévoit que le taux d’activité des 65/69 ans devrait fortement augmenter dans les prochaines années. Il devrait passer de 5 à 18 % pour les hommes et de 3 à 13 % pour les femmes d’ici 2060. La diminution du taux de remplacement des pensions, le développement du travail de consultant ainsi que le meilleur état de santé des seniors expliquent cette progression du nombre de travailleurs de plus de 65 ans.
Le vieillissement de la population active est, en France, moindre que celui de plusieurs de nos partenaires. En effet, du fait d’un taux de natalité supérieur, la population active continue de s’accroître par l’arrivée de jeunes actifs. Ainsi, si la proportion des 50/64 ans est en France de 35 %, Elle est de 42 % en Espagne, de 41 % en Italie et de 40 % en Allemagne.
Tous les pays avancés et un certain nombre de pays émergents comme la Chine sont confrontés à la gestion d’une main-d’œuvre plus âgée.
Travailler c’est bien, mais être en bonne santé, c’est mieux !
L’allongement de la vie professionnelle n’est possible qu’à condition d’être en bonne santé. Le passage de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans a provoqué un surcoût pour les organismes chargés de la prévoyance.
Les handicaps augmentent fortement à partir de 50 ans. Ainsi, selon l’enquête HSM, une femme âgée de 50 ans en 2015 passera, en moyenne, au cours des 15 prochaines années plus de 30 % de son temps professionnel avec des limitations physiques. Pour les hommes, le ratio est de 17 %. Concernant les atteintes cognitives, les limitations sont évaluées à une année.
Un homme ayant une mauvaise santé a une probabilité d’être en emploi après 50 ans amputé de 28 %. L’accumulation d’arrêts de travail pour raison de santé provoque la cessation anticipée d’activité et la mise en retraite dans un très grand nombre de cas. Les employeurs et les salariés préfèrent faire jouer les régimes de prévoyance.
Certains demandent la création d’un statut de travailleur âgé et de mieux définir l’inaptitude au travail.
L’expérience au travail, difficile à mesurer, constitue un des principaux facteurs d’employabilité. La meilleure preuve est fournie par la difficulté qu’ont les jeunes à trouver leur premier emploi. L’expérience au travail nécessite une dizaine d’années de vie professionnelle. Elle est moins importante dans les secteurs technologiques (start-up, informatique, communication).
La motivation constitue un autre facteur important. Elle est, en règle générale, plus forte chez les jeunes actifs mais n’est pas obligatoirement absente chez les seniors.
Productivité, innovation et seniors sont-ils antinomiques ?
Il est couramment admis que les travailleurs âgés sont moins productifs que les jeunes. Les départs anticipés à la retraite concernant certains métiers étaient accordés au nom d’une certaine compensation sociale mais aussi au nom de la productivité. Un travailleur âgé ne pouvait pas être aussi rentable dans les mines, dans les usines sidérurgiques qu’un jeune. Aujourd’hui, avec la robotisation, avec la tertiarisation de l’économie, ce sont moins les critères de force physiques que les capacités cognitives à absorber le changement. Les problèmes psychologiques deviennent également de plus en plus prégnants avec l’âge.
Selon les résultats du test d’aptitude générale (GATB) et au regard de nombreuses études en neurosciences, les facultés cognitives atteindraient un maximum autour de 30 ans avant de décliner. Il apparaît que ce sont les capacités physiques et d’intégration du progrès qui diminuent le plus rapidement. En revanche, ce qui est assez logique, les capacités managériales qui reposent sur l’expérience, restent assez constantes avec l’âge.
Les seniors sont handicapés par un ralentissement de leur capacité de réaction et de résolution des problèmes (étude Lemaire 1999). « La mémoire de travail » zone du cerveau permettant de stocker et de manipuler des informations en vue d’accomplir une tâche cognitive (étude Braver et West 2007) est corrélée à l’âge.
Différentes études ont prouvé que les capacités cognitives baissent d’autant moins rapidement que le niveau de formation initial est élevé et que l’activité intellectuelle demeure importante durant toute la vie. Ce sont pour ces raisons que les professions intellectuelles connaissent une moindre baisse de leurs capacités cognitives.
Au regard des différentes études, il apparaît nécessaire tant pour la santé de la population que pour la compétitivité des entreprises d’enrichir intellectuellement les emplois et de maintenir tout le long de la vie professionnelle un fort volant de formation.
La productivité et les seniors font-ils bon ménage ?
Des enquêtes autrichiennes concluent que le vieillissement de la population conduit à une baisse de productivité mais qu’en revanche son rajeunissement a peu d’effets.
L’étude de Maestas de 2014 portant sur les États-Unis souligne qu’une augmentation de 10 % de la population active âgée de plus de 60 ans entraîne une baisse du PIB par habitant de 5,7 %.
Selon une étude de Feyrer de 2007, la croissance repose sur les 40–50 ans. Quand cette part de la population est la plus importante, le taux de croissance a tendance à s’élever. Les pays à faibles revenus sont des pays ayant une population jeune importante et un nombre d’actifs de plus de 40 ans faible.
Les études de Lisenkova et de Boersch-Supan soulignent que le vieillissement de la population en Écosse ou en Allemagne provoquera une baisse de 15 % la productivité du facteur travail et cela malgré l’accumulation capitalistique. Pour maintenir le pouvoir d’achat des Écossais comme des Allemands, il conviendra d’accroître la productivité des actifs. Les simulations par modèle économique démontrent que l’accroissement du capital ne pourra générer dans les prochaines années que 0,2 point supplémentaire de productivité quand il en faudrait au minimum 0,5 point.
Pour ralentir le vieillissement de la population, le recours à l’immigration constitue une des solutions possibles. Pour des pays comme l’Italie ou l’Allemagne, le nombre d’immigrés nécessaire pour contrecarrer le vieillissement est important. Ces pays devraient accueillir dans les vingt prochaines années, plusieurs millions de travailleurs étrangers. En 2015, l’Allemagne a accepté 890 000 réfugiés politiques.
La robotisation et la digitalisation mettent-elles en danger le travail des seniors ?
Depuis le début de la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle, le développement des machines a permis de décupler la force du travailleur, force physique puis force intellectuelle avec l’émergence de l’informatique.
Le développement de la robotique et de l’intelligence artificielle risque – dans les prochaines années – de supprimer de nombreux métiers. Après le secteur secondaire, c’est le secteur tertiaire qui est concerné. Seront concernés les activités de service classiques comme le gardiennage mais aussi des activités plus sophistiquées (diagnostic médical). Les emplois de demain reposeront de plus en plus sur la créativité, le sens de l’organisation, la capacité de réaction et sur le contact humain.
Cette transformation rapide de la sphère productive peut conduire à l’expulsion des actifs les plus âgés. La diminution de la croissance de la population active constitue un frein à cette tendance. Par ailleurs, selon une étude de 2014 (Autor), si l’automatisation conduit à une segmentation accrue du marché du travail (avec moins d’emplois à faible qualification et plus d’emplois qualifiés), elle ne sera pas en tant que telle à l’origine d’une massification du chômage.
Les salariés les plus âgés se situent rarement dans les entreprises à forte teneur en technologie. Ils se concentrent au sein des secteurs traditionnels qui sont plus sensibles aux aléas de la conjoncture. Ces secteurs peuvent néanmoins connaître des ruptures technologiques.
La robotisation est indispensable afin d’améliorer la productivité du travail amenée à baisser du fait du vieillissement. À ce titre, il est à noter que pour le moment, les gains de productivité générés par le big data, les objets connectés et le digital sont plus faibles que ceux procurés par les technologies de l’information et de la communication au tournant du siècle. Ces derniers avaient été évalués à 0,6 point en moyenne annuelle en Europe et à 1 point aux États-Unis. Les gains de l’actuelle révolution numérique seraient de 0,3 à 0,4 point en moyenne annuelle.
Les conséquences économiques liées au report de l’âge de la retraite
Le taux d’emploi qui mesure la part de personnes en emploi dans une tranche d’âge, a fortement progressé, ces dernières années, chez les 55/59 ans du fait de l’allongement de la durée de cotisation, du report de l’âge de la retraite à 62 ans et de la progression du taux d’activité féminine. Entre 2005 et 2015, il est passé de 38,2 à 48,6 % se rapprochant de l’objectif de 50 % que les pouvoirs publics s’étaient fixés. Il reste néanmoins inférieur à la moyenne européenne.
Le nombre de bénéficiaires de pensions d’invalidité augmente assez fortement du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite pour deux raisons. La première est liée au fait que des personnes bénéficiant avant 60 ans d’une pension d’invalidité continuent à la percevoir durant une période supplémentaire de 2 ans. La seconde est liée au fait que des personnes qui avant 2010, après 60 ans, auraient été à la retraite, se retrouvent de possibles bénéficiaires de pensions d’invalidité, ce qui génère un surcoût pour les caisses concernées.
Le report de l’âge de la retraite a, selon une étude (Rabaté/Rochut 2016), entraîné une baisse de 40 % du taux de retraités à 60 ans avec en contrepartie une hausse du taux d’emploi de 14 points, du taux de chômage de 13 points et du taux des personnes en arrêt-maladie ou en invalidité de 5 points. Pour les 9 points restants, les auteurs de l’étude concluent qu’une partie des sexagénaires se serait placée en inactivité en attendant de pouvoir toucher leur pension. Si les cadres arrivent à se maintenir en activité, en revanche, la proportion des employés et des ouvriers qui basculent dans le chômage ou l’invalidité est forte. Ce phénomène est constaté dans tous les pays ayant décidé des reports de l’âge de la retraite.
Au sommaire de cette étude
Augmentation des dépenses d’invalidité
- Le risque d’invalidité augmente de manière exponentielle en fonction de l’âge
- Le montant moyen de la pension d’invalidité croît avec l’âge
L’augmentation du taux de chômage chez les seniors, une illusion d’optique ?
Le Livret A maintient de justesse le cap
Le Livret A a signé, en septembre, un septième mois consécutif en collecte nette positive mais de peu. En effet, elle ne s’élève qu’à 140 millions d’euros contre 1,14 milliard d’euros au mois d’août dernier. Certes, cela est nettement supérieur à la décollecte record de 2,38 milliards d’euros du mois de septembre 2015. Mais, l’année dernière, cette décollecte s’expliquait par la baisse à 0,75 % du rendement du Livret A.
En prenant en compte le Livret A et le Livret de Développement Durable, une décollecte de 410 millions d’euros est enregistrée (la décollecte atteint 560 millions d’euros pour le LDD). Le décalage entre ces deux produits s’explique par le fait que le LDD est plus souvent lié aux comptes courants des ménages que le Livret A. Les ménages, en fonction de leur solde de compte courant, effectuent des arbitrages avec le LDD quand le Livret A est utilisé avant tout comme un produit d’épargne. Cette différence de comportement résulte, par ailleurs, de la distribution du LDD, dès sa création, par les banques du LDD (pour le Livret A, elles ont dû attendre le 1er janvier 2009).
Dans un climat économique incertain, les Français devraient maintenir leur effort d’épargne de précaution dans les prochains mois. Néanmoins, du fait de la disparition des gains de pouvoir d’achat générés par la baisse des prix de l’énergie, la collecte nette devrait être faible en octobre comme en novembre. Durant ces deux mois, les ménages doivent acquitter les impôts locaux.
Le retour des livrets et les dépôts à vue en forme
Le mois de septembre a été marqué par la progression de l’épargne de court terme quand, dans le même temps, l’assurance-vie faisait du surplace. L’épargne de précaution avec la garantie en capital conserve de nombreux adeptes malgré la baisse des rendements. L’assurance-vie a souffert de la polémique excessive concernant les dispositions que le Gouvernement a introduites dans le cadre de la discussion du projet de loi Sapin II afin de disposer de moyens techniques de geler temporairement les contrats d’assurance-vie en cas de force majeure.
L’encours des dépôts à vue de l’ensemble des agents économiques financiers continue à augmenter, en septembre, assez rapidement, plus de 10 % en un mois pour s’élever à 804 milliards d’euros. Une petite décélération est néanmoins enregistrée. En effet, la progression dépassait 12 % au mois de juillet dernier.
Les comptes sur livret sont en progression de 0,3 % en septembre et leur encours atteint 611 milliards d’euros.
Locataire ou propriétaire, l’éternel débat
L’édito de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne
Les ménages français ont repris, au cours du 3e trimestre, le chemin de l’investissement immobilier mettant un terme à deux ans de recul. La baisse du coût du crédit et celle du rendement des produits d’épargne de taux expliquent, sans nul doute, ce regain de flamme en faveur de la pierre. Si les prix sont à la hausse, cette dernière demeure raisonnable. Les primo-accédants ne sont pas encore de retour car le niveau des prix demeure dissuasif.
Par ailleurs, les jeunes actifs de moins de 30 ans, en raison d’une insertion plus difficile dans la vie professionnelle, ont plus de trois ans de retard par rapport à leurs aînés pour l’acquisition de leur première résidence principale. De ce fait, le marché dépend des reventes et des achats de la part de ménages matures. Cela pèse sur les prix.
Mais au-delà de ces variations conjoncturelles, est-il vraiment intéressant d’acheter un bien immobilier ? Quand les taux d’intérêt étaient élevés, il était bien souvent plus rationnel financièrement d’être locataire et d’épargner. Aujourd’hui, évidemment, la baisse des taux d’intérêt modifie la donne. Mais est-ce aussi simple que cela ? Dans les prochaines années, les plus-values seront plus rares du fait notamment du vieillissement de la population. L’acquéreur doit également intégrer dans ses calculs les impôts liés à la propriété dont la taxe foncière qui a tendance à augmenter. II doit acquitter les frais de notaire et les charges de copropriété qui sont de plus en plus onéreuses.
De leur côté, les loyers ont, ces dernières années, augmenté moins rapidement que la valeur des biens immobiliers donnant un avantage aux locataires. Certes, la baisse des taux a amélioré la rentabilité de l’achat immobilier, malgré tout, la location peut encore l’emporter. À titre d’exemple, un propriétaire qui aura investi 535 000 euros pour acheter un logement à Paris (frais de notaire compris, apport personnel de 100 000 euros, emprunt à 1,57 % sur 15 ans, assurance comprise, charges et impôts à 10 000 euros par an), serait perdant face à un locataire occupant ce même logement de 67 mètres carrés et dont le loyer serait inférieur à 1900 euros. Ce calcul est fait en considérant qu’il n’y aura pas de plus-values sur 15 ans. Au-delà des aspects comptables et financiers, l’immobilier a, à son crédit, une valeur psychologique qui n’a pas de prix.
Epargne des ménages quasi-stable au deuxième trimestre 2016
A 14, 6 % sur le deuxième trimestre 2016, le taux d’épargne des ménages progresse de 0,1 % sur le deuxième trimestre 2016 après six mois de stabilité.Les Français confortent ainsi leur désir de ne pas puiser dans leur bas de laine malgré le contexte des taux bas.
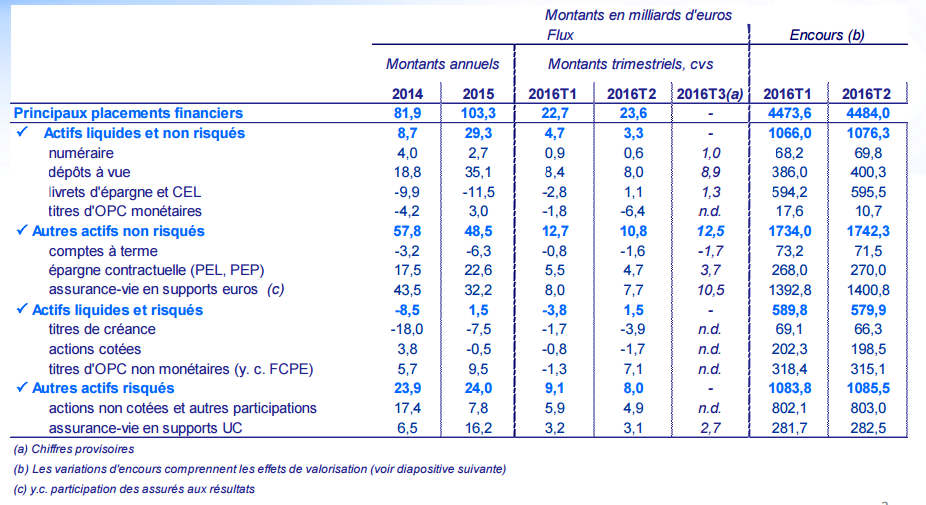
Le patrimoine financier brut des ménages s’établit, à la fin juin, à 4 484,0 milliards d’euros grâce a une progression des flux nets de placements(+23,6 milliards) qui vient compenser une valorisation à la baisse des actifs (-13, 2 milliards d’euros).
Cette progression des flux profite principalement aux dépôts à vue dont les flux atteignent 8 milliards d’euros sur le deuxième trimestre, à l’assurance vie (en support euros) et aux titres d’OPC non monétaires. Les livrets d’épargne après avoir nettement reculés en 2015 retrouvent un attrait auprès des épargnants avec des flux qui atteignent 1,1 milliard d’euros sur entre mars et juin 2016 et 1,3 milliard attendu sur le troisième trimestre.
Sur la base des estimations de la banque de France au titre du troisième trimestre, les actifs non risqués après avoir reculés sur le deuxième trimestre devraient revenir à un niveau proche de celui constaté sur les trois premier mois de l’année 2016 grâce à l’assurance vie avec 10,5 milliards d’euros de flux sur les supports euros entre de juillet à septembre contre 7,7 milliards à la fin juin. Signe des incertitudes des Français sur les placements à privilégier, les dépôts à vue auraient continué à progresser pour atteindre 8,9 milliards d’euros sur l’intervalle.
consulter la note de la banque de France
Europe1 – Epargne : retour en grâce du Livret A
Après avoir longtemps boudé le Livret A, les épargnants semblent s’être habitués à la baisse du rendement entrée en vigueur en août 2015, avec un huitième mois consécutif de collecte positive en septembre. Dans une interview donné à Europe1, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi les Français se sont réconciliées avec ce placement.
Croissance européenne : le PIB poursuit sa progression à rythme constant
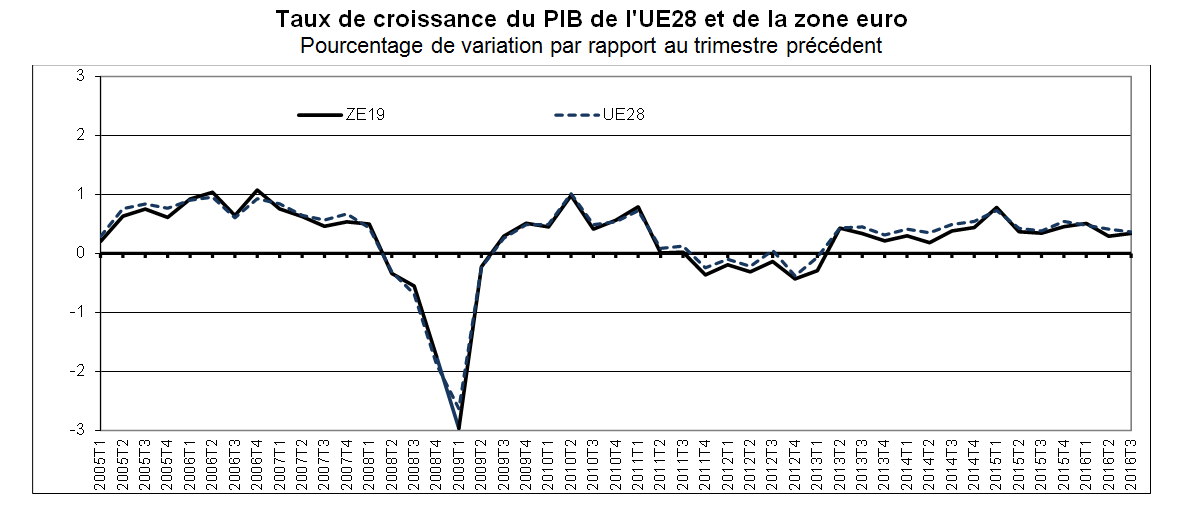
31 octobre : la Journée mondiale de l’épargne
Depuis la fin des années 1990, les Français se sont familiarisés avec la fête Halloween, pendant festif de la Toussaint, populaire dans les pays anglo-saxons. Le 31 octobre est également, la journée mondiale de l’épargne. Méconnue du grand public, la journée mondiale de l’épargne souffle pourtant sa 91e bougie cette année. Créée en 1925, cette journée a été initiée par les représentants des caisses d’épargnes de 29 pays pour inciter les peuples à épargner .
RTL – interview de Philippe Crevel sur les résultats de la croissance française
Philippe Crevel commente sur RTL les résultats de la croissance française au 3e trimestre 2016. Estimée à 0,2 % par Bercy, Philippe Crevel met en évidence la situation de la France au regard de ses voisins et considère que l’objectif gouvernemental sera difficilement atteignable.
Moindre amélioration de la situation des ménages européens au 2e trimestre 2016
Les revenus des ménages par habitant la zone euro et l’Union européenne progressent moins vite au 2e trimestre 2016. Ainsi, les ménages habitants la zone euro voient leur revenus réels progresser de 0,2 % quand ceux des membres de l’Union européenne à 28 progressent de 0,5 %. Au premier trimestre l’année, les progression étaient de 1 % dans les deux zones concernés.
La principale conséquence de ce ralentissement est la moindre croissance des dépenses de consommation sur les deux zones. La consommation réelle des habitants de l’UE28 progresse ainsi de 0,4% (après 0,5 % le trimestre précédent) quand elle est restée stable au seinde la zone euro (après avoir gagné près d’ 1 point au premier trimestre).
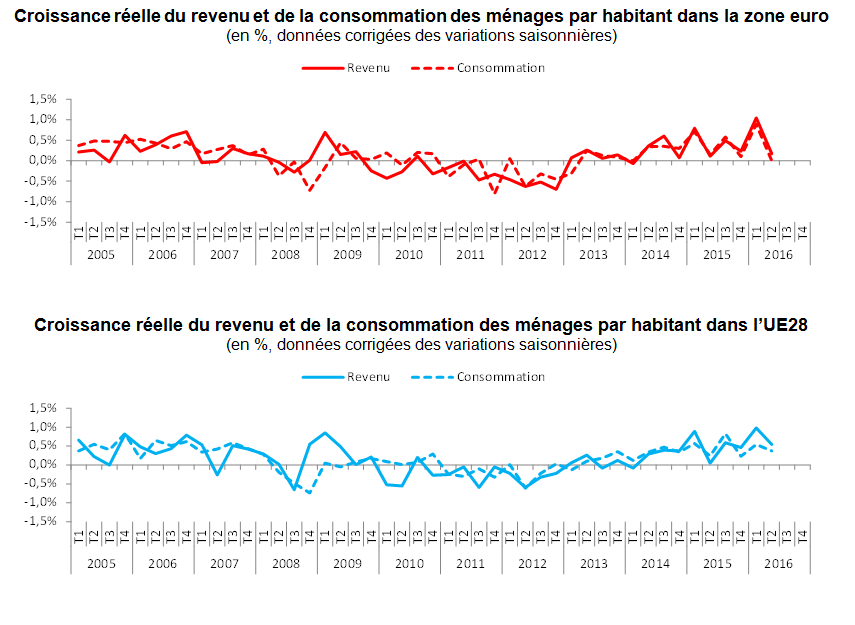
Au 3e trimestre, une croissance bien poussive
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AU 3EME TRIMESTRE, UNE CROISSANCE BIEN POUSSIVE
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Un petit 0,2 % qui permet d’éviter la récession
Le taux de croissance de l’économie française n’aura été que de 0,2 % au troisième trimestre. Certes, ce taux positif évite à la France de tomber en récession après le recul de 0,1 % du PIB au deuxième trimestre. Elle ne le doit qu’aux variations de stock et à l’investissement, les autres composantes, la consommation et le commerce extérieur, ayant joué négativement.
Les dépenses de consommation des ménages stagnent pour le deuxième trimestre consécutif en raison du recul des dépenses de biens (-0,5 %), qui n’est que partiellement compensé par les dépenses de service en hausse de 0,3 %. Les attentats peuvent avoir pesé sur les achats des ménages au début du trimestre. Néanmoins, en septembre, les dépenses de consommation en biens diminuent de 0,2 % au mois de septembre prouvant que les Français demeurent très attentistes. Par ailleurs, la consommation est certainement entravée par la fin des gains de pouvoir d’achat générés par la baisse du prix du pétrole ainsi que par le maintien d’un fort taux d’épargne.
L’investissement de retour grâce à l’immobilier et aux services
Après une stagnation au deuxième trimestre, l’investissement augmente de 0,3 % au 3ème. L’investissement en construction connaît une nette reprise avec une hausse de 0,9 % faisant suite à une contraction de 0,1 % au deuxième trimestre. Les dépenses d’investissement en services marchands progressent également fortement avec +1,1 % après 0,0 %. Ce sont les dépenses en logiciels qui sont les plus dynamiques. En revanche et c’est un point noir pour l’industrie, l’investissement en biens manufacturés se contracte nettement (-2,3 % après +0,3 %), notamment en matériels de transport et en biens d’équipements. Le résultat de l’investissement peut apparaître donc assez décevant surtout au regard du retard pris en matière d’investissement industriel ces dernières années.
Le commerce extérieur reste un maillon faible
Le commerce extérieur a pesé négativement sur la croissance du 3ème trimestre avec des importations en forte hausse, +2,2 % après -1,7 %) et des exportations qui ne progressent que de +0,6 % après +0,2 %. Au total, le solde extérieur contribue négativement à la croissance du PIB à hauteur de -0,5 point, après +0,6 point.
Les variations de stock ont sauvé la croissance
Avec un gain de 0,6 % faisant suite à une contraction de 0,8 %, les variations de stocks ont empêché la France de tomber en récession. Après une forte baisse, il est assez logique que les entreprises reconstituent leurs stocks surtout dans la perspective de la rentrée et de la fin d’année. Cette progression des stocks témoignent également que la confiance des chefs d’entreprise dans l’avenir n’est pas entamée
Une croissance entre deux eaux
L’économie française devrait continuer à croître à un rythme de sénateur dans les prochains mois. Au regard des indicateurs dernièrement publiés (confiance des consommateurs et climat des affaires), il n’y pas de véritable rupture dans la croissance mais pas non plus d’embellie à attendre. Le taux de croissance du dernier trimestre devrait se situer entre 0,2 et 0,3 % permettant d’atteindre 1,2 à 1,3 % sur l’année. Le léger redressement des prix du pétrole devrait un peu peser sur la consommation qui pourrait néanmoins profiter de l’amélioration du marché de l’emploi.
Contact presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
Les Echos – Assurance-vie : la collecte stagne en septembre
L’assurance vie fait du surplace en septembre. Une première depuis 32 mois! Retrouvez l’analyse et les explications de Philippe Crevel sur ce coup d’arrêt dans cet article publié ce jour dans le journal Les Echos.
Résultats de l’assurance-vie au mois de septembre 2016 : L’assurance-vie au point mort
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats de l’assurance-vie au mois de septembre 2016
L’assurance-vie au point mort
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Après 32 mois de collecte positive, cette dernière a été nulle au mois de septembre (la dernière décollecte est intervenue au mois de décembre 2013). Cette baisse s’inscrit dans la décélération des collectes nette de ces derniers mois (à l’exception de celle du mois de juillet 2016, +3,5 milliards d’euros).
Le montant des cotisations a été, en septembre, en léger retrait à 9,6 milliards d’euros par rapport à la tendance de ces derniers mois (11 milliards d’euros par mois en moyenne sur les 9 premiers mois de 2016 et 10,4 milliards d’euros en septembre 2015). En revanche, les rachats sont en hausse à 9,6 milliards d’euros et sont légèrement au-dessus de la moyenne (9,4 milliards d’euros sur les 9 premiers mois).
Les épargnants ne renforcent pas le poids des unités de compte au sein de leurs contrats qui représentent toujours 19 % du total des cotisations (pour le mois de septembre comme pour les 9 premiers mois de l’année).
Septembre n’est pas un mauvais mois pour l’assurance-vie. En 2012 et en 2013, la collecte avait été négative mais ces décollectes sont intervenues en pleine crise des dettes souveraines. L’introduction dans la loi Sapin 2 de dispositions permettant aux pouvoirs publics de bloquer les contrats d’assurance-vie en cas de crise exceptionnelle et la polémique qui en a résulté, ont pesé sur les résultats. Il en a résulté des cotisations un peu plus faibles et des rachats un peu plus importants. Malgré tout, il n’y a pas eu de retraits massifs. La possibilité de geler des contrats même si cela répond à un objectif de sécurisation du placement a été perçue par certains épargnants comme une remise en cause de leurs contrats. Les mesures prises par le Gouvernement ne sont qu’une déclinaison de ce qui existe déjà au niveau bancaire. Elles constituent également une arme de dissuasion massive en cas de crise grave. Elles complètent l’arsenal de l’autorité de régulation qui a actuellement la possibilité de bloquer les contrats compagnie par compagnie.
La question du rendement des fonds euros devrait par ailleurs continuer d’être au cœur de l’actualité d’autant plus que le Gouverneur de la Banque de France qui préside également l’autorité de régulation a, à plusieurs reprises, demandé à ce que les compagnies d’assurance les diminuent. De ce fait, les épargnants seront de plus en plus incités à investir sur les unités de compte. Il conviendra alors de regarder si leur appétence en la matière s’accroisse.
Contact presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
Protection sociale : Quelles sont les attentes des indépendants ?
Avec la montée en puissance du nombre de travailleurs non-salariés au cours des dernières décennies, liée au passage de la civilisation de l’usine à celle du savoir qui a été accompagnée depuis 2009 par le statut de l’auto-entrepreneur, la DREES s’est intéressée au système de protection sociale des indépendants. A travers son baromètre d’opinion, la direction de recherche du ministère des affaires sociales et de la santé, a souhaité connaître et comprendre la perception des travailleurs indépendants sur leur système de protection sociale et en quoi ils pouvaient, le cas échéant, se distinguer des travailleurs salariés.
Constatant de nombreuses convergences entre les catégories de professionnels, l’étude met en avant une crainte partagée face au chômage et le risque de tomber en situation de pauvreté. Ainsi, 82 % des indépendants seraient préoccupés par le chômage et 90 % inquiets du niveau de la pauvreté en France. Du côté des salariés les inquiétudes sont respectivement de 89 % face au chômage et 90 %au titre de la pauvreté.
Plus nombreux à considérer que notre système de protection sociale est surdimensionné, les indépendants considèrent à 31 % (contre 20 % parmi les salariés) que les ressources déployées sont trop importantes. Ils jugent par ailleurs à 37 % que le dégré d’intervention de notre modèle social est excessif quand ils ne sont que 25 % à le penser parmi les salariés. De fait, les travailleurs non-salariés sont deux fois moins nombreux que les salariés à souhaiter une hausse des cotisations sociales payées par les entreprises.
Toutefois, il convient de rappeler que nonobstents ces écarts entre les deux catégories de travailleurs, ces opinions restent minoritaires et que travailleurs non salariés et travailleurs salariés se rejoignent en réfutant une diminution des prestations en échange d’une baisse des impôts. Par ailleurs, indépendants (56%) et salariés privilégient un système universaliste, ouvert à tous sans distinction à un système réservé aux seuls cotisants, tant pour le risque maladie que retraite.
De fait, s’ils estiment qu’il faut maintenir l’intervention publique en faveur des plus démunis, les indépendant sont plus nombreux à juger nécessaire l’encadrement des dépenses de santé (8 sur dix estiment ainsi que notre modèle souffre d’une mauvaise gestion).
Ils se retrouvent enfin sur l’âge estimé de départ à la retraite qui devrait se situer autour de 65 ans, les indépendant restant légèrement au dessus en fixant cet âge à 65,6 ans. La DREES note sur ce point un rapprochement des points de vue qui tiendrait à l’entrée en vigueur successive des différentes réformes des retraites. Elle met par ailleurs en évidence une plus grande divergence dans ce domaine en fonction de l’âge des interviewés. Ainsi les âges de départ anticipés par les salariés du privé diminuent avec l’âge quand celui des indépendants est moins sensible à cette variable.
L’ÉPARGNE COLLECTIVE, UN OVNI ?
L’ÉPARGNE COLLECTIVE, UN OVNI ?
Dans le sens le plus strict du terme, l’épargne collective comprend tous les dispositifs d’épargne proposés au sein des entreprises. Sont donc rassemblés sous cette bannière l’épargne salariale et les contrats de retraite supplémentaires souscrits par les entreprises. Il pourrait y être ajouté le Compte Épargne Temps voire les Indemnités de Fin de Carrière.
En retenant le caractère professionnel, les Contrats Madelin souscrits par les travailleurs non-salariés auprès d’associations peuvent être intégrés à l’épargne collective.
Le Fonds de Réserve des Retraites géré par la Caisse des Dépôts et Consignations peut également être considéré comme un fonds collectif. Il est alimenté par des prélèvements payés par les Français et il sert depuis 2011 à rembourser la dette sociale.
De manière un peu plus extensive, pourraient être ajoutés les PERP qui sont, certes, des produits d’épargne individuelle mais qui sont souscrits dans le cadre de contrats de groupe via des associations dédiées.
Enfin, dans une définition beaucoup plus large, les Organismes de Placement Collectif pourraient être intégrés. L’argent collecté auprès des épargnants est géré collectivement à travers des fonds qui permettent d’accéder à un très grand nombre de supports et une gestion active. Si les Français sont de moins en moins des actionnaires en direct, ils le sont, de plus en plus, de manière indirecte. La capitalisation des SICAV et des FCP atteint 3 600 milliards d’euros. Les épargnants détiennent des OPC dans le cadre de leurs comptes titres mais cela est de plus en plus rare ; ils sont avant tout logés au sein des PEA et des contrats d’assurance-vie multi-supports (unités de compte).
Au sommaire de l’étude
- L’épargne collective, des encours relativement faibles
- Une forme de paritarisme méconnue
- Petit détour en allemagne avec le concept de mitbestimmung
- L’épargne salariale ou plutôt « les épargnes salariales »
- L’épargne salariale un privilège des salariés des grandes entreprises
- L’épargne salariale est-elle juste ?
- Les actions gratuites, de l’enfer au purgatoire
DES ÉPARGNANTS QUI ÉPARGNENT, C’EST BIEN ÇA LE PROBLÈME !
DES ÉPARGNANTS QUI ÉPARGNENT, C’EST BIEN ÇA LE PROBLÈME !
Des épargnants qui épargnent, c’est bien là le problème. Les faibles taux d’intérêt que nous connaissons depuis plus de 2 ans trouvent leur origine dans les politiques monétaires accommodantes, dans la faible inflation, dans la baisse des gains de productivité mais aussi, et surtout, dans le vieillissement de la population qui pèse sur l’investissement et accroît l’épargne.
Sommaire de l’étude
- Une affaire de banques centrales
- Des forces structurelles pèsent sur les taux
- Perplexité sur la fixation des taux
Le Livret A sauve les meubles en septembre
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Livret A – Résultats du mois de septembre 2016
Le Livret A sauve les meubles en septembre
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le mois de septembre n’est traditionnellement pas très porteur pour le Livret A. Les dépenses de rentrées et le dernier tiers provisionnel de l’impôt sur le revenu pèsent sur le budget des ménages d’autant plus que les rentrées exceptionnelles se font rares durant ce mois de reprise d’activité (pas de primes).
L’année 2016 n’échappe pas à la règle. Certes, le Livret A demeure pour le septième mois consécutif en collecte nette positive mais de peu. En effet, elle ne s’élève qu’à 140 millions d’euros contre 1,14 milliard d’euros au mois d’août dernier. Certes, cela est nettement supérieur à la décollecte record de 2,38 milliards d’euros du mois de septembre 2015. Mais, l’année dernière, cette décollecte s’expliquait par la baisse à 0,75 % du rendement du Livret A.
En prenant en compte le Livret A et le Livret de Développement Durable, une décollecte de 410 millions d’euros est enregistrée (la décollecte atteint 550 millions d’euros pour le LDD). Le décalage entre ces deux produits s’explique par le fait que le LDD est plus souvent lié aux comptes courants des ménages que le Livret A. Les ménages en fonction de leur solde de compte courant effectuent des arbitrages avec le LDD quand le Livret A est utilisé avant tout comme un produit d’épargne. Cette différence de comportement résulte, par ailleurs, de la distribution du LDD, dès sa création, par les banques quand elles ont dû attendre le 1er janvier 2009 pour le Livret A.
Dans un climat économique incertain, les Français devraient maintenir leur effort d’épargne de précaution dans les prochains mois. Néanmoins, du fait de la disparition des gains de pouvoir d’achat générés par la baisse des prix de l’énergie, la collecte nette devrait être faible en octobre comme en novembre. Durant ces deux mois, les ménages doivent acquitter les impôts locaux.
Contact presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
Le marché de l’immobilier profite des taux bas
L’INSEE enregistre une progression de 0,6 % des prix des logements au deuxième trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent. Une croissance qui profite davantage aux logements neufs qui enregistrent – sur l’intervalle – une hausse de 0,9 % quand le marché de l’ancien affiche une augmentation de 0,5 %. La comparaison des résultats du deuxième trimestre 2016 au regard du même trimestre un an plus temps met en évidence une hausse de 0,8 % au global avec, dans le détail +1 % dans le neuf et +0,7 % dans l’ancien.
La chute, mois après mois, des taux des prêts immobiliers dont le niveau moyen à 20 ans est passé – à titre indicatif – de 2,10 % à la fin mars à 1,8 % à la fin juin, y contribue certainement.
Par ailleurs, l’institut statistique a révisé à la baisse (0,4 % contre 0,6 % initalement) ses estimations publiées à la mi-juillet au titre du premier trimestre.
Le taux d’épargne des ménages de la zone euro à son plus haut niveau depuis 2011
A 12,8 % le taux d’épargne désaisonnalisé des ménages européens situés en zone euro enregistre une progression de 0,2 % par rapport au trimestre précédent. Il est à son plus haut niveau depuis la fin 2011 ou il atteignait 13 %.
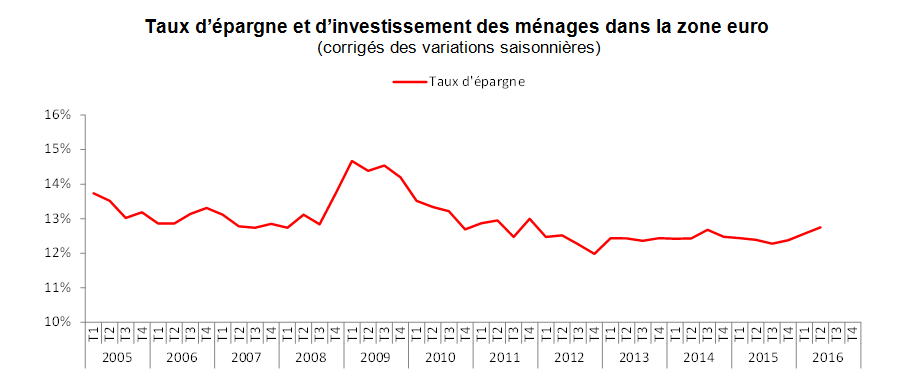
Dans le même temps, le taux d’investissement des ménages s 8,6 % au deuxième trimestre 2016 dans la zone euro, contre 8,4% au trimestre précédent.
Séniors actifs et retraités face à l’épargne et la retraite
SÉNIORS ACTIFS ET RETRAITÉS
FACE À L’ÉPARGNE ET LA RETRAITE
La France, comme de nombreux pays avancés, est confrontée au défi démographique et au vieillissement de sa population. Au 1er janvier 2016, sur les 66,6 millions d’habitants que compte la France, près d’un sur quatre est âgé de 60 ans ou plus. Fruit du baby-boom et de l’allongement de l’espérance de vie, notre population compte aujourd’hui plus de personnes de 60 ans et plus que de jeunes de moins de 25 ans.
Sur le plan économique, les séniors – dont les habitudes de consommation se rapprochent de celles des autres ménages – disposent par ailleurs d’un niveau de vie supérieur à celui de la moyenne nationale.
De ce fait, le Cercle de l’Épargne a étudié dans ce dossier le comportement des séniors en matière d’épargne et de retraite, à partir d’une analyse ciblée des résultats de l’enquête 2016, « les Français, l’épargne et la retraite ».
Sommaire de l’étude
Les séniors face à l’épargne
- Le sénior porté sur le risque
- La transmission au cœur des préoccupations des séniors
- L’assurance-vie, le produit phare des séniors
- Pour la rentabilité, les séniors misent sur l’immobilier et l’assurance-vie
- Les retraités sont multi-supports
Les séniors face à la retraite
- La pérennité du système de retraite : une inquiétude manifeste sur le devenir des retraites complémentaires
- Les solutions pour assurer la pérennité du régime de retraite
- Travailler plus longtemps pour gagner plus à la retraite, les séniors n’y croient pas !
- 51 % des retraités mécontents de leur retraite
- Épargner pour sa retraite une évidence pour les 50 – 64 ans
- L’épargne retraite pour quoi faire ?
- Pour préparer leur retraite, les séniors misent sur leur logement et l’épargne longue
Le vieux continent et ses séniors
À l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, Eurostat s’est intéressé aux 27 millions de séniors de plus de 80 ans qui vivent dans les États membres de l’Union Européenne.
Avec 7 millions d’Européens de 80 ans et plus qu’il y a 10 ans, le vieux continent vieillit ! Ce phénomène, généralisé selon Eurostat, est particulièrement marqué dans les États du sud de l’Europe où la part des 80 ans et plus atteint même les records de 6,5 % de la population totale en Italie et 6,3 % en Grèce. L’Espagne, la France et le Portugal suivent de près avec une proportion qui atteint respectivement 5,9 et 5,8 et 5,7 % de la population totale. Inversement, les personnes âgées de 80 ans et plus sont – en proportion de la population totale – moins nombreuses en Irlande et en Slovaquie où ils ne comptent que 3,1 % du total.
À l’exception de la Suède, la part des personnes âgées de 80 ans a augmenté dans tous les États membres avec les plus fortes progressions enregistrées en Grèce (de 3,9 % en 2005 à 6,3 % en 2015, soit +2,4 pp) et dans les pays de l’Europe de l’Est (+2,1 pp en Lituanie ; +1,9 pp en Estonie et en Lettonie).
Cette progression du poids des 80 ans et est le fruit de l’augmentation de l’espérance de vie à 80 ans qui est passée de 8,4 ans en 2004 à 9,5 ans en 2014. Sans surprise, la France dont l’espérance de vie est l’une des plus élevées au monde, est le pays membre où les personnes âgées de 80 ans en 2014 pouvaient espérer vivre le plus longtemps (11 ans). Après la France, c’est au Luxembourg et en Italie que cette population peut espérer profiter le plus longtemps de ses vieux jours (10,1 ans pour le premier et 10 ans pour la seconde). À l’inverse, l’espérance de vie la plus faible à l’âge de 80 ans a été enregistrée en Bulgarie (7,0 ans), en Roumanie (7,6 ans), en Croatie (7,7 ans), en Hongrie et en Slovaquie (7,9 ans chacune).
Ce n’est pas nouveau, les hommes et les femmes sont inégaux en matière d’espérance de vie. De fait, parmi les octogénaires et leurs aînés, les femmes sont surreprésentées. Ainsi, plus d’une personne de 80 ans et plus est une femme dans les États baltes avec respectivement, 73,4 % en Lituanie, 75,2 % en Estonie et même 75, 9 % en Lettonie. En raison d’un rapprochement des modes de vie et des habitudes entre les deux sexes, Eurostat note toutefois que le poids des femmes dans cette classe d’âge tend à diminuer. Les diminutions les plus notables au cours de ces 10 dernières années ont été constatées au Luxembourg (de 71,6 % en 2005 à 64,2 % en 2015, soit -7,4 points de pourcentage – pp), en Allemagne (-7,2 pp), en Autriche (-6,2 pp), en Finlande (-5,3 pp), au Royaume-Uni (-4,5 pp) et aux Pays-Bas (-4,4 pp).
Les Echos – Les 7 questions essentielles pour votre épargne
Dans un contexte de taux bas, très bas voire négatifs, que faire de son épargne ?

Être mère à 40 ans n’est pas nouveau !
L’INSEE a publié ses statistiques sur les naissances de 2015 avec un focus sur celles dont la mère a plus de 40 ans. Contrairement à quelques idées reçues, ce phénomène n’est pas en soi révolutionnaire. Au début du XXe siècle, il y a plus de mères de plus de 40 ans qui accouchaient qu’en 2015. Les facteurs qui sous-tendent ces naissances après 40 ans ont évidemment profondément évolué. Elles sont aujourd’hui très majoritairement voulues. L’arrivée du premier enfant intervenant plus tard, autour de 30 ans, cela décale l’ensemble des naissances. Par ailleurs, l’amélioration du suivi médical favorise également le développement de naissances considérées autrefois comme tardives. Elles sont également la traduction de la forte progression de l’activité féminine. Il est de plus en plus difficile de concilier à 30 ans la gestion de plusieurs enfants et une vie professionnelle.
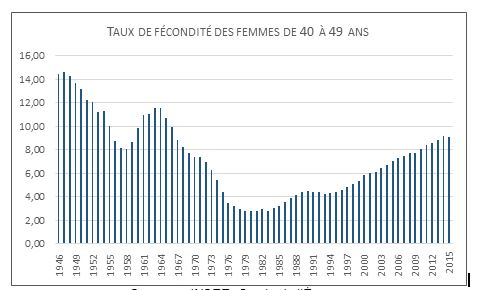
Sources : INSEE, Cercle de l’Épargne
En 1901, 6,5 % des bébés de l’année ont une mère de 40 ans ou plus. Du fait de la contraception et du travail féminin ainsi que de la diffusion de consignes émanant du corps médical, la part des naissances du fait de mères de plus 40 ans a fortement décru des années 40 jusqu’aux années 80. Il convient de souligner que la baisse avait commencé avant 1940. En 1981, seulement 1,1 % des nouveau-nés ont une mère de 40 ans ou plus. Avec la hausse qui suit, la part des naissances du fait de mères de 40 ans ou plus retrouve en 2015 son niveau de 1948 soit 5,1 %.
Cette montée en puissance des mères de 40 ans à partir des années 80 est également liée au fait que ce sont des générations importantes issues du baby-boom qui atteignent cet âge. Ce phénomène devrait se ralentir dans les prochaines années du fait que ce sont des générations moins importantes qui abordent la quarantaine.
En 2014, 26,4 % des naissances du fait de mères de 40 ans ou plus sont des premières naissances, 29,3 % des deuxièmes naissances et 44,3 % des troisièmes naissances ou plus.
La proportion de premières naissances parmi les naissances tardives reste minoritaire, même si elle n’a cessé de progresser depuis une cinquantaine d’années. Elle était de 12 % en 1967, 17 % en 1981, puis 24 % en 2007.
Ces chiffres traduisent bien l’étalement au-delà de 30 ans des naissances du fait des femmes issues du baby-boom.
La progression constatée ces trente dernières années, par le jeu des générations, est amenée à se tasser.
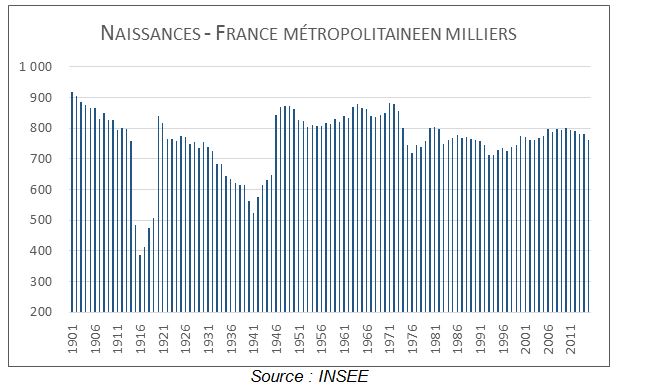
Sputnicknews – Quoi de neuf pour le régime des retraites des fonctionnaires français?
Dans cet interview publié par Sputnicknews, Philippe Crevel revient sur le rapport rendu par la Cour des Comptes dans lequel les sages de la rue Cambon dénoncent le poids du régime des retraites des fonctionnaires sur les finances publiques françaises.
Taux de remplacement et croissance font-ils bon ménage ?
Selon Yannick Moreau, Présidente du Comité de Suivi des Retraites, le taux de remplacement net (qui diffère de celui de l’OCDE cité au-dessus qui est calculé par rapport au salaire brut) devrait baisser d’autant plus rapidement que la croissance serait importante. En effet, à législation constante, compte tenu des règles d’indexation, plus la croissance est élevée, plus les salaires progressent. Étant donné les salaires de référence servant de calcul pour les pensions ainsi que les règles de revalorisation des points des régimes complémentaires, l’écart entre revenus d’activité et pensions de retraite augmente si la croissance s’accélère.
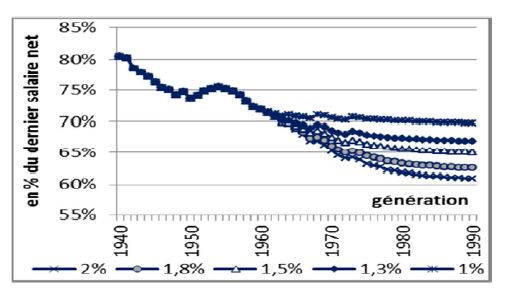
Source COR
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


