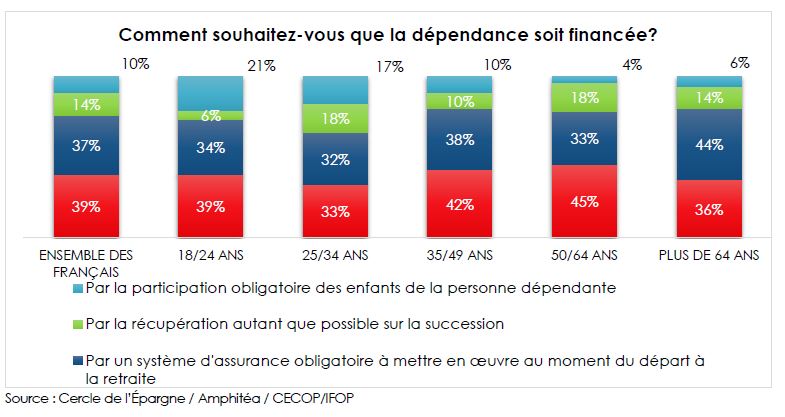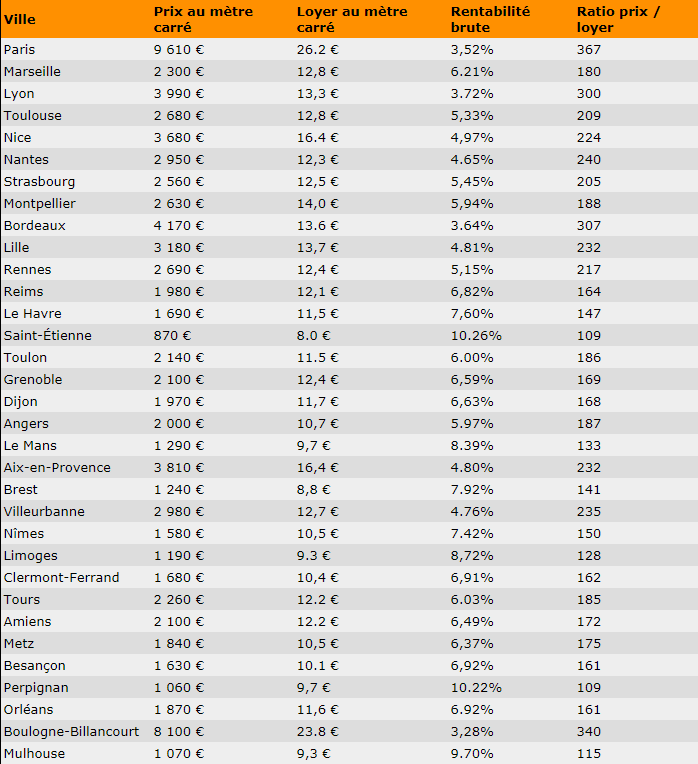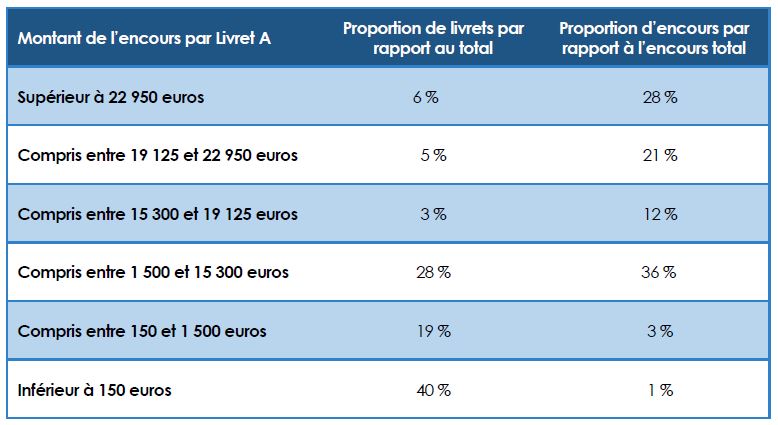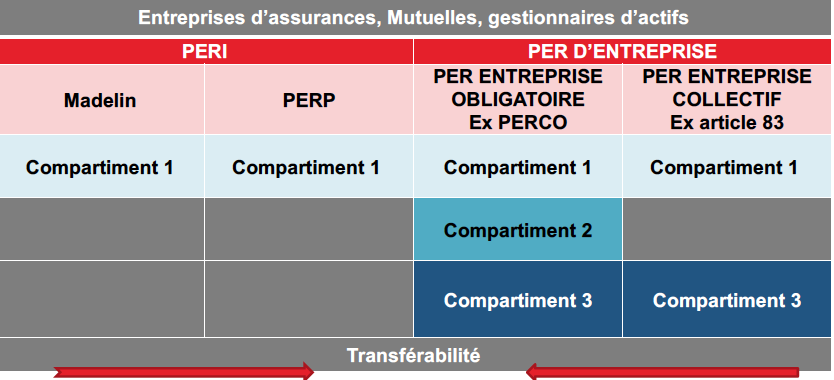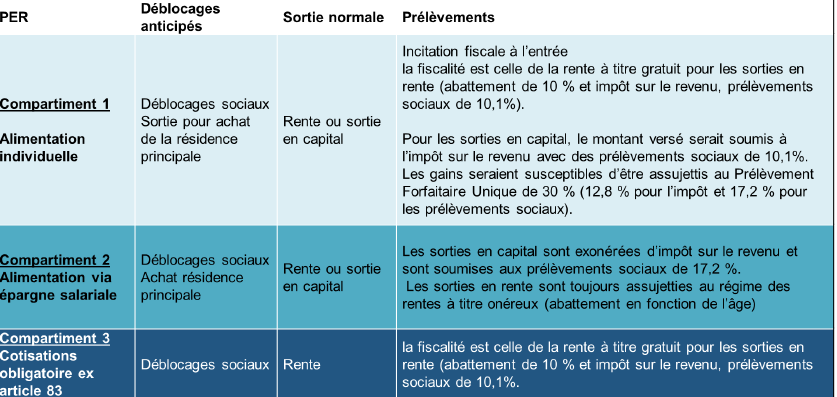Les épargnants aiment le liquide et le garanti !
Selon la Banque de France, les placements financiers des ménages au premier trimestre 2019 s’élevaient à 5153,8 milliards d’euros. Cette augmentation est imputable à la hausse du cours des actions et aux flux d’épargne. En rythme annuel, leur flux d’épargne a atteint 135,4 au premier trimestre 2019 contre 113,7 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Les produits de taux sont les grands gagnants. Leur encours s’élève à 3 322 milliards d’euros au p trimestre 2019. Les flux correspondants se sont élevés à 35,0 milliards d’euros au premier trimestre 2019 contre 32 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Le numéraire et les dépôts à vue poursuivent leur hausse avec un flux de janvier à mars 2019 de 20,3 milliards contre 9,1 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Pour le deuxième trimestre 2019, la hausse serait plus faible, 8,5 milliards d’euros. L’encours du numéraire et des dépôts à vue atteint un nouveau sommet à 576,2 milliards d’euros. La préférence pour la liquidité demeure forte dans un contexte d’incertitudes économiques et sociales. Avec la crise des « gilets jaunes », de nombreux ménages ont reporté des achats en particulier durables, ce qui a conduit à augmenter la poche d’épargne de précaution.
L’épargne réglementée (Livret A, LDDS, PEL, etc.) continue à enregistrer des flux importants. Ainsi au deuxième trimestre 2019, ils ont atteint 11 milliards d’euros contre 11,9 milliards au premier et 7,5 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. L’encours de l’épargne réglementée s’élevait au deuxième trimestre 2019 à 759,2 milliards d’euros. Les ménages continuent à placer leur argent sur ces produits malgré leur faible taux de rendement. Au regard de la situation du marché monétaire, il faut néanmoins relativiser la faiblesse de ces rendements. En effet, sans leur fixation réglementée, ils devraient être nuls voire négatifs. En effet, le taux des obligations d’État deuxième à 10 ans était, mi-août, inférieur à 0,4 %.
L’assurance vie en euros maintient le cap. Ainsi, les flux ont été de 11,3 milliards d’euros au deuxième trimestre 2019 contre 10,1 milliards d’euros au cours du premier. L’encours des fonds euros au premier trimestre 2019 était de 1 625 milliards d’euros. La garantie en capital constitue toujours le premier atout des fonds euros.
Les ménages se sont désengagés au premier trimestre du marché actions. Le flux a été négatif d’un milliard d’euros. Cette décollecte s’explique par les mauvais résultats des cours boursiers à la fin de l’année 2018. En revanche, en raison de l’appréciation des cours au premier trimestre 2019, l’encours est en hausse pour les actions cotées à 253 milliards d’euros contre 245,9 milliards d’euros au quatrième trimestre 2018. Les flux des actions détenues indirectement via les Organismes de Placement Collectif (OPC) sont également négatifs et cela tant au quatrième trimestre 2018 qu’au premier trimestre 2019. Les unités de compte des contrats d’assurance vie ont enregistré une collecte trimestrielle d’un milliard d’euros tant au premier qu’au deuxième trimestre 2019. L’encours est de 362,8 milliards d’euros au 1e trimestre 2019.
Les ménages français restent très averses aux risques en limitant autant que possible leur exposition aux produits ne bénéficiant pas de garantie en capital. Les produits de taux représentent 64 % de l’ensemble des placements financiers. En outre, figurent parmi ces produits, les parts sociales des entrepreneurs indépendants sous forme d’actions non cotées (1 036 milliards d’euros). Les actions cotées, les unités de compte (qui ne sont pas tous investies en actions) et les actions contenues dans les OPC représentent un total de 705,3 milliards d’euros, soit moins de 14 %.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
Loi Pacte: le nouveau PER peut-il vraiment booster votre épargne retraite?
Le PER est-il l’avenir de l’épargne retraite ? Dans cet article consacré au nouveau dispositif introduit dans le PACTE, Philippe Crevel évoque les avancées notamment en terme de portabilité des produits d’épargne retraite d’entreprise. https://www.challenges.fr/patrimoine/retraite/loi-pacte-le-nouveau-per-peut-il-vraiment-booster-votre-epargne-retraite_668783
« 385 milliards d’euros dorment sur les comptes courants des ménages »: les connaissances limitées des Français en finance
Philippe Crevel était interrogé sur RMC sur les milliards d’euros que les Français préfèrent laisser dormir sur leur comptes courants ou placer dans produits au rendement réel négatif par précaution.
Dépendance, sortir des sentiers battus
Le rapport de Dominique Libault semble récuser l’assurance comme solution pour financer la dépendance. Pour autant, la dépendance répond parfaitement à la logique assurantielle ; c’est un risque car tous les seniors n’ont pas vocation à devenir dépendants. Il est modélisable sous réserve d’avoir accès aux données de santé publique. Les pouvoirs publics opposent bizarrement solidarité et assurance. Pour autant, depuis 1945, les assurances sociales se sont révélées être des instruments très puissants de solidarité. L’assurance, c’est une technique de couverture des risques reposant sur la mutualisation. C’est par définition un système redistributif. Elle permet de réduire le coût supporté par chacun des assurés du fait qu’ils ne sont pas tous dépendants au même moment. L’assurance n’interdit pas une prise en charge par l’État de tout ou partie des cotisations pour les assurés les plus modestes. Ce refus est d’autant plus préjudiciable qu’aucune autre solution n’est avancée. Le recours à la CRDS et à la CADES une fois l’épuration de la dette sociale réalisée est fort sympathique, mais nul ne sait quand celle-ci interviendra. Initialement prévu pour 2024, du fait de la persistance des déficits, le Ministre des Comptes publics a indiqué que le remboursement pourrait être différé d’une à plusieurs années.
Avant d’être problème financier, la dépendance pose la question de l’accès aux services et aux soins du quotidien. Les soins lourds de santé sont pris en charge par l’assurance maladie, en revanche, les soins de la vie quotidienne, les problèmes d’hébergement ou d’adaptation des logements sont complexes et coûteux. Les familles, face à la dépendance d’un proche, se divisent fréquemment. Or, d’ici le milieu du siècle, le nombre de personnes dépendantes, en France, sera amené à doubler. Chaque année, plus de 225 000 nouveaux cas de dépendance sont comptabilisés.
La question de la dépendance constitue le défi social des trente prochaines années. Avec l’arrivée, d’ici une dizaine d’années, aux grands âges des générations du baby-boom, les pays européens devront faire face à une augmentation sensible des dépenses de santé et de soins, des dépenses d’hébergement ainsi que des dépenses relatives aux services de proximité. Ainsi, au sein de l’Union européenne, les dépenses publiques liées à la dépendance devraient passer de 1,6 % du PIB en 2013 à 2,8 % en 2060 (Commission européenne, 2015).
Selon différentes études, notamment celles réalisées à partir des données européennes (enquête SHARE de l’INSEE), la probabilité de perte d’autonomie varie entre 29 % et 58 % pour les hommes et entre 51 % et 79 % pour les femmes. La durée de la dépendance oscille entre 2,2 et 3,7 ans pour les hommes et entre 3,7 et 4,7 ans pour les femmes. Ces écarts s’expliquent en partie par l’adoption de critères différents pour définir ce qu’est la perte d’autonomie.
La qualité de vie des personnes dépendantes à domicile est un sujet clef. La présence ou non de professionnels de santé, de moyens de transport et de services de proximité, joue un rôle majeur dans le maintien à domicile. En effet, 86 % des personnes âgées de plus de 80 ans vivent chez elles. Dans 40 % des cas, ce sont des femmes seules. Il faut souligner que seulement 20 % des personnes de plus de 80 ans vivent dans un logement avec un ascenseur. 35 % de cette catégorie de population n’ont pas accès dans leur agglomération à un cabinet ophtalmologique ou à un cabinet de cardiologie. Si en moyenne 31 % des plus de 60 ans sont à 30 minutes en voiture d’un établissement de santé, ce taux atteint plus de 50 % dans 18 départements dont ceux de l’Ariège, des Alpes-de-Haute-Provence ou du Cantal.
L’Allemagne qui dans les années 90 avait privilégié le maintien à domicile se heurte aujourd’hui à la problématique du personnel et des coûts. Si dans un premier temps, cette option est une source d’économies, mais par l’absence de gains d’échelle, elle apparaît vite comme budgétivore obligeant à une réorientation de la politique à travers la construction d’établissements spécialisés.
Le système de protection sociale est confronté au défi de la massification. L’arrivée en masse des générations du baby-boom à l’âge de la retraite et ensuite à l’âge de la dépendance se double de l’allongement de l’espérance de vie. Ces contraintes s’imposent à nous et changent la nature de notre système. Construit sur la base d’une large population active et d’une faible population retraitée, il doit faire face une inversion des fondations. La profession médicale doit opérer une véritable révolution. Formés à soigner, les praticiens sont amenés à accompagner des personnes dépendantes en fin de vie. La massification du système de soins peut déboucher de manière insidieuse et implicite à une sélection des patients selon des critères arbitraires, l’âge, l’état de santé, la fortune…
La prise en charge de la perte d’autonomie constitue un enjeu de taille tant financier que moral. Pour les personnes et les familles concernées, la perte d’autonomie provoque un surcroît de dépenses brutal qui peut être difficilement financé en s’appuyant exclusivement sur les pensions de retraite. Le coût des dépenses associées à la perte d’autonomie est en effet généralement supérieur au montant de la retraite moyenne. La situation ne devrait pas s’améliorer dans les prochaines années en raison d’une baisse de taux de remplacement des régimes de retraite obligatoire. La baisse pourrait atteindre, selon la Commission de Bruxelles, 12 points de pourcentage entre 2013 et 2060.
Face à cette augmentation des coûts, les pouvoirs publics privilégient la solution du maintien le plus longtemps possible au domicile. Cette option qui s’appuie sur la volonté supposée des intéressés, répond avant tout à une approche budgétaire de court terme. Grâce à l’appui des aidants familiaux, en allégeant le coût de l’hébergement, les pouvoirs publics réduisent à première vue les coûts supportés par la collectivité. Ce choix de l’hébergement à domicile s’impose évidemment pour les cas les plus légers de dépendance. Il est, en revanche, inopérant pour les cas plus complexes, surtout quand il s’agit de personnes seules et vivant en milieu rural ainsi que dans des communes de banlieues mal desservies. Les scénarii de l’administration occultent consciemment le fait que dans les prochaines années le nombre des aidants familiaux sera amené à diminuer en raison même du vieillissement de la population et de l’éclatement des structures familiales. Actuellement, plus de 4 millions de personnes aident une personne dépendante de manière régulière. En y ajoutant l’aide occasionnelle, ce nombre atteint 8,3 millions. Selon certaines sources, ce chiffre atteindrait 11 millions (baromètre Fondation April). Plus de la moitié des personnes dépendantes à domicile sont aidées à titre principal par leur conjoint ou par un proche. Pour le laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé de l’Université de Paris Dauphine, les aidants familiaux permettent une économie de plus de 11 milliards d’euros. Avec la montée en puissance de la dépendance, d’ici 2030, plus d’un cinquième de la population serait amené à s’occuper d’une personne dépendante. Étant rappelé que les aidants familiaux sont eux-mêmes des personnes âgées.
La dépendance est consommatrice de soins au quotidien. Pour y faire face, encore faut-il disposer d’un personnel suffisant et bien formé techniquement et moralement. Or, depuis plus de trente ans, afin de maîtriser les dépenses, il a été décidé de limiter les effectifs d’étudiants pour les professions médicales. La pénurie constatée aujourd’hui ne pourra que s’amplifier dans les prochaines années. En 2019, les personnes dépendantes éprouvent déjà des difficultés à être soignées en début et en fin de journée. En outre, bien souvent, la fréquence des passages est insuffisante pour garantir un niveau de soins compatible avec l’état de santé des patients.
Comme tous les autres Français, les professionnels de santé ont des contraintes familiales qui limitent leurs disponibilités à des moments clefs de la journée (entrées et sorties des enfants à l’école par exemple). Les professionnels de santé aspirent à un rythme de vie équilibré mais qui aboutit à réduire l’offre de soins. Ils sont de plus en plus nombreux à opter pour le statut de salarié, voire à choisir la médecine du travail, jugés moins chronophages que l’exercice en libéral ou en établissement de santé. La complexité et le coût croissant des déplacements en milieu urbain ou en milieu rural limitent également l’offre de soins. Il n’est pas rare que des infirmiers ou des kinésithérapeutes refusent de prodiguer des soins du fait de l’éloignement du domicile de la personne dépendante de leur lieu traditionnel d’exercice. Dans des banlieues difficiles, certains mettent également en avant le problème de la sécurité. En outre, à la différence du handicap par exemple, la gérontologie souffre d’un déficit d’image et d’attractivité que l’on retrouve dans le cursus de formation des médecins et, plus largement, dans les filières de formation médico-sociales.
Or, l’accès difficile des soins peut avoir des conséquences importantes pour les personnes âgées. Le traitement de la douleur peut être négligé tout comme le respect des simples règles d’hygiène.
De nombreux pays européens ont mis en place des prestations relatives à la perte d’autonomie mais elles ne permettent pas de couvrir l’ensemble des besoins et le reste à charge pour certaines familles peut être par conséquent très élevé.
Le recours à des systèmes d’assurance privée reste trop partiel pour donner des résultats tangibles. Aux États-Unis, seules 7 % des dépenses de perte d’autonomie sont financées par le biais de l’assurance dépendance privée, un chiffre qui tombe à 2 % dans les autres pays de l’OCDE. Malgré tout, une partie de la population est susceptible de souscrire un tel contrat. Selon l’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa, 37 % des sondés estiment que le financement de la dépendance passe par le développement d’un dispositif assurantiel obligatoire. Cette formule arrive en tête chez les 50/64 ans (45 % des sondés).
La faible couverture assurantielle est liée au fait que s’assurent essentiellement les personnes qui estiment avoir un fort risque d’être dépendantes. Une partie des populations de l’OCDE considèrent que leur patrimoine leur permettra de faire face aux dépenses liées à la dépendance. Une autre partie estime que c’est à l’État ou plus globalement aux collectivités publiques qu’il revient de financer ce risque.
Les retraités concentrent une grande part du patrimoine des ménages. Ils sont, en règle générale, propriétaires de leur résidence principale, 77 % en France. Le règlement de la question de la dépendance passe par la mobilisation de ce patrimoine. Cependant, la vente de la résidence principale ou l’organisation de viagers ne sont pas évidentes à réaliser. La perte de l’autonomie peut être rapide et nécessiter de disposer rapidement de liquidités ; or, la vente d’un logement exige plusieurs mois. En milieu rural, dans des villes connaissant des problèmes économiques ou en déclin démographique, il peut s’avérer difficile de trouver des acquéreurs. En outre, les héritiers peuvent mal vivre le fait de vendre les biens de leurs aïeux.
La solution des prêts viagers hypothécaires
Dans les pays anglo-saxons, le recours aux prêts viagers hypothécaires est utilisé notamment dans le cadre du financement de la retraite ou de la dépendance. Cette formule existe également en France depuis 2007 mais reste assez confidentielle.
Les prêts viagers hypothécaires (appelés « lifetime mortgage » au Royaume-Uni ou « Home Equity Conversion Mortgage » aux États-Unis sont des opérations de crédit permettant d’obtenir des liquidités grâce à son patrimoine immobilier. Contrairement aux ventes en viager telles qu’elles sont pratiquées en France, ce dispositif n’implique aucun transfert de propriété. Les propriétaires occupants empruntent avec hypothèque sur tout ou partie de la valeur de leur logement. La principale différence avec une hypothèque classique réside dans le fait que l’emprunteur n’a besoin d’effectuer aucun remboursement tant qu’il occupe le bien. Les intérêts viennent donc s’ajouter au solde de l’emprunt. Le prêt viager hypothécaire arrive à échéance quand l’emprunteur ou le dernier des emprunteurs décède, vend le logement ou en déménage de manière permanente. En cas de décès, les héritiers peuvent au choix, soit rembourser le montant du crédit au prêteur afin de conserver le bien immobilier, soit vendre le bien. Si son prix de vente est supérieur au montant de la dette, ils pourront récupérer la différence. Le risque de longévité et le risque d’évolution des prix de l’immobilier sont transférés au prêteur, le montant de la dette de l’emprunteur étant limité à la valeur du logement à l’échéance du contrat. Les prêts viagers hypothécaires ne nécessitent pas d’examen médical et ne sont soumis à aucun critère de revenu, ils sont donc accessibles aux personnes en mauvaise santé ou disposant de revenus modestes. La seule contrainte est d’avoir les moyens de continuer à payer les impôts fonciers et l’assurance habitation. Contrairement à l’assurance dépendance privée (avant l’apparition de la perte d’autonomie), les prêts viagers hypothécaires peuvent être souscrits à un âge très avancé. Ils peuvent par ailleurs donner lieu à une mutualisation et à une titrisation, même si, en la matière, depuis la crise des subprimes, cette pratique est jugée suspecte.
Aux États‑Unis, 2 % à 3 % des propriétaires dépendants avaient, en 2010, souscrit un prêt viager hypothécaire (Consumer Financial Protection Bureau, 2012). Le Home Equity Conversion Mortgage (HECM), assuré par la Federal Housing Administration (administration fédérale du logement), domine le marché américain des prêts viagers hypothécaires avec plus de 90 % des parts de ce marché. Le nombre de nouveaux prêts HECM était passé de moins de 7 000 en 2 000 à plus de 110 000 en 2009. Après la crise des subprimes, il est retombé à 55 000 en 2012. En Europe, le marché des prêts viagers hypothécaires représentait 3,31 milliards d’euros en 2007.
Pour un certain nombre d’experts, le recours aux prêts hypothécaires pourrait couvrir une part significative des dépenses liées à la dépendance. L’évaluation du coût de la perte d’autonomie est un exercice difficile, en particulier en raison des différents acteurs intervenants pour sa prise en charge : les systèmes publics (qui diffèrent d’un pays à l’autre), les personnes âgées elles‑mêmes et leur famille. En fonction des critères retenus, le montant des dépenses peut varier de 1 à 10.
Aux États‑Unis, selon certaines études, le coût annuel médian s’élève à 47 934 dollars pour l’aide-ménagère, à 49 192 dollars pour les soins de santé à domicile, à 18 200 dollars pour les structures d’accueil de jour, à 45 000 dollars pour les résidences services et à 97 455 dollars pour une chambre privée dans une maison de retraite (Genworth Cost of Care Survey, 2017). Selon d’autres études américaines, le coût global annuel de la dépendance se situerait entre 50 000 et 70 000 dollars.
Selon des données néerlandaises, les dépenses liées à la perte d’autonomie s’élèvent au total à 73 817 dollars. Au Royaume‑Uni, l’estimation du coût moyen des dépenses liées à la perte d’autonomie sur toute la vie est de 53 506 dollars pour les femmes et de 29 531 dollars pour les hommes. En France, le coût se situerait entre 70 000 et 150 000 euros par an.
Du fait des écarts des prix immobiliers et des coûts des services liés à la dépendance, la formule des prêts hypothécaires est plus adaptée aux pays d’Europe du Sud qu’aux États-Unis. Dans ce dernier pays et au Royaume-Uni, la mobilisation du patrimoine financier apparaît plus adaptée.
Depuis vingt ans, chaque Président de la République annonce une grande loi sur la dépendance. À chaque fois, le projet est enterré faute de volonté. La question du financement sert d’épouvantail. Or, elle est loin d’être la seule ni, peut-être, la plus complexe à régler. Les personnes de plus de 60 ans sont aujourd’hui les principaux détenteurs du patrimoine des ménages. Certes, il n’est pas facile de mobiliser un patrimoine immobilier quand la dépendance survient. Mais le recours à des solutions assurantielles pour financer la prise en charge est imaginable soit en complément des revenus, soit en soudure, le temps de vendre le logement ou de le louer. Serait-il choquant que les retraités s’acquittent d’une cotisation dépendance obligatoire si en contrepartie une prise en charge de qualité était assurée ? Au-delà de la question financière, c’est en effet le niveau de services et le suivi des personnes dépendantes qu’il convient d’améliorer. D’ici 2040, la menace d’une société duale, avec d’un côté les actifs valides et de l’autre ceux qui seront invalides ou à la charge de la société, et un fossé au milieu, est réelle. Afin que la solidarité puisse conserver toute sa place, elle doit être acceptée par tous et reposer sur une répartition équitable des charges.
Livret A : les raisons de son succès malgré sa faible rémunération
Malgré un contexte défavorable au produit, le Livret affiche un encours record grâce à une collecte soutenue depuis plusieurs mois. Retour sur les raisons de ce succès avec les éléments d’explications du Cercle de l’Epargne.
PEL, Livret A… : ce qu’ils vous font perdre
Retour sur les rendements des placements phares des Français et analyses des comportements des épargnants avec Philippe Crevel dans cet article de Sarah Asali publié sur Capital.fr.
Immobilier, les acheteurs sont-ils toujours gagnants ?
Les taux d’intérêt sont à des niveaux historiquement bas. D’après les chiffres publiés par Crédit Logement/CSA, au mois de juin, le taux moyen accordé par les banques, toutes durées confondues, est descendu à 1,25 %. Pour des prêts à 10 ans, le taux moyen est d’environ de 0,77 %. Le pouvoir d’achat immobilier des Français n’aurait jamais été aussi élevé depuis 2002, selon la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim). Évidemment, la situation peut différer d’une agglomération à une autre. Dans certaines villes, les prix sont orientés à la baisse comme à Mulhouse quand dans d’autres, depuis une génération, ils sont en hausse. À Paris, ils ont ainsi doublé depuis le début du XXIe siècle.
Des experts mettent en avant le fait que les taux réels des prêts immobiliers sont négatifs mais ce phénomène s’est déjà produit à plusieurs reprises. L’inflation des années d’après-guerre érodait le coût du remboursement. Le capital à rembourser perdait chaque année de 7 à 13 % de sa valeur réelle quand les salaires suivaient, voire anticipaient la hausse des prix. La dépréciation du capital faisait plus que compenser le niveau élevé des taux qui pouvaient atteindre plus de 12 points. Les taux d’intérêt réels étaient négatifs de plusieurs points quand aujourd’hui ils sont nuls voire faiblement négatifs. Ainsi, avec une inflation de 1,2 %, le taux d’intérêt réel pour un emprunt immobilier est de -0,4 point.
Entre les années 70 et maintenant, l’accès au crédit s’est, par ailleurs, durci. Les banques, du fait du rétrécissement de leurs marges en relation avec les faibles taux ainsi qu’en raison des normes prudentielles en cours, entendent réduire leur exposition aux risques. Elles vérifient avec plus d’attention qu’auparavant la solvabilité de leurs clients. La moindre progression des salaires et la plus forte instabilité professionnelle sont autant de freins pour l’accès à l’emprunt. Avec les difficultés d’une partie de la population pour s’insérer professionnellement, l’achat d’un bien immobilier intervient de plus en plus tard. En moyenne, le premier achat est effectué à 33 ans, le temps de stabiliser sa situation et de se constituer un apport.
Pour permettre à des ménages d’acquérir un bien immobilier, les banques allongent la durée des prêts. Elles proposent désormais des prêts à 25 ou à 30 ans. Plus de 40 % des prêts immobiliers sont à 25 ans. Au deuxième trimestre de cette année, 53,3 % des ménages de moins de 35 ans ont emprunté sur une durée de 25 ans et plus, alors qu’ils n’étaient que 20,4 % au deuxième trimestre 2014. La part des prêts de moins de 15 ans ne représente plus que de 8,5 % de la production de crédits immobiliers. Au mois de juin, la durée moyenne est de 19 ans et trois mois, soit 15 mois de plus qu’à l’automne 2017 et 30 mois de plus que début 2014.
Les ménages empruntaient en moyenne 170 187 euros en 2018. Ce montant progresse de 5 % par an depuis plusieurs années. Le taux d’effort, remboursement par rapport aux revenus est de son côté en hausse. Il atteint 30 %. Le coût d’achat doit prendre en compte les droits de mutation ainsi que les impôts et charges liés à la propriété. De ce fait, des ménages peuvent rapidement être en difficulté quand surviennent, par exemple, des travaux (ravalement, toiture).
La rentabilité de l’investissement locatif tend à se détériorer. L’augmentation des loyers ne suit pas la hausse du prix de l’immobilier, ce qui entraîne automatiquement la baisse de la rentabilité. L’encadrement des loyers ne devrait qu’accentuer ce phénomène. Cette baisse s’est accélérée ces quatre dernières années.
Quelle est la rentabilité d’un bien immobilier ?
La rentabilité
brute s’obtient en divisant le loyer annuel par le prix du logement, intérêt
compris de l’emprunt éventuellement souscrit. Souvent utilisée, elle peut varier
fortement dans la pratique. La rentabilité nette est plus précise, car elle
prend en compte le paiement des impôts locaux (la taxe foncière payée par le
propriétaire) et les charges non récupérables sur le locataire ainsi que les
frais de gestion. Ces charges et prélèvements peuvent représenter entre un et
deux mois de loyers. La rentabilité nette-nette est calculée après impôts et
éventuellement après intégration des avantages fiscaux (dispositif Pinel,
Censi, Bouvard, etc.). En moyenne, la rentabilité nette avant fiscalité varie
de 2 à 3 %.
Comparaison des rentabilités brutes pour les plus grandes villes françaises en 2018
Source des chiffres : Les prix au m² sont ceux donnés par ImmoPrix pour la Province (ou par le dernier numéro de l’Express pour les rares villes où le site Immoprix ne donne qu’une fourchette) et par le site des notaires de Paris/Ile-de-France pour l’Ile-de-France (chiffres d’avril 2019). Les chiffres sur les loyers proviennent de l’étude de Clameur publiée en mars 2019.
Le problème vient de l’offre
La France a un problème récurrent avec le logement. Déjà durant l’entre-deux-guerres, il y avait une crise du logement. Après-guerre, le Livret A a été affecté au financement du logement social. Il a fallu dans l’urgence régler le problème de bidonvilles en créant dans les années 60 des villes nouvelles et des cités devenues depuis des ghettos. Depuis trente ans, la population française s’urbanise à grande vitesse au sein des grandes métropoles : région parisienne, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes… Par ailleurs, d’importantes migrations en provenance de l’est et du nord de la France vers l’Ouest et le Sud occasionnent des tensions sur le marché du logement. Un malthusianisme foncier favorise également la crise perpétuelle du logement en France. Entre propriétaires et écologistes, il y a un consensus, limiter la construction. Cette rareté du foncier a pour corollaire une dépense croissante de la part des pouvoirs publics, près de 40 milliards d’euros consacrés chaque année pour le logement (aides à la personne ou à la pierre). Malgré ce montant d’aides important, un record en Europe, la situation ne s’améliore guère. Aujourd’hui, il n’y a pas d’accord pour densifier réellement les logements, ce qui signifierait construire plus haut ou réaliser des villes nouvelles. Il est assez frappant de constater que le nombre de transactions augmente quand, dans le même temps, les constructions nouvelles reculent et cela malgré un déficit de logement évalué à 500 000.
N.B: Le tableau et quelques éléments de l’article ci-dessus reprennent les travaux de David Lelong publiés sur le site immobilier-danger.com
Pourquoi les nouveaux contrats d’épargne retraite peuvent attirer
Avec la réforme de l’épargne retraite dans le cadre du PACTE, le Ministre Bruno Le Maire entend booster l’épargne retraite avec un objectif espéré de collecte qui peut sembler ambitieux. Dans cet article publié dans Les Échos, Philippe Crevel considère néanmoins que le contexte de la réforme des retraites pourrait profiter au nouveau dispositif.
5 002 milliards d’euros, c’est le montant de l’épargne financière des ménages
Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, organisme dépendant de la Banque de France, le patrimoine financier des ménages s’élevait, à la fin de l’année dernière, à 5 002 milliards d’euros, en recul de 40 milliards d’euros par rapport à 2017. Cette contraction n’est pas la conséquence d’une baisse du taux d’épargne qui au contraire a progressé, mais de la diminution du cours des actions au cours du dernier trimestre 2018. Les flux des ménages vers leurs placements financiers ont, en effet, augmenté de 20 % l’année dernière. Ils ont atteint 114 milliards d’euros, soit le meilleur résultat enregistré lors de ces trois dernières années.
Près des deux tiers de l’épargne des ménages (65 %) sont placés en produits de taux, principalement sous forme de dépôts bancaires et d’assurance-vie en euros. En 2018, 87 milliards d’euros ont été placés en produits de taux, contre 58 en 2017.
Des dépôts à vue toujours en hausse
Les ménages laissent des sommes de plus en plus importantes au sein de leurs dépôts à vue ou en numéraire (pièces et billets), plus de 560 milliards d’euros. Ces sommes ont augmenté de 38 milliards d’euros après 43 milliards en 2017. Ces dépôts non rémunérés ont progressé de plus de 150 milliards d’euros depuis la crise. Depuis 2013, les flux sur les dépôts à vue sont plus élevés que sur les dépôts rémunérés (28 milliards d’euros en 2018). Cette évolution est imputable à la baisse des rendements et à la volonté de conserver une forte poche d’argent liquide. Elle est liée au climat économique anxiogène que connaît le pays depuis une dizaine d’années. Le poids élevé des dépôts à vue dans le patrimoine des ménages n’est pas une spécificité française. Il est en effet proportionnellement plus important en Allemagne, en Espagne ou en Italie. La France se distingue en revanche de ses partenaires par le rôle particulier joué par l’épargne réglementée.
Les livrets ordinaires dopés par le Prélèvement Forfaitaire Unique
Les livrets bancaires rémunérés et fiscalisés détenus par les ménages ont atteint, en 2018, un encours de 185 milliards d’euros avec une collecte de près de 13 milliards d’euros. L’instauration du Prélèvement Forfaitaire Unique a joué en faveur de ces placements qui, en revanche, sont pénalisés par leur très faible rendement (0,26 % à fin 2018).
L’épargne réglementée, 15 % du patrimoine financier des ménages
L’épargne réglementée qui comprend le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDs), le Plan d’épargne logement (PEL), le Livret jeune, le Livret d’épargne populaire (LEP) et le Compte d’épargne logement (CEL), représente plus de 15 % de l’épargne financière française. Avec 751 milliards d’euros d’encours, elle bat un nouveau record, record porté par le succès rencontré l’année dernière par le Livret A (+ 11 milliards d’euros en 2018, après + 8 milliards en 2017). Ce niveau de collecte nette est inégalé depuis cinq ans. Malgré le niveau historiquement bas de son rendement, le Livret A a séduit les épargnants, pour son 200e anniversaire, par son triptyque : sécurité, liquidité et exonération de prélèvements.
Les encours des Livrets A et des LDDS ont atteint ainsi respectivement 267,5 milliards d’euros à fin 2018 (+ 4,2 %) et 107,2 milliards (+ 3,2 %). En revanche les LEP sont toujours en décollecte et représentent moins de 6 % de l’épargne réglementée des ménages. Même si la croissance s’est ralentie avec le durcissement du régime fiscal et la baisse du taux de rendement, l’encours des PEL continue d’augmenter et dépasse désormais 276 milliards d’euros à fin 2018.
L’assurance vie conforte sa première place
L’encours de l’assurance vie (avec épargne retraite en contrats d’assurance) s’est élevé à 1 913 milliards d’euros à la fin de l’année 2018. Ce produit représente 38 % du patrimoine financier des ménages. Les fonds euros ont atteint 1 570 euros, et les unités de compte 343 milliards d’euros. Les flux vers l’assurance vie se sont établis à + 51 milliards d’euros, en forte hausse par rapport à 2017. La collecte nette (différence entre les cotisations et les rachats ainsi que les versements des rentes) a été de 22 milliards d’euros en 2918 après +9 milliards en 2017.
Les placements « actions » retrouvent quelques couleurs malgré la chute des cours
Les produits de fonds propres, essentiellement composés d’actions détenues directement ou indirectement, ont bénéficié d’un flux positif de 17 milliards d’euros en 2018. Leur encours s’est élevé à 1 653 milliards d’euros soit le tiers de l’épargne financière des ménages. L’encours est en baisse de 89 milliards d’euros du fait du recul du cours des actions. Le CAC 40 a, en effet, perdu 13 % l’année dernière après avoir augmenté de 9 % en 2017. Malgré tout, les ménages ont acquis 4 milliards d’euros d’actions en direct. Ces achats ont été stimulés par le nouveau régime fiscal (Prélèvement forfaitaire Unique).
2018, une année faste pour l’épargne
Avec une amélioration sensible du pouvoir d’achat en fin d’année, avec la stabilisation des prix et dans un contexte économique et social compliqué, les ménages français ont renforcé leur effort d’épargne. Tous les grands produits ont bénéficié de cet engouement pour l’épargne. Cette tendance s’est poursuivie au cours du premier semestre 2019. Une inflexion est attendue pour la fin de l’année en raison d’une reprise anticipée de la consommation.
Le Livret A, un succès total pour ses 200 ans
Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, 82,5 % des Français disposent d’un Livret A (82,9 % en 2017). Depuis la mise en place des dispositifs de recherche des comptes et livrets en déshérence (Loi Eckert) et la lutte accrue contre la multi-détention, la proportion de détenteurs a diminué lors de ces dix dernières années. En 2011, ce taux était de 95 %. Plus de 6 millions de comptes avaient été fermés en 2016 et 2017.
Le nombre de Livrets A augmente pour les personnes morales (+ 35 000 livrets). Elles détiennent 850 000 livrets fin 2018 (+ 4 % sur un an). Ces ouvertures sont portées essentiellement par les syndicats de copropriétaires. Ils détiennent 130 000 Livrets A en 2018, contre 50 000 en 2016.
L’encours détenu par les personnes morales a dépassé 20 milliards d’euros en 2018, en hausse de 1,5 milliard d’euros par rapport à 2017. Les encours sont détenus pour moitié par les organismes HLM (9,6 milliards d’euros). Le reste est détenu à parts égales par les associations et les autres organismes habilités (dont les syndicats de copropriétaires). Les personnes morales détiennent ainsi 7 % de l’encours de Livrets A en 2018.
La France compte ainsi 55 millions de Livret A pour un encours de 263,5 milliards d’euros à la fin de l’année 2018. 35,2 millions de Livrets A sont gérés par les réseaux historiques (Caisse d’Épargne, Crédit Mutuel et Banque Postale) et 19,8 millions par les réseaux bancaires.
Le nombre de clôtures brutes de Livrets A atteint 2,8 millions en 2018, un plus bas depuis 2009, à comparer à un niveau annuel moyen de 3,8 millions depuis 2009. Le nombre d’ouvertures de Livrets A reste stable depuis plusieurs années, autour de 2,5 millions par an. Les nouveaux réseaux représentent en moyenne 60 % des ouvertures brutes quand les réseaux historiques concentrent 60 % des fermetures brutes. Au total, les nouveaux réseaux enregistrent 600 000 ouvertures de livrets en solde net tandis que les réseaux historiques comptabilisent 800 000 fermetures nettes de comptes.
L’application de la loi Eckert
Les restitutions aux bénéficiaires au titre de la loi Eckert sont multipliées par plus de deux. La Caisse des dépôts et consignations a reçu plus de 450 000 livrets réglementés inactifs en 2018, de 149 millions d’euros. Les Livrets A représentent toujours l’essentiel (95 %) de ces livrets inactifs.
Les taux de détention des LDDS et LEP) sont stables eux aussi, à respectivement 36 % et 13 %.
18 499 LDDS ont été également transférés à la Caisse des Dépôts pour un encours de 7,3 millions d’euros. 874 ont été restitués. Leur montant total était de 1,9 million d’euros.
965 Livrets d’Épargne Populaire ont été transmis. Leur montant global s’élevait à 1,3 million d’euros. 27 ont été restitués à leurs ayants droit avec à la clef 200 000 euros.
Au total, la Caisse des Dépôts a restitué à leurs bénéficiaires plus de 20 000 comptes pour un encours global de 36 millions d’euros au titre de l’épargne réglementée. Les restitutions ont plus que doublé par rapport à 2017 (16 millions d’euros).
Le nombre de livrets d’épargne populaire (LEP) : des clôtures toujours nombreuses, un début de reprise des ouvertures
Le nombre de LEP a diminué chaque année depuis 2009, sauf en 2015. Il se replie de 260 000 comptes en 2018, après 170 000 comptes en 2017.
Le Plan d’épargne logement (PEL) en recul
Le nombre total de PEL s’établit à 14,3 millions d’unités à fin 2018, en baisse de 7,3 % sur un an. Cette diminution de 1,1 million de comptes est la plus importante enregistrée depuis 2009. Le nombre d’ouvertures brutes est lui aussi en très forte baisse : 0,7 million de PEL ouverts en 2018 à comparer à 1,7 million en 2017. La chute des ouvertures de PEL est essentiellement influencée par la baisse de son taux de rémunération net de la fiscalité.
Une concentration de plus en plus forte
Les Livrets A supérieurs au plafond (22 950 euros) représentent 6 % du nombre de livrets en 2018. En six ans, cette proportion a été multipliée par trois. Leur poids au sein de l’encours global est passé de 11,3 % en 2013 à 28,3 % en 2018. Les livrets de montant inférieur à 1 500 euros totalisent 60 % du nombre de livrets et représentent 3 % de l’encours.
Les LDDS supérieurs au plafond (12 000 euros) représentent 18 % du nombre de livrets et un peu moins de la moitié des encours (49 %). Les LDDS inférieurs à 6 000 euros (deux tiers du nombre de livrets) ne représentent que 16 % des encours. Les LEP supérieurs au plafond (7 700 euros) dépassent deux tiers des encours (69 %, comme en 2017) pour 38 % du nombre de livrets en 2018.
Un montant moyen par Livret A en hausse
L’encours moyen des Livrets A et des LDDS était fin 2018 respectivement de 4 800 et 4 500 euros en hausse de plus de 1 500 euros par rapport à son montant de 2009. Celui des Livrets d’Épargne Populaire est stable depuis 10 ans, autour de 5 000 euros.
Le nombre moyen de mouvements constatés sur les livrets actifs s’établit en 2018 à 4,74 pour les versements et 5,14 pour les retraits, soit environ un mouvement par mois. Le montant moyen des mouvements sur l’ensemble des livrets s’établit à 527 euros pour les Livrets A, 434 euros pour les LEP et 658 euros pour les LDDS.
Les plus de 65 ans détiennent 38 % des encours de livrets réglementés
Les épargnants de plus de 65 ans, qui représentent 20 % de la population française au 1er janvier 2019, détiennent 38 % des encours de livrets d’épargne réglementée. Les jeunes détiennent en proportion quatre fois moins d’épargne réglementée que la moyenne de la population française. Ils représentent 29 % de la population et détiennent seulement 9 % des encours. Leur argent est placé principalement sur des Livrets A (80 %) et sur des Livrets jeunes (16 %). Malgré un taux de rendement (1,4 % en 2018) supérieur à celui du livret A, l’encours des Livrets jeunes est en baisse depuis plusieurs années.
Le temps est-il encore de notre côté ?
L’édito du Président – Août 2019
Nous sommes confrontés à un double défi, le réchauffement climatique et le vieillissement démographique. Au cours de l’histoire de l’humanité, nous n’avons jamais connu une telle situation. En raison de l’augmentation de la population et de notre essor économique, nos conditions de vie sont en danger. Compte tenu des statistiques publiées ces dernières années, nous sommes en train de vérifier les projections les plus pessimistes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Pour certains, la fonte accélérée des glaces aux pôles pourrait précipiter la montée des eaux et des températures et générer un effet « boule de neige ». L’autre défi auquel nous sommes confrontés est donc l’augmentation rapide, généralisée dans tous les pays des plus de 60 ans. Ce phénomène est sans précédent, dans l’histoire de l’humanité. Ce vieillissement est le produit de notre essor économique. Il est également le résultat de l’augmentation exponentielle, depuis 1800, de la population mondiale qui est passée de 1 à 7,5 milliards d’habitants. Ce vieillissement a des conséquences importantes en matière de répartition des charges entre actifs et inactifs. Il entraîne une progression sans précédent des dépenses de santé, de retraite et de dépendance. Il oblige de revoir nos systèmes de protection sociale et plus globalement de production. Face à ces défis, nous semblons pour le moment bien désemparés. Les gouvernements optent pour des solutions traditionnelles, l’augmentation des impôts, le malthusianisme économique et social. Nous sommes atteints par un double mal, l’attentisme et la myopie. Le progrès est récusé car accusé de nous avoir menés dans une impasse. Nous nous autoflagellons en permanence quand nous devrions consacrer notre énergie à innover. Nous ne manquons pas d’épargne ; il y en aurait même trop. Nous ne manquons pas de chercheurs ; il n’y en a jamais eu autant. L’urgence est donc d’orienter les moyens financiers sur des projets de long terme. Nous avons contribué par nos inventions à détériorer notre cadre de vie, travaillons à trouver les moyens techniques pour contrecarrer ce processus. De même, des efforts doivent être consacrés au niveau de la recherche médicale non pas pour rendre l’homme immortel mais pour permettre de réduire les effets du vieillissement. Financièrement, des moyens sont disponibles. Au niveau de l’Union européenne, il y aurait la possibilité de lancer deux grands programmes de recherche financés par emprunts à faibles taux qui traiteraient de la transition écologique et de la santé. L’engagement de ces deux plans de recherche ouverts à des pays non membres de l’Union européenne comme la Russie et demain le Royaume-Uni auraient un impact positif sur la croissance et l’emploi. Cela permettrait à l’Europe, en décrochage technologique par rapport aux États-Unis et les pays d’Asie du Sud d’Est, de rattraper son retard.
A lire dans le Mensuel n°64 du Cercle
La croissance française ralentit, les Français consomment moins
Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne commente sur BFMTV.com les résultats de la croissance française sur le 2e trimestre.
Cachez ce Ceta que je ne saurais voir !
Retrouvez dans le Cercle des Echos, la tribune de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne.
Réforme des retraites : quel impact sur votre pension ?
Retour sur les grandes lignes de la réforme préconisée par Jean-Paul Delevoye dans cet article qui cite le Directeur du Cercle de l’Epargne.
Pouvoir d’achat : pourquoi les Français restent frileux pour dépenser
Sur RTL Philippe Crevel commente les résultats de la croissance sur le 2e trimestre et explique les raisons pour lesquels les Français préfèrent épargner que consommer.
La croissance française fait du surplace
Paris, le 30 juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La croissance française fait du surplace
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
L’économie française continue de croître mais à un rythme d’escargot. Après avoir enregistré un gain de 0,3 % au premier trimestre, le PIB ne s’est accru que de 0,2 % au deuxième. Ce résultat en demi-teinte est imputable à la faiblesse de la consommation qui n’a augmenté que de 0,2 % contre +0,4 % au premier trimestre. Avec ce résultat, l’objectif de croissance de 1,4 % sur l’ensemble de l’année semble de plus en plus hors d’atteinte. Une révision à la baisse à 1,2 % est probable, avec à la clef, un risque de dérapage du déficit public.
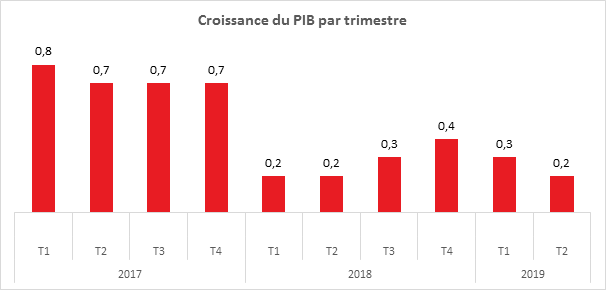
L’épargne avant la consommation
Les Français restent toujours très prudents en matière de dépenses de consommation. Le rebond après la crise des « gilets jaunes » ne s’est pas réalisé. En effet, au premier trimestre, la progression de la consommation avait été jugée faible, +0,4 %. Malgré les gains de pouvoir d’achat, primes défiscalisées, versement anticipé des réductions d’impôt, amélioration de certains minimas sociaux, etc., les ménages n’ont pas accru leurs dépenses. Ils ont préféré épargner comme l’indique le montant élevé des collectes nettes du Livret A (+11,57 milliards d’euros) et de l’assurance vie (+15,1 milliards d’euros). Le montant des dépôts à vue a été multiplié par deux en douze ans. Les Français, face à la multiplication des incertitudes économiques, tensions commerciales sino-américaines ou le Brexit demeurent très prudents et reportent leurs achats de biens durables. L’achat de véhicules neufs est ainsi en retrait au cours du premier trimestre. Dans ces conditions, il est assez logique que la production manufacturière soit orientée à la baisse (-0,4 % au deuxième trimestre contre +0,5 % au premier). La production a été, de ce fait, portée par les services qui ont connu une progression de 0,5 %.
L’investissement des entreprises en hausse
La bonne nouvelle des résultats de la croissance du deuxième trimestre provient de l’investissement qui augmente de 0,9 % contre +0,5 % au premier trimestre. Cette progression est imputable aux entreprises dont les investissements sont en hausse de 1,2 % après +0,7 %. Elles se sont équipées en matériel informatique et de télécommunication afin de compenser le retard accumulé en la matière ces dernières années. L’investissement des ménages a enregistré une petite croissance de 0,1 % stable par rapport à celle du premier trimestre.
Gage d’amélioration de la compétitivité de notre économie, la hausse de l’investissement traduit la confiance maintenue des chefs d’entreprise dans la croissance de l’économie française.
Le commerce extérieur neutre pour la croissance
Dans un contexte de ralentissement du commerce international, le commerce extérieur de la France n’a pas pesé sur le cours de l’économie française. La croissance des importations s’est ralentie passant de 1,1 % à 0,1 % du premier au deuxième trimestre. Les exportations ont de leur côté cru au même rythme, +0,2 %. La contribution à la croissance du PIB a été neutre quand elle avait été négative de 0,3 point au premier trimestre. La France est moins touchée que certains de ses partenaires dont l’Allemagne par le ralentissement des échanges extérieurs du fait du poids plus faible de son industrie.
Les variations de stocks ont joué négativement
Au deuxième trimestre, les entreprises ont réduit leurs stocks. Ces derniers ont ainsi pesé sur la croissance, -0,2 % contre +0,3 % au premier trimestre.
Un deuxième semestre plus porteur ?
Les ménages, avec l’amélioration de leur pouvoir d’achat, +2,5 % attendu en 2019, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 2007, devraient reprendre le chemin de la consommation au cours du deuxième semestre. En effet, depuis plusieurs années, les comportements des ménages diffèrent d’un semestre à l’autre. Au cours du premier, les Français épargnent quand, au cours du second, du fait des vacances, de la rentrée scolaire ou des fêtes de fin d’année, ils dépensent davantage.
Pour expliquer l’atonie des dépenses, il faut prendre en compte le fait que les ménages sont toujours dubitatifs en cas d’augmentation soudaine de leur pouvoir d’achat considérant que cette situation ne soit pas amenée à perdurer. Ils craignent que les pouvoirs publics leur reprennent d’une main ce qu’ils ont donné de l’autre. Il en est de même en matière d’inflation. Après plusieurs mois de hausse des prix durant l’année 2018, ils intègrent lentement la désinflation. Il est à noter également que l’indice de confiance des ménages qui avait fortement baissé entre la fin de l’année 2018 et le printemps 2019 est à nouveau en hausse.
**
*
La poursuite de l’amélioration de la situation de l’emploi pourrait jouer positivement en faveur de la croissance d’ici le mois de décembre. Si dans les années 80/90, il fallait un taux de croissance de 2 % pour créer des emplois, désormais, une faible croissance suffit. Cette situation est liée à la tertiarisation de l’économie et à la plus grande flexibilité de notre marché du travail. La décrue du chômage est également facilitée par les nombreux départs à la retraite.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
« Super livrets bancaires », une bonne idée ?
Les livrets bancaires peuvent bénéficier au cours de la période estivales d’offres visant à booster leur rendemnt. S’agit-il pour autant des placements qu’il convient de recommander aux épargnants ? Retrouver l’analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne.
La révolution du secteur des finances est-elle en marche ?
Le secteur de la banque, de l’assurance et de la prévoyance a comme particularité de gérer d’importants stocks (l’encours de l’assurance dépassant à titre d’exemple 1 745 milliards d’euros au 30 avril 2019) et des flux. Par ailleurs, ce secteur doit constituer des réserves, des provisions pour des raisons techniques et prudentielles. Des exigences précises de fonds propres sont fixées par le législateur au nom de la défense des intérêts des épargnants et des clients et afin d’éviter une crise systémique en cas de défaillance d’un acteur important. Ces contraintes rendent l’arrivée de nouveaux acteurs plus complexes. Malgré tout, des fintechs et des assurtechs intervenants sur des créneaux particuliers, connaissent quelques succès. Les banques sont de plus en plus concurrencées dans les métiers des paiements avec l’arrivée de géants du digital comme Apple ou Facebook. Pour capter une part de marché, les start-up jouent sur leur caractère disruptif. Elles mettent en avant la transparence, la simplicité et l’instantanéité. Elles recourent aux nouvelles techniques que ce soit le Blockchain, les algorithmes, les objets connectés. Cette mutation digitale intervient au moment où le secteur financier est confronté à une baisse durable des taux d’intérêt. Par le passé, des taux relativement élevés offraient des marges non négligeables tant pour le monde bancaire que pour celui de l’assurance. Aujourd’hui, avec des taux nuls ou presque, les prêts ou la gestion des fonds euros n’offrent peu de rendement pour les acteurs financiers. Le développement des frais n’a compensé qu’en partie le manque à gagner.
Au sommaire de cette étude
La banque face à la révolution monétaire
- Le temps des agrégateurs
- La bataille des paiements est engagée
L’intelligence artificielle au cœur de l’assurance de demain
- Des nouveaux contrats d’assurance pour faire face à de nouveaux risques
- L’utilisation de la Blockchain
- La révolution des objets connectés
- Quand l’assurance devient communautariste
- La relation client de plus en plus digitalisée
- Le retour de l’humain
L’ordonnance sur le Plan d’Épargne Retraite (PER) publiée au journal officiel
Paris, le 25 juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ORDONNANCE SUR LE PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
L’ordonnance relative au Plan d’Epargne Retraite (PER) a été publiée au Journal Officiel du 25 juillet 2019. Elle fixe les règles de fonctionnement ainsi que le régime fiscal et social des futurs PER qui pourront être souscrits avant la fin de l’année (certainement à partir du 1er octobre 2019).
L’ordonnance prévoit que les anciens produits d’épargne retraite (PERP, Madelin, PERCO, article 83, etc.) ne pourront plus être souscrits au plus tard après le 1er décembre 2020 (date qui sera précisée par arrêté).
Le PER se décompose en deux sous-ensembles : le Plan d’Epargne Retraite Individuel et le Plan d’Epargne Retraite Entreprise. Le premier sous ensemble regroupe les versements aujourd’hui effectués sur les PERP et les Contrats Madelin. Le second reprend les PERCO et les contrats article 83. Le PER entreprise se subdivise ainsi en deux blocs, le PER collectif et le PER obligatoire.
Le PER pourra prendre la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte titres.
Le Plan d’Épargne Retraite Entreprise
Pour le plan des produits d’entreprise dits collectifs, l’ordonnance définit deux produits :
- un produit collectif bénéficiant à l’ensemble des salariés (ex PERCO) ;
- un produit à adhésion obligatoire, le PER entreprise obligatoire, et pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés, qui succèdera aux contrats « article 83 » – PERE. Ce produit est également qualifié de catégoriel.
Les plans investis uniquement en Fonds Communs de Placement en Entreprise (FCPE) bénéficieront toujours d’une gouvernance paritaire. Pour les autres produits, un comité de surveillance paritaire devra être institué. En ce qui concerne les produits catégoriels qui ne sont pas alimentés par l’épargne salariale, cette création sera facultative. De ce fait, cela signifie que les produits catégoriels pourront recevoir, au nom de la portabilité, des sommes issues de l’épargne salariale.
L’intéressement et la participation pourront donc être versés sur un PERCO, ou sur un plan catégoriel sous réserve que celui-ci dispose d’une gouvernance paritaire (et que tous les salariés soient couverts par un Plan d’Épargne Retraite.
L’intéressement et la participation ne pourront pas en revanche être versés sur les produits individuels retraite, sauf en cas de transfert.
Les entreprises disposant à la fois d’un produit collectif et d’un produit catégoriel auront la faculté de les regrouper en un produit unique cumulant toutes les possibilités des différents produits. Les salariés seront ainsi en mesure d’effectuer des versements provenant de l’épargne salariale, réaliser des versements volontaires, recevoir les abondements de l’employeur et les cotisations des produits dits catégoriels.
Le Plan d’Épargne Retraite Individuel
Le PERP et le contrat Madelin sont fusionnés mais les avantages fiscaux à l’entrée restent distincts. Le Plan d’Épargne Individuel pourra être proposé par les assureurs et par les gestionnaires d’actifs.
Pour les produits proposés par les gestionnaires d’actifs, un compte titre et un compte espèce seront ouverts. Comme actuellement, pour les PERP et les Contrats Madelin, les PER assurantiels seront souscrits par l’intermédiaire d’une association souscriptrice de contrats de groupe. Un comité de surveillance qui intègrera des représentants des épargnants disposera de pouvoirs de contrôle. Les décisions importantes concernant les PER assurantiels seront soumises aux votes des assemblées générales des adhérents.
Les produits ouverts auprès d’un assureur pourront inclure des garanties optionnelles, par exemple en cas de perte d’autonomie, d’invalidité de perte d’emploi subie ou de décès. La liste des garanties optionnelles est inspirée des produits actuels.
Le régime fiscal et social du PER
Au niveau fiscal, les versements volontaires et les versements obligatoires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR) à l’entrée dans la limite de plafonds de déductibilité. À la sortie, les versements obligatoires et les versements volontaires déduits de l’IR sont soumis à l’IR, en rente comme en capital (dispositif du report d’imposition). À l’inverse, pour les versements volontaires non déduits de l’assiette de l’IR à l’entrée, seules les plus-values sont fiscalisées en sortie. Les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur et jours de compte-épargne temps) conservent leur régime d’exonération fiscale à l’entrée et à la sortie.
Pour les prélèvements sociaux, à l’entrée le dispositif d’exonération de cotisation sociale et d’assujettissement au forfait social est maintenu pour les versements de l’employeur, par parallélisme avec les produits actuels. À la sortie, l’ordonnance prévoit d’appliquer les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires.
La transférabilité
L’ordonnance mentionne que tous les produits seront transférables. Pour les produits obligatoires, cela s’entend en cas de changement d’entreprise. Par ailleurs, les règles fiscales prévoient qu’en cas d’avantage à l’entrée, il ne saurait y avoir avantage à la sortie ce qui obligera à réaliser une traçabilité des versements.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
L’assurance vie conserve la forme en juin
Paris, le 25 juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultat de l’assurance vie du mois de juin et du premier semestre 2019
L’ASSURANCE VIE CONSERVE LA FORME
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Pour le sixième mois consécutif, l’assurance vie a enregistré en juin une collecte nette positive, +2,4 milliards d’euros contre +1,8 milliard d’euros en mai et un an auparavant. Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre, la collecte nette a été de 15,1 milliards d’euros soit 3,5 milliards d’euros de plus qu’en 2018.
Au mois de juin, la collecte brute, à 12,1 milliards d’euros, s’est bien tenue quand dans le même temps les prestations sont restées stables à 9,8 milliards d’euros. Au cours des six premiers mois, le montant total des cotisations a atteint 74,0 milliards d’euros et les prestations 58,9 milliards d’euros.
En liaison avec l’amélioration des cours des actions, la souscription des unités de compte est en progression par rapport aux mois précédents. Elle a représenté 25,6 % de la collecte totale en juin. Pour les six premiers mois, la part des UC est de 24 %, en retrait par rapport à l’année 2018 (28 %).
L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 750 milliards d’euros à fin juin 2019, en progression de 3 % sur un an.
Le mois de juin a conforté la tendance constatée depuis le début de l’année. L’effort d’épargne a été accru sur le premier semestre ce qui a profité au premier placement financier des ménages. Juin est en règle générale un mois correct pour l’assurance, seules deux décollectes ont été enregistrés lors de ces dix dernières années (2012 et 2013). Il y a dix ans, la collecte nette était de plus de 4,6 milliards d’euros. La proportion d’unités de compte dans la collecte était de 11 %. Pour mémoire, l’encours était de 1 188 milliards d’euros.
L’assurance vie bénéficie de l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’aversion des ménages aux risques d’où le poids important de la collecte des fonds euros. Loin de freiner l’assurance vie, la vitalité de l’immobilier semble même lui être profitable. Les ménages pour acquérir un logement sont contraints de disposer d’apports personnels plus importants ce qui les conduit à épargner davantage. Par ailleurs, le vieillissement de la population engendre une hausse naturelle du taux d’épargne et une progression de l’assurance vie qui constitue le produit d’épargne de référence des plus de 45 ans.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Livret A : Petite collecte en juin, relâchement avec modération de l’effort d’épargne
Paris, le 23 juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les résultats du Livret A du mois de juin et du premier semestre 2019
Petite collecte en juin, relâchement avec modération de l’effort d’épargne
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
La collecte du mois de juin est en net retrait par rapport à celle des mois précédents. Elle s’est élevée à 510 millions contre 1,22 milliard d’euros au mois de mai. Il s’agit de la plus faible collecte depuis le début de l’année. Il faut remonter au mois d’octobre dernier pour enregistrer un résultat plus faible. Depuis le début de l’année, la moyenne mensuelle est de 1,9 milliard d’euros. De ce fait, la collecte nette du premier semestre pour le Livret A est de 11,57 milliards d’euros contre 9,11 milliards d’euros pour la même période en 2018. À fin juin, l’encours du Livret A est à son plus haut historique avec 295,4 milliards d’euros.
Malgré un rendement réel négatif, après prise en compte de l’inflation, le Livret A a donc été plébiscité au cours du premier semestre. Les ménages ont décidé d’y affecter une grande partie des gains de pouvoir d’achat engrangés depuis la fin de l’année dernière (prime défiscalisée, versement anticipé des réductions d’impôt, etc.). Le climat économique anxiogène a contribué au report de dépenses en biens durables nécessitant de puiser dans l’épargne. Par ailleurs, du fait de l’introduction de la retenue à la source, certains ménages ont pu modifier leurs comportements en augmentant leur épargne de court terme de peur de ne pouvoir pas faire face à leurs dépenses courantes.
Après avoir accentué leur effort d’épargne, les ménages commencent néanmoins à relâcher leur effort. La proximité des vacances qui s’accompagnent de dépenses importantes ainsi que la nécessité d’effectuer des achats reportés depuis plusieurs mois expliquent ce changement de rythme. Après s’être restreints depuis la fin de l’année dernière, les ménages semblent reprendre goût à la consommation. La fin de la crise des « gilets jaunes » et l’amélioration du pouvoir d’achat expliquent également ce petit regain d’optimisme rendant moins nécessaire le renforcement de l’épargne de précaution. L’évolution de l’indice de confiance des ménages dans la situation économique symbolise ce changement de climat. Au mois de juin, l’indicateur de l’INSEE qui la synthétise est, en effet, en hausse pour le sixième mois consécutif et est repassé au-dessus de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis avril 2018.
Juin est toujours un mois charnière pour le Livret A. Ainsi, sur ces dix dernières années, quatre décollectes ont été enregistrées. Les ménages, après avoir épargné durant les premiers mois de l’année, entrent dans un cycle de dépenses, vacances, rentrées scolaire, puis fêtes de fin d’année. Cette année, en revanche, la disparition du paiement du dernier tiers d’impôt sur le revenu avec l’instauration du prélèvement à la source, devrait limiter les décollectes sur le Livret A.
Comme l’année dernière, les six derniers mois de l’année devraient donc être moins favorables au Livret A. Malgré tout, sur l’ensemble de l’année, la collecte devrait rester positive et dépasser les 10 milliards d’euros.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Livrets, assurance-vie… où les Français placent-ils leur argent ?
Quels sont les placements plébiscités par les Français et comment articulent-ils effort d’épargne et consommation ? Le Directeur du Cercle de l’Épargne apporte quelques éléments d’explication dans cet article publié dans Capital.fr
Réforme des retraites : ces Français menacés par la « bombe » du gouvernement
Philippe Crevel décrypte les propositions du rapport Delevoye pour introduire un régime universel de retraite.
Réforme des retraites : « On va vers plus d’équité et de transparence, on peut s’en réjouir »
Philippe Crevel revient sur France Info sur les principales annonces du Haut-commissaire à la réforme des retraites.
Réforme des retraites
À quelques heures de la présentation des recommandations du Haut-commissaire à la réforme des retraites, le Cercle de l’Épargne rappelle l’état de l’opinion, en reprenant les résultats de l’enquête 2019 « Les Français, la retraite et l’épargne » et évoque les enjeux de la réforme souhaitée par le Président de la République.
Les enjeux de la réforme des retraites
Paris, le 16 juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES ENJEUX DE LA RÉFORME DES RETRAITES
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
En décidant de réformer les régimes de retraites, le Gouvernement touche au premier poste de dépenses sociales du pays, plus de 320 milliards d’euros. Pour les Français, le système social est un des éléments clefs du pacte social.
La réforme systémique voulue par le Président de la République repose sur un principe simple « un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous ». Ce slogan plébiscité durant la campagne présidentielle de 2017 ne sera pas, malgré tout, aisé à traduire en actes car un système de retraite est par nature complexe et intègre de nombreux éléments de solidarité. Le passage de notre système actuel comportant 42 régimes de base et une centaine de régimes complémentaires vers un régime universel à points est une véritable révolution nécessitant la résolution de nombreuses équations. Les questions de l’âge de départ, de la réversion, des droits familiaux devront être tranchées. Il faudra également déterminer les modalités de la convergence des régimes actuels vers le nouveau régime. À ce titre, des règles de transfert des cotisants des anciens régimes vers le nouveau devront être fixées. Cette réforme aura des conséquences pour les personnels qui sont en charge de la gestion des régimes existants.
Une réforme d’une telle ampleur occasionnera des gagnants mais aussi des perdants ; les premiers resteront assez silencieux quand les seconds exprimeront leur mécontentement.
I. L’ÉTAT DE L’OPINION PUBLIQUE
Un soutien ambigu à la réforme
Les Français demandent plus d’équité en matière de retraite mais ils craignent que cette réforme serve avant tout à reculer l’âge de départ ou à diminuer les pensions.
Toute l’ambiguïté provient du fait que si le souhait d’une égalité de traitement est fort, il n’interdit pas le maintien de spécificités. Ainsi, selon la dernière enquête du Cercle de l’Épargne, 48 % des Français se prononcent en faveur d’un régime universel intégrant certaines spécificités (pénibilité, missions de nuit ou dangereuses, etc.). 34 % des Français sont pour l’application d’un régime universel total visant à traiter tous les assurés de manière identique. En revanche, seuls 18 % des sondés sont pour le statu quo.
Les retraités, les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques, craignant de figurer parmi les perdants de la réforme en cas d’unification totale, sont les plus enclins au statu quo en matière de retraite.
Seuls 34 % des Français considèrent que le futur système de retraite respectera l’engagement présidentiel, « un euro cotisé donnera les mêmes droits pour tous ». En revanche, ils sont 37 % à penser que les pouvoirs publics veulent profiter de cette réforme pour reculer l’âge effectif de départ à la retraite. Ce jugement est partagé par 52 % des fonctionnaires. Par ailleurs, 29 % des Français estiment que l’objectif de la réforme est de réduire les pensions.
II. LES ÉQUATIONS EN PARTIE RÉSOLUES
Le calendrier, le périmètre de la réforme, les spécificités
Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites souhaite que le projet de loi soit adopté en 2020 avec une entrée en vigueur progressive à compter de 2025, après l’élection présidentielle de 2022. Cette réforme pourrait concerner les générations nées après 1963 ou 1964. Pour les générations antérieures, les règles de liquidation ne seraient pas changées. Par ailleurs, pour les retraités, il n’y aurait pas de modification.
Une période transitoire sera sans nul doute instituée pour passer d’un système à un autre. Les pays européens qui ont, ces dernières années, mené des réformes systémiques ont prévu des dispositifs de transition. En 1998, la Suède, pour la mise en place des « comptes notionnels », a prévu une période transitoire qui a duré 17 années. L’Italie avait, en 1995, décidé de réaliser sa grande réforme des retraités sur 40 ans. Sur la pression de Bruxelles, ce délai a été légèrement réduit. En Allemagne, le passage d’un régime par annuités à un régime par points en 1992 a en revanche été instantané, les droits anciens ayant été convertis d’emblée.
La réforme française devra prévoir un mécanisme particulier pour ceux qui ont cotisé dans l’ancien système et qui liquideront leurs droits à retraite dans le nouveau.
La réforme est censée concerner 42 régimes de base et les régimes complémentaires qui y sont associés. Les régimes spéciaux et le système de la fonction publique devront converger et se fondre dans le futur régime universel.
Le Gouvernement a déjà prévu le maintien de règles de cotisations spécifiques pour les indépendants. La question des départs anticipés à la retraite a été en partie réglée. Ils seront admis au regard de la pénibilité subie durant la période d’activité. Ils ne seront plus liés à un statut mais à un emploi.
Un régime à points
Le nouveau régime unique devrait prendre la forme, a priori, d’un système par points qui offre de nombreux avantages en matière de pilotage. Aujourd’hui, les deux principaux régimes par points sont l’ARRCO et l’AGIRC. Les cotisations versées par les actifs servent à acquérir des points à un prix déterminé. Au moment de la liquidation, les points accumulés sont convertis en rente en prenant en compte la valeur de rachat du point.
Le taux de cotisations
Jean-Paul Delevoye a indiqué que le taux de cotisation dans le nouveau régime sera proche de 28 % pour les assurés et les employeurs qu’ils soient publics ou privés. En 2017, les taux de cotisation salarial et employeur sont de 27,5 % (sous plafond de la Sécurité sociale) pour un salarié non cadre et de 84,57 % pour un fonctionnaire civil de l’État (taux virtuel car les sommes sont prélevées sur le budget de l’État). Ce taux est de 10 % pour un professionnel libéral. Il dépasse 120 % pour les militaires.
Ce taux unique prévu pour le futur régime accompagnera de fait la suppression des mécanismes de compensation démographique qui existent à l’heure actuelle.
En matière de cotisation, il a été admis que les actifs ayant des revenus mensuels supérieurs à 10 000 euros bruts continueraient à cotiser au-delà de ce montant sans se constituer de nouveaux droits. Cela aboutit à introduire un mécanisme de redistribution fiscale dans le système par points. Cette mesure pénalisera les cadres supérieurs.
La gouvernance
Jean-Paul Delevoye a indiqué que le futur régime donnerait lieu à la création d’un établissement public à gestion paritaire. Cet établissement pourrait être adossé à la Caisse des dépôts et consignations.
III. LES ÉQUATIONS A RÉSOUDRE
La question sensible de l’âge de départ à la retraite
Initialement, le Président de la République souhaitait la suppression des durées de cotisations et permettre à tout à chacun de prendre librement sa retraite. Compte tenu de l’inclinaison naturelle des Français, le risque d’un grand nombre de départs précoces est à craindre. Il en résulterait un déséquilibre financier avec en outre un problème de niveau de vie pour les retraités qui auraient accumulé peu de points.
Pour contrarier ce risque, plusieurs propositions ont été émises mais aucune n’a reçu l’assentiment des partenaires sociaux. L’opinion publique reste pour le moment opposée à un report de l’âge de départ à la retraite.
79 % des Français considèrent qu’il faut maintenir la retraite à 62 ans voire revenir à 60 ans. 41 % des Français pensent qu’il est possible de revenir à la retraite à 60 ans. Ce sentiment est partagé par 59 % des employés et 57 % des ouvriers. 59 % des actifs âgés de 35 à 49 ans pensent de même. Seuls 21 % des sondés estiment qu’il est nécessaire de faire progressivement évoluer l’âge légal de départ à la retraite vers 65 ans. Ce report n’est accepté que par les actifs qui traditionnellement partent déjà au-delà de 62 ans à la retraite (les cadres, les indépendants, les professions libérales).
La problématique du passage d’un système à l’autre
Le Gouvernement devra fixer les règles de transition d’un système à un autre. Si pour les actuels retraités, le basculement ne devrait pas avoir d’incidences, tel ne serait pas le cas pour les actifs.
Pour les actuels actifs concernés par la réforme, un dispositif de transfert devra être adopté permettant de convertir leurs droits à retraite et donc garantir un certain montant de pension compte tenu de la carrière professionnelle passée. Plusieurs options sont possibles. Les pouvoirs publics pourraient réaliser une photographie des droits accumulés au moment du transfert et faire une conversion en points. Il y aurait aussi la possibilité au moment de la liquidation de calculer deux pensions, une en vertu des règles passées et l’autre constituée à partir des points accumulés. Moins probable, il serait possible de faire une attribution de points au regard des rémunérations perçues avant l’entrée en vigueur de la réforme. Quelle que soit la méthode choisie, il y aura obligatoirement des gagnants et des perdants qu’il faudra le cas échéant indemniser.
Les questions de solidarité à résoudre
L’article 4 de la loi de 2003 prévoit que « la Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance ». En 2018, ce taux est de 78 % pour les salariés au SMIC. Il est en moyenne de 61 % (chiffres OCDE – 2016). Dans un système par points, la pension ne sera plus proportionnelle aux revenus d’activité. De ce fait, pour garantir un taux de remplacement supérieur aux actifs à faibles revenus, des mécanismes de solidarité seront nécessaires. Ils devront être financés certainement par l’impôt.
La question de la réversion devra être également abordée. Aujourd’hui, les pensions de réversion essentiellement touchées par les veuves représentent 34 milliards d’euros. Les règles d’attribution diffèrent d’un régime à l’autre. Le choix des nouvelles règles ne sera pas sans incidence sur le niveau de vie des veufs et des veuves.
Le Gouvernement a prévu de changer les modalités d’octroi des majorations pour enfants. Elles seraient accordées dès le premier enfant. La question de leur financement sera à trancher. Il en est de même avec celles liées à la prise en compte des périodes de chômage, de congés maternité, etc. Il faudra également fixer les règles applicables pour les retraites des handicapés.
Le devenir des réserves des caisses de retraite
Les régimes de retraite par répartition disposent de 137 milliards d’euros de réserves qui font l’objet d’un débat concernant leur éventuelle dévolution avec la mise en œuvre du futur régime universel de retraite. À ces réserves, il faut ajouter celles du Fonds de réserve des retraites (36,4 milliards d’euros) et celles des régimes par capitalisation obligatoires (RAFP : 22,4 milliards d’euros, CAVP : 5,8 milliards d’euros). La dévolution de ces réserves sera un des enjeux de la réforme. Serviront-elles à indemniser les perdants ou pourront-elles être conservées par les caisses quand bien même ces dernières auront perdu leur mission de délivrer des pensions. Pourront-elles alors être affectés à de futurs produits d’épargne retraite ?
En guise de conclusion, la question de l’équilibre et l’essor des suppléments de retraite
L’instauration d’un régime dit universel ne résout pas les problèmes de financement soulignés récemment par le Conseil d’Orientation des Retraites et le Comité de Suivi des Retraites. L’augmentation du nombre de retraités et la stagnation de la population active dans un contexte de faible croissance posent le problème de l’évolution du pouvoir d’achat des retraités. Certes, le système par points sera par nature plus facile à gérer que celui actuellement en vigueur en jouant sur le montant d’achat et de rachat, mais, ce système pourrait aboutir, pour certaines catégories de la population, à des pensions plus faibles comme cela a été constaté en Allemagne ou en Suède.
Pour les cadres et en particulier les cadres supérieurs, le maintien d’un niveau de vie correct à la retraite passera sans nul doute par l’adhésion à des suppléments d’épargne retraite qu’ils soient collectifs ou individuels. Cette réforme pourrait relancer l’idée d’accord de branche sur l’épargne retraite.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
Les Français épargnent toujours plus
Pour quelles raisons les Français préfèrent épargner plutôt que de consommer. Le Figaro cite Le Cercle de l’Épargne dans cet article consacré à cette question.
Les Français continuent à mettre de l’argent de côté
Les motivations des Français pour épargner décryptées dans Mieux Vivre Votre Argent qui reprend dans cet article les analyses formulées par les équipes du Cercle.
Les retraités, leur retraite et l’avenir des régimes
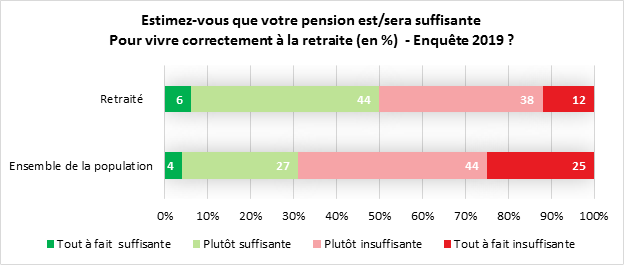
La France compte 16,3 millions de retraités en 2018. À horizon 2070, leur poids dans la population totale devrait fortement progresser pour s’établir à 24,5 millions. Dans le même temps, le nombre de cotisants qui devront assumer la prise en charge de notre régime par répartition augmenterait de manière plus modeste, passant ainsi de 28,3 millions aujourd’hui à près de 31 millions en 2070. Alors que dans ses dernières projections, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) reporte sine die l’équilibre des régimes et que les pouvoirs publics planchent sur une réforme d’envergure, cette étude s’intéresse au regard que portent les retraités sur leur situation actuelle et future. Réalisée à partir des résultats de l’enquête 2019 « Les Français, la retraite et l’épargne » du Cercle de l’Épargne et Amphitéa, cette étude tâche de mettre en avant les aspirations des retraités pour eux-mêmes et les générations à venir.
Au sommaire de cette étude
Les retraités, moins inquiets pour leurs pensions ?
Le retraité épargne d’abord par précaution puis… pour sa retraite !
Pour les retraités, la préparation de la retraite passe par la résidence principale et l’assurance vie
Réforme des retraites, les retraites favorables aux mesures qui permettront de préserver leur niveau de vie
Les retraités, leur retraite et la réforme
Paris, le 12 juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les retraités, leur retraite et la réforme
Une étude du Cercle de l’Épargne
Le Cercle de l’Epargne a, à partir des résultats de son enquête annuelle « Les Français, la retraite et l’épargne » réalisée avec le concours de l’association Amphitéa et AG2R LA MONDIALE, analysé les opinions des retraités vis-à-vis de leurs pensions, de leur évolution ainsi que leur appréciation de la future réforme des retraites prévue par l’actuelle gouvernement.
Des retraités moins inquiets en 2019 pour le pouvoir d’achat de leurs pensions
En 2018, en raison de l’augmentation du taux de CSG, 61 % des retraités estimaient que leurs pensions est insuffisante pour vivre correctement. En 2019, après les annonces du Président de la République, ce taux est revenu à 50 %. Ils sont plus optimistes que l’ensemble de la population française. En effet, pour 69 % des Français, les pensions sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement.
Des retraités plus enclins à conserver le système actuel de retraite que les actifs
27 % des retraités souhaitent le maintien du régime actuel de retraite quand ce taux est de 13 % pour les actifs. Même si le Gouvernement a annoncé que la future réforme des retraites ne modifierait en rien le calcul des pensions, les retraités sont sur la défensive. À la différence des actifs, ils sont plus favorables à l’instauration d’un régime universel pur, 38 % contre 35 %. Les actifs préfèreraient un système universel avec prise en compte de certaines spécificités (52 % quand seulement 35 % des retraités optent pour ce système). Les retraités craignent que la mise en place de dispositifs dérogatoires aboutissent à éroder le pouvoir d’achat de leurs retraites. Par ailleurs, ils ne sont pas, par définition, concernés par d’éventuels dispositifs de départ anticipé à la retraite qui pourraient être introduits dans le futur régime.
Les retraités moins hostiles que l’ensemble des Français au report de l’âge de la retraite
38 % des retraités sont favorables à un report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans quand cette option ne reçoit l’assentiment que de 15 % des actifs.
24 % des retraités jugent encore nécessaire d’épargner pour leur retraite
Comme l’ensemble des Français, les retraités épargnent d’abord par précaution. Ils sont en moyenne 38 % à déclarer le faire dans ce but contre 40 % parmi les actifs et l’ensemble de la population. Cependant l’épargne en vue de la retraite reste un enjeu prioritaire pour un retraité sur quatre et devance l’épargne destinée à soutenir ses descendants ou transmettre du patrimoine à sa famille.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Les Français sont toujours aussi attirés par l’épargne
L’épargne de précaution bat son plein en période d’incertitudes économiques. Retrouvez dans 20 Minutes, les raisons du niveau élevé de l’épargne en France, avec les explications du Directeur du Cercle, Philippe Crevel.
L’éternelle tentation budgétaire
Retrouvez la tribune de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne dans le Cercle des Échos. Un appel à la mesure contre les tentations d’accroître la dépense publique.
Plus-value comment vendre sa résidence secondaire sans payer d’impôts
Comment bénéficier d’une exonération des plus-values sur la vente d’un logement qui n’est pas sa résidence principale ?
Une personne qui n’est pas propriétaire de sa résidence principale et qui décide de vendre un bien immobilier à usage locatif, un bien vacant ou une résidence secondaire peut bénéficier d’une exonération fiscale des plus-values. Malgré tout, le contribuable doit respecter deux conditions qui ont été fixées par l’article 5 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit réemployer le montant de la vente pour acheter ou construire son habitation principale dans un délai de 24 mois à compter de la cession.
Ne pas être propriétaire de sa résidence principale lors des quatre dernières années précédant la cession
Cette exonération ne peut jouer que si le cédant n’est pas propriétaire de sa résidence principale au jour de la cession, y compris par l’intermédiaire d’une société qu’il détient directement ou indirectement ou l’a été à un moment quelconque au cours des quatre années qui précèdent la cession. La détention d’un droit démembré ou d’un droit indivis sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à le priver du bénéfice de l’exonération.
Le respect de cette condition s’apprécie au niveau du cédant personne physique. En revanche, si au sein d’un couple marié, l’un des époux détient ou a détenu comme bien propre, au cours des quatre années précédant la cession, la résidence principale du couple, ce n’est pas de nature à priver l’autre époux du bénéfice de l’exonération, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies.
Qu’est-ce qu’une résidence principale ?
La résidence principale correspond au logement où résident habituellement les membres du foyer pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit du lieu où ils résident effectivement sur le plan fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation.
Quand un des membres du foyer fiscal est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue en principe sa résidence principale. Quand le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale du foyer. Dans ces situations, la notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l’administration apprécie strictement sous le contrôle du juge de l’impôt.
Ne pas être propriétaire depuis au moins quatre ans !
Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire, directement ou par personne interposée, de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. Ce délai peut être atténué en cas d’achat d’une résidence principale à crédit et nécessitant la vente de la résidence secondaire.
L’exonération s’applique aux seules cessions de logements ou de droits réels démembrés portant sur un logement (usufruit, nue-propriété). Un immeuble précédemment affecté à un usage professionnel, puis transformé pour être cédé comme logement, entre dans le champ de l’exonération. Il est également admis que l’exonération ne s’applique, lorsque le bien cédé est affecté pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage professionnel, mais qu’à la seule la fraction de la plus-value afférente à la cession de la partie à usage d’habitation.
Les terrains à bâtir, les locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal ne peuvent pas bénéficier de l’exonération tout comme les cessions de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).
Pour les ventes en viager, une partie du prix est payée comptant (« bouquet »), l’autre partie est versée progressivement par le débirentier au crédirentier, sa vie durant, sous la forme d’une rente viagère. L’aléa inhérent à la nature même du contrat ne permet pas de connaître, au jour de la cession, le montant que percevra effectivement le cédant en contrepartie de la vente du logement. Par suite, dans le cadre d’une vente en viager d’un immeuble (« viager immobilier »), le remploi ne peut porter que sur le « bouquet ».
Une seule cession exonérée acceptée
Un contribuable ne peut bénéficier que d’une seule exonération au titre de la cession d’un logement. La date de référence à prendre en compte étant le 1er février 2012, les ventes de logements ayant eu lieu avant cette date ne sont pas prises en considération. L’exonération n’est pas automatique. Elle s’effectue sur demande. Le cédant doit en faire mention dans l’acte de cession.
La condition de réemploi
Le contribuable est tenu de remployer, dans un délai de vingt-quatre mois, tout ou partie du prix de cession du logement à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte à sa résidence principale.
Le remploi peut prendre la forme d’une opération à titre onéreux (vente, licitation, échange ou partage qui donne lieu au versement d’une soulte) ou d’une opération à titre gratuit (paiement de droits d’enregistrement au titre d’une donation ou d’une succession) dès lors que les droits d’enregistrement sont relatifs à un logement reçu en pleine propriété par donation ou succession.
L’exonération s’applique uniquement quand le prix de cession est remployé à l’acquisition ou la construction d’un logement en pleine propriété. Il est admis que le remploi peut être effectué dans l’acquisition de parts de sociétés dotées de la transparence fiscale dès lors que les associés de ces sociétés sont réputés être directement propriétaires du logement correspondant à leurs droits dans la société.
L’exonération ne s’applique pas lorsque le prix de cession est affecté à l’acquisition de droits relatifs à un immeuble, qui s’entendent de ceux résultant notamment du démembrement de la propriété (nue-propriété et usufruit).
Le délai de remploi est calculé de date à date à partir de la date de la cession. La condition de remploi de tout ou partie du prix de cession est réalisée dès lors que le contribuable acquiert ou construit, dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, un logement.
Il peut s’agir indifféremment d’une acquisition portant sur :
- Un logement neuf achevé ou en l’état futur d’achèvement (VEFA) ;
- Un logement en état futur de rénovation, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) ;
- Un logement ancien.
Les travaux sont pris en compte à la condition d’être réalisés concomitamment à l’acquisition du logement. Sont considérés comme tels les travaux qui sont achevés et payés dans les douze mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du logement. Il peut s’agir de travaux d’amélioration ou d’agrandissement.
Le remploi peut également porter indifféremment sur l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un logement et les dépenses de construction de celui-ci.
Le cédant, bénéficiaire de l’exonération, doit être en mesure de justifier, au plus tard au terme du délai de vingt-quatre mois à compter de la date de cession, du remploi effectif de tout ou partie du prix de cession au titre duquel il a demandé à bénéficier de l’exonération.
Affectation du bien acquis en résidence principale
L’affectation à la résidence principale doit en principe intervenir dès l’acquisition du logement ou dès l’achèvement de la construction ou des travaux de transformation. Par exception, en cas d’acquisition d’un logement suivie de travaux, et pour tenir compte du délai de réalisation de ces travaux il est admis que l’affectation à la résidence principale soit différée au maximum de douze mois après l’acquisition du logement. De même, en cas d’acquisition d’un immeuble transformé en logement, et pour tenir compte là encore du délai de réalisation des travaux, il est admis que l’affectation à la résidence principale soit différée au maximum de vingt-quatre mois après l’acquisition du logement.
Le cédant doit justifier que le logement, objet du remploi, a constitué sa résidence habituelle et effective mais il n’a aucune durée minimale de conservation et d’affectation à la résidence principale. Il peut au bout de quelques mois décider de le louer, de le transformer en résidence secondaire ou de le vendre.
Calcul de l’exonération
La plus-value est exonérée à hauteur de la fraction du prix de cession remployée par le cédant à l’acquisition ou la construction de sa résidence principale. Ainsi, en cas de remploi partiel, la plus-value est exonérée à hauteur de la proportion du montant du remploi dans le prix de cession. Au jour de la cession, le cédant doit évaluer la fraction du prix de cession qu’il destine à l’acquisition ou la construction de sa résidence principale.
En cas d’indivision, le respect des conditions d’application de l’exonération s’apprécie au niveau de chaque indivisaire. Ainsi, chaque coïndivisaire peut bénéficier individuellement de l’exonération pour la plus-value qui lui revient en fonction de sa quote-part.
Lorsque la cession porte sur un bien commun dont les époux sont co-cédants, les conditions d’application de l’exonération sont appréciées distinctement pour chacun des époux.
Au plus tard à l’expiration du délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, délai éventuellement prorogé en cas de réalisation de travaux, le contribuable doit être en mesure de justifier d’un remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale, pour un montant équivalant à la fraction du prix de cession dont il a demandé le remploi. À défaut, une régularisation doit être opérée.
État des lieux de l’épargne-retraite avant déménagement
D’ici la fin de l’année, l’épargne-retraite sera soumise à de nouvelles règles. Ce changement est le plus important depuis la création en 2003 du PERP et du PERCO. Le Gouvernement a, à travers la loi PACTE, décidé de restructurer l’ensemble de la législation en instituant le Plan d’Épargne Retraite qui jouera le rôle d’enveloppe d’accueil de tous les produits existants. Dorénavant, l’épargne française sera structurée autour de plusieurs grands pôles : l’épargne réglementée, l’assurance vie, le Plan d’Épargne en Actions, les comptes titres et le Plan d’Épargne Retraite.
Au sommaire de cette étude
- La retraite supplémentaire, une niche à fort potentiel
- Plus de 13 millions d’adhérents
- Les cotisations augmentent lentement
- Les indépendants cotisent le plus
- Les cotisations inférieures à 2 000 euros par an sont majoritaires
- Un rajeunissement en cours des effectifs
- Les produits d’épargne-retraite, avant tout souscrits par les hommes
- 2,23 millions de bénéficiaires de l’épargne-retraite
- Près de 12 % des retraités bénéficient d’une rente issue d’un produit d’épargne-retraite
- Les prestations suivent le cours du vieillissement de la population
- La rente moyenne est de 2 336 euros par an
- Les produits collectifs offrent les rentes les plus élevées
- Des bénéficiaires âgées
- Les hommes surreprésentés parmi les bénéficiaires
- La réversion varie de 5 à 23 % en fonction des produits
Retraite, Madame la Marquise, tout va très bien…
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a publié, au mois de juin, son rapport annuel avec à la clef l’annonce d’une résorption plus tardive du déficit des régimes de retraite. Le retour à l’équilibre ne devrait pas intervenir avant 2042 voire plus certainement pas avant 2056 ou 2070… Les conclusions des rapports du COR obéissent à des cycles. Elles peuvent être soit optimistes quand aucune réforme ne s’annonce ou pessimistes quand les pouvoirs publics entendent modifier les règles de l’assurance vieillesse. Ces dernières années, avec la reprise économique et après l’adoption de mesures fortes (relèvement de l’âge de départ, augmentation des cotisations, dispositions concernant la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO), l’idée que les régimes de retraite étaient placés sur une bonne trajectoire s’était imposée. Hors Fonds de Solidarité Vieillesse, de légers excédents sont apparus en 2018. Le COR était accusé par un nombre négligeable d’experts de faire preuve d’un optimisme béat. Les prévisions de croissance étaient jugées irréalistes et faussant, de fait les résultats proposés. L’engagement du chantier du régime universel semble avoir changé la donne. Tout en conservant des hypothèses de croissance de la productivité optimistes s’étageant de 1 à 1,8 %, les comptes apparaissent moins florissants que prévu avec un retour du déficit à compter de 2020. Par ailleurs, mais cela n’était pas occulté dans les précédents rapports, le taux de remplacement ainsi que le pouvoir d’achat relatif des retraités seront amenés à se contracter, de manière substantielle dans les prochaines années.
Des hypothèses démographiques moins porteuses
Moins d’enfants
Le Conseil d’Orientation des Retraites constate que depuis le début de l’actuelle décennie le taux de fécondité en France est orienté à la baisse. Il est passé de 2,03 à 1,87 de 2010 à 2018. Il demeure néanmoins supérieur à son niveau de 1994 (1,68). Le nombre de naissances baisse en liaison également avec la diminution du nombre de femmes en âge de procréer. Le phénomène de rattrapage, lié au recul de l’âge d’arrivée des enfants, touche à son terme. Par ailleurs, ce sont des générations peu nombreuses des années 90 qui arrivent à l’âge d’avoir des enfants. Le nombre de naissances a été de 758 000 en 2018 contre 833 000 en 2010. Le COR retient les prévisions de l’INSEE avec une fécondité restant comprise entre 1,8 et 2,1. Du fait de l’alignement du taux de fécondité de la population immigrée sur celui de la population de souche, la baisse du taux de fécondité peut se poursuivre d’autant plus que les conditions économiques ne s’améliorent que lentement.
Moins d’immigrés
L’immigration tend à ralentir en France. En 2007 et 2018, le flux migratoire annuel (différence des entrées et des sorties du territoire) n’est que de 58 000 contre 100 000 entre 2001 et 2006. Cette réduction a des incidences sur l’évolution de la population active et donc sur les cotisations sociales. Le COR retient pour les prochaines années, un flux positif de 70 000.
Des gains d’espérance de vie moins rapides que précédemment
En matière de retraite, ce qui compte, c’est en grande partie l’espérance de vie des personnes de plus de 60 ans. Avant 2014, elle augmentait de 1,5 à 2 ans par décennie. Depuis 2014, elle progresse de 0,4 an par décennie pour les femmes et de 0,8 an pour les hommes. En 2018, l’espérance de vie pour les hommes à 60 ans est de 23,2 ans, pour les femmes de 27,6 ans. Compte tenu des projections retenues, l’espérance de vie pour les hommes à 60 ans serait de 26,7 ans en 2040 et de 31 ans en 2070. Pour les femmes, les valeurs respectives sont 30,1 et 33,6 ans. Calculée par génération, l’espérance de vie des hommes et des femmes nés en 1960 serait de 28 ans à 60 ans.
Un nombre croissant de retraités
Du fait de la composition de la population active, le nombre de personnes pouvant liquider leurs droits à pension continue à augmenter à grande vitesse. Il passera de 300 000 pour les générations nées avant la Seconde Guerre mondiale à 900 000 pour les générations nées entre 1964 et 1970. À partir de la génération de 1972, une décrue s’opérera, -120 000 en quatre ans, mais une remontée pour les générations des années 80 qui sont composées des enfants des baby-boomers et qui bénéficient d’un recul de la mortalité avant 60 ans.
Le rapport démographique des 20-59 ans par rapport aux plus de 60 ans est passé de 2,5 à 1,94 de 2006 à 2018. En 2070, il sera de 1,25. En prenant comme référence les 20-64 ans et les plus de 65 ans, le ratio passe de 3,5 en 2011 à 2,9 en 2018 et à 1,7 en 2070.
Des hypothèses économiques toujours critiquables
Le COR retient pour le long terme quatre scénarios de gains de productivité (+ 1 %, +1,3 %, +1,5 %, +1,8 %) associés à un taux de chômage de 7 %. Deux variantes de taux de chômage sont également retenues : celui de 4,5 % qui correspond au taux adopté lors du premier rapport du COR et un taux plus pessimiste de 10 % à l’horizon 2070.
Pour le court terme, le COR a admis que le taux de croissance entre 2019 et 2022 pourrait être inférieur aux prévisions retenues en 2018, ce qui aura une incidence sur les comptes.
Pour la productivité, le COR admet que les gains actuels sont en deçà de ses projections passées mais qu’ils ont été marqués par les crises de 2008 et de 2012. Les auteurs du rapport estiment que le scénario central s’appuyant sur des gains de 1,3 % est crédible. Le COR admet que le taux de chômage de 7 % constitue un point bas non atteint depuis plus de 10 ans.
Pour expliquer une partie de la dérive financière des régimes de retraite, le COR met en avant le fait que la rémunération des fonctionnaires est constituée de plus en plus par des primes qui ne sont très faiblement soumises à cotisations. En effet, pour l’ensemble des fonctionnaires d’État, le poids des primes dans la rémunération totale est passé de 18 à 20 % de 2009 à 2016. Pour les cadres A +, ce taux atteint plus de 42 %. Pour les personnels des fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce taux est de 21,4 %. La poursuite de ce processus réduit le montant des cotisations et donc pèse négativement sur l’équilibre des régimes de retraite. Un des enjeux de la réforme du régime universel est d’intégrer notamment les primes des fonctionnaires dans l’assiette des cotisations.
Les taux d’activité et d’emploi à améliorer
En 2018, la population active française comptait 29,8 millions de personnes. Elle s’est accrue de 172 000 par an de 1975 à 2018, soit +0,7 %. Entre 2018 et 2040, elle devrait augmenter de 60 700 par an puis de 22 500 par an entre 2041 et 2055. La population active française s’élèverait à 32,1 millions en 2070. Le taux d’activité était de 55,8 % en 2018.
La France, du fait des réformes mises en œuvre ces dernières années, connaît une forte progression du taux d’activité des seniors. Pour les 55/59 ans, il a progressé de 30 points entre 1978 et 2018 en atteignant 73,6 %. D’ici 2070, il devrait s’élever à 77 %. Entre 60 et 64 ans, ce taux est de 33 %. Le COR estime qu’il pourrait passer à 62 % pour les femmes et à 71 % pour les hommes d’ici 2070. Entre 65 et 69 ans, le taux d’activité en 2070 pourrait retrouver son niveau de 1975, 13 % pour les femmes et 20 % pour les hommes.
De son côté, le taux d’emploi des seniors est également en forte progression. Il est, pour les 55-59 ans, de 72,1 % en 2018 contre 48,9 % en 2000. Pour les 60-64 ans, il a augmenté de 20 points en 18 ans pour s’établir à 32 %. Le taux d’emploi des 65-69 ans est, en revanche, assez stable à 6 %.
À l’âge de 60 ans, près de 28 % des personnes ne sont ni en emploi, ni à la retraite. 7 % sont au chômage et 21 % sont inactives en ayant arrêté de chercher un emploi. Plus de 11 % des personnes âgées de 60 ans sont inactives depuis 10 ans.
Les âges de départ à la retraite
Dans le secteur privé, l’âge effectif de départ à la retraite a constamment baissé de 1963 à 2008, passant de 64 à 61 ans avant de remonter à 62,5 ans en 2017. Du fait des dispositifs de carrière longue, 11 % des femmes et 23 % des hommes peuvent partir à la retraite à 60 ans. Les générations 1945/1955 sont celles qui ont pu partir le plus tôt à la retraite. Ainsi, 22 % des membres de la génération 1949 sont partis avant 60 ans. Ce taux est de près de 33 % pour les hommes. Du fait du durcissement de la législation, ce taux est tombé à moins de 9 % pour la génération 1957.
Les pensions de droit direct : plus de 88 % des pensions versées
En 2016, le système de retraite, hors capitalisation, a versé pour 303,7 milliards d’euros de pensions dont 269 en droit direct (y compris majorations pour trois enfants et plus). 34,4 milliards d’euros ont été versés au titre des pensions de réversion. Les dispositifs de solidarité dont le minimum vieillesse ont représenté 54,9 milliards d’euros soit 20,4 % de l’ensemble des pensions.
Le financement des régimes de retraite
80 % des ressources des régimes de retraite proviennent des cotisations sociales, soit 262 milliards d’euros. 11 % sont issues des impôts et taxes. Les autres ressources sont les subventions, les transferts des autres régimes de sécurité sociale et le recours à l’emprunt.
137 milliards d’euros de réserves
Les régimes de retraite par répartition disposent de 137 milliards d’euros de réserves qui font l’objet d’un débat concernant leur éventuelle dévolution avec la mise en œuvre du futur régime universel de retraite. À ces réserves, il faut ajouter celles du Fonds de réserve des retraites (36,4 milliards d’euros) et celle des régimes par capitalisation obligatoires (RAFP : 22,4 milliards d’euros ; CAVP : 5,8 milliards d’euros).
|
Réserves des régimes par répartition |
En milliards d’euros |
En mois de prestations |
| CNAVPL | 1,7 | 14 |
| CNBF | 0,6 | 49 |
| Total régimes de base | 2,4 | |
| BDF | 5,7 | 145 |
| CNRACL | 2,2 | 1 |
| CRPCEN | 0,5 | 7 |
| Sous total régimes intégrés | 8,4 | |
| AGIRC/ARRCO | 70,8 | 11 |
| IRCANTEC | 8,5 | 35 |
| MSA complémentaire | 0,1 | 1 |
| RCI | 17,4 | 108 |
| CNAVPL complémentaire | 24,3 | 66 |
| CNBF complémentaire | 1,3 | 69 |
| CRPNPAC | 3,8 | 76 |
| Sous total régimes complémentaires | 126,1 | |
| Total réserves | 136,9 | |
| Réserves FRR | 36,4 | |
| Capitalisation obligatoire | ||
| Capitalisation RAFP | 22,4 | |
| Capitalisation CAVP | 5,8 |
Source : Cor – Cercle de l’Épargne
Les régimes de retraite concourent par leurs déficits à l’endettement des administrations sociales. La part de la dette qui leur imputable est de 46 milliards d’euros, soit 2 % du PIB. De ce fait, la situation patrimoniale nette hors prise en compte des régimes par capitalisation est de 127 milliards d’euros soit 5,6 % du PIB.
Les taux de cotisation légal et apparent aux régimes de retraite
En 2017, les taux de cotisation salarial et employeur sont de 27,5 % (sous plafond de la Sécurité sociale) pour un salarié non cadre et de 84,57 % pour un fonctionnaire civil de l’État. Ce taux est de 10 % pour un professionnel libéral. Afin de prendre en compte les situations démographiques des différents régimes, le COR calcule des taux de cotisation dits harmonisés. Le taux est alors de 24 % pour les salariés du privé, de 68 % pour les fonctionnaires d’État, de 110 % pour les militaires et de 12,8 % pour les professionnels libéraux.
Le retour à l’équilibre reporté
Compte tenu de l’évolution du nombre de retraités et du contexte économique, le besoin de financement du système de retraite a été évalué pour 2018 à 0,1 % du PIB, soit 2,9 milliards d’euros. De 2002 à 2018, les ressources ont augmenté de 1,7 point de PIB et les dépenses de 2,1 % du PIB. L’excédent des régimes de retraites a disparu en 2007. Le déficit s’est creusé jusqu’en 2010 pour se réduire jusqu’en 2018.
Jusqu’en 2022, le déficit serait cantonné à 0,4 % du PIB. Une dégradation interviendrait jusqu’en 2030 avec une amélioration après dans le cadre du scénario central avec une croissance de 1,5 %. Le retour à l’équilibre serait alors atteint en 2056. En cas de croissance de 1,8 %, l’annulation du déficit intervient plus tôt, en 2042. En revanche, si la croissance est de 1,3 %, le déficit pourrait atteindre 1 % ; sa disparition serait constatée en 2070. Si la croissance est de l’ordre de 1 %, il n’y a pas de retour programmé des excédents.
En moyenne, sur une période de 50 ans, seule une croissance de 1,8 % bien éloignée des standards actuels permettrait de dégager des excédents. Dans tous les autres, un déficit variant de 0,2 à 0,9 % du PIB serait constaté.
La hausse de l’âge de départ effectif à la retraite
Comme les années précédentes, de manière prudente, le COR souligne que la mesure la plus efficace pour juguler le déficit est le report de l’âge moyen de départ à la retraite. L’âge devrait atteindre près de 64 ans et 6 mois. À défaut, il faudrait relever les prélèvements de 0,6 point de PIB ou diminuer le montant global des pensions de 0,7 point de PIB.
Un niveau de vie élevé mais une baisse inévitable ?
Les pensions ne constituent qu’un élément du niveau de vie des retraités. Il faut prendre en compte les prestations sociales, les revenus du patrimoine et ceux du ménage quand un des membres est encore actif. En 2016, le niveau de vie moyen par unité de consommation est de 2 070 euros par mois. Après avoir progressé continûment des années 70 jusqu’en 2010, il s’est depuis stabilisé. Il est malgré tout supérieur à celui de l’ensemble de la population (105,6 %). Pour les hommes, il est de 8,5 % supérieur et pour les femmes de 3,3 %. En prenant en compte le fait qu’ils sont propriétaires à 75 % de leur logement, le niveau de vie effectif est encore plus élevé. L’INSEE estime que celui-ci est supérieur de 10,5 % à celui de l’ensemble de la population.
Selon les estimations du Conseil d’Orientation des Retraites en fonction des scénarii retenus, le niveau de vie des retraités s’établirait entre 91 et 96 % de celui de l’ensemble de la population en 2040 et entre 78 et 87 % en 2070.
L’évolution de la durée de la retraite
Pour mesurer l’efficacité d’un système de retraite, il faut prendre en compte la durée de service des pensions et la décomposition de la vie. Ainsi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la durée de la vie consacrée à la formation est assez stable, autour de 23 % de la durée totale de la vie, sachant que celle-ci s’est allongée de plusieurs années. La durée dévolue à l’activité professionnelle a fortement augmenté entre les générations nées dans les années 1940 et celles nées dans les années 1960 du fait de l’allongement de la durée de cotisation qui est passé de 37,5 à plus de 42 ans. La durée de la retraite qui a augmenté ces vingt dernières années du fait des départs à 60 ans et avant, s’est stabilisée autour de 29 %. Toutes choses égales par ailleurs, elle pourrait atteindre 32 % pour la génération 2000.
Le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites semble justifier l’adoption de mesures conjoncturelles avant même l’engagement de la réforme systémique. Le report de celle-ci, de quelques mois, obéit à des contraintes d’agenda parlementaire mais aussi à la nécessité pour le Gouvernement de renouer des liens avec les partenaires sociaux. Cela permettra également d’éviter un télescopage avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 qui pourrait comporter des mesures de rééquilibrage. Le Gouvernement devra vendre son projet d’âge pivot et le faire accepter par une opinion publique et des syndicats plutôt hostiles. Le projet de régime universel reste populaire du fait du message d’équité qu’il porte. En revanche, l’idée de travailler plus longtemps est loin de faire consensus. La discussion du projet de loi sur la réforme qui devrait intervenir au cours du premier semestre 2020, certainement après municipales, sera une opération délicate d’autant plus que nous entrerons de plain-pied dans la deuxième partie du quinquennat.
« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
L’édito de juillet de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne
Les régimes de retraite seront à l’équilibre en 2056 ou en 2070. Cette prévision émane du dernier rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). J’ai beaucoup de respect pour les membres de cette vénérable institution qui a comme mission d’étudier la soutenabilité financière de nos régimes de retraite. Leurs prévisions reposent sur des évolutions projetées du taux de chômage, de la productivité du travail, du nombre d’actifs, de l’immigration ou de l’âge de départ à la retraite. Le retour à bonne fortune est conditionné par un grand nombre de paramètres qui depuis des années se jouent avec malice du talent de nos meilleurs prévisionnistes. En effet, force est de constater que le taux de chômage qui devait revenir rapidement à 7 voire à 4,5 %, fait depuis des années de la résistance au-delà de 8 %. De même, la croissance ou la productivité qui devrait se situer autour de 1,5 % par an, tend à se dérober année après année. Par ailleurs, le taux de fécondité lui aussi est moins vaillant qu’escompté. Il est passé de 2010 à 2018 de 2,03 à 1,87. Au niveau de l’immigration, le nombre d’entrées nettes serait passé de 100 000 à 58 000 par an entre le début du siècle et maintenant. Même en matière d’espérance de vie, les prévisions deviennent hasardeuses. Les gains auraient été divisés par deux depuis l’an 2000. Les marges d’erreur sont donc importantes. Cela n’interdit pas pour autant de tenter de revenir à l’équilibre dans les meilleurs délais afin de ne pas laisser une charge supplémentaire aux générations futures.
Un temps, l’idée était de préempter la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) qui finance la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES), en charge de remboursement de la dette sociale et dont l’extinction était espérée dans les prochaines années afin de financer le surcroît de dépenses liées à la montée en puissance de la dépendance. Or, une petite musique de nuit se fait entendre comme quoi la CADES pourrait bien poursuivre son activité en faveur de la Sécurité Sociale et des régimes de retraite bien au-delà de 2024, année qui aurait dû voir, selon l’actuel Gouvernement, sa disparition. Avec un déficit qui ne sera effacé qu’après 2056 ou 2070, comment pourrait-il en être autrement ? Le CRDS est une dépouille courtisée avant même que l’avis de son décès ne soit publié. C’est surtout un prélèvement qui connaît d’importants gains d’espérance de vie. Il devait s’éteindre initialement en 2014 et a été prorogé, tout comme la CADES.
L’intérêt d’un rapport du COR ne réside pas dans ses projections qui seront obligatoirement remises en cause par les aléas de la conjoncture ou qui peuvent subir les affres des influences politiques. II témoigne de la persistance, d’année en année, des mêmes questions. Comment améliorer le taux d’emploi des seniors ? Comment garantir un niveau de vie correct pour les retraités dans les prochaines années ? Comment mettre en place un système pérenne et efficient pour la dépendance ? Ces points simples qui transparaissent à la lecture des écrits du COR attendent toujours une réponse. Il n’est pas garanti que le futur régime universel résolve ces problèmes. En effet, les tergiversations sur la notion d’âge de départ à la retraite ou sur le traitement des mécanismes de solidarité prouvent qu’en matière de retraite la route n’est pas très droite même si la pente est forte pour paraphraser Jean-Pierre Raffarin.
Retraite : cette nouvelle décision d’Edouard Philippe pourrait ne pas vous plaire
Dans Planet.fr, Philippe Crevel commente l’annonce du Premier ministre d’augmenter la durée de cotisation pour assurer l’équilibre de régimes de retraite.
L’exécutif cherche-t-il à enterrer la réforme des retraites ?
Dans Mieux Vivre Votre Argent, Philippe Crevel réagit aux annonces relatives à la réforme des retraites.
L’assurance vie assure sans forcer en mai
Paris, le 25 juin 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTAT DE L’ASSURANCE VIE – MAI 2019
L’ASSURANCE VIE ASSURE SANS FORCER
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
L’assurance vie a réalisé, au mois de mai, une cinquième collecte nette positive. Le gain est de 1,9 milliard d’euros. C’est malgré tout la plus faible collecte nette depuis le début de l’année. Elle est inférieure de 1,5 milliard d’euros à celle du mois d’avril 2019. Elle est, en revanche, assez proche de celle de l’année dernière (2,1 milliards d’euros). Lors de ces dix dernières années, la collecte nette du mois de mai a toujours été positive à l’exception de celle de 2012, année marquée par une forte décollecte.
Depuis le début de l’année, la collecte nette s’élève à 13,1 milliards d’euros soit 3,1 milliards d’euros de plus que sur la même période en 2018. Sur les cinq premiers mois de l’année, l’assurance vie dépasse légèrement le Livret A en matière de collecte (13,1 contre 11,06 milliards d’euros) même si les encours de ces deux produits ne sont pas comparables. L’encours de l’assurance vie s’élevait à la fin du mois de mai à 1739 milliards d’euros en hausse de 2 % en un an. L’encours du Livret A est de 294,9 milliards d’euros.
Le résultat en retrait de l’assurance vie en mai est imputable à un recul de la collecte brute qui est passée de 12,9 à 11,6 milliards d’euros. C’est la première fois depuis le mois de décembre dernier que cette collecte passe en-dessous de la barre des 12 milliards d’euros. La collecte en unités de compte a atteint, de son côté, 2,9 milliards d’euros soit 25 % de la collecte totale, en léger progrès par rapport aux mois précédents mais elle reste toujours inférieure à la moyenne de 2018 (28 %).
Les prestations et les rachats sont assez stables à 9,7 milliards d’euros en progression de 200 millions par rapport au mois d’avril.
Les ménages français semblent toujours mus par une grande prudence comme en témoigne les bons résultats du Livret A et des fonds euros de l’assurance vie qui captent 75 % de la collecte de cette dernière. Dans une période d’incertitudes, l’arbitrage s’effectue en faveur de la liquidité et de la sécurité.
Depuis le début de l’année, les Français ont privilégié l’épargne à la consommation. Au cours du mois de mai, une légère inflexion semble se dessiner mais elle ne remet pas encore en cause la tendance lourde de ces derniers mois. Mai est un mois charnière avec la préparation des vacances d’été et l’engagement de travaux au niveau de l’habitation ainsi que la réalisation d’achats durables. Le nombre de véhicules livrés était en hausse de 1,2 % au mois de mai 2019 par rapport à mai 2018. L’effet des mesures de soutien du pouvoir d’achat décidées à la fin de l’année dernière s’estompe, ce qui peut également expliquer la moindre collecte brute.
À l’image des années précédentes, la collecte nette de l’assurance vie et du Livret A devrait être moindre au cours du second semestre sans pour autant effacer les bons résultats du premier. En fin d’année, les ménages doivent faire face à un cycle de dépenses plus importants : vacances, rentrée scolaires, fêtes de fin d’année. Par ailleurs, les déménagements ont essentiellement lieu de fin juin à fin octobre.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Le Livret A, un succès sur fond d’inquiétude
Paris, le 21 juin 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTAT DU LIVRET A
Mai 2019
Le Livret A, un succès sur fond d’inquiétude
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le Livret A n’en finit pas d’enregistrer des collectes importantes en cette année 2019. Pour le mois de mai, elle a atteint 1,22 milliard d’euros soit deux fois plus qu’un an plus tôt, en mai 2018. Avec le Livret de Développement Durable, la collecte atteint même 1,61 milliard d’euros. L’encours du Livret A bat un nouveau record au mois de mai avec 294,9 milliards d’euros. En y ajoutant le LDDS, l’encours est de 405,2 milliards d’euros.
Le résultat du mois de mai même s’il est en retrait par rapport à celui d’avril reste exceptionnel. Lors de ces dix dernières années, quatre décollectes avaient été enregistrées en mai. Le cinquième mois de l’année était jusqu’à maintenant une charnière. Avec la proximité des vacances, les ménages commençaient, à la fin du printemps, à ralentir leur effort d’épargne. Les années précédentes, les impôts expliquaient également, par le jeu des tiers provisionnels, le reflux de l’épargne à compter de mai, ce qui n’est plus le cas avec l’instauration de la retenue à la source.
Depuis le début de l’année, les ménages français continuent d’arbitrer en faveur de l’épargne leurs gains de pouvoir d’achat. Les revenus sont en hausse du fait de la mise en œuvre de plusieurs mesures de soutien annoncées au mois de décembre dernier par le Président de la République (prime exceptionnelle défiscalisée, la baisse de la CSG pour les retraités, revalorisation de certaines prestations sociales). Sur l’ensemble de l’année, les gains de pouvoir d’achat sont évalués à 2,1 %, soit le plus fort gain depuis 2007. Ces derniers sont également liés au repli de l’inflation qui est revenue de 2 à 1 % en quelques mois.
Cette préférence pour l’épargne s’explique par un niveau de confiance relativement faible. Même si l’indicateur de l’INSEE qui mesure la confiance des ménages était en hausse au mois de mai, il reste, et cela depuis un an, en-dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages doutent de la réalité de l’amélioration de leur situation financière et surtout de sa durabilité. Ils anticipent une détérioration de la situation. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ainsi qu’avec l’Iran peuvent justifier la prudence des ménages. Par ailleurs, l’idée d’une prochaine récession a été évoquée à plusieurs reprises. L’impact des incertitudes et des annonces pessimistes peuvent aboutir à une autoréalisation de la crise. Il n’est donc pas étonnant que le taux d’épargne soit passé de 13,7 à 15,3 % du revenu disponible brut du 1er trimestre 2018 au premier trimestre 2019.
Le Livret A ne pâtit pas de son faible rendement qui reste en valeur réelle, une fois l’inflation prise en compte, négatif. Compte tenu de la baisse des taux sur le marché obligataire, son rendement peut apparaître néanmoins élevé pour un placement de court terme bénéficiant d’une garantie en capital. Le taux de l’emprunt d’État à 10 ans a été négatif pour la première fois de son histoire mardi 18 juin.
Avec l’amélioration de l’emploi et la persistance des gains de pouvoir d’achat, l’INSEE table sur une reprise franche de la consommation au second semestre devant amener une baisse en parallèle de l’épargne. Pour le moment, peu d’indices indiquent que les ménages soient prêts à infléchir leur comportement empreint de prudence et de méfiance tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de la situation économique.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Retraite des salariés impatriés : la dispense temporaire d’affiliation à l’assurance précisée par décret
Par décret, l’executif explicite les règles de mise en oeuvre du
du dispositif d’exonération temporaire (3 ans, renouvelable une fois) des cotisations de l’assurance vieillesse de base et complémentaire pour les salariés impatriés en France.
Pour pouvoir entrée en vigueur, la mesure prévue dans le décret publié au journal officiel le 18 juin 2019 doit donner lieu à la publication d’un arrêté ministériel qui présentera le modèle de la demande d’exmption.
Qui peut bénéficier du dispositif ?
Pour se prévaloir de ces mesures d’exonération temporaires de cotisations retraites les personnes remplissant les conditions suivantes:
- Être appelé(e) de l’étranger à occuper un emploi en France depuis le 11 juillet 2018.
- Ne pas avoir été affilié(e) au cours des cinq (5) années civiles précédant la prise de fonction, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse (sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à la présence en France pour y suivre des études).
- Justifier d’une contribution minimale de 20 000 euros par an à un régime d’assurance retraite français (privé) ou étranger (public ou privé) prévoyant le versement d’une rente ou d’un capital conditionné par le départ à la retraite (sauf cas exceptionnels de versement avant le départ à la retraite prévus par le produit d’assurance vieillesse concerné).
Crédit immo et épargne : les conséquences sur vos finances des taux négatifs de la France
La France emprunte à taux négatifs à 10 ans. Une situation exceptionnelle qui n’est pas sans conséquences pour les épargnants. Citant Philippe Crevel, cBanque revient sur les répercussions de cette nouvelle donne économique.
Les questions que posent les taux négatifs
Quels impacts ont les taux négatifs pour les entreprises, les banques et les épargnants ? Alors que le taux à 10 ans de la France est passé sous 0 %, Philippe Crevel évoque dans les Echos l’incidence des taux négatifs sur les produits de taux.
Amphitéa magazine N°110 – Juin 2019
Au sommaire de ce numéro retrouvez :
ÉDITO
- L’édito d’Yvan Stolarczuk, directeur d’AMPHITÉA
ZOOM
- Une nouvelle communication pour AMPHITÉA
PANORAMA
- Protection sociale : le casse-tête français
- C’est quoi la protection sociale ?
- Un modèle social qui doit évoluer avec son temps
- Retraites : vers un système mixte combinant répartition et capitalisation
- Rencontre avec Jean-Marie Spaeth, membre du conseil scientifique du Cercle de l’Épargne
INTERVIEW
- Jean-Claude Barboul, président de l’Agirc-Arrco
- Rencontre avec Philippe Georges, membre du conseil scientifique du Cercle de l’Épargne
- Dépendance : pourquoi pas l’assurance obligatoire ?
EN PRATIQUE
- Audit de protection sociale : objectif sérénité
- Quatre adhérents d’AMPHITÉA témoignent
- Rencontre avec Philippe Dabat, membre du comité de direction d’AG2R LA MONDIALE
ZOOM
- Un défi particulier pour les Outre-mer
À DÉCOUVRIR SUR AMPHITÉA.COM
- Questions à Jean-Claude Fluhr, président de la protection sociale européenne
- Comment lire son bulletin de salaire ?
- Enquête 2019 “Les Français, la retraite
et l’épargne”
Les travailleurs indépendants pour le régime universel et la capitalisation
Paris, le 18 juin 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
POUR LE RÉGIME UNIVERSEL ET LA CAPITALISATION
Une étude du Cercle de l’Épargne
Artisans, commerçants, professions libérales, entrepreneurs individuels ou gérants majoritaires de société, portent en raison de la spécificité de leurs activités un regard différencié sur notre système de protection sociale. À partir de l’examen des résultats de l’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa « Les Français, la retraite et l’épargne », les équipes du Cercle décryptent dans une étude consacrée aux indépendants, les attentes des 2,87 millions de travailleurs non-salariés en matière de retraite.
Les indépendants inquiets face à l’évolution des retraites
Les travailleurs indépendants, partagent avec le reste de la population la crainte de ne pas disposer d’une pension suffisante pour vivre correctement à la retraite. Ils sont ainsi 77 % à considérer que leur pension est ou sera insuffisante contre 69 % en moyenne en France. Chez les artisans et les commerçants le taux d’insatisfaction grimpe même à 84 % dont 45 % de très insatisfaits. De fait, le montant moyen de la pension de droit direct (y compris majoration pour enfants) d’un commerçant (490 euros) ou un artisan (700 euros) est nettement plus faible que celui d’un salarié du régime général (1 390 euros) ou d’un professionnel libéral (1 970 euros).
Les indépendants favorables au report de l’âge de départ à la retraite
En moyenne, les indépendants partent plus tard à la retraite que la moyenne des Français. En 2017, l’âge moyen de liquidation des droits à la retraite est de 62,6 chez les artisans et de 63,5 ans chez les commerçants et 64,8 ans chez les professions libérales quand il est de 62,5 ans pour les salariés du privé. Cette situation les conduit à ne pas être hostiles à un report de l’âge de départ à la retraite. 56 % sont prêts à travailler à plein temps jusqu’à 65 ans ou à travailler jusqu’à 67 ans mais à temps partiel les trois dernières années. Malgré tout ils éprouvent tout comme le reste de la population une nostalgie pour la retraite à 60 ans.
Les indépendants favorables à la création d’un régime de retraite universel
Considérant, à tort ou à raison, que leur régime d’assurance vieillesse est moins protecteur que celui des salariés du privé ou celui des fonctionnaires, les travailleurs indépendants soutiennent massivement l’introduction d’un régime universel dans lequel chacun recevrait une pension dont le montant serait fonction des cotisations versées durant sa vie active (52 %) quand seulement 34 % des Français se déclarent favorables au régime universel sans prise en compte des éventuels particularismes propres à chaque activité ou statut professionnel. Ils sont par ailleurs moins nombreux à défendre le maintien du statu quo. De fait, les indépendants portent un regard sévère sur le système actuel de retraite qu’ils jugent à la fois inefficace (81%) et injuste (79 %).
Épargne retraite, des indépendants toujours en pointe
Les travailleurs indépendants, afin d’améliorer leur niveau de pension, sont les plus enclins à épargner en vue de la retraite.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr
Travailleurs indépendants : diversité des profils et des attentes en matière de retraite
Après l’adoption de la loi PACTE modifiant le régime de l’épargne retraite et à la veille de la présentation de la réforme des retraites les équipes du Cercle de l’Épargne se sont intéressées au regard porté par les 2,87 millions de travailleurs non-salariés sur le système de protection sociale et plus particulièrement leurs attentes en matière de retraite à partir des résultats de l’enquête 2019 « Les Français, la retraite et l’épargne » réalisée par le Cercle de l’Epargne et Amphitéa.
Au sommaire de cette étude :
- La retraite un sujet d’inquiétude plus ou moins vivace pour les indépendants
- Travailler plus pour améliorer son pouvoir d’achat à la retraite, une nécessité plus qu’un choix pour les indépendants ?
- Quelle réforme des retraites a la faveur des travailleurs non-salariés ?
- Les travailleurs indépendants partagés sur les objectifs cachés de la réforme
- Les travailleurs non-salariés tiennent à leur indépendance !
- Les indépendants, un public converti à la capitalisation ?
- L’immobilier et l’épargne longue restent néanmoins les solutions privilégiées par les indépendants pour préparer leur retraite
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com