Le Livret A revêt ses habits d’automne
« Octobre est le plus mauvais mois pour le Livret A », rappelle Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, dans un communiqué. « Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il faut remonter à celui de 2012 (+ 7,35 milliards), collecte gargantuesque faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. Octobre est logiquement un mois de dépenses avec notamment la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. L’année 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose, n’échappe pas à la règle », ajoute-t-il.
Bourse : un an après, les actionnaires de la FDJ se frottent les mains
Le directeur du Cercle de l’Épargne est cité dans cet article qui revient sur le doublement de la valeur de l’action FDJ en un an. Cette forte hausse a permis à de nombreux épargnants d’obtenir des gains très importants.
Opinion | La revanche du travail
Avec la digitalisation, avec la robotisation, avec la mondialisation, nombreux sont ceux qui avancent l’idée de la fin du travail avec, par voie de conséquence, l’instauration d’un revenu universel. La crise, écrit l’économiste Philippe Crevel, pourrait sonner le glas de cette théorie et aboutir à la revalorisation du travail.
Quels regards sur la protection sociale à l’heure de la pandémie de Covid-19 ?
Cet article de Naimi Média évoque les deux études qui ont été réalisées pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), d’une part auprès des Français et d’autre part auprès des entreprises et des TNS, avec les éclairages respectifs de Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’études et de connaissances de l’opinion publique (Cecop), et d’Alain Mergier, consultant en sociologie.
Deux tiers des Français épargnent en cas de difficultés, pas pour consommer
Cet article du Fil Social mentionne les résultats de l’enquête réalisée en septembre 2020 par l’IFOP pour AG2R La Mondiale, Amphitéa et le Cercle de l’Épargne. L’article rappelle notamment que selon cette étude, 65 % des personnes interrogées épargent « pour faire face à d’éventuelles difficultés ».
Quelle protection sociale demain ? AG2R La Mondiale lance la réflexion
Cet article du Fil Social mentionne les résultats des sondages réalisés en septembre 2020 par l’IFOP pour AG2R La Mondiale, Amphitéa et le Cercle de l’Épargne.
Placements : les Français se désintéressent des actions en 2020
Cet article rappelle que « selon une enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa, pendant le premier confinement au printemps 2020, près d’un quart des Français (22% exactement) ont épargné « plus que d’habitude ». Une courte minorité (4%) ont même épargné « beaucoup plus ». Fait intéressant : de toutes les catégories d’âge, ce sont les jeunes (18-24 ans) qui ont été les plus nombreux (39%) à avoir épargné plus que d’habitude. »
L’article évoque aussi le fait que « malgré l’envolée spectaculaire des actions entamée en mars 2020, et contrairement aux années précédentes, ce ne sont pas les actions qui ont attiré le plus d’épargne de nos concitoyens. Cette enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa nous apprend que c’est l’investissement dans l’immobilier locatif qui a attiré le plus d’épargnants cette année (68%), devant l’indéboulonnable assurance-vie (52%). Les actions n’arrivent qu’en troisième position et recueillent les faveurs des 39% d’épargnants. »
Bourse, placements: la nouvelle stratégie des épargnants reconfinés
Dans cet article du Figaro consacré à la stratégie actuelle des épargnants, le directeur du Cercle de l’Épargne souligne que «La fin de l’année est habituellement un moment important pour les questions de défiscalisation».
Opinion | Pour une révolution de la formation
L’après-crise ne se gagnera qu’à travers une montée en gamme de notre économie et par une élévation des compétences des actifs. En la matière, une refonte du système de formation constitue la clef de voute du rebond pérenne de l’économie, refonte qui pourrait passer par un système assurantiel. (Par Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne)
Résultats études – Quels regards sur la protection sociale à l’heure de la pandémie de Covid-19 ?
Alors que la pandémie se poursuit, quelle est la vision des Français et des entreprises sur les questions relatives à la retraite et à sa réforme, sur leur épargne, sur les préoccupations liées à la dépendance ou encore sur les dispositifs en prévoyance-santé ? Comment réagissent les sociétés et les travailleurs non-salariés (TNS) face à l’imprévisibilité de l’avenir ?
Afin de répondre à ces interrogations, deux études ont été réalisées pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), d’une part auprès des Français et d’autre part auprès des entreprises et des TNS, avec les éclairages respectifs de Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’études et de connaissances de l’opinion publique (Cecop), et d’Alain Mergier, consultant en sociologie.
Ces deux enquêtes soulignent l’importance qu’accordent les Français à la protection sociale. Si cette crise sanitaire a accentué l’attention qu’ils portent à leur protection et celle de leur famille, au mieux-vivre ensemble et au bien-vieillir, elle a également montré que les entreprises sont déstabilisées par cette crise exceptionnelle qui s’installe dans le temps créant par la même des incertitudes grandissantes. Elles voient ainsi la protection sociale sous un angle nouveau et cherchent à lui accorder une place plus importante en particulier dans leurs politiques de ressources humaines.
| Principaux chiffres clés Grand public > Près des deux tiers des Français (65 %) estiment qu’il est opportun d’épargner pour faire face à d’éventuelles difficultés quand un tiers pensent utiliser leur épargne pour consommer. > 41 % des sondés privilégient la liquidité en souhaitant que leur épargne soit mobilisable à tout moment. > 32 % des Français estiment que leur pension est ou sera suffisante pour vivre correctement.· > Face à la question de la dépendance des personnes très âgées, 70 % des sondés sont favorables à la mise en place d’une couverture complémentaire. Entreprises et TNS > 6 entreprises ou TNS sur 10 ont une activité plus soumise aux aléas qu’avant du fait de la pandémie (95%), de l’instabilité règlementaire et sociale (82%) et de l’accélération des transformations du monde (64%). > Le système de protection sociale est aussi un sujet d’attention majeur : système actuel des retraites complexe (83%), non pérenne (76%), absence de visibilité du futur système (75%) et plus globalement imprévisibilité du système de protection sociale liée à des paramètres instables (78%). > Près de 6 individus sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. > En conséquence, 41% des répondants accordent aujourd’hui plus d’importance qu’avant aux contrats de prévoyance. |
Face à la pandémie, les Français expriment de nouveaux besoins de protection sociale et patrimoniale
Méthodologie de l’enquête menée pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA : l’enquête a été réalisée sur internet les 8 et 9 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.
À l’issue de la crise sanitaire de ce printemps, 22% des Français interrogés affirment avoir épargné « plus que d’habitude » et cette réponse atteint son maximum chez les 18-24 ans (39%). Toutefois, près de 20 % des répondants se perçoivent comme victimes économiques de cette pandémie en déclarant avoir dû épargner « moins que d’habitude ». Quelles ont été leurs motivations pour épargner durant cette période ? La principale raison évoquée est qu’ils n’avaient « pas envie de consommer » (38 % des réponses) suivie de près par la crainte de tomber malade (13 %) et de perdre son emploi (12 %).
Concernant l’utilisation de leur épargne, les Français (41%) mettent en avant l’intention de la conserver afin qu’elle soit mobilisable à tout moment. Maintenir ou même augmenter son effort d’épargne arrive en deuxième position (35%) tandis qu’utiliser tout ou partie de son épargne pour faire des achats n’arrive qu’en troisième position (21%). Il est important de préciser que 40% des moins de 35 ans souhaitent maintenir voire augmenter leur effort d’épargne (contre 27 % en moyenne au sein de la population), signe que la crise du coronavirus est susceptible d’impacter fortement les stratégies financières des jeunes générations.
Le palmarès des placements les plus intéressants ne change pas depuis le début de la pandémie mais indique néanmoins une préférence accrue pour la liquidité. L’immobilier locatif continue de faire la course en tête : 61% des Français jugent ce placement intéressant (stable depuis février 2020), devançant comme en février l’assurance-vie (48% ; en baisse de 3 points) et le placement « actions » (37% ; en recul – 8 points, quand le Livret A en gagne 14). Les comptes courants sont jugés intéressants par 30 % des Français malgré l’absence de rémunération.
La pandémie et ses conséquences économiques créent-elles des inquiétudes sur le fait et/ou la perspective de disposer à sa retraite d’une pension suffisante pour vivre correctement ? Près de 44% des retraités interrogés estiment disposer d’une pension de retraite suffisante pour vivre correctement alors que 72% des non retraités craignent le contraire. Plusieurs mois après le déclenchement de cette crise qui a mis en sommeil le projet de réforme des retraites, seuls 19 % des Français souhaitent que le texte soit repris pour être mis en œuvre en totalité tandis que 31% d’entre eux se déclarent favorables à un projet rectifié maintenant la mise en place du régime par points et écartant l’âge pivot à 64 ans.
Dans le contexte actuel, la question de la dépendance des personnes âgées préoccupe 53% des Français. Ce taux atteint 70 % chez les plus de 70 ans contre 57 % des 60-69 ans et 48 % des moins de 60 ans. 70 % des personnes interrogées affirment être favorables à la mise en place d’un contrat dépendance qui devrait pouvoir être facultatif pour 53% d’entre eux.
Quand l’imprévisibilité de l’activité renforce l’importance de la protection individuelle des entreprises et des TNS
Méthodologie de l’étude conduite pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA : l’étude a été réalisée par téléphone du 15 septembre au 5 octobre 2020 auprès d’un échantillon de 400 individus (100 TNS, 100 patrons TPE, 100 directeurs administratifs, directeurs financiers, DRH de PME, et 100 de ETI). Après redressement, selon les critères de taille, activité et région, l’échantillon d’ensemble est représentatif de la cible BtoB. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.
Aujourd’hui, 60% des entreprises et des TNS interrogés se déclarent plus inquiets qu’avant quant à l’imprévisibilité de l’avenir économique de leur activité professionnelle désormais exposée à trois familles de risques :
- La crise sanitaire actuelle et ses conséquences (95%) ;
- L’instabilité réglementaire et sociale (82%) ;
- L’accélération des transformations du monde (64%).
À cette vulnérabilité économique s’ajoute celle de la protection sociale. En effet, de manière générale, l’avenir du système de protection sociale apparait imprévisible car les paramètres changent trop souvent pour 78%des entreprises et des TNS. Par ailleurs, le régime de retraite actuel est perçu comme non pérenne par 76% et complexe par 83% des répondants, obstruant ainsi la lisibilité de leur pension de retraite tout en renforçant la nécessité de disposer d’une protection individuelle. À noter que si 71% des entreprises sont favorables à la mise en œuvre de la réforme des retraites, avec pour 40% une préférence pour l’abandon de l’âge pivot, près de 6 individus sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. Si ce taux tend à s’accroître à mesure que diminue la taille de l’entreprise (58% pour les TNS contre 46% pour les ETI), les individus de 35-49 ans sont les plus inquiets (64%), suivis par les femmes (60%) et les jeunes de moins de 35 ans (59%).
Afin de faire face à la complexité du système de retraite, les comportements diffèrent selon la taille de l’entreprise. Ainsi, les TNS ont un processus de délégation : 79% s’adressent à leur expert-comptable. Les dirigeants de très petites entreprises (TPE) se réfèrent aussi à leur comptable (43%) mais font par ailleurs des recherches sur Internet (40%). Les petites et moyennes entreprises (PME) et les ETI s’appuient sur l’expertise du directeur administratif, financier ou des ressources humaines pour faire des recherches sur Internet (56% des PME, 64% des ETI) et se référer aux textes officiels (57% des PME, 52% des ETI). Dans l’ensemble l’assureur est un interlocuteur privilégié pour 54% des TNS et des entreprises.
Face à ces inquiétudes, 41% des sondés attachent aujourd’hui plus d’importance aux contrats qui sécurisent leur avenir : prévoyance, dépendance et retraite supplémentaire. Ainsi, 93% des personnes interrogées déclarent posséder une complémentaire santé, 81% un contrat de prévoyance et 54% un contrat de retraite supplémentaire. La possession d’un contrat de retraite supplémentaire s’accroit pour les individus qui craignent que leur pension de retraite soit insuffisante (59%), qui sont très inquiets de la pérennité du système de retraite (61%) et pour les TNS (60%).
En complément, 54% des entreprises et des TNS se disent favorables à la mise en place d’un contrat de dépendance, de préférence facultatif pour 43% d’entre eux.
La prévoyance apparaît pour les entreprises comme un facteur différenciant de leurs politiques RH. En effet, pour attirer et conserver les meilleurs salariés, 83% des entreprises considèrent qu’une complémentaire santé offrant des remboursements santé élevés et des services correspondants aux attentes des collaborateurs est un argument important. De plus, selon 81% d’entre elles, un contrat de prévoyance permettant à leurs collaborateurs et leurs familles d’être bien protégés en cas de coup dur est un facteur déterminant tout comme le fait de proposer aux salariés un supplément de revenus à la retraite (69%). Sur ce dernier point, ils sont cependant 57% à considérer que les salariés préfèrent se constituer ce complément de revenus individuellement.
Face à l’imprévisibilité de leur activité à laquelle s’ajoute celle de la protection sociale, les entreprises et les TNS sont 81% à être rassurés par la pérennité de l’assureur, qui se conjugue pour 58% des répondants à la stabilité qu’apporte sa forme juridique de société de personnes (mutuelle).
À propos du CERCLE DE L’ÉPARGNE :
LE CERCLE DE L’ÉPARGNE est un think tank dédié à l’épargne, la retraite et à la prévoyance. LE CERCLE DE L’ÉPARGNE étudie les évolutions de la législation concernant l’épargne, la retraite et la prévoyance. Il analyse, les besoins et les attentes des Français en la matière.
Pour réaliser ses missions, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE s’appuie sur l’expertise de son conseil scientifique constitué de membres reconnus pour leurs compétences dans les domaines économiques, sociologiques, démographiques. Les experts du Cercle travaillent, ensemble, sur les sujets de l’épargne et de la retraite. Le croisement des approches constitue la marque de fabrique du Cercle qui place au cœur de sa mission la pédagogie.
Les statuts reconnaissent l’indépendance du Conseil scientifique.
À propos d’AMPHITÉA :
Créée le 17 décembre 1974, AMPHITÉA est une association de Loi 1901 chargée du dialogue entre les sociétés membres d’AG2R LA MONDIALE et ses assurés. Au nom et au profit de ses Adhérents, AMPHITÉA est donc une association d’assurés, dont les objectifs sont de :
– négocier, souscrire et faire évoluer auprès de son partenaire assureur les meilleurs contrats de santé, prévoyance, épargne et retraite ;
– communiquer, former et informer sur toutes les thématiques liées à la protection sociale et la protection patrimoniale, auprès de ses Adhérents actuels et à venir ;
– développer entre ses membres un esprit de solidarité et d’entraide, fidèle aux valeurs mutualistes et paritaires de son partenaire assureur.
Avec près de 450 000 Adhérents, AMPHITÉA s’inscrit aujourd’hui parmi les plus grandes associations d’assurés de France.
Toutes les informations : www.amphitea.com
À propos d’AG2R LA MONDIALE :
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE
LE CERCLE DE L’ÉPARGNE : Charles Citroën
01 76 60 85 39 / 06 75 85 50 44 – ccitroen@cercledelepargne.fr
AMPHITÉA : Christelle Douche
01 71 24 02 65 / 06 78 87 78 15 – christelle.douche@amphitea.com
AG2R LA MONDIALE : Mélissa Bourguignon
01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63 – melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr
Enquêtes 2020 « Quels regards sur la protection sociale à l’heure de la crise sanitaire Covid-19 ? ».
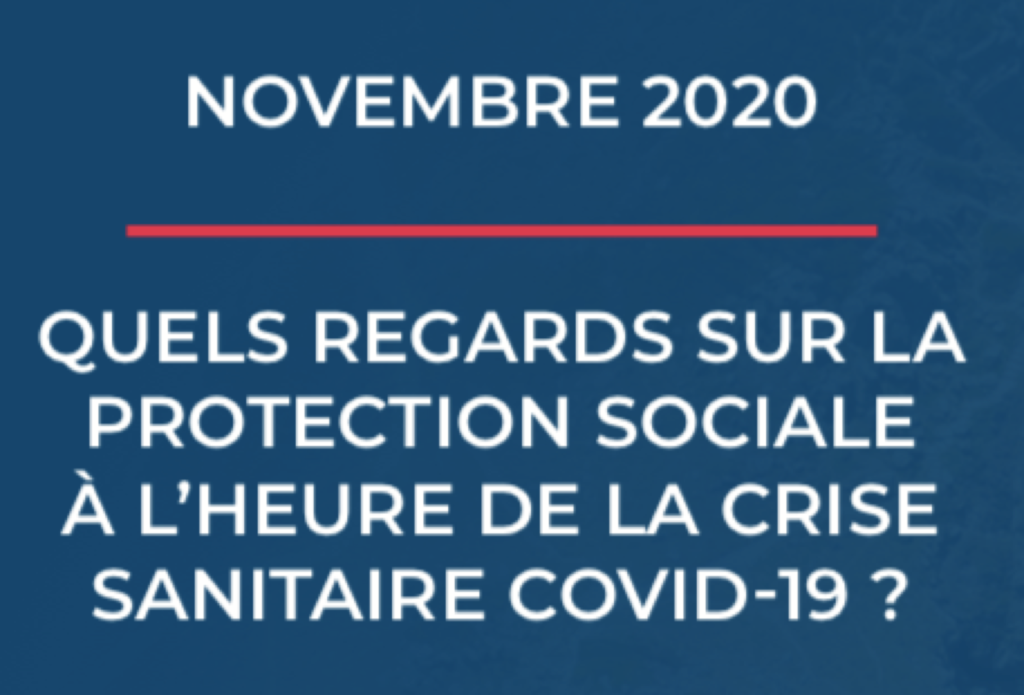
Consulter la plaquette de présentation des résultats des deux études
Consulter le communiqué de presse du CERCLE DE L’ÉPARGNE, d’AMPHITÉA et d’AG2R LA MONDIALE
Consulter tous les résultats de l’enquête du CERCLE DE L’ÉPARGNE
****
Alors que la pandémie se poursuit, quelle est la vision des Français et des entreprises sur les questions relatives à la retraite et à sa réforme, sur leur épargne, sur les préoccupations liées à la dépendance ou encore sur les dispositifs en prévoyance-santé ? Comment réagissent les sociétés et les travailleurs non-salariés (TNS) face à l’imprévisibilité de l’avenir ?
Afin de répondre à ces interrogations, deux études ont été réalisées pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), d’une part auprès des Français et d’autre part auprès des entreprises et des TNS, avec les éclairages respectifs de Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’études et de connaissances de l’opinion publique (Cecop), et d’Alain Mergier, consultant en sociologie.
Ces deux enquêtes soulignent l’importance qu’accordent les Français à la protection sociale. Si cette crise sanitaire a accentué l’attention qu’ils portent à leur protection et celle de leur famille, au mieux-vivre ensemble et au bien-vieillir, elle a également montré que les entreprises sont déstabilisées par cette crise exceptionnelle qui s’installe dans le temps créant par la même des incertitudes grandissantes. Elles voient ainsi la protection sociale sous un angle nouveau et cherchent à lui accorder une place plus importante en particulier dans leurs politiques de ressources humaines.
| PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS 2020 Grand public -> Près des deux tiers des Français (65 %) estiment qu’il est opportun d’épargner pour faire face à d’éventuelles difficultés quand un tiers pensent utiliser leur épargne pour consommer ; -> 41 % des sondés privilégient la liquidité en souhaitant que leur épargne soit mobilisable à tout moment ; -> 32 % des Français estiment que leur pension est ou sera suffisante pour vivre correctement ; -> Face à la question de la dépendance des personnes très âgées, 70 % des sondés sont favorables à la mise en place d’une couverture complémentaire. Entreprises et TNS ->6 entreprises ou TNS sur 10 ont une activité plus soumise aux aléas qu’avant du fait de la pandémie, de l’instabilité règlementaire et sociale et de l’accélération des transformations du monde ; ->Le système de protection sociale est aussi un sujet d’attention majeur : système actuel des retraites complexe (83%), non pérenne (76%), absence de visibilité du futur système (75%) et plus globalement imprévisibilité du système de protection sociale liée à des paramètres instables (78%); -> Près de 6 TNS sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante.En conséquence ; -> 41% des répondants accordent aujourd’hui plus d’importance qu’avant aux contrats de prévoyance. |
ENQUÊTE CERCLE DE L’EPARGNE – GRAND PUBLIC
1. Les comportements d’épargne durant la crise de printemps du coronavirus
Près du quart des français a épargné « plus que d’habitude » durant la crise de printemps de coronavirus :
Invités à indiquer si durant la crise de printemps du coronavirus, ils ont « plus que d’habitude » épargné ou mis de l’argent de côté, près d’un quart des Français (22 % exactement) répond positivement. Un pourcentage élevé mais seulement 4 % précisent l’avoir fait « beaucoup plus », la grande majorité (18 %) indiquant « un peu plus ».

La réponse cumulée des « beaucoup plus » et « un peu plus » est plus fréquente bien sûr à mesure que le niveau de revenu s’élève mais même 20 % de ceux qui ont un revenu faible se rangent dans cette catégorie. Il est d’ailleurs à noter que ce pourcentage est plus élevé parmi les patrimoines moyens (37 %) que parmi les patrimoines élevés (24 %).
L’enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa permet d’évaluer à 20 % la proportion de Français victimes financièrement de la crise de printemps du coronavirus, ceux qui déclarent avoir épargné ou mis de l’argent de côté « moins que d’habitude ». Avec un pourcentage plus élevé parmi les commerçants et artisans (29 %) ainsi que chez ceux qui ne disposent d’aucun produit d’épargne (32 %) ou sont sans patrimoine (30 %).
Une nette remontée du livret A comme produit d’épargne intéressant :
Entre les enquêtes de février 2020 – juste avant la période de confinement – et de septembre 2020, on assiste à une certaine redistribution quant à l’intérêt porté aux différents produits d’épargne. À côté de la stabilité du bien immobilier que l’on loue qui reste en tête des produits jugés intéressants sans subir de recul, l’assurance-vie perd un peu de terrain (-3 points) mais moins que les actions qui enregistrent un recul d’intérêt de huit points. Un résultat d’autant plus frappant qu’en cinq ans des enquêtes annuelles Le Cercle de l’Épargne/Amphitéa, les actions avaient atteint leur plus haut score en ce début d’année.
En sens contraire, on constate une forte remontée du bon vieux livret A jugé comme produit intéressant par 29 % des interviewés au lieu de 15 % en février. Certes cela place le livret A au même niveau que le compte courant en banque cité comme produit intéressant par 30 % – sans doute en raison de sa fonction de protection de l’argent déposé.

Les motivations à épargner durant la crise de printemps du coronavirus :
Quelles ont été les motivations à épargner ou à mettre de l’argent de côté durant la crise de printemps du coronavirus ? La réponse qui arrive en tête est « pas d’envie de consommer » avec 38 % des réponses et même 41 % parmi ceux qui ont épargné « plus que d’habitude ».
Relevons qu’une motivation plus profonde comme la crainte d’une baisse de revenus se place en deuxième position à 30 % et que la crainte d’une hausse d’impôts est assez souvent citée chez les revenus élevés. En revanche, deux éléments plus directement liés à la crise du coronavirus occupent les dernières positions : la crainte de tomber malade (13 % seulement avec une pointe à 21 % chez les plus de 65 ans) et la crainte de perdre son emploi (12 %).

Les types de placement préférés pour l’épargne constituée durant la crise de printemps du coronavirus :
Parmi les interviewés qui durant la crise de printemps du coronavirus ont épargné plus que d’habitude ou au moins autant, 50 % ont laissé tout ou partie de cette épargne sur leur compte courant, 49 % l’ont placée à court terme (comme dans le livret A). Seuls 19 % ont opté pour un placement de long terme, en plus grand nombre vers l’assurance-vie (11 %) qu’en faveur des actions (8 %).

Les intentions sur l’utilisation de l’épargne dans les prochains mois :
Concernant les utilisations de leur épargne, les Français mettent nettement en avant l’intention de la conserver pour qu’elle soit mobilisable à tout moment.
Maintenir ou même augmenter son effort d’épargne arrive en seconde position, davantage cité aussi par les revenus les plus élevés. La constitution de l’épargne appelle la continuation de l’épargne. Utiliser tout ou partie de son épargne pour faire des achats n’arrive qu’en troisième position avec 21 %.

Le souhait pour les prochains mois : que les français épargnent ou consomment ?
Compte tenu des intentions affichées par beaucoup de Français de conserver l’argent épargné ou mis de côté, on ne sera guère surpris que l’appel du gouvernement à l’utiliser pour faire des achats ne recueille qu’une minorité de soutien (35 %).

2. La retraite et sa réforme
Pas d’inquiétude accrue sur le niveau de sa pension de retraite :
Curieusement, la crise de printemps du coronavirus et ses conséquences économiques ne créent pas d’inquiétude supplémentaire sur le fait ou bien la perspective de disposer à sa retraite d’une pension suffisante pour vivre correctement. Certes, le pourcentage de réponses positives parmi l’ensemble des Français reste minoritaire (à 32 %) mais dans la série d’enquêtes annuelles du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa réalisées depuis 2016, il n’a jamais été aussi haut. D’une certaine façon, le maintien au même niveau des pensions versées malgré la violence de la crise peut expliquer ce résultat positif. On est davantage surpris par l’évolution également positive (quoique de moindre ampleur) parmi les non retraités puisqu’il s’agit là non de réalités mais de perspectives.
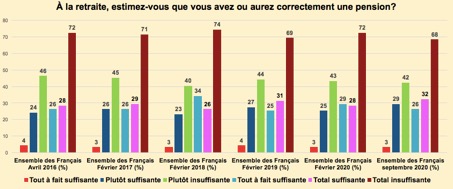
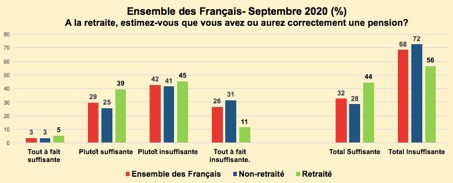
La moitié des français souhaite que la réforme des retraites soit abandonnée complètement :
Plusieurs mois après le déclenchement de la crise du coronavirus qui a mis en sommeil le projet de réforme des retraites, seuls 19 % des Français souhaitent que le texte soit repris pour être mis en œuvre en totalité.
En fait, une formule de compromis pourrait rallier une plus grande part de l’opinion en faisant aboutir le régime par points à condition d’abandonner au passage l’âge pivot. Si l’on additionne les partisans de ce schéma et ceux qui voudraient maintenir le projet initial, on totalise 50 % des réponses.

3. La dépendance et son financement
Un peu plus de la moitié des français se sent concerné par la question de la dépendance :
Résultat parmi les plus spectaculaires de l’enquête du Cercle de l’Épargne et Amphitéa, la question de la dépendance des personnes très âgées préoccupe la majorité des Français (53 % d’entre eux). Parmi les préoccupés, on distingue deux grands groupes : d’abord ceux qui sont directement concernés et représentent 25 % des personnes interrogées (soit qu’elles soient touchées personnellement, soit comme aidants ou ayant un membre de leur famille touché) et ensuite ceux qui craignent de tomber un jour dans la dépendance, soit 35 % des Français (en sachant qu’un petit nombre appartient aux deux groupes).

70 % des français sont favorables à la mise en place d’un contrat dépendance qui, pour la grande majorité, doit être facultatif :
Interrogés sur la mise en place d’un contrat-dépendance qui serait à prendre au moment du passage à la retraite – et viendrait s’ajouter à ce que l’État fait pour sa prise en charge –, 70 % des Français s’y montrent favorables mais ils optent massivement pour un contrat facultatif (à 53 %) plutôt qu’obligatoire (à 17 %).
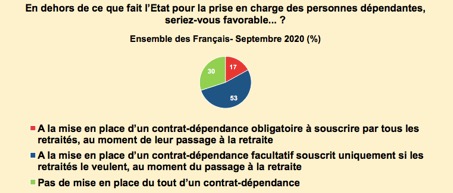
Méthodologie de l’enquête menée pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA :l’enquête a été réalisée sur internet les 8 et 9 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.
Les totaux supérieurs à 100 s’expliquent par le fait que les interviewés ont pu donner jusqu’à deux réponse pour certaines questions.
CONCLUSION POUR L’ENQUÊTE GRAND PUBLIC :
• Faisant le bilan de la crise du printemps du coronavirus, près du quart des Français déclare avoir épargné ou mis de l’argent de côté « plus que d’habitude ». Cette proportion est plus élevée parmi les patrimoines moyens que parmi les patrimoines élevés ainsi que parmi les 18-24 ans. En sens inverse, il faut relever que 20 % des Français se classent comme victimes économiques de cette période en ayant dû épargner « moins que d’habitude », ce qui est plus fréquent parmi les Français modestes bien sûr mais aussi chez les commerçants et artisans durement impactés par la période.
• « Pas envie de consommer », telle est la première motivation citée par les interviewés qui ont épargné « plus que d’habitude » et surtout par les revenus élevés. Mais seuls 21 % des interviewés déclarent vouloir maintenant utiliser tout ou partie de leur épargne pour faire des achats. Les deux premières priorités sont plutôt de conserver l’épargne pour qu’elle soit mobilisable à tout moment et, nettement en retrait, la volonté de maintenir voire d’augmenter l’effort d’épargne consenti, citée par 27 % des interviewés et jusqu’à 40 % parmi les moins de 35 ans.
• Concernant la réforme des retraites, les Français souhaitent à une grande majorité que le projet de loi qui était en examen ne soit pas remis sur la table. Ils pourraient plus facilement accepter un projet rectifié maintenant la mise en place du régime par points et écartant l’âge pivot à 64 ans. Ce sont surtout les catégories aisées et aussi les jeunes qui s’y montrent les plus favorables. Mais 50 % des Français optent pour l’abandon total de la réforme et ce sont les catégories qui pourraient en bénéficier le plus qui sont les plus fermes en ce sens : les femmes et les faibles revenus.
• La question de la dépendance des personnes très âgées préoccupe désormais fortement beaucoup de Français :
53 % se déclarent concernés à un titre ou à un autre. La crainte de tomber soi-même en dépendance est fréquente chez les personnes aisées, elle prend aussi une dimension de crainte supplémentaire avec pour elles-mêmes les conséquences économiques de cette situation. Dans ce contexte, la mise en place d’un contrat-dépendance à souscrire au moment du passage à la retraite – qui s’ajouterait à ce que fait l’État – est accueillie favorablement mais la préférence va massivement à une formule facultative.
ENQUÊTE ENTREPRISES ET TNS
Dans quelles perspectives se place la cible B to B vis-à-vis de l’avenir de son activité :
A la question de savoir si leur activité est aujourd’hui plus, autant ou moins soumise à des aléas qu’avant 60 % des professionnels répondent plus qu’avant, 35 % autant et 5 % moins. Ceux qui nous ont par ailleurs répondu accorder aux contrats de prévoyance plus d’importance qu’avant sont 63 % dans ce cas. L’imprévisibilité de l’activité renforce l’importance de la protection individuelle.
Quels sont les risques qui accentuent l’imprévisibilité de l’activité :
L’imprévisibilité liée à la crise sanitaire concerne plus de 9 activités sur 10, suivie de l’instabilité réglementaire et sociale pour plus de 8 sur 10, puis de l’accélération des transformations du monde pour plus de 6 sur 10.
Dans ce contexte d’incertitude professionnelle, quelles perspectives offrent le système de protection social :
Pour 8 interlocuteurs sur 10 le système des retraites est complexe et pour plus de 8 sur 10 d’entre eux cela obère la visibilité de la pension de retraite. Ce sentiment de complexité (quasi-unanime chez les jeunes 94 %) renforce la nécessité d’une protection individuelle (90 %). A la complexité suit pour plus de 7 interlocuteurs sur 10, le sentiment de précarité du système actuel et d’absence de visibilité du système à venir.
Ces incertitudes inquiètent quant aux revenus à la retraite (78 %) et renforcent aussi le besoin de protection individuelle (77 %). Plus globalement, l’imprévisibilité concerne l’ensemble du système de protection sociale pour près de 8 interlocuteurs sur 10, il est de nouveau majoré chez ceux qui accordent aujourd’hui plus d’importance qu’avant à leurs contrats de protection individuelle pour sécuriser leur avenir (85 %).
Dans ce contexte d’incertitude professionnelle, quelles perspectives offrent le niveau de la pension de retraite :
Près de 6 individus sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. Ce taux s’accroit à mesure que diminue la taille de l’entreprise. Les TNS sont les plus inquiets (56 %). Les femmes (60 %) économiquement plus fragilisées ainsi que les jeunes (59 %).
Contrat de prévoyance équipement :
Plus de 9 interlocuteurs sur 10 ont un contrat de mutuelle santé, plus de 8 sur 10 de prévoyance, plus d’1 sur 2 de retraite supplémentaire, et 3 sur 10 de dépendance (un taux certainement surévalué par la méconnaissance de ce que couvre ce dernier type de contrat).
Contrats de prévoyance en entreprise et captation des meilleurs salariés :
Proposer de bons contrats de prévoyance est un argument supplémentaire pour 69 %. L’importance croît avec la taille de différenciant pour recruter et fidéliser les meilleurs : la mutuelle l’entreprise, ce qui corrobore le fait que l‘équipement suit la même pour 85 % des interlocuteurs, la prévoyance pour 81 % et la retraite tendance.
Contrats de prévoyance en entreprise, processus de décision retraite supplémentaire :
57 % de nos interlocuteurs considèrent que les salariés préfèrent se constituer eux-mêmes un complément de revenus à la retraite. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment vis-à-vis du taux d’équipement en retraite supplémentaire, puis de l’importance de ce type de contrat pour capter les meilleurs, les ETI se distinguent avec une légère préférence pour une prise en charge par l’employeur (61 %).
Contrats de prévoyance en entreprise et sécurisation de l’avenir :
4 interlocuteurs sur 10 accordent plus d’importance qu’avant aux contrats de prévoyance pour sécuriser leur avenir et celle de leurs salariés.
L’assureur et le conseil :
Pour s’y retrouver dans la complexité, ici du système de retraite, l’assureur a une fonction de conseil pour plus d’1 interlocuteur sur 2.
Critères de confiance dans le choix d’un assureur :
Face à l’imprévisibilité, la pérennité inspire confiance à plus de 8 interlocuteurs sur 10, suivie pour plus de 7 sur 10 de la spécialisation qui compense l’incertitude d’un système de protection sociale dont les paramètres évoluent en permanence et du statut de société de personnes (non cotées en bourse) garant de la stabilité.
Contrat de dépendance et son financement :
Plus d’1 interlocuteur sur 2 est favorable à la mise en place d’un contrat de dépendance, de préférence facultatif.
La réforme des retraites :
Vis-à-vis de la réforme des retraites moins de 3 interlocuteurs sur 10 souhaitent son abandon. Ceux qui souhaitent qu’elle soit appliquée, ont tendance à soutenir le régime par points et l’abandon de l’âge pivot (40 %), comme dans l’enquête grand-public cette préférence est plus marquée chez les femmes.
Deux facteurs expliquent, les différences de résultats entre le B to B et le grand public :
• Facteur 1 : Selon l’enquête grand-public de septembre 2020, les individus ayant les revenus les plus faibles sont les plus nombreux à souhaiter l’abandon complet (55 % VS 48 % pour les revenus élevés), alors que dans l’enquête B to B, de part leur CSP nous avons majoritairement des individus à haut niveau de revenu.
• Facteur 2 : Selon l’enquête Grand-Public de l’hiver 2019, les agents de la fonction publique et les salariés d’une entreprise publique sont plus nombreux à souhaiter l’abandon, contrairement aux indépendants et aux salariés d’une entreprise privée qui constituent notre cible.
Méthodologie de l’étude conduite pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA : l’étude a été réalisée par téléphone du 15 septembre au 5 octobre 2020 auprès d’un échantillon de 400 individus (100 TNS, 100 patrons TPE, 100 directeurs administratifs, directeurs financiers, DRH de PME, et 100 de ETI). Après redressement, selon les critères de taille, activité et région, l’échantillon d’ensemble est représentatif de la cible BtoB. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.
CONCLUSION POUR L’ENQUÊTE ENTREPRISES ET TNS :
La cible B to B est majoritairement plus inquiète qu’avant quant à l’imprévisibilité de l’avenir de son activité professionnelle exposée à trois familles de risques. Il s’agit en premier lieu de la crise sanitaire actuelle et ses conséquences, suivies de l’instabilité réglementaire, puis de l’accélération des transformations du monde.
• A sa vulnérabilité économique s’ajoute celle de sa protection sociale. Avec en premier lieu le régime de retraite actuel qu’elle perçoit comme complexe puis précaire, suivi d’une réforme dont elle ne connait pas l’issue et, plus globalement, un système de protection sociale instable.
• Aujourd’hui, bien qu’appartenant aux catégories sociales supérieures, nos interlocuteurs craignent en majorité de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. Les TNS, plus précaires, sont nettement plus nombreux dans ce cas. Cependant, le niveau d’inquiétude est moindre que pour le grand-public. Cette différence s’explique notamment par les différences de représentation des catégories sociales dans les deux populations. Ici sont représentées les catégories supérieures, alors que l’enquête grand public montre que ce sont les catégories inférieures les plus inquiètes.
• Tous ou presque disposent d’une mutuelle, légèrement moins d’une prévoyance. Dans les deux cas le niveau d’équipement progresse avec la taille de l’entreprise. La retraite supplémentaire concerne prioritairement : les TNS moins couverts par une complémentaire et plus inquiets sur leur pension de retraite, puis les ETI qui y voient un élément de différenciation pour recruter et fidéliser les meilleurs au même titre que la performance de la mutuelle santé et du contrat de prévoyance. Un tiers ont un contrat de dépendance. (Ce niveau d’équipement est à vérifier, il est possible qu’il y ait confusion dans l’esprit des personnes sondées).
• Dans ce contexte d’imprévisibilité, 4 interlocuteurs sur 10 attachent aujourd’hui plus d’importance aux contrats qui sécurisent l’avenir : prévoyance, dépendance et retraite supplémentaire.
• Pour s’y retrouver dans la complexité du système de retraite, les comportements diffèrent selon la taille de l’entreprise. Les TNS, “non spécialistes des sujets de protection sociale” et débordés, délèguent à leur expert-comptable, leur assureur, puis leur conseiller gestionnaire de patrimoine ou courtier. Les TPE, principalement des chefs d’entreprise se réfèrent à leur comptable ou font des recherches sur internet. Les PME et les ETI, des directeurs administratifs, financiers ou des ressources humaines s’appuient sur leur expertise pour faire des recherches sur internet et lire les textes officiels. Les ETI sont aussi plus nombreux à s’adresser à leur assureur.
• Face à l’imprévisibilité de l’avenir du système de protection sociale, la pérennité de l’assureur est la caractéristique la plus rassurante, et encore plus nettement pour les PME et surtout les ETI. Pour ces dernières elle est garantie par le statut de société de personnes (non cotées en bourse) qui conforte la stabilité de la stratégie. La spécialisation sur l’ensemble des domaines de l’assurance à la personne est pour tous un argument important. Notons que les TNS sont les plus nombreux à préférer un assureur multirisque, nous voyons ici, selon l’étude image, le bénéfice de confort que peut apporter le fait de disposer d’un interlocuteur unique.
• Pour l’avenir, cette cible est majoritairement favorable à la mise en place d’un contrat de dépendance, avec une nette préférence pour qu’il soit facultatif. Ils sont cependant nettement moins intéressés que le grand-public.
• Vis-à-vis de la réforme des retraites les avis sont contrastés avec une légère préférence, sans qu’elle ne remporte la majorité, pour une mise en œuvre du système à point avec un abandon de l’âge pivot. Ici aussi, le B to B diffère du B to C dont 1 individu sur 2 souhaite l’abandon de la réforme.
Tous les résultats de l’enquête sont sur le site du Cercle : www.cercledelepargne.com
À propos du CERCLE DE L’ÉPARGNE
LE CERCLE DE L’ÉPARGNE est un think tank dédié à l’épargne, la retraite et à la prévoyance. LE CERCLE DE L’ÉPARGNE étudie les évolutions de la législation concernant l’épargne, la retraite et la prévoyance. Il analyse, les besoins et les attentes des Français en la matière.
Pour réaliser ses missions, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE s’appuie sur l’expertise de son conseil scientifique constitué de membres reconnus pour leurs compétences dans les domaines économiques, sociologiques, démographiques. Les experts du Cercle travaillent, ensemble, sur les sujets de l’épargne et de la retraite. Le croisement des approches constitue la marque de fabrique du Cercle qui place au cœur de sa mission la pédagogie.
Les statuts reconnaissent l’indépendance du Conseil scientifique.
À propos d’AMPHITÉA
Créée le 17 décembre 1974, AMPHITÉA est une association de Loi 1901 chargée du dialogue entre les sociétés membres d’AG2R LA MONDIALE et ses assurés. Au nom et au profit de ses Adhérents, AMPHITÉA est donc une association d’assurés, dont les objectifs sont de :
– négocier, souscrire et faire évoluer auprès de son partenaire assureur les meilleurs contrats de santé, prévoyance, épargne et retraite ; – communiquer, former et informer sur toutes les thématiques liées à la protection sociale et la protection patrimoniale, auprès de ses Adhérents actuels et à venir ;
– développer entre ses membres un esprit de solidarité et d’entraide, fidèle aux valeurs mutualistes et paritaires de son partenaire assureur.
Avec près de 450 000 Adhérents, AMPHITÉA s’inscrit aujourd’hui parmi les plus grandes associations d’assurés de France.
Toutes les informations : www.amphitea.com
À propos d’AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE
Contacts presse :
| Philippe Crevel 06 03 84 70 36 pcrevel@cercledelepargne.fr | Charles Citroën 06 75 85 50 44 ccitroen@cercledelepargne. |
Faut-il opter pour le nouveau placement d’épargne retraite et lequel choisir ?
Philippe Crevel souligne dans cet article consacré au nouveau placement d’épargne retraite que «L’objectif gouvernemental de 300 milliards d’euros d’encours d’épargne retraite en 2022 contre 230 milliards en 2017 et de trois millions de PER souscrits, paraît bien ambitieux». Le directeur du Cercle de l’Épargne ajoute que « la question des retraites demeure un sujet d’inquiétude légitime pour un grand nombre de Français et le PER a indéniablement un potentiel de croissance dans les prochaines années».
Récession : mais pourquoi la France fait-elle partie du trio des pays les plus impactés économiquement par le Covid ?
Le directeur du Cercle de l’Épargne Philippe Crevel a répondu aux questions suivantes d’Atlantico: « Pourquoi la France fait-elle partie du trio des pays les plus impactés économiquement par le Covid ? Quelles sont les principales explications liées au contexte et à la structure économique ? Quelle est la part de responsabilité du gouvernement ? »
Crise du Covid : petit bulletin de notes des mesures gouvernementales
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne a répondu à plusieurs questions d’Atlantico sur la gestion par le gouvernement de la crise générée par la pandémie de Covid-19.
Spéciale Impact PME l’hebdo : Les décisions stratégiques des entreprises pour rester compétitives
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, est revenu sur BFM Business sur les stratégies des PME pour se sortir de la crise générée par la Covid-19.
« Les minima de pensions de retraite », complexité à tous les étages
Dans le cadre de la réforme visant à instituer un système universel par points, le gouvernement d’Édouard Philippe souhaitait réformer le dispositif du minimum contributif. Tous les futurs retraités auraient été à terme soumis aux mêmes règles avec un minimum fixé à 1 000 euros ou 85 % du SMIC, ce qui l’amenait automatiquement au-dessus du minimum vieillesse (900 euros). La refonte du minimum contributif pourrait être un des morceaux de la réforme des retraites que l’actuel gouvernement souhaitera peut-être appliquer avant l’échéance présidentielle de 2022. Il est encouragé en cela par le dernier rapport annuel de la Cour des comptes consacré à l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié début octobre 2020, qui souligne les lacunes du système français des minima de pension de retraite. Dans un chapitre intitulé « Les minima de pension de retraite : un système complexe à la logique devenue incertaine », la Cour des comptes met en évidence la complexité des dispositifs de minima de pension et avance des pistes de réformes.
Plusieurs pays ont un système de minima de revenus à la retraite proche de celui de la France
Comme dans de nombreux pays étrangers, la France a fait le choix dans les années 1980, pour améliorer le niveau de vie des personnes ayant atteint l’âge de la retraite, d’un système à deux volets de minima de revenus à la retraite comprenant comme le rappelle la Cour des comptes « des minima de pension par régime et un minimum vieillesse universel, qui peut compléter les minima de pension de manière différentielle ».
Le système français en la matière est très proche de ceux en vigueur en Belgique, en Espagne et en Italie. Il présente aussi des similitudes avec les systèmes suédois, hollandais et canadiens. En revanche, les États-Unis et l’Allemagne n’ont pas établi de mécanismes visant à garantir un montant minimal de pension.
La Cour des comptes souligne, en se basant sur la publication 2019 « Pensions at a Glance » de l’OCDE, que « la pension, forfaitaire ou minimum selon les pays étudiés, servie entière et rapportée au salaire moyen, varie entre 13 % au Canada et 34 % en Espagne, la France avec le Mico se situant dans une position médiane (22 %). À l’exception du Japon, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, où la pension minimale est universelle et versée à la totalité ou quasi-totalité de la population des plus de 65 ans, les minima concernent entre 30 % et 40 % de cette population dans les autres pays ».
Présentation des grandes caractéristiques du système de minima de revenus à la retraite
Le premier étage du système de minima de revenus à la retraite en France est le minimum vieillesse. Il correspond depuis 2007 à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), allocation universelle bénéficiant aux ménages les moins aisés, servie sans aucun lien avec les activités professionnelles des bénéficiaires. Cette allocation, qui intervient de façon subsidiaire, a été versée en 2018 à 570 000 bénéficiaires pour un montant total de 3,2 Md€.
Le second pilier du système consiste en des minima de pension, qui sont versés par la plupart des régimes de retraite, à titre individuel et sous condition, à certains de leurs assurés. L’objectif des minima de pension est d’augmenter les pensions servies en garantissant un niveau de vie à la retraite à des personnes ayant eu une carrière complète mais de faibles rémunérations. La place de ces minima a eu tendance à progressivement se réduire.
Les principaux minima de pension sont le minimum garanti (Miga), le minimum contributif (Mico) et la pension majorée de référence (PMR). Le Miga est versé aux fonctionnaires par le Service des retraites de l’État et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le Mico est quant à lui versé par les régimes alignés ainsi que le régime des cultes. La PMR est versée aux non-salariés agricoles par la Mutualité sociale agricole des salariés (MSA).
Environ un nouveau retraité sur cinq bénéficie aujourd’hui des minima de pension. Le montant de pension supplémentaire versé via les minima de pension était estimé à 8,7 milliards d’euros en 2018, ce qui équivaut à un cinquième des dépenses de solidarité au titre de la retraite. Le minimum de pension doit permettre pour un salarié du privé d’atteindre un minimum de pension de 1 191 euros. Pour une personne seule, le montant du Mico ne peut pas dépasser 642,93 euros par mois. Ce minima de pension est un revenu différentiel. Il dépend donc du revenu perçu. Il est en moyenne de 130 euros par mois.
L’articulation entre l’Aspa et le minimum est peu lisible et à bien des égards inefficiente
L’Aspa et les minima de pension coexistent. Une proportion importante de bénéficiaires des minima de pension est allocataire du minimum vieillesse. Comme l’explique la Cour des comptes, « Lorsque la pension de base portée au Mico, augmentée de la retraite complémentaire, reste inférieure au minimum vieillesse et que les autres revenus du ménage sont faibles, l’Aspa peut en conséquence être versée en complément. Ainsi, en 2016, 9 % des retraites bénéficiaires d’un minimum de pension dans leur régime principal percevaient également l’Aspa (dont 5,7 % parmi les femmes et 19,8 % parmi les hommes) ».
La Cour des comptes déplore que l’articulation de l’Aspa et du minimum retraite ne soit pas très claire. Les magistrats financiers soulignent ainsi que le Mico ne permet pas à un retraité ayant eu une carrière complète au Smic de bénéficier d’une pension correspondant à 85 % de son salaire, ce qui était pourtant le but initial de ce dispositif. Ces minima de pension n’assurent par ailleurs pas toujours une pension supérieure au minimum vieillesse. Ce phénomène est la conséquence de modalités d’indexation différentes des deux dispositifs, l’ASPA ayant bénéficié de revalorisations exceptionnelles au cours de ces dernières années alors que l’évolution du seuil de pension d’éligibilité au MICO est liée à l’inflation.
La complexité du système français entraîne d’importantes différences de traitement entre les assurés et des retards dans le traitement des dossiers pour obtenir le minimum de pension
La complexité de ce système conduit à des différences de traitement entre les assurés des différents régimes de retraite. Ces divergences concernent tant les règles d’éligibilité que de calcul. Les bénéficiaires du minimum contributif sont aujourd’hui surtout des assurés ayant eu des carrières courtes alors que la cible initiale du minimum de pension du régime général était de bénéficier à des retraités ayant eu au cours de leur vie professionnelle de faibles salaires et des carrières longues.
Ces règles complexes entraînent aussi un retard dans le traitement des dossiers pour obtenir le minimum de pension. La Cour des comptes avait souligné dans le cadre de sa dernière certification des comptes de la branche vieillesse du régime général que près de 500 000 demandes de majorations de pension au titre du Mico étaient en attente de calcul fin 2019. La MSA se caractérise aussi par un fort nombre de majorations de pension en attente de calcul même s’il n’y a pas de données chiffrées en la matière. En l’absence de nouvelles informations, ni la Cnav, ni la MSA salariés ne reviennent sur ces dossiers. Ces demandes restent alors potentiellement de nombreuses années en attente, conduisant certains retraités aux ressources faibles à ne pas bénéficier des suppléments de pension auxquels ils ont droit.
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter avec efficacité contre ces défauts du système de minima de revenus à la retraite
Pour pallier ces difficultés, la Cour des comptes recommande une meilleure articulation du système de minima de pension avec le minimum vieillesse. Elle prône aussi une harmonisation entre assurés des différents régimes. Cette réflexion était un sujet de réflexion dans le cadre des travaux sur la réforme des retraites, qui a été repoussée en raison de l’actuelle crise du Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex a confié en juillet 2020 aux députés Lionel Causse et Nicolas Turquois une mission sur « la prise en compte des petites pensions ».
Pour la Cour des comptes, il est également souhaitable de mettre en application les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 qui soumettent « le Miga à des conditions de subsidiarité́ et d’écrêtement » ainsi que « d’harmoniser le traitement des minima de pension au regard de la surcote et de la réversion ». Enfin, il convient de « résorber le stock des dossiers en attente de calcul définitif du Mico » et « d’améliorer l’information sur les dispositifs de minima en renforçant la communication pour les assurés ne liquidant par leur pension à taux plein ».
Des systèmes de retraite ébranlés
Cette note sur les conséquences pour le système de retraite de la crise sanitaire débutée au mois de mars s’appuie sur le document publié au mois d’octobre du Conseil d’orientation des retraites ainsi que sur plusieurs documents publiés par l’INSEE et la DREES.
Dans un régime de retraite par répartition, les cotisations des actifs financent les pensions des retraités, en vertu de la solidarité intergénérationnelle. Quand la masse salariale se contracte, à défaut d’abaisser le niveau des pensions, le solde desdits régimes ne peut qu’être négatif. Ce déficit de nature conjoncturelle peut se doubler d’un déficit structurel du fait d’une sous-croissance chronique et du vieillissement de la population.
La crise sanitaire qui a débuté au mois de mars génère un choc conjoncturel sur l’ensemble des régimes sociaux. Les cotisations sont en forte baisse quand les dépenses restent constantes comme pour les régimes de retraite ou augmentent en ce qui concerne l’assurance maladie ou l’assurance chômage. La diminution des cotisations est depuis le mois de mars à mettre sur le compte du chômage partiel. Dans un deuxième temps, elles pourraient être touchées par une vague de licenciements et donc par une diminution de l’emploi. La crise a également comme conséquence de diminuer l’ampleur des hausses de salaire, ce qui induit un manque à gagner pour les régimes de retraite.
En 2020, le PIB pourrait se replier, en France, de plus de 10 points. Le solde du système de retraite devrait être négatif de 25,4 milliards d’euros, soit -1,1 % du PIB. Selon le Conseil d’orientation des retraites, la croissance reviendrait au niveau envisagé avant-crise que vers 2024 ; néanmoins, le manque à gagner lié à la crise ne sera pas effacé. Le PIB en volume resterait durablement en deçà ce qui était prévu avant la crise sanitaire. La perte est estimée à 2,5 % de PIB par rapport à ce qui était anticipé en novembre 2019. Les prévisions du COR ont été réalisées avant la deuxième vague. Une nouvelle révision sera donc nécessaire pour intégrer le manque à gagner de la fin de l’année 2020.
Le poids des dépenses de retraite devrait rester au-dessus de leur niveau d’avant crise pour plusieurs années, entre 14 et 15 % du PIB. Les ressources seraient inférieures aux prévisions ce qui entraînerait un déficit de 0,5 point de PIB en 2024, soit un peu plus de 13 milliards d’euros.
À la fin de décennie, selon les estimations du COR, la trajectoire des dépenses en pourcentage du PIB rejoindrait celle anticipée avant 2020. Il faudrait donc une décennie pour effacer le choc de la crise sanitaire.
1. Une situation inédite sur le plan démographique
La première vague s’est traduite par un accroissement de 30 000 du nombre de décès soit deux fois plus que la canicule de 2003. La deuxième vague qui a débuté en septembre devrait également s’accompagner d’une recrudescence du nombre de décès. En l’état actuel, il est trop tôt pour en apprécier la portée. Au regard des épidémies précédentes, il est à craindre que le nombre de décès soit élevé. La diffusion de la maladie à l’ensemble du territoire peut entraîner une massification des cas les plus graves.
Au total, entre le 1er mars et le 31 juillet, Santé Publique France a ainsi comptabilisé 30 224 décès attribués à la Covid, dont 19 750 décès à l’hôpital et 10 474 en EHPAD alors que la surmortalité globale entre le 1er mars et le 31 juillet était environ de 25 000. Le confinement et les restrictions de circulation ont limité certaines causes de mortalité (accidents du travail, accident de circulation, etc.). De ce fait l’excédent de mortalité a été évalué sur la période à 25 000 par INSEE. Durant l’été, un phénomène assez logique de sous-mortalité a été constaté, certaines personnes fragiles sont décédées de manière anticipée en raison de la covid-19.
Entre le 1er mars et le 31 juillet 2020, la surmortalité mesurée à partir des données de l’INSEE apparaît concentrée sur les 65 ans et plus, donc essentiellement sur les retraités. Les plus de 65 ans représentent 98,2 % de la surmortalité selon l’INSEE. A contrario, une sous-mortalité est observée chez les moins de 50 ans, plus marquée chez les hommes, de sorte que la surmortalité ne concerne que les seniors. Cette sous-mortalité chez les hommes relativement jeunes s’expliquerait vraisemblablement pour une large part par la diminution des morts accidentelles.
La surmortalité, mesurée par le taux de décès supplémentaires par sexe et âge, atteint 0,6 % chez les femmes de 85 ans et plus pour une mortalité de 11,4 % et 0,85 % chez les hommes de 85 ans et plus pour une mortalité de 14,4 % et augmente fortement avec l’âge parmi les plus de 85 ans, allant jusqu’à dépasser 2 % chez les centenaires.
Ces résultats portent sur la surmortalité observée durant la période allant du 1er mars au 31 juillet 2020. Ils ne prennent donc pas en compte la surmortalité allant du 1er août au 31 octobre.
Avant la survenue de la deuxième vague, la crise sanitaire induirait une baisse de l’espérance de vie à 60 ans d’environ 0,3 an (0,29 an pour les femmes et 0,37 an pour les hommes). L’espérance de vie à 60 ans se situerait alors à 27,5 ans pour les femmes et à 23,1 ans pour les hommes en 2020. Ce résultat est amené à se dégrader au cours du dernier trimestre 2020. Entre 2013 et 2019, l’espérance de vie, mesurée par l’INSEE dans ses bilans démographiques annuels, a augmenté de 1 mois par an, soit l’hypothèse basse des dernières projections démographiques de l’INSEE (projections 2013-2070 basées sur l’année 2013). Avant la crise sanitaire, l’hypothèse basse pouvait ainsi être retenue pour projeter l’espérance de vie attendue en 2020. Selon cette hypothèse basse, l’INSEE projetait que l’espérance de vie à 60 ans atteindrait 27,8 ans pour les femmes et 23,4 ans pour les hommes en 2020.
Sous réserve de l’évolution en cours, un rebond d’espérance de vie devrait intervenir après la fin de l’épidémie comme cela a été constaté après la canicule de 2003. Ce rebond s’expliquerait par le fait que l’épidémie a accéléré le décès de certaines personnes âgées.
Pour le Conseil d’orientation des retraites, l’épidémie aurait des effets limités sur la démographie française à moyen terme. Une légère baisse du nombre de retraités serait constatée par rapport à l’évolution attendue. Ainsi en fonction de la surmortalité observée entre le 1er mars et le 31 juillet 2020, 22 500 retraités (10 900 femmes et 11 600 hommes) seraient prématurément disparus. En conséquence, les effectifs de retraités au 1er janvier 2021 seraient révisés à la baisse de 0,14 % (0,12 % pour les femmes et 0,16 % pour les hommes).
2. Un choc économique d’une rare violence aux effets multiples
Jamais hors période de guerre, l’économie française n’aura connu une telle contraction du PIB, au minimum 10 points en 2020. Le gouvernement espère un rebond de 8 points en 2021 sous réserve que l’épidémie soit maîtrisée assez rapidement, sachant que la deuxième vague pourrait se faire ressentir encore dans les premiers mois de l’année prochaine.
Les régimes de retraite sont très sensibles à l’évolution de la masse salariale et donc de chômage partiel ou pas. Pour l’année 2020, les prévisionnistes anticipent, en moyenne, un taux de chômage allant de 8,0 % à 11,5 % et de 8,4 % à 12,5 % en 2021 (respectivement 9,1 % et 10,0 % en moyenne). Ils sont également sensibles à l’évolution des prix, notamment à travers les règles d’indexation des pensions. Le taux d’inflation devrait être très faible en 2020, proche de 0 % quand en 2021, un très léger sursaut est attendu, autour de 0,7 %. Ces taux sont évidemment inférieurs aux prévisions réalisées en 2019 et ils sont en deçà de leur niveau de moyenne tendance.
À moyen terme, les prévisions sont en l’état délicates. Le gouvernement prévoit à horizon 2024 que la croissance serait de 3,5 % en 2022, année où le PIB retrouverait son niveau de 2019, puis de 2,0 % en 2023 et de 1,4 % en 2024, soit la croissance qui était anticipée pour cette année-là avant la crise. La croissance potentielle, quant à elle, serait négative en 2020 et inférieure à 1 % en 2021, en raison de la crise.
Le nombre de cotisants rapporté à celui des retraités devrait passer de 1,7 cotisant par retraité de droit direct en 2019 à environ 1,6 en 2030 puis 1,3 en 2070.
3. Une hausse mécanique des dépenses de retraite dans le PIB dans les prochaines années
Du fait des départs à la retraite et des modes de liquidation, le montant des pensions est insensible à court terme aux aléas de la conjoncture. Il en résulte que l’ensemble des dépenses de retraite augmentera au sein du PIB de la France.
Avec 330,6 milliards d’euros versés en 2019, les dépenses brutes du système de retraite s’élevaient à 13,6 % du PIB. Entre 2015 et 2019, les dépenses de retraite ont augmenté de 0,7 % en moyenne par an en réel. Du fait d’une progression plus rapide du PIB, la part des dépenses de retraite dans le PIB a régressé de 0,4 point entre 2015 et 2019, passant de 14,0 % à 13,6 %. En 2020, les dépenses de retraite dépasseront les 14 % du PIB. Avec le rebond attendu, ce ratio devrait diminuer dans les prochaines années.
Avec la crise, le montant des pensions à venir serait moindre à celui prévu en 2019. De ce fait, le poids des retraites dans le PIB devrait diminuer après 2024 pour revenir à 12,7 % du PIB en 2070. Le scénario du COR repose une fois de plus sur une croissance élevée de la productivité par tête, 1,3 % par an à partir de 2034.
4. L’effet de la crise sur les ressources
Les ressources du système de retraite qui se sont élevées à 328,7 milliards d’euros, soit 13,6 % du PIB en 2019 devraient baisser de plus de 5 % en 2020 en raison de la contraction de plus de 8 % de la masse salariale. Du fait de la contraction plus importante du PIB, leur poids en son sein s’établirait à 14,1 %. Les ressources progresseraient en réel ensuite plus nettement mais un peu moins que la richesse nationale, de 2,3 % en moyenne par an entre 2020 et 2024 contre 3,7 %, et représenteraient à cet horizon 13,4 % du PIB, quasiment au même niveau que ce qui était envisagé en 2019.
Une augmentation logique du déficit
En 2020, selon le COR, le solde du système de retraite serait négatif et atteindrait 25,4 milliards d’euros, soit 1,1 % du PIB. Ce déficit resterait supérieur à 10 milliards d’euros au moins jusqu’en 2024.
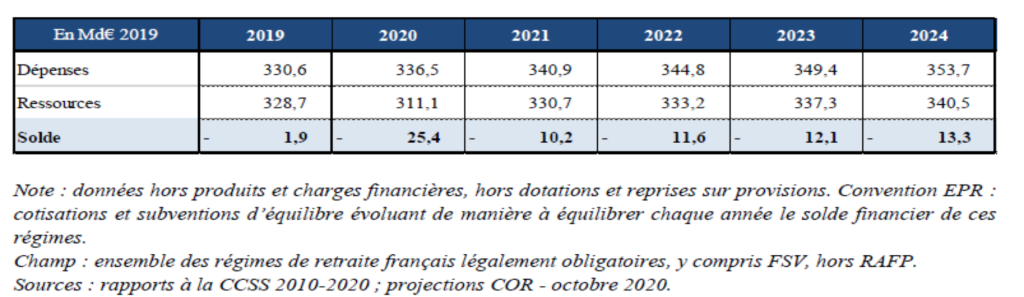
Ce déficit se décompose en deux parties, une partie conjoncturelle liée à la crise sanitaire et une seconde de nature structurelle. En 2020, le besoin de financement du système de retraite qui atteindrait 1,1 % du PIB, serait essentiellement d’origine conjoncturelle (-1 %). Sur la période 2021-2024, le solde financier du système de retraite oscillerait entre 0,4 % et 0,5 % du PIB. Sa composante conjoncturelle se réduirait progressivement pour s’annuler à l’horizon 2024, date à laquelle l’écart de production serait nul.
La situation pour les principaux régimes de retraite
L’analyse concerne la CNAV, le FSV, l’AGIRC-ARRCO, le régime de la fonction publique de l’État et la CNRACL qui représentent 90 % du total des dépenses du système de retraite.
La part des dépenses de retraite de la CNAV dans le PIB progresserait de 0,2 point à l’horizon 2024 par rapport à 2019 (de 5,7 % à 5,9 %) et le régime présenterait un besoin de financement de 0,3 % du PIB à cette date.
Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui finance une partie des prestations de solidarité du système de retraite, serait à l’équilibre, toute chose étant égale par ailleurs en 2024 (-0,1 % en 2019).
Les dépenses de l’AGIRC-ARRCO seraient stables sur la période 2019-2024 (3,4 % du PIB), à l’exception de 2020 où elles atteindraient 3,8 % du PIB, et le régime serait proche de l’équilibre en 2024 grâce aux mesures prises par les partenaires sociaux.
La part des dépenses du régime de la fonction publique d’État dans le PIB serait également quasi stable, passant de 2,3 % en 2019 à 2,2 % en 2020.
Le régime de la CNRACL verrait son poids dans le PIB progresser de 0,1 point à l’horizon 2024 et son besoin de financement serait de 0,1 point de PIB quand le régime était à l’équilibre en 2019. Ce besoin de financement est cependant en partie réduit à cette date par l’apport de nouvelles ressources liées au Ségur de la santé qui devrait aboutir à une augmentation de la rémunération des fonctionnaires, ce qui accroîtra les cotisations.
Mieux vaut être riche et en bonne santé
Selon un article publié dans le numéro de septembre de l’American Economic Review, l’inégalité des richesses s’explique en partie par le fait que les gens peuvent prendre des risques avec leur argent. Les auteurs Laurent Bach, Laurent E. Calvet et Paolo Sodini examinent les bilans de chaque ménage suédois entre 2000 et 2007. Les rendements sont quantifiés grâce à des registres de propriété suédois extrêmement détaillés.
L’étude met en évidence que les ménages les plus riches investissent dans des actifs plus risqués et potentiellement plus rentables
Alors que les ménages ont une variété de choix considérable pour leurs placements, le patrimoine des Suédois de la part des 1 % des plus riches est ainsi investi en grande partie dans le private equity et plus marginalement dans l’immobilier commercial et d’autres actifs financiers risqués.
L’augmentation des rendements avec le patrimoine ne réside presque pas dans un accès des plus riches à de meilleures informations ou dans de meilleures compétences. Elle s’explique en revanche par le fait qu’ils acceptent de prendre de manière régulière davantage de risques. Les riches s’exposent aussi plus à des risques diversifiables, en particulier les entrepreneurs.
L’écart de rendement annuel entre le ménage médian suédois et les ménages suédois les plus aisés atteint ainsi près de cinq points. Pour la totalité de la distribution, des investissements exposés au même niveau de risque permettent d’arriver aux mêmes résultats. Une distribution des richesses initialement égalitaire va finir par se concentrer.
L’étude donne un aperçu de la composition de la richesse et des types d’actifs qui contribuent le plus à l’inégalité en Suède. Les auteurs montrent la répartition moyenne de la richesse brute, ventilée en différentes tranches de valeur nette. L’argent liquide est dominant pour les 20 % des ménages les moins aisés. L’argent liquide devient moins important à mesure que la valeur nette augmente et ne représente que 3 % pour les 0,01 % des ménages les plus aisés. La part des actifs à risque (comme l’immobilier commercial et le capital-investissement) fluctue autour de 10 % pour les ménages situés dans les 70 % inférieurs de la valeur nette. En revanche, elle est presque égale à 95 % pour les 0,01 % les plus riches.
Le logement contribue à modérer la dynamique des inégalités de patrimoine grâce à la possibilité de l’acheter à crédit. L’achat de logement à crédit permet à la « classe moyenne » de bénéficier d’un effet de levier qui augmente son exposition au risque mais aussi le rendement de son patrimoine. En France, la forte hausse des prix de l’immobilier au cours de ces dernières années a limité la dynamique des inégalités de capital.En définitive, les ménages riches obtiennent des rendements moyens élevés parce qu’ils supportent donc un risque systématique élevé. Ce phénomène permet d’expliquer la quasi-intégralité de l’évolution de la part des 1 % les plus riches au début du XXIe siècle en Suède.
La France, le paradis de l’épargne réglementée
La France se caractérise par l’importance de l’épargne réglementée, qui est soumise à des règles fixées par les pouvoirs publics n’obéissant pas pour tout ou partie à celles du marché. Aucun pays européen ne dispose d’une gamme aussi large de produits dérogeant au droit commun avec le livret A, le LDDS, le livret d’épargne populaire, le livret jeune, le plan d’épargne logement. Ces produits bénéficient de taux fixés par l’État et bénéficient de régimes fiscaux particuliers. Avec 772 milliards d’euros, fin 2019, ils représentent, selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, 14 % du patrimoine financier des ménages qui s’élevait à 5 437 milliards d’euros.
En 2019, les ménages avaient déjà tendance à augmenter leur effort d’épargne. La crise des gilets jaunes et les grèves liées à la réforme des retraites avaient conduit à une augmentation du taux d’épargne qui était passé de la fin 2018 à la fin 2019 de 13,8 à 15 % du revenu disponible brut. Les flux de placements des ménages ont ainsi atteint 143 milliards d’euros en 2019 en augmentation de près de 50 % par rapport à 2018 (95 milliards). L’assurance‑vie demeure sans surprise le placement le plus important du patrimoine financier des ménages (38 % en 2019 comme en 2018),
En 2019, les produits de taux représentent 64 % des placements des ménages, et les produits de fonds propres 34 %. Les épargnants ont versé sur les produits de taux 129 milliards d’euros en 2019, contre 69 milliards en 2018. Ils ont notamment renforcé leur assurance‑vie en euros, avec des flux nets de 44,7 milliards d’euros en 2019.
Les flux de placements en numéraire et en dépôts à vue augmentent à un rythme soutenu en 2019 (+ 49 milliards d’euros en 2019, après + 39 milliards en 2018), tandis que les flux des autres dépôts bancaires, rémunérés, progressent plus modestement. Depuis 2013, les flux sur les dépôts à vue sont plus élevés que sur les dépôts rémunérés. Ils dépassent 400 milliards d’euros contre moins de 200 avant la crise de 2008.
L’épargne réglementée a augmenté de 2,7 % en un an. Sa rémunération moyenne est de 1,5 % soutenue par la résilience du taux moyen des plans d’épargne logement. En 2019, cette rémunération moyenne des produits d’épargne réglementée s’est inscrite durablement à un niveau légèrement supérieur à l’inflation ; le rendement de l’épargne réglementée s’est élevé à 1,47 % en moyenne annuelle, contre une inflation qui s’est établie à 1,10 %. Sans le PEL, le rendement réel est en revanche négatif. Cette situation est constatée depuis 2017.
Les produits de fonds propres restent également dynamiques avec une progression de 19 milliards d’euros de placements en 2019, contre 26 milliards en 2018. Les ménages ont particulièrement privilégié les unités de comptes des contrats d’assurance vie, puis les actions. Les flux vers l’assurance-vie en unités de compte s’établissent ainsi à + 4,3 milliards d’euros en 2019, prolongeant la tendance de 2018 (+ 17 milliards). La reprise des placements en produits de fonds propres a accompagné la croissance des cours de Bourse de l’année 2020. Après une chute de 11 % en 2019, le CAC 40 a progressé de près de 25 % en 2019. Dans ce contexte porteur, la valeur des produits en fonds propres détenus par les ménages s’est accrue de + 234 milliards d’euros en 2019, après une chute de 97 milliards l’année précédente. Les actions non cotées et autres participations, dont l’encours représente 19,5 % du patrimoine financier des ménages à fin 2019, ont à nouveau fait l’objet de placements soutenus en 2019 (+ 19 milliards d’euros, après + 14 milliards en 2018).
En revanche, les ménages ont à nouveau, en 2019, cédé des actions cotées détenues directement (– 0,3 milliard d’euros, après + 10 milliards en 2018).
Livret A, le produit d’épargne le plus diffusé en France
Au 31 décembre 2019, le nombre de livrets A s’élève à 55,6 millions, dont 54,9 millions détenus par des personnes physiques et 0,8 million détenus par des personnes morales. Depuis le 31 décembre 2018, le nombre de livrets A se replie de 147 000 unités (– 0,3 %), dont 131 000 livrets pour les personnes physiques, et 16 000 livrets pour les personnes morales. Le taux de détention des personnes physiques s’établit donc à 81,8 % en 2019, après 82,1 % en 2018.
2,6 millions d’unités ont été ouvertes en 2019 quand 2,8 millions ont été fermés. Le processus de détention des double ou triple livret par une même personne arrive à son terme. En effet, en 2016, 7,8 millions de livrets avaient été alors fermés.
En 2019, l’encours du livret A s’est établi à 298,4 milliards d’euros dont 278,2 milliards pour les personnes physiques et 20,3 milliards pour les personnes morales. Depuis le 31 décembre 2018, l’encours des livrets A progresse de 14,7 milliards d’euros (+ 5,2 % depuis 2018), dont la quasi‑totalité du fait des personnes physiques. Quant à l’encours des personnes morales, les organismes de logements sociaux continuent d’en représenter près de la moitié. Les versements sur les livrets A en 2019 se sont élevés à 154 milliards d’euros, quand les retraits ont représenté 142 milliards. La collecte nette (hors intérêts) a été de 12 milliards
L’encours moyen d’un livret A s’élève à 5 100 euros pour une personne physique (4 800 euros en 2018). Le relèvement du plafond en 2012 et 2013 a conduit à la hausse de l’encours moyen. 6 % des livrets A de personnes physiques ont un encours dépassant le plafond réglementaire de 22 950 euros. Ils représentent 30 % de l’encours total.
Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 35 % des encours des livrets A mais 21 % des livrets, soit leur poids dans la population française.
4,7 millions de livrets A sont inactifs – c’est-à-dire sans un versement ou un retrait – depuis au moins cinq ans, dont 3,5 millions ont un encours inférieur à 150 euros. Ces 4,7 millions de livrets représentent un encours de 12,7 milliards d’euros (0,09 milliard pour les seuls livrets à l’encours inférieur à 150 euros).
Le nombre moyen de mouvements constatés sur les livrets A actifs s’établit en 2019 à 4,9 versements et 5,2 retraits par an, soit environ un mouvement par mois. Ces chiffres varient en fonction de l’encours détenu, avec une moyenne de 5 à 6 retraits pour les livrets à l’encours inférieur à 7 500 euros, mais seulement 0,6 retrait pour les livrets au plafond.
Le montant moyen des versements sur les livrets A actifs est de 589 euros, celui des retraits s’élevant à 495 euros.
Le rôle particulier de la Banque Postale
La Banque Postale a reçu une mission de service public dans le cadre de l’accessibilité bancaire qui lui a été confiée. En vertu de cette mission, elle se doit d’ouvrir à toute personne qui en fait la demande un livret A à partir d’un dépôt initial de 1,50 euro, de lui permettre d’effectuer des opérations de retrait et de dépôt à partir de 1,50 euro sur ce support, la gratuité des virements sur le compte à vue du titulaire du livret A quel que soit l’établissement détenteur du compte à vue, et l’acceptation des domiciliations de virements et de prélèvements de certaines opérations. Au total, alors que la Banque Postale détient 27 % des livrets A en France, ces livrets A d’accessibilité bancaire de La Banque Postale ont permis la réalisation de 61 % des 2,4 millions de dépôts en numéraire, 59 % des 21,2 millions de retraits en numéraire, 47 % de l’encours de 0,5 milliard d’euros de dépôts et 77 % de l’encours des 5,3 milliards d’euros de retraits – les livrets à l’encours inférieur à 150 euros représentant la moitié de mouvements.
À noter que 53 % des livrets A ont plus de dix ans, et concentrent 58 % de l’encours.
Le LDDS, le petit frère du Livret A
Même rémunération et même fiscalité que le Livret A, le LDDS évolue sensiblement comme son aîné. Il est certes plus sensible aux évolutions de revenus et de consommation étant souvent associé aux comptes courants de ses titulaires. Le LDDS a été dès sa création, en 1983, distribué par tous les réseaux bancaires quand le Livret A n’était proposé que par les Caisses d’Epargne et la Banque Postale (le Crédit Mutuel pouvait proposer le Livret Bleu).
Au 31 décembre 2019, le nombre de LDDS s’élève à 24,2 millions. En 2019, le nombre net de LDDS a augmenté de 14 000 unités (+ 0,5 %). Cette hausse est une première depuis 2013. Le taux de détention de ce produit s’établit donc à 47,4 % en 2019, comme en 2018. En 2019, 1,6 million de LDDS ont été ouverts, alors que 1,5 million ont été fermés.
L’encours du LDDS demeure dynamique en 2019, s’établissant à 111,9 milliards d’euros. Depuis le 31 décembre 2018, il a progressé de 4,3 milliards (+ 4 %). Les versements sur les LDDS en 2019 se sont élevés à 50 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 46 milliards d’euros. La collecte nette a donc atteint 4 milliards d’euros.
L’encours moyen d’un LDDS s’élève à 4 600 euros (4 500 euros en 2018). Les 19 % de LDDS dont l’encours dépasse le plafond réglementaire de 12 000 euros représentent 51 % de l’encours. Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 41 % des encours des LDDS, mais 34 % des livrets – pour un poids dans la population française de 21 %.
À l’heure actuelle, 1,4 million de LDDS sont inactifs. Ces livrets représentent un encours de 6,8 milliards d’euros.
Le nombre moyen de mouvements constatés sur les LDDS actifs s’établit en 2019 à 3,4 versements et 2,6 retraits par an, soit environ un mouvement tous les deux mois. Le montant moyen des versements sur les LDDS actifs s’établit à 620 euros, contre 708 euros pour celui des retraits. 57 % des LDDS ont plus de dix ans, et concentrent 61 % de l’encours.
Le livret d’épargne populaire, la fin d’un long déclin
Au 31 décembre 2019, le nombre de LEP s’élève à 7,3 millions. Depuis le 31 décembre 2018, une basse de 1 225 000 unités a été constatée (– 14,4%). Le taux de détention des personnes physiques s’établit désormais à 14,3 % contre 16,8 % en 2018. Ce taux de détention est à rapprocher de la proportion de Français majeurs éligibles au LEP du fait d’une condition de ressources, estimée à 50 % de la population (en 2019, le revenu fiscal pour une part était fixé à 19 779 euros). Depuis le mois de septembre 2019, le nombre de LEP augmente néanmoins. Les ouvertures de LEP s’élèvent en 2019 à 0,9 million d’unités, alors que 2,1 millions de LEP ont été fermés. Toutefois, le nombre de fermetures est significativement amplifié par l’arrivée à échéance, en 2019, de la dérogation légale qui a permis à certains détenteurs de conserver un LEP entre 2014 et 2019 alors qu’ils n’en respectaient pas les nouveaux critères d’éligibilité (ce dispositif est parfois qualifié de « clause de grand‑père »). La Banque de France estime que 65 % des fermetures, soit 1,4 million sur 2,1, sont la conséquence de cette arrivée à échéance. Corrigé de cet effet, le nombre de LEP aurait donc progressé de 200 000 unités, une première reprise depuis 2015.
L’encours du LEP a continué à baisser en 2019, pour atteindre 39,4 milliards d’euros. Il a ainsi diminué de 4,0 milliards (– 9,2%). Cet encours progresse toutefois depuis septembre, où il s’élevait à 38,7 milliards d’euros. Les versements sur les LEP en 2019 se sont élevés à 11 milliards d’euros, quand les retraits ont représenté 15 milliards d’euros soit une décollecte nette (hors intérêts) de 4 milliards. Il s’agit de la onzième année consécutive de décollecte nette, depuis 2009.
L’encours moyen d’un LEP s’élève à 5 400 euros, en progression continue depuis 2009 (en 2018, ce montant moyen était de 5 100 euros). Les 41 % de LEP dont l’encours dépasse le plafond réglementaire de 7 700 euros représentent ainsi 69 % de l’encours. Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 53 % des encours des LEP, mais 44 % des livrets.
0,5 million de LEP sont inactifs. Ces livrets représentent un encours de 4,6 milliards d’euros. Le nombre moyen de mouvements constatés sur les LEP actifs s’établit en 2019 à 3,5 versements et 3,3 retraits par an, soit plus d’un mouvement tous les deux mois. 46 % des LEP ont plus de dix ans, et concentrent 55 % de l’encours.
Le plan d’épargne logement, un produit coûteux pour les banques mais intéressant pour certains épargnants
Au 31 décembre 2019, le nombre de plans d’épargne logement s’élève à 13,4 millions. Depuis le 31 décembre 2018, il accuse un repli de 0,9 million de plans (– 6,1 %). De fait, le taux de détention des personnes physiques s’établit à 20,0 % en 2019, contre 21,4 % en 2018. Les ouvertures de PEL s’élèvent en 2019 à 0,8 million d’unités, alors que 1,7 million de PEL ont été fermés. Le nombre de fermetures est en baisse constante depuis 2016, où ce chiffre a atteint 2,1 millions. L’encours du PEL a continué de croître en 2019, s’établissant à 282,5 milliards d’euros. Depuis le 31 décembre 2018, il a ainsi augmenté de 6,1 milliards d’euros (+ 2,2 %). Les versements sur les PEL en 2019 se sont élevés à 26 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 30 milliards – soit une décollecte nette (hors intérêts) de 4 milliards. Cette décollecte est la deuxième consécutive après celle de 2018 qui était la conséquence de la baisse du taux de rendement et de la fiscalisation du PEL. Ce processus de décollecte rompt avec le fort mouvement de collecte des années précédentes. En 2016, elle s’était élevée à 10 milliards d’euros.
Le taux moyen des PEL s’élève à 2,65 % en pondérant le taux d’intérêt par le nombre de PEL, et à 3,13 % en le pondérant par l’encours. 44 % des PEL représentant 45 % de l’encours ont un taux d’intérêt égal à 2,50 % et 5 % des PEL représentant 11 % de l’encours sont rémunérés à un taux au moins égal à 5,25 %. Les caractéristiques sociodémographiques du PEL. L’encours moyen d’un PEL s’élève à 21 000 euros. Cette moyenne cache toutefois d’importantes disparités sociodémographiques.
Si 50 % des titulaires d’un PEL représentent 90 % de l’encours, les 10 % les mieux dotés assurent plus de 40 % de l’encours global.
69 % de l’encours des PEL est compris dans des plans ouverts il y a moins de dix ans, ces derniers représentant 80 % des PEL et dont l’abondement est donc encore possible.
Le PEL est un contrat
Le plan d’épargne logement n’est pas un livret comme le Livret A et le LDDS. C’est un contrat associant l’État, un établissement financier et un épargnant. En vertu du droit des contrats, ce sont les clauses signées au moment qui s’appliquent durant toute la vie du contrat. De ce fait, les modifications relatives au PEL ne peuvent pas être rétroactives. Ainsi, le taux de rémunération est fixé à la signature et court jusqu’à la fin du contrat. Celle-ci n’a été bornée qu’à compter de 2011. Elle ne peut excéder 10 ans pour les versements et 15 ans pour la rémunération au taux initial. Tous les contrats signés avant 2011 sont donc toujours ouverts. Du fait du contexte de taux de l’époque, ils sont bien rémunérés et d’autant plus qu’une prime d’État pouvait s’appliquer, prime supprimée en 2018. Hors prime, les contrats d’avant 2011 peuvent être rémunérés entre 2,5 et 4,75 %.
Les plans souscrits avant le 1er mars 2011 représentaient fin 2019 115,5 milliards d’encours, répartis sur 3,7 millions de plans avec une rémunération de 4,44 % Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, si l’ensemble des PEL souscrits avant 2011 voyaient leur rémunération fixée à 1,00 % – taux applicable depuis 2016 –, le gain en termes de ressources finançant l’économie serait de l’ordre de 4,0 milliards d’euros.
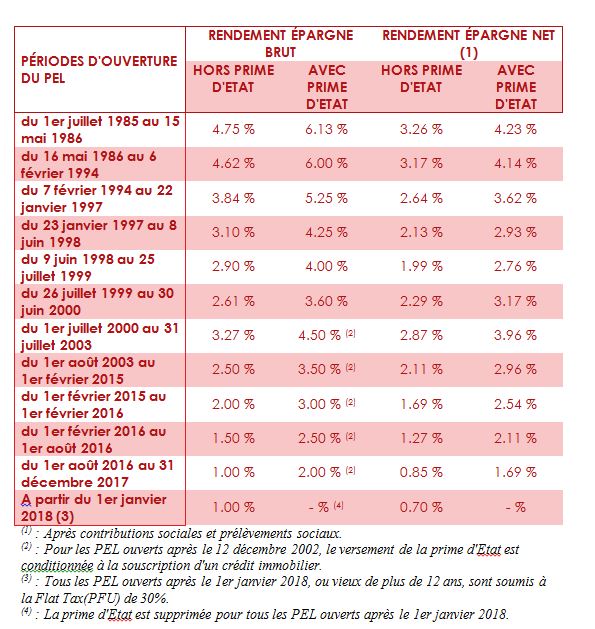
Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, le taux moyen de la rémunération des PEL était de 2,65 % en 2019 mais pour ceux des PEL ouverts avant 2011, ce taux est de 4,4 %. Le rapport 2019 de cet observatoire souligne que « cette rémunération élevée au regard des taux d’intérêt actuels pèse sur l’économie française, en accroissant le coût des ressources disponibles pour le financement de l’économie par les établissements bancaires ».
L’Observatoire indique que l’application d’un taux de 1 % à tous les PEL souscrits avant 2011 pourrait permettre aux banques d’économiser et de reverser dans l’économie 4 milliards d’euros par an.
L’adoption d’une telle réforme est délicate à mener. Elle serait impopulaire et juridiquement osée. Le PEL étant considéré comme un contrat comme l’assurance vie, le législateur a veillé jusqu’à maintenant à ne pas adopter de mesures rétroactives de peur d’une censure du Conseil constitutionnel. La réforme prévue par la loi de finances pour 2011 qui institue une durée de placement de 10 ans pour les PEL en est une des manifestations. Pour modifier les règles rétroactivement, il faudrait donc compter sur la mansuétude du Conseil constitutionnel. Le gouvernement pourrait arguer que la remise en cause du contrat se justifie au nom de l’intérêt général. Ce n’est pas évident à plaider. Il pourrait décider l’arrêt des versements à compter d’une date sans fermeture des plans, cela serait néanmoins une modification substantielle du contrat. Il pourrait fiscaliser davantage les PEL mais cela ne serait guère populaire et cela frapperait tous les titulaires. Ce ne serait pas très juste. L’État et surtout les banques doivent faire face au problème des taux garantis, ce qui est interdit au niveau des contrats d’assurance vie. En Allemagne, le problème s’est posé pour les contrats d’assurance vie. Le gouvernement a obtenu l’abandon des taux garantis après validation législative. Le risque était alors très important pour les compagnies compte tenu des encours en jeu, ce qui n’est pas le cas avec le PEL.
Faut-il verdir l’épargne ?
Les épargnants, leur cassette et la covid-19
Avec le deuxième confinement annoncé le 28 octobre 2020, les Français seront, sans nul doute, amenés à épargner par défaut, de manière subie ou contrainte. À défaut de pouvoir consommer, ils épargneront. Ce comportement est de plus en phase avec leur état d’esprit. La crainte de perdre leur travail et de supporter des baisses de revenus les conduit à renforcer leur épargne de précaution.
Une cassette bien remplie
De mars à juillet, la cassette de la covid-19 – une cinquantaine de milliards d’euros selon le Conseil d’analyse économique d’euros mis de côté – serait le produit des ménages les plus aisés. 70 % de l’épargne supplémentaire aurait été constituée par les 20 % des ménages les plus aisés. Les 10 % les plus riches en termes de revenus auraient été à l’origine de 54 % du supplément d’épargne. Ces résultats ne sont en rien surprenants car, covid ou pas, l’épargne est en France avant tout constituée par le quintile le plus aisé des ménages. Durant le confinement, les ménages ont réduit leurs dépenses, les achats se limitant à l’essentiel : nourriture, abonnements, loyer, etc. Parmi les seuls postes de dépenses en augmentation figurait celui des achats de matériels informatiques. Les ménages les plus aisés consacrent, par nature, une part plus importante que les autres à des dépenses non obligatoires, loisirs, tourisme, etc. Ces activités étant rendues impossibles, leurs capacités d’épargne ont automatiquement progressé. Si depuis le déconfinement, la consommation de biens a retrouvé, voire dépassé, son niveau d’avant crise, celle de services demeure encore très en retrait du fait de la forte contraction des activités culturelles, de loisirs, de restauration et d’hébergement.
Avec le deuxième confinement, cette poche pourrait tendre vers plus de 75 milliards d’euros. Elle sera sans précédent à la hauteur de l’évènement auquel est confrontée la France.Pour les économistes du Conseil d’analyse économique, les 10 % les plus pauvres se seraient endettés ou du moins auraient désépargné pour faire face à une baisse de leurs revenus par ailleurs majoritairement constitués de
revenus de transferts. Les ménages du premier décile ont été les plus affectés par la forte contraction de l’intérim, des contrats à durée déterminée et de la suppression des heures supplémentaires. En revanche, il convient de souligner que la collecte du livret d’épargne populaire qui était en baisse depuis plus d’une décennie est de nouveau positive depuis le mois de mars. Ce produit qui ouvre droit à une rémunération de 1 point est réservé aux personnes globalement non imposables à l’impôt sur le revenu. De même, la collecte du livret jeune est depuis six mois positive.
Qui sont les épargnants ?
Dans les propos de certains commentateurs et de certains économistes, cette épargne serait illégitime. À demi-mot, les pouvoirs publics devraient punir les épargnants d’avoir épargné, de ne pas consommer et de ne pas contribuer à la relance du pays. Si les Français mettent de l’argent de côté, c’est avant tout par peur des lendemains qui pourraient déchanter. L’absence de visibilité sur le cours de l’épidémie n’incite pas à se lancer dans des achats inconsidérés, la prudence est de mise. Ce phénomène est constaté à chaque crise, que ce soit en 1993, en 2009 ou en 2012. Le Conseil d’analyse économique estime qu’il conviendrait d’accorder des prestations supplémentaires aux plus modestes afin qu’ils puissent consommer davantage. Sans nier la faiblesse de leurs revenus et des difficultés que peuvent rencontrer au quotidien les 10 % des ménages les plus modestes, il convient de se remémorer qu’en 2018/2019, dans le cadre du règlement de la crise des Gilets Jaunes, le gouvernement avait alors prévu 17 milliards d’euros d’aides aux ménages à faibles revenus. Or, ces 17 milliards d’euros n’ont aucun effet sur la consommation ; en revanche, la collecte du Livret A a fortement augmenté. Les Français du premier quintile qui sont menacés de perdre leur emploi sont les premiers à tenter de mettre de l’argent de côté.
L’épargnant n’est pas un nuisible ?
L’épargnant est de plus en plus mis au ban de l’empire ; autrefois loué, il est devenu un mauvais patriote. Mettre de l’argent de côté était un signe de bonne gestion, de prévoyance, de bonne santé morale. La fourmi l’emportait sur la cigale à tous les coups. Aujourd’hui, l’épargnant devrait cesser de l’être afin de défendre l’économie. Pour autant, il doit consommer responsable, faire attention à la planète, aux animaux, et ne pas émettre de gaz à effet de serre. Consommer sans le faire peut amener l’épargnant citoyen à l’inaction ou à la schizophrénie.
L’épargne a encore de nombreuses qualités. Elle permet de préparer l’avenir, de financer l’État, les entreprises, le logement social avec le Livret A et l’économie sociale et solidaire avec le livret de développement durable et solidaire (LDDS). Si les Français n’épargnaient en moyenne plus de 15 % de leur revenu disponible brut, la notation de la France et les capacités d’emprunt de l’État seraient tout autres.
Comment dégonfler la cagnotte ?
Pour certains, le dégonflement de la cagnotte liée à l’épidémie passe par l’augmentation des prélèvements. Puiser dans l’épargne covid de manière fiscale aurait comme conséquence des retraits massifs avec une préférence absolue pour la liquidité immédiate, le compte courant ou la monnaie fiduciaire. Par ailleurs, l’augmentation des prélèvements sur l’épargne a, en règle générale, l’effet inverse, en conduisant les ménages à épargner davantage afin d’effacer la perte subie sur le patrimoine.
La question de la réorientation de l’épargne se posera surtout après les confinements. Néanmoins, les épargnants auraient peut-être intérêt à effectuer des arbitrages avant la fin de l’année. Le Plan d’épargne retraite lancé le 1er octobre 2019 constitue un outil répondant tout à la fois à la crainte de baisse des revenus après la liquidation des droits à pension et à la nécessité de financer les entreprises en recourant moins aux crédits bancaires. L’assurance vie et le plan d’épargne en actions sont les deux autres enveloppes permettant une réelle transformation de l’épargne liquide.
La diabolisation de l’épargne serait une erreur au moment où le rétablissement d’un minimum de confiance en ces temps troublés est une ardente obligation. Les pouvoirs publics doivent accompagner les épargnants afin de les inciter en douceur à surmonter la peur du lendemain. Les injonctions et les menaces ne sont pas de mises en la matière. L’épargne pourrait être mobilisée de manière positive pour contribuer au financement des recherches sur la santé, sur les nouvelles énergies, sur les nouveaux moyens de transport. Les sujets ne manquent pas sous réserve de ne pas rejeter le progrès.
L’épargne verte tiendra-t-elle ses promesses ?
L’épargne des ménages représentait, selon la Banque de France, fin 2019, plus de 5 437 milliards d’euros dont 3 576 milliards d’euros en produits de taux. Avec la crise sanitaire en cours, les ménages ont accru leur effort d’épargne en privilégiant les placements liquides et faiblement rémunérés. Selon le Conseil d’analyse économique, le supplément d’épargne lié au Covid-19 dépasse 55 milliards d’euros. Du mois de mars au mois d’août 2020, l’encours des dépôts à vue a augmenté de 47 milliards d’euros, celui du Livret A et du LDDS de 26 milliards d’euros et celui des livrets bancaires de 14 milliards d’euros. En revanche, l’assurance vie qui est un placement de plus long terme a enregistré une décollecte nette de 8,4 milliards d’euros.
L’épargne constitue une partie des revenus qui fait l’objet d’une renonciation à la consommation. Elle permet tout à la fois de répondre à des besoins réels ou potentiels à venir et de rembourser le capital des emprunts souscrits dans le passé. En France, deux tiers de l’effort d’épargne des ménages sont ainsi affectés au remboursement du capital des emprunts immobiliers. L’épargne est logiquement un flux, bien que souvent abordé sous forme de stock ou d’encours. Les deux approches sont différentes. Le stock de capital est alimenté par les flux d’épargne et peut connaître, par ailleurs en fonction des valeurs de marché une appréciation ou une dépréciation. En 2019, le flux d’épargne a été de 143 milliards d’euros quand le capital financier détenu par les ménages a augmenté de 465 milliards d’euros en raison de la forte valorisation des actions.
La mobilisation de l’épargne covid-19 est au cœur du débat public depuis la fin du confinement. Certains souhaitent qu’elle alimente la consommation quand d’autres rêvent de sa réorientation vers des placements de long terme afin de contribuer notamment à la transition énergétique.
Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), demandent que l’épargne soit mise au service de la transition écologique. Parmi les 149 propositions élaborées par les 150 citoyens et présentée au gouvernement le 21 juin dernier, une concerne l’épargne. La PT3 (le nom de code de la proposition) préconise de modifier la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations en y intégrant la notion de transition écologique afin de permettre « une orientation massive de l’épargne réglementée vers les investissements verts ». L’objectif est de mettre à disposition de la transition le Livret A et le LDDS. Cette proposition n’est pas nouvelle. Un décret d’application de la loi Sapin 2 datant de 2017 permet déjà le fléchage de l’épargne du Livret A et du LDDS. Les banques sont censées orienter vers l’économie sociale et solidaire au minimum 5 % de l’encours du LDDS et du Livret A, non centralisé à la Caisse des dépôts.
En souhaitant réorienter l’épargne de précaution en faveur de la transition énergétique, les membres de la convention entendent assécher les activités qui ne seraient pas compatibles avec la transition énergétique. Ils reprennent ainsi la thèse de Jeremy Rifkin qui pense que dans les prochaines années, les activités carbonées périront par manque de ressources financières, les investisseurs s’en détournant que ce soit par la pression des marchés ou par l’application de normes. Un manichéisme trop violent pourrait être contre-productif. Ainsi, faut-il priver Total de financement en tant que symbole de l’industrie pétrolière ou au contraire accélérer sa mutation ? Les grandes entreprises au cœur de la production carbonée disposent d’un savoir-faire, de compétences qui peuvent être utiles pour la transition énergétique. Ils possèdent aussi de capitaux qu’il serait irrationnel de ne pas exploiter. Pour certains, au nom de la théorie Kodak, en vertu de laquelle les représentants du monde d’avant sont incapables de s’adapter aux nouvelles règles, il vaut mieux les asphyxier quand pour d’autres leur apport est indispensable. Plusieurs fonds d’investissement ainsi que quelques banques semblent choisir cette voie qui pourrait se révéler périlleuse sur le terrain de l’emploi. Affaire à suivre !
Nouvelle vague
L’édito de novembre de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne
En cet automne 2020, nous sommes loin de l’insouciance de « la Nouvelle Vague » qui au début des années 1960 a révolutionné les lois du cinéma avec comme illustres représentants François Truffaut, Éric Rohmer, Agnès Varda, Jean Eustache, Jacques Rivette, Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard. Il y a bien longtemps que l’esprit de liberté des Trente Glorieuses s’est évanoui. Le monde semble être de nouveau entré dans une phase sombre de son histoire.
Trois crises majeures menacent l’Occident, l’épidémie de covid-19, l’extrémisme islamique et le réchauffement de la planète. Ces trois crises mettent à mal les fondements des démocraties occidentales, la liberté de pensée et de mouvement, la croissance comme moteur de l’économie et de l’ascension sociale et le pluralisme associé à l’état de droit. Les crises à répétition s’accompagnent d’un affadissement des valeurs démocratiques au point que les peuples recherchent de plus en plus des solutions autoritaires. En cette fin d’année, l’accumulation de mauvaises nouvelles pourrait alimenter un mouvement de panique.
L’aversion aux risques qui est de plus en plus répandue pourrait conduire les investisseurs, les épargnants, à opter pour des placements dits sûrs, les obligations d’État au moment même où ceux-ci n’en finissent pas de s’endetter. Ironie de l’histoire, les épargnants semblent demander toujours plus de produits de taux quand la prudence pourrait les inciter à réduire leur poids. Compte tenu de la montagne d’incertitudes auxquelles nous devons faire face, la recherche de la liquidité et de la sécurité apparaît légitime, même si sa rationalité est contestable.Il n’en demeure pas moins que la fin de l’année se rapprochant, il est temps de penser à alléger sa facture fiscale en réorientant une partie de son épargne de précaution vers des placements pouvant contribuer au financement des entreprises. Les épargnants n’ont que l’embarras du choix entre les fonds d’investissement de proximité, les fonds communs de placement dans l’innovation, les SOFICA qui financent le cinéma et bien évidemment l’épargne retraite. Afin de préserver notre pouvoir d’achat en tant que futur retraité, le recours à des suppléments par capitalisation apparaît, de plus, indispensable. Cette épargne longue a de nombreuses qualités dont celle de nous constituer un pécule au moment de la liquidation des droits et celle de renforcer les fonds propres des entreprises. Sur l’ensemble de l’année 2020, les Français devraient mettre de côté environ 150 milliards d’euros dont près de la moitié en raison de la crise sanitaire. En affectant 20 % de l’épargne covid-19 à l’épargne retraite, les ménages français feraient ainsi coup double.
Jean-Pierre Thomas
3 questions à : Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Avec un deuxième confinement en sept mois, quelles sont les conséquences à attendre sur le plan économique?
Après une contraction historique de 13,7 % au deuxième trimestre, le PIB de la France s’est accru de 18,2 % au troisième. La France a enregistré le plus fort taux de croissance au sein de l’Union européenne et précède l’Espagne ainsi que l’Italie. Ce rebond est lié à l’importance du recul des deux trimestres précédents. Les trois pays en tête pour la croissance au troisième trimestre se caractérisent par un poids élevé du secteur touristique au sein de leur PIB. La relative bonne tenue de la saison estivale a facilité la reprise. Avec le deuxième confinement qui est entré en vigueur le 30 octobre, le dernier trimestre devrait enregistrer une nouvelle diminution du PIB.
La seconde vague, qui pour le moment est centrée sur l’Europe, aura un coût économique en l’état difficilement évaluable. Le choc sera moins dur que lors du premier qui avait été marqué par un arrêt total sur image. Les acteurs économiques ont appris à évoluer dans un contexte contraint de risque sanitaire. Les entreprises devraient continuer à tourner tout comme les chantiers. Les échanges commerciaux seront obligatoirement atteints.
La deuxième vague de l’épidémie touchera évidemment les fêtes de fin d’année et devrait avoir un effet négatif non négligeable sur la restauration et l’hôtellerie. Le commerce en ligne devrait battre tous ses records pour la fin de l’année. La progression de son chiffre d’affaires pourrait dépasser 40 % cette année.
Avec l’aéronautique, l’industrie automobile devrait replonger avec la deuxième vague. Au sein de l’OCDE, la production industrielle de matériel de transport s’était contractée de 70 % au cœur de la première vague avant de revenir à 10 % de son niveau d’avant crise. Ce secteur, au-delà de l’épidémie, est confronté au problème de la transition énergétique. Dans le cadre des plans de relance, de nombreux gouvernements ont souhaité l’accélérer au risque de fragiliser un secteur majeur de l’économie de leur pays. Avec la deuxième vague, la capacité de résistance des entreprises sera mise à dure épreuve rendant plus que délicat le maintien de mesures contraignantes sur le plan environnemental.Avant même l’annonce d’un reconfinement, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait admis le 23 octobre que le PIB pourrait diminuer à nouveau au cours du quatrième trimestre. En outre, le ministre soulignait que l’économie française devait faire face à de nombreuses incertitudes, dont les prochaines élections américaines et le Brexit. Il espérait alors que le niveau de 2019 serait atteint d’ici 2022. Avec le reconfinement décidé le 28 octobre, la perte attendue de PIB se situerait entre 2 à 5 points en fonction de la durée et de l’ampleur du confinement d’ici fin décembre. Les dépenses publiques devraient augmenter de plus de 10 milliards d’euros quand les recettes publiques se contracteraient d’autant. Pour l’ensemble de l’année, recul du PIB pourrait se situer entre 9 et 11 points.
L’Europe semble être beaucoup plus touchée que les États-Unis qui pourtant connaissent un taux de mortalité du fait de l’épidémie plus fort. Pourquoi un tel écart au niveau de l’activité ?
L’Europe et les États-Unis devraient avoir des bilans différents à la fin de l’année. Sur le plan sanitaire, la situation n’est d’ailleurs pas identique. L’Europe a été touchée par l’épidémie dès mars quand les États-Unis l’ont été plus tardivement. La courbe du nombre de cas diffère entre les deux zones. Après une forte croissance entre avril et mai, le nombre de nouveaux cas aux États-Unis s’est stabilisé à 40 000 par jour entre la mi-mai et le mois de juin avant de progresser rapidement pour atteindre 80 000 mi-juillet. Une légère décrue est alors intervenue jusqu’en septembre, mois à partir duquel une nouvelle hausse est constatée. Fin octobre, le nombre de cas atteint 70 000 par jour. En Europe, après le pic de mars/avril autour de 40 000 nouveaux par jour, une forte baisse a été constatée entre mai et août avec un nombre de cas inférieur à 10 000. En revanche, la remontée depuis le début du mois de septembre est massive avec plus de 200 000 cas quotidiens en octobre. Le taux de mortalité lié à la maladie y est plus élevé que la moyenne mondiale et de celle de l’Europe. Il est en revanche proche de celui du Royaume-Uni (685 décès par million d’habitants contre 672 au Royaume-Uni et 515 en France). Sur ce sujet, avec l’absence de mesures de confinement, la Suède (517 décès par million d’habitants) se situe au même niveau que la France. Aux États-Unis, la tendance a été au maintien de l’activité avec des confinements localisés, essentiellement dans les grandes villes, sachant que la politique sanitaire dépend des États fédérés. Si le taux de chômage est passé en quelques semaines de 3,5 à 14,7 % aux États-Unis quand celui de l’Europe n’est qu’en légère hausse, les créations d’emploi y sont bien plus nombreuses depuis le mois de juin. Le taux de chômage américain est rapidement redescendu à 7,9 % en septembre.
Sur le plan économique, l’Europe est fortement touchée par la chute du tourisme et de l’activité aérienne. Le nombre de passagers jour est passé de 380 à moins de 100 millions par jour de décembre 2019 à août 2020. Les nouvelles mesures de confinement devraient aboutir à une nouvelle baisse du nombre de passagers pour l’Europe. Cela aura des conséquences sur les recettes touristiques qui compensent, pour la France, une part non négligeable du déficit commercial. Le tourisme représente 9 % du PIB français. Aux dépenses de transports, d’hébergement, de loisirs ou de restauration, il faut ajouter celles liées aux achats (luxe, alimentaire, cadeaux, etc.). Le manque à gagner sera important pour la France, l’Italie et l’Espagne.
Avec la deuxième vague, quel sera le comportement des épargnants ?
De mars à juillet, l’épargne supplémentaire liée à la crise sanitaire représente plus de 55 milliards d’euros. Avec le deuxième confinement, les ménages seront soumis à un nouveau régime de réduction de leurs dépenses de consommation. Le taux d’épargne devrait donc augmenter à nouveau. Il était passé de 15 à 27 % du revenu disponible brut entre décembre 2019 et juin 2020. Au troisième trimestre, il est revenu a priori autour de 20 %. Il devrait certainement se situer entre 22 et 25 % pour le dernier trimestre en fonction de la durée du reconfinement et des modalités de sortie. La poche d’épargne de précaution devrait de toute façon s’accroître. Certes, avec la fin de l’année, un certain nombre d’épargnants auraient tout intérêt à effectuer des arbitrages en faveur de l’épargne de long terme. Cela concerne évidemment ceux qui ne sont pas affectés en matière d’emploi et de revenus par la crise sanitaire. Cette réorientation peut s’imposer pour des raisons fiscales. L’octroi des réductions et des déductions fiscales suppose d’effectuer les placements idoines avant la fin de l’année.
Opinion | Santé : la faillite d’un système suradministré
Le « meilleur système de santé du monde » est au bord de la rupture. Complexités, manque d’agilité, déresponsabilisation des acteurs… le Covid-19 a fait apparaître au grand jour ses difficultés chroniques, écrit l’économiste Philippe Crevel.
Réforme des retraites : Jean Castex reçoit les syndicats
Le directeur du Cercle de l’Épargne est cité dans cet article de Planet relatif à l’avenir de la réforme des retraites. Pour Philippe Crevel, » la nouvelle stratégie pourrait se faire par étapes. Le régime unique ne sera probablement pas imposé à l’ensemble des caisses en 2024. Cela pourrait se faire plus progressivement. On pourrait dès lors imaginer que les salariés entreraient les premiers dans le régime universel. Les autres professions, dépendant des régimes spéciaux, suivraient, petit à petit ».
Plan épargne logement : voilà pourquoi le taux de votre PEL ne baissera pas
Philippe Crevel est cité dans cet article de Capital qui évoque la possible évolution de la rémunération des PEL ouverts avant le 1er mars 2011. Le problème a été mis en avant par le rapport annuel 2019 de la Banque de France sur l’épargne réglementée. Le taux moyen de la rémunération des PEL était de 2,65 % en 2019 mais ceux des PEL ouverts avant 2011, ont une rémunération de près de 4,4 %. Comme le souligne Capital, « les PEL souscrits en 2002 permettent encore aujourd’hui de toucher une rémunération de 4,50% (prime d’Etat incluse) », ce qui correspond à “un taux complètement anachronique” selon l’économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne.
Sommet social : et s’il y avait une seule réforme à faire par ces temps de pandémie, laquelle serait-elle ?
Le directeur du Cercle de l’Épargne est l’une des cinq personnes interrogées dans cet article d’Atlantico sur la meilleure réforme à mettre en oeuvre en ces temps de crise du Covid-19.
Près d’un Français sur deux préfère emprunter que de puiser dans son épargne
L’article du Figaro souligne que pour le directeur du Cercle de l’Épargne ‘privilégier le crédit à la consommation à l’épargne n’est pas rentable à long terme, et peut même être coûteux’. En effet pour Philippe Crevel: «La plupart du temps, les individus placent leur épargne de manière peu ou pas rémunérée. Or en souscrivant à un crédit à la consommation, ils vont faire face à des taux forcément plus élevés que ceux appliqués à l’épargne, et donc à terme perdre de l’argent».
Fusionner le Livret A et le LDDS, une bonne idée ?
MoneyVox cite Philippe Crevel dans cet article sur la possibilité d’une fusion sur le livret A et le LDDS. Philippe Crevel y explique notamment qu’en cas de fusion entre ces « deux produits qui possèdent les mêmes caractéristiques » , il est possible d’ « imaginer un produit qui maintienne un haut niveau, autour de 30 000 euros ou un peu moins ».
L’épargne et l’assurance vie à l’heure du digital
À partir du début des années 2000, de nouveaux acteurs bancaires ont émergé en parallèle des banques traditionnelles. Cette nouvelle offre ne cesse de gagner en importance. Lors de son émergence, ces « néobanques » ou banques en ligne s’adressaient surtout à des clients déjà bancarisés et cherchant un complément aux réseaux bancaires physiques.
Elles parviennent à fidéliser aujourd’hui une très large clientèle même si leur rôle reste très limité pour des opérations aussi structurantes que l’acquisition d’un bien immobilier.
Les produits d’épargne comme l’assurance vie ou le livret d’épargne ont été primordiaux dans un premier temps pour permettre aux banques en ligne de conquérir de nouveaux clients. Aujourd’hui, ce sont les stratégies commerciales reposant sur les services bancaires quotidiens (compte courant couplé à une carte de paiement) qui jouent pour eux un rôle décisif dans l’obtention et la fidélisation de nouveaux clients.
Ces nouvelles banques qui tâchent de rendre le client aussi autonome que possible, sont dans leur grande majorité rattachées au réseau bancaire classique étant donné qu’elles ont souvent été créées ou achetées par des banques traditionnelles. Boursorama, qui a été créée en 1998, est ainsi depuis 2002 une filiale de la Société Générale. Fortuneo appartient à 100 % au Crédit Mutuel Arkea et le compte Nickel est une filiale de BNP Paribas.
Le problème, ce n’est pas l’épargne mais l’investissement
Depuis la sortie du confinement, la question de l’utilisation de la cagnotte des ménages est au cœur du débat, en France comme ailleurs. Dans tous les pays de l’OCDE, les aides publiques ont été massives, compensant tout ou partie des pertes des revenus. Aux États-Unis, le revenu des Américains aurait même augmenté. En France, la perte est évaluée au maximum à 5 %. Dans ce contexte, le problème n’est donc pas la perte de revenu, mais son utilisation. Cette question vaut pour les épargnants mais aussi pour les entreprises qui depuis plusieurs mois augmentent leur trésorerie.
Les déficits publics ont augmenté en quelques semaines dans des proportions sans précédent. Pour les pays de l’OCDE, les déficits sont passés de -2 à -14 % de la fin de l’année 2019 au mois de septembre 2020. L’effort budgétaire dépasse la contraction du PIB qui devrait se situer toujours pour les pays de l’OCDE entre -5 et -7 %.
Logiquement, en période de fort chômage et de baisse d’activité, les ménages sont contraints de puiser dans leur bas de laine pour compenser la diminution des revenus. Or, dans tous les pays avancés, le taux d’épargne augmente. Il est passé de 10 à 14 % en moyenne. En France, il s’élevait à 27,4 % à la fin du deuxième trimestre contre 15 % à la fin de l’année 2019. Les encaisses monétaires des ménages ont connu une croissance verticale. Elles atteignent 16 % du PIB, contre 6 % avant la crise. L’épargne subie durant le confinement s’est transformée en épargne de précaution. La multiplication des annonces anxiogènes et contradictoires en raison du manque de connaissances sur la maladie incite les ménages à maintenir un fort volant de liquidités.
Les ménages épargnent liquide et sans risque par peur
Depuis le début de la crise sanitaire, le surplus d’épargne lié à la crise sanitaire est évalué entre 75 et 100 milliards d’euros. Les Français ont épargné de manière contrainte entre mars et mai. Cette épargne contrainte s’est ensuite muée en épargne de précaution. L’épargne est un signe d’anxiété, lié à la peur de perdre son emploi, ses revenus.
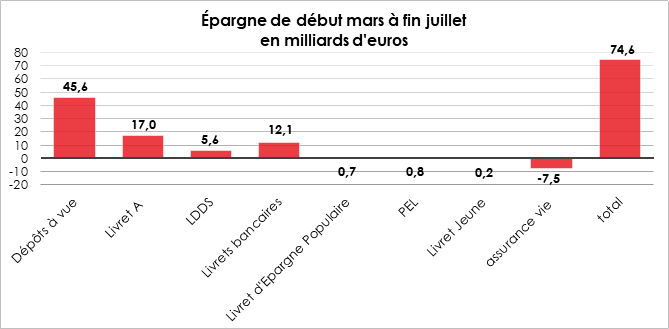
Tout le monde épargne
Depuis le mois de mars, tout le monde épargne, y compris les personnes à revenus modestes comme le prouve la progression du Livret d’Épargne Populaire après dix ans de déclin, et les jeunes qui ont également mis de l’argent sur leur Livret Jeune. Néanmoins, ce sont les cadres vivant dans les grandes agglomérations qui ont mis le plus d’argent de côté. L’épargne a progressé parce que l’État a joué le rôle d’amortisseur : chômage partiel ; aides aux entrepreneurs, PGE, etc. La France est le pays de l’OCDE où les revenus ont le moins baissé depuis le début de la crise.
Les ménages privilégient la sécurité, la liquidité et s’assoient sur le rendement
Le placement numéro un est un non-placement puisqu’il s’agit des dépôts à vue, des comptes courants, avec une hausse de +45 milliards d’euros depuis mars. L’encours atteint la coquette somme de 459 milliards d’euros contre moins de 200 milliards d’euros en 2007. Le Livret A (produit plafonné à 22 950 euros) avec son rendement de 0,5 % a collecté 2,25 milliards d’euros en août et près de 25 milliards d’euros depuis le début d’année. Le Livret de développement durable connaît également une forte progression : +7 milliards d’euros depuis le début d’année avec un plafond à 12 000 euros et le même rendement que le Livret A. Même les livrets bancaires fiscalisés qui offrent en moyenne une rémunération de 0,13 % (selon la Banque de France) connaissent des collectes positives (+12 milliards d’euros depuis le début du mois de mars).
L’assurance vie délaissée mais pas coulée
L’assurance vie, produit d’épargne de moyen et long terme est délaissée depuis le mois de mars. Depuis le début de la crise sanitaire, la décollecte a atteint 8,4 milliards d’euros (de mars à août). Les ménages ne veulent pas s’engager sur le long terme et s’ouvrir sur des placements dits risqués (sous forme d’unité de compte à hauteur de 30 % pour les nouveaux versements).
Que faire de la cagnotte ?
Le concours Lépine de l’épargne semble ouvert. Tout le monde veut sa part : les commerçants, le bâtiment, l’État, etc. C’est oublier que l’épargne appartient aux épargnants !
Les idées saugrenues ne manquent pas. Parmi celles-ci figure la taxation de l’épargne. Elle n’est pas pour le moment d’actualité. En effet, taxer les épargnants pour favoriser la consommation génère l’effet inverse à celui escompté. Pour compenser la taxation, l’épargnant épargne plus. Cette mesure renforcerait le sentiment de défiance à l’égard des pouvoirs publics. Les ménages pourraient retirer l’argent de la banque pour échapper aux taxes. Afin de relancer la consommation, certains estiment qu’il faudrait obliger les ménages à dépenser leur numéraire, leurs billets en fixant des dates de fin de cours légal sur certaines coupures. Par exemple, tous les détenteurs de billets dont le numéro se terminerait par « deux » auraient deux mois pour les écouler. Pour inciter à la consommation, d’autres imaginent de diminuer le rendement de l’épargne. Or, une telle baisse aurait le même effet que la taxation. Les ménages seraient conduits à mettre plus d’argent de côté afin d’atteindre l’objectif patrimonial qu’ils se sont fixé, implicitement ou explicitement.
En France, la création de nouveaux supports d’épargne a été érigée en art. De ce fait, il n’est pas étonnant que pour relancer l’économie et favoriser la transition énergétique, l’idée de créer de nouveaux produits ait ressurgi. La France dispose déjà d’un nombre impressionnant de produits qui couvrent un grand nombre de domaines. Elle est déjà une exception. L’épargne réglementée n’existe pas chez nos partenaires. Nul n’a osé inventer une telle machinerie.
- Le livret A : épargne de court terme qui finance du long terme : logement social, collectivités locales, PME
- LDDS : épargne de court terme qui finance les entreprises notamment celles intervenant dans le domaine du développement durable et l’économie sociale
- L’épargne logement
- Le Livret d’Épargne Populaire
- Le Livet Jeune
À cela il faut ajouter, les FCPI pour l’innovation, les FIP pour l’investissement régional. Pour les actions françaises et européennes, les épargnants ont accès au Plan d’Épargne en Actions. Pour le non-coté, ils disposent du PEA-PME. L’assurance vie permet tout à la fois de financer les États et les entreprises. Enfin, il convient de souligner le Plan d’Épargne Retraite qui a été créé par la loi PACTE en 2019 afin justement de faciliter la réorientation de l’épargne vers le long terme. Les ménages ont ainsi l’embarras du choix en matière de produits d’épargne. Le lancement d’un nouveau produit supposerait une rémunération plus alléchante que le marché, or aujourd’hui, l’État emprunte à taux négatif. Les entreprises n’ont pas de problèmes de financement. Leur trésorerie est excédentaire à l’heure actuelle. Ce raisonnement vaut également pour un éventuel grand emprunt. L’État ou les épargnants seraient perdants. Soit le gouvernement impose un taux négatif et l’épargnant est perdant ; soit il accepte de rémunérer positivement l’emprunt et c’est l’État et donc les contribuables qui y perdront.
Pour dégonfler la cagnotte, certains imaginent multiplier les incitations fiscales et les primes. En règle générale, ces mesures génèrent un important effet d’aubaine. Que ce soit pour l’automobile, le bâtiment, ceux qui en profitent avaient de toute façon l’intention d’acheter une voiture ou de réaliser des travaux. Or, ces mesures ont un coût fiscal important. Elles peuvent, de plus, accroître le déficit commercial déjà important du pays. En outre, il est difficile de mettre un terme aux niches et aux primes, elles jouent le rôle de drogue.
De fait, plus le gouvernement s’agitera, plus l’épargnant entrera dans sa coquille. Parfois, il n’est pas mauvais de ne pas trop vouloir en faire. Ce n’est pas à la mode mais ce n’est pas un mauvais conseil.
La question n’est pas l’épargne mais l’investissement
La question centrale n’est donc pas le comportement des ménages mais plutôt le niveau de l’investissement public et privé. Les plans de relance engagés par les États sont censés favoriser l’investissement. Pour le moment, les entreprises ont eu tendance à augmenter leur trésorerie afin de pouvoir passer le cap de la crise. Certaines ont opportunément utilisé les dispositifs mis en œuvre par les États. La croissance des crédits aux entreprises est en forte hausse au sein de tous les pays occidentaux, +8 % en moyenne depuis le mois de juin. Pour le moment, en raison de l’absence de visibilité sur le front sanitaire, les entreprises investissent peu. Le taux de croissance est, toujours au sein de l’OCDE, nul quand il s’élevait à 4 % avant la crise. L’encours d’actifs liquides et monétaires des entreprises non financières atteignait à la fin de juin 21 % du PIB, contre 19 % avant la crise. Ce ratio était de 16 % en 2007. Les entreprises ont conservé de plus en plus de liquidités depuis la crise financière, leur aversion aux risques a augmenté de manière parallèle à celle des ménages. La reprise de l’investissement conditionne celle de l’économie. Sans investissement, la croissance potentielle s’affadira rendant difficile le remboursement des dettes. Pour créer une impulsion, les pouvoirs publics pourraient favoriser la construction de logements d’autant plus qu’au sein de nombreux pays de l’OCDE, un déficit en la matière existe. Ce dernier contribue à l’augmentation des dépenses de logement en particulier pour les jeunes actifs. Un desserrement des contraintes pesant sur le foncier serait nécessaire. Les gouvernements doivent veiller à ce que les aides publiques ne soient pas trop accaparées par des entreprises dites « zombies » dans l’incapacité d’investir en raison de leur fragilité.
Dis moi combien tu gagnes, je te dirai combien tu épargnes ?
En 2017, le revenu disponible moyen par unité de consommation (UC) est de 29 954 euros, soit environ 2 500 euros par mois. Pour les 20 % les plus modestes, ce revenu est de 1 100 euros par mois, contre 4 700 euros pour les 20 % les plus aisés. En ne tenant compte que des revenus nets d’activité et des revenus du patrimoine, l’écart entre le premier et le dernier quintile serait de 1 à 10. Cet écart est réduit à 4,3 après prise en compte des transferts sociaux et fiscaux.
Pour les ménages les plus aisés, les revenus d’activité indépendante et les revenus financiers représentent respectivement 14 % et 11 % du revenu disponible brut, contre au plus 2 % et 3 % pour les autres ménages. Pour les plus aisés, la part des transferts nets est aussi bien plus faible (4 %) que chez les autres ménages (où, selon le quintile, elle est comprise entre 16 % et 57 %).
Les ménages les plus aisés contribuent à deux tiers des impôts sur le revenu. Les transferts représentent 28 % de leurs revenus contre une moyenne de 35 % en France. Ces transferts prennent essentiellement la forme de pensions de retraite. Pour les 20 % les plus modestes, les transferts nets représentent plus de la moitié de leurs revenus quand pour les autres ménages, les revenus d’activité assurent la plus grande partie des revenus.
De 2011 à 2017, le revenu des 20 % les plus aisés a baissé de 6,7 % en euros constants principalement en raison de la chute de leurs revenus financiers (-30,6 %). Cette contraction s’explique par la crise des dettes souveraines et par le durcissement de la fiscalité. Les produits financiers ont été soumis, pour les années 2013 à 2017, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Les ménages des quatre premiers déciles ont enregistré entre 2011 et 2017 une hausse de leurs revenus en euros constants. Pour le premier quintile, cette hausse est imputable à l’augmentation des transferts nets qui a été, sur l’intervalle, supérieure à la baisse des salaires nets. La croissance du RDB des quintiles intermédiaires s’explique presque intégralement par la hausse des salaires nets.
Entre les ménages du premier quintile de RDB/UC et ceux du dernier, la dépense de consommation par UC varie de 1 à 3,1 (contre 1 à 4,3 pour le RDB). Le plus souvent, la structure du panier de consommation reste néanmoins assez proche pour tous les quintiles. En 2017, le poids de l’alimentation dans la dépense des plus modestes est ainsi supérieur de 4,6 points à celui des plus aisés. En proportion de leur consommation totale, les premiers dépensent aussi deux fois plus en communication que les derniers, et deux fois plus en alcools et tabac. En revanche, la part budgétaire de l’ameublement et de l’entretien de la maison est moins importante, reflétant la plus faible proportion de propriétaires dans ce premier quintile. Ils dépensent aussi moins en hôtels et restaurants.
Entre les ménages du premier quintile de RDB/UC et ceux du dernier, la dépense de consommation par UC varie de 1 à 3,1 (contre 1 à 4,3 pour le RDB). Le plus souvent, la structure du panier de consommation reste néanmoins assez proche pour tous les quintiles. En 2017, le poids de l’alimentation dans la dépense des plus modestes est ainsi supérieur de 4,6 points à celui des plus aisés. En proportion de leur consommation totale, les premiers dépensent aussi deux fois plus en communication que les derniers, et deux fois plus en alcools et tabac. En revanche, la part budgétaire de l’ameublement et de l’entretien de la maison est moins importante, reflétant la plus faible proportion de propriétaires dans ce premier quintile. Ils dépensent aussi moins en hôtels et restaurants.

En 2017, le taux d’épargne passe de 2,7 % du RDB pour les ménages du premier quintile à 28,4 % chez ceux du dernier quintile. De 2011 à 2017, les taux d’épargne auraient tendance à augmenter pour les quatre premiers quintiles, les revenus augmentant plus vite que la consommation. En revanche, le taux d’épargne des 20 % de ménages les plus aisés perd 5 points, dont 3 points entre 2012 et 2013.

Les plus de 70 ans dégagent le plus fort taux d’épargne, 21,8 %, contre 15,9 % en moyenne en 2017. Les retraités en France épargnent, et cela même au-delà de 70 ans. Cette situation est liée au fait que leur niveau de vie est de 5 points au-dessus de la moyenne de la population et qu’ils ont tendance à restreindre leurs dépenses avec l’âge. Le taux d’épargne est, en revanche de moins de 9 % chez les moins de 40 ans. Il passe à 17,8 % chez les 50-59 ans.
Les écarts de revenu selon l’âge sont moins élevés qu’entre les quintiles de « niveau de vie ». Les 40-49 ans constituent la catégorie la plus aisée, percevant un revenu par ménage deux fois plus élevé que les moins de 30 ans qui sont les plus modestes. Chez les ménages seniors (60 ans ou plus), les prestations (principalement les pensions de retraite) représentent fort logiquement la grande partie des revenus, 70 % en moyenne quand chez les moins de 60 ans, les revenus d’activité constituent la source essentielle de revenu (86 % du RDB).
Entre 2011 et 2017, les revenus des ménages les plus âgés (70 ans ou plus) s’accroissent fortement (+8,6 % en euros constants) en raison du dynamisme des prestations retraites. Cette augmentation est imputable à l’effet noria. De larges cohortes d’actifs comportant de nombreux cadres sont parties à la retraite ces dernières années. Par ailleurs, le niveau des pensions des femmes progresse du fait qu’un nombre croissant dispose d’une carrière complète au moment de la liquidation des droits. En revanche, le revenu des ménages les plus jeunes (moins de 30 ans) diminue en raison de la montée de la précarité professionnelle.
Par rapport aux plus jeunes, les seniors dépensent une plus grande part en alimentation et sensiblement moins en transports et en hôtels et restaurants.
L’INSEE calcule un revenu disponible brut ajusté qui prend en compte les transferts en nature (crèches, école, repas, loisirs, transports, etc.). Ces transferts représentent 20 % du revenu disponible brut ajusté. Pour les 20 % les plus modestes, le taux des transferts ainsi comptabilisés atteint plus de 70 % quand pour le dernier quintile, ce taux est inférieur à 20 %. En retenant ce mode de calcul, l’écart de revenus entre le premier et le dernier quintile est ramené à 3 contre 4,4 avec le mode de calcul fondé sur le simple revenu disponible brut.
La socialisation des revenus est en France très élevée pour les 20 % des ménages les plus modestes qui sont de facto placés sous un régime de revenu universel sans le dire. Par ailleurs, il apparaît clairement que le coût de l’immobilier constitue pour les jeunes générations un facteur d’appauvrissement marqué, leurs dépenses pré-engagées pouvant atteindre 50 % de leur RDB. Si malgré des transferts importants, les plus élevés au sein de l’OCDE, le niveau d’insatisfaction sociale progresse d’année en année, l’origine est liée au ralentissement de l’ascension sociale, à la perte de valeur du travail certainement en lien avec la socialisation des revenus et aux problèmes de logement. La précarité croissante en début de carrière génère, par ailleurs, d’importantes frustrations conduisant à une dégradation du climat social. Il n’en demeure pas moins que le taux d’épargne en France demeure élevé, en particulier chez les seniors.
La santé, ici et ailleurs
Les États-Unis détiennent de loin le record des dépenses de santé en y consacrant, en 2018, 17,8 % de leur PIB. Ils devancent de près de 6 points la Suisse (11,9 %). Arrivent après l’Allemagne (11,5 %), et la France (11,3 %). En moyenne, les États membres de l’Union européenne consacrent 9,9 % de leurs PIB aux dépenses de santé. Les pays du cœur de l’Europe dépensent en moyenne 10 % du PIB quand ceux du sud de l’Europe y consacrent 8 % et ceux de l’Est autour de 7 % à 9 %). En retenant comme critère de comparaison les dépenses de santé en parité de pouvoir d’achat (PPA), la France se situe au 7e rang des pays au sein de l’Union européenne et est proche de la Belgique ou du Danemark.
La dépense de santé par habitant s’élève, en France, à 3 970 euros par habitant en 2018. Aux États-Unis, en parité de pouvoir d’achat, les dépenses sont de 8 180 euros par habitant. L’écart est plus modéré avec l’Allemagne qui consacre seulement 820 euros toujours en parité de pouvoir d’achat de plus par habitant que la France.
Des dépenses de santé essentiellement concentrées vers les soins hospitaliers et de ville
La structure des dépenses de santé selon leur fonction varie considérablement d’un pays à un autre. Près de 69 % des dépenses de santé des États-Unis se rapportent aux soins courants, dont 48 % pour les soins courants en cabinet de ville et 18 % pour les soins hospitaliers. Les soins courants représentent 54 % de la dépense de santé pour le premier cercle des États de l’Union européenne (UE – 15) avec une prédominance des soins courants hospitaliers (29 %). Les dépenses consacrées aux soins de ville sont plus élevées au Portugal (39 %) ou en Finlande (34 %). À l’inverse, elles sont plus faibles en France ou en Grèce pour lesquels elles représentent 18 % de la dépense. Les biens médicaux (produits pharmaceutiques et appareils médicaux) sont la troisième grande catégorie de dépenses de santé. La part des biens médicaux est particulièrement importante dans les pays les plus pauvres de l’OCDE.
Le taux de croissance des dépenses de santé reste modéré depuis 2013
Avec le vieillissement de la population, les dépenses de santé ont tendance à augmenter plus vite que le PIB. De 2013 à 2018, les dépenses de santé ont augmenté de 4 % l’an en Allemagne, un des pays les plus concernés par l’augmentation du nombre de personnes âgées. La croissance de ces dépenses est aussi soutenue aux États-Unis où une accélération est constatée avec la mise en œuvre de l’Obamacare. En France, leur croissance se situe autour de 2 % l’an. Les pouvoirs publics tentaient, avant la crise sanitaire, de caler la croissance des dépenses de santé sur celle du PIB. En France, la convergence avait été obtenue en 2018. L’augmentation plus rapide du PIB a facilité ce processus quand la crise de 2008/2009 s’était traduite par une augmentation de la santé dans le PIB. L’épidémie de Covid devrait aboutir à une progression très nette des dépenses de santé tant en raison de la contraction du PIB que par les augmentations de dépenses décidées par les gouvernements.
Entre 2009 et 2018, le poids relatif des dépenses de santé par rapport au PIB diminue en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en France. Seuls les États-Unis et l’Allemagne ont une croissance des dépenses de santé en part du PIB qui continue de progresser après la crise (respectivement +0,7 point et +0,2 point entre 2009 et 2018).
La France se caractérise par le plus faible reste à charge au sein de l’OCDE
En moyenne, 79 % des dépenses de santé sont prises en charge au sein des quinze premiers États membres de l’Union européenne par les États, les assurances maladie obligatoires ou les assurances privées obligatoires. Les assurances santé facultatives prennent en charge en moyenne 5 % des dépenses de santé pour ces mêmes pays. Dans ces conditions, le reste à charge se situe autour de 16 % dans l’Europe de l’Ouest. Il atteint 36 % en Grèce, 30 % au Portugal et 28 % en Suisse. La France, avec un reste à charge inférieur à 9 %, se distingue de la moyenne des autres pays.
Dans les trois pays scandinaves, en Allemagne et au Japon, les régimes obligatoires assurent une plus grande part des dépenses qu’en France (84 %) mais dans ces États les assurances complémentaires y sont beaucoup plus faibles. Aux États-Unis, l’Obamacare a permis une baisse sensible du reste à charge qui se situait, en 2018, autour de 11 %. Toutefois, la dépense de soins et les primes d’assurance restent importantes, du fait des honoraires des médecins et des prix élevés des produits de santé. En Europe, la France a également le reste à charge en parité de pouvoir d’achat le plus faible avec 370 euros par habitant.
Des organisations différentes d’un pays à l’autre
Dans la totalité des pays considérés, les régimes obligatoires de financement de la santé couvrent plus de la moitié des dépenses. Dans les pays du nord et du sud de l’Europe, en Lettonie, au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada, l’État assure un service national de santé financé par l’impôt. Les résidents sont couverts automatiquement, mais le parcours de soins est très encadré. En Finlande, en Suède, mais aussi en Espagne et au Portugal, les soins primaires sont souvent dispensés dans des centres publics où les médecins sont généralement salariés ou payés à la capitation.
Dans les systèmes d’assurance maladie gérés par des caisses publiques de sécurité sociale, les prestations maladie sont versées en contrepartie de cotisations en général assises sur les revenus d’activité. Au Luxembourg, en Allemagne et en France notamment, plus de 70 % de l’ensemble des dépenses courantes de santé sont couverts par l’assurance maladie. Concernant l’offre de soins, la médecine y est souvent libérale et les médecins sont principalement rémunérés à l’acte, même si ce mode d’exercice cohabite avec des hôpitaux publics. Si l’assurance maladie est en grande partie financée par les cotisations sociales versées par les employeurs et les salariés, une part des recettes de ces dispositifs peut également provenir des transferts publics. L’étatisation de la santé concerne un grand nombre de pays dont la France en raison de la montée en puissance des transferts publics. Au Japon, au Luxembourg ou en Belgique, les recettes de l’assurance maladie proviennent de l’État à hauteur d’environ 40 % pour les deux premiers et de 30 % pour la Belgique.
Certains pays, comme la Suisse et les Pays-Bas, disposent d’un système d’assurance maladie obligatoire pour tous les résidents, mais dont la gestion est assurée par des acteurs privés mis en concurrence. L’État intervient toutefois afin de remédier aux défaillances du marché. Il oblige tous les résidents à contracter une assurance santé, définit le panier de soins de base minimal et met en place des dispositifs d’aide à l’acquisition et au paiement de cette assurance pour les personnes aux revenus modestes. Aux États-Unis, depuis 2014, le Patient Protection and Affordable Care Act (ACA ou Obamacare) oblige les particuliers à souscrire une assurance maladie, sous peine de se voir infliger des pénalités. À l’instar de la Suisse et des Pays-Bas, les assurances maladie, devenues obligatoires, restent toutefois largement privées.
Une généralisation des complémentaires
En Allemagne et en France, une partie de l’assurance privée, auparavant facultative, est devenue obligatoire. En Allemagne, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les salariés les plus aisés peuvent sortir de l’assurance maladie publique et s’assurer auprès d’un organisme privé. En France, depuis 2016, une assurance maladie complémentaire, financée partiellement par l’employeur, est obligatoire pour les salariés du secteur privé. Aux États-Unis, ce mouvement a été plus fort avec, entre 2006 et 2018, un basculement de l’assurance privée volontaire ou facultative à l’assurance privée obligatoire.
Des frais de gestion variables
Aux États-Unis, les dépenses de gestion atteignent près de 9 %. La France arrive en deuxième position avec près de 6 %, juste devant l’Allemagne (4,7 %). De manière générale, les dépenses de gouvernance les plus importantes relativement aux dépenses de soins sont observées dans les pays avec une gestion par des caisses de sécurité sociale ou des assureurs privés. Les systèmes nationaux de santé gérés par l’État semblent plus économes en matière de frais de gestion (de 1 à 3 %). Ce constat est lié au caractère forfaitaire des prestations et à la fonctionnarisation du personnel de santé. La nature très différente entre les différents systèmes de santé ne permet pas de réaliser en la matière de réelle comparaison.
La problématique des déserts médicaux au sein de l’OCDE
En 2018, la densité de médecins (nombre de médecins en activité pour 100 000 habitants), atteint en moyenne 347 dans les 15 pays d’Europe de l’Ouest. Avec une densité de 317 médecins pour 100 000 habitants, la France se situe en dessous de cette moyenne, mais elle ne comptabilise pas les internes et les résidents en médecine (médecins en formation), quand les autres pays de l’OCDE le font.
La densité de médecins est en général plus faible parmi les nouveaux États membres de l’Union européenne. C’est le cas en particulier en Pologne (235 médecins).
Dans beaucoup de pays, une faible densité de médecins s’accompagne d’une forte densité d’infirmiers et inversement. Avec 1 079 infirmiers en France pour 100 000 habitants en 2018, la densité d’infirmiers est supérieure à la moyenne de l’UE-15 (900) quand elle est plus faible en termes de densité de médecin. À l’inverse, les pays du sud de l’Europe (comme l’Espagne et l’Italie) présentent des densités élevées de médecins, mais la présence des infirmiers y est moins développée (moins de 600 infirmiers pour 100 000 habitants contre 900 en moyenne dans l’UE-15). Ils sont quasiment absents des soins de ville, qui sont assurés par des médecins, et la prise en charge de la dépendance y est très faible. Certains pays comme la Norvège, la Suède, le Danemark, la Suisse ou l’Allemagne font figure d’exception en cumulant une forte densité de médecins et d’infirmiers. En Allemagne, les infirmiers exercent principalement à l’hôpital, mais jouent également un rôle important dans les soins de ville pour la prise en charge à domicile des personnes âgées dépendantes. Ainsi, ce pays cumule à la fois un niveau très élevé de médecins (431 pour 100 000 habitants) et d’infirmiers (1 322). À l’opposé, au Royaume-Uni, la densité de médecins (284) et celle d’infirmiers (778) sont plus faibles qu’en moyenne dans l’UE. Dans ces pays, les infirmiers disposent de compétences élargies dans des domaines tels que la promotion de la santé, le suivi des maladies chroniques, et assurent des consultations de premier recours.
Entre 2008 et 2018, le nombre de médecins augmente légèrement plus vite que la population dans la quasi-totalité des pays considérés ici. Pendant cette période, la densité augmente de 296 à 347 médecins pour 100 000 habitants en moyenne dans l’UE-15. Elle est particulièrement dynamique en Allemagne, aux Pays-Bas, en Slovénie et au Canada (plus de 2 % par an d’augmentation). En revanche, la densité de médecins progresse très peu dans d’autres pays, notamment en France, en Italie et en Belgique. Sur la même période, la densité d’infirmiers augmente dans la majorité des pays considérés (+1,2 % par an en moyenne en UE-15), hormis notamment au Royaume-Uni, en Pologne, ou en Irlande. En France, la densité d’infirmiers a progressé à un rythme soutenu de 3,2 % en moyenne par an entre 2008 et 2018. Pour quasiment tous les pays de l’OCDE, le numerus clausus est le principal levier utilisé pour réguler l’offre de soins par le biais des variations d’effectifs de médecins. Certains pays ont beaucoup de médecins formés à l’étranger.
Un anniversaire sur fond de crise sanitaire
La Sécurité sociale fête ses 75 ans en France. Elle a été créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. En trois quarts de siècle, le système a fortement évolué en devenant, au fil des décennies, de moins en moins lié à l’emploi et de plus en plus universel.
La protection sociale a commencé à être structurée sous le régime de Vichy. Comme celui-ci fut considéré comme « nul et non avenu » et comme l’objectif était d’associer les syndicats qui avaient œuvré à la libération de la France, les pouvoirs publics ont dessiné un nouveau cadre. Celui-ci reposait notamment sur le préambule de la IVe République qui dans son 10e alinéa précisait que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Le 11e aliéna est encore plus précis « la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Pierre Laroque, un des pères de la protection sociale française, avait, avant même la fin de la Guerre, défini avec justesse les missions de la Sécurité Sociale à l’occasion d’un discours prononcé le 23 mars 1945 à l’École nationale d’organisation économique et sociale. Il avait également souligné que « La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’il disposera en toutes circonstances d’un revenu suffisant pour assurer à lui-même et à sa famille une existence décente, ou à tout le moins un minimum vital […] Si donc cette garantie, pour être vraiment complète, doit viser toutes les familles, il n’en est pas moins vrai que la sécurité sociale est avant tout la sécurité des travailleurs, des familles, qui tirent leurs revenus du travail d’un ou de plusieurs de leurs membres ».
La Sécurité sociale est créée sur une base professionnelle. Elle est de nature assurantielle avec des cotisations salariales et patronales. La philosophie retenue est celle qui avait prévalu en Allemagne en 1879 sous Bismarck. La Sécurité sociale, qui couvre les risques maladie, accident du travail, retraite et famille a connu depuis sa création trois grandes périodes :
- 1945/1967 : une gouvernance élue par les assurés ;
- 1967/1996 : un paritarisme assumé sur fond d’interventionnisme de plus en plus appuyé de l’État ;
- À partir de 1996 : une étatisation croissante avec la création des lois de financement de la Sécurité sociale qui avaient été précédées de celle de la CSG, une contribution de nature fiscale.
La construction d’inspiration bismarckienne n’a pas empêché l’État d’être très tôt un acteur majeur de la protection sociale en jouant plus ou moins directement sur le contenu des prestations et sur le montant des cotisations. Dans les faits, l’État assure la tutelle des régimes sociaux grâce à l’appui de la direction générale de la Sécurité sociale qui est alors rattachée au ministère du Travail et de ses déclinaisons régionales. Au niveau financier, le ministère des finances exerce dès le début de l’aventure un contrôle. Pour Bruno Pallier, « dès les premières années de fonctionnement, le mode d’organisation de la Sécurité sociale se traduit peu à peu par un tripartisme de fait ». Avec le dérapage des dépenses à la fin des années 60, l’État renforce sa présence dans la gestion de la protection sociale. Par ordonnances, en 1967, le gouvernement de Georges Pompidou décide de remplacer la caisse nationale de sécurité sociale, par la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), gérant également les accidents du travail, la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en vue de séparer les risques et d’éviter des compensations jugées contraires à la responsabilisation des partenaires sociaux. Cette transformation s’accompagne de la fin des élections des représentants des caisses au profit de leur désignation par les organisations représentatives. La répartition paritaire est alors immédiatement décriée par les syndicats qui y voient un renforcement inopportun du rôle du patronat. Les ordonnances de 1967 donnent une expression juridique aux branches de la Sécurité sociale.
Avec la succession des crises à compter de 1973, l’État est de plus en plus présent dans la gestion de la protection sociale même si, avec l’arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République, l’élection des représentants des caisses de Sécurité sociale est réactivée. Les élections du 19 octobre 1983 sont marquées par une forte abstention et par la dispersion des forces syndicales. L’abandon des élections aboutit à la restauration du paritarisme en 1994. Auparavant, en raison de l’accumulation des déficits de la Sécurité sociale et pour ne pas peser sur le coût du travail, Michel Rocard crée la contribution sociale généralisée (CSG) en 1991. La CSG vise initialement à financer la branche famille avec un taux fixé à 1,1 %. En 30 ans, cette contribution a été augmentée à sept reprises pour atteindre 9,2 % des revenus d’activité. En plus des prestations famille, elle finance désormais l’assurance maladie, la retraite et le chômage. Compte tenu du projet de loi déposé au mois de juin 2020, elle devrait financer à terme la dépendance. Par sa nature fiscale, ayant une assiette très large, la CSG a déconnecté en partie la protection sociale de sa base professionnelle.
Avec la réforme d’Alain Juppé de 1995, la gouvernance de la Sécurité sociale a profondément évolué. Le paritarisme se double d’un contrôle parlementaire qui discute et vote les projets de loi de financement de la Sécurité sociale. L’État fixe directement le cadre financier général dans lequel s’inscrit la gestion des caisses en ayant la charge de l’élaboration de projets de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) et en concluant des conventions d’objectifs et de gestion avec les caisses nationales de la Sécurité sociale. La création de la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) en 1996 conforte le processus d’étatisation et de changement de nature de la protection sociale. Les déficits de la Sécurité sociale sont transférés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) qui est financée par des prélèvements de nature fiscale dont la CRDS. Le contribuable est ainsi appelé à financer indirectement des dépenses relevant des branches. Le changement de nature de la protection sociale concerne également les dépenses. Le lien avec le statut professionnel se délite avec une forte demande d’universalisation des couvertures sociales. L’instauration de la CMU puis de la CMUC, remplacée depuis 2018 par la protection universelle maladie (Puma), transforme en profondeur le modèle français d’assurance maladie. La mise en place de la complémentaire obligatoire pour les salariés et des zéros à charge y contribuent également. Ce ne sont plus les négociations entre les partenaires sociaux qui aboutissent à la création de nouveaux droits, ce sont les programmes des candidats à l’élection présidentielle. L’instauration du quinquennat et la personnalisation du pouvoir ont favorisé l’hégémonisme de l’exécutif en ce qui concerne l’initiative sur le terrain social. Certes, certains engagements présidentiels résultent de propositions pouvant émaner d’une organisation syndicale comme ce fut le cas pour le compte de pénibilité ou pour le projet de régime universel de retraite. Néanmoins, ces projets sont portés par le pouvoir politique sans être le fruit d’une négociation entre partenaires sociaux.
Le poids croissant des dépenses sociales, en France, plus du tiers du PIB, a conduit l’exécutif à être de plus en plus présent. Les prestations tout comme les cotisations sont devenues des outils de la gestion publique. Cette prise de contrôle est intervenue au moment où son pouvoir sur l’économie a faibli en raison de la montée en puissance de l’Union européenne et de la mondialisation.
À défaut d’orienter l’économie, les gouvernements ont privilégié le terrain social. Cet interventionnisme a l’avantage de pouvoir peser directement sur le niveau de vie des citoyens et donc des électeurs. Par ailleurs, les gouvernements confrontés au chômage de masse ont, depuis les années 80, mené des politiques de baisses ciblées des cotisations sociales afin de favoriser la création d’emplois. Cette immixtion dans la gestion de la Sécurité Sociale s’est accrue avec l’instauration des 35 heures entre 1999 et 2001 qui donna lieu à d’importantes exonérations afin de compenser une partie du surcoût pour les entreprises. Face à cette intrusion dans les comptes, la loi Veil du 25 juillet 1994 avait prévu que les exonérations de cotisations décidées par l’État soient intégralement compensées. Cependant, le gouvernement d’Édouard Philippe, en 2019, avec le retour attendu des excédents de la Sécurité sociale avait envisagé de mettre un terme à ce principe. Si le paritarisme a été contesté, il n’a pas disparu pour autant disparu du champ du social. Une de ses expressions majeures a concerné la retraite complémentaire. Celle-ci est née de l’insatisfaction des cadres et des ingénieurs dont les retraites prévues par le nouveau régime général étaient bien moins intéressantes que celles dont ils pouvaient disposer dans le cadre des régimes privés qui avaient été mis en place dans l’entre-deux-guerres. En 1945, 200 000 ingénieurs et cadres étaient couverts. Le 14 mars 1947, l’Association générale des institutions de retraites des cadres (Agirc) voit le jour par signature de conventions collectives donnant alors accès à une retraite complémentaire à ces salariés. Ce processus concerne également les non-cadres qui avaient accès à près de 600 dispositifs de couverture retraite et prévoyance. En 1957, par des accords de branches et d’entreprises sous l’égide de l’Union nationale des institutions de retraites des salariés (Unirs), un processus de fusion est engagé. Il se matérialise, en 1961 par la création de l’Association des régimes de retraites complémentaires (Arrco). La loi du 29 décembre 1972 a ensuite généralisé la retraite complémentaire à l’ensemble des salariés et anciens salariés affiliés à titre obligatoire au régime général de Sécurité sociale. La gestion de l’Agirc et de l’Arrco est pleinement assumée par les partenaires sociaux qui adaptent régulièrement les paramètres de ces régimes par répartition (valeur du point, âge de départ, montant des cotisations), et fixent les grandes orientations pour assurer l’équilibre financier des régimes (cf. accords de 1993, 1994, 1996, 2001, 2003, 2011, 2013, 2015…). Avec l’assurance-chômage jusqu’à la réforme de 2019, la retraite complémentaire a été le principal champ du paritarisme en France.
Si l’assurance maladie a été la première branche à être sous les feux de l’étatisation avec la fixation d’un objectif de dépenses (ONDAM), la retraite et le chômage n’échappent pas à la mainmise de l’exécutif. L’instauration de la CSG, contribution sociale mais déconnectée en partie du travail, a joué un rôle important dans l’évolution du système. La complexification des liens entre le budget de l’État et les budgets sociaux a également facilité la mainmise de Bercy. Les divisions des partenaires sociaux ont également permis à l’État d’être tout à la fois l’arbitre, le décideur et le gestionnaire. La forte demande de l’opinion pour une couverture générale indépendante du travail a servi de fondement à la tentation hégémonique de l’administration. 75 ans après sa création, la Sécurité sociale a répondu aux attentes de ses créateurs tout en étant en crise depuis au moins quarante ans. Les crises économiques ces dernières décennies ont mis sous tension le système social qui par ailleurs est à la recherche d’une nouvelle légitimité. Les réformes mises en œuvre depuis plusieurs dizaines d’années sont souvent perçues comme des reculs et non comme des adaptations à l’évolution de l’économie. Le système est à la peine face à l’évolution de l’emploi avec la montée en puissance de la micro-entreprise, des CDD ou du travail à temps partiel. La question de l’allongement de la durée de la vie est également difficilement appréhendée comme le soulignent les difficultés nées de la mise en place du compte de pénibilité.
Les régimes de base de retraite en France
Les pensions servies par les régimes de retraite de base se sont élevées à 236,8 milliards d’euros en 2019 et atteindraient 242,6 milliards d’euros en 2020, soit une hausse de 2,4 %, après 2,0 % en 2019.
Évolution des dépenses de retraite de base en France
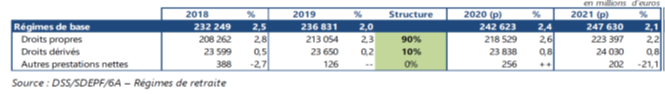
Les pensions de base sont versées à 57 % par les régimes alignés (régime général et régime des salariés agricoles), à 32 % par les régimes de fonctionnaires, à 7 % par les régimes spéciaux et à 4 % par les autres régimes de base (essentiellement des régimes de non-salariés).
Répartition des différents régimes de base
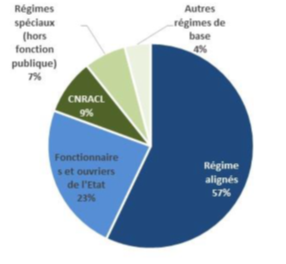
Depuis plusieurs années, les dépenses de retraite augmentent assez vivement. Le nombre de retraités est en hausse avec la poursuite de l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses du baby-boom, qui remplacent les classes creuses nées dans l’entre-deux-guerres. L’allongement de l’espérance de vie contribue également à la progression des dépenses. Le ratio démographique des régimes se dégrade progressivement. Il a atteint 1,3 cotisant pour un retraité au régime général au milieu de la décennie 2010 contre 1,6 au début des années 2000. Le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite s’est traduit par un ralentissement des départs même si ce processus a été atténué par les assouplissements successifs de la retraite anticipée pour carrière longue. Par effet de noria, les nouveaux retraités ont des pensions, en moyenne, plus élevées, en raison de carrières plus favorables, en lien notamment avec une participation plus élevée des femmes au marché du travail. En revanche, ces dernières années ont été marquées par de faibles revalorisations, ce qui a pesé sur l’évolution des dépenses. Les prestations servies par les régimes de base ont progressé en 2019 mais de manière plus contenue qu’en 2018 (+2,0 % après +2,5 %). Ce ralentissement résulte aussi bien de celui des pensions de droits propres (+2,3 % après 2,8 % en 2018) que de celui des pensions de droits dérivés (+0,2 % après 0,5 %).
Pour l’année 2019, la réforme de l’AGIRC/ARRCO avec l’introduction du mécanisme de bonus/malus a eu un effet réel sur les demandes de liquidation des droits pour les salariés du privé. Au total, 470 000 nouveaux pensionnés ont liquidé leur pension au seul régime général en 2019, hors retraite anticipée, après 491 000 en 2018, soit une baisse de -4,1 %, qui s’explique en partie par les coefficients dits de « solidarité » à l’Agirc-Arrco. Pour ce régime, la mise en œuvre en 2018 de ces coefficients aurait conduit une minorité des personnes ayant atteint l’âge légal à décaler la date de liquidation de leur pension.
Pour les régimes spéciaux, les règles d’évolution sont un peu différentes. Les modalités de liquidation des retraites ont été réformées en 2008 et le relèvement de l’âge légal n’a débuté qu’en 2017. Les flux de départs en retraite sont en forte hausse même si une décélération a été constatée en 2019 (+1,4 % après +1,6 % en 2018).
La progression de la pension moyenne
La pension annuelle moyenne du flux de nouveaux retraités au régime général s’est élevée à 8 509 euros tandis que celle du flux de décédés était de 7 173 euros. La pension moyenne de l’ensemble des retraités du régime général a atteint 7 706 euros après 7 642 euros en 2018 (soit +0,8 %).
Les retraites anticipées en déclin
Les pensions pour retraite anticipée ont poursuivi leur repli en 2019. Les pensions versées pour retraite anticipée ne représentent qu’une petite fraction des pensions servies, 5,9 milliards d’euros en 2019, soit 2,3 % du total des pensions versées, dont la moitié pour le seul régime général des salariés. Après une décennie de progression du fait de plusieurs vagues d’assouplissement des conditions de départ en retraite anticipée, les pensions versées à ce titre ont stagné en 2018 avant d’amorcer une nette baisse en 2019 (-6,5 %), qui se confirmerait en 2020 (-1,5 %). Les effectifs de bénéficiaires sont en net déclin. Ils avaient atteint un pic en 2017 (311 000 bénéficiaires) et décroissent depuis pour s’établir à 253 000 en 2019. Les nouveaux bénéficiaires diminuent fortement depuis 2018 (-12 % en 2018 puis -11 % en 2019) sous l’effet de l’augmentation d’un trimestre de la durée d’assurance cotisée nécessaire pour bénéficier de la retraite anticipée à partir de la génération 1958 (en application de la loi du 20 janvier 2014).
Retraite, peu ou pas de revalorisation ?
Le ministre en charge des Comptes publics a indiqué lors de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 que les pensions des régimes de base seraient revalorisées comme l’inflation, ce qui pourrait amener une hausse de 0,4 % au 1er janvier 2021. A priori, il n’y aura pas l’année prochaine d’indexation différenciée en fonction des revenus pour les retraités. En 2020, les pensions ont été revalorisées de 0,3 % pour ceux gagnant plus de 2 000 euros et de 1 % pour ceux gagnant moins. En 2021 tous les retraités seront traités de la même façon. Selon la synthèse des comptes de la Sécurité sociale, publiée ce mardi 29 septembre, « les pensions seraient indexées sur l’inflation et revalorisées à hauteur de 0,4 % pour tous les retraités ».
Du côté des complémentaires, le gel des pensions a été, en revanche, décidé compte tenu de l’évolution des comptes du régime Agirc-Arrco qui ne peut pas être en déficit à la différence des régimes de base. La formule logique de révision des points fait intervenir le salaire moyen, l’inflation et le niveau des réserves financières, sachant qu’elle ne peut pas aboutir à une diminution. Les salaires moyens sont actuellement orientés à la baisse et l’inflation inexistante. Les réserves ont ainsi été mises à contribution pour faire face, en 2020, à la contraction des cotisations, en particulier pendant le confinement.
3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Quatre mois après le déconfinement, comment jugez-vous la reprise économique ?
Après avoir touché un point bas au mois d’avril, l’économie française a connu un rebond rapide en mai et en juin. Depuis, la réduction de l’écart d’activité par rapport à la période d’avant crise se ralentit.
Au troisième trimestre, le déficit d’activité en France par rapport au niveau d’avant crise ne serait plus, selon l’INSEE, que de 5 %, contre 19 % au deuxième trimestre. La période estivale n’a pas arrêté le rebond amorcé en mai et juin, néanmoins celui-ci tend à s’affaiblir avec la multiplication des cas de Covid-19. L’INSEE estime que la perte d’activité serait de 4 % pour le dernier trimestre, sous réserve que les mesures restrictives prises depuis le milieu du mois de septembre ne bloquent pas trop la reprise. Dans l’hypothèse d’une pandémie maîtrisée et d’une stabilité des dispositions sanitaires, la prévision de baisse du PIB en 2020 est fixée à -9 %/-10 % avec un rebond en 2021 de 8 %.
Pour le moment, la consommation de biens est de retour avec un mois d’août de très bonne facture. En revanche, la consommation de services marchands reste pénalisée par une offre culturelle réduite et par une diminution des dépenses d’hébergement. La consommation de services aurait été, en juillet, de 7 % inférieure au niveau d’avant crise et de 5 % en août. Les fermetures des bars dans plusieurs grandes villes dont Paris ne devrait pas permettre de réduire l’écart au cours du troisième trimestre. Dans les services principalement non marchands, la consommation aurait continué à se redresser, à travers la reprise progressive des soins de ville. Elle se situerait néanmoins, en juillet puis en août, encore en dessous du niveau d’avant crise (-9 % de perte de consommation en août).
Dans ce contexte économique atypique, les finances publiques sont mises sous tension. Comment jugez-vous les projets de loi de finances présentés fin septembre ?
En 2009, le déficit public avait atteint 7,2 %. Pour 2020, il devrait s’élever à 10,2 % du PIB, un niveau inconnu depuis 1942. L’espoir de renouer avec un excédent des comptes publics s’est éloigné, sachant que le dernier exercice positif date de 1973. Le budget de 2021 sera le dernier à être mené à son terme pour ce quinquennat, l’exercice 2022 sera marqué par l’élection présidentielle et les élections législatives. Compte tenu de la situation sanitaire et économique, le budget 2021 a toutes les chances ou plutôt tous les risques d’être amendé en profondeur en cours de route. Celui de 2020 l’a été déjà à trois reprises depuis le mois de mars.
Le solde public était revenu en dessous des 3 % du PIB, pour la première fois depuis 2001, en 2018 (-2,3 %) et en 2019 (-2,1 % sous réserve de neutraliser l’impact de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisse de charges). Après l’adoption de trois lois de finances rectificatives, le solde public en 2020 devrait selon le ministère de l’Économie atteindre 10,2 % du PIB, soit plus de 7 points au-dessus de la prévision initiale. En 2021, le déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique. Il pourrait être de -6,7 % du PIB. Dans ce contexte, l’endettement public devrait passer de 98 % en 2019 à 117,5 % en 2020, avant de revenir à 116,2 % du PIB en 2021 grâce au redressement de l’activité.
Le poids des dépenses publiques (hors crédits d’impôt) qui s’élevait à 54,0 % du PIB en 2019, devrait atteindre 62,8 % du PIB en 2020, à la fois sous l’effet de la récession économique affectant le niveau du PIB et des mesures d’urgence prises depuis le mois de mars. Avec la reprise, le niveau de dépenses publiques entamerait sa décrue en 2021 en diminuant à 58,5 % du PIB (hors crédits d’impôts). Le taux de croissance des dépenses publiques atteindrait en 2020 +6,3 %, pour revenir à un taux de +0,4 % en 2021.
Le déficit du budget de l’État s’établirait à -195,2 milliards d’euros en 2020, en dégradation de – 102,0 milliards d’euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2020. Le déficit représente plus de 50 % des recettes de l’État, un record. Pour 2021, le montant annoncé pour le déficit de l’État est de -152,8 milliards d’euros.
La forte dégradation en 2020 s’explique en premier lieu par la baisse des recettes fiscales nettes (-46,2 milliards d’euros). Les recettes de l’impôt sur les sociétés diminuent de 18,3 milliards d’euros et celles de la taxe sur la valeur ajoutée de 14,7 milliards d’euros. L’augmentation des dépenses de soutien à l’économie et à l’emploi contribue également à la dérive du déficit.
Le montant des dépenses pour 2021 atteindra 448 milliards d’euros avec 70 milliards d’euros de prélèvements sur recettes (dépenses fiscales). Les dépenses du budget général devraient s’élever à 378,7 milliards d’euros contre 253 milliards d’euros prévus en loi de finances initiale pour 2020. Le projet de loi de finances pour 2021 intégrera les mesures de « France relance », à hauteur de 36,4 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 22,0 milliards d’euros en crédits de paiement.
De son côté, le déficit de la Sécurité sociale devrait s’élever à 44,4 milliards d’euros en 2020 (régime général plus fonds de solidarité vieillesse) avant de revenir à 27,1 milliards d’euros en 2021. D’ici quatre ans, il devrait encore atteindre 22 milliards d’euros, traduisant bien l’impact structurel de la crise actuelle sur les comptes de la Sécurité sociale qui étaient censés être à l’équilibre dans les prochaines années. Le précédent record pour la Sécurité sociale date de 2010 avec un déficit de 28 milliards d’euros.
En 2021, l’assurance maladie serait déficitaire de 19 milliards d’euros et l’assurance vieillesse de 7,3 milliards d’euros. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), après une augmentation de 7,6 % en 2020, devrait connaître une hausse de 3,5 % en 2021. L’assurance retraite devrait enregistrer une perte de 7,9 milliards d’euros pour 2020 et de 8 milliards d’euros en 2021.
Au-delà de ces chiffres, la gestion de l’État et de la Sécurité sociale s’effectuera au fil de l’eau en fonction de l’évolution de l’épidémie. Le plan de relance qui essaie de mixer soutien à l’économie et transition énergétique contribuera à soutenir l’activité à partir du premier trimestre 2021. Il n’en demeure pas moins que l’économie française qui était déjà très affaiblie avant la crise sanitaire doit relever un défi important compte tenu de l’ampleur de ses déficits publics et commerciaux.
Dans le contexte actuel, le gouvernement peut-il relancer la réforme des retraites dont la discussion au Parlement a été interrompue avec le confinement du mois de mars dernier ?
Le Premier ministre, Jean Castex, a, au mois de juillet dernier, indiqué que le projet de loi réformant le système de retraite serait à l’ordre du jour en 2021. Il avait décidé de différer la réouverture du dossier afin de placer l’emploi au cœur des priorités de la fin d’année. Il n’est pas certain qu’en 2021, la crise sanitaire soit jugulée et que la situation de l’emploi se soit clarifiée, ce qui pourrait rendre délicate la réouverture d’un dossier conflictuel au sein de l’opinion publique, d’autant plus que la campagne présidentielle s’ouvrira sans nul doute après les vacances d’été. Le gouvernement sera tenté de faire passer quelques points de la réforme des retraites sans pour autant remettre en débat les sujets polémiques. Ainsi, pourraient être concernés le plancher de pension à 1 000 euros, la refonte de la réversion et l’amélioration de la retraite des agriculteurs. La mise en place de la Caisse nationale de retraite universelle pourrait être instituée avec comme mission la convergence des différents régimes. L’État pourrait être incité à y insérer son « système de retraite » afin de l’externaliser des comptes budgétaires.
Mélodie en rente
L’édito d’octobre de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne
Au XIXe siècle, la fortune se mesurait aux rentes perçues comme le décrit avec moquerie Balzac dans ses romans. Le rentier souvent dépeint comme un inactif, oisif profitant du travail des autres, disparaît dans les décombres des deux guerres mondiales, dans l’inflation et aussi avec la crise de 1929. Il en est resté une expression, la faillite des rentiers.
En France, le terme de rentier renvoie à une image sociale, les possédants, les détenteurs de capitaux qui exploitent les masses laborieuses. Si de 1673, année de création du premier régime de retraite jusqu’aux années 1930, la capitalisation apparaissait comme le seul système légitime et rationnel, il en a été tout autrement après la Seconde Guerre mondiale, la répartition étant considérée comme seule à même à financer les pensions de retraite. La rupture idéologique fut totale. Auparavant, les syndicats révolutionnaires estimaient que le salaire ne pouvait pas servir de fondement aux régimes de retraite au nom de la défense du pouvoir d’achat des salariés. Leur opposition se fondait sur leur refus d’instituer des systèmes de protection sociale qualifiés alors de « béquilles du capitalisme ».
Pour autant, une pension de retraite par répartition est dans les faits une rente financée par les actifs à travers leurs cotisations au profit de personnes inactives. Les mots ont changé, mais ni les faits ni les mécanismes. Pour autant, aujourd’hui encore, la rente a mauvaise presse, conduisant à une préférence marquée des épargnants pour la sortie en capital. Dans le même temps, la rente est omniprésente et, parfois, sous des formes peu orthodoxes, peu compatibles avec un développement harmonieux de l’économie.
De nombreux secteurs économiques sont dominés par des oligopoles voire des monopoles qui bénéficient de rentes de situation se traduisant par l’accumulation d’excédents importants. Les techniques de l’information et de la communication en sont un exemple criant. Ces rentes liées à des positions dominantes ralentissent la diffusion du progrès technique et aboutissent à une mauvaise allocation des ressources. Elles sont l’expression d’une défaillance des règles de la concurrence.
Au niveau des particuliers, la situation est tout autre. Le rentier doit faire face à la baisse des taux d’intérêt induisant une véritable « répression financière ». S’il échappe pour le moment à la menace inflationniste, il doit supporter des taux d’intérêt négatifs, ce qui constitue une première. Pour gagner de l’argent, il doit, à la différence des héros de Balzac, cesser de compter sur le versement automatique et régulier et opter pour le risque. Certes, il peut miser sur l’immobilier tout en prenant en compte le fait que le rendement net d’impôt, net de charges est bien souvent très réduit. La plus-value est alors son seul espoir en matière de gains, espoir aléatoire et non automatique.
Dans une période de forte instabilité où la prévision à deux ou trois ans appartient de plus en plus à l’art divinatoire, la rente peut redevenir un véritable luxe. Bénéficier d’un revenu régulier sur longue période n’est pas à la portée de tout le monde surtout quand on ne s’appelle pas Apple, Google, Facebook ou Amazon.
Jean-Pierre Thomas
Placement jusqu’à 7% : ce produit poussé par le gouvernement est-il fait pour vous ?
Philippe Crevel est cité dans cet article concernant le lancement d’un fonds pour inciter les Français à investir leur épargne dans des PME françaises. Le rendement annuel espéré de l’ordre de 5% à 7% par an.
Le directeur du Cercle de l’Epargne explique que ce produit ne « peut pas constituer le cœur de l’épargne d’un ménage. C’est un produit de niche. Ce n’est pas le Livret A. Si le fonds est bien géré et bien distribué, il sera souscrit mais il ne pourra pas à lui seul dégonfler l’épargne de précaution liée au coronavirus. Celle-ci obéit à d’autres considérations, la peur de la perte des revenus, du chômage… »
Vos placements à l’épreuve du Covid : nos conseils pour gérer votre épargne
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, est cité dans cet article sur la gestion de l’épargne en période de crise sanitaire et économique.
Les fonds en euros font de la résistance grâce à l’inflation
Le directeur du Cercle de l’Epargne Philippe Crevel est cité dans cet article d’Investir consacré aux fonds en euro.
Pourquoi l’assurance vie fait moins recette
Le directeur du Cercle de l’Epargne Philippe Crevel est cité dans cet article de Ouest France qui revient notamment sur la relative désaffection des Français pour l’épargne.
Assurance-vie, les fonds en euros vont-ils sombrer ?
Dans cet article des Echos relatif à l’avenir des fonds en euro, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, rappelle qu’« avec 1.761 milliards d’euros d’encours, l’assurance-vie reste le premier placement des ménages mais elle pâtit de leur préférence actuelle pour la liquidité et leur refus de s’engager sur le moyen-long terme, comme les y incitent les assureurs ».
Opinion | Le travail est-il un archaïsme ?
La crise sanitaire met à dure épreuve le travail, valeur déjà attaquée par la mondialisation et la digitalisation. Dans cette tribune, l’économiste Philippe Crevel s’interroge : face aux utopiques qui rêvent de l’abolir, ne faut-il pas, bien au contraire, en faire le point d’ancrage de notre société ?
Banquiers et assureurs se ruent sur l’épargne retraite
Cet article souligne qu’un an après son lancement, le plan d’épargne retraite (PER) commence à séduire les épargnants. Philippe Crevel estime que le PER est « un produit bienvenu pour les banquiers et les assureurs. Ils élargissent leurs offres et peuvent capter une nouvelle clientèle, car la question de la retraite demeure un sujet très anxiogène dans l’opinion ».
L’épargne au cœur de la relance responsable
Philippe Crevel est cité dans cet article sur la possibilité pour l’épargne des Français de soutenir la relance et la mutation vers une économie plus durable.
Le dircteur du Cercle de l’Épargne estime que « Si les épargnants privilégient les placements liquides et de court terme, les dépôts à vue et les livrets, c’est par crainte de l’avenir. Quand les revenus fondent, quand l’emploi apparaît incertain, il est difficile de se projeter et de placer son argent à long terme. La réorientation de l’épargne de la Covid interviendra avec la clarification de la situation économique et sanitaire. Le plan de relance du gouvernement peut y aider tout comme celui de l’Union européenne ».
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


