Retraite : les solutions balbutiantes des Français pour contrer la baisse du pouvoir d’achat
Les Echos reviennent dans cet article sur les enseignements de la 10e enquête « Les Français, l’épargne et la retraite » AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA-Le Cercle de l’Epargne. Cet article s’intéresse particulièrement aux solutions privilégiées par les Français pour maintenir leur pouvoir d’achat à la retraite.
Livret A : pourquoi n’augmentera-t-il pas au 1er mai ?
Sur RTL le directeur du Cercle de l’Epargne est interrogé sur l’impact du relèvement du taux du Livret A pour les établissements financiers.
Semaine de l’Épargne Salariale 2023 : L’épargne salariale au service du partage de la valeur
Avec la résurgence de l’inflation, la question du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de la population française. Au moment où les grandes entreprises ont, en 2022, réalisé, pour certaines d’entre elles du moins, des bénéfices importants, la question de leur partage est également d’une forte acuité.
Les dispositifs inventés sous la présidence du Général de Gaulle demeurent mais les pouvoirs publics ont, ces dernières années, privilégié des formules plus simples avec la création notamment des primes de partage de la valeur ajoutée (« prime Macron » ou de pouvoir d’achat).
Malgré des progrès depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’épargne salariale reste peu diffusée au sein des PME, ce qui a conduit à l’introduction des primes de pouvoir d’achat. La complexité des dispositifs rebute encore de nombreux dirigeants d’entreprise.
L’épargne salariale, c’est en 2022 :
- 162 milliards d’euros d’encours ;
- 378 000 entreprises couvertes ;
- 11 millions de salariés potentiellement bénéficiaires ;
- 19 milliards d’euros de collecte brute (+2,7 Mds€ par rapport à 2021) ;
- 2,6 milliards d’euros de collecte nette.
Au sommaire de cette étude
- L’épargne salariale, une histoire riche
- Les différents dispositifs d’épargne salariale en France
- Conditions de mise en place
- L’épargne salariale, un encours de 162 milliards d’euros
- L’épargne salariale, premier vecteur de la finance verte
- L’épargne retraite collective, un potentiel de croissance
- Le chantier de l’élargissement de l’épargne salariale aux PME toujours ouvert
- L’épargne salariale, un enjeu majeur
Report de l’âge de la retraite, santé, prévoyance et chômage
Le report de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans ainsi que l’accélération de la durée de cotisation auront des incidences sur les autres régimes sociaux, chômage, santé, et accident du travail ainsi que sur les complémentaires (santé, prévoyance, retraite supplémentaire).
La réforme 2023 autorise le départ à la retraite à 62 ans à taux plein pour les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude, quel que soit le nombre de trimestres validés. Pour les travailleurs handicapés, cette possibilité reste ouverte à compter de 55 ans. Les victimes d’incapacité permanente pourront partir à la retraite dès 60 ans et non 62 comme prévu par le gouvernement. Cette décision, à la différence celle qui avait prévalu lors de la précédente réforme de 2010, réduit les charges supportées par les régimes de prévoyance.
Le report de l’âge légal de 60 à 62 ans et de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans avait induit un surcoût de l’ordre de 3 milliards d’euros de dépenses sociales supplémentaires (dont environ 800 millions pour l’assurance-chômage, 700 millions au titre de minima sociaux et de 1,2 à 1,5 milliard d’euros de dépenses d’invalidité), soit environ 20 % du gain réalisé. Ce montant indiqué par la Cour des Comptes est encore plus élevé après intégration de l’ensemble des couvertures de prévoyance complémentaire.
L’objectif de la réforme des retraites : freiner l’augmentation du nombre de retraités et maintenir le plus grand nombre de personnes en activité
Les régimes de retraite par répartition fonctionnent selon le principe de solidarité intergénérationnelle, les cotisations des actifs servant à financer directement les pensions des retraités. La masse salariale est donc la clef de voûte de l’équilibre de ces régimes. Plus il y a des actifs ayant des salaires élevés, plus le montant des cotisations est important. La population active dépend du nombre de personnes en âge de travailler, de leur volonté de travailler et du nombre de postes dont l’économie dispose.
Après avoir connu une forte augmentation durant les années 1980-2000 avec l’arrivée des larges classes du baby-boom à l’âge du travail, le nombre potentiel d’actifs progresse de plus en plus lentement. D’ici une dizaine d’années, la population active pourrait baisser. Cette évolution est la conséquence de la baisse de la fécondité depuis une quarantaine d’années, baisse qui a repris depuis 2007.
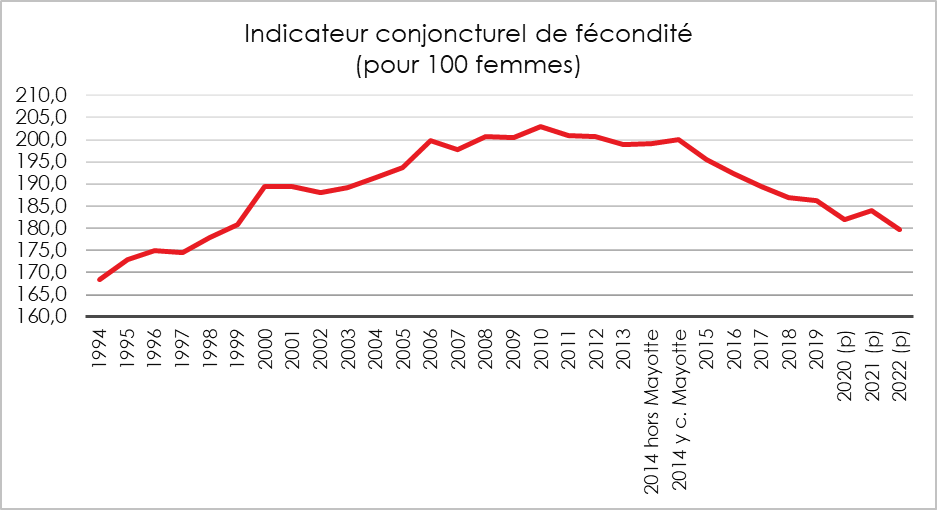
La taille de la population active peut être accrue en jouant sur l’immigration ou les âges d’entrée et de sortie du monde du travail. En matière d’immigration, aucun consensus n’existe pour le moment pour accueillir des travailleurs. L’Allemagne ou le Canada ont opté en partie pour cette solution.
En 2021, 10,3 % de la population vivant en France est, selon le rapport de l’INSEE « Immigrés et descendants d’immigrés en France » de 2023, immigrée contre 6,5 % en 1968. Les origines de la population immigrée se sont diversifiées en cinquante ans, les nouveaux immigrés arrivant en France étant nés dans des pays de plus en plus variés.
La France est dans la moyenne européenne en matière d’immigration. La part d’immigrés est de 18,2 % en Allemagne, de 15,2 % en Espagne et de 10,6 % en Italie. La France a, selon François Héran, moins accueilli de réfugiés en provenance de l’Afghanistan, de Syrie ou de l’Ukraine que les autres pays européens et en particulier que l’Allemagne.
Des taux d’emploi faibles avant 25 ns et après 55 ans
La France se caractérise par un problème d’insertion des jeunes et par une sortie précoce du marché du travail.
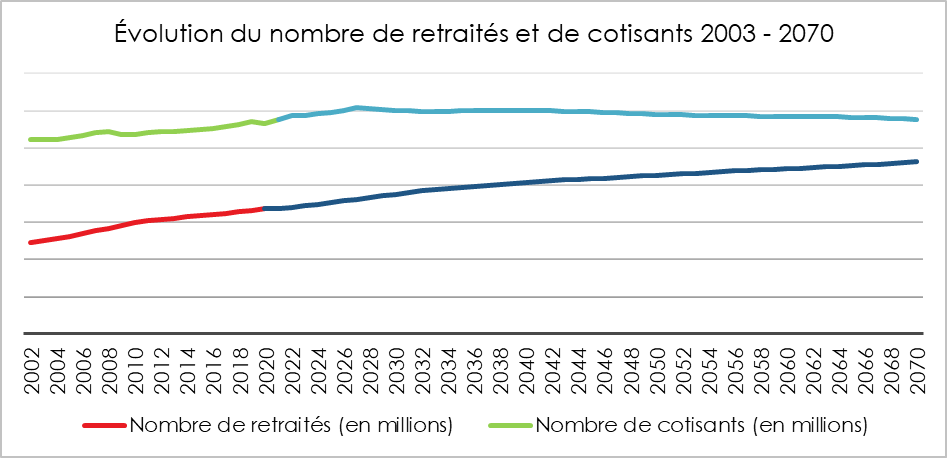
Le taux d’emploi est particulièrement élevé entre 25 et 50 ans, autour de 80 %. En revanche, il est faible avant 25 ans et après 50 ans.
Si avant 25 ans, une part croissante des jeunes est en formation, il n’en demeure pas moins que ceux qui sont sur le marché du travail sont confrontés à un chômage élevé. Ce dernier a certes fortement baissé, il reste néanmoins supérieur à la moyenne européenne. Il était en décembre 2022 de 18,7 % en France, contre 14,8 % au sein de la zone euro. Par ailleurs, le nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi ou en formation est important et préoccupant.
Malgré tout, depuis cinq ans, le nombre de jeunes en alternance a fortement progressé pour se rapprocher d’un million en 2022.
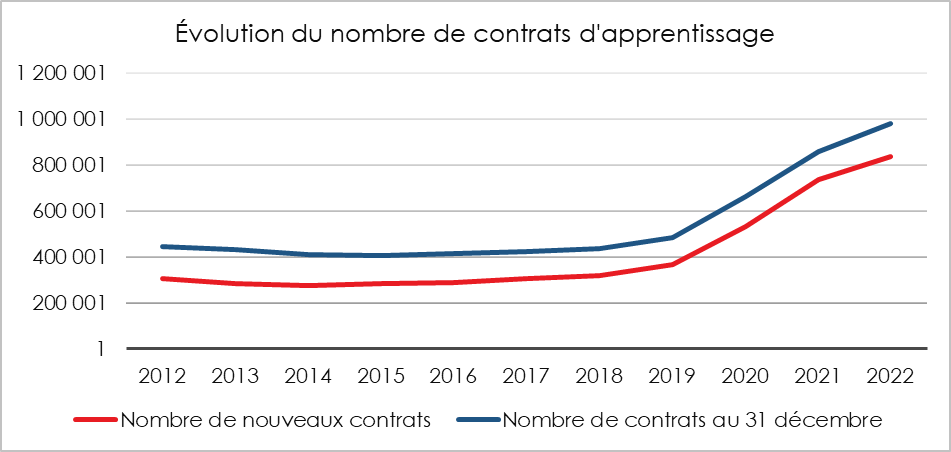
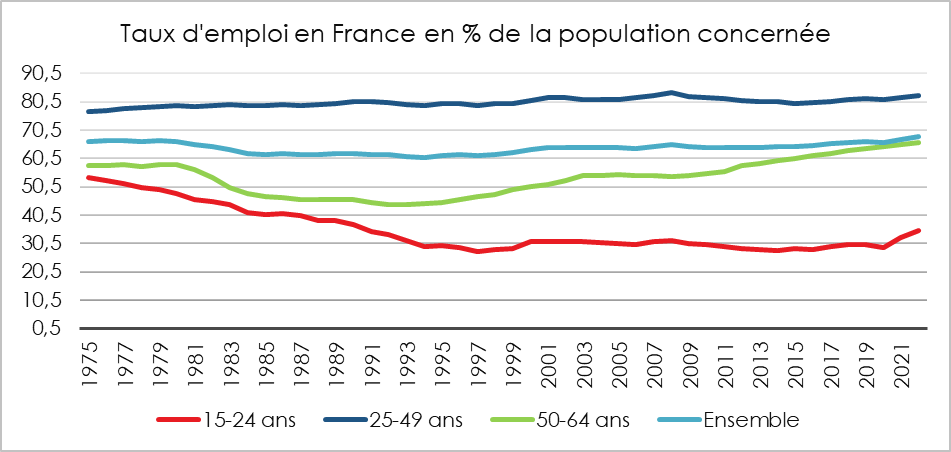
Le taux d’emploi des 55/64 ans s’est accru, en France, de 2010 à 2022 passant de 38 à 56,5 %. Il reste inférieur au taux moyen de l’Union européenne (59,3 %) et surtout à celui de l’Allemagne (73,6 %).
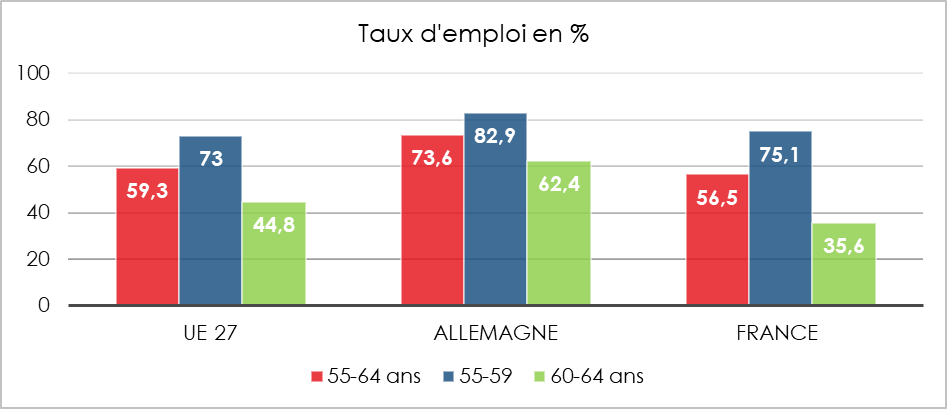
Les différentes réformes des retraites engagées depuis 1993 expliquent la remontée du taux d’emploi après 55 ans. Le passage de la durée de cotisation de 37,5 à 42 ans d’une part et le report de l’âge légal de 60 à 62 ans ainsi que celui de l’âge de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans ont conduit les actifs à retarder leur départ à la retraite. La réforme de 2010, qui a repoussé l’âge de la retraite de deux ans, a eu un indéniable effet horizon. Malgré tout, le taux d’emploi entre 60 et 64 ans est en France de 35,6 % contre 44,8 % en moyenne au sein de l’Union européenne et 62,4 ans en Allemagne.
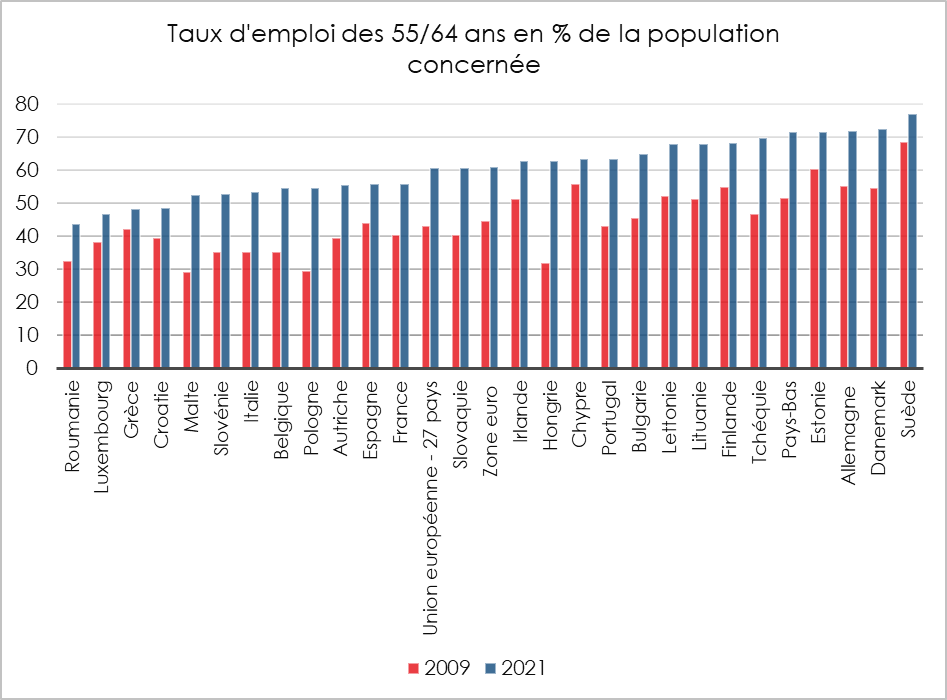
Un âge conjoncturel de départ à la retraite en hausse depuis 2010
Après avoir atteint un point bas à 60,5 ans en 2008, l’âge conjoncturel de départ à la retraite progresse d’année en année. Il a atteint 62,3 ans en 2022, les hommes partant en moyenne à 62 ans quand les femmes partent à 62,6 ans. Avec les dispositifs de départs anticipés dans les fonctions publiques, au sein des régimes spéciaux ou avec le dispositif de carrière longue, plus de 40 % des actifs partiraient en deçà de 62 ans.
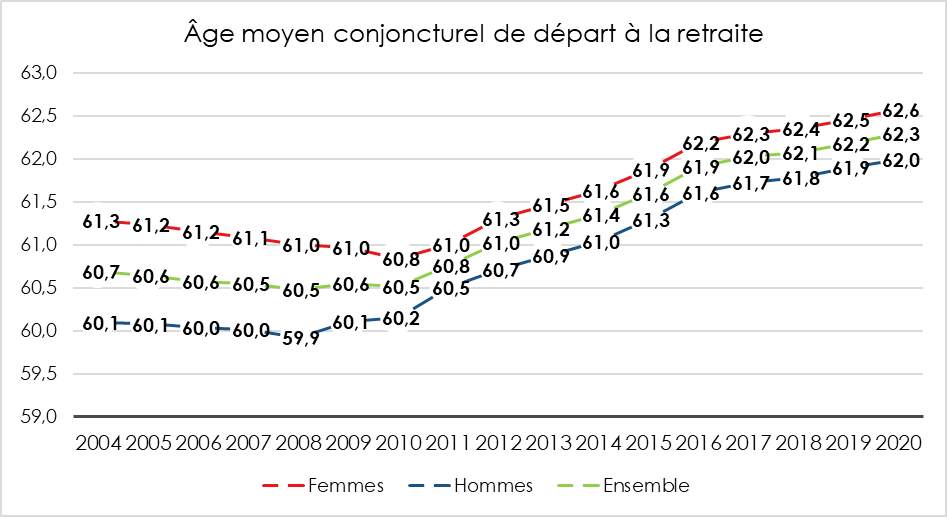
L’augmentation à venir du nombre d’actifs de plus de 60 ans
Pour établir ses prévisions de 2022 concernant l’équilibre à venir des régimes de retraite, le Conseil d’Orientation des Retraites tablait sur la poursuite de la remontée du taux d’activité et d’emploi des seniors. Le principe d’un départ à 64 ans était intégré dans les calculs du COR à l’horizon 2040. La réforme 2023 vise avant tout à accélérer le processus pour réduire les déficits.
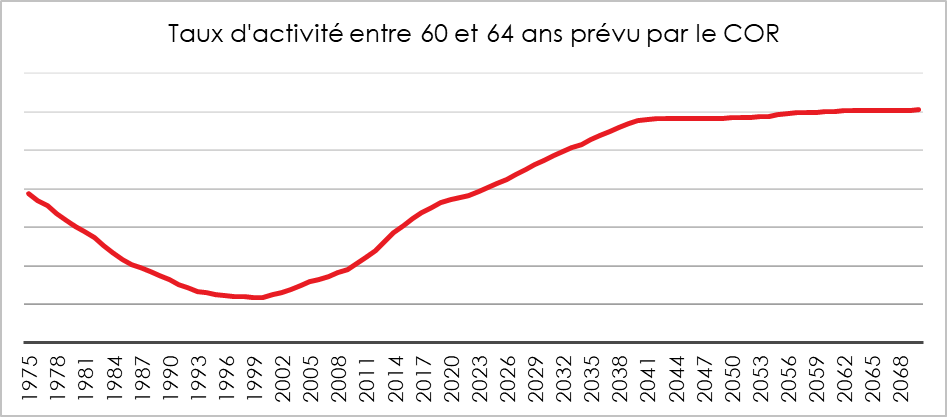
En reportant l’âge légal de 62 à 64 ans, la réforme 2023 accroît le nombre potentiel de personnes en activité. Le surplus atteindrait plus de 350 000 sur une année en 2032, soit l’équivalent de près de la moitié d’une génération. Ces 350 000 seraient constitués essentiellement de 60/64 ans. Cela signifie que ces personnes acquitteront des cotisations sociales finançant notamment les régimes de retraite et ne percevront pas de pensions sauf pour celles qui seraient en cumul emploi/retraite. La population active augmenterait de 1,2 % quand celle des retraités serait réduite de 2 %.
Effectif de personnes supplémentaires en emploi par rapport à une situation hors réforme
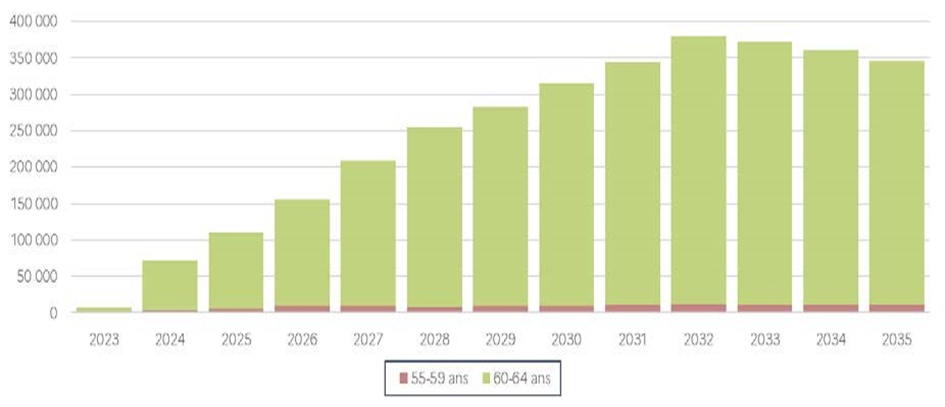
Le taux d’emploi devrait augmenter au minimum de 0,5 % pour l’ensemble de la population d’ici 2030 et de 6 % pour les 60/64 ans. Cette progression ne permettrait pas, en l’état, de rattraper la moyenne européenne. L’importance du dispositif « carrières longues » et les départs des fonctionnaires de catégorie active continueraient à expliquer les écarts avec la moyenne européenne.
Variation du taux d’emploi permise par l’augmentation de l’âge de départ à la retraite induite par la réforme, pour la population générale et pour les seniors
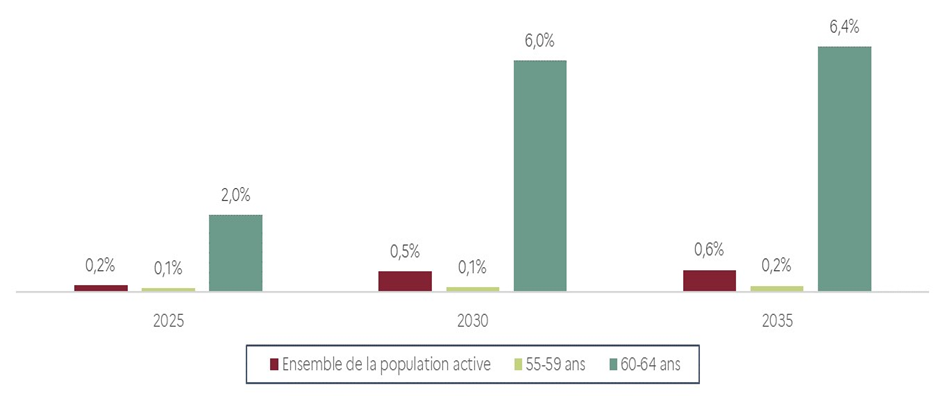
La question sensible du chômage des seniors
Le report de l’âge de la retraite pour être efficace suppose que les personnes concernées soient réellement en emploi. En cas de chômage, les gains pour les régimes de retraite seraient réduits voire annihilés par les dépenses de chômage. Si depuis la réforme de 2010, le taux de chômage des plus de 55 ans a augmenté, il reste inférieur à celui de l’ensemble de la population (respectivement 6 et 7,2 %). En revanche, la durée moyenne du chômage est plus longue pour les seniors que pour le reste de la population. La question de la formation et de l’adaptabilité des postes aux actifs de plus de 50 ans est bien plus centrale que celle du chômage en tant que tel. Par ailleurs, ces dernières années, employeurs et salariés ont utilisé la formule du chômage comme dispositif de préretraite.
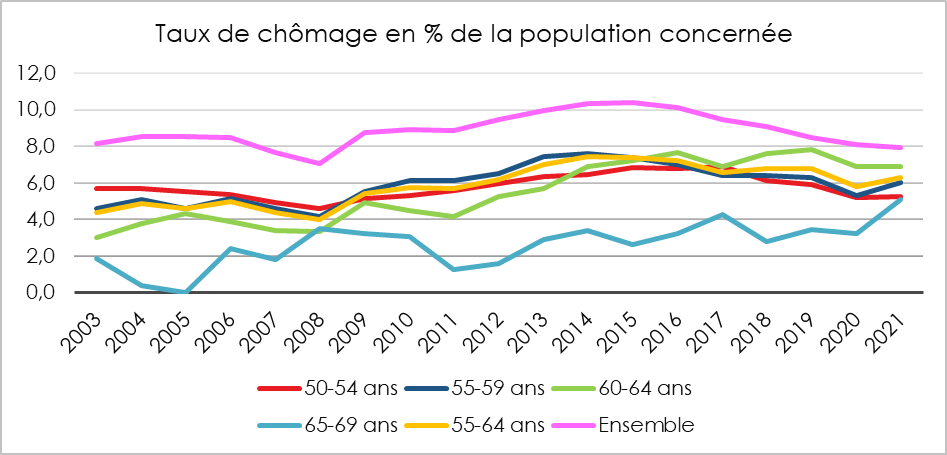
Quelles conséquences pour les complémentaires santé souscrites par les entreprises ?
Le report de l’âge de départ à la retraite de deux ans devrait générer des surcoûts pour les complémentaires de santé dont bénéficient les salariés au sein de leur entreprise. Les dépenses de santé augmentent rapidement après 60 ans. Les arrêts maladie sont plus longs du fait de problèmes de santé pouvant être graves.
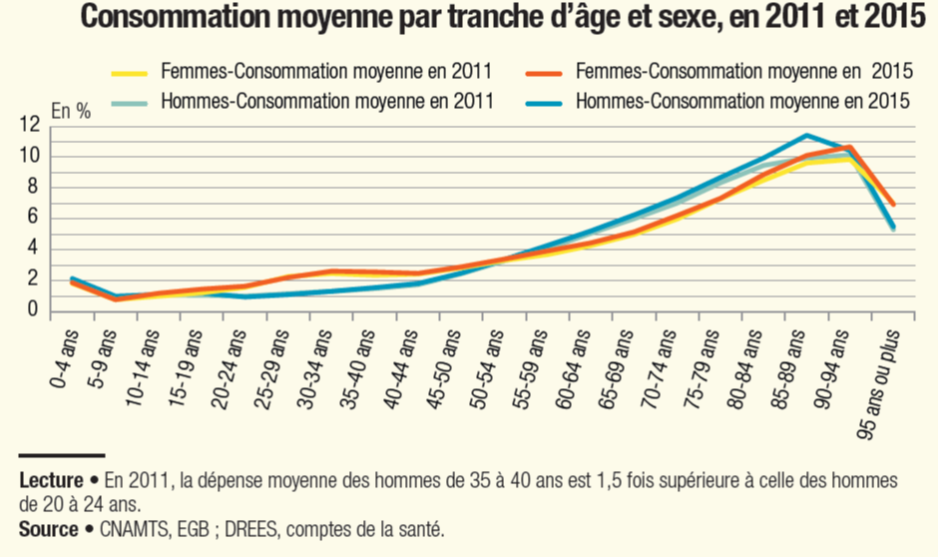
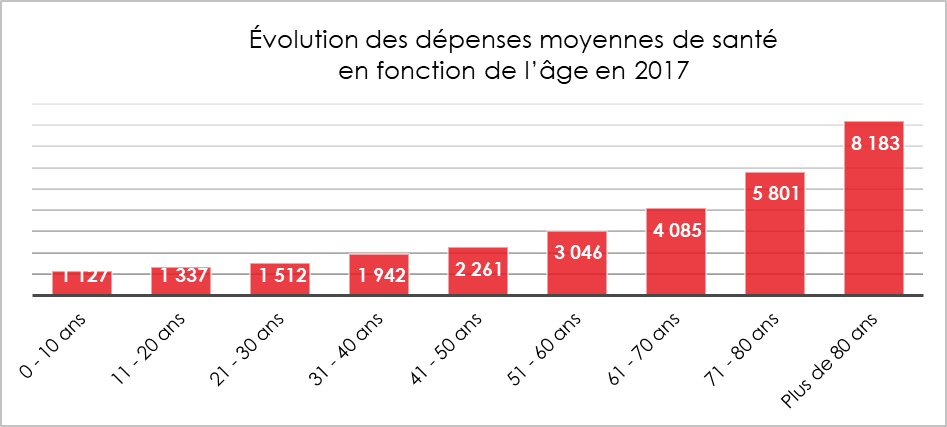
Quelles conséquences pour le régime d’accident du travail ?
Le nombre d’accidents de travail est plus faible pour les seniors. En revanche, la durée des arrêts de travail est plus longue. Le nombre moins important d’accidents du travail est lié à une moindre exposition aux emplois pénibles en fin de carrière et à une plus grande expérience. En 2017, Près de 30 % accidents du travail ayant engendré au moins 4 jours d’arrêt sur 2017 sont survenus à des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. En 2019, la fréquence des accidents du travail diminue avec l’âge mais pas leur gravité.
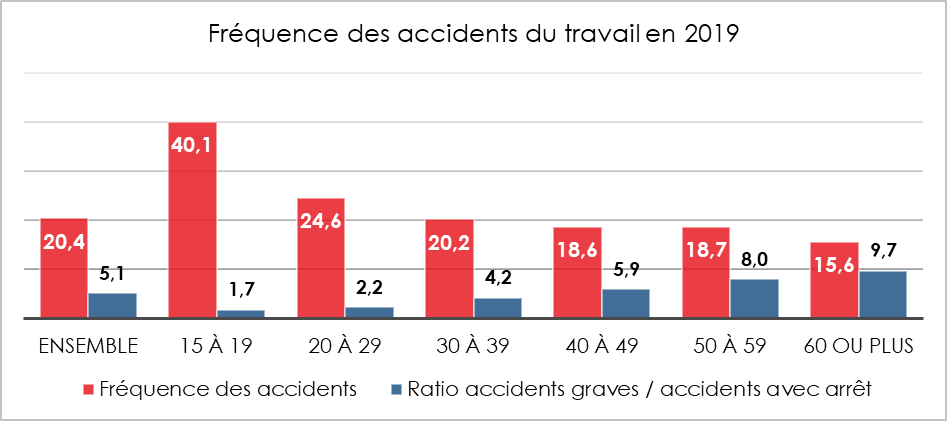
La durée des arrêts de travail faisant suite avec un accident du travail augmente sensiblement avec l’âge
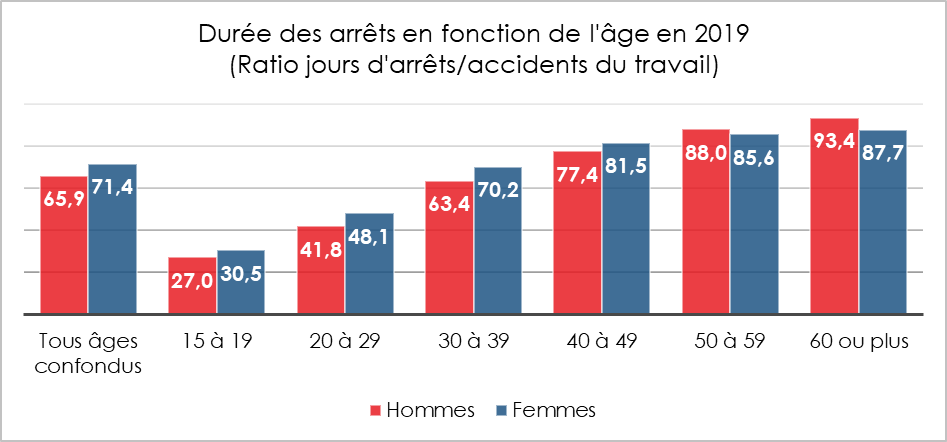
La réforme et son effet sur les pensions
Le report de l’âge légal à 64 ans et le passage à 43 ans de la durée de cotisation peuvent, pour certains assurés, provoquer la perte du bénéfice d’une surcote et donc d’une pension plus élevée. Ces cas devraient être rares, car dans le même temps, un départ plus tardif contribue à une augmentation des pensions de base et complémentaires. La pension de base est calculée en fonction des 25 meilleures années or, en règle générale, les dernières années sont les meilleures en termes de revenus. Les pensions des régimes complémentaires sont fonction du nombre de points accumulés par les assurés. Or, en travaillant plus longtemps, ces derniers auront plus de points.
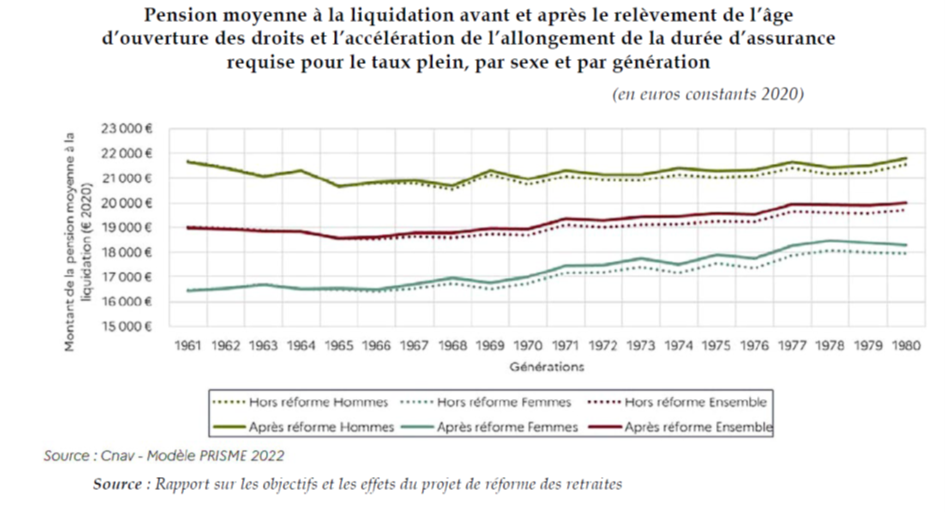
En restant plus longtemps en activité, en raison de la réforme des retraites, les actifs seront amenés à cotiser davantage à leurs plans d’épargne retraite, sachant que les capacités d’épargne sont plus élevées en fin de carrière.
***
*
La réforme de 2023 prévoit que les personnes invalides ou en incapacité professionnelle pourront dès 62 ans voire 60 ans liquider leurs pensions à la différence de ce qui avait été prévu lors de celle de 2010. Ce choix évitera un surcoût (public et privé) pour la prévoyance de plusieurs milliards d’euros. En revanche, la réforme devrait provoquer un surcoût pour les complémentaires santé et la branche accident du travail.
La réforme des retraites version 2023
30 ans après la première réforme adoptée pour prendre en compte les effets du vieillissement de la population sur les équilibres des régimes de retraite, une nouvelle réforme a été adoptée en 2023. Présenté le mardi 10 janvier, le projet de loi a été adopté par le Parlement le 20 mars 2023. Cette loi prévoit le report progressif de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation qui avait été adopté dans le cadre de la réforme Touraine de 2014. Elle prévoit également une augmentation du minimum contributif, une amélioration des droits des mères de famille et des incitations pour le maintien en emploi des seniors. Le projet de loi a été soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.
L’objectif assigné par le gouvernement à la réforme : l’équilibre des régimes de retraite en 2030
Le Gouvernement, en s’appuyant sur les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites, a justifié la nécessité de réformer le système de retraite afin d’éviter une explosion du déficit qui aurait pu atteindre 12 milliards d’euros en 2027, 14 milliards d’euros en 2030 et 21 milliards d’euros en 2035. Cette dégradation des comptes des régimes de retraite est la conséquence de celle du rapport actifs/inactifs. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité, en 1970, 3 cotisants pour 1 retraité, en 2000, 2 cotisants pour 1 retraité, en 2023, 1,7 et 1,4 en 2050. La France comptait 5 millions de retraités en 1981. En 2023, ils sont 17 millions. Ils seront 20 millions d’ici 2040.
Les deux mesures d’âge : le report à 64 ans de l’âge légal et accélération du passage à 43 ans de la durée de cotisation
L’âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, à raison de 3 mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat en 2027, puis atteindra 64 ans en 2030.
La réforme de 2014 dite « Touraine » prévoyant le passage de la durée de cotisation à 43 ans sera accélérée. Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans.
En revanche, le Gouvernement ne modifie par l’âge de la retraite à taux plein, fixé à 67 ans depuis la réforme « Woerth » des retraites. Il correspond à l’âge à partir duquel il est possible de partir sans décote.
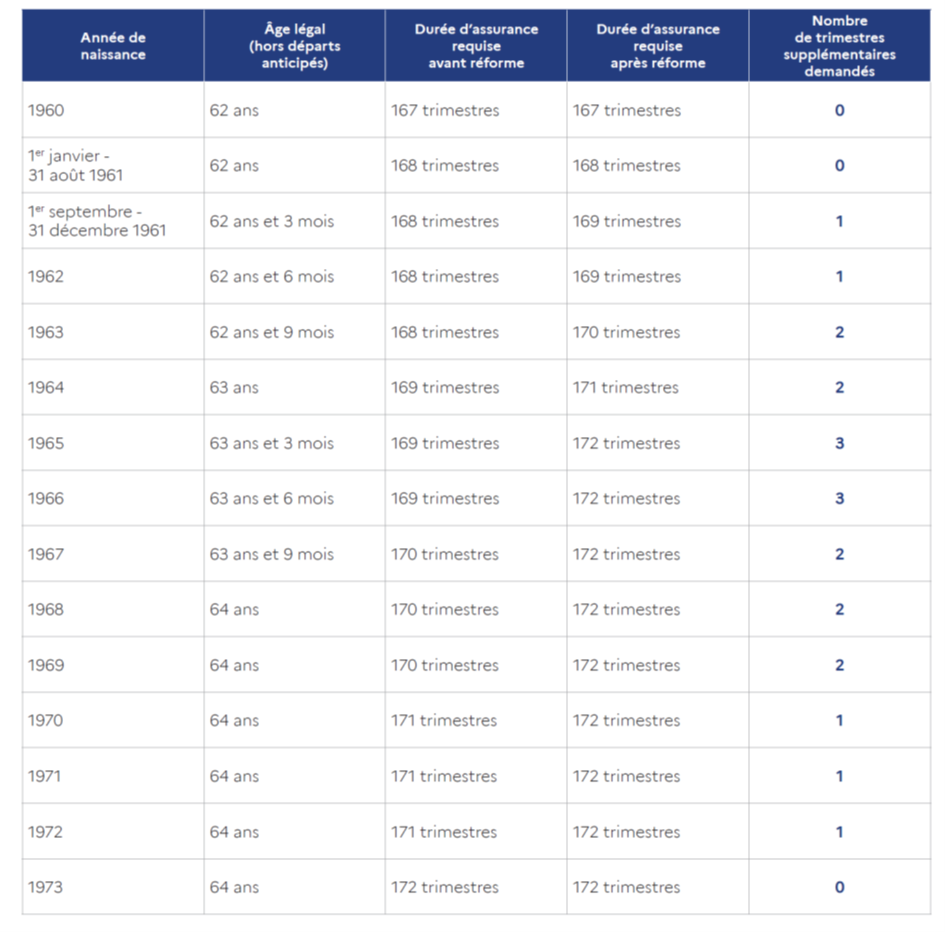
Le dispositif pour la fonction publique
La réforme 2023 concerne également la fonction publique. Les différentes catégories de fonctionnaires (catégories sédentaire, active ou super active) devront progressivement travailler deux ans de plus.
Les fonctionnaires en catégorie active et les militaires conserveront un droit à partir plus tôt compte tenu de leurs sujétions particulières de service public et de leur exposition aux risques. La durée de service et l’âge d’annulation de la décote seront inchangés.
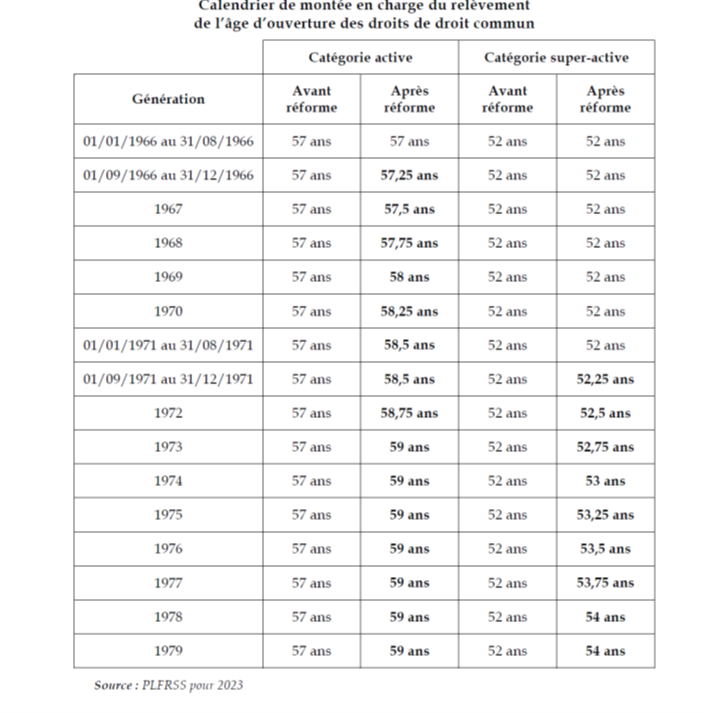
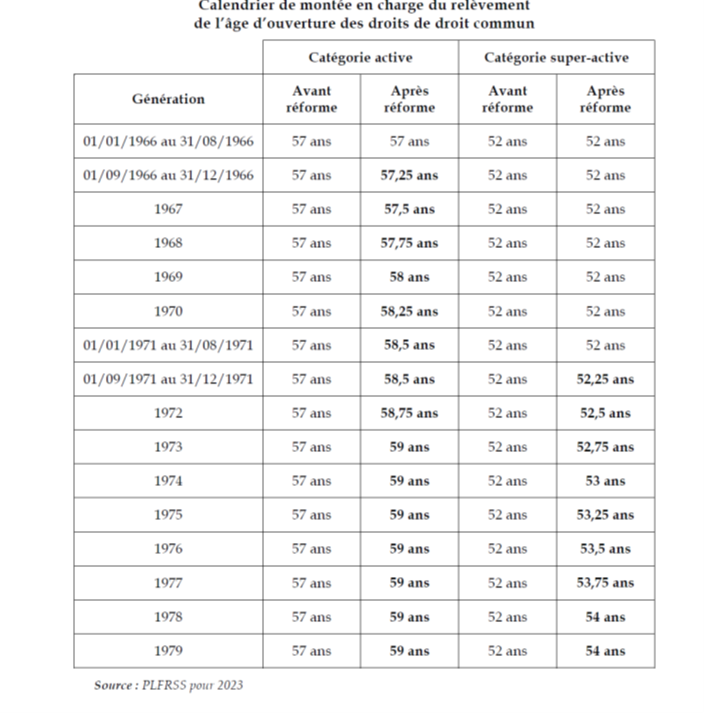
La possibilité de demander à travailler jusqu’à 70 ans dans la fonction publique est systématisée (recul de la limite d’âge sans condition). Actuellement, seuls les agents ayant encore des enfants ou dont la carrière est incomplète peuvent demander à poursuivre leur activité jusqu’à 70 ans.
La retraite progressive est étendue aux agents publics, selon les mêmes principes que le dispositif existant pour les salariés et les indépendants. Les conditions de cumul emploi-retraite sont assouplies à l’identique du secteur privé.
Le cumul emploi-retraite assoupli
La loi Touraine en 2014 avait durci le dispositif de cumul emploi retraite. Les retraités ayant une activité professionnelle cotisaient aux régimes de retraites sans pour autant pouvoir se constituer de nouveaux droits. La réforme 2023 revient au droit antérieur.
Le dispositif « carrières longues » adapté au report de l’âge légal modifié lors de l’examen par le Parlement
Actuellement, un début de carrière avant 20 ans peut permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans peut donner droit à une retraite anticipée de quatre ans.
Le dispositif actuel va être « adapté » : ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir un an plus tôt, à 63 ans ; ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, soit 62 ans ; ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite quatre ans plus tôt, soit 60 ans ; ceux qui ont démarré avant 16 ans pourront terminer leur carrière six ans plus tôt, soit 58 ans. Le texte prévoit que sous certaines conditions, les bénéficiaires du dispositif « carrières longues » pourront partir non pas avec 44 années validées mais avec 43 années.
Deux tiers des assurés devraient ainsi pouvoir partir avec 43 années mais tout dépendra du nombre de trimestres cotisés avant 21 ans, de l’année de naissance de l’assuré et des bornes d’âge légal.
Les périodes de congé parental seront prises en compte tant pour le dispositif « carrières longues » que dans le calcul du minimum de pension de ceux qui ont travaillé plus de 30 ans.
Au total, les assouplissements du régime carrières longues coûteront 700 millions d’euros dont 300 millions pour le dispositif en faveur des moins de 21 ans.
Une surcote pour les mères de famille
Le Parlement a décidé la création d’une majoration de pension pour certaines mères de famille. Cette surcote, pouvant augmenter jusqu’à 5 % la pension des intéressées sera réservée aux femmes qui, à 63 ans, ont atteint la durée de cotisation nécessaire pour partir à taux plein et ont acquis au moins un trimestre au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation d’enfants. Les bénéficiaires de la surcote devront toujours travailler jusqu’à 64 ans.
Cette mesure s’applique tant aux fonctionnaires qu’aux salariées du secteur privé. Elle vise à atténuer la perte de l’avantage du bénéfice des trimestres acquis au titre de la maternité avec le report de l’âge légal. Le coût de cette mesure est estimé à près de 250 millions d’euros à horizon 2030.
Une majoration pour famille nombreuse des professions libérales
Une majoration de pension pour les familles nombreuses des professions libérales a été également ajoutée. Cette disposition permettra aux professionnels libéraux et aux avocats ayant trois enfants et plus de bénéficier de la bonification de pension de 10 % déjà prévue pour les bénéficiaires du régime général.
Les départs anticipés pour invalidité maintenus
Comme aujourd’hui, les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés. Pour les travailleurs handicapés, cette possibilité reste ouverte à compter de 55 ans.
Les victimes d’incapacité permanente pourront, en revanche, partir à la retraite dès 60 ans et non 62 comme prévu par le gouvernement.
La création d’un index senior confirmée
Supprimé par l’Assemblée nationale en première lecture, puis restauré par le Sénat, l’index senior a été proposé dans une nouvelle version par la Commission mixte paritaire.
L’instauration d’un index senior vise à inciter les entreprises à maintenir dans leurs effectifs les salariés de plus de 55 ans. Sur le modèle de l’index égalité homme-femme, les entreprises concernées devront publier une fois par an, sous peine d’amende allant jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires, une liste d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors et aux actions favorisant leur maintien dans les effectifs. Cet index concernera les entreprises de plus de 300 salariés. Un décret définira ces indicateurs, leur méthode de calcul et les modalités de publication, le tout pouvant être amendé par accord de branche. Si l’index d’une entreprise ne s’améliore pas après trois exercices de suite, elle devra définir un plan d’action après négociation avec les représentants du personnel. En revanche, aucun mécanisme de sanction n’est prévu.
Le CDI senior à l’essai
Le Parlement a adopté un article prévoyant, sous certaines conditions, la mise en œuvre d’un contrat à durée indéterminée « senior » pour l’embauche des salariés de plus de 60 ans. Seuls les demandeurs d’emploi de plus d’un an y seront éligibles. La mise en place du dispositif est conditionnée à un accord national interprofessionnel qui définira les contours de ce nouveau CDI. À défaut d’accord avant le 31 août 2023, le dispositif s’appliquera de manière expérimentale du 1er septembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2026. Une convention ou un accord de branche arrêtera les modalités permettant de mettre un terme au CDI quand le salarié aura rempli les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein (donc sans que l’employeur ne soit tenu par la limite des 70 ans actuellement en vigueur) et pour l’inciter à le conserver jusque-là. Le CDI senior sera, dans ce cadre exonéré de cotisations familiales la première année. Les bénéficiaires d’un cumul emploi-retraite ne pourront pas bénéficier de ce CDI. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Le Compte professionnel de prévention modifié
1,9 million de comptes professionnels de prévention (C2P) ont été ouverts depuis la création du dispositif. Ce compte permet d’accumuler des droits pour chaque année d’exposition, qui serviront ensuite à financer des formations, un passage à temps partiel payé temps plein ou à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Le Gouvernement a renoncé à réintégrer le facteur des « ports de charges lourdes » supprimé en 2018. En revanche, les seuils des principaux facteurs d’exposition aux risques professionnels seront abaissés pour permettre à davantage de salariés de bénéficier du dispositif. Le seuil de travail de nuit passera de 120 à 100 nuits par an et celui du travail en équipes successives alternantes passera de 50 à 30 nuits par an. Cela permettra, chaque année, à plus de 60 000 personnes supplémentaires de bénéficier d’un compte. Les points seront acquis plus rapidement pour les salariés exposés à plusieurs risques et sans limite de nombre de points, contrairement à aujourd’hui.
Une nouvelle utilisation du compte professionnel de prévention sera créée avec la possibilité de financer un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.
Un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exerçant des métiers identifiés comme exposés à la pénibilité, afin de mener des actions de prévention et mieux détecter les situations d’inaptitude permettant un départ anticipé à 62 ans.
Un fonds d’investissement d’un milliard d’euros
Le Gouvernement a décidé la création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle doté d’un milliard d’euros sur le quinquennat. Il soutiendra les branches professionnelles pour identifier les métiers exposés aux risques ergonomiques (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations), et financer, avec les employeurs, des actions de prévention et de reconversion.
La clause du grand-père pour les régimes spéciaux
Le gouvernement a maintenu, contre l’avis des sénateurs, la clause du grand-père pour les régimes spéciaux. Tous les salariés actuels resteront régis par leur régime actuel jusqu’à leur retraite. Sont concernés les régimes de la RATP, de la branche des industries électriques et gazières (IEG), des clercs et employés de notaires, des personnels de la banque de France ainsi que des membres du Conseil économique social et environnemental (CESE). Les nouveaux embauchés recrutés à compter du 1er septembre 2023 dans les secteurs ci-dessus seront affiliés au régime général pour la retraite. Cette méthode avait été retenue lors de la fermeture du régime spécial de la SNCF dans la réforme de 2018.
Les régimes autonomes (professions libérales et avocats) et ceux répondant à des sujétions spécifiques (marins, Opéra de Paris, Comédie Française) ne seront pas concernés par cette fermeture.
Les bénéficiaires des régimes spéciaux seront néanmoins soumis au report de l’âge de départ à la retraite de deux ans et à l’accélération de la réforme Touraine mais des mesures d’adaptation sont prévues. La prise en compte des précédentes réformes, qui étalaient l’augmentation de l’âge jusqu’en 2024, conduit à une entrée en vigueur, pour ces actifs, des nouvelles règles relatives à l’âge de départ en 2025.
Une réforme de l’assiette sociale des indépendants
Le Gouvernement a prévu de réformer l’assiette sociale des indépendants d’ici le PLFSS 2024 en concertation avec les professions concernées, afin que son calcul soit simplifié et que les droits à la retraite des indépendants soient renforcés.
Le relèvement du minimum contributif et l’indexation en fonction du SMIC
Reprenant un des objectifs de la loi Fillon de 2003, le gouvernement prévoit que pour une carrière complète cotisée au SMIC, la pension ne pourra être inférieure à 85 % du SMIC net, soit environ 1 200 euros brut par mois. L’objectif est de revaloriser les petites pensions et de créer un écart avec le minimum vieillesse qui est de 963 euros depuis le 1er janvier 2023.
Le minimum de pension augmentera de 100 euros par mois pour une carrière complète dès septembre 2023. Cette mesure s’appliquera aux actuels et aux nouveaux retraités.
Des trimestres supplémentaires pour certaines catégories d’assurés
Les aidants familiaux, qui sont contraints de réduire leur activité pour s’occuper d’un proche parent ou d’un enfant, bénéficieront de validations de trimestres. La réforme donnera également des trimestres de retraite aux personnes ayant effectué des stages de travaux d’utilité collective.
Des mesures d’ajustement budgétaire
En raison des mesures adoptées en faveur des carrières longues, des retraitées femmes, des personnes en incapacité, etc., le Parlement a prévu de nouvelles recettes pour les régimes de retraite. Il a ainsi retenu le principe d’un relèvement de la contribution sur les indemnités de ruptures conventionnelles (300 millions d’euros à horizon 2030). Le gouvernement prévoit également d’augmenter les cotisations vieillesse des entreprises d’un côté et de baisser le niveau de cotisations alimentant la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale (AT-MP) de l’autre.
Les parlementaires se sont aussi entendus pour adopter des mesures de lutte contre la fraude. Pour bénéficier du minimum vieillesse, il faudra avoir résidé au moins 9 mois en France (et non plus 6). Par ailleurs, le versement des retraites à l’étranger sera contrôlé grâce à l’usage de la biométrie. Ces dispositions sont censées rapporter 200 millions d’euros de recettes.
Le bilan comptable
Dans la version présentée en Conseil des ministres, le 23 janvier, le projet de loi prévoyait un retour à l’équilibre des comptes des régimes de retraite en 2030. Le relèvement à 64 ans et l’accélération du calendrier du passage à 43 ans de la durée de cotisation doivent rapporter 17,7 milliards d’euros avant mesures de compensation qui devaient initialement coûter 6 milliards d’euros dont 1,7 milliard d’euros au titre de la revalorisation des pensions minimales.
Dans le cadre de la discussion parlementaire, plusieurs amendements ont accru le coût des compensations. L’élargissement du dispositif des carrières longues, qui permet aux personnes ayant commencé à travailler tôt de partir avant l’âge d’ouverture des droits représente une charge de 700 millions d’euros par an en 2030. La surcote accordée aux assurés – principalement des femmes – ayant atteint, à 63 ans, la durée de cotisation requise pour être éligibles au taux plein devrait coûter 240 millions d’euros par an en 2030. Plusieurs mesures prises en particulier au Sénat ne ponctionneront pas les recettes des régimes de retraites mais celles des autres régimes sociaux. Le « contrat senior » qui sera expérimenté pour des demandeurs d’emploi de longue durée d’au moins 60 ans sera après négociation sociale exonéré de cotisations familiales. A contrario, les personnes atteintes d’une incapacité permanente pourront partir à la retraite dès 60 ans, ce qui réduira d’autant les dépenses de la branche Accident du Travail – Maladie professionnelle.
Le texte prévoit une augmentation des prélèvements sociaux applicables aux indemnités de ruptures conventionnelles, le renforcement de la lutte contre la fraude sociale. Le taux de cotisations d’assurance-vieillesse a également été augmenté, pour accroître les ressources du système de retraites, mais en contrepartie, celui de la branche Accident du Travail Maladie Professionnelle a été diminué, dans des proportions équivalentes, afin que l’opération soit neutre pour les entreprises et n’influe pas sur le coût du travail. Le retour à l’équilibre est soumis à une diminution substantielle du taux de chômage d’ici 2030 (4,5 % contre 7,2 % en décembre 2022). L’équilibre financier sera donc difficile à tenir compte tenu des incertitudes économiques, sociales et politiques.
Assurance vie, une année 2022 atypique
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a dressé le bilan 2022 de l’assurance vie. Le rendement moyen des fonds euros a progressé, passant de 1,28 à 2 % de 2021 à 2022. Cette hausse est la première depuis les années 1990. En 2022, nets d’impôt, les fonds euros de l’assurance vie ont rapporté plus que le livret A, 1,4 %, contre 1,37 %. Jamais l’écart n’aura été aussi faible lors de ces trente dernières années. Les deux produits ne sont néanmoins pas comparables. Le Livret A est un livret réglementé, plafonné quand l’assurance vie est une enveloppe permettant de combiner plusieurs supports et ouvrant droit à des avantages fiscaux tant sur les gains que sur la transmission des produits capitalisés.
L’assurance vie, un tiers de l’épargne financière des ménages
Le patrimoine financier des Français est constitué à 34 % par des dépôts bancaires (les dépôts à vue, les dépôts à terme et les livrets). Leur encours a augmenté de 85 milliards d’euros en 2022 (+4,6 %) pour s’établir à 1 913 milliards d’euros. La deuxième composante est l’assurance vie, dont l’encours représentait 33 % du patrimoine financier des Français fin 2022, soit 1 885 milliards d’euros.
La collecte brute de l’assurance vie a diminué de 5 milliards d’euros en 2022 par rapport à celle de 2021. Elle a retrouvé ses niveaux d’avant-crise (+0,3 % par rapport à 2019). En revanche, les prestations augmentent et ont atteint 116,2 milliards d’euros en 2022 (+5 % par rapport à 2021). Le solde net des flux en assurance vie a reculé selon l’ACPR par rapport à 2021 (+8,4 milliards d’euros en 2022 après +18,3 milliards d’euros en 2021). Ce solde est en recul par rapport à ceux observés en 2018 et 2019 (plus de 20 milliards d’euros).
Le marché de l’assurance vie fortement concentré en France
Six organismes d’assurance représentent plus de 58 % du total des provisions mathématiques, tous supports confondus. Cette forte concentration s’explique notamment par le poids des bancassureurs sur le marché de l’assurance vie. Les bancassureurs ont contribué à hauteur de 8,8 milliards d’euros à la collecte nette quand les autres organismes d’assurance ont enregistré une décollecte de 400 millions d’euros.
La collecte nette portée par les unités de compte
La collecte nette, qui a atteint 8,4 milliards d’euros en 2022, n’a été positive que grâce aux unités de compte. La décollecte pour les fonds euros s’est élevée à 29,8 milliards d’euros en 2022, contre -30,9 milliards d’euros en 2020 et -12,3 milliards d’euros en 2021. Les supports en unités de compte ont connu, de leur côté, une collecte nette historique de 38,2 milliards d’euros, soit un niveau nettement supérieur à celui de 2021 (+30,6 milliards d’euros). Cette progression de la collecte nette des unités de compte est d’autant plus exceptionnelle que les marchés étaient orientés à la baisse l’année dernière.
Une collecte brute en recul et des retraits en hausse
La collecte brute a diminué, en 2022, sur les fonds euros de 2,2 milliards d’euros et de 2,5 milliards d’euros pour les unités de compte. La collecte brute sur les supports en unités de compte s’élève à 54,3 milliards d’euros (- 4 % par rapport à 2021). La collecte nette a été positive grâce à la baisse des rachats (-0,7 %) et à des arbitrages en provenance des fonds euros. Les supports en unités de compte représentent, comme en 2021, 44 % des nouveaux versements sur les contrats d’assurance vie, contre 15 % en 2011.
Les retraits sont en hausse en raison de l’augmentation du nombre de décès et des transferts réalisés au profit du Plan d’Épargne Retraite qui bénéficiait d’un avantage fiscal spécifique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. L’abattement sur les gains de 4 600 pour un célibataire ou 9 200 pour un couple était doublé pour les assurés qui effectuaient des transferts d’un contrat d’assurance vie de plus de huit ans vers un PER. Par ailleurs, le durcissement de l’accès aux prêts immobiliers a conduit des ménages à puiser dans leur assurance vie pour satisfaire aux conditions imposées par les banques.
Une hausse historique du rendement des fonds euros
En 2022, les assureurs ont puisé dans leurs provisions pour participation aux bénéfices accumulées pendant la période de baisse des taux afin de revaloriser les taux de rendement. Ces provisions s’élevaient à près de 5,5 % des encours fin 2021. Le rendement a été ainsi porté à 2 % en moyenne, contre 1,28 % en 2020 et 2021. Cette remontée intervient dans un contexte de relèvement des taux de rémunération de l’épargne réglementée et de résurgence de l’inflation. Le Livret A, dont le taux a été augmenté le 1er février et le 1er août 2022, a enregistré une collecte nette de 32 milliards d’euros auprès des ménages en 2022. Les annonces de relèvements des rendements des fonds euros, intervenues en fin d’année dernière et au début de l’actuelle, n’ont pas eu d’incidence sur la collecte.
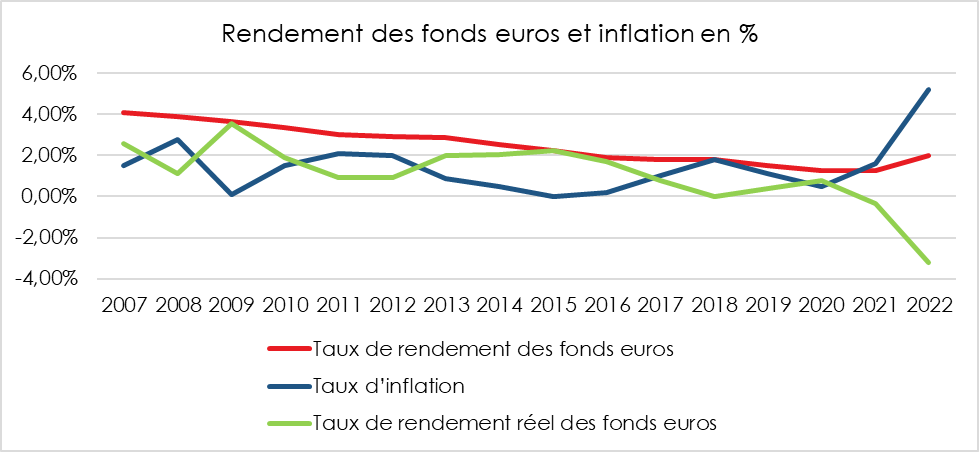
L’épargne retraite, une solution à la problématique des retraites ?
Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne
Le débat sur la réforme des retraites ne constitue-t-il pas une aubaine pour les produits d’épargne retraite ?
Avant tout, en France, les régimes par répartition assurent 98 % des prestations de retraite, contre 85 % en moyenne au sein de l’OCDE. La France a toujours placé la répartition au cœur de son système de retraite et l’actuelle réforme ne changera pas, en la matière, la donne. Cette loi, en allongeant la durée de cotisation jusqu’à 43 ans, pourrait néanmoins inciter de nombreux Français à ouvrir des produits d’épargne retraite ou à y verser des montants supérieurs afin de pouvoir anticiper leur départ à la retraite. En effet, le risque de subir une décote augmente pour les personnes entrées tardivement sur le marché du travail. Au-delà de ce caractère technique, tout débat sur les retraites est anxiogène, car il souligne les difficultés à venir des régimes de retraite. Selon les études réalisées par le Cercle de l’Épargne depuis 2004, l’inquiétude des Français tend à augmenter avec la présentation et la discussion des réformes. Plane l’idée fausse que le système pourrait faire faillite. Par ailleurs, près de trois Français sur quatre estiment que leurs pensions sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement à la retraite. Il n’est donc pas surprenant que la moitié des Français déclarent épargner en vue de leur retraite. Les Français placent la retraite juste après le besoin de se couvrir à court terme (épargne de précaution) comme facteur les amenant à épargner.
Le nouveau PER créé par la loi PACTE profite donc de la situation pour se développer ?
Depuis trois ans, malgré un contexte compliqué, l’épidémie de covid et la guerre en Ukraine, le Plan d’Épargne Retraite (PER), connaît un réel succès. Selon France Assureurs, 3,8 millions de plans d’épargne retraite individuels ont été ouverts. L’encours atteint 48 milliards d’euros. En prenant en compte tous les contrats (individuels et collectifs, en entreprise), 6,5 millions de PER ont été ouverts en trois ans pour un encours de 73 milliards d’euros. Au total, l’encours de l’épargne retraite (tous produits confondus) atteint, en France, 300 milliards d’euros.
Cercle de l’Épargne – données France Assureurs
L’épargne retraite reste faible en France par rapport aux autres pays ?
300 milliards d’euros d’encours pour l’épargne retraite, c’est moins que l’encours du Livret A, 385 milliards d’euros en janvier 2023, et c’est beaucoup moins que celui de l’assurance vie, plus de 1 840 milliards d’euros fin janvier 2023. L’assurance vie est considérée, par ailleurs, comme un produit d’épargne retraite par une grande partie de la population.
En France, au total, un quart des actifs aurait un produit d’épargne retraite. Les cotisations d’épargne retraite, c’est 5 % des cotisations retraite et 2,1 % des prestations. En moyenne, au sein de l’OCDE, c’est 15 %.
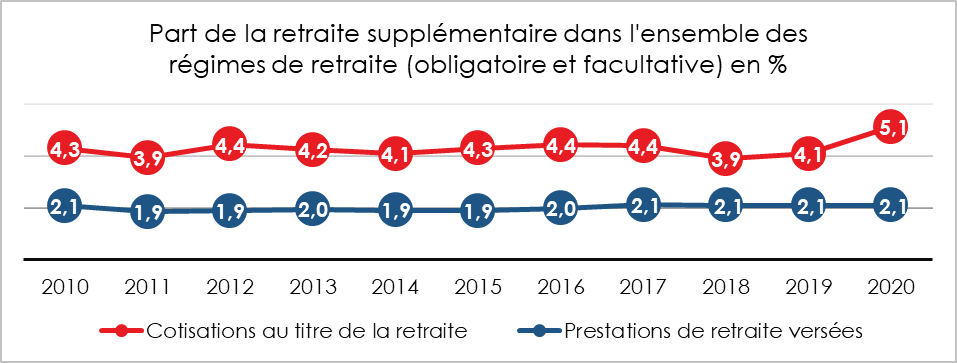
Comment expliquez-vous le faible poids de l’épargne retraite en France ?
Le niveau des pensions était jusqu’à maintenant correct. Le niveau de vie des retraités est actuellement supérieur à celui de l’ensemble de la population de 2 points. En revanche, dans les prochaines années, une dégradation est attendue du fait de l’application des réformes passées. Jusqu’à la loi PACTE, l’offre de produits d’épargne retraite était complexe. Les produits individuels comme le PERP ou le Contrat Madelin disposaient d’une sortie essentiellement en rente quand les Français sont adeptes des sorties en capital. Le PER, en prévoyant dès le départ une sortie en capital pour les versements des particuliers, a répondu à leurs attentes.
Du fait de l’application des réformes adoptées depuis 1993, le niveau de vie relatif des retraités par rapport à l’ensemble de la population devrait diminuer dans les prochaines années. Le taux de remplacement (pensions/derniers revenus d’activité) se dégradera également. L’épargne retraite sera donc la bienvenue pour maintenir le niveau de vie des futurs retraités.
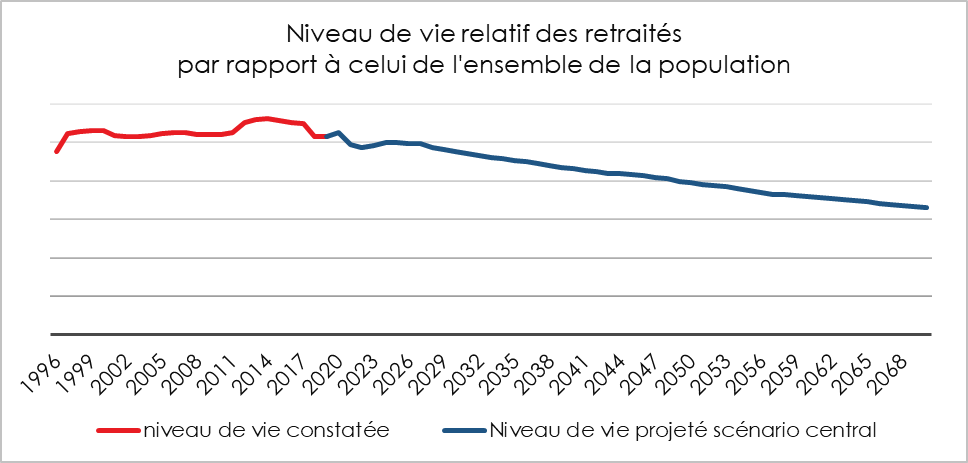
La première épargne retraite, en France, c’est l’immobilier ?
Les Français aiment la pierre. Plus de 75 % des personnes qui liquident leurs droits à la retraite sont propriétaires de leur résidence principale.
L’investissement immobilier locatif est jugé comme un bon placement en vue de la retraite, néanmoins seulement 8 % des ménages y ont recours. En revanche, depuis plusieurs années, les parts de SCPI ou d’OPCI (pierre papier) rencontrent un vif succès. Ils sont de plus en plus présents au sein des contrats d’assurance vie ou dans les Plans d’Épargne Retraite.
Dans ce contexte, le PER est-il le bon placement pour la retraite ?
Un produit d’épargne a comme avantage d’être destiné à la préparation exclusive de la retraite. Sauf cas exceptionnels (invalidité, perte de droits au chômage, décès du conjoint, achat de la résidence principale), l’épargne qui y est affectée ne peut pas être retirée avant la liquidation des pensions de retraite. En outre, les versements ouvrent droit à une déduction fiscale à l’entrée attractive. Par ailleurs, ce produit est également accessible en entreprise (PER collectif et PER obligatoire). Dans ce cas, les salariés bénéficient de versements ou d’abondements de la part des employeurs. Les suppléments d’épargne retraite devraient constituer, dans les prochaines années, des éléments d’attractivité au niveau de l’embauche et du maintien des effectifs pour les entreprises.
L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne : Pour un renouveau de la négociation sociale
Redonner corps à la négociation sociale, après l’âpre séquence sur les retraites, sera un des enjeux majeurs des prochains mois. De nombreux sujets restent pendants depuis des années et surtout depuis la crise sanitaire. Cette dernière a souligné les failles qui existaient en matière de prévoyance pour la couverture de certains risques. Si nous n’avons pas vocation à connaître une épidémie chaque année, de nouveaux évènements pourraient dans l’avenir nous contraindre à des réductions involontaires d’activité parmi lesquelles figurent par exemple les attaques cybernétiques ou les épisodes climatiques violents. L’essor du télétravail oblige également à envisager une reformulation de certains concepts du droit du travail comme la durée de travail ou la responsabilité en cas d’accident du travail. Le développement des emplois à la tâche et d’auto-entrepreneurs dépendants de plateformes digitales nécessite que la notion de contrat de travail soit revisitée. Par ailleurs, l’adaptation de l’emploi à une population active plus âgée se pose. Les branches devraient également se saisir plus activement de la diffusion de l’épargne retraite collective afin qu’un plus grand nombre de salariés soient couverts. Aujourd’hui, seulement un salarié sur quatre l’est, essentiellement au sein des grandes entreprises. Des aides spécifiques pour les PME et les TPE devraient être imaginées avec une mutualisation la plus large possible. Il n’est pas souhaitable qu’une population active à deux ou trois vitesses se mette en place. Les salariés des grandes entreprises disposant de meilleures couvertures sociales risquent, le cas échéant, de cohabiter avec des salariés de PME moins bien couverts et des travailleurs indépendants peu ou pas couverts. La protection sociale est amenée à évoluer en phase avec l’économie. Elle a une ardente nécessité de se réinventer pour ne pas péricliter. L’immobilisme serait synonyme d’attrition. La sacralisation du champ social à travers une reconnaissance constitutionnelle limiterait l’ingérence de l’État. Aux côtés des domaines de la loi et du règlement, celui du social serait protégé, donnant ses lettres de noblesse à la négociation. L’État ne pourrait plus intervenir sauf impérieuse nécessité. Cette reconnaissance est certes une remise en cause du principe de centralisation engagée depuis 1995 avec l’instauration des lois de financement de la Sécurité sociale. Elle redonnerait de l’espace et serait un gage de subsidiarité dans un pays qui reste malgré les décentralisations menées, depuis 1982, vertical.
L’assurance vie sous pression en février
Résultats de l’assurance vie/PER – février 2023 : L’assurance vie sous pression
La collecte nette sauvée par les unités de compte
En février 2023, l’assurance vie a dégagé une collecte nette de 1,1 milliard d’euros, après 1,2 milliard d’euros en janvier, bien plus faible que celle du Livret A (+6,27 milliards d’euros). Traditionnellement, le mois de février est pourtant un bon cru pour l’assurance vie, avec aucune décollecte lors de ces dix dernières années. La collecte moyenne, lors de ces dix dernières années était de +2,1 milliards d’euros.
L’assurance vie est de plus en plus concurrencée par les livrets d’épargne réglementée ainsi que par les contrats à terme qui proposent, sans risque de capital, des rendements équivalents voire supérieurs (2 % en moyenne pour les fonds euros de l’assurance vie en 2022 contre 3 % depuis le 1er février 2023 pour le Livret A). Les unités de compte, dans un contexte boursier plutôt favorable même s’il est volatil, demeurent le vecteur de croissance de l’assurance vie. La collecte nette en fonds euros demeure, en effet, négative (-1,7 milliard d’euros) quand elle positive pour les unités de compte (+2,8 milliards d’euros).
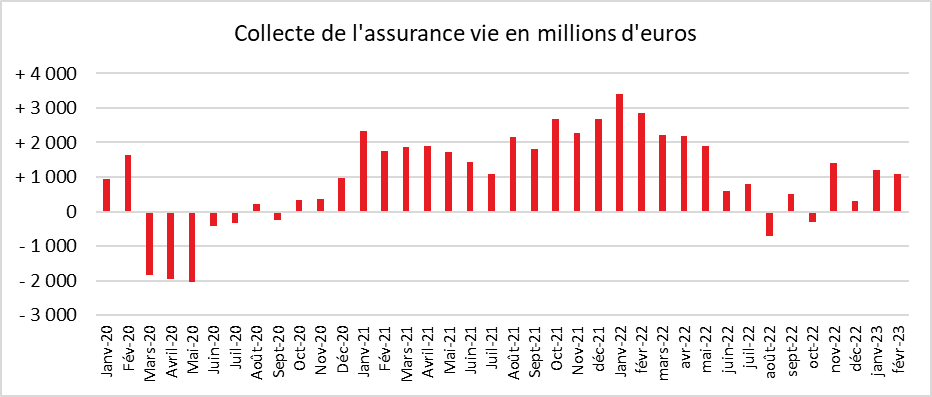
En février, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 13,0 milliards d’euros avec une proportion de 40 % pour les unités de compte. Cette collecte brute est élevée d’autant plus que le Livret A et le LDDS ont bénéficié en février de l’effet « relèvement de leur taux » en cumulant 8,17 milliards d’euros de collecte. Les prestations sont en hausse, de leur côté, à 11,9 milliards d’euros en février. Les prestations sont portées depuis plusieurs années par l’augmentation des décès qui s’accompagne de versements au profit des bénéficiaires désignés ou des héritiers.
Le Plan d’Épargne Retraite assurantiel en mode conquête
Lancé le 1er octobre 2019, le Plan d’Épargne Retraite conquiert, chaque mois, de nouveaux adeptes avec, en février, 71 600 nouveaux assurés. Les cotisations en février ont atteint 544 millions d’euros, en hausse de +14 % par rapport au même mois de 2022. La collecte nette s’est élevée à +410 millions d’euros, en hausse de +4 % par rapport à février 2022.
Les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois, 22 900 assurés pour un montant de 563 millions d’euros.
Fin février, 4 millions de personnes avaient souscrit à un PER assurantiel. L’encours de ce produit a atteint de son côté 51,2 milliards d’euros constitué à hauteur de 46 % d’unités de compte.
L’assurance vie de plus en plus challengée
Avec la hausse des taux, de plus en plus d’établissements financiers proposent, dans le cadre de leurs « superlivrets » ou de leurs contrats à terme, des rendements de plus en plus attractifs concurrençant ceux des fonds euros de l’assurance vie. Cette dernière devrait donc continuer à enregistrer, dans les prochains mois, des petites collectes qui resteront portées par les unités de compte. Les fonds euros ne retrouveront quelques attraits qu’avec la décrue attendue de l’inflation et donc des rendements de l’épargne réglementée. L’assurance vie n’en demeure pas moins le premier placement des ménages avec un encours de 1874 milliards d’euros. Elle bénéficie toujours d’un régime incitatif en particulier pour les contrats ouverts depuis plus de huit ans. Ce produit permet en outre de combiner garantie en capital avec les fonds euros et valeurs de marché avec les unités de compte.
Le Livret A signe un nouveau record depuis quatorze ans, poussé par le taux à 3 %
« Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois (le mois de l’annonce et les deux qui suivent) », explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne dans les colonnes du journal Les Echos. Selon lui « la forte collecte de 2023 est liée à l’ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an. »
Livret A une collecte abracadabrantesque en février
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats du mois de février 2023
LE LIVRET A, UNE COLLECTE ABRACADABRANTESQUE
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le Livret A, seul au monde ou presque
Avec 6,27 milliards d’euros de collecte au mois de février, le Livret A établit un record. Jamais au deuxième mois de l’année, le Livret A avait connu un telle collecte. Le produit d’épargne le plus diffusé confirme et signe ainsi son bel entame d’année 2023. En deux mois, il a colleté 15,54 milliards d’euros. Il faut remonter à 2009 au moment de la banalisation de la distribution du Livret A, pour avoir un tel montant de collecte en janvier et février (20,73 milliards d’euros). L’encours du Livret A bat un nouveau record en février à 391 milliards d’euros, en hausse de 50 % en dix ans.
Toujours l’effet taux
Le résultat de février s’inscrit dans le prolongement logique de celui du mois de janvier (+9,27 milliards d’euros) et trouve son origine dans le relèvement du taux du Livret A intervenu le 1er février dernier. La collecte de février 2023 est plus de cinq fois supérieure à la moyenne des mois de février de ces dix dernières années. Elle est deux fois plus importante que celle du mois de février 2022 qui avait été dopée par le premier relèvement intervenu depuis plus de dix ans, le taux étant alors passé de 0,5 à 1 %.
Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois (mois de l’annonce et les deux qui suivent). La forte collecte de 2023 est liée à l’ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an. Le taux du livret A a été multiplié par six en douze mois. Ce rendement place le produit d’épargne le plus diffusé en France, parmi ceux qui sont les mieux rémunérés. Seul le Livret d’Épargne Populaire avec un taux de 6,1 % se classe au-dessus mais n’est pas accessible à tous les épargnants (18,6 millions de personnes éligibles – 7 millions en possèdent un). Le Livret A tire sa force du triptyque, sécurité, liquidité et zéro prélèvement. Quand à ces trois facteurs, se rajoute une rentabilité relative attractive, il n’est pas surprenant que la collecte s’envole.
Une concurrence limitée
Plusieurs établissements financiers tentent de concurrencer le Livret A en proposant des taux promotionnels dans le cadre de superlivrets mais ces taux ne sont applicables que sur de courtes périodes. Ramenés sur l’année, ces taux sont moins compétitifs que le Livret A surtout en tenant compte de la fiscalité. Seuls les comptes à terme peuvent à la limite concurrencer le Livret A. Ils ne sont pas plafonnés mais l’argent est bloqué, en règle générale, de 12 à 24 moins et le versement doit intervenir souvent en une seule fois avec un montant qui peut se révéler élevé (10 000 à 20 000 euros).
Le paradoxe de l’épargne en période d’inflation
Le passage à 3 % du taux du Livret A sur fond d’inflation incite les ménages à réduire leurs liquidités sur leurs comptes courants. Le Livret A apparait, pour une large majorité des Français, comme le meilleur placement pour se protéger de la hausse des prix même s’il n’en couvre que la moitié.
Face à la hausse des prix, les Français, en moyenne, ne puisent pas dans leur épargne de précaution. Au contraire, ils la renforcent en préférant diminuer leurs dépenses de consommation. Ils veulent renforcer leur épargne afin de pouvoir faire face à des dépenses qui pourraient coûter, à terme, plus chères. Implicitement, ils veulent également conserver en valeur réelle le montant de leur patrimoine financier ce qui les conduit à épargner d’avantage. Par ailleurs, leurs capacités d’épargne n’ont pas été atteintes car les pertes de pouvoir d’achat sont pour le moment limitées. Même si le ressenti est tout autre, selon la Banque de France et l’INSEE, les pertes ont été évaluées en 2022 entre 0,1 et 0,2 %.
Reclassement des liquidités
Avec la résurgence de l’inflation, les ménages n’entendent plus laisser dormir leurs liquidités sur leurs comptes courants. Ils arbitrent les sommes accumulées sur ces derniers au profit de l’épargne réglementée. Depuis des années, l’encours des dépôts à vue augmentait au point de dépasser en 2022, 540 milliards d’euros. Depuis le mois de septembre dernier, pour la première fois depuis plus de 7 ans, une baisse est constatée. De fin 2019 à septembre 2022, l’encours des dépôts à vue avait augmenté de 140 milliards d’euros. Il est revenu à 514 milliards d’euros à fin janvier 2023.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire sur les pas de son grand frère
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a enregistré une collecte de 1,9 milliard d’euros en février. En deux mois, celle-ci a atteint 3,85 milliards d’euros portant l’encours à un niveau record de 138,1 milliards d’euros, en hausse de 40 % en dix ans.
Le LDDS est, en règle générale, associé aux comptes courants des ménages du fait, dès sa création en 1983, de la banalisation de sa distribution quand celle-ci n’est intervenue qu’en 2009 pour le Livret A. Les ménages affectent plus rapidement leurs liquidités entre le LDDS et leurs comptes courants qu’avec le Livret A qui peut être ouvert dans un autre établissement.
Le LDDS ainsi que le Livret A ont pu bénéficier des versements des Primes de Pouvoir d’Achat de 2022 versées en décembre ou en janvier.
Vers une collecte record
Traditionnellement, le premier semestre est porteur pour le Livret A. Cette année, il est parti pour battre des records. Le mois de mars devrait encore être marqué par une collecte élevée toujours sous l’emprise de l’effet taux. Un tassement devrait se produire dans la seconde partie de l’année sauf si une nouvelle revalorisation du taux du Livret A était décidée. Compte tenu de la formule de calcul qui associé inflation et taux des marchés monétaires, le taux du Livret A pourrait atteindre plus de 3,5 %. Il est probable que les pouvoirs publics n’appliquent pas la formule sur la recommandation de la Banque de France comme lors du relèvement du 1er février dernier. En espérant une décrue rapide des prix au cours des prochains mois, les pouvoirs publics pourraient opter pour le statuquo ou pour 3,25 %.
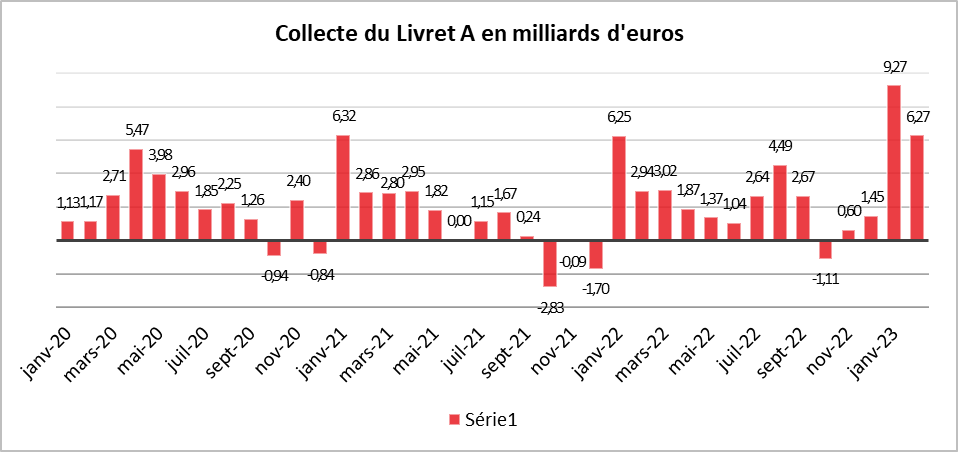
Assurance-vie : les 6 informations capitales à scruter sur son relevé annuel
Interrogé dans les colonnes de Ouest France, le directeur du Cercle de l’Epargne sur les éléments figurant dans le relevé annuel adressé aux titulaires de contrat d’assurance vie met en garde contre « l’abondance d’informations ». Il estime qu’il est difficile de les traiter de façon claire.
La Bourse chahutée : faut-il s’inquiéter pour son assurance-vie ?
Interrogé dans Ouest France, Philippe Crevel conseille de « ne surtout pas paniquer et vendre à tout va ses unités de compte, . Car, à ce moment-là, on subirait la baisse. »
Le Livret A est-il un bon placement pour préparer sa retraite ?
Dans cet article consacré à la préparation à la retraite, Philippe Crevel explique pourquoi le Livret A n’est pas destiné à cet objectif. « Pour préparer sa retraite, mieux vaut s’y prendre au moins 20 ans avant la fin de sa vie active ». Le Livret A en étant plafonné à 22 950 € est insuffisant pour assurer un complément de revenu tout au long de la retraite selon le directeur du Cercle de l’Épargne.
Retour sur une année d’épargne
Augmentation de l’inflation, baisse du pouvoir d’achat, hausse des taux, cours des actions volatil, l’année 2022 a été mouvementée pour les épargnants. Comme lors des précédents épisodes inflationnistes, les ménages français ont maintenu un effort important d’épargne. En vertu de l’effet Tobin, ils ont souhaité se prémunir des risques à venir en renforçant leur épargne de précaution. Les incertitudes économiques, la crainte de ne pas pouvoir s’acquitter des dépenses à venir et celle d’une hausse des impôts les ont conduit à mettre de l’argent de côté. L’effort accru d’épargne repose également sur un objectif d’encaisse. Comme l’inflation déprécie le capital de l’épargne, les ménages doivent épargner d’avantage pour le reconstituer. Selon l’économiste Jean-Marc Daniel, l’effet Tobin joue jusqu’à un taux d’inflation de 8 % ; au-delà, les pertes de pouvoir d’achat contraignent les ménages à puiser dans leur épargne. Avec un taux d’inflation de 5,2 % en 2022, la France se situait en-dessous de ce seuil expliquant un taux d’épargne encore supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire. Les ménages ont privilégié, en 2022, les produits de court terme, à capital garanti, essentiellement les livrets réglementés comme le Livret A, au nom de l’effet précaution dans un contexte boursier plus compliqué qu’en 2021.
Au sommaire de cette étude
- Dépôts à vue, une décrue en fin d’année 2022 après une longue phase de progression
- Le Livret A, une année en or !
- Le Livret de Développement Durable et Solidaire, sur les traces de son grand frère
- Le Livret d’Épargne Populaire retrouve des couleurs
- Le Compte d’Épargne Logement toujours sur un plateau
- Le Plan d’Épargne Logement, en mode érosion
- Le Plan d’Épargne Populaire, lent déclin d’un produit fermé à la commercialisation en 2003
- Les livrets ordinaires, en hausse malgré une faible rémunération
- 2022, une année hors normes pour l’assurance vie
- Le PER, toujours en pointe
- Le Plan d’Épargne en Actions, la barre des 5 millions de titulaires à nouveau franchie
- L’immobilier encore en hausse
- De 2022 à 2023…
Augmentation de l’âge médian et du taux de dépendance au sein de l’Union européenne
Au 1er janvier 2022, l’âge médian de la population de l’Union européenne a atteint 44,4 ans, soit 0,3 an de plus qu’en 2021. Cet âge a progressé de 2,5 ans depuis 2012 (en moyenne de 0,25 an par an). La moitié de la population de l’Union avait ainsi, en 2022, plus de 44,4 ans, tandis que l’autre moitié était plus jeune. Dans les pays de l’Union, l’âge médian variait de 38,3 ans à Chypre à 48,0 ans en Italie. 18 pays de l’Union étaient en-dessous de l’âge médian de l’Union. Entre 2021 et 2022, l’âge médian a augmenté dans 24 pays de l’Union, tandis qu’il a diminué en Allemagne (-0,1 an) et est resté constant en Autriche et aux Pays-Bas. La plus forte augmentation de l’âge médian entre 2021 et 2022 a été observée en Grèce (+0,6 an) et en Tchéquie (+0,5). L’âge médian est, en France (42,2 ans), inférieur à la moyenne européenne.
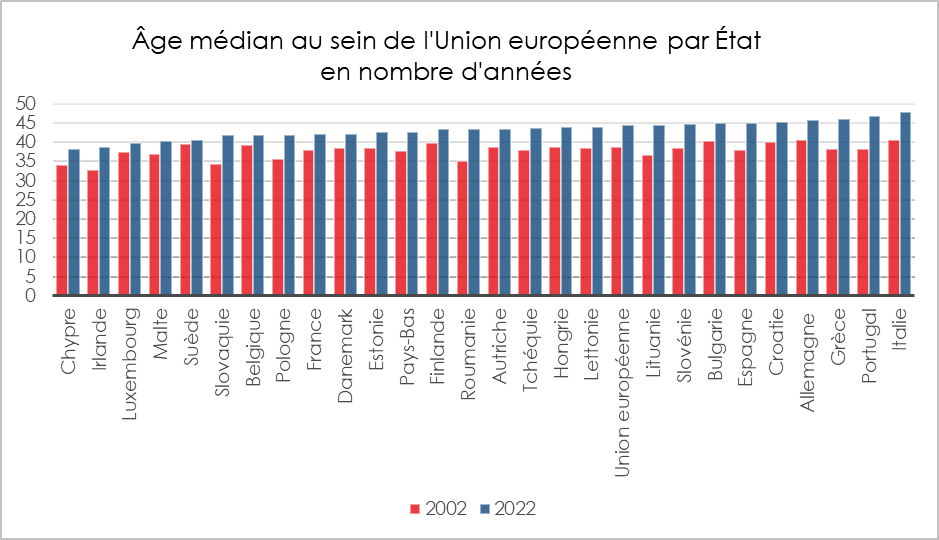
Le taux de dépendance des personnes âgées de l’Union, défini comme le rapport entre le nombre de personnes âgées (65 ans et plus) et le nombre de personnes en âge de travailler (15-64 ans), continue de progresser. Ce taux était de 33 % en 2022, soit 0,5 point de pourcentage (pp) de plus qu’en 2021. Depuis 2012 (27,1 %), cet indicateur a augmenté de 5,9 pp. Les ratios les plus élevés ont été enregistrés en Italie (37,5 %), en Finlande (37,4 %) et au Portugal (37,2 %), tandis que les plus faibles ont été enregistrés au Luxembourg (21,3 %), en Irlande (23,1 %) et à Chypre (24,5 %). Avec un taux de 34,7 %, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne.
Par rapport à la décennie précédente, les plus fortes augmentations des ratios ont été observées en Finlande (+9,7 pp), en Pologne (+9,6 pp) et en Tchéquie (+9,2 pp) et les plus faibles au Luxembourg (+1,0 pp), en Autriche (+3,1 pp ) et l’Allemagne (+3,3 pp).
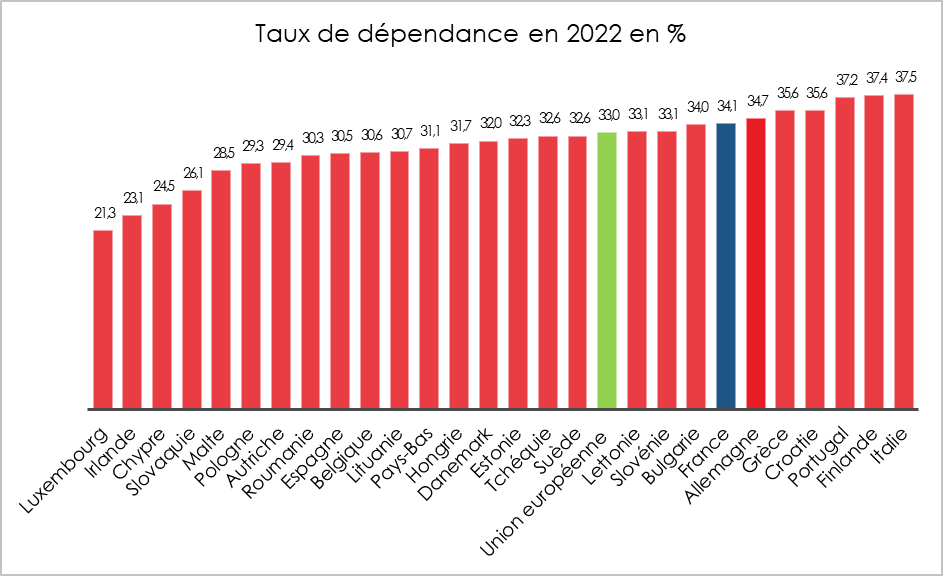
L’espérance de vie en bonne santé, la France au-dessus de la moyenne européenne
En France, l’espérance de vie à la naissance a, depuis la Seconde Guerre mondiale, augmenté à un rythme soutenu. Il en est de même pour celle calculée à 65 ans. La question de l’espérance de vie en bonne santé a été abordée au cours du débat sur les retraites. Le report éventuel de 62 à 64 ans a été accusé de faire perdre des années en bonne santé aux futurs retraités. Par nature, l’espérance de vie en bonne santé est une valeur subjective contrairement aux données objectives de l’espérance de vie ce qui peut donner lieu à des appréciations différentes.
L’indicateur d’espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité est calculé à partir des réponses apportées par un échantillon de personnes dit représentatif à la question « Êtes-vous limité depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? ». Les personnes interrogées doivent indiquer s’il s’agit de limitations fortes ou non, ce qui permet également de repérer les personnes handicapées et de calculer un indicateur d’espérance de vie sans incapacité forte.
Espérance de vie en bonne santé à 65 ans : 12 ans en moyenne en France
En France, en 2021, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans s’élève à 12,6 ans pour les femmes et 11,3 ans pour les hommes. Au même âge, l’espérance de vie sans incapacité forte atteint, quant à elle, 18,8 ans pour les femmes et 16,2 ans pour les hommes. Entre 2008 et 2021, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a augmenté de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans et 7 mois pour les femmes. L’espérance de vie sans incapacité forte à 65 ans augmente au cours de cette même période, de 2 ans et 2 mois pour les femmes et 2 ans et 1 mois pour les hommes.
La tendance à la hausse des espérances de vie sans incapacité et sans incapacité forte à 65 ans s’est accélérée ces deux dernières années, en dépit de la crise sanitaire. Après un recul en 2020 (sauf pour l’espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans), ces indicateurs ont fortement progressé en 2021, rattrapant ce recul et dépassant le niveau qu’ils auraient atteint en suivant leurs tendances d’avant-crise.
La DREES souligne que les variations d’une année sur l’autre doivent être interprétées avec prudence en raison de la dimension déclarative de l’indicateur et de la taille de l’échantillon de l’enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) sur laquelle les indicateurs reposent.
Entre 2008 et 2021, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a crû plus vite que l’espérance de vie. En 2021, pour les hommes les années sans incapacité représentaient 59,3 % des années restant à vivre à 65 ans, contre 47,7 % en 2008. Pour les femmes, la part d’années sans incapacité dans l’espérance de vie à 65 ans est passée de 44,7 % en 2008 à 54,4 % en 2021. L’espérance de vie sans incapacité a augmenté au moment où, avec la crise covid, l’espérance de vie à 65 ans a enregistré une baisse. Malgré un rebond en 2021, l’espérance de vie à 65 ans n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise.
Augmentation de l’espérance de vie sans incapacité à la naissance
L’espérance de vie sans incapacité peut également être calculée à tous les âges de la vie, notamment à la naissance. Elle reflète alors les incapacités qui font leur apparition dès l’enfance ou au cours de la vie active, et couvre ainsi l’ensemble de la population, contrairement à l’espérance de vie à 65 ans qui ne concerne, par définition, que les personnes ayant survécu jusqu’à cet âge.
À la naissance, en 2021, les femmes peuvent espérer vivre 67,0 ans sans incapacité et 78,6 ans sans incapacité forte ; les hommes 65,6 ans sans incapacité et 74,4 ans sans incapacité forte. Depuis 2008, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance des femmes a augmenté de 2 ans et 6 mois, celle des hommes de 2 ans et 10 mois. Les espérances de vie sans incapacité forte augmentent sur la même période de 1 an et 11 mois pour les femmes et 2 ans et 6 mois pour les hommes.
La France au-dessus de la moyenne pour l’espérance de vie sans incapacité
En France, en 2020, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est, selon Eurostat, supérieure à la moyenne européenne, de 8 mois pour les hommes et de 1 an et 8 mois pour les femmes.
La France est néanmoins mieux placée au sein de l’Union européenne en ce qui concerne l’espérance de vie à 65 ans que pour celle sans incapacité. L’espérance de vie à 65 ans des femmes était, en France en 2020, la plus élevée de l’Union européenne. Celle sans incapacité place la France, toujours pour les femmes, au 5e rang. Le classement pour les hommes est respectivement 3 et 10e.
À la naissance, en 2020, l’espérance de vie sans incapacité des hommes est supérieure (+5 mois) à la moyenne de l’Union européenne, qui est de 63,5 ans. L’espérance de vie sans incapacité des femmes à la naissance est également supérieure (+10 mois) à la moyenne européenne (64,5 ans). La France se situe en 2020 au 10e rang pour l’espérance de vie à la naissance sans incapacité pour les femmes et au 9e rang pour les hommes. Pour les hommes et les femmes, la France se classe au 10e rang pour l’espérance de vie sans incapacité forte.
Retraite, l’égalité homme/femme, un chantier encore ouvert !
Le projet de réforme des retraites de 2023 donne lieu à un débat sur le niveau et l’évolution des pensions des femmes qui restent nettement inférieures à celles des hommes. Miroir des inégalités passées, cette situation ne se corrige que lentement, l’écart étant en 2020 de 40 % pour les pensions de droits directs et de 28 % après prise en compte des droits de réversion. En raison de faibles droits à pension, les femmes sont contraintes de les liquider après les hommes ce qui constitue une deuxième inégalité.
Au sommaire de cette étude
- Des pensions toujours trop basses
- Les femmes surreprésentées parmi les bénéficiaires des pensions dérivées et du minimum vieillesse
- Des départs à la retraite plus tardifs
- La retraite, un sujet d’inquiétude
- Près d’une femme sur deux épargne pour sa retraite
- Après la retraite, le risque dépendance
- La réforme 2023 des retraites, avancées ou reculs pour les femmes ?
Les différentes catégories de Fonctionnaires face à la retraite
Au sein des fonctions publiques (hors militaires), la date de départ de la retraite dépend de la nature des fonctions occupées. Deux types d’emplois sont à distinguer : les emplois de catégorie active et les emplois de catégorie sédentaire. Les premiers ouvrent droit, sous certaines conditions, à un départ anticipé à la retraite (de 52 à 57 ans) quand les seconds sont soumis aux règles de droit commun.
Un emploi est classé dans la catégorie active s’il présente un risque particulier justifiant un départ anticipé à la retraite. Ces emplois sont désignés par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement. Tout emploi non désigné dans cette catégorie est considéré comme sédentaire. La classification est parfois mentionnée par deux lettre A (catégorie sédentaire) et B (catégorie active). Ce classement ne doit pas être confondu avec celui des catégories hiérarchiques A, B et C, qui classent les cadres d’emplois en fonction du niveau de qualification.
Les fonctionnaires de la catégorie active
Les emplois de la catégorie active relèvent de trois domaines selon l’arrêté du 12 novembre 1969 :
- sécurité et police (sapeurs-pompiers, police nationale, police municipale depuis 2017 et services pénitentiaires) ;
- service de santé des collectivités territoriales et établissements publics d’hospitalisation, de soins et de cure ;
- services divers (contrôle aérien, agent des réseaux souterrains des égouts).
Tous les emplois en lien avec ces domaines ne sont pas tous de catégorie active. L’arrêté précité liste les emplois concernés.
Les pouvoirs publics sont amenés à réviser le classement périodiquement. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux de classe normale et de classe supérieure, ainsi que les aides-soignants territoriaux de classe normale et de classe supérieure appartiennent à la catégorie active. Il en fut de même à compter du 1er janvier 2017 pour les adjoints techniques territoriaux principaux. Ces derniers relèvent depuis cette date de la catégorie active sous réserve que la collectivité qui emploie l’agent atteste que celui-ci continue de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses.
Les fonctionnaires de catégorie d’active doivent, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, valider un nombre suffisant de trimestres faute de quoi ils sont assujettis à une décote. Par ailleurs, Pour bénéficier du départ anticipé à la retraite, la durée de services exigée dans la catégorie active varie selon les domaines concernés de 12 à 32 ans dans les emplois concernés. Après la réforme des retraites de 2010, cette durée a été progressivement accrue de deux ans.
Pour certains emplois de la catégorie active, les titulaires peuvent également bénéficier de bonifications et de majorations. Les bonifications correspondent à des trimestres supplémentaires « gratuits » accordés lors du calcul de la pension de retraite, les majorations étant des augmentations du montant de la pension.
Le projet de réforme de retraite en cours de discussion aurait comme conséquence de reculer l’âge de départ de retraite de deux ans pour les deux catégories de fonctionnaires. Un fond de pénibilité pourrait être créé. Il ouvrirait le droit à des bonifications sur le modèle du Compte Professionnelle de Prévention institué dans le secteur privé depuis 2014.
La retraite des fonctionnaires sédentaires
Les fonctionnaires dits sédentaires, pour bénéficier d’une une retraite à taux plein, sans décote, doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :
- justifier d’un nombre de trimestres d’assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte ;
- avoir atteint un âge déterminé qui donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres d’assurance retraite acquis.
Le nombre de trimestres exigé et l’âge du taux plein automatique varient selon l’année de naissance, dans les conditions suivantes :
Conditions d’attribution d’une retraite à taux plein pour un fonctionnaire de catégorie sédentaire
| Années de naissance | Nombre de trimestres d’assurance retraite | Âge d’annulation de la décote |
| 1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
| 1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
| 1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
| 1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
| 1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
| 1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
| 1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
| 1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
| À partir de 1973 | 172 (43 ans) | 67 ans |
Pour avoir droit à une retraite de la fonction publique, le titulaire doit avoir travaillé et cotisé au moins 2 ans en tant que fonctionnaire.
Le dispositif de carrière longue pour les fonctionnaires
Les fonctionnaires ayant commencé à travailler avant 20 ans peuvent partir plus tôt à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
Les fonctionnaires justifiant d’au moins 15 ans de service et ayant eu un enfant invalide (taux d’invalidité de 80 %) peuvent liquider leur droit à pension sans condition d’âge.
De même, les fonctionnaires ayant trois enfants vivants peuvent reculer d’un an l’âge de la radiation (les trois enfants doivent être vivants quand le fonctionnaire a 50 ans).
Les rachats de trimestres
Comme dans le secteur privé, les fonctionnaires peuvent racheter des trimestres, dans la limite de 12, correspondant aux années d’études permettant d’accéder au concours de la fonction publique.
La retraite des contractuels de la fonction publique
Les agents non titulaires de la fonction publique relèvent du régime général pour la retraite de base et de l’IRCANTEC pour la retraite complémentaire. Cette dernière caisse a également la charge des agents de la fonction publique n’ayant pas atteint les 15 années de service. Les règles de calcul de la retraite complémentaire sont proches de celles en vigueur pour les salariés de droit privé.
Les contractuels de la fonction publique sont soumis au règle du régime général pour les départs à la retraite. Ils peuvent partir à la retraite avant 62 ans, s’ils relèvent de l’un d’une des situations suivantes :
- Carrière longue
- Handicap
- Incapacité permanente d’origine professionnelle reconnue par l’Assurance maladie
- Exposition à l’amiante au cours de la vie professionnelle
À défaut, les contractuels peuvent partir à la retraite à compter de 62 ans, sans décote s’ils ont validé le nombre de trimestres suffisants. Comme dans le régime général du secteur privé, le nombre de trimestres exigé dépend de l’année de naissance de l’agent. À 67 ans, la retraite à taux plein est accordé sans condition de trimestres.
La pierre papier a la côte
La collecte nette des fonds immobiliers accessibles au grand public a atteint, en 2022, selon l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), 16,1 milliards d’euros. En hausse de +47 % sur un an, elle dépasse ainsi le précédent record de 2019 (14,8 milliards d’euros). Au cours du dernier trimestre de l’année 2022, la collecte de l’ensemble des fonds s’est élevée à 3,8 milliards d’euros (+26 % sur un an). La pierre papier a continué à attirer les épargnants dans un contexte d’inflation et de hausse des taux. Une part croissante de la collecte s’est effectuée via les unités de compte dans le cadre des contrats d’assurance vie. En tenant compte de la détention en unités de compte immobilières, le nombre d’épargnants détenant des parts de fonds immobiliers non cotés atteint 4 millions de Français.
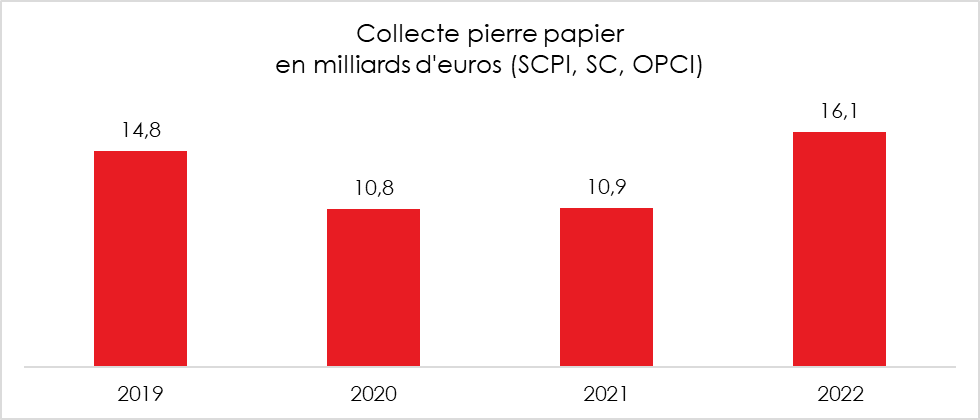
Le développement de la collecte ISR
45 % de la collecte annuelle (7,2 milliards d’euros) a été réalisée, selon l’ASPIM, par les fonds labellisés ISR. 60 fonds immobiliers grand public étaient, au 31 décembre 2022, labellisés ISR, représentent 48 % de la capitalisation globale (soit 64,8 milliards d’euros) et 45 % de la collecte nette des fonds grand public en 2022.
La collecte des SCPI franchit la barre des 10 milliards d’euros en 2022
Le principal vecteur de la collecte pierre papier est assuré par les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). La collecte de ces dernières a atteint 10,2 milliards d’euros en 2022 soit 60 % de la collecte totale. Elle a progressé de 37 % par rapport à l’année 2021 et a dépassé de 9 % le précédent record de 2019. Au dernier trimestre 2022, la collecte nette des SCPI s’est élevée à 2,6 milliards euros, en progression de 18 % par rapport au dernier trimestre de 2021. Sur l’année 2022, les SCPI à prépondérance « bureaux » ont représenté 41 % de la collecte nette des SCPI, les SCPI à « stratégie diversifiée » 29 % et les SCPI « santé et éducation » 17 %.
Au 31 décembre 2022, la capitalisation des SCPI a atteint 89,6 milliards d’euros, en hausse de 14 % sur un an.
Les sociétés civiles immobilières distribuées en Unités de Compte collectent 5,4 milliards d’euros en 2022
Les société civiles immobilières distribuées en unités de compte ont enregistré pour 5,4 milliards d’euros de souscriptions nettes, en hausse de 65 % par rapport à 2021. Le poids des sociétés civiles dans la collecte globale des fonds immobiliers grand public est passé de 23 % à 34 % entre 2019 et 2022 avec l’essor des unités de compte dans ce domaine.
Au dernier trimestre 2022, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 1,4 milliard d’euros de collecte nette, en progression de 66 % par rapport au dernier trimestre 2021. Au 31 décembre 2022, l’actif net des sociétés civiles immobilières s’établit à 25 milliards euros, en augmentation de 33 % sur un an.
une collecte nette des OPCI grand public de près de 500 millions d’euros
En, 2022, les OPCI grand public ont réalisé pour 465 millions d’euros de collecte nette, les souscriptions brutes ayant atteint 900 millions d’euros et les rachats 400 millions d’euros. Au dernier trimestre 2022, les retraits ont été supérieurs aux souscriptions générant une décollecte pour un montant de 135 millions d’euros.
L’actif net des OPCI grand public se monte à 20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en baisse de 3 % sur un an.
Légère augmentation du rendement en 2022 pour les SCPI
Le taux de distribution des SCPI s’établit à 4,53 % en 2022 en légère augmentation par rapport à 2021. Avec un taux d’inflation de 5,2 %, le rendement réel a été légèrement négatif (-0,7 point).
Selon l’ASPIM, le taux de distribution de 2022 comprend une distribution sur résultat courant (de l’ordre de 4,02 %), une distribution exceptionnelle, principalement sur réserves de plus-values (de l’ordre de 0,38 %) et une fiscalité acquittée à la source (de l’ordre de 0,13 %).
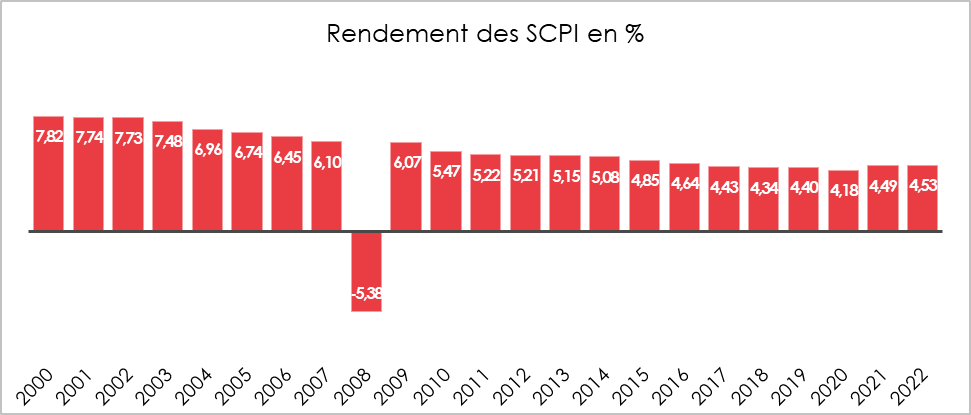
Par catégorie, le taux de distribution moyen varie de 4,17 % pour les SCPI à prépondérance « résidentiel » à 5,63 % pour les SCPI à stratégie diversifiée. Les SCPI à prépondérance « hôtels, tourisme, loisirs » ont renoué avec des niveaux de distribution d’avant crise sanitaire (5,09 % en 2022 contre 2,85 % en 2021).
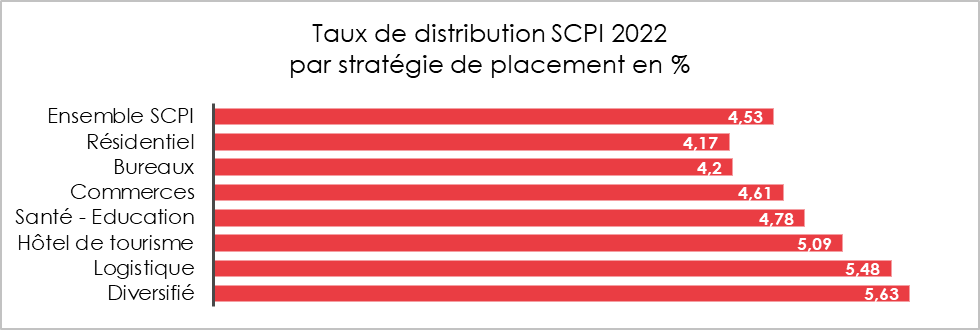
La performance globale moyenne de l’ensemble des OPCI grand public s’établit à -3,48 % en 2022 (contre +4,4 % en 2021). Cette performance négative a été provoquée par la baisse des marchés financiers en 2022. Les poches financières et foncières cotées des fonds ont affiché des performances respectives de -5 % et -29 %. Des baisses de valorisation des actifs ont été observées en fin d’année, pesant sur les performances globales de la poche immobilière.
Les sociétés civiles unités de compte immobilières en assurance vie ont enregistré un rendement moyen de +3,7 % en 2022. Cette moyenne de marché est voisine de la performance moyenne délivrée en 2021 (+ 3,8 %).
Près de 15 milliards d’euros d’acquisition pour les fonds immobiliers
Sur l’année 2022, les acquisitions immobilières des trois catégories de fonds accessibles par le grand public ont atteint 14,2 milliards d’euros. Les SCPI ont réalisé pour 10,7 milliards d’euros d’acquisitions, dépassant leur précédent record de 2019 (9,2 milliards d’euros). Les sociétés civiles ont investi pour près de 2,4 milliards d’euros en immobilier direct, soit 45 % de l’ensemble de leurs investissements en 2022 (5,5 milliards d’euros). Les parts de fonds immobiliers non cotés ont constitué 36 % de l’allocation des sociétés civiles en 2022 (dont 15 % en SCPI). Les acquisitions des OPCI grand public s’élèvent à environ 1 milliard d’euros.
Les trois catégories de fonds grand public ont cédé pour environ 2,6 milliards d’euros dont 1,8 milliard d’euros de cessions d’actifs pour les SCPI.
En termes de typologie d’actifs, les bureaux ont, en 2022, représenté 46 % des acquisitions réalisées. Suivent ensuite la santé et l’éducation (14 %), les commerces (14 %) et le résidentiel (12 %, en incluant les résidences gérées). Enfin, l’hôtellerie et la logistique ont capté chacune 7 % des acquisitions en valeur.
Les cessions d’actifs au premier semestre concernent tout d’abord les bureaux (75 %) devant la santé et l’éducation (10 %), les commerces (8 %), le résidentiel (3 %), l’hôtellerie et les loisirs (3 %) et la logistique/locaux d’activité (2 %).
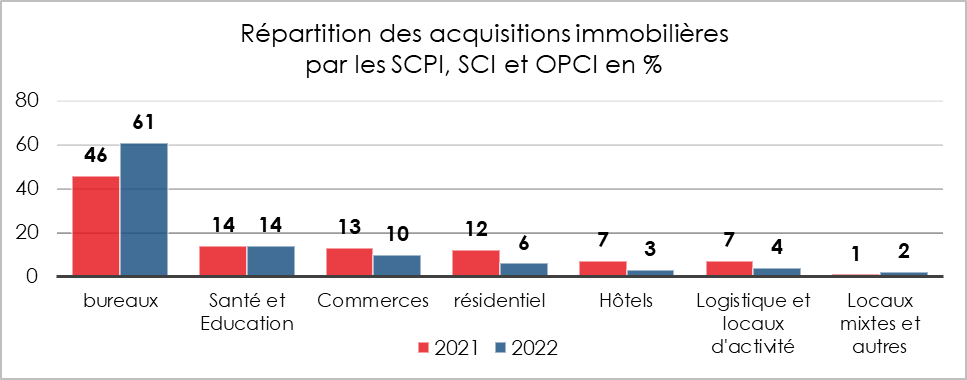
En termes de localisation, les investissements ciblent l’étranger (37 %), puis les régions (35 %) et enfin l’Île-de-France (28 %, dont 8 % à Paris).
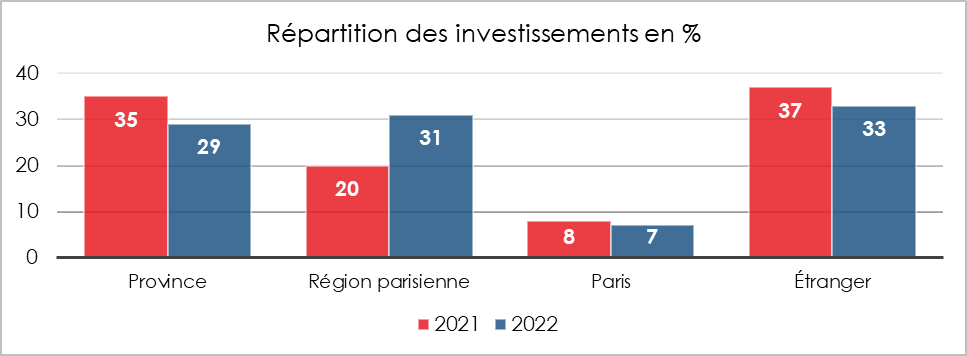
Hors de France, l’Allemagne est le premier d’investissement pour la pierre papier (8 %). Ce pays devance le Royaume-Uni (7 %). Figurent ensuite les Pays-Bas (5 %), l’Espagne (4 %) et l’Italie (4 %). En ce qui concerne les cessions, les actifs arbitrés sont localisés pour 49 % en Île-de-France (dont 19 % à Paris), 29 % à l’étranger et 21 % en régions.
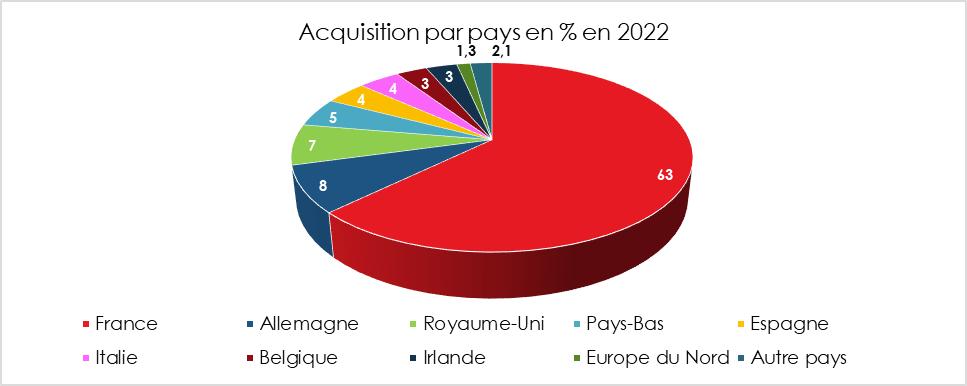
La pierre papier s’impose de plus en plus au sein des portefeuilles des ménages. La popularité croissante de cette catégorie de placement est en grande partie liée à sa diffusion au sein des contrats d’assurance vie et des Plans d’Épargne Retraite. Le rendement des SCPI résiste malgré l’inflation et les difficultés de certaines enseignes commerciales.
Extension de l’épargne salariale au sein des PME
Le MEDEF, la CPME et quatre syndicats de salariés (la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO) ont signé l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur du 10 février 2023. Malgré l’opposition de la CGT, cet accord, signé par des organisations syndicales affichant une représentativité d’au moins 30 %, sans opposition d’autres organisations représentatives des salariés pesant au moins 50 %, est validé. Il résulte d’une négociation demandée par le gouvernement aux partenaires sociaux afin de généraliser les dispositifs de partage de la valeur dans les petites entreprises.
Toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années devra mettre en œuvre pour ses salariés, soit un accord d’intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d’une prime défiscalisée. En 2022, si 80 % des salariés des grands entreprises sont couverts par un accord de participation ou d’intéressement aux résultats de l’entreprise, seuls 20 % le sont dans les PME.
La complexité et la méconnaissance des dispositifs ainsi que le manque d’accompagnement des chefs d’entreprises figurent parmi les raisons avancées pour expliquer la faible diffusion de l’épargne salariale au sein des TPE et PME. Les assouplissements décidés dans la loi Pacte de 2019 et celle de l’été 2022 sur le pouvoir d’achat n’ont pas permis de résoudre la totalité des réticences au sein de ces entreprises.
Le nouveau texte imposent ainsi aux entreprises entre 11 et 49 employés qui sont rentables – c’est-à-dire dont leur bénéfice net représente au moins 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives – de mettre en place « au moins un dispositif » de partage de la valeur à partir du 1er janvier 2025. Les entreprises de moins de 11 salariés « ont la possibilité » de partager les profits avec leurs salariés. Dans celles de plus de 50 salariés, la participation devra « mieux prendre en compte » les résultats « réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel tel que défini par l’employeur ».
La première ministre Elisabeth Borne s’est engagée, à retranscrire, en le reprenant intégralement, dans un projet de loi l’accord du 10 février afin de l’étendre à toutes les entreprises.
La finance peut-elle être verte ?
Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne
Au niveau européen, la transition énergétique devrait coûter plus de 11 000 milliards d’euros d’ici 2030. Pour la financer, la Commission européenne compte mobiliser l’épargne des ménages. Quelles mesures les autorités européennes et les États ont adoptées afin de rendre l’épargne verte ?
La réorientation de l’épargne vers des placements durables est au cœur des priorités de la Commission européenne et plus globalement de l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Les compagnies d’assurance sont également à a manœuvre pour réorienter l’épargne vers des placements permettant une décarbonation de l’économie. Sur le terrain de la législation, plusieurs dispositions sont en cours de déploiement en France que ce soit à travers le règlement européen sur la transparence financière (SFDR -« Sustainable Finance Disclosure Regulation », la taxonomie ou encore la réforme du label ISR prévue pour cet été.
La taxonomie européenne désigne une classification des activités économiques en fonction de leurs conséquences sur l’environnement. Son objectif est d’inciter à la réalisation d’investissements accélérant la décarbonation.
La finance durable, est-ce crédible ?
Selon la banque de France, fin 2021, l’encours des actifs verts, socialement responsables ou solidaires, y compris les fonds Relance, s’élevait à 262,5 milliards d’euros, soit 9 % des placements des assureurs. Ils sont constitués aux trois quarts (74,8 %) de fonds labellisés ISR et au cinquième (19,9 %) d’obligations vertes. Les 5,3 % restants sont composés de fonds labellisés Relance (2,0 %), de fonds labellisés Greenfin (1,0 %), de fonds labellisés Finansol (0,2 %) et de fonds multi-labellisés(2,1 %).
La finance durable est de plus en plus surveillée tant par les pouvoirs publics que par les ONG. Le greenwashing est traqué et dénoncé. La finance durable n’est pas toujours évidente à appréhender en raison de sa complexité.
Trois catégories peuvent être distinguées :
- la finance solidaire qui représente moins de 0,4 % de l’épargne des ménages ;
- la finance ISR-ESG qui se développe du fait de la transformation des fonds proposés par les acteurs financiers ;
- la finance verte au sens européen du terme et du règlement européen sur la transparence financière et ses articles 8 et 9.
Trois grands labels permettent de classer les fonds :
- Le label Finansol est le plus ancien. Créé en 1997, il favorise les aspects sociaux et environnementaux et vise à soutenir des entreprises solidaires (création d’emplois durables, accès au logement, soutien à l’agriculture bio…). Près de 170 fonds sont aujourd’hui labellisés.
- Le label Greenfin est un label d’État lancé en 2015 par le ministère de l’Écologie. Pour l’obtenir, les fonds doivent œuvrer pour la transition écologique et investir dans l’un des 8 secteurs clés. On y trouve les énergies renouvelables, le bâtiment, la gestion des déchets, l’industrie, les transports propres, les nouvelles technologies, l’agriculture et la forêt ainsi que l’adaptation au changement climatique. 95 fonds sont titulaires de ce label.
- Le label ISR est également un label d’État, créé en 2016 par le ministère de l’Économie. Destiné aux fonds d’investissement et aux supports immobiliers type SCPI et OPCI, il atteste que les gestionnaires effectuent une sélection d’investissements en fonction de critères environnementaux sociaux et de gouvernance, abrégés critères ESG. Plus de 1100 fonds sont labellisés. Selon le site du Label ISR, l’ensemble de ces fonds labellisés pèse 695 milliards d’euros, répartis en 440 milliards d’euros pour les fonds de droit français et 255 milliards d’euros de fonds étrangers. Cet encours est un peu exagéré car il intègre des OPC monétaires dont le caractère « vert » est contestable. Il intègre également des fonds étrangers qui ne sont pas totalement commercialisés en France.
Comment les épargnants peuvent-ils accéder à des produits verts ?
Les épargnants ont de nombreuses possibilités pour accéder à des produits verts. Ils peuvent le faire en acquérant des parts d’OPC ou des unités de compte. Depuis le 1er janvier 2022, les assureurs doivent présenter à leurs clients dans le cadre des contrats multi-supports au moins une unité de compte adossée à un fonds bénéficiant du label ISR, au moins une unité de compte adossée à un fonds labellisé Greenfin et au moins une unité de compte adossée à un fonds solidaire labellisé Finansol. Certains assureurs proposent également des fonds euros labellisés « vert ». Il ainsi possible d’avoir une gestion ISR complète dans les contrats d’assurance vie ou dans les PER.
Les obligations « vertes » connaissent un essor important. La zone euro, avec 185 milliards d’euros émis en 2021, représente à elle seule 39 % du marché mondial des émissions vertes. Au sein de la zone euro, la France a joué un rôle moteur en étant à l’origine de la première obligation verte souveraine émise dans le monde en janvier 2017. Avec l’Allemagne, la France est l’un des principaux émetteurs d’obligations vertes.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire tend également à financer des PME ayant des projets visant à réduire leur empreinte carbone.
Les épargnants français sont-ils prêts à jouer le jeu des fonds ISR ?
Dans les enquêtes d’opinion, les épargnants déclarent être favorables à la finance verte mais avouent être un peu perdus face à la multitude de labels. Si selon une enquête IFOP, 60 % de Français déclaraient accorder une importance à l’impact environnemental et social de leurs placements, la notion d’épargne « responsable » reste floue pour 2 Français sur 3 selon une autre enquête menée par Opinionway pour l’Autorité des marchés financiers (AMF). Malgré tout, les comportements des épargnants changent rapidement. Les générations Y et Z, fortement sensibilisées aux questions environnementales, sont en attente de produits d’épargne en phase avec leurs convictions et leurs engagements.
La taxonomie, le SFDR et la refonte du label ISR permettront-ils d’amplifier le succès de l’épargne verte ?
En 2018, la Commission européenne a adopté son premier plan d’action pour la finance durable. Elle avait comme objectifs de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Ses deux priorités étaient :
- d’intégrer la durabilité dans la gestion des risques ;
- de favoriser la transparence et une vision long terme.
Le règlement « Taxonomie » fixe un cadre commun aux entreprises financières et non financières membres l’Union européenne, afin de partager une même définition de la durabilité, et de lutter contre les pratiques d’écoblanchiment (connu sous le nom de « greenwashing »).
Le règlement européen sur la transparence financière (SFDR) établit un classement en fonction des déclarations des gestionnaires des labels qui certifient les fonds.
Trois catégories de fonds ou placements sont distingués :
- les placements dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux ;
- les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d’investissement durable, à savoir un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance ;
- les placements dits « Article 6 », concernent, par élimination, tous les autres placements (qui ne sont donc ni « Article 8 » ni « Article 9 »).
Le SFDR donne lieu à plusieurs critiques car il laisse une large place à l’interprétation des gestionnaires d’actifs et ne définit pas, de manière précise, la notion d’investissement durable. En raison des nombreuses incertitudes liées à ce règlement, les gestionnaires d’actifs ont déclassé des fonds de l’article 9 pour les placer en article 8. Le montant global des encours « article 9 » a diminué, en France, de 40 % au quatrième trimestre 2022. Afin d’améliorer la situation, l’Autorité des marchés financiers propose que la Commission européenne introduise des critères minimaux sur les conséquences des placements sur l’environnement afin de faciliter leur classement. Le régulateur français propose également qu’une proportion minimale des actifs en portefeuille pour les fonds classés « article 9 » soit en phase avec la taxonomie européenne. Les investissements des fonds sous « article 9 » devraient réellement être affectés à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. Enfin les acteurs financiers qui gèrent des fonds classés articles 8 et 9 devraient adopter une approche ESG (économique, sociale et de gouvernance). L’AMF propose enfin d’exclure des fonds article 9 « les investissements dans les activités du secteur des combustibles fossiles qui ne sont pas alignées avec la taxonomie européenne » et de les tolérer dans les produits article 8, à condition de justifier une démarche de transition.
L’autre chantier en cours en France est la refonte du label ISR qui se veut plus exigeant que le SFDR. La réforme poursuit un double objectif : limiter le greenwashing et assurer la crédibilité du label. Le processus de labellisation ISR est déjà exigeant. Disposant d’un cahier des charges assez précis, il comporte six catégories d’exigences. Les certifications sont délivrées par des organismes indépendants certifiés par le Comité français d’accréditation. D’ici quelques mois, l’obtention du label ISR sera rendue encore plus difficile. Les candidats à la labellisation devront soumettre un plan d’action concret concernant la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les sociétés appartenant au secteur des énergies fossiles et du charbon seront exclues. Des indicateurs devront obligatoirement être mis en place pour mesurer les effets réels des portefeuilles sur les questions sociales, environnementales et de bonne gouvernance.
En termes de rentabilité, les fonds verts sont-ils intéressants pour les épargnants ?
Longtemps, ils ont été jugés moins intéressants que les fonds classiques mais les écarts tendent à se réduire, l’offre s’étant élargie. Les secteurs des énergies renouvelables commencent à devenir rentables et à générer des bénéfices. Tesla prouve également que les placements verts peuvent rapporter de l’argent même s’ils ne sont pas à l’abri de la spéculation. Sur le long terme, les placements ISR offrent potentiellement des gains plus importants que les autres. L’augmentation des capitaux qui sont affectés à la transition énergétique ne peut qu’améliorer la rentabilité de ces placements.
L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne : « Retraite, vous avez dit retraite, comme c’est bizarre »
L’édito de mars 2023
La retraite est devenue au fil des décennies une valeur positive. Elle est aujourd’hui sacralisée voire sanctifiée. Or, le mot « retraite » a longtemps été connoté négativement. La retraite signifie selon le dictionnaire Larousse, « l’action de se retirer de la vie active ». Associée à une période durant laquelle les femmes et les hommes n’étaient plus en capacité de travailler, de manière rentable, elle était perçue comme l’antichambre de la mort. La retraite est également synonyme de défaite, surtout pour Napoléon dont l’Empire n’a pas résisté à celle de Russie. Depuis près de quatre-vingts ans, la retraite est devenue, du moins pour ceux qui en ont les moyens et la santé, une période de liberté. Affranchis du travail, les retraités peuvent se consacrer à leur famille et à leurs loisirs. Ils sont des piliers de la vie associative et jouent un rôle clef tant pour la garde des enfants que pour l’aide à apporter aux personnes dépendantes.
En France, un large consensus s’est installé depuis des années en faveur d’un départ précoce à la retraite pour compenser le coût élevé et la durée faible du travail. Pour être compétitives, les entreprises concentrent le travail concentrer sur des actifs jeunes. Le pays a longtemps eu recours aux préretraites permettant une rotation plus rapide des effectifs. Si ce recours aux préretraites s’est révélé sans effet sur le chômage, il s’est avéré coûteux pour l’État et les régimes sociaux. Depuis, ce système a été abandonné mais l’idée d’un départ précoce à la retraite demeure.
La situation démographique exceptionnelle qui a perduré des années 1960 aux années 2000 a contribué au maintien d’un âge bas de départ à la retraite. La France a, en effet connu un nombre limité de départs à la retraite dans les années 1980 durant lesquelles les générations creuses de l’entre deux guerres mondiales arrivaient dans la soixantaine. Au même moment, celles du baby-boom entraient sur le marché du travail. Il y avait plus de 4 cotisants pour 1 retraité. Le Président François Mitterrand pouvait alors abaisser de 65 à 60 ans l’âge de départ à la retraite sans que cela ne génère de tensions particulières. Cette mesure qui figurait parmi les 110 propositions de 1981 avait l’avantage d’alléger les dépenses de chômage et d’atténuer les problèmes d’emploi de plusieurs secteurs d’activité dont la sidérurgie. Quand des visiteurs du soir du Président l’interpellaient sur le coût à venir du passage à 60 ans de l’âge de la retraite, celui-ci aurait répondu en bon Keynésien, qu’à ce moment-là il serait mort.
Quarante ans plus après l’instauration des 60 ans devenus, en 2010, 62 ans, l’économie française doit relever plusieurs défis de grande ampleur, le vieillissement de sa population bien évidemment mais aussi la transition énergétique, et la digitalisation. Tous ces défis nécessitent de l’imagination et de la volonté. La protection sociale est un corps vivant qui doit s’adapter aux évolutions de l’économie et de la société. Le travail et les actifs en 2023 ne sont pas ceux de 1945. En près de 80 ans, l’espérance de vie à la naissance a gagné vingt ans et celle à 65 ans dix ans. Si l’entrée dans la vie professionnelle s’effectuait, en moyenne, à moins de 18 ans dans les années 1950, elle s’effectue désormais à 22 ans et 7 mois (2021). La France en 1972 comptait 40 % d’emplois dans l’industrie ; aujourd’hui plus de quatre sur cinq sont dans le tertiaire.
La façon de travailler a été bouleversé avec le digital. Pour un nombre non négligeable de salariés, travail rime désormais avec télétravail. La vie s’articule en quatre parties : une phase de près de 25 ans de formation, une phase de travail de plus de 40 ans, une phase de retraite active d’une quinzaine d’années et, pour finir, une phase susceptible de donner lieu à des problèmes de dépendance. La question centrale dans les prochaines années sera celle de remplacer les départs à la retraite. L’idée du mouvement « Fire » qui promeut la retraite le plus tôt possible est une ineptie car elle symbolise l’individualisme poussé à l’extrême. Si les Français souhaitent partir tôt à la retraite, ils aspirent, dans le même temps, à bénéficier de services de qualité, ce qui suppose des personnes disponibles pour travailler.
La question du maintien des seniors en activité est intimement lié à celle de la pénibilité. Le travail ne doit pas être un lieu de souffrance physique et morale. L’adaptation des postes de travail en fonction des âges, la possibilité d’accéder à des formations permettant réellement d’évoluer au sein de son entreprise ou de changer de métier devraient être des priorités. Par ailleurs, le principe d’une « retraite à la carte » accessible après une certaine durée de cotisation, mérite d’être pris en compte. Certains actifs souhaitent partir tôt, d’autres plus tard. Cela devrait être possible avec l’introduction d’une modulation actuarielle des pensions ou d’une décote plus importante pour ceux qui choisissent d’anticiper leur départ. Le développement des suppléments par capitalisation pourrait compenser la baisse subie sur les pensions des régimes obligatoires. À cette fin, un dispositif d’aide en faveur des personnes à revenus modestes pourrait être imaginé sous forme de crédits d’impôts. Les branches professionnelles sont le niveau plus à même à traiter les questions liées aux départs à la retraite.
Jean-Pierre Thomas
Épargne : pourquoi l’assurance-vie reste attractive
Dans les colonnes de Mieux Vivre Votre Argent, Philippe Crevel rappelle « l’assurance-vie s’inscrit dans la durée et constitue un contrat de services (la compagnie d’assurances s’engage sur la réalisation de certaines prestations : garantie en capital, versement en rentes, option de réversion, etc.) qui permet de financer des projets de vie, une future retraite, le tout en préparant sa succession » quand le Livret A est un produit plafonné à 22.950 euros.
Le vieillissement de la population, un défi qui dépasse de loin le problème des retraites
Cité dans cet article du Monde, le Directeur du Cercle de l’Épargne explique que « Le vieillissement joue contre la croissance, car une population active âgée est moins productive qu’une population jeune ».
Assurance vie à l’heure des grands arbitrages
Paris, le 2 mars 2023
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats de l’assurance vie/PER – Janvier 2023
Assurance vie à l’heure des grands arbitrages
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
En janvier 2023, l’assurance vie a dégagé une collecte nette de 1,2 milliard d’euros bien plus faible que celle du Livret A (+9,27 milliards d’euros). La collecte du premier placement des ménages a été, comme les mois précédents, tirée par les unités de compte. Leur collecte nette a été positive de 3,6 milliards d’euros quand celle des fonds a été en décollecte de 2,4 milliards d’euros. La collecte en unités de compte se maintient, en effet à un niveau élevé, 39 % en janvier.
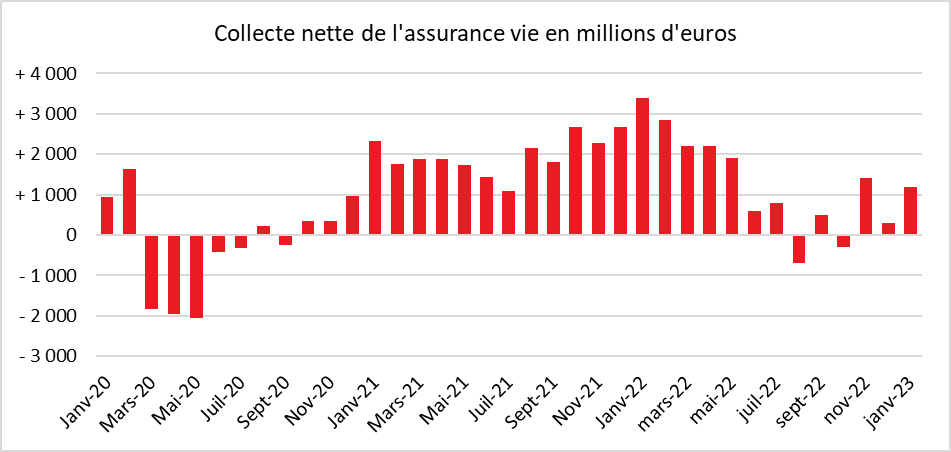
Un mois de janvier paradoxal : des versements et des rachats massifs
La collecte nette du mois de janvier 2023 est faible par rapport à la moyenne de ces dix dernières années (plus de 2 milliards d’euros). Ce résultat décevant est d’autant plus étonnant que la collecte brute a été exceptionnelle. Les ménages ont tout à fois effectué des versements importants tout et réalisé des retraits élevés. Le montant de la collecte brute a atteint 14,1 milliards d’euros et les rachats 12,9 milliards d’euros. De tels montants signifient la réalisation d’arbitrages. Importants dont les fonds euros ont fait les frais.
L’annonce des résultats des rendements des fonds euros n’a pas créé un engouement pour ces derniers. L’assurance vie a certainement pâti du relèvement du taux du Livret A. Les ménages sont également en train d’alléger leurs liquidités non rémunérées (comptes courants) afin de se protéger de l’inflation. L’augmentation des taux d’intérêt et le durcissement des conditions d’octroi des prêts conduisent les ménages réalisant un achat immobilier à puiser dans leur contrat d’assurance vie. Les ménages optent également pour le Plan d’Épargne Retraite (PER), placement à long terme qui bénéficie d’un avantage fiscal à l’entrée.
Le PER au-dessus de la barre des 50 milliards d’euros d’encours
Dans un contexte propice, toute annonce de réforme des retraites contribuant à la progression des produits d’épargne retraite, le PER assurantiel poursuit sa montée en puissance. Selon France assureurs, son encours a dépassé, au mois de janvier, 50 milliards d’euros. Les unités de compte représentent 45 % de l’encours soit deux fois leur poids pour l’assurance vie. 3,9 millions de personnes disposent désormais d’un PER assurantiel.
Le nombre de nouveaux plans a été de 75 400 dont 22 900 dans le cadre de transferts d’anciens contrats d’épargne (30 %). Les transferts ont porté sur 326 millions, soit près de 40 % de la collecte du mois de janvier. La collecte nette globales s’est élevée à +668 millions d’euros, en hausse de +194 millions d’euros par rapport à l’année dernière (+41 %).
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Retraite, l’égalité homme/femme un chantier encore ouvert!
Paris, le 2 mars 2023
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RETRAITE : L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME, UN CHANTIER ENCORE OUVERT !
Analyse de Sarah Le Gouez, Secrétaire générale du Cercle de l’Épargne
Le projet de réforme des retraites de 2023 donne lieu à un débat sur le niveau et l’évolution des pensions des femmes qui restent nettement inférieures à celles des hommes. Miroir des inégalités passées, cette situation ne se corrige que lentement, l’écart étant en 2020 de 40 % pour les pensions de droits directs et de 28 % après prise en compte des droits de réversion. En raison de faibles droits à pension, les femmes sont contraintes de les liquider après les hommes ce qui constitue une deuxième inégalité.
Des pensions toujours trop basses
Depuis une dizaine d’années, le montant des pensions des femmes progresse plus vite que celui des hommes en lien avec une meilleure égalité de traitement durant la vie professionnelle. Plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont également contribué à réduire une des plus grandes inégalités de revenus en France.
L’introduction, en 1972, de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), ainsi que les réformes adoptées depuis une vingtaine d’années ont permis une meilleure prise en compte des arrêts de travail pour maternité dans le calcul des droits à pension. La progression du taux d’activité des femmes et du niveau d’étude ainsi que l’accès à des postes plus qualifiés que par le passé ont également permis d’améliorer situation des femmes à la retraite.
Malgré ces nombreuses avancées, l’écart de pension homme/femme qui a diminué de 10 points entre 2004 et 2020 demeure encore important.
Les femmes surreprésentées parmi les bénéficiaires des pensions dérivées et du minimum vieillesse
La pension de réversion, principale source de revenus pour de nombreuses retraitées
Les femmes sont les principales bénéficiaires de droits dérivés, aussi appelés « pensions de réversion », versés aux assurés dont le conjoint est décédé. Cette situation est liée à la plus grande espérance de vie des femmes et au fait qu’elles sont en moyenne deux à trois ans plus jeunes que leurs conjoints. Elle est aussi la conséquence des différences de pensions précitées.
La pension de réversion qui correspond à une fraction de la retraite de leur conjoint décédé est généralement soumise à conditions de ressources. C’est notamment le cas dans le régime de base des salariés du privé, qui est de loin le régime le plus répandu. Les hommes disposant plus fréquemment des revenus supérieurs au plafond de ressources éligible à la réversion, sont, de ce fait, moins attributaires des droits dérivés. Les femmes représentent, en 2020, 88 % des 4,3 millions de bénéficiaires d’une réversion.
Parmi les bénéficiaires d’une réversion 1 million ne perçoivent pas de pension de droit direct. Les femmes sont également surreprésentées parmi cette population. Leur part est de 95 %, alors qu’elles sont 86 % parmi les personnes qui cumulent une pension de droit dérivé avec une pension de droit direct.
Il convient néanmoins de noter un recul de la proportion de femmes parmi les bénéficiaires de réversion depuis le début des années 2000 (-6 points en entre 2004 et 2017 avant de se stabiliser à 88 %).
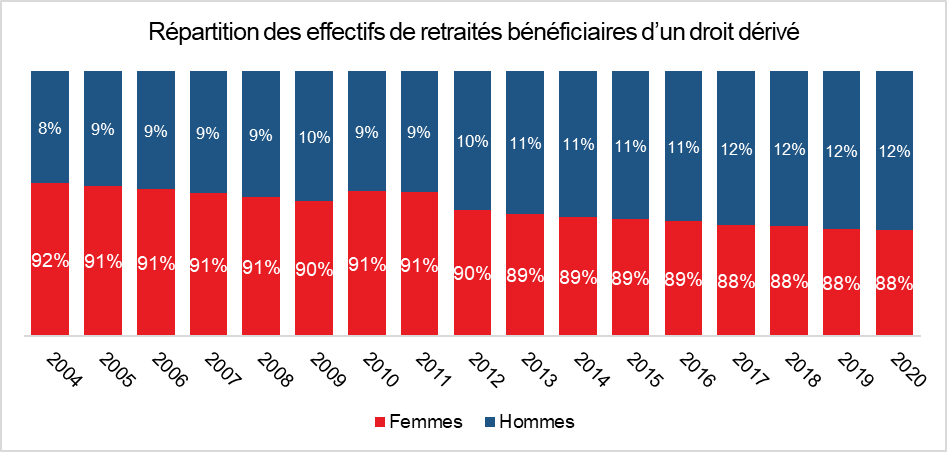
La proportion bénéficiaires d’une réversion tend à diminuer chez les nouvelles retraitées (81 % des 227 000 nouveaux bénéficiaires de droit dérivé en 2020 sont des femmes).
Plus d’un allocataire sur deux du minimum vieillesse est une femme
Le minimum vieillesse, dispositif destiné aux retraités modestes, profite davantage au femmes et en particulier aux femmes seules (célibataires, veuves ou divorcées). Sur un peu plus de 635 000 titulaires de l’ASV (allocation supplémentaire du minimum vieillesse) ou de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées créée en 2004), les femmes représentaient, fin 2020, 56 % des allocataires.
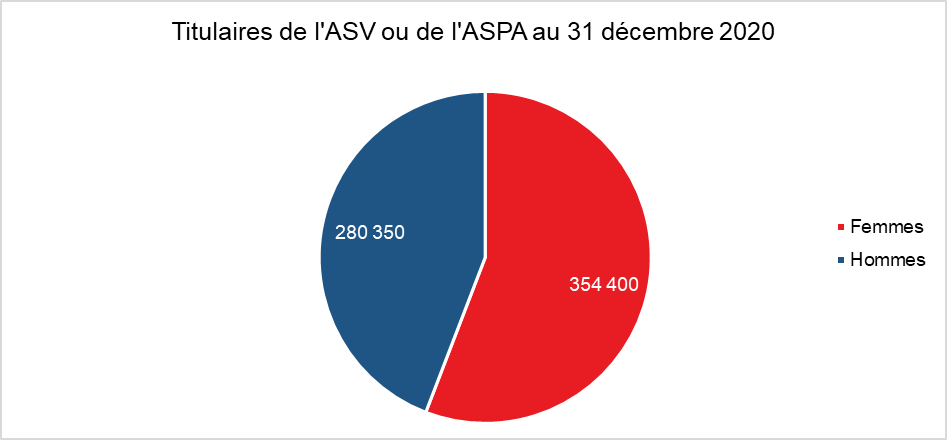
Des départs à la retraite plus tardifs
Les femmes sont généralement tenues de retarder la liquidation de leur droits à pension pour compenser des carrières professionnelles discontinues et moins bien rémunérées. Selon la DREES, en 2020, l’âge conjoncturel moyen de départ à la retraite des femmes était en moyenne supérieur de 7 mois à celui des hommes à 62,7 mois contre 62 ans. Néanmoins, au même titre que les écarts de pensions tendent à se réduire, l’écart d’âges de liquidation des droits à la retraite diminue au fil des générations. Il était en moyenne d’un an et demi parmi les générations nées dans la première moitié des années 1930, et de 10 mois parmi celles nées au cours des années 1940.
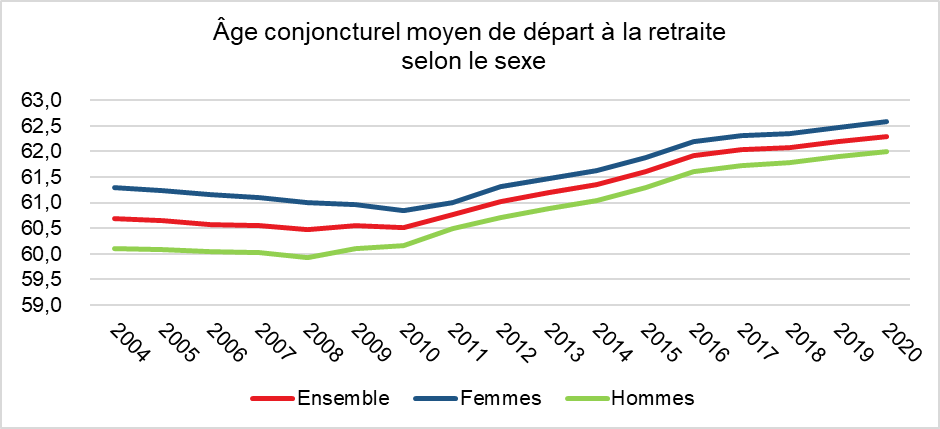
La retraite, un sujet d’inquiétude
Les femmes expriment traditionnellement une plus vive inquiétude à l’égard de la retraite. Ainsi, selon l’enquête 2022 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa, 72 % estimaient que le niveau de pensions servies est ou sera insuffisant pour vivre correctement quand 60 % des hommes partagent ce point de vue. 3 sondées sur 10 considéraient même qu’il était « tout à fait insuffisant » (contre 20 % des hommes). Si la situation des retraitées tend à s’améliorer, le ressenti des femmes témoigne de l’impact de ces écarts persistants sur leurs conditions de vie.
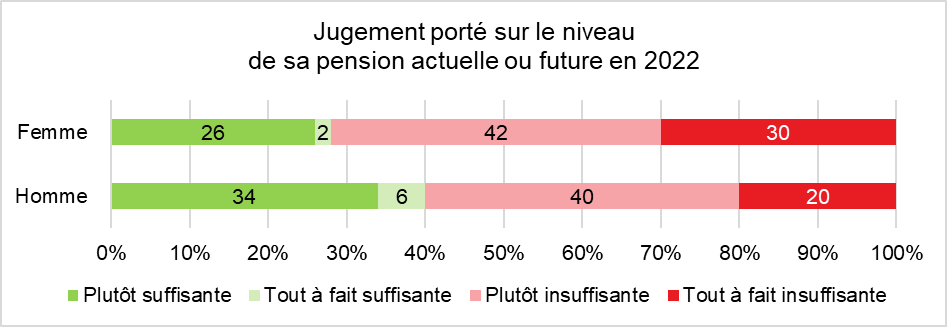
Près d’une femme sur deux épargne pour sa retraite
Toujours selon l’enquête précitée Cercle de l’Épargne/Amphitéa, près d’une femme sur deux déclare épargner en vue de sa retraite (49 %) quand 56 % des hommes sont dans ce cas. Cette moindre pratique de l’épargne en vue de la retraite tient aux capacités plus limitées de ces dernières à épargner. Parmi les sondés déclarant épargner très régulièrement, les femmes sont en revanche mieux représentées (respectivement 11 % et 10 %).
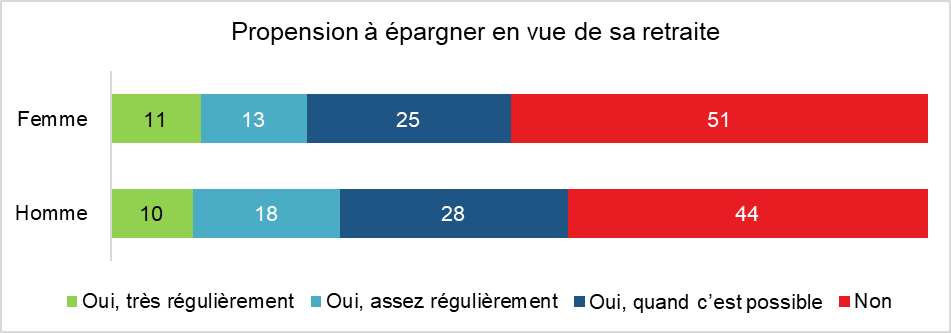
Après la retraite, le risque dépendance
Au-delà de la retraite, avec l’arrivée à des âges avancées des générations nombreuses du baby-boom, la question de la gestion de la perte d’autonomie est de plus en plus prégnante. Face au risque de dépendance, les femmes sont, à, en première ligne. Par leur espérance de vie plus longue, leur taux de prévalence à la dépendance est potentiellement plus élevé.
Les femmes sont également au cœur de la dépendance en tant qu’aidantes. Elles assument une grande partie des tâches domestiques et des soins aux membres de leur famille. Elles sont surreprésentées parmi les aidants familiaux (70 % des aidants en 2015 selon la DREES), ce qui n’est pas sans conséquence sur leur santé, leurs conditions de travail et leur vie sociale.
***
*
Les inégalités homme/femme à la retraite ne sont que la photographie des divergences de parcours au cours de la vie active passée. Si, en raison de l’effet de masse, les évolutions sont lentes, elles demeurent pour autant notables. Le taux d’activité des femmes augmente régulièrement depuis le milieu des années 1970. En 2021, 70,0 % des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives, contre seulement 54,5 % en 1975. Chez les hommes, le taux d’activité, a reculé sur l’intervalle, passant de près de 84 % en 1975 à 76 % des hommes aujourd’hui. L’écart homme/femme tend donc à se réduire, passant de près de 31 points en 1975 à seulement 6 points en 2021.
Sur le terrain de l’emploi, la convergence des courbes est encore plus visible. Si en 1975, le taux de chômage des femmes était presque deux fois plus élevé que celui des hommes (respectivement 5 % des femmes contre 2,7 % des hommes), l’écart s’est réduit au point que ce rapport s’est inversé. Depuis 2012, la proportion d’hommes au chômage a dépassé celle des femmes. Selon les l’enquête Emploi de l’INSEE, 7,8 % des femmes étaient, en 2021, au chômage contre 8 % des hommes. Cette inversion des courbes tient notamment au niveau de formation plus élevé des femmes qui favorise leur insertion professionnelle et à leur plus forte employabilité dans le secteur des services qui créent des emplois.
Les femmes représentent une part croissante des retraités de droit direct, car elles sont de plus en plus nombreuses, au fil des générations, à avoir participé au marché du travail. En 2004, elles représentaient 50,8 % des retraités de droit direct ; fin 2020, cette part s’élève à 52,8 %. Une récente étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur les durées d’assurance en fonction des années de naissance des assurés met en évidence que l’écart pour la validation des trimestres, entre les hommes et les femmes, s’estompe voire s’inverse.
À 49 ans, l’écart des durées d’assurance validées moyennes depuis le début de la carrière s’est réduit fortement entre les deux sexes au fil du temps : les hommes de la génération 1946 (y compris ceux déjà retraités à cet âge) valident 106 trimestres, contre 95 trimestres pour les femmes (y compris celles déjà retraitées à cet âge), alors que ceux de la génération 1968 en valident 94, contre 92 pour les femmes. Compte tenu des réformes adoptées depuis une vingtaine d’années, le nombre de trimestres validés par les femmes devrait, d’ici quelques années dépasser celui des hommes.
Malgré ces importantes avancées, les inégalités salariales persistantes entre hommes et femmes continuent à faire obstacle à l’atteinte d’une véritable égalité devant la retraite. En 2020, toutes catégories sociales confondues, en moyenne la rémunération d’un homme demeure supérieure de 14,8 % à celle d’une femme (en recul de 0,8 point sur un an). Si une partie du différentiel peut s’expliquer par des divergences en termes de volume de travail, la nature des emplois occupés et les secteurs d’activité, l’écart tiendrait en grande partie, selon les chercheurs de l’INSEE, au fait que les femmes accèdent moins aux emplois les mieux rémunérés, en particulier parmi les salariés ayant des enfants.
Le projet de réforme des retraites de 2023 comporte plusieurs mesures visant à améliorer la situation des femmes dont ma revalorisation du minimum contributif dont elles sont plus souvent bénéficiaires que les hommes.
Le texte du gouvernement prévoit une amélioration de la prise en compte des périodes validées au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour bénéficier du dispositif carrières longues. Cette situation concerne certains cas de congé parental, qui sont dans 90 % des situations des femmes. En cas d’adoption de la réforme, jusqu’à 4 trimestres validés à ce titre pourront être pris en compte.
Par ailleurs, la Commission des affaires sociales du Sénat a adopté des mesures visant également à améliorer les pensions des femmes et tout particulièrement celles des mères de famille. Pour éviter à ces dernières de perdre tout ou partie du bénéfice des trimestres acquis au titre de la maternité et de l’éducation, la Commission a prévu l’instauration d’une surcote d’1,25 % par trimestre pour les femmes qui ont atteint la durée d’assurance requise un an avant l’âge légal (63 ans). D’ici l’adoption éventuelle de ce projet de loi, de nouveaux amendements en faveur des femmes pourraient être retenus.
Epargne : nos conseils pour profiter de la hausse des taux
Le Cercle de l’Epargne est cité dans cet article consacré aux placements à privilégier en
» Les ménages tentent de se protéger de l’inflation » (Le Cercle de l’Epargne)
Le Cercle de l’Epargne et son directeur, Philippe Crevel, sont cités dans cet article consacré au comportement d’épargne des ménages depuis le retour de l’inflation.
Livret A, LEP… Cette règle d’un autre âge qui grignote vos intérêts
Dans Money Vox, Philippe Crevel revient sur le mode de rémunération des livrets d’épargne réglementée. Il explique que la « règle des quinzaines », est une particularité française.
Le Livret A a commencé l’année en trombe
Challenge cite le Cercle de l’Epargne et son directeur, Philippe Crevel, dans cet article consacré à la collecte record du Livret A en janvier.
Le Livret A signe une collecte historique en janvier, un record depuis 2009
Le journal Les Echos reprend l’analyse de Philippe Crevel dans un article consacré à la collecte historique du produit d’épargne. Pour le directeur du Cercle de l’Épargne, « les ménages ont décidé, sans nul doute, de profiter à plein du relèvement de la rémunération à 3 % en réduisant leurs liquidités non rémunérées sur leurs comptes courants ».
Livrets A et LDDS : les ménages ont placé plus de 11,2 milliards d’euros en un mois !
Le Livret A enregistre son meilleur résultat depuis 2009. Le Cercle de l’Épargne cité dans cet article revient sur les raisons du succès du Livret A en janvier.
Livret A : plus de 9 milliards d’euros déposés en janvier, un record depuis 14 ans
Dans le Figaro, le directeur du Cercle de l’Epargne évoque la hausse du taux et le contexte inflationniste pour expliquer la collecte record du Livret A en janvier.
Ruée sur le Livret A en janvier
Cité dans le journal Le Monde, Philippe Crevel commente la collecte record du Livret A en janvier 2023.
Le Livret A, l’effet taux joue à plein
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats du mois de janvier 2023
Le Livret A, l’effet taux joue à plein
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le Livret A boosté par l’effet taux
Le Livret A démarre l’année en trombe. Avec une collecte positive de 9,27 milliards d’euros en janvier, le Livret A enregistre sa meilleure performance depuis janvier 2009 (18,31 milliards d’euros) qui avait été alors réalisée au moment de la banalisation de sa distribution et en pleine crise financière. Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), la collecte a atteint, en janvier 1,95 milliard d’euros. Il faut remonter à octobre – décembre 2012 pour enregistrer des collectes supérieures. Ces dernières avaient été obtenues au moment du doublement du plafond du LDDS qui était alors passé de 6 000 à 12 000 euros (octobre 2012).
Le Livret A et le LDDS ont été dopés par l’annonce, au cours du mois de janvier, du relèvement de leur taux de 2 à 3 %, hausse entrée en vigueur le 1er février 2023. Toute annonce de relèvement provoque une augmentation de la collecte qui perdure entre deux et trois mois. Le rebond de janvier 2023 se distingue par sa force. Les ménages ont décidé, sans nul doute, de profiter à plein du relèvement de la rémunération à 3 % en réduisant leurs liquidités non rémunérés sur leurs comptes courants.
Les ménages tentent de se protéger de l’inflation
Avec la baisse des taux de l’épargne réglementée et l’absence d’inflation, les ménages avaient, ces dernières années laissé, de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants. L’encours des dépôts à vue était, en effet, selon la Banque de France, passé, de décembre 2014 à juillet 2022, de 257 milliards d’euros à plus de 543 milliards d’euros. À défaut de placements garantis suffisamment rémunérés, les Français avaient opté pour le compte courant.
Depuis juillet et surtout septembre 2022, les ménages ont changé leurs comportements. Le rendement est redevenu, du moins de manière faciale, attractif et l’inflation érode la valeur des sommes laissées sur les comptes courants qui ne sont pas rémunérés. L’encours des dépôts à vue s’est ainsi, sur le quatrième trimestre 2022, contracté de 18,9 milliards d’euros. Une grande partie de ces retraits a profité à l’épargne réglementée.
En privilégiant le Livret A et le LDDS, les ménages tentent de limiter les effets de l’inflation sur leurs liquidités. La protection n’est pas totale, le rendement réel du Livret A étant négatif d’au moins trois points. Il faut remonter aux années 80 pour constater un rendement réel négatif aussi important.
Un effort d’épargne toujours élevé
Face à la hausse des prix et à l’érosion de leur pouvoir d’achat, les ménages ne puisent pas dans leur bas de laine, bien au contraire, ils le renforcent. Le rendement réel négatif du Livret A ou du LDDS ne les dissuade pas. Ils préfèrent réduire leur consommation que d’entamer leur épargne de précaution. La crainte d’une détérioration à venir de la situation économique explique cette attitude. Les débats sur les retraites et les menaces de blocage du pays s’accompagnent traditionnellement d’une remontée de l’épargne. À l’exception des États-Unis, la tendance de fond est, par ailleurs, dans les pays occidentaux comme dans les pays émergents, au maintien d’un fort taux d’épargne. La succession des crises et le vieillissement de la population expliqueraient en grande partie cette évolution.
Des encours au sommet au service demain, peut-être, du nucléaire ?
L’encours du Livret A a atteint au mois de janvier un nouveau record absolu à 384,7 milliards d’euros ; celui du LDDS est également au plus haut à 136,2 milliards d’euros. Cette augmentation de l’encours du Livret A pourrait conforter le gouvernement dans son idée d’utiliser ce placement pour financer la construction des nouvelles centrales nucléaires. Les bailleurs sociaux sont à la peine pour utiliser l’ensemble des ressources disponibles faute de foncier en quantité suffisante.
Vers un premier semestre record
Traditionnellement, le premier trimestre est porteur pour le Livret A. En début d’année, les ménages y affectent une partie des primes perçues fin décembre. Par ailleurs, ce sont des mois à faibles dépenses et sans rendez-vous fiscaux. L’effet taux qui a joué en janvier devrait perdurer en février et en mars.
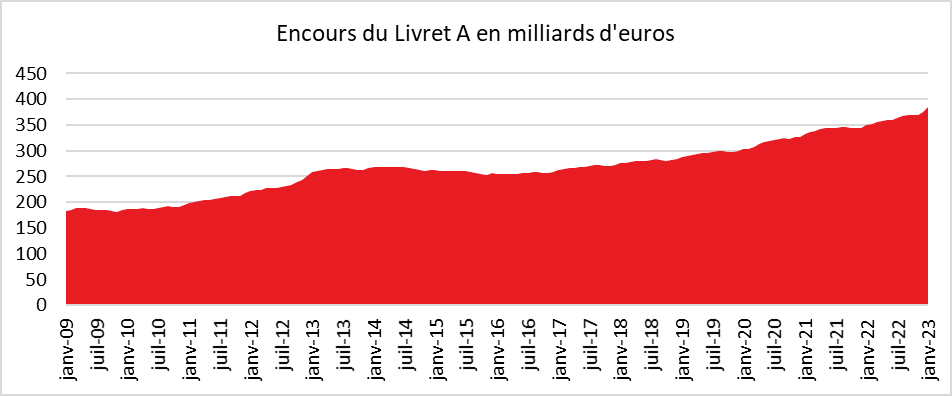
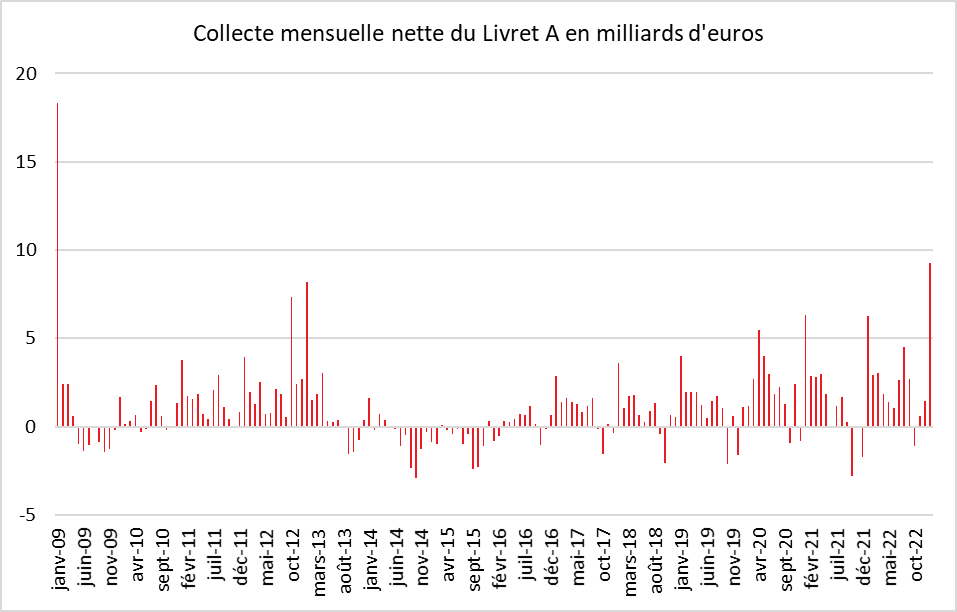
Contacts presse
| Philippe Crevel 06 03 84 70 36 | Sarah Le Gouez 06 13 90 75 48 slegouez@cercledelepargne.fr |
LEP à 6,1% : un nouveau plafond à 10 000 euros pour ce super livret ?
Interrogé par le média Money Vox sur l’opportunité de relever le plafond du LEP, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne estime qu’ «il ne serait pas absurde de relever le plafond du LEP à 10 000 euros. L’encours moyen actuel sur ce produit est élevé et pourrait justifier une telle hausse ».
Philippe Crevel : « Les fonds en euros ne s’en sortent pas si mal en 2022 face au livret A »
Dans un entretien accordé à Investir, Philippe Crevel revient sur la place tenue par le Livret A et l’assurance vie dans l’épargne financière des ménages.
Le plan d’épargne-retraite, un avantage fiscal pour les personnes à hauts revenus
Dans le journal Le Monde, le Directeur du Cercle de l’Épargne revient sur la croissance du PER. « Longtemps, les assureurs, ne souhaitant pas dépouiller l’assurance-vie, n’étaient pas très chauds vis-à-vis des produits d’épargne-retraite, mais il y a eu un vrai changement, ils sont séduits par l’idée de capter le client sur le long terme et par des exigences de fonds propres moindres que pour les fonds en euros », analyse-t-il.
Le système de retraite par capitalisation s’installe, discrètement, dans les pratiques en France
Cité dans Le Monde, Philippe Crevel estime qu’« il ne faut pas diaboliser la capitalisation en soi, tout dépend par qui elle est gérée, si elle est obligatoire, etc. ». Selon lui : « l’enjeu aujourd’hui est d’éviter un système à deux vitesses, dans lequel la capitalisation serait réservée aux salariés des grandes entreprises et aux ménages très fiscalisés. »
Les Français, des épargnants européens comme les autres ?
Au plus fort de la crise Covid, faute de pouvoir consommer, les ménages ont, en France comme dans l’ensemble des pays avancés, rempli leur bas de laine. Le taux d’épargne des ménages est ainsi passé de 14,7 % au quatrième trimestre 2019 à 27,3 % au deuxième trimestre 2020 en France et de 6,2 % à 25,6 % en Espagne. Outre-Atlantique, il atteint 26,0 % aux États-Unis au cœur de l’été 2020 en pleine crise sanitaire quand il plafonnait autour de 7 en moyenne dans les années qui précédaient la crise. Si une baisse du taux d’épargne est constatée tant dans la zone euro qu’aux États-Unis en lien avec la résurgence de l’inflation et la guerre en Ukraine, celui-ci demeure à des niveaux supérieurs en zone euro et notamment en France.
D’importantes disparités de patrimoine au sein de la zone euro antérieures à la crise sanitaire
Selon les dernières données disponibles issues de l’enquête Household Finance and Consumption Survey (HFCS) de l’Eurosystème, le patrimoine net moyen des ménages de la zone euro s’élevait à 228 000 euros en 2017-2018. Le Luxembourg, avec un patrimoine moyen de 899 000 euros, était en tête du classement, suivi de Chypre (524 600 euros) et de Malte (400 700 euros) quand la Grèce, la Lituanie et la Lettonie arrivent dernières avec respectivement 93 300, 83 600 et 42 200 euros. La France avec un patrimoine moyen de 242 000 euros devance l’Allemagne d’une dizaine de milliers d’euros (232 600 euros en moyenne).
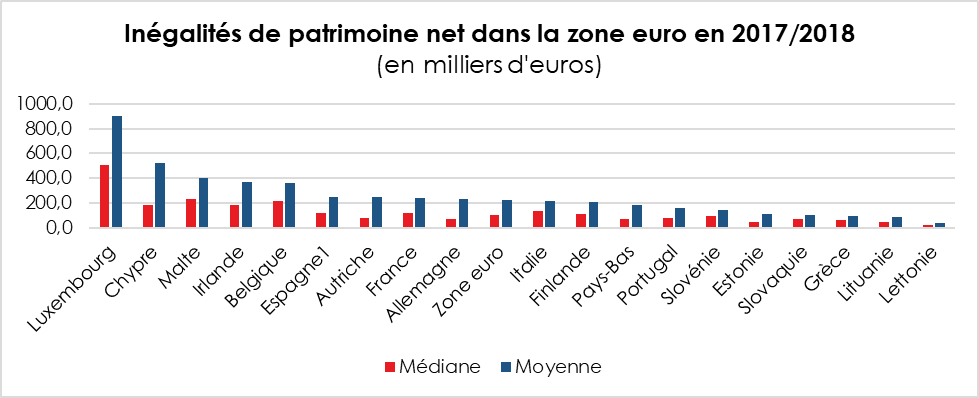
Champ : ménages résidant en Autriche, Belgique, Chypre, Allemagne, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie,Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.
Source : BCE, enquête HFCS vague 3 – INSEE
L’immobilier, un moteur pour l’épargne en Europe
Selon les données de l’office européen de la statistique, la France comptait, en 2021, près de 65 % (64,7 %) de propriétaires contre moins de 50 % de la population allemande (49,5 %). Ces ratios sont inférieurs à ceux de la moyenne européenne (respectivement de 65,8 % en zone euro et 69,9 % dans l’Union européenne), en raison des proportions particulièrement élevées de propriétaires dans les pays d’Europe du Sud et de l’Est (plus de 73 % en Italie et en Grèce et plus de 95 % en Roumanie).
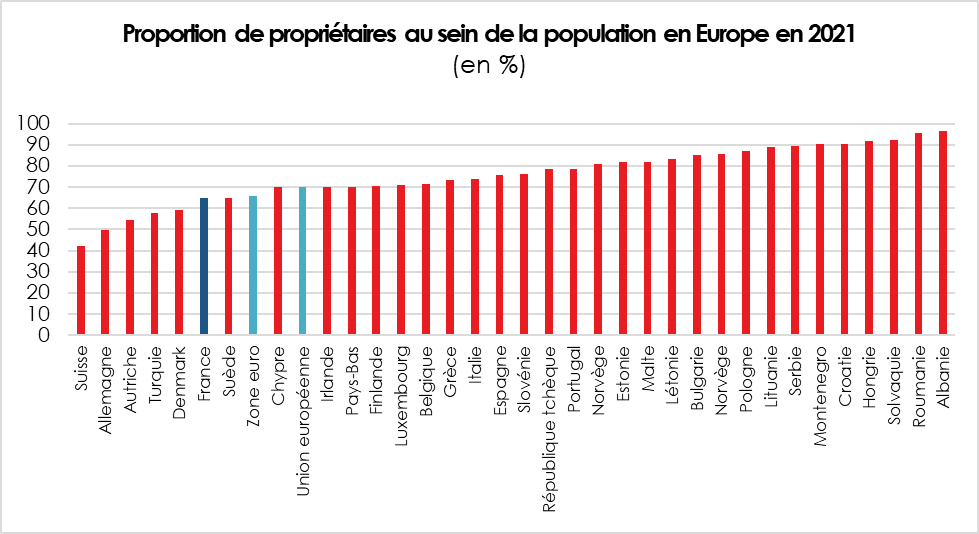
Selon l’enquête Household Finance and Consumption Survey (HFCS) de l’Eurosystème précitée, l’immobilier (tous biens confondus) représentait, en 2017-2018, 79 % du patrimoine brut des ménages propriétaires dans les pays membres de l’Union européenne. En ne prenant en compte que la seule résidence principale, ce ratio était de 70 %. La part de la résidence principale dans le patrimoine brut des ménages était respectivement de 64 % en Allemagne, 68,4 % en France et 76 % en Italie.
En lien avec ce qui précède, l’endettement immobilier constitue, sans surprise, une part prépondérante de l’endettement des ménages de la zone euro (près de 89 %). L’endettement immobilier lié à la résidence principale représente en moyenne 37 % de la richesse brute des ménages propriétaires. Ce taux est de 31 % en Allemagne, 32 % en Italie et 36 % en France, contre 49 % en Espagne.
L’aversion aux risques, une exception française ?
Contrairement à quelques idées reçues, le poids élevé de l’épargne liquide n’est pas propre à la France. Sur le vieux continent, de nombreux pays se distinguent par leur moindre appétence pour la prise de risque et le marché actions, en comparaison par exemple des États-Unis. L’épargne de précaution tient une place importante en France mais également en Espagne, en Allemagne ou plus encore en Italie. Ainsi, les produits liquides, tels que les compte-chèques ou comptes d’épargne, représentaient 39 % de l’épargne financière en France contre respectivement 35 % en Espagne, 47 % en Allemagne et jusqu’à 52 % en Italie.
Structure de l’épargne financière des ménages dans les principales économies européennes en 2017-2018 (en %)
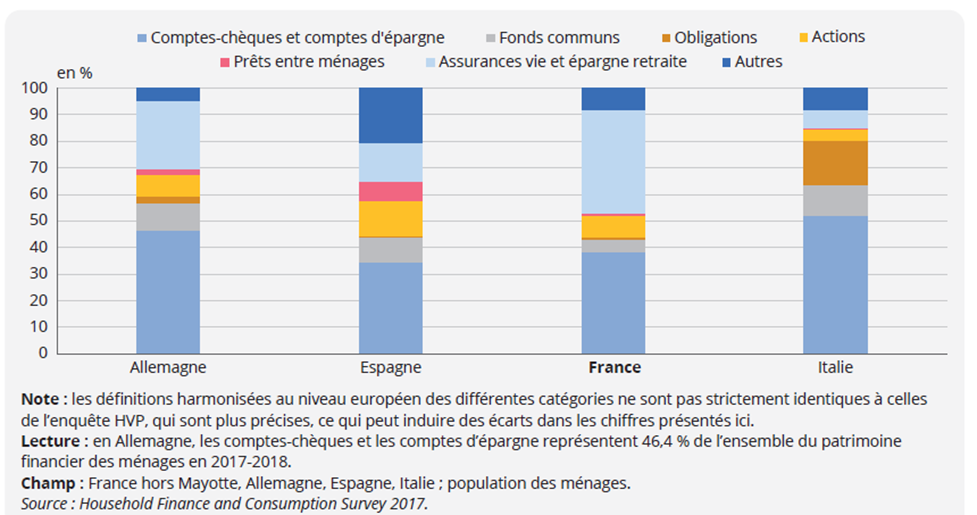
Les Européens se distinguent par ailleurs par les véhicules d’épargne privilégiés. Les Allemands sont davantage portés sur les livrets, les obligations et l’assurance vie, les Italiens préfèrent les obligations et les fonds communs de placement, quand en France l’assurance vie tient traditionnellement une place de choix.
Le retrait du marché actions à la suite de la crise des subprimes de 2008 puis à celle des dettes souveraines en 2011 avait ainsi été constaté en France comme chez nos voisins. En France, 18 % des ménages détenaient, en 2017-2018, au moins une valeur mobilière, soit un peu moins que les Allemands (21 %) et un peu plus que les Espagnols et les Italiens (15 %).
Les récentes données publiées par l’AMF et la Banque de France témoignent d’un tournant dans l’attitude des ménages français. Il conviendra, dès lors, une fois les données disponibles, de vérifier si cet intérêt naissant se manifeste également chez nos partenaires.
Taux de détention directe d’actions dans les principales économies européennes (en %)
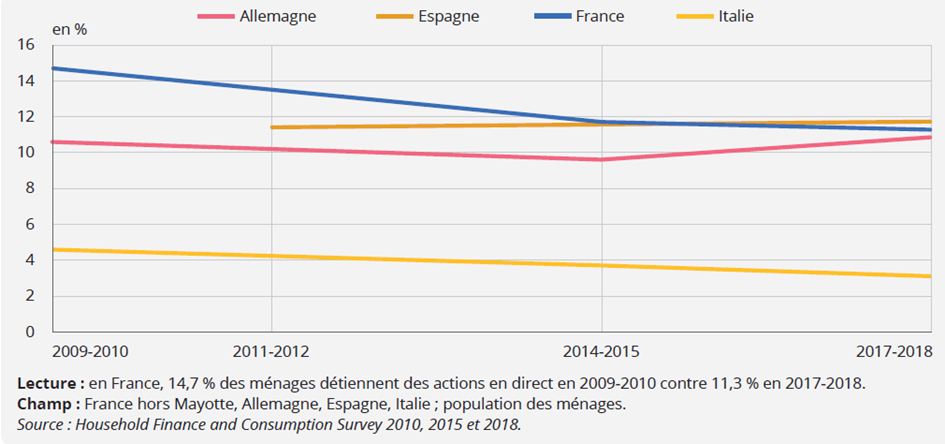
La lente progression des fonds de pension en France
Les actifs des fonds de pension, après avoir effacé les traces de la crise des subprimes, ont connu une forte croissance entre 2010 et 2020. Ils ont presque doublé aux Pays-Bas, passant de 119 % à près de 213 % et sont passés de 73,5 % à 96,8 % aux États-Unis.
En Europe, exception faite des Pays-Bas et de quelques pays d’Europe du Nord ou de tradition anglo-saxonne, la capitalisation tient une place limitée dans les systèmes de retraite. Le poids historique des régimes par répartition et la prise de conscience tardive de la dégradation du taux de remplacement (rapport entre le montant des pensions et celui des derniers revenus d’activité) expliquent cette faiblesse. Aux États-Unis, au contraire, la faiblesse des régimes par répartition incite les ménages à cotiser à des fonds de pension.
Néanmoins, les difficultés engendrées par le choc démographique déjà engagé (baby-boom conjugué à une contraction du taux de fécondité entraînant mécaniquement un recul du nombre d’actifs) conduisent de nombreux pays, dont la France à changer de braquet. Ainsi, en France, les actifs des fonds de pension s’établissent à 2,5 % en 2020 selon l’OCDE, quand ils étaient quasi inexistants en 2010 (0,2 %). Outre la valorisation des actifs sur l’intervalle, le développement du Plan d’Épargne Retraite contribue à la progression de l’épargne retraite. Outre la valorisation des actifs sur l’intervalle, la croissance française est à mettre en perspective avec l’émergence, fin 2019 d’un nouveau produit dédié à l’épargne retraite, le PER. Ce produit, encore jeune, semble néanmoins avoir trouvé son public au regard de son expansion rapide tant en termes de détenteurs que d’encours.
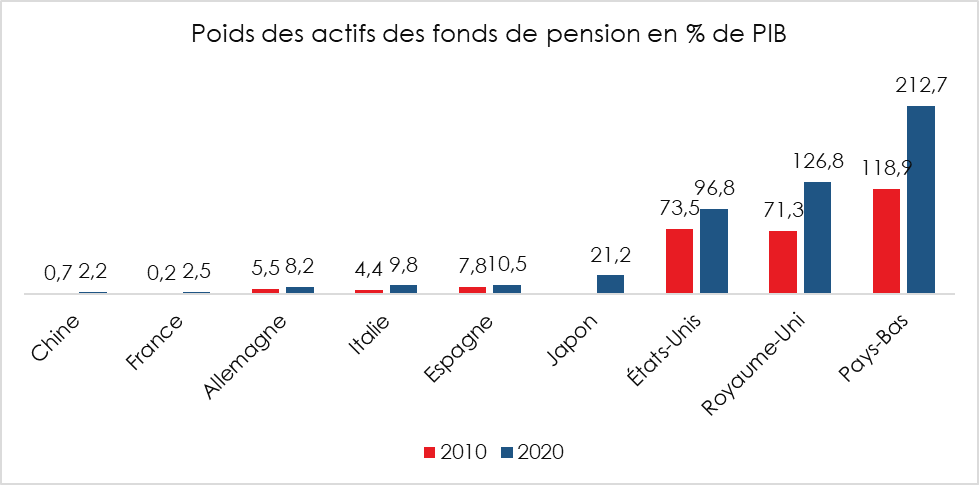
**
*
Les pays européens à l’exception du Royaume-Uni, des Pays-Bas et, dans une moindre mesure, des pays d’Europe du Nord se caractérisent par l’abondance de l’épargne sans risque. Le défi pour l’épargne financière européenne est son allocation afin de financer la transition énergétique. L’Union européenne aurait tout avantage à développer un réel marché unifié de l’épargne tant pour écarter le problème des écarts de taux entre les États membres que pour offrir aux épargnants des placements mieux rémunérés. En lieu et place d’un Livret vert franco-français, l’Union pourrait instituer un plan d’épargne vert accessible à tous les Européens, plan qui permettrait de lever des obligations européennes dans le prolongement de celles créées dans le cadre du Plan de Relance de 2021.
La France face à son vieillissement
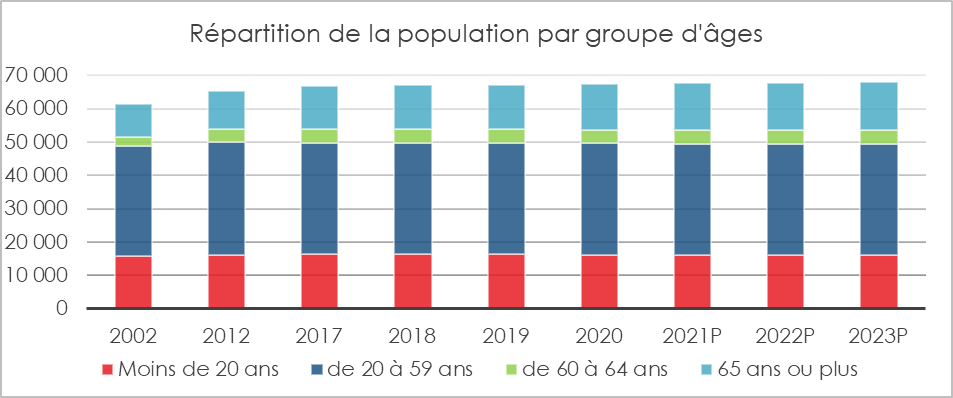
Avec la fin du baby-boom au début des années 1970, le vieillissement de la population était programmé. À l’exception des années autour du changement de millénaire, le taux de fécondité, inférieur à 2, ne permet pas le remplacement des générations. Avec la montée en âge de la population, le solde naturel se réduit d’année en année. Cette diminution n’est pas compensée par une hausse de l’immigration. Dans ce contexte, la population active est amenée à décliner d’ici 2030 et la population globale après 2070. La barre des 70 millions d’habitations sera difficile à atteindre. La population française qui s’élevait à 67 millions au 1er janvier 2022 devrait lentement atteindre 69 millions avant de se replier.
Au sommaire de cette étude
- Une croissance de la population en voie de ralentissement
- Un solde naturel de plus en plus ténu
- La France, le deuxième pays le plus peuplé de l’Union européenne
- Le renouvellement des générations n’est plus assuré
- Un solde migratoire inférieur à 200 000
- Un nombre de décès toujours en nette hausse
- Une mortalité infantile stabilisée
- Une espérance de vie toujours inférieure à celle de 2019
- En France, plus de 20 % de la population a plus de 65 ans
- Une pyramide des âges de plus en plus efflanquée à la base
- Les mariages en mode rattrapage
États-Unis/Royaume-Uni, de la grande démission à la retraite
Depuis la fin des confinements, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le nombre de départs à la retraite s’accroît. Certains actifs souhaitent même partir le plus jeune possible en comptant sur leur épargne pour vivre. Le mouvement Fire « Financial Independence, Retire Early ou Indépendance financière, retraite précoce », né aux États-Unis dans les années 2000 conquiert de nouveaux militants. En France, Victor Lora a publié un livre sur le sujet « La retraite à 40 ans, c’est possible ! »
Aux États-Unis, l’âge normal de déclenchement des droits est de 66 ans et devrait être porté progressivement à 67 ans. Le système américain permet néanmoins d’accéder à une pension publique dès 62 ans mais avec l’application d’une décote de 30 %. Compte tenu de la modicité des retraites publiques, les actifs sont invités soit directement, soit à travers leurs employeurs à se constituer des suppléments de revenu par capitalisation qui peuvent être perçus dès 55 ans.
Selon l’étude « The Great Retirement Boom » (« le grand boom de la retraite »). de Joshua Montes, Christopher Smith et Juliana Dajon, des centaines de milliers d’Américains ou de Britanniques souhaitent anticiper leur départ à la retraite. Ce souhait serait un des vecteurs essentiels de la grande démission.
Aux États-Unis, un à trois millions d’actifs, particulièrement des cadres diplômés de l’enseignement supérieur âgés de 65 ans environ, auraient anticipé de deux à trois ans leur départ à la retraite. Au Royaume-Uni, un demi-million de personnes âgées de 50 à 65 ans auraient décidé de partir à la retraite depuis la pandémie. Ces départs précoces augmentent les pénuries de main-d’œuvre. Ce sont des cadres, propriétaires de leur logement, sans crédit, et disposant d’une solide épargne financière. Ce sont des personnes qui ont en moyenne plus de 680 000 euros d’épargne financière. La possession d’un patrimoine financier aux États-Unis ou au Royaume-Uni permet de partir plus tôt à la retraite sachant que la décote ne concerne que les pensions des régimes obligatoires qui sont faibles. La pénalité financière a, par conséquent, peu de conséquences au niveau du pouvoir d’achat de ces populations.
En France, l’épargne retraite ne peut pas être débloquée, sauf exception, avant l’âge légal de départ à la retraite. Des options de déblocage anticipé existent néanmoins. En revanche, l’assurance vie peut jouer un rôle-clef dans le maintien du pouvoir d’achat en cas d’arrêt du travail.
L’équation délicate de l’emploi des seniors
En France, le sujet de l’emploi des seniors est, par nature, conflictuel. Il renvoie à l’âge de départ à la retraite, au comportement des employeurs par rapport aux salariés de plus de 50 ans, à la pénibilité, etc. La France se caractérise par un faible taux d’emploi des seniors par rapport à ses partenaires. Un des enjeux de la réforme des retraites présentée par le Gouvernement d’Élisabeth Borne est d’améliorer ce taux d’emploi dans le prolongement des actions conduites depuis des années. De nombreuses fausses informations circulent sur la question de l’emploi des séniors. En partant des données fournies par l’INSEE et par le service des statistiques du Ministère du Travail (la DARES), essayons d’apprécier la réalité du marché du travail pour les plus de 55 ans en France.
L’emploi des seniors, la France en retrait par rapport aux autres pays européens
En 2021, selon l’INSEE, 56,5 % des personnes de 55 à 64 ans sont en emploi en France (hors Mayotte), dont une partie cumulant leur activité avec une retraite. En intégrant les seniors au chômage, le taux d’activité atteint 59,7 %.
La présence des seniors sur le marché du travail a diminué de 1975 jusqu’à la fin des années 1990, et particulièrement à partir de 1983. Cette baisse s’explique par le développement des systèmes de préretraites après les deux chocs pétroliers et par le passage, en 1983, de l’âge légal de départ à la retraite de 65 à 60 ans. Entre 1983 et 2000, le taux d’emploi des 60-64 ans a ainsi baissé de 12,9 points, tandis que celui des 55-59 ans était stable. Une remontée s’amorce depuis les années 2000. De 2002 à 2022, le taux d’emploi des 55/64 ans a, en France, progressé de 16 points. Les progrès ont été réalisés dans la tranche 55-59 ans (+15 points) mais aussi chez les plus de 59 ans (+26 points). Le report de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans a fortement contribué à ce relèvement. Par ailleurs, de manière plus lente, l’allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 42 ans a également joué un rôle.
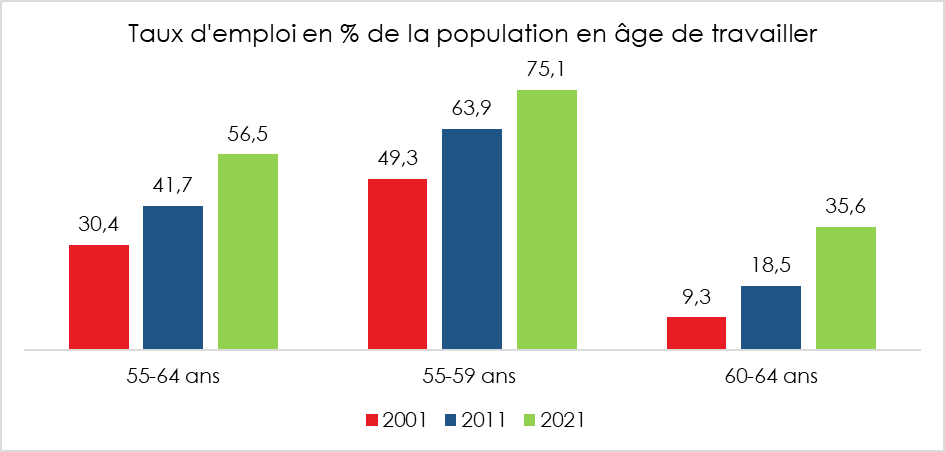
Le taux d’emploi varie fortement en fonction de l’âge
Le taux d’emploi diminue avec l’âge. En 2021, il atteint 81,8 % pour les 25-49 ans, puis 75,1 % pour les 55-59 ans et 35,5 % pour les 60-64 ans. De 50 à 56 ans, le taux reste proche de 80 %, puis diminue de 10 points jusqu’à 59 ans. À partir de 52 ans, certaines catégories d’actifs peuvent prétendre à la retraite (catégories d’actives dans la fonction publique). Cette proportion s’accroît au fil des années. Le taux d’emploi passe ainsi à 60 % à 60 ans. Le dispositif de carrières longues et les départs anticipés pour invalidité expliquent la baisse du taux d’emploi autour de 60 ans. Ce taux atteint 20 % à partir de 64 ans. À 60 ans, une personne sur six environ est retraitée et deux sur trois le sont à 63 ans.
Sur l’ensemble des 55-64 ans, la part des personnes en emploi augmente de 7,7 points entre 2014 et 2021. Symétriquement, celle des inactifs, principalement des retraités, perd 7,6 points. Ce repli est pour partie dû à l’augmentation progressive du nombre de trimestres de cotisation ouvrant les droits à la retraite à taux plein en lien avec les réformes mises en œuvre à partir de 1993. Ce phénomène est encore plus marqué pour les 60-64 ans. Le taux d’emploi s’accroît de 8,9 points et la part d’inactifs recule de 9,6 points. La part d’inactifs parmi les 55-59 ans se replie également entre 2014 et 2021, de 5,1 points.
Le problème d’insertion des jeunes, l’autre raison du taux d’emploi faible de la France
Le relatif faible taux d’emploi des seniors s’explique par les difficultés d’insertion des jeunes au sein du marché du travail et par un départ à la retraite à un âge inférieur à la moyenne européenne.
Le taux de chômage des jeunes, même s’il est en recul depuis plusieurs années, reste élevé et proche de la moyenne européenne. La France se caractérise par un nombre important de jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi (NEET).
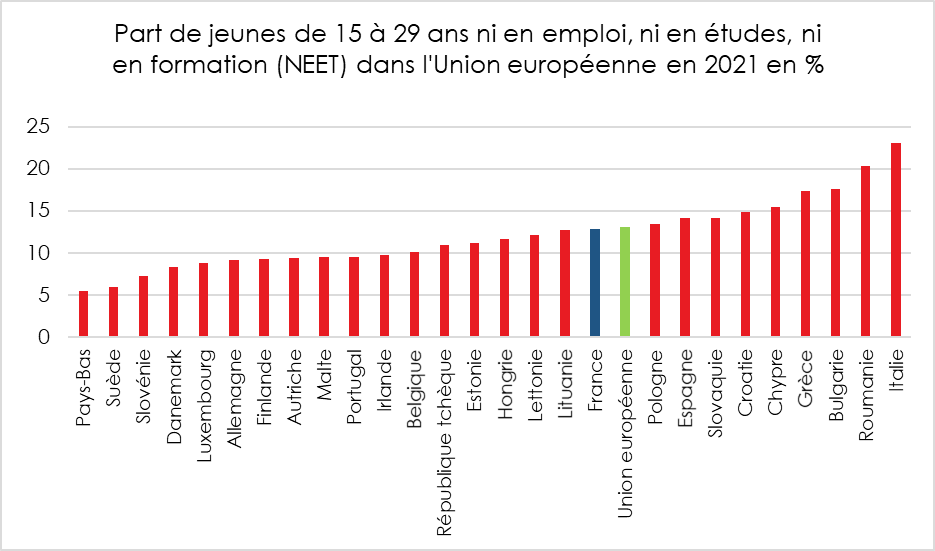
Un âge effectif de départ à la retraite en hausse depuis 2010
L’âge effectif de départ à la retraite progresse en France, mais il est également inférieur à la moyenne européenne.
L’âge moyen de départ à la retraite, en France, s’élevait, en 2020, à 62 ans et 3 mois. Il est de 62 ans et 6 mois pour les femmes et de 62 ans pour les hommes. Cet âge qui était en baisse constante depuis les années 1980 est en hausse depuis 2010, année du passage de la retraite à 62 ans. Près de la moitié des personnes liquidant leurs droits à la retraite ont un âge inférieur à 62 ans. Sont concernés les fonctionnaires dits de catégorie active, les titulaires des régimes spéciaux, les bénéficiaires du dispositif carrières longues, ainsi que les personnes handicapées ou invalides pouvant anticiper leur départ à la retraite.
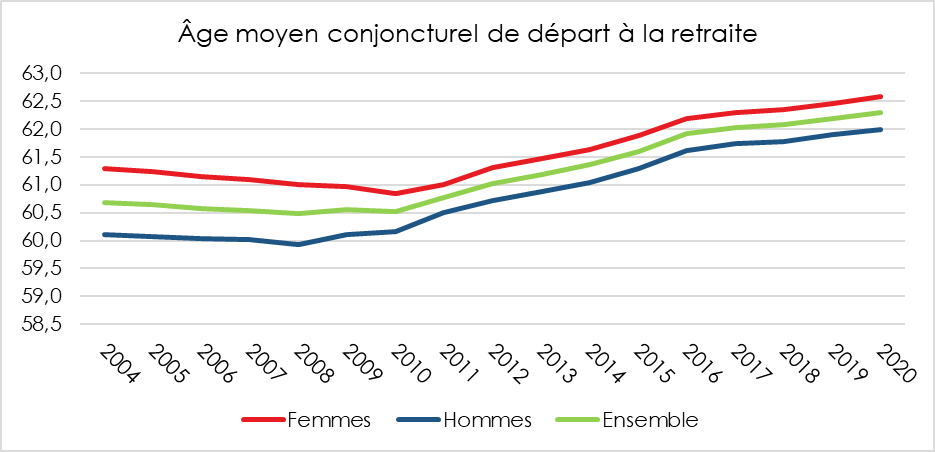
Selon la DREES, la durée moyenne de la retraite pour la génération 1980 devrait diminuer de plus de vingt mois.
Le taux de chômage des seniors inférieur à celui de l’ensemble de la population active
Fin 2021, le taux de chômage des seniors était de 6,3 %. Ce taux de chômage diminue depuis 2015, comme celui des 15-64 ans. Depuis 2003, il est toujours inférieur à celui de l’ensemble des actifs de 15 à 64 ans, mais l’écart tend à se réduire : compris entre -3,5 et -4,0 points de 2003 à 2006, il est de -1,6 point en 2021. En 2021, le taux de chômage des 55-64 ans est légèrement plus faible chez les femmes seniors, 6,1 % contre 6,5 % chez les hommes. Ces derniers sont plus souvent en retraite (27,7 % contre 24,5 %) et les femmes plus fréquemment inactives sans être pour autant retraitées. Les femmes seniors en emploi sont davantage à temps partiel (32,0 % d’entre elles contre 11,0 % des hommes) et en situation de sous-emploi (7,8 % contre 4,3 %).
L’emploi des seniors progresse dans tous les pays européens
Malgré l’augmentation du taux d’emploi des seniors depuis 2001, la France reste en deçà de la moyenne européenne et surtout du niveau de l’Allemagne. L’objectif européen est d’atteindre un taux d’emploi chez les 60/64 ans de 50 %.
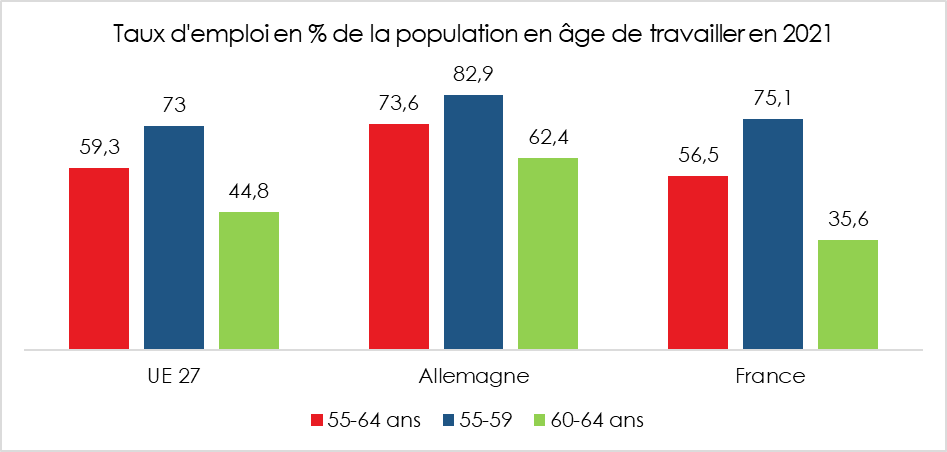
Sur ces dix dernières années, tous les pays de l’Union européenne ont enregistré une progression de leur taux d’emploi des plus de 55 ans. Les États qui sont en situation de plein-emploi sont naturellement ceux qui ont les taux d’emploi des seniors les plus élevés. En France, le taux d’emploi des femmes seniors est égal à la moyenne européenne, quand il est inférieur de près de 10 points pour les hommes.
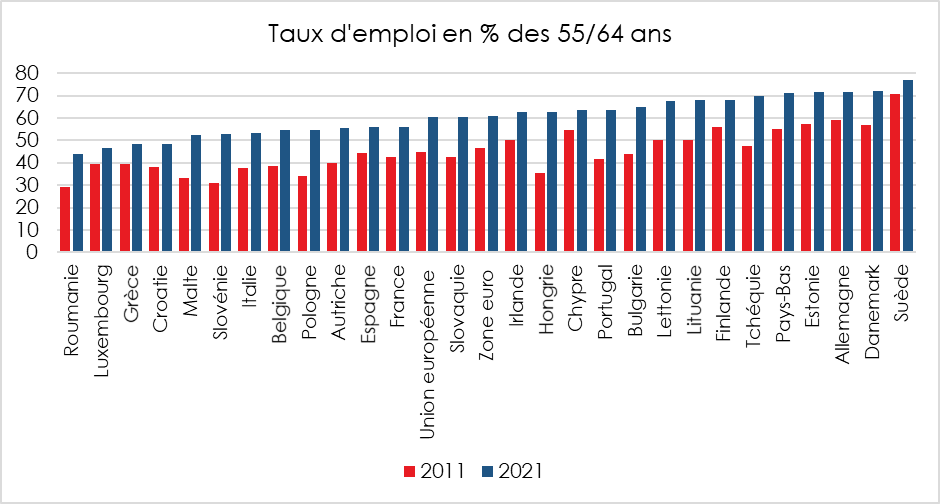
L’emploi des seniors et les coûts masqués
La réduction de la durée des retraites génère des coûts induits importants qu’il convient de prendre en considération. Avec le recul de l’âge minimum légal de la retraite, des personnes peuvent connaître des épisodes de chômage, en règle générale assez longs, et des périodes d’invalidité. Le recul de l’âge minimum légal de 60 à 62 ans aurait ainsi occasionné en 2017, au terme de sa montée en charge, de l’ordre de 3 milliards d’euros de dépenses sociales supplémentaires (dont environ 800 millions pour l’assurance chômage, 700 millions au titre de minima sociaux et de 1,2 à 1,5 milliard d’euros de dépenses d’invalidité), soit environ 20 % du gain réalisé cette année-là sur les dépenses de retraite. Ce montant indiqué par la Cour des Comptes pourrait être plus élevé en intégrant l’ensemble des couvertures de prévoyance complémentaire.
Le passage de 62 à 64 ans devrait générer un coût moindre pour les régimes de prévoyance du fait du basculement en retraite des personnes en situation d’invalidité à compter de 62 ans.
Livret A – assurance vie, on refait le match !
Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le taux du Livret A à 3 % et le taux du LEP à 6,1 %, est-ce une bonne affaire pour les épargnants ?
Depuis le 1er février, le taux du Livret A a été fixé à 3 %. Cette hausse est la troisième consécutive en un an, après celle du 1er février et du 1er août 2022. Après avoir plafonné, entre 2020 et 2022, à 0,5 % son taux le plus de l’histoire bicentenaire du Livret A, ce dernier connaît une progression rapide également sans précédent. Pour retrouver à 3 %, il faut remonter quatorze ans en arrière, en 2009.
Le passage à 3 % du taux du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire est certainement une bonne nouvelle pour les titulaires de ces produits, mais il convient néanmoins de la relativiser. Leur rendement réel est négatif depuis plus d’un an. En 2022, le taux moyen du Livret A a été de 1,37 % quand l’inflation a été de 5,2 %. Pour 2023, logiquement l’inflation devrait rester supérieure au taux du Livret A.
Ce dernier correspond, en principe, à la moyenne de l’inflation annuelle et du taux de référence du marché monétaire des six derniers mois. La composante « taux » fait baisser le rendement du Livret A en étant inférieure à l’inflation. Seul le Livret d’Épargne Populaire permet une compensation totale de l’inflation en offrant un taux de 6,1 % mais ce produit n’est pas accessible à tous les Français. Seuls ceux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 21 393 euros en 2023 pour une part (5 712 euros par demi-part supplémentaire) peuvent souscrire ce produit. À 3 %, le Livret A n’en demeure pas moins un des produits d’épargne de court terme les mieux rémunérés, bien plus que les livrets d’épargne ordinaires.
Quelles sont les conséquences de l’augmentation du taux du Livret A pour l’économie ?
L’augmentation de la collecte peut nuire à la consommation, au moment même où celle-ci est en difficulté en raison de la hausse des prix. Mais il ne faut pas opposer épargne et croissance. Nous avons besoin de l’épargne pour financer les investissements. Les ressources du Livret A et du LDDS sont utilisées pour proposer des emprunts aux bailleurs sociaux, aux collectivités locales et aux entreprises. Demain, elles pourraient servir au financement des centrales nucléaires.
Toute hausse des taux du Livret A et du LDDS renchérit le coût de la ressource pour les établissements financiers. La majoration d’un point du taux génère, pour le seul Livret A, un surcoût de 3,7 milliards d’euros pour les banques et la Caisse des dépôts et Consignations (CDC), celle-ci centralisant 60 % des ressources de ce livret. Pour assurer le paiement des intérêts du Livret A, les banques et la CDC devront soit répercuter la hausse, soit réduire leurs marges. L’État sera également touché en touchant moins de dividendes de la part de la CDC et moins d’impôts sur les sociétés en provenance des banques.
Le taux des emprunts proposés risque de passer au-dessus des taux du marché, ce qui peut peser sur le financement du logement social.
Les banques pourraient également essayer de compenser par ailleurs le surcoût.
Pensez-vous que la collecte du Livret A sera élevée dans les prochains mois ?
Chaque relèvement du taux du Livret A se traduit par une hausse de la collecte. En 2022 avec deux relèvements, dans un contexte anxiogène, la collecte a été supérieure à 25 milliards d’euros, soit la deuxième meilleure année du Livret A de son histoire. En France, en période de crise, le Livret A joue le rôle de valeur refuge. Par crainte du lendemain, les ménages ont tendance à surestimer leur besoin en épargne de précaution et à conserver d’importantes liquidités. À ce titre, même s’il a légèrement baissé ces derniers mois, l’encours des comptes courants demeure à un niveau élevé, plus de 520 milliards d’euros, soit près de 120 milliards d’euros de plus qu’en décembre 2019, avant la pandémie.
L’assurance vie n’est-elle pas la grande perdante de la revalorisation des taux de l’épargne réglementée ?
Les deux produits ne sont pas à mettre sur le même plan. Le Livret A est un produit d’épargne de court terme plafonné à 22 950 euros quand l’assurance vie n’est pas plafonnée.
L’assurance vie permet de placer une partie de son épargne sur un placement de moyen et long terme. Il s’agit d’un contrat de services. La compagnie d’assurances s’engage sur la réalisation de certaines prestations (garantie en capital, versement en rentes, option de réversion, etc.).
L’assurance vie est un placement qui permet de financer des projets de vie (immobilier, création d’entreprises, etc.) une future retraite tout en préparant sa succession. Elle bénéficie d’avantages fiscaux non négligeables, abattement de 4 600 euros pour un célibataire et de 9 200 euros pour un couple sur les gains pour les contrats de plus de 8 ans et une réduction des droits de mutation en cas de décès. Elle permet en outre de déroger aux règles de succession sous certaines conditions.
Les fonds euros offrent une garantie en capital à laquelle sont attachés les Français quand les unités de compte donnent accès à des valeurs de marché qui sur moyenne et longue période sont potentiellement des sources de rendement. Le Livret A ne dispose pas de cette multiplicité de supports.
Le rendement des fonds euros peut apparaître faible au regard du niveau qu’ils avaient atteint dans le passé. Les fonds euros ressemblent à des tankers. Ils se meuvent avec un fort volant d’inertie. La baisse de leur rendement, ces dix dernières années, a accompagné celle des taux des obligations d’État mais dans une moindre proportion grâce à la poche de diversification dont ils sont dotés. Depuis la crise financière, nous étions dans une période sans précédent de faibles taux en lien avec les politiques monétaires non conventionnelles instituées par les banques centrales pour lutter contre les menaces de déflation.
Cette période anormale n’avait pas vocation à perdurer éternellement. La résurgence de l’inflation a sonné sa fin. Le taux des obligations d’État est loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant 2008 mais sa remontée se fera sentir dans les prochaines années sur les rendements des fonds euros. Pour l’année 2022, ces derniers augmentent de 0,4 point à 0,5 point pour se situer autour de 2 %. À la différence du Livret A, l’annonce du rendement des fonds euros intervient en fin d’année ou au début de l’année qui suit. Le taux moyen du Livret A a été de 1,37 % en 2022, ce qui place le rendement des fonds euros au-dessus.
L’assurance vie donne la possibilité à l’assuré d’accéder à un grand nombre de supports. Au-delà du fonds euros et de sa garantie en capital, l’assuré peut souscrire à des unités de compte qui représentent des parts de fonds. L’assuré peut ainsi accéder à un nombre impressionnant de titres, actions, obligations, monétaires, pierre papier, etc. Il est possible de loger des titres en vifs dans certains contrats d’assurance vie. Des fonds structurés permettent également d’associer une sécurisation du capital tout en bénéficiant de la croissance des marchés. L’assurance vie multi-supports est un véhicule hors du commun. Ses caractéristiques contribuent à son succès. Près d’un ménage sur deux a souscrit au moins un contrat d’assurance vie. L’encours dépasse 1 850 milliards d’euros, soit plus de 60 % du PIB français.
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com




