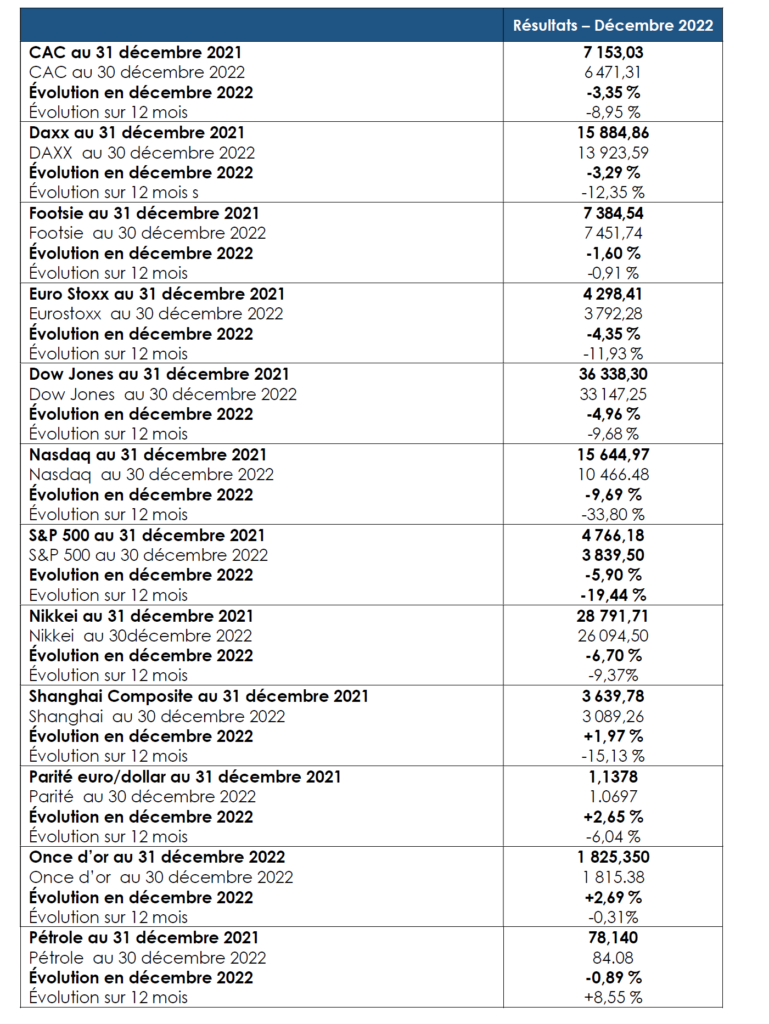Le taux d’épargne des ménages toujours au-dessus de son niveau d’avant crise sanitaire
En moyenne sur l’année 2022, le taux d’épargne s’est élevé, selon l’INSEE, à 16,6 % du revenu disponible brut. Il a reculé de deux points par rapport à 2021, mais reste supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (+1,6 point par rapport à 2019). Les ménages n’ont pas encore réellement puisé dans leur cagnotte covid qui est évalué à plus de 145 milliards d’euros. Ils ont maintenu un effort important d’épargne malgré ou à cause de l’inflation. Les ménages mettent de l’argent de côté pour faire face aux dépenses à venir qui pourraient coûter plus chères. Il convient par ailleurs de souligner que les deux tiers de l’épargne sont constitués par les remboursements du capital des emprunts immobiliers. En 2022, le taux d’épargne financière a été de 5,4 % du revenu disponible brut quand la composante immobilière a représenté 11,2 % du revenu disponible brut.
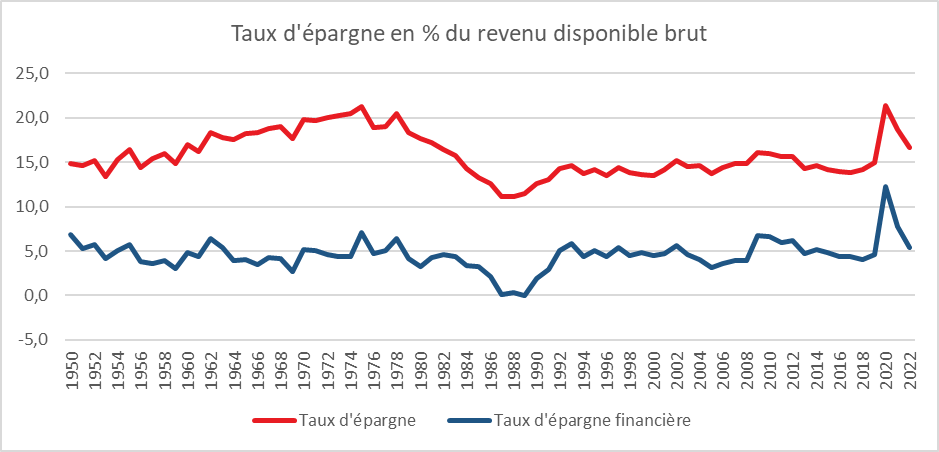
Pierre papier, un bon cru en 2022 grâce aux unités de compte de l’assurance vie
La collecte nette des fonds immobiliers accessibles au grand public a atteint, en 2022, selon l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), 16,1 milliards d’euros, en hausse de + 47 % sur un an et dépassant ainsi le précédent record de 2019 (14,8 milliards d’euros). Au cours du dernier trimestre de l’année 2022, la collecte de l’ensemble des fonds s’est élevé à 3,8 milliards d’euros (+ 26 % sur un an). La pierre papier a continué à attirer les épargnants dans un contexte d’inflation et de hausse des taux. Une part croissante de la collecte s’est effectuée via les unités de compte dans le cadre des contrats d’assurance vie. En tenant compte de la détention en unités de compte immobilières, le nombre d’épargnants détenant des parts de fonds immobiliers non-côtés atteint 4 millions de Français qui aujourd’hui détiennent des parts de fonds immobiliers non cotés.
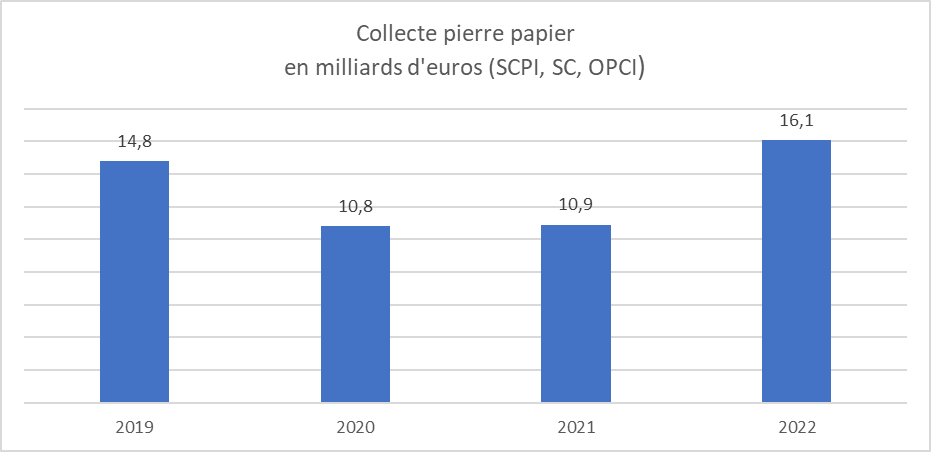
Le développement de la collecte ISR
45 % de la collecte annuelle (7,2 milliards d’euros) a été réalisée, selon l’ASPIM, par les fonds labellisés ISR. 60 fonds immobiliers grand public étaient au 31 décembre 2022 labellisés ISR, représentent 48 % de la capitalisation globale (soit 64,8 milliards d’euros) et 45 % de la collecte nette des fonds grand public en 2022
La collecte des SCPI franchit la barre des 10 milliards d’euros en 2022
Le principal vecteur de la collecte pierre papier est assurée par les SCPI. La collecte de ces derniers a atteint 10,2 milliards d’euros en 2022 soit 60 % de la collecte totale. Elle a progressé de 37 % par rapport à l’année 2021 et a dépassé de 9 % le précédent record de 2019. Au dernier trimestre 2022, la collecte nette des SCPI s’est élevé à 2,6 milliards euros, en progression de 18 % par rapport au dernier trimestre de 2021.Sur l’année 2022, les SCPI à prépondérance « bureaux » ont représenté 41 % de la collecte nette des SCPI, les SCPI à stratégie diversifiée 29 %) et les SCPI « santé et éducation » 17 %.
Au 31 décembre 2022, la capitalisation des SCPI a atteint 89,6 milliards d’euros, en hausse de 14 % sur un an.
Les sociétés civiles distribuées en UC collectent 5,4 milliards € en 2022
Les société civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 5,4 milliards d’euros de souscriptions nettes, en hausse de 65 % par rapport à 2021. Le poids des sociétés civiles dans la collecte globale des fonds immobiliers grand public est passé de 23 % à 34 % entre 2019 et 2022 avec l’essor des unités de compte dans ce domaine.
Au dernier trimestre 2022, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 1,4 milliard d’euros de collecte nette, en progression de 66 % par rapport au dernier trimestre 2021.
Au 31 décembre 2022, l’actif net des sociétés civiles unités de compte immobilières s’établit à 25 milliards d’euros, en augmentation de 33 % sur un an.
La collecte nette des OPCI grand public près de 500 millions d’euros
E, 2022, les OPCI grand public ont réalisé pour 465 millions d’euros de collecte nette, les souscriptions brutes ayant atteint 900 millions d’euros et les rachats 400 millions d’euros. Au dernier trimestre 2022, les retraits ont été supérieurs aux souscriptions générant une décollecte pour un montant de 135 millions d’euros.
L’actif net des OPCI grand public se monte à 20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en baisse de 3 % sur un an.
Légère augmentation du rendement en 2022 pour les SCPI
Le taux de distribution des SCPI s’établit à 4,53 % en 2022 en légère augmentation par rapport à 2021. Avec un taux d’inflation de 5,2 %, le rendement réel a été légèrement négatif (-0,7 point).
Selon l’ASPIM, le taux de distribution de 2022 comprend une distribution sur résultat courant de l’ordre de 4,02 %, d’une distribution exceptionnelle, principalement sur réserves de plus-values, de l’ordre de 0,38 % et d’une fiscalité acquittée à la source de l’ordre de 0,13 %.
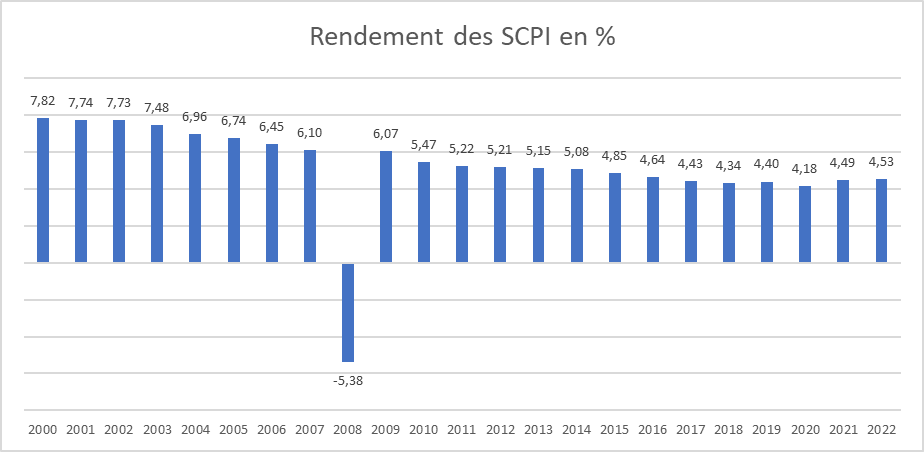
Par catégorie, le taux de distribution moyen varie de 4,17 % pour les SCPI à prépondérance « résidentiel » à 5,63 % pour les SCPI à stratégie diversifiée. Les SCPI à prépondérance « hôtels, tourisme, loisirs » ont renoué avec des niveaux de distribution d’avant crise sanitaire (5,09 % en 2022 contre 2,85 % en 2021).
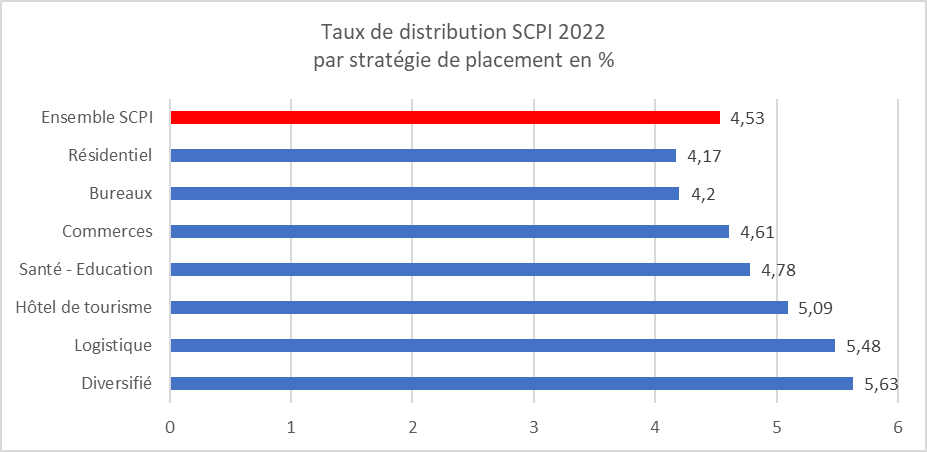
La performance globale moyenne de l’ensemble des OPCI grand public s’établit à -3,48 % en 2022 (contre + 4,4 %). Cette performance négative a été provoquée par la baisse des marchés financiers en 2022. Les poches financières et foncières cotées des fonds ont affiché des performances respectives de -5 % et – 29%. Des baisses de valorisation des actifs ont été observées en fin d’année, pesant sur les performances globales de la poche immobilière.
Les sociétés civiles unités de compte immobilières en assurance-vie ont enregistré un rendement moyen+ 3,7 % en 2022. Cette moyenne de marché est voisine de la performance moyenne délivrée en 2021 (+ 3,8%).
Actualisation des taux de l’usure au 1er mars 2023
Comme depuis le 1er février, les taux de l’usure sont désormais révisés tous les mois et non une fois par trimestre comme auparavant. Les nouveaux taux applicables au 1er mars 2023 ont été publiés au Journal Officiel du 26 février 2023.
Taux effectifs moyens pratiques par les établissements de crédit au cours des 3 derniers mois pour les catégories de crédits suivantes et seuils de l’usure correspondants applicables, à compter du 1er mars 2023 :
Catégories | Taux effectif pratiqué au cours des trois derniers mois par les établissements de crédit et les sociétés de financement | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mars 2023 |
|---|---|---|
Contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) | 15,43 % | 20,57 % |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) | 7,95 % | 10,6 % |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros (1) | 4,61 % | 6,15 % |
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |
Catégories | Taux effectif pratiqué au cours des trois derniers mois par les établissements de crédit et les sociétés de financement | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mars 2023 |
|---|---|---|
Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
Prêts à taux fixe (3) : | ||
-prêts d’une durée inférieure à 10 ans | 2,75 % | 3,67 % |
-prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,90 % | 3,87 % |
-prêts d’une durée de 20 ans et plus ; | 3 % | 4 % |
Prêts à taux variable | 2,84 % | 3,79 % |
Prêts- relais | 3,08 % | 4,11 % |
(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit ; (3) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus. |
Catégories | Taux effectif pratiqué au cours des trois derniers mois par les établissements de crédit et les sociétés de financement | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mars 2023 |
|---|---|---|
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 3,90 % | 5,20 % |
Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe : | ||
-Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 3,68 % | 4,91 % |
– Prêts d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,64 % | 4,85 % |
– Prêts d’une durée initiale de 20 ans et plus | 3,71 % | 4,95 % |
Découverts en compte | 12,49 % | 16,65 % |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 3,57 % | 4,76 % |
Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d’associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours des trois derniers mois pour cette catégorie de prêts est de 3,90 %.
Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.
Le Coin des Epargnants du 25 février 2023 : L’inflation, toujours l’inflation
Une semaine de repli pour les actions
Aux Etats-Unis, les ménages continuent de consommer favorisant le maintien de l’inflation à un niveau élevé et cela malgré les efforts de la Réserve fédérale pour freiner la croissance, L’indice PCE des dépenses de consommation personnelle, indicateur d’inflation privilégié par la Fed, a augmenté de 0,6 % sur un mois en janvier et de 5,4 % en rythme annuel contre respectivement 0,5 % et 5 % anticipés par le consensus formé par Bloomberg. En données core (hors alimentation et énergie), la hausse est de 0,6 % en janvier, et de 4,7 % sur un an (+0,4 % et 4,3 % estimés, après 4,6 % en décembre). Toujours en janvier, les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,6 % et leurs dépenses de 1,8 %, soit plus que prévu. Ces chiffres confirment les différents indices et indicateurs avancés publiés récemment (emploi, ventes au détail, inflation, PMI) qui justifient la poursuite des hausses des taux directeurs de la part de la FED. De nouveaux relèvements des taux directeurs de 50 points de base sont à prévoir, la fin du cycle de resserrement n’étant plus attendue que pour la seconde partie de l’année. En Allemagne, la baisse du PIB au quatrième trimestre 2022 a été plus forte qu’initialement annoncée ; elle a atteint 0,4 % ravivant les menaces de récession pour la première économie européenne. Le Président de la Bundesbank en appelle néanmoins à des relèvements des taux directeurs significatifs, l’inflation baissant à ses yeux que trop lentement. Dans ce contexte, les indices « actions » ont été, cette semaine, en recul. Le CAC40 a perdu 1,27 %, le Nasdaq près de 3,5 % et le S&P500 près de 3 %. Les taux des obligations sont, en revanche, en hausse. Le taux de l’OAT à 10 ans de la France est passé au-dessus des 3 % quand son équivalent aux Etats-Unis se rapproche de 4 %.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 24 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 187,27 | -1,27 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 816,92 | -3,20 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 970,04 | -2,93 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 394,94 | -3,47 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 209,74 | -1,34 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 878,66 | -1,43 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 178,82 | -2,02 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 453,48 | -0,22 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 267,16 | +1,34 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,016 % | +0,119 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,539 % | +0,102 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,967 % | +0,129 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0550 | -1,50 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 811,95 | -1,67 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 83,18 | -1,76 % | 84,08 | 78,140 |
2022, une année compliquée pour les OPC
L’encours des Organisme de Placement Collectif (OPC) dépasse 2 100 milliards d’euros. Ces fonds qu’ils soient monétaires, obligataires, actions, mixtes ou indiciels sont présents dans l’assurance vie, les Plans d’Épargne en Actions, les Plans d’Épargne Retraite ou sur les comptes titres. Après une année 2021 qui avait été favorables aux fonds actions et aux fonds indiciels, 2022 a été marquée par la baisse des rendements de tous les fonds à l’exception de ceux à dominante monétaire, qui après des années de taux nuls voire négatifs, sont repassés légèrement au-dessus de 0 %. La baisse des fonds obligataires ont, l’année dernière, s’explique par la hausse des taux qui ont provoqué la diminution des cours des obligations.
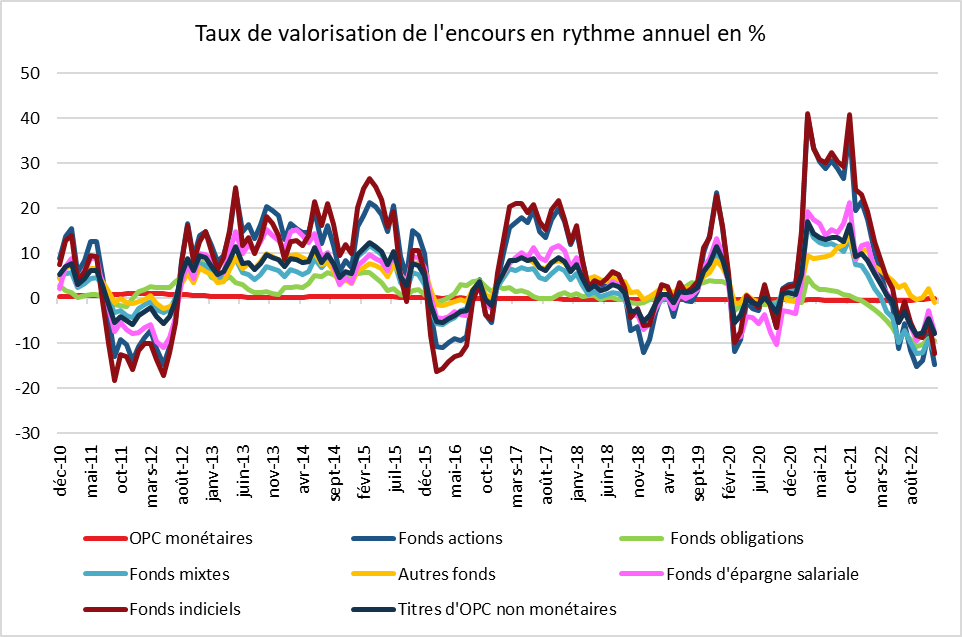
Les Français en mode épargne
En février, la confiance des ménages, mesurée par l’INSEE, est quasi stable. À 82, l’indicateur synthétique perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).
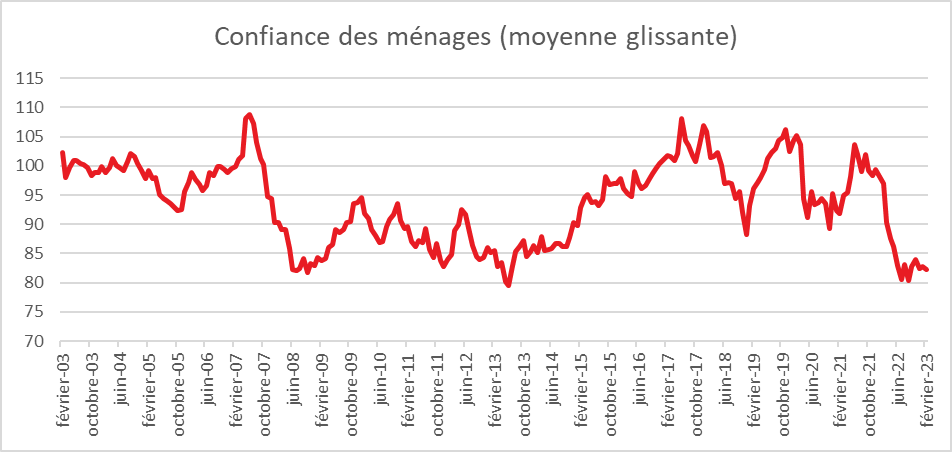
Les ménages en mode épargne
En février 2023, l’appréciation des ménages sur leur situation financière passée et future reste dégradée. Les soldes d’opinion correspondants baissent respectivement de deux et d’un point et sont au-dessous de leur moyenne de longue période. Le solde d’opinion associé à l’opportunité de faire des achats importants est, quant à lui, stable, au-dessous de sa moyenne de longue période. La proportion des ménages considérant qu’il est opportun d’épargner augmente, selon de l’INSEE, de nouveau fortement. L’augmentation des taux de rémunération des livrets d’épargne réglementée a sans nul doute joué dans cette appréciation. Le solde d’opinion correspondant est au plus haut depuis mai 2021, en gagnant sept points, après une hausse de huit points en janvier (données révisées). Cette propension à épargner a comme limite l’inflation qui ronge leur pouvoir d’achat. Ainsi, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future diminue d’un point tandis que celui sur leur capacité d’épargne actuelle est stable. Ces deux soldes restent au-dessus de leur moyenne de longue période.
Sans surprise, en février les soldes d’opinion des ménages relatifs à l’évolution passée comme future du niveau de vie en France sont stables et se situent au-dessous de leurs moyennes de longue période.
Les ménages ne croient pas à la décrue prochaine de l’inflation
La proportion de ménages qui considèrent que les prix ont augmenté sur les douze derniers mois est en hausse. Le solde correspondant gagne trois points et atteint son plus haut niveau depuis 1977. La proportion des ménages considérant que les prix accélèreront au cours des douze prochains mois augmente légèrement. Le solde d’opinion associé gagne deux points et reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
Chômage, l’optimisme perdure
Dans un contexte d’amélioration de la situation sur le front de l’emploi, en février 2023, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage sont stables. Le solde correspondant reste au-dessous de sa moyenne de longue période.
Résultats du mois de janvier 2023 : le Livret A surfe sur l’effet taux
Le Livret A boosté par l’effet taux
Le Livret A démarre l’année en trombe. Avec une collecte positive de 9,27 milliards d’euros en janvier, le Livret A enregistre sa meilleure performance depuis janvier 2009 (18,31 milliards d’euros) qui avait été alors réalisée au moment de la banalisation de sa distribution et en pleine crise financière. Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), la collecte a atteint, en janvier 1,95 milliard d’euros. Il faut remonter à octobre – décembre 2012 pour enregistrer des collectes supérieures. Ces dernières avaient été obtenues au moment du doublement du plafond du LDDS qui était alors passé de 6000 à 12 000 euros (octobre 2012).
Le Livret A et le LDDS ont été dopés par l’annonce au cours du mois de janvier du relèvement de leur taux de 2 à 3 %, hausse entrée en vigueur le 1er février 2023. Toute annonce de relèvement provoque une augmentation de la collecte, augmentation qui perdure entre deux et trois mois. Le rebond de janvier 2023 se distingue par sa force. Les ménages ont décidé, sans nul doute de profiter à plein du passage à 3 % en réduisant leurs liquidités non rémunérés sur leurs comptes courants.
Les ménages tentent de se protéger de l’inflation
Avec la baisse des taux de l’épargne réglementée et l’absence d’inflation, les ménages avaient, ces dernières années laissé, de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants. L’encours des dépôts à vue était, en effet, selon la Banque de France, passé, de décembre 2014 à juillet 2022, de 257 milliards d’euros à plus de 543 milliards d’euros. A défaut de placements garantis suffisamment rémunérés, les Français avaient opté, défaut, pour le compte courant.
Depuis le mois de juillet et surtout septembre de l’année dernière, les ménages ont changé leurs comportements. Le rendement est redevenu, du moins de manière faciale, attractif et l’inflation érode la valeur des sommes laissées sur les comptes courants qui ne sont pas rémunérés. L’encours des dépôts à vue s’est ainsi, sur le quatrième trimestre 2022, contracté de 18,9 milliards d’euros dont une grande partie au profit à l’épargne réglementée.
En privilégiant le Livret A et le LDDS, les ménages tentent de limiter les effets de l’inflation sur leurs liquidités. La protection n’est pas totale, le rendement réel du Livret A étant négatif d’au moins trois points. Il faut remonter aux années 80 pour constater un rendement réel négatif aussi important.
Un effort d’épargne toujours élevé
Face à la hausse des prix et l’érosion de leur pouvoir d’achat, les ménages ne puisent pas dans leur bas de laine, bien au contraire, ils le renforcent. Le rendement réel négatif du Livret A ou du LDDS ne les dissuade pas. Ils préfèrent réduire leur consommation que d’entamer leur épargne de précaution. La crainte d’une détérioration à venir de la situation économique explique cette attitude. Les débats sur les retraites et les menaces de blocage du pays s’accompagnent traditionnellement d’une remontée de l’épargne. A l’exception des Etats-Unis, la tendance de fond est, par ailleurs, dans les pays occidentaux comme dans les pays émergents, au maintien d’un fort taux d’épargne. La succession des crises et le vieillissement de la population expliqueraient en grande partie cette évolution.
Des encours au sommet au service demain, peut-être du nucléaire
L’encours du Livret A a atteint au mois de janvier un nouveau record absolu à 384,7 milliards d’euros ; celui du LDDS est également au plus haut à 136,2 milliards d’euros. Cette augmentation de l’encours du Livret A pourrait conforter le gouvernement dans son idée d’utiliser ce placement pour financer la construction des nouvelles centrales nucléaires. Les bailleurs sociaux sont à la peine pour utiliser l’ensemble des ressources disponibles faute de foncier en quantité suffisante.
Vers un premier semestre record
Traditionnellement, le premier trimestre est porteur pour le Livret A. En début d’année, les ménages y affectent une partie des primes perçues fin décembre. Par ailleurs, ce sont des mois à faibles dépenses et sans rendez-vous fiscaux. L’effet taux qui a joué en janvier devrait perdurer en février et en mars.
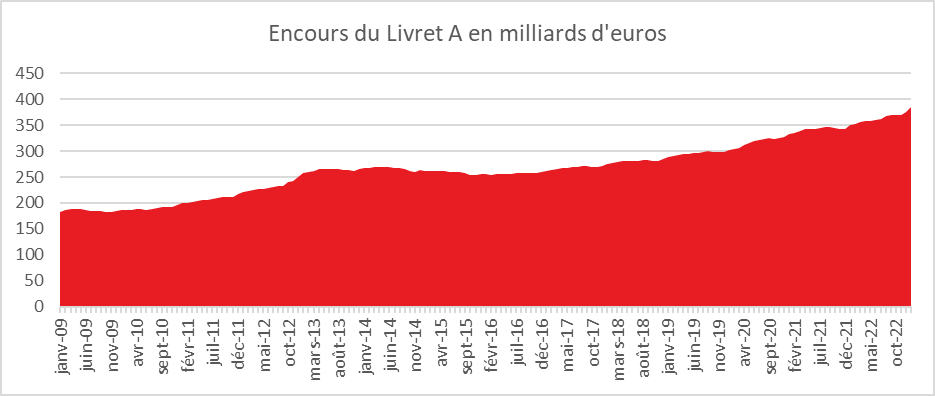
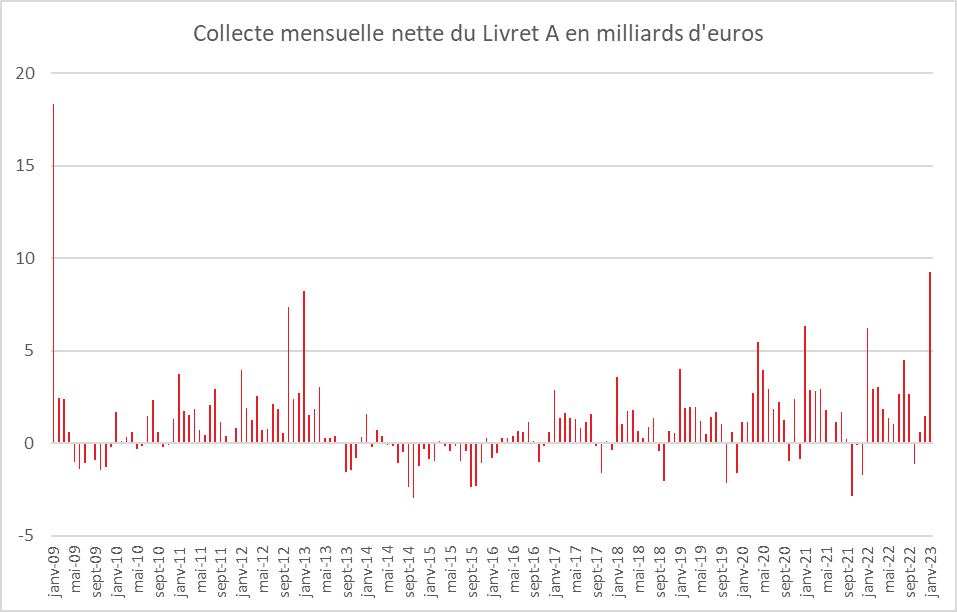
Le Coin des Epargnants du samedi 18 février 2023 : le CAC40 en plein boom
Un record surprise pour le CAC40
Le CAC 40 a battu, à 7387,29 points, dans la matinée du jeudi 16 février 2023, son record historique du 5 janvier 2022, soit une année, un mois et onze jours après le précédent qui avait tenu plus de vingt ans. Depuis le début de l’année, le CAC40 a gagné près de 14 % portant son rebond à près de 30 % depuis son point bas atteint le 27 septembre dernier à 5 753 points. La forte chute des cours provoquée par la guerre en Ukraine et la remontée des taux après a été effacée en quelques semaines. L’économie européenne condamnée par de nombreux experts à la récession se révèle plus résiliente que prévu. Le cours de l’énergie est en repli, les résultats des entreprises demeurent bien orientés. Les marchés européens connaissent ainsi leur meilleure début d’année en plus de 20 ans. Même l’indice britannique est en forte hausse. Il a dépassé pour la première fois de son histoire le seuil des 8 000 points. Les indices « actions » qui étaient portés ces dernières années par les valeurs technologiques le sont désormais par celles du luxe l’énergie et la défense (Thales, Total Energy). Certaines valeurs bancaires sont également recherchées comme BNP PARIBAS. Malgré une baisse vendredi 17 février, le CAC40 a gagné plus de 3 % sur la semaine.
Aux Etats-Unis, les indices actions sont restés relativement stables, la publication d’indicateurs économiques soulignant la résistance de l’inflation a refroidi les ardeurs des investisseurs. Les chiffres des prix à la production (PPI) pour le mois de janvier sont ainsi ressortis en rebond de 0,7% sur un mois. Deux des membres les plus « faucons » de la Réserve fédérale américaine, Loretta Mester, présidente de la FED de Cleveland, et son collègue de St. Louis, James Bullard ont pris position pour le durcissement de la politique monétaire. La première a ainsi déclaré qu’elle percevait « des arguments économiques convaincants » pour une hausse de 50 points de base du taux des Fed funds en mars. Le second a indiqué qu’il était favorable à une hausse des taux directeurs à 5,375 % le plus tôt possible avec à la clef des relèvements de 50 points de base, plutôt que le 25de points de base. La probabilité d’une hausse de 50 points de base en mars est désormais évaluée à 21 %, contre seulement 9,2 % vendredi dernier et 0 % en début de mois avant la publication de chiffres de l’emploi jugés peu compatibles avec une décrue de l’inflation. Au sein de la zone euro, Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, s’est alarmé du risque que les marchés ne sous-estiment la force de l’inflation et la réponse nécessaire pour la ramener au sein de l’objectif cible. « Nous sommes encore loin de pouvoir crier victoire », a-t-elle déclaré lors d’un entretien accordé à Bloomberg.
Les taux des obligations d’Etat ont continué leur progression se rapprochant, en France, des 2,9 % pour l’OAT à 10 ans, des 2,5 % et des 3,9 % pour ses homologues allemand et américain. Le cours du baril de pétrole a reculé de près de 5 % sur la semaine avec la publication de stocks plus importants aux Etats-Unis témoignant d’une baisse de la demande.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 17 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 347,72 | +3,10 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 826.69 | -0,30 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 079.09 | -0,43 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 787,27 | +0,31 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 482,00 | +1,11 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 8 004,36 | +1,59 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 274,92 | +1,93 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 513,13 | -0,47 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 224,02 | -1,12 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,897 % | +0,071 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,437 % | +0,077 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,838 % | +0,108 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0686 | -0,09 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 840,56 | -1,62 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 82,99 | -4,46 % | 84,08 | 78,140 |
Les Français n’ont pas, en 2022, boudé la bourse
Selon la neuvième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les Français malgré une volatilité accrue des cours de bourse ne sont pas retirés du marché « actions ». 1,5 million d’épargnants français ont réalisé au moins une opération d’achat ou de vente sur des actions, sur l’ensemble de l’année 2022. Cette proportion est en baisse de 5,5 % par rapport à 2021 qui avait été marquée par une hausse records des indices « actions ».
L’indice CAC40 (dividendes réinvestis) a limité ses pertes à 6,7 % en 2022, contre un gain de 31,9 % en 2021. Durant la crise sanitaire, en 2020, les Français, contrairement aux précédentes crises n’étaient pas sortis du marché « actions ». Au contraire, ils avaient alors fait preuve d’opportunisme en effectuant des achats durant le mois d’avril et mai, attirés par la baisse des marchés liée. 1,3 million d’épargnants avaient alors exécuté des opérations en bourse.
En 2022, l’AMF a recensé 195 000 nouveaux investisseurs, qui n’avaient jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018. En quatre ans, sur la période 2019-2022, plus de 1,3 million de nouveaux investisseurs ont été décomptés.
Le nombre de transactions réalisées par des particuliers sur des actions de l’Union européenne s’est élevé à 42,2 millions sur l’année 2022, en recul de 24 % par rapport à l’année précédente. Ce niveau reste néanmoins supérieur aux volumes moyens enregistrés dans l’ensemble de la 2018-2019 (environ 24 millions de transactions par an en moyenne).
L’AMF souligne que les fonds indiciels cotés (ETF) continuent à attirer un nombre croissant d’épargnants. (250 000 de plus en 2022, en progression de 14 % en un an). Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt et de baisse des marchés d’actions, les investisseurs particuliers en obligations ont augmenté en 2022, retrouvant le niveau de 2019, à 107 000 (+67 %).
6,7 milliards d’euros sur les comptes inactifs
Depuis 2016, année de la mise en oeuvre de la loi Eckert sur les comptes non réclamés, la Caisse des Dépôts a récupéré au total 7,8 milliards d’euros. 133,6 millions d’euros ont été restitués en 2022 aux titulaires ou aux ayants droit qui se sont manifestés, portant le total à 684,1 millions d’euros depuis 2017. Selon le Parisien, deux tiers de cette somme étaient issus de comptes bancaires en déshérence, un quart de contrats d’assurance-vie non réclamés, le solde provenant de l’épargne salariale. En moyenne, d chaque bénéficiaire a récupéré 2 583 euros. En 2022, 632,16 millions d’euros issus d’environ 850 000 comptes et produits bancaires et d’assurances ont été transférés à la Caisse des Dépôts. Entre juillet 2016 et le 31 décembre 2022, 7,8 milliards d’euros ont été ainsi affectés à la Caisse des Dépôts provenant de 11,5 millions de comptes et contrats.
Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi, banques et assureurs sont tenus de réaliser un suivi et effort de recherche des titulaires des contrats qu’ils ont en gestion. A ce titre ils ont l’obligation de :
- s’assurer que les titulaires sont vivants : les banques doivent s’informer de l’éventuel décès des titulaires, en croisant les fichiers clients avec le registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP) de l’Insee ;
- informer les titulaires ou leurs représentants légaux ou ayant-droits de l’état d’inactivité des comptes ;
- limiter les frais de tenue de compte ;
- transférer la gestion des comptes à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 10 ans après la dernière opération ou la dernière manifestation du client. Pour les plans d’épargne logement, le délai est de 20 ans. Dans le cas du décès du titulaire, le délai est ramené à trois ans. Le titulaire, ses représentants ou ses héritiers doivent s’adresser à la CDC pour récupérer les sommes. Celle-ci les conserve pendant 20 ans (27 ans si l’inactivité fait suite au décès connu du titulaire) avant leur transfert définitif à l’Etat ;
- publier annuellement le nombre de comptes bancaires inactifs et le montant des encours détenus ou transférés à la CDC. Cette dernière doit faire la publicité de l’identité des titulaires des comptes bancaires transférés ;
Les moyens mis à la disposition les détenteurs et/ou leur ayant-droits
La Caisse des dépôts s’est vue confiée la mission de le conserver les fonds non-réclamés, de permettre sa recherche aux titulaires, bénéficiaires et héritiers avec Ciclade et de gérer les demandes de restitution. A cet effet, elle met à disposition des assurés un service en ligne gratuit destiné à faciliter leur recherche.
ciclade – pour rechercher votre argent
Quelles incidences pour les contrats inactifs ?
La loi renvoie a un décret, adopté le 28 août 2015, le soin de préciser les règles destinées à encadrer les frais applicables aux comptes bancaires et contrats d’assurance vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d’assurance vie.
Ainsi ce décret créé une série de plafonds annuels de frais perceptibles par compte et les distingue par catégorie de produits :
- épargne réglementée
- PEA et PEA-PME
- Comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers
- Autres comptes (comptes courants, à terme, sur livret, etc.)
De fait, le principe que le décret pose est l’impossibilité pour les établissements financiers dépositaires des fonds de percevoir, après la date de connaissance du décès du détenteur des frais « supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n’était pas intervenu ».
Par ailleurs, le décret précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés. Il fixe également les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l’État (par la CDC ou par les établissements) à l’issue de la prescription du délai.
En outre, le texte prévoit les règles relatives à la rémunération des sommes déposées à la CDC. Sur ce point, il renvoie à l’article 518-23 du code monétaire et financier . Cet article dispose « que le e taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l’approbation du ministre chargé de l’économie. »
Enfin, le décret détermine la fiscalité à appliquer par la CDC aux contrats et Livrets inactifs dont elle est en possession. En cas de décès du titulaire du compte avant la restitution des sommes, « la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l’article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article ». En revanche, « Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées, ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts. . »
Le Coin des Epargnants du samedi 11 février 2023 : l’inflation n’est pas encore vaincue
Des marchés toujours sous la pression des banques centrales
Les marchés financiers évoluent toujours au gré des annonces des banquiers centraux. Après s’être réjouis la semaine dernière de la modération des hausses de taux par la FED et la BCE, les investisseurs, cette semaine, ont entendu un chant inverse, celui du combat contre l’inflation qui n’est pas gagné et qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Selon certains responsables de la FED, le plafond des taux directeurs pourrait atteindre jusqu’à 5,4 %, contre 4,5 % actuellement, quand le consensus penchait pour 5,1/5,2 %. L’espoir d’une pause dans le cycle de resserrement monétaire s’est atténué provoquant le repli des valeurs technologiques et celles du luxe
Le processus de hausse de taux se poursuit comme en témoignent les décisions de la Banque de Suède et celle du Mexique qui ont relevé les leurs jeudi 9 février 2023. De son côté, la banque centrale russe a maintenu son principal taux directeur à 7,5% vendredi 10 février, tout en prévenant qu’elle pourrait resserrer le loyer de l’argent à l’occasion d’une prochaine réunion. Le Premier ministre nippon Fumio Kishida, pourrait nommer Kazuo Ueda à la tête de la Banque du Japon mardi prochain, qui est connu pour être moins favorable que son prédécesseur Haruhiko Kuroda aux politiques accommodantes. Dans l’attente de la confirmation de cette nomination, sur le marché des changes, le yen s’est apprécié de 0,6 % par rapport au dollar.
Après avoir connu une forte progression au mois de janvier, les indices actions de toutes les grandes places financières ont reculé cette semaine. Le CAC 40 a reculé de près de 1,5 % en une semaine. Les taux des obligations d’Etat sont orientés à la hausse dans la perspective de prochains relèvements des taux directeurs. En fin de semaine, le taux de l’OAT à 10 ans a ainsi dépassé 2,8 % et son équivalent américain 3,7 %.
Le cours du baril de pétrole Brent a gagné près de 8 % cette semaine. Cette augmentation est la conséquence de la décision de la Russie de réduire sa production en mars. Cette décision a été prise en réponse aux sanctions occidentales. La réduction « volontaire » s’élèvera à 500 000 barils par jour en mars, soit environ 5 % de la production russe. Les autorités russes ont également annoncé qu’elles ne vendront pas de pétrole à ceux qui adhèrent directement ou indirectement aux principes du prix plafond. Ce dernier a été mis en place par le G7, l’Union européenne et l’Australie depuis le mois de décembre pour le pétrole brut et depuis le début du mois de février pour les produits pétroliers raffinés.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 10 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 129,73 | -1,44 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 869,27 | -0,06 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 090,46 | -0,50 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 718,12 | -1,42 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 307,98 | -1,09 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 882,45 | -0,24 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 197,94 | -1,41 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 670,98 | +0,59 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 260,67 | -0,08 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,826 % | +0,189 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,360 % | +0,176 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,730 % | +0,209 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0674 | -1,11 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 862,85 | -0,24 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,08 | +7,86 % | 84,08 | 78,140 |
Le Coin des Epargnants : les banques centrales entre volontarisme et temporisation
Les États-Unis n’en finissent pas de surprendre
En janvier, les États-Unis ont créé 517 000 emplois non agricoles quand le consensus n’en attendait que 189 000. Au mois de novembre, seulement 260 000 créations avaient été enregistrées. Ce résultat étonnant s’expliquerait par des ajustements d’effectifs en janvier après un mois de décembre marqué par d’importantes grèves. En revanche, le ministère du travail américain n’a pas encore mesuré les conséquences des plans de licenciements des grandes entreprises du digital. Le taux de chômage a reculé, à 3,4 % de la population active. Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine est passé de 34,4 à 34,7, ce qui signifie que la demande de main-d’œuvre est plus forte que prévu. En revanche, et cela constitue une bonne nouvelle pour la FED, la croissance du salaire horaire moyen ralentit, augmentant de 0,3 % sur un an, ce qui ramène le taux annuel à 4,4 %, contre 4,8 % en décembre. La composante des prix de l’indice ISM manufacturier américain de janvier est en légère baisse passant de 68,1 à 67,8 ce qui constitue également une bonne nouvelle pour l’inflation.
Les banques centrales à la manœuvre
Jeudi 2 février, comme prévu, la Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs de 50 points de base. Le taux de dépôt passe ainsi à 2,5 %, le taux de refinancement à 3 % et celui de la facilité de prêt marginal à 3,25 %. De tels taux n’avaient pas été constatés depuis novembre 2008. En juillet dernier, le taux de dépôt était encore en territoire négatif, à -0,5 %. Cette remontée est la conséquence de la résurgence de l’inflation depuis plus d’un an. L’augmentation de février n’est pas la dernière. Une nouvelle hausse de 50 points de base devrait être décidée à l’occasion de la prochaine réunion du comité de politique monétaire prévue le 16 mars prochain. La volonté de lutter contre l’inflation demeure ferme de la part de la Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Elle a notamment souligné que la décrue de l’inflation au mois de janvier 8,5 % contre 9,2 % en décembre, résultait de la diminution des prix de l’énergie et que l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) n’avait pas diminué. Compte tenu néanmoins de la tendance des prix en cours, Christine Lagarde a souligné qu’après mars, la BCE adopterait une approche « réunion par réunion » et « en fonction des données disponibles ». Elle a ainsi ouvert la possibilité d’un ralentissement des hausses voire d’une pause. Au sein du Conseil des gouverneurs, les débats sont de plus en plus animés entre ceux favorables à la poursuite du durcissement et ceux partisans d’une rapide stabilisation des taux. Quoi qu’il en soit, une étude réalisée par la BCE montre que les conditions de crédit ont retrouvé leurs niveaux de 2011. Les propos apaisants de Christine Lagarde ont provoqué le repli du rendement des obligations d’État européennes. Elle a confirmé que le dégonflement du bilan de la BCE sera prochainement engagé. Approchant 9000 milliards d’euros dont 5000 milliards d’euros d’obligations acquises depuis 2015, pour soutenir l’économie, le bilan devrait commencer à diminuer en mars avec une réduction de 15 milliards d’euros par mois. Cette réduction prendra la forme d’un moindre réinvestissement lors des tombées d’emprunts. Le montant de réinvestissement restant – en matière d’obligations souveraines – sera alloué pays par pays, en proportion des remboursements reçus. Pour les achats d’obligations d’entreprises, en revanche, la banque centrale a officialisé un changement des règles du jeu. Les réinvestissements seront orientés prioritairement « vers les émetteurs présentant de meilleures performances climatiques ».
De son côté, la banque centrale américaine (Fed) avait relevé, mercredi 1er février, son principal taux directeur d’un quart de point, une huitième hausse d’affilée moins forte que les précédentes, et prévoit de nouvelles hausses. Les taux de la Fed, qui se trouvaient à zéro il y a encore un an, évoluent désormais dans une fourchette de 4,50 à 4,75 %, Après des augmentations de 0,75 point et de 0,50 point, celle du mois de janvier est de nature plus habituelle. Les autorités monétaires américaines se félicitent des premiers signes de ralentissement de l’inflation qui néanmoins demeure élevée. Plusieurs statistiques sont encourageantes. La progression du coût moyen d’un salarié a ralenti au quatrième trimestre 2022. La hausse des prix à la consommation s’élevait en décembre à 5,0 % sur un an contre 5,5 % le mois précédent.
Des indices actions toujours orientés à la hausse
Le CAC 40 a 1,66 % gagné sur la semaine et a clôturé à 7 233,94 points, à 150 points de son record historique du 5 janvier 2022 (7 384,86 en séance). Au mois de janvier le CAC 40 a progressé de 7,4 %. En dix ans, il a augmenté de près de 100 %. Au mois de janvier, tous les grands indices « actions » ont progressé, le Nasdaq s’étant valorisé de plus de 11 %.
L’euro continue à s’apprécier légèrement, profitant du durcissement de la politique monétaire. Le pétrole de Brent est revenu autour de 80 dollars le baril. Vendredi 3 février, l’Union européenne (UE) est parvenue à un accord sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes. Cet accord sera soumis pour adoption définitive au prochain Conseil européen. Il comprend un prix plafond de 100 dollars le baril pour des produits plus chers comme le diesel et un autre de 45 euros le baril pour des produits moins raffinés comme le mazout. Au-delà du plafond fixé par les Européens, il sera interdit pour les entreprises basées dans l’Union le G7 ou l’Australie de fournir les services permettant le transport maritime, notamment l’assurance. Ce dispositif mesure s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle série de sanctions européennes contre la Russie
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 3 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 233,94 | +1,66 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 926,01 | -0,25 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 136,48 | +1,62 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 33 926,01 | +3,24 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 476,43 | +1,70 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 901,80 | +1,74 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 257,98 | +1,65 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 509,46 | +0,46 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 263,41 | -0,04 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,637 % | -0,060 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,184 % | -0,054 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,521 % | -0,001 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0834 | -0,032 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 866,45 | -2,98 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 80.70 | -3,84 % | 84,08 | 78,140 |
Hause de la rémunération de l’épargne liquide
L’épargne investie dans les produits de taux est mieux rémunérée en lien avec la hausse des rendements des livrets réglementés
La rémunération moyenne des dépôts bancaires était, selon la Banque de France, à 0,95 % en décembre, portant ainsi la hausse à 54 points de base sur un an (dont 45 points de base entre juillet et décembre). La rémunération des dépôts des ménages a presque doublé sur un an à 1,18 %, portée notamment par deux relèvements successifs du taux du livret A au cours de l’année. Le taux des livrets ordinaire est resté néanmoins stable à 0,33% en décembre.
La rémunération des dépôts des sociétés non financières, qui était quasi nulle en fin d’année 2021, s’établit à 0,59 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et par celle des dépôts à vue. Le tau
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| déc-22 (g) | déc-21 | oct-22 | nov-22 (f) | déc-22 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 150 | 0,41 | 0,80 | 0,88 | 0,95 |
| dont Ménages | 1 837 | 0,63 | 1,15 | 1,17 | 1,18 |
| – dépôts à vue | 623 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 16 | 0,40 | 0,98 | 1,31 | 1,70 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 59 | 0,76 | 0,72 | 0,74 | 0,80 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 586 | 0,52 | 2,16 | 2,16 | 2,17 |
| dont : livret A | 343 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| – livrets ordinaires | 274 | 0,09 | 0,28 | 0,33 | 0,33 |
| – plan d’épargne-logement | 280 | 2,59 | 2,58 | 2,57 | 2,57 |
| dont SNF | 917 | 0,09 | 0,28 | 0,45 | 0,59 |
| – dépôts à vue | 666 | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,21 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 195 | 0,13 | 0,81 | 1,30 | 1,67 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 56 | 0,62 | 0,85 | 1,09 | 1,41 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 1,25 | 2,00 | 2,50 | |
| Euribor 3 mois (d) | -0,58 | 1,43 | 1,83 | 2,06 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | -0,42 | 2,34 | 2,27 | 2,36 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
L’assurance vie en 2022 : transition et résilience
Dix ans après l’année horribilis, l’assurance vie dans un contexte compliqué – résurgence de l’inflation, incertitudes géopolitiques et économiques – a prouvé, en 2022, sa résilience, avec une collecte nette de 14,3 milliards d’euros. Cette dernière est néanmoins inférieure à celle de 2021 qui était de 23,7 milliards d’euros. Elle est simplement dans la moyenne de ces dix dernières années.
Le Plan d’Epargne Retraite est devenu, de son côté, en moins de trois ans, le vecteur de croissance de l’épargne longue en France en prenant la place. L’assurance vie demeure malgré tout de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1842 milliards d’euros à fin décembre 2022.
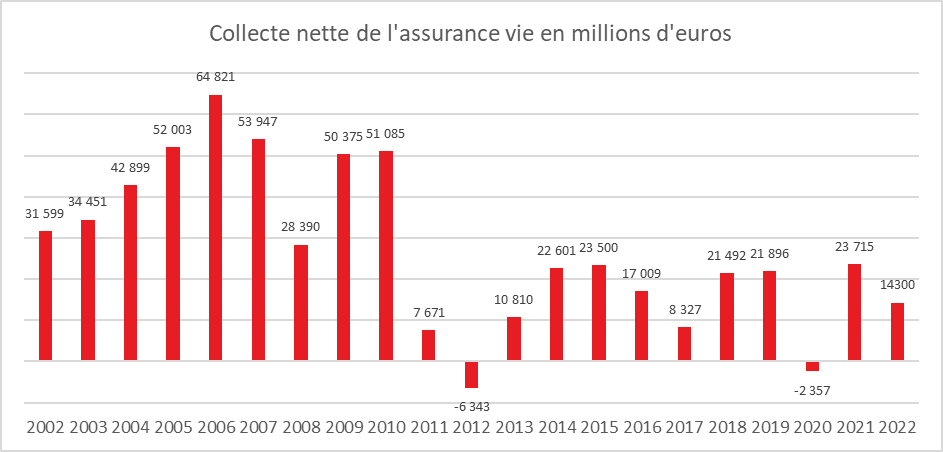
Des cotisations dynamiques et des prestations records
Les cotisations, sur l’ensemble de l’année 2022, sont restées dynamiques sur l’ensemble de l’année 2022 en s’élevant à 144,4 milliards d’euros tout en étant inférieures à leur niveau de 2021 (151 milliards d’euros). La part des unités de compte dans les cotisations s’est établie, malgré la chute du cours des actions, à 40 % sur l’année, après 39 % en 2021. Ce taux est le plus haut constaté lors de ces vingt dernières années.
Les prestations ont, de leur côté, atteint un niveau record à plus de 130 milliards d’euros. Si les ménages affectent une partie de leur épargne à l’assurance vie, ils sont également nombreux à effectuer des rachats. L’augmentation du nombre de décès en France, ces dix dernières années, expliquent, en partie, cette augmentation les prestations. Le nombre de décès est passé de 569 000 à 667 000 de 2012 à 2022. Par ailleurs, le nombre important des transactions immobilières, plus d’un million en 2022, peut également expliquer le volume élevé des rachats
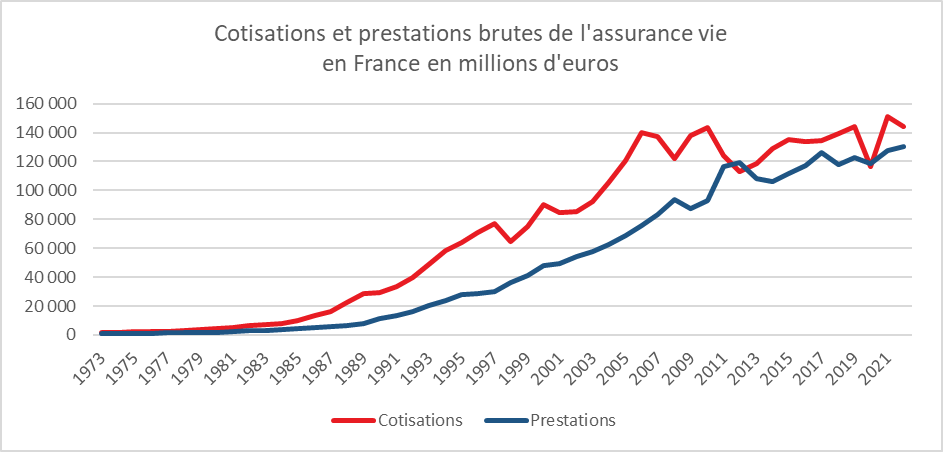
2022, une année hors normes
2022 a été une année atypique pour l’assurance vie. Pour la première fois depuis trente ans, le rendement des fonds euros est passé en-dessous de l’inflation. Les taux de l’épargne réglementée se sont rapprochés de ceux des fonds euros, voire les ont, net d’impôt, dépassés. Sur l’ensemble de l’année 2022, le taux du Livret A a été de 1,37 % quand ceux des fonds euros de l’assurance vie qui sont actuellement annoncés devraient se situer entre 1,8 et 2 % en brut soit entre 1,2 et 1,4 % en net. La publication des rendements 2022 des fonds euros étant postérieure à celle concernant les revalorisation des taux du Livret A n’a pas et d’effet en faveur de la collecte. En 2022, les fonds euros ont connu un processus de décollecte de 20,3 milliards d’euros traduisant un changement de modèle de l’assurance vie qui est désormais portée par les unités de compte (collecte nette positive de 34,6 milliards d’euros).
L’assurance vie termine l’année au petit trot
L’assurance vie a terminé l’année au petit trot avec une collecte nette de 300 millions d’euros qui a été rendue possible par la bonne tenue des unités de compte. La collecte nette de ces dernières a été de 3,5 milliards d’euros ; les fonds euros étant en décollecte de 3,2 milliards d’euros.
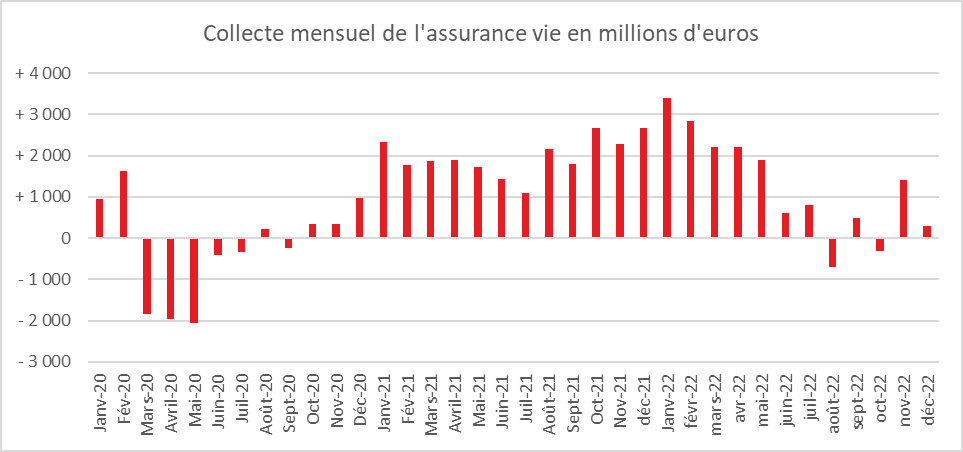
En décembre 2022, les cotisations en assurance vie s’établissent à 12,8 milliards d’euros dont 6,1 milliards d’euros au titre des unités de compte, soit 48 %. Les prestations se sont élevées de leur côté à 12,5 milliards d’euros
Un PER, toujours en pointe
Fêtant sa troisième année d’existence, le Plan d’Epargne Retraite confirme son succès avec 3,8 millions d’assurés et un encours de 48,4 milliards d’euros. Le nombre d’assurés au PER a augmenté de 1,3 million en 2022. Les sommes de versements ont fait, l’année dernière, jeu égal avec les transferts issus des anciens produits d’épargne retraite (8,8 milliards d’euros, contre 9,9 milliards d’euros). Les versements progressent néanmoins plus vite que les sommes issues des transferts (+30 % contre +14 %). Avec la gestion pilotée, la part des unités de compte est naturellement plus importante qu’en assurance vie (45 % contre 40 %).
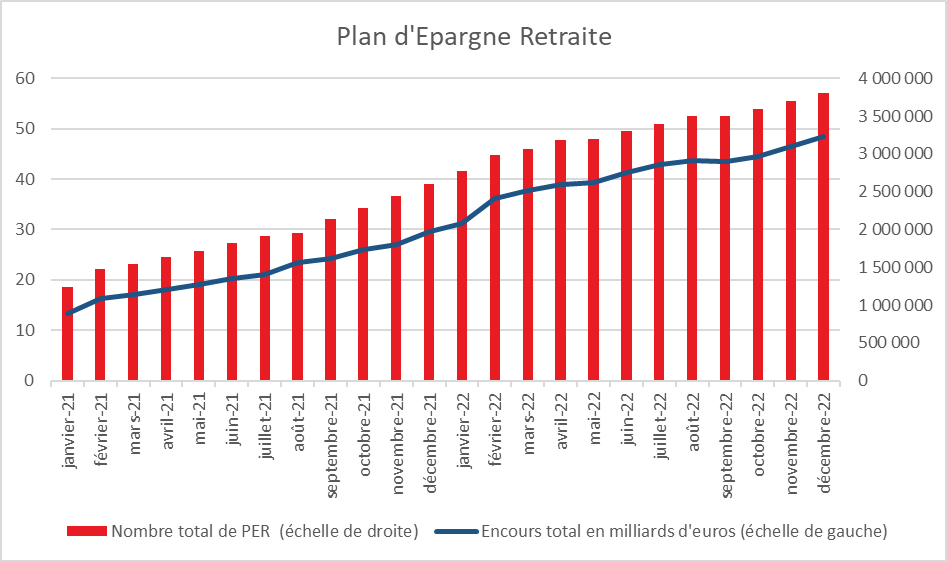
2023, une nouvelle séquence pour l’assurance vie ?
Avec l’annonce des rendements 2022, l’assurance vie clôt une période de vingt ans de baisse de ces derniers. En une génération, les contrats multisupports se sont imposés. Les unités de compte sont devenus au fil des mois depuis trois ans le moteur de la croissance de l’assurance vie au point de représenter près de la moitié de la collecte. Si dans les années 1990/2000, les épargnants achetaient de la garantie en capital, désormais ils acceptent des risques sur une part croissante de leurs cotisations. La remontée des taux d’intérêt constitue une bonne nouvelle pour les épargnants et pour les compagnies d’assurance. L’augmentation du rendement des fonds euros sera progressive compte tenu des effets d’inertie qui les caractérisent. Cette remontée devrait se traduire par le développement des fonds structurés et par le retour des fonds « eurocroissance » qui pour le moment n’ont pas rencontré le succès escompté.
En 2023, dans un contexte encore complique sur le plan du pouvoir d’achat, la collecte nette devrait se situer dans le prolongement de celle de 2022. Une baisse de l’engouement pour l’immobilier, en raison de la hausse des taux, devrait néanmoins profiter à l’assurance vie.
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
France, une croissance languissante mais toujours là
La France a enregistré, en 2022, une croissance de 2,6 %, faisant suite à la hausse de 6,8 % de 2021 et au recul sans précédent de 2021 de 7,9 %. Ce taux honorable est avant le produit de l’acquis de croissance généré par l’année 2021 qui avait été marquée par une accélération de l’activité en fin d’année. La croissance a été portée par l’investissement qui a été dopé par les plans de relance, la préparation des Jeux Olympiques et la transition énergétique. Les entreprises continuent également à rattraper le retard accumulé en matière d’investissement ces dernières années en particulier en matière d’équipements numériques. La croissance est, par ailleurs, alimentée par les importantes créations d’emploi.
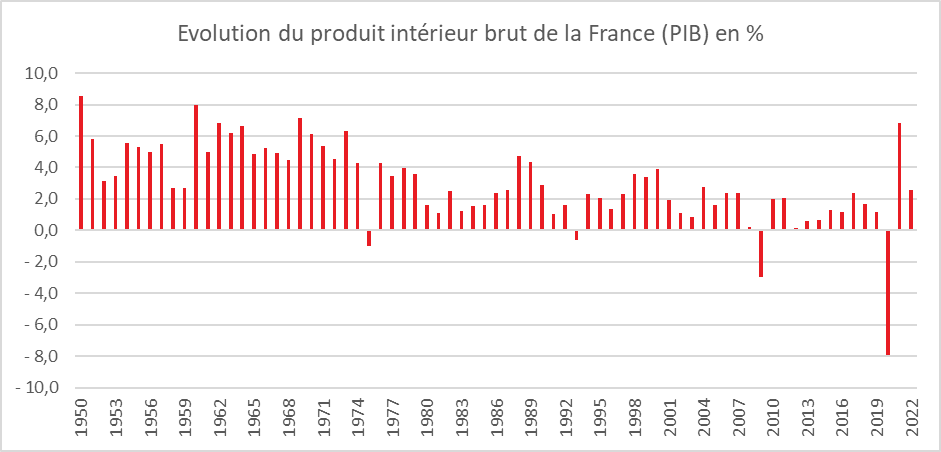
Au quatrième trimestre, une croissance sauvée sur le fil. Elle a été de 0,1 % au quatrième trimestre, après +0,2 % au troisième.
Depuis le dernier trimestre 2021, la croissance est étale. Si ce n’est le recul du premier trimestre, la croissance est restée positive mais proche de zéro. Au dernier trimestre, la consommation a pesé sur la croissance. Au quatrième trimestre, la demande intérieure finale (hors stocks) a contribué négativement à la croissance (‑0,2 point après +0,9 point). Les achats de biens par les ménages baissent fortement (‑1,9 % après ‑0,5 %).
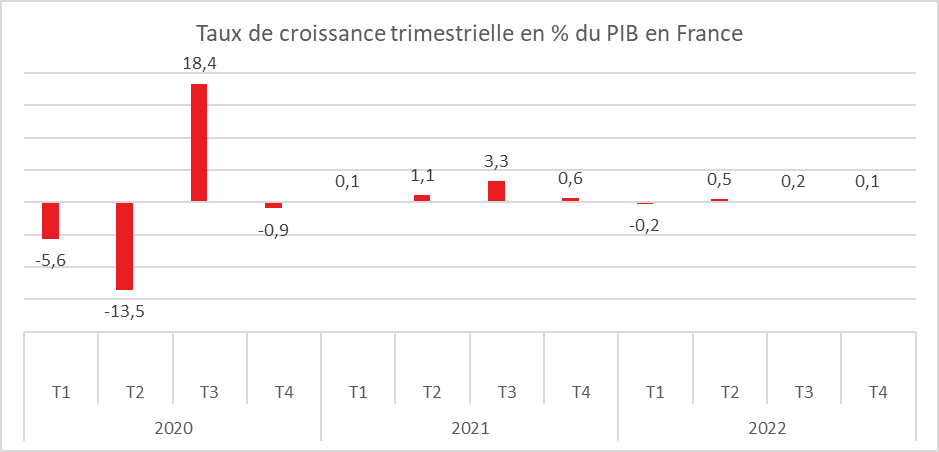
Le repli de la consommation s’explique par le recul des dépenses alimentaires
La consommation des ménages diminue de 0,9 % au quatrième trimestre (après +0,5 %). La consommation alimentaire recule pour le quatrième trimestre consécutif (‑2,8 % après ‑1,2 %). La consommation d’énergie se replie fortement (‑5,5 % après +0,3 %), du fait des températures clémentes et des économies réalisées par les ménages. La consommation des ménages en services est en hausse de 0,5 % (après +0,4 % au trimestre précédent). Cette légère accélération est portée par les services de transport (+2,0 % après +0,3 %).
L’investissement en ralentissement mais toujours positif
L’investissement ou formation brute en capital fixe totale (FCBF) a ralenti au quatrième trimestre (+0,8 % après +2,3 %). L’investissement est moins dynamique dans l’industrie (+1,2 % après +6,8 %), freinée en particulier par le recul de celui en matériels de transport (‑3,2 % après +19,1 %). La FBCF en services ralentit un peu ce trimestre (+0,6 % après +1,1 %), la FBCF en information-communication étant moins dynamique (+2,5 % après +4,8 %) tandis que celle en services immobiliers recule pour le deuxième trimestre consécutif (‑1,4 % après ‑3,7 %). La FBCF reste étale (+0,0 %, comme au troisième trimestre).
La production étale en fin d’année
La production totale est moins dynamique au quatrième trimestre 2022 (+0,2 % après +0,4 %). Dans l’industrie manufacturière, la production se replie (‑0,5 % après +0,6 %), avec une forte baisse de la production des raffineries (‑10,0 % après ‑0,2 %), en conséquence des grèves d’octobre, mais aussi des baisses dans les matériels de transport (‑0,7 % après +4,0 %) et les autres biens manufacturés (‑0,3 %, comme au trimestre précédent). Par ailleurs, la production d’énergie reste basse, toujours perturbée par les maintenances de réacteurs nucléaires. La production de services décélère quant à elle légèrement (+0,4 % après +0,5 %). Elle continue d’être portée par la production en services aux entreprises (+0,5 % après +0,8 %) et en information et communication (+1,9 % après +2,4 %), mais est notamment freinée par le recul de la production dans le commerce (‑0,3 % après +0,6 %), en lien avec la baisse de la consommation des ménages. À l’inverse, le commerce extérieur contribue positivement à la croissance du PIB (+0,5 point), après une contribution négative au trimestre précédent. Les importations diminuent fortement (‑1,9 % après +3,9 %), davantage que les exportations (‑0,3 % après +0,8 %).
Le commerce extérieur, facteur de croissance au dernier trimestre
La France devrait enregistrer un déficit commercial d’un montant historique en 2022 en raison d’une facture énergétique en forte augmentation et des difficultés persistantes de l’industrie. Les touristes étrangers et les services aux entreprises à l’internationale ont contribuer à réduire au niveau de la balance des paiements courants cet imposant déficit. Pour le dernier trimestre, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance (+0,5 point, après ‑1,0 point au trimestre précédent), grâce à un recul des importations plus important que celui des exportations.
Les exportations ont diminué au quatrième trimestre de ‑0,3 % après +0,8 %, pénalisées notamment par la contraction des exportations de produits manufacturés (‑1,8 % après +1,5 %), et en particulier de matériels de transport (‑1,8 % après +4,9 %). Ce recul est toutefois atténué par le rebond des exportations en énergie, eau, déchets (+32,6 % après ‑2,2 %), à la fois en hydrocarbures bruts et en électricité, et par la hausse des dépenses des touristes non-résidents en France.
Les importations se sont repliés de ‑1,9 % après +3,9 %. La chute des achats à l’étranger d’énergie, d’eau et de déchets explique en partie l’évolution des importations (‑17,9 % après +7,8 %). En raison des grèves du mois d’octobre, les importations de pétrole raffiné ont néanmoins augmenté (+9,7 % après +2,3 %). Les importations de biens fabriqués ont diminué (‑1,5 % après +2,7 %). Les importations de services restent en hausse (+0,6 % après +5,6 %), portées par les importations de services aux entreprises (+1,4 % après +0,7 %), quand que les importations en services de transport se replient légèrement (‑0,4 % après +14,2 %), de même que celles en service d’information et communication (‑0,3 % après +5,5 %). Enfin, les dépenses des résidents français à l’étranger se replient avec la fin des vacances estivales (‑4,0 % après +9,8 %).
La contribution des stocks négatives au dernier trimestre
La contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est négative ce trimestre (-0,2 point après +0,3 point au troisième trimestre). Les entreprises ont déstockés avec les fêtes de fin d’année et sont demeurées prudentes au vu des perspectives de croissance.
2023, croissance, les jeux sont ouverts
2023 ne pourra pas compter sur le même acquis de croissance que 2022 qui avait bénéficié de l’élan post-covid. L’acquis de croissance pour 2023 s’élève, en effet, à +0,3 %. De nombreuses incertitudes pèsent sur l’évolution de la conjoncture, l’inflation, la guerre en Ukraine, la Chine, etc. Malgré tout, la récession, histoire d’une chronique maintes fois annoncée pourrait être l’arlésienne des temps modernes. La résilience de l’économie pourrait déjouer les pronostics. La baisse des cours de l’énergie pourrait modérer plus vite que prévu l’inflation malgré la suppression de la ristourne sur les carburants. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à la croissance de l’économie comme les Jeux Olympiques de 2024 qui contraignent la finalisation des différents chantiers dans les prochains mois et le redémarrage économique de la Chine. Si celui-ci peut provoquer une hausse des prix de l’énergie, son effet d’entraînement sera positif pour l’ensemble de l’économie mondiale. L’emploi devrait continuer à jouer positivement en faveur de la croissance. Depuis 2019, plus d’un million d’emploi ont été créés ce qui conduit à une augmentation de la masse salariale. Enfin si le contexte économique s’éclaircit, le taux d’épargne pourrait baisser en cours d’année, ce qui favorisera la consommation. La croissance pourrait se situer entre 0,6 et 1 % en 2023, toute chose étant égale par ailleurs.
Les taux des livrets d’épargne réglementés en vigueur le 1er février 2023
Le 1er février, les taux des livrets réglementés seront les suivants
- Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire : 3 %
- Livret d’Epargne Populaire : 6,1 %
- Livret Jeune : 3 % + prime bancaire
- Compte d’Epargne Logement : 2,25 %
- Pour mémoire, depuis le 1er janvier le Taux du Plan d’Epargne Logement est de 2 %
Lire le décret publié au Journal Officiel du 29 janvier 2023
Le Coin des Epargnants du 28 janvier 2023 : en attendant la semaine prochaine…
Aux Etats-Unis, le ralentissement de la consommation a rassuré les investisseurs qui croient à la maîtrise relativement rapide de l’inflation. Le CAC 40 a gagné 1,22 % et a franchi à nouveau la barre des 7000 points et le S&P 500 plus de 3 % quand le Nasdaq a progressé de près de 5 %. L’indice américain des dépenses personnelles de consommation (PCE) n’a augmenté que de 0,1 % sur un mois en décembre, soit deux fois moins qu’attendu, et de 5 % sur un an, contre 5,5 % en novembre. Mesurée en excluant l’alimentation et l’énergie, la hausse est de 0,3 % sur un mois, comme anticipé, et à 4,4 % sur un an, en ralentissement rapport aux 4,7 % de novembre. L’ensemble des dépenses des ménages américains a diminué, signe d’une croissance plus faible pour 2023. Ces données confortent l’idée que la semaine prochaine, que la Réserve fédérale américaine (Fed) n’augmentera ses taux d’intérêt que de 25 points de base, après quatre relèvements de 75 points de base et un autre de 50 points de base.
Le 2 février sera également marquée par les réunions du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de celui de la Banque d’Angleterre (BoE). Christine Lagarde, la présidente de l’institution, a indiqué à plusieurs reprise sa volonté de lutter contre l’inflation. Une nouvelle hausse de 50 points de base des taux directeurs est donc probable. La BoE devrait opter pour un relèvement d’une même ampleur, les prix à la consommation ayant atteint 10,5 % sur un an en décembre, ceux des aliments et des boissons ayant augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 1977.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 27 jan. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 097,21 | +1,22 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 978,08 | +2,33 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 070,56 | +3,06 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 621,71 | +4,79 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 150,03 | +0,68 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 765,15 | -0,10 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 178,01 | +1,41 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 382,56 | +3,12 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 264,81 | +0,00 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,697 % | +0,077 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,235 % | +0,064 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,526 % | +0,029 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0856 | +0,003 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 930,27 | +0,22 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,72 | -0,70 % | 84,08 | 78,140 |
Protection des épargnants, une proposition de loi du Sénat en cours de discussion
La Commission des Finances du Sénat a adopté le 25 janvier 2023 une proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants des sénateurs. Cette proposition de loi résulte de la mission de contrôle sur la protection des épargnants créée, en 2020, sous l’autorité du rapporteur général de la Commission des finances Albéric de MONTGOLFIER qui fut remplacé, en 2021, par Jean-François HUSSON. La proposition de loi reprend les préconisations issues des travaux de cette commission avec comme objectif de rendre plus transparentes les pratiques tarifaires des intermédiaires du marché de l’épargne. Les auteurs de la proposition de loi souhaitent agir sur les frais des produits et sur les commissions perçues par les intermédiaires, même si, dans ce domaine, de nombreuses règles relèvent du niveau européen et que la France se situent dans la moyenne des Etats membres de l’Union européenne. Les auteurs de la proposition de loi entendent par ailleurs accroître la concurrence afin d’obtenir une baisse des frais. Ils demandent enfin un contrôle accru des intermédiaires du marché de l’épargne pour renforcer la protection des épargnants.
Les différents articles de la proposition de loi
L’article 1er interdit la perception de commissions de mouvement, qui correspondent aux commissions perçues, en plus des frais d’intermédiation, à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille de l’épargnant
L’article 2 introduit au sein du code des assurances une définition spécifique de l’arbitrage en assurance vie – conditions d’accès, modalités de conclusion du mandat, obligations des mandataires envers les mandants.
L’article 3 rend obligatoire, pour les distributeurs d’assurance vie et de plans d’épargne retraite, de lister les produits indiciels cotés à bas coût disponibles à la souscription. Cette transparence vise à favoriser la distribution des produits les moins onéreux.
L’article 4 confie au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) le soin de suivre l’évolution des pratiques tarifaires des entreprises d’assurance, afin que les épargnants puissent disposer d’une information accessible et compréhensible du « coût complet » de l’assurance vie.
L’article 5 permet aux détenteurs de plans d’épargne en actions (PEA) de ne pas perdre l’avantage fiscal attaché à ce produit lors de l’acquisition de titres inéligibles, dès lors que le gestionnaire du plan n’a pas mis en place de procédures permettant de bloquer l’acquisition de tels titres. Les détenteurs disposeraient alors d’un délai de deux mois pour rectifier leur situation.
L’article 6 renforce la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital des petites et moyennes entreprises, dite réduction d’impôt « Madelin ». Le taux de la réduction d’impôt est porté de 18 % à 25 % et, à titre dérogatoire, à 30 % jusqu’en 2026. Il s’agit ainsi, d’une part, d’encourager les épargnants à mobiliser leur épargne au profit des entreprises et, d’autre part, de compenser le rehaussement des seuils de taille critique devant être atteints par les fonds fiscaux pour être agréés. En effet, des fonds de taille trop limitée désavantagent les épargnants, que ce soit en termes de produits offerts, de risque ou encore de frais.
L’article 7 vise à garantir une réelle transférabilité interne et externe de l’assurance vie. Le présent article sécurise le droit au transfert interne à une compagnie en indiquant qu’il doit être réalisé sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert. Sur la transférabilité externe, la Commission des finances a limité le texte d’origine en la limitant aux contrats de plus de 8 ans. Le transfert doit être global pour être accepté.
L’article 8 prolonge jusqu’en 2026 le bénéfice de l’incitation fiscale mise en place par la loi « Pacte » pour transférer les sommes investies dans un contrat d’assurance vie vers un plan d’épargne retraite (PER). Cette prorogation, qui doit encourager la poursuite de la migration de l’assurance vie vers les produits d’épargne retraite, incitera les épargnants à préparer au mieux leur départ de la vie active. Cette possibilité de transfert est tombé le 1er janvier 2023.
L’article 9 confie à la Caisse des dépôts et des consignations la gestion administrative et financière d’un fonds de fonds indiciels cotés, qui serait ensuite distribué dans les plans d’épargne retraite (PER). Il fait partie des produits qui devront être présentés et référencés par les gestionnaires des PER en vertu de l’article 3 de la présente proposition de loi. Le développement de ce produit est avant tout destiné à offrir une option accessible à tous les épargnants. Il doit également permettre de stimuler la concurrence sur le marché des PER afin de baisser les frais moyens de ces produits.
L’article 10 confie à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) le contrôle de l’honorabilité des dirigeants et des salariés des intermédiaires ayant l’obligation de s’immatriculer auprès de ce registre. Ce contrôle incombe aujourd’hui aux employeurs de ces salariés, qui ne disposent pas des mêmes prérogatives pour s’assurer de l’honorabilité de ces intermédiaires. À l’initiative de la commission des finances, le Sénat avait déjà proposé de confier cette mission à l’Orias dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.
A l’article 11, La commission des finances du Sénat n’a pas retenu le projet de création défendu par les auteurs de la proposition de loi d’une nouvelle catégorie d’intermédiaires, les intermédiaires en immobilier. L’objectif était de renforcé le contrôle de l’ensemble des acteurs impliqués dans La Commission a en revanche adopté la disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement une évaluation de l’opportunité de confier le contrôle de ces intermédiaires et de leurs communications promotionnelles à l’Autorité des marchés financiers, ainsi que des moyens financiers, humains et budgétaires qui lui seraient nécessaires pour assurer cette nouvelle mission, à l’image de ce qui existe déjà pour les biens divers.
L’article 12 soumet enfin l’ensemble des acteurs du financement participatif à l’obligation de transmettre annuellement – à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l’Autorité des marchés financiers selon leur statut – les informations relatives aux projets pour lesquels ils ont servi d’intermédiaires, ainsi que les montants collectés. Cette transmission doit permettre aux régulateurs de mieux s’assurer que ces acteurs respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dans un contexte de fort développement des « cagnottes en ligne ».
La proposition de loi sera discutée, au Sénat en séance le 31 décembre 2023 avant d’être discuté à l’Assemblée nationale.
Le Livret A signe une de ses plus belles années en 2022
2022, la deuxième plus forte collecte de l’histoire du Livret A
Avec une collecte positive de 1,45 milliard d’euros en décembre, le Livret A signe, en 2022, sa deuxième meilleure année de son histoire. La collecte annuelle a, en effet, atteint, selon les données de la Caisse des Dépôts et Consignation, 27,23 milliards d’euros. Seule l’année 2012 fait mieux (28,16 milliards d’euros), année qui fut marquée par le relèvement du plafond à 22 950 euros et par la crise des dettes souveraines. En 2022, le Livret A aura donc enregistré une collecte supérieure à celle de 2020, l’année de la crise sanitaire (26,39 milliards d’euros).
La valeur refuge consacrée
Le contexte anxiogène en lien avec la guerre en Ukraine et la résurgence de l’inflation ainsi que les deux relèvements du taux rendement ont contribué aux excellents résultats du Livret A. En période de troubles et d’incertitudes, les Français épargnent en privilégiant la valeur refuge que représente le Livret A. Malgré l’érosion du pouvoir d’achat, les ménages ont maintenu un taux d’épargne élevé durant toute l’année. Ce dernier n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire.
L’augmentation de l’épargne de précaution au début des vagues inflationnistes est traditionnelle, les ménages craignant de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour faire face aux dépenses de demain et d’après-demain. Tout relèvement du taux du Livret A dope la collecte le mois de l’annonce et les deux ou trois mois qui suivent. En 2022, ce phénomène s’est une fois de plus vérifié.
Un rendement réel pourtant négatif
Le deux relèvement de son taux n’ont pas permis au Livret A de compenser les effets de l’inflation. Il n’aura pas complètement protégé les épargnants des effets de la hausse des prix. Sur l’année, son rendement moyen a été de 1,37 % quand l’inflation a été de 5,2 %. Le rendement réel a donc été négatif de 3,8 points. Malgré tout, à l’exception du Livret d’Epargne Populaire, le Livret A figure parmi les produits de taux avec garantie du capital qui ont offert en 2022 une des meilleure protection face à l’inflation.
Le LDDS, une collecte mesurée mais un encours au plus haut
Le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré, en 2022, une collecte de 6,26 milliards d’euros. Il s’agit de sa quatrième meilleure année. Le LDDS est plus tributaire des besoins de liquidités des ménages au quotidien en étant l’antichambre du compte courant. Le Livret A est considéré plus que le LDDS comme un placement d’épargne même si les deux produits obéissent aux mêmes règles.
Des encours au sommet
L’encours du Livret A bat un nouveau record, en fin d’année, avec près de 375,5 milliards d’euros. Le montant des intérêts capitalisés s’est élevé à 4,83 milliards d’euros.
L’encours du LDDS a atteint également, en fin d’année, un nouveau sommet à 134,3 milliards d’euros. Les intérêts capitalisés ont atteint 1,73 milliard d’euros.
L’encours du LDDS et du Livret A s’élevait à 509,7 milliards d’euros, contre 469,7 milliards d’euros fin 2021. En décembre 2012, l’encours cumulé était de 342,6 milliards d’euros. En dix ans, cet encours a progressé de près de 50 % (48,7 %.
Décembre 2022, le Livret A et le LDDS terminent sur les chapeaux de roue
Décembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Lors de ces dix dernières années, cinq décollectes ont été enregistrées. En 2021, elle avait été de 1,7 milliard d’euros. La collecte moyenne de ces dix dernières années (hors 2022) était négative. Logiquement, décembre rime avec dépenses de fin d’année. En 2022, la collecte a été de 1,45 milliard d’euros. Seule l’année 2012 (2,7 milliards d’euros) a connu une collecte du Livret A plus élevée lors de ces quinze dernières années. Le LDDS a également enregistré une forte collecte en décembre avec 1,24 milliard d’euros.
En cette fin d’année, les ménages ont opté pour la prudence, l’attentisme et la frugalité. Il est également possible que les préannonces d’un relèvement du taux du Livret A et LDDS aient joué en leur faveur.
Un début d’années sous de bons auspices
Le début d’année 2023 devrait être encore favorable aux couleurs du Livret A et du LDDS qui profiteront sans nul doute du relèvement de leur taux, relèvement qui sera effectif à compter du 1er février 2023.
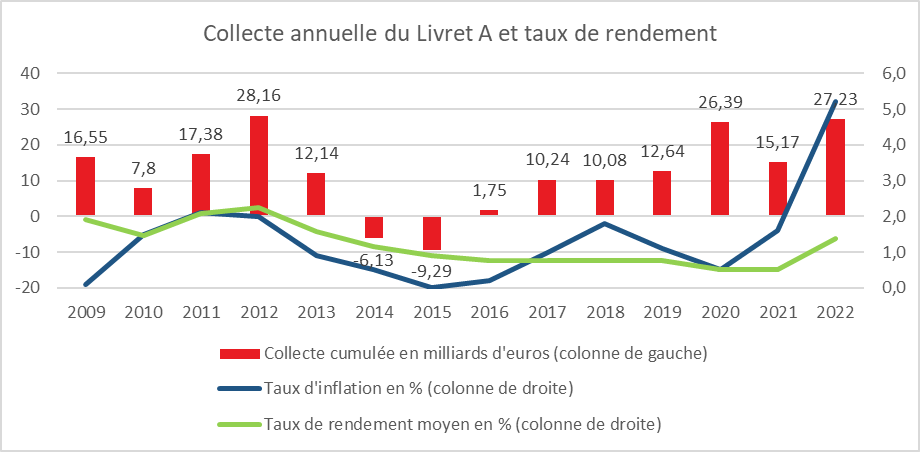
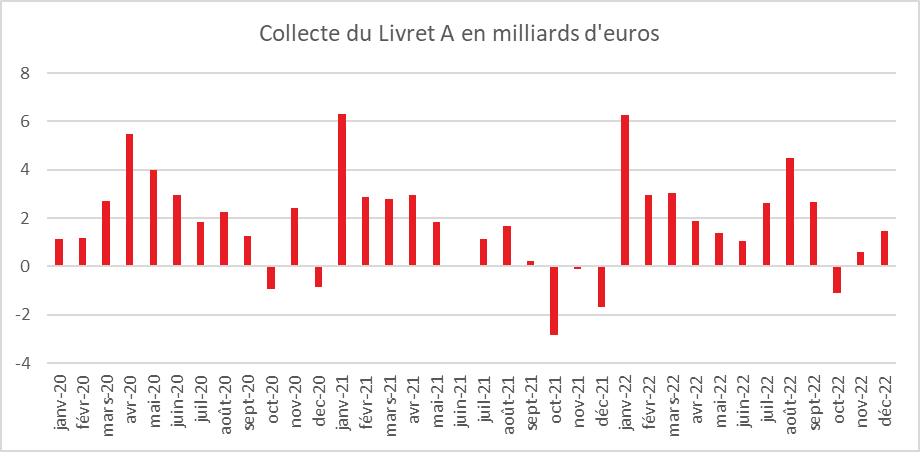
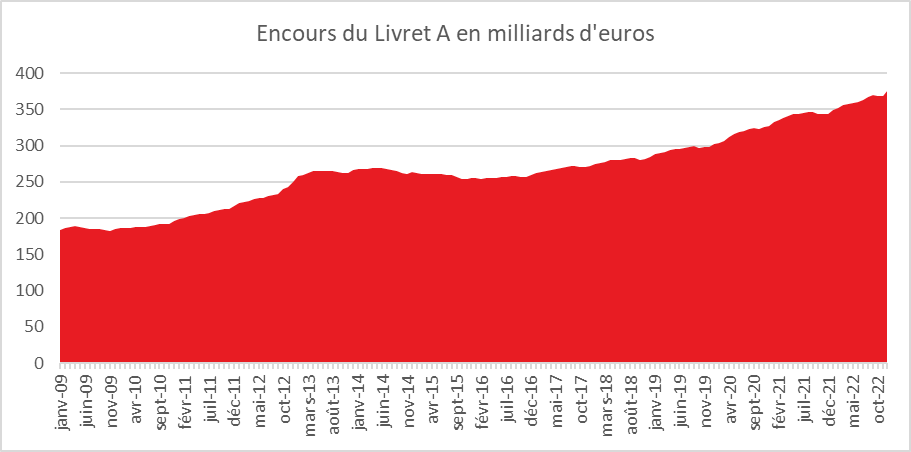
Le Coin des Epargnants du 21 janvier 2023 : au temps des doutes
Rappel à l’ordre des marchés à Davos
A Davos, la secrétaire générale du FMI, Kristalina Georgieva et la Présidente de la Banque Centrale Européenne ont tenu à refroidir l’optimisme des investisseurs qui, ces derniers jours, voulaient croire que la fin de la bataille contre l’inflation était pour demain. La secrétaire générale du FMI a ainsi précisé que si avec sa réouverture, la Chine soutiendra la croissance de l’économie mondiale, elle provoquera par un accroissement de la demande une hausse des cours de l’énergie et des matières. Christine Lagarde a été dans le même sens, en rappelant que la fin de la politique du zéro covid renforcera les pressions inflationnistes. Elle a affirmé à plusieurs reprises que la BCE doit « maintenir le cap » dans sa lutte contre l’inflation, message également martelé par la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard. Ces deux dirigeantes ont souligné que le coût du crédit restera élevé pendant un certain temps. Ces propos ont provoqué un repli des indices « actions » en milieu de semaine. L’indice CAC 40 qui a ainsi enregistré sa première baisse hebdomadaire de l’année est ainsi repassé en-dessous des 7000 points. Après une remontada engagé à la fin de l’année 2022, des signes d’essoufflement se font ressentir. Les craintes d’une prochaine récession sont à nouveau à l’ordre du jour (indicateurs PMI en baisse). Les tensions sur les places financières se manifestent par un regain de la volatilité. Aux Etats-Unis, la multiplication des annonces concernant des plans de licenciement chez les géants du numérique laisse présager une nette décélération de l’activité. Les résultats de nombreuses entreprises pour le quatrième trimestre 202 sont attendus à la baisse dans les prochains jours pouvant amener à un recul des cours.. La menace d’un défaut américain faute d’un accord politique sur le relèvement du plafond de la dette ne fait que renforcer les incertitudes concernant l’économie américaine et pourrait peser sur le moral des investisseurs.
Pour le moment l’Europe n’en finit pas l’heure de l’arrivée de la récession. L’inflation semble avoir atteint un sommet et l’activité économique résiste malgré un contexte difficile. La BCE a ainsi indiqué que la France pourrait échapper à la récession en 2023. Cette résilience incite es investisseurs à privilégier les valeurs européennes. Pour la première fois en près d’un an, les fonds investis sur les Bourses d’Europe ont enregistré une collecte nette positive de 200 millions de dollars la semaine dernière, selon Bank of America, alors que les fonds investis à Wall Street subissaient leur troisième semaine consécutive de sorties. Après avoir été injustement délaissés, les indices européens bénéficient, depuis quelques semaines, d’un engouement peut être exagéré. Une correction à la baisse est possible en cas de rebond d’ici le printemps de l’inflation et au moment de l’annonce des résultats des entreprises. Les traders de Bank America sont de loin les plus pessimistes tablant sur un recul de 20 % des indices européens d’ici l’été.
Si cette semaine, un léger ajustement s’est produit sur les marchés « actions », les taux des obligations d’Etat n’ont pas, en revanche, bougé d’un iota sur la semaine.
.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 20 jan. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 995,99 | -0,45 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 375,49 | -3,06 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 972,61 | -1,18 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 140.43 | +0,10 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 033,56 | -0,35 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 770,59 | -1,02 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 119,90 | -0,78 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 26 553,53 | +1,59 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 261,46 | +2,17 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,620 % | -0,012 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,171 % | +0,007 pt | +2,564 % | –0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,497 % | +0,016 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0837 | +0,086 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 924,23 | +0,30 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,91 | +0,83 % | 84,08 | 78,140 |
La France vieillit
Plus de seniors, moins d’enfants, plus de décès et moins de naissances, la France vieillit. Cette évolution sans surprise modifie néanmoins année après année la structure de la population.
Une croissance de la population en voie de ralentissement
Dans les années, la France comptait, selon l’INSEE, une cinquantaine de millions d’habitants, au 1er janvier 2023, ce nombre atteint 68,0 millions d’habitants, 65,8 millions résident en France métropolitaine et 2,2 millions dans les cinq départements d’outre-mer. La population augmente de 0,3 % en 2022, après + 0,4 % en 2021 et + 0,3 % en 2020.
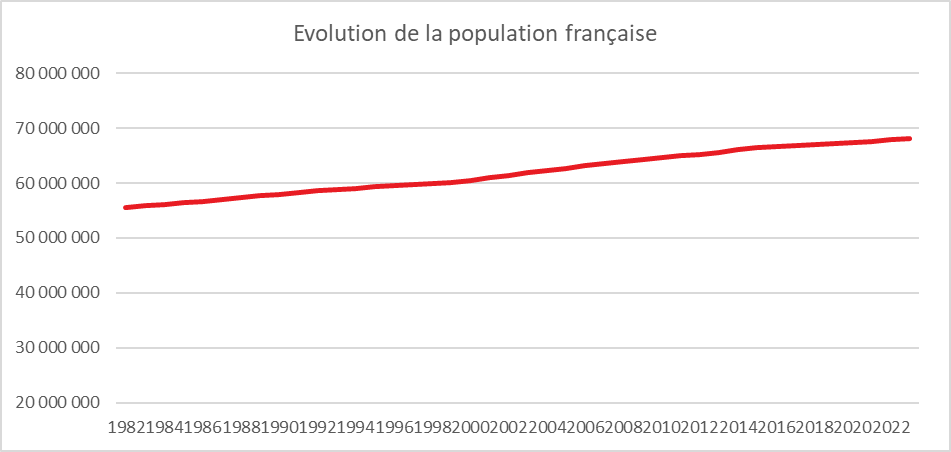
Un solde naturel de plus en plus ténu
En 2022, le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, atteint son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à + 56 000. Il avait déjà atteint en 2020 un niveau historiquement bas du fait de la forte hausse du nombre de décès due à l’épidémie de Covid‑19. Remonté en 2021 grâce au rebond du nombre de naissances et à une baisse du nombre de décès, il est à nouveau orienté à la baisse en 2022. Le solde migratoire a été évalué par l’INSEE à + 161 000 personnes. Trois quarts à la hausse de la population proviendraient du solde migratoire.
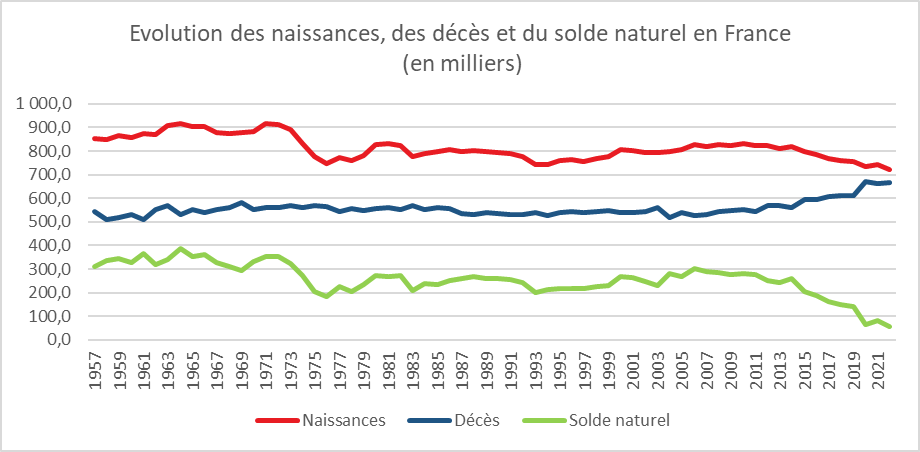
La France, le deuxième pays le plus peuplé de l’Union européenne
Au 1er janvier 2021, la France représente 15 % de la population de l’Union européenne à 27 pays. Elle occupe le deuxième rang au sein de l’Union européenne par son poids démographique, derrière l’Allemagne (19 %). Ce dernier pays plafonne depuis quatre ans à 83 millions d’habitants. Sans apport migratoire, l’Allemagne enregistrerait une décrue de sa population. Cette dernière devrait être amenée à se contracter dans les prochaines années quand celle de la France continuera à augmenter jusqu’en 2044 avant de décliner.
Le natalité en berne
En 2022, 723 000 bébés sont, selon l’INSEE, nés en, soit 19 000 de moins qu’en 2021 (– 2,6 %). Entre 2015 et 2020, les naissances ont été chaque année de moins en moins nombreuses. En 2021, un rebond avait été constaté après la forte contraction de 2020 marquée par la crise covid. La reprise de la natalité a été éphémère.
Le renouvellement des générations n’est plus assuré
En 2022, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) s’élevait, selon l’INSEE, à 1,80 enfant par femme, en baisse, après 1,84 en 2021. Il avait diminué chaque année entre 2015 et 2020, avant d’augmenter en 2021 toujours en rebond de 2020.
L’âge moyen à la maternité est de 31,0 ans en 2022, contre 29,4 ans en 2002. Le taux de fécondité des femmes de moins de 30 ans baisse depuis les années 2000. Cette diminution s’accentue depuis 2015 Après avoir augmenté, le taux de fécondité des femmes de 35 à 39 ans est également orienté à la baisse.
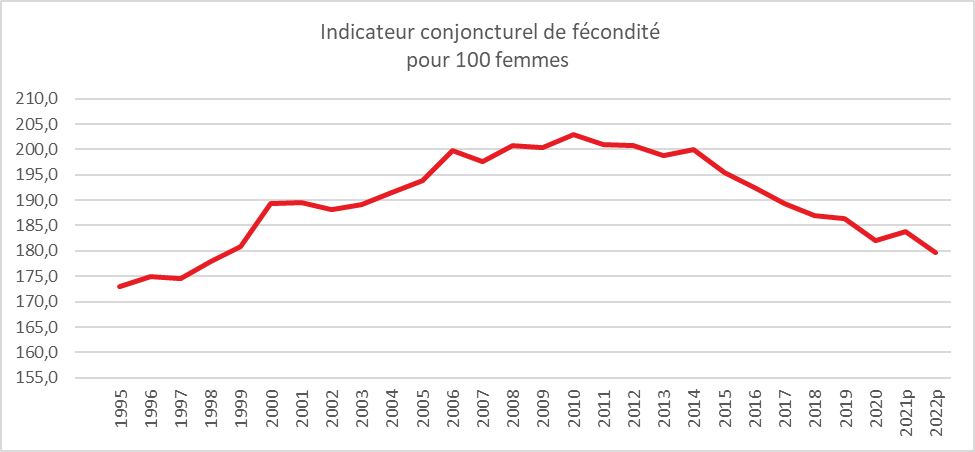
En 2020, la France est le pays de l’Union européenne est le pays plus fécond (ICF de 1,82), suivie par la Roumanie (1,80). Trois pays ont des ICF inférieurs à 1,3 : Malte, l’Espagne et l’Italie. L’Allemagne se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne, 1,53, contre 1,50.
Un nombre de décès toujours en nette hausse
Le vieillissement de la population, l’épidémie de covid et les canicules expliquent la forte croissance du nombre décès en France. En 2022, 667 000 personnes sont, selon l’INSEE, décédées en France, soit 5 000 de plus qu’en 2021 et à peine moins qu’en 2020 (– 2 000). Par rapport à 2019, le surcroit de décès est de 54 000, soit l’équivalent d’une ville moyenne française. L’arrivée des générations nombreuses du baby‑boom à des âges de forte mortalité tend naturellement à accroître le nombre de décès (+ 0,7 % par an en moyenne entre 2004 et 2014, puis + 1,9 % entre 2014 et 2019). La pandémie est responsable de 48 000 décès en plus en 2020. En 2021, elle est à l’origine d’un surcroit de décès de 43 000 L’épidémie de grippe et les trois périodes de canicule (mi‑juin, du 10 au 25 juillet et la première quinzaine d’août) ont occasionné également un plus grand nombre de décès.
L’espérance de vie toujours inférieure à celle de 2019
En 2022, l’espérance de vie à la naissance s’élevait, selon l’INSEE, à 85,2 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour les hommes. Par rapport à 2021, les hommes ont gagné 0,1 an d’espérance de vie quand pour les femmes, cette dernière est restée stable. En raison de sa forte baisse en 2020 (− 0,5 an pour les femmes, − 0,6 an pour les hommes), l’espérance de vie en France est inférieure de 0,4 an à celle de 2019, pour les femmes comme pour les hommes.
En 2021, l’espérance de vie, en France, est supérieure de plus de deux ans à la moyenne de l’Union européenne (82,8 ans pour les femmes, 77,2 ans pour les hommes).
En France, plus de 20 % de la population a plus de 65 an
Au 1er janvier 2023, en France, 21,3 % des habitants ont 65 ans ou plus. Depuis plus de trente ans, cette proportion est en hausse constante. Avec l’arrivée à ces âges des générations nombreuses du baby‑boom, le vieillissement s’accélère. Ce constat est partagé par tous les pays de l’Union. En 2021, les personnes de 65 ans ou plus représentent 20,8 % de la population de l’Union, contre 17,8 % en 2011. Leur part est supérieure à 22 % en Italie, en Finlande, en Grèce, au Portugal et en Allemagne.
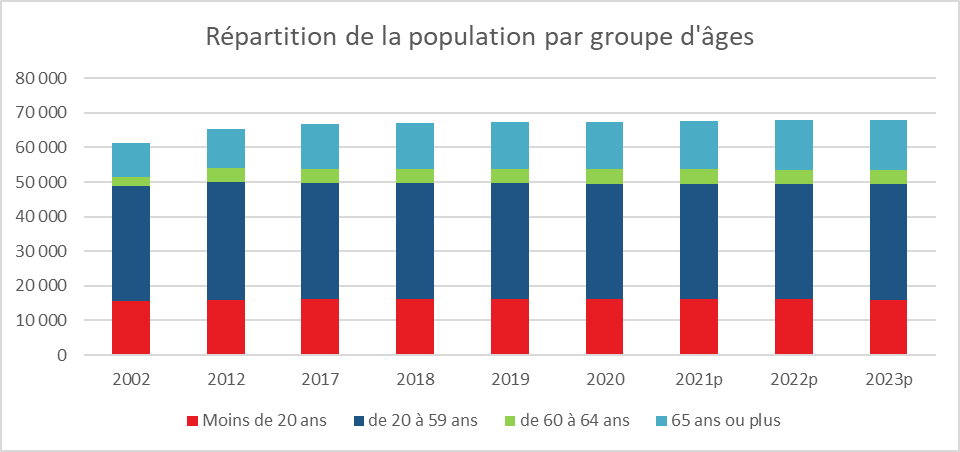
Les mariages en mode rattrapage
En 2022, 244 000 mariages ont été célébrés dont 237 000 entre personnes de sexe différent et 7 000 entre personnes de même sexe. Ce nombre est le plus élevé depuis 2012. Après une année 2020 marquée par un recul historique (– 31 % par rapport à 2019), un phénomène de rattrapage est en cours.
L’âge moyen des mariés de sexe différent continue à augmenter. Il est de 37,2 ans pour les femmes (+ 0,4 an) et de 39,6 ans pour les hommes (+ 0,3 an). Pour les couples de même sexe, l’âge au mariage est toujours supérieur à celui des conjoints de sexe différent mais a tendance à diminuer depuis 2013, première année d’ouverture du mariage aux conjoints de même sexe (à l’exception de 2020). En 2022, il est de 38,5 ans pour les femmes (+ 0,9 an), et de 44,0 ans pour les hommes (stable par rapport à 2021).
En 2021, 209 000 pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus, soit une hausse de 20 % par rapport à 2020. Cette hausse s’inscrit dans le processus de rattrapage après la chute du nombre de PACS en 2020 de 11 %. En revanche, pour 2022, une première évaluation semble indiquer une baisse de 8 %
Le Coin des Epargnants : les marchés actions en plein boom
Les bourses à la fête
Les grandes places financières européennes ont progressé lors des douze des quinze dernières semaines. Le CAC 40 a terminé la séance du vendredi 13 janvier au-dessus de 7 000 points Depuis le début de l’année, la hausse est supérieure à 8,5 %. Sur trois mois, elle atteint près de 20 %. Le marché new-yorkais a également poursuivi sur la lancée de la semaine dernière, le Nasdaq progressant plus de 4 % et le S&P 500 de plus de 2 %.
La récession crainte, en Europe, pour la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023 est reportée à plus tard ou à jamais. Selon les premiers résultats publiés par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), l’Allemagne aurait enregistré en 2022 une croissance de son PIB de 1,9 %. Ce résultat marque une décrue par rapport à 2021 (2,6 %). Il est également inférieur à la moyenne de la croissance attendue pour l’Union européenne qui devrait être supérieure à 3 %. Le PIB allemand est, fin 2022, plus élevé de 0,7 % par rapport à son niveau de 2019, avant le début de la crise du Covid. En France, la Banque de France a, dans sa dernière enquête de conjoncture, souligné que l’économie avait continué à croître au dernier trimestre de l’année dernière. L’inflation semble avoir atteint un plafond dans plusieurs pays permettant des hausses moins importantes des taux directeurs des banques centrales, ce qui a été salué par les marchés « actions ». Aux États-Unis, la composante des anticipations d’inflation à un an est retombée à 4 %, au plus bas depuis avril 2021, contre 4,4 % en décembre et 4,3 % anticipé par les analystes
Aux États-Unis, les investisseurs ont réagi négativement aux résultats décevants de certaines banques comme JPMorgan Chase ou Wells Fargo. En revanche, ils ont été rassurés par la confiance du consommateur américain qui s’est améliorée en janvier, selon la première estimation de l’Université du Michigan, en hausse de 8,9 points à 64,6 pour le mois de janvier. Ils anticipent également un ralentissement du mouvement de hausse des taux directeurs.
Le baril de pétrole était orienté à la hausse cette semaine retrouvant ainsi son niveau de la fin de l’année dernière à plus de 80 dollars. La hausse s’explique par les perspectives d’ouverture de la Chine mettant un terme à la politique du zéro covid. Les experts s’attendent à une croissance de la demande émanant de la Chine de 1 à 1,5 million de barils jour. Les fêtes du Nouvel An chinois devraient s’accompagner d’importants déplacements à l’intérieur du territoire. L’annonce de l’augmentation des stocks de brut américains n’a pas eu, en revanche, d’effet sur les cours. Les stocks ont augmenté de19 millions de barils supplémentaires, une hausse exceptionnelle due aux ruptures d’activité des raffineries ces dernières semaines en raison d’une tempête hivernale fin décembre. Si cette augmentation n’a pas provoqué de hausse sur les cours, la raison provient de la forte diminution au recours par les autorités américaines aux réserves stratégiques. Depuis un an et demi, elles ont pour peser sur les cours puisé dans ces réserves stratégiques. Depuis le mois de mars, la quantité injectée sur les marchés dépasse 200 millions de barils. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a indiqué que désormais le processus de retour à la normale est engagée, la ponction dans les réserves stratégiques étant passée de plusieurs millions de barils par semaine à 800 000 barils. L’arrêt du recours aux réserves stratégiques pourrait provoquer un rebond de 5 à 7 dollars du prix du baril.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 13 jan. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 023,50 | +2,40 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 302,61 | +1,75 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 999,09 | +2,59 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 079,16 | +4,47 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 086,52 | +3,26 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 844,07 | +1,88 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 151,33 | +3,31 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 26 119,52 | +1,83 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 195,31 | +1,19 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,632 % | -0,088 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,164 % | -0,042 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,481 % | -0,097 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0827 | +1,26 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 916,93 | +2,46 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84,81 | +8,23 % | 84,08 | 78,140 |
Le taux du Livret A à 3 % au 1er février 2023 : analyse du Cercle de l’Epargne
Le Livret A occupe une place à part dans l’imaginaire de l’épargne Possédé par quatre Français cinq (55 millions de livrets en circulation), il est de loin le premier produit d’épargne du moins en nombre. Son encours de 369,1 milliards d’euros (novembre 2022 – source Caisse des Dépôts et Consignation) le place loin derrière l’assurance vie (1856 milliards d’euros en novembre – source France Assureurs). Le succès du Livret A repose sur un triptyque : sécurité, liquidité et zéro fiscalité. Le Livret A est garanti par l’Etat ; l’épargnant peut entrer et sortit à sa guise et ne supporte ni impôt, ni prélèvement sociaux. Le Livret A est le produit phare de l’épargne de précaution que chaque Français connaît depuis son enfance.
Les taux des produits d’épargne réglementée sont fixés selon les dispositions prévues par l’arrêté du 27 janvier 2021.
Jusqu’en 2004, la fixation du taux des livrets de l’épargne réglementée relevait du pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Economie. Afin de mieux protéger les épargnants et de dépolitiser le débat, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a décidé l’adoption d’une formule reposant sur des paramètres économiques et financiers. La formule ne fut pas à plusieurs reprises respectées ; elles fut également modifiée plusieurs fois.
Le taux du Livret A a atteint un point bas le 1er février 2020 à 0,5 %, son record date d’octobre 1981 à 8,5 % en pleine inflationniste.
1. Les règles de fixation du taux du Livret A et du LDDS
Les taux des produits d’épargne réglementée sont fixés selon les dispositions prévues par l’arrêté du 27 janvier 2021.
Jusqu’en 2004, la fixation du taux des livrets de l’épargne réglementée relevait du pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Économie. Afin de mieux protéger les épargnants et de dépolitiser le débat, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait retenu une formule reposant sur des paramètres économiques et financiers. À plusieurs reprises, les gouvernements n’ont pas retenu les résultats de la formule qui a connu, par ailleurs, plusieurs évolutions.
Le taux du Livret A a atteint un point bas le 1er février 2020 à 0,5 %. Son record date d’octobre 1981 à 8,5 % en pleine vague inflationniste.
Le taux est logiquement révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. En vertu de la formule en vigueur, il est égal à :
a) La moyenne arithmétique entre :
– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;
– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages ;
b) 0,5 % qui joue le rôle de taux plancher.
En synthèse, le taux du Livret A correspond à la moyenne de l’inflation et du principal taux des marchés monétaires des six derniers mois.
Les données utilisées sont celles relatives au dernier mois pour lequel ces données sont connues. La composante « inflation » qui entre dans le calcul du taux du Livret A correspond à la moyenne arithmétique, sur 6 mois, des glissements annuels de l’IPC hors tabac (IPCHT).
En cas de circonstances exceptionnelles, afin de préserver le pouvoir d’achat des épargnants, le Gouverneur peut transmettre au ministre de l’Économie un avis et des propositions de taux dérogeant à la règle.
Le gouverneur peut également, entre les deux modifications traditionnelles, prévoir une révision du taux du Livret A. Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l’inflation ou des marchés monétaires le justifie, son gouverneur peut, en effet, proposer au ministre chargé de l’Économie de réviser les taux au 1er mai ou au 1er novembre.
2. La situation économique et financière pour la révision du 1er février 2023
Après avoir été à son niveau plancher de 0,5 % du 1er février 2020 au 1er février 2022, qui était également son niveau le plus bas depuis sa création en 1818, le taux du Livret A a connu, en 2022, deux hausses le portant successivement à 1 % le 1er février puis à 2 % le 1er août. Ces relèvements étaient avant tout imputables à la remontée de l’inflation qui est passée de 1,6 % en 2021 à 5,2 % en 2022. La résurgence de l’inflation a été plus marquée au second semestre 2022 qu’au premier.
Le relèvement du 1er février sera la troisième en douze mois. Le mouvement de hausse est le plus rapide de l’histoire du Livret A.
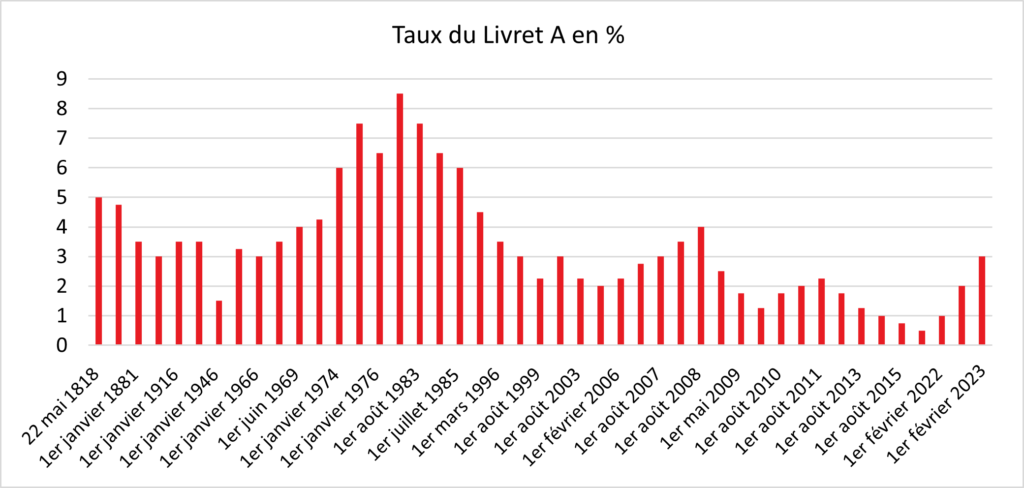
3. Le rendement réel du Livret A reste négatif
Sur l’ensemble de l’année 2022, compte tenu des relèvements de la rémunération du placement, le taux moyen du Livret A a été de 1,37 % soit moins que l’inflation qui s’est élevée à 5,2 %. Le rendement réel a donc été négatif de près de 4 % (3,83 %). Il faut remonter aux années 1980 pour retrouver une tel rendement négatif.
En passant à 3 % au 1er février avec une inflation attendue à 5,5 %, le rendement réel devrait du Livret A rester négatif mais dans une moindre proportion qu’en 2022.
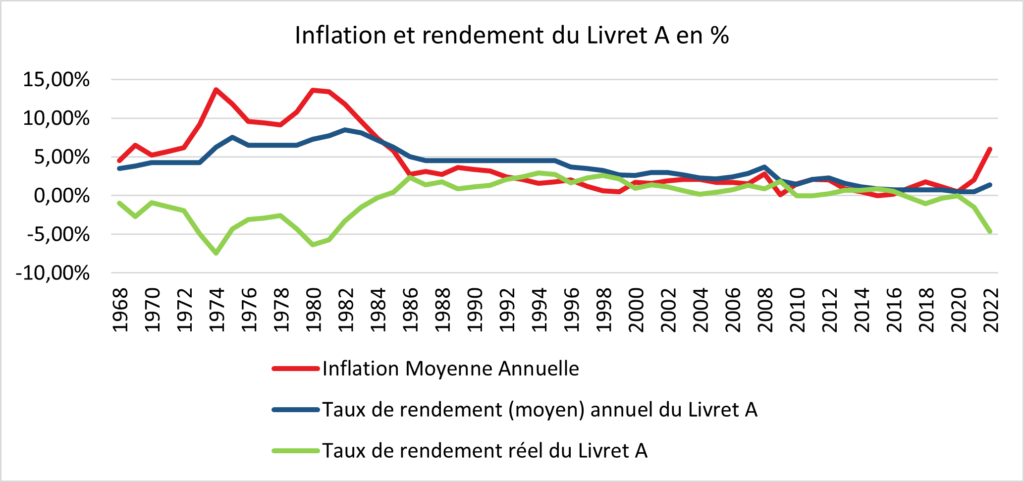
4. Le LDDS, le petit frère du Livret A
Le Livrets de Développement Durable et Solidaire obéît aux mêmes caractéristiques que le Livret A. Il bénéficie du même taux que ce dernier. La France compte 24,5 millions de LDDS. L’encours moyen de ce produit est de 5 100 milliards d’euros. Au 30 novembre dernier, l’encours global s’élevait à 131,3 milliards d’euros.
5. Les conséquences de l’augmentation du taux du Livret A et du LDDS
Le relèvement du taux du Livret A et du LDDS a des conséquences non seulement pour les épargnants mais aussi pour les banques, la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les entreprises et l’État.
Quelles conséquences pour les épargnants ?
L’encours moyen des Livrets A est de 5 800 euros. En retenant ce montant, le passage de 2 à 3,0 % génère sur un an un gain de 58 euros, l’ensemble de la rémunération étant alors porté de 116 à 174 euros.
Pour un livret ayant atteint le plafond de 22 950 euros, le gain est de 229,5 euros pour une rémunération globale de 688,5 euros. 4,3 millions de titulaires de Livret A sont au plafond. S’ils ne peuvent plus faire de versements, ils continuent néanmoins à capitaliser les intérêts.
Pour les 24,5 millions de titulaires de LDDS, la hausse est la même. Pour un LDDS ayant un encours de 5 100 euros, correspondant à l’encours moyen, le gain est de 51 euros pour une rémunération globale, toujours sur un an, de 153 euros.
L’attractivité relative du Livret A par rapport aux autres placements
Le taux du Livret A et du LDDS se situe au-dessus du taux moyen des livrets ordinaires (0,3 % en novembre 2022, selon la Banque de France). Les rendements des fonds euros l’assurance vie pour 2022 devraient se situer autour de 1,8 et 2 %. Net d’impôts, ils devraient se situer entre 1,2 et 1,4 % c’est-à-dire au même niveau que le taux du Livret A sur l’année écoulée. Pour 2023, le rendement du Livret A pourrait être supérieur à celui des fonds euros de l’assurance vie, ce qui constituera un précédent, un produit de court terme étant en principe moins bien rémunéré qu’un produit de long terme.
Les conséquences pour le logement social, les banques et l’État
L’augmentation des taux de l’épargne réglementée qui est plus rapide que celle des taux de marché renchérit les coûts de gestion des produits concernés (Livret A, LDDS, LEP et Livret Jeune). Cette augmentation a également des conséquences pour le logement social.
Le relèvement du taux du Livret A augmente le coût de la ressource pour les bailleurs sociaux qui se financent à partir du Livret A. Ce coût prend en compte le taux de rémunération auquel s’ajoute les frais de rémunération des réseaux (0,3 %) et ceux liés à la gestion des prêts. Le coût marginal pourrait dépasser 3,5 % ce qui est supérieur aux taux des emprunts sur les marchés. Le Livret A finance également les collectivités locales qui seront également touchées par la hausse des taux tout comme les PME qui peuvent accéder aux ressources du LDDS.
Le relèvement des taux de l’épargne réglementée génère un surcoût pour la Caisse des dépôts et consignations qui centralise 60 % de l’encours du Livret A et pour les banques en ce qui concerne le solde restant. Le coût global du relèvement pour le Livret A est de 3,69 milliards d’euros dont 1,5 milliard pris en charge par les banques et 2,2 par la Caisse des dépôts. Pour le LDDS, le surcoût est de 1,3 milliard d’euros. Au total, le surcoût pourrait être de 5 milliards d’euros.
L’augmentation du coût du Livret A peut diminuer les recettes de la Caisse des dépôts et, par voie de ricochet, les bénéfices qu’elle verse à l’État.
Une collecte en hausse dans les prochains mois ?
Toute augmentation du taux du Livret A a un effet immédiat sur le collecte. Cet effet dure en règle générale trois mois avant de s’estomper. En 2022, les deux annonces de hausse ont été suivies d’une forte collecte.
Au mois de janvier 2022 (mois de l’annonce du passage à 1 %), la collecte du Livret A a été positive de 6,25 milliards d’euros. Elle a été de 2,94 milliards d’euros en février et de 3,02 milliards d’euros en mars. Elle a diminué en avril à 1,87 milliards d’euros. Elle est remontée au mois de juillet (mois d’annonce du passage à 2 %), atteignant 2,64 milliards d’euros quand, au mois d’août, elle s’est élevée à 4,49 milliards d’euros. Au mois de novembre, la collecte est devenue négative à -1,1 milliard d’euros.
Sur l’ensemble de l’année 2022, marquée par deux relèvements, la collecte a été fortement positive avec (dans l’attente des résultats du mois de décembre), un gain de plus de 25 milliards d’euros. La collecte de 2022 pourrait être pour le Livret A la troisième voire la deuxième (en fonction de décembre) plus importante de son histoire. Pour le moment, les deux collectes les plus importantes sont celles de 2012 (crise des dettes souveraines et relèvement du plafond de 15 300 à 22 950 euros) avec 28,16 milliards d’euros et celle de 2020 (crise sanitaire) avec 26,39 milliards d’euros. En 2022, au-delà de l’effet taux, la guerre en Ukraine et les incertitudes économiques qu’elle a générées ont incité les ménages à mettre de l’argent de côté. La remontée du taux au 1er février 2023 devrait provoquer comme l’année dernière une hausse passagère de la collecte. Elle sera d’autant plus forte que les placements concurrents, à l’exception du Livret d’Épargne Populaire ne peuvent pas offrir un rendement supérieur.
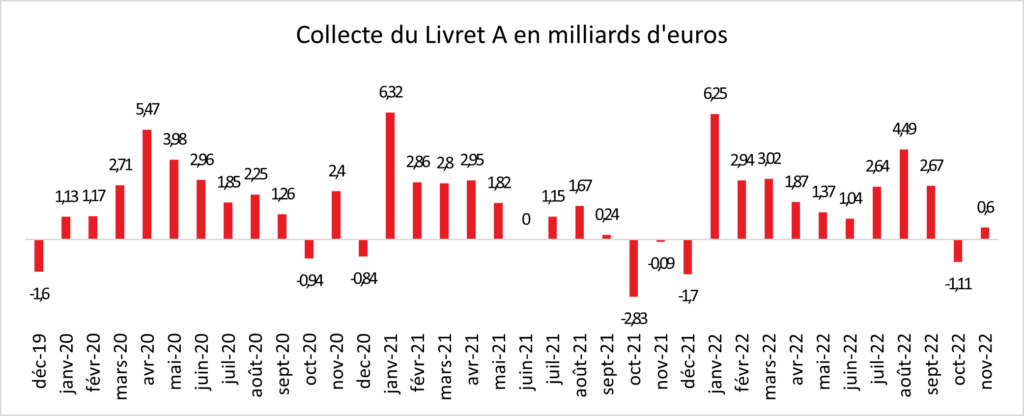
6. Le relèvement du taux du Livret d’Épargne Populaire à 6,1 %
Détenu par 6,9 millions de Français, le Livret d’Épargne Populaire est réservé aux épargnants modestes dont le revenu fiscal de référence était, en 2021, de 21 393 euros pour une part (+ 5 712 € par demi-part supplémentaire).
L’encours moyen du LEP est de 5 600 euros et son plafond est fixé à 7 700 euros. L’encours total de ce produit était, selon la Banque de France, au mois de novembre 2022 de 45,8 milliards d’euros.
Son taux est fonction soit de celui du Livret A soit de l’inflation. Il est fixé par l’arrêté du 27 janvier 2021 de la manière suivante :
La rémunération des LEP est égale au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux du livrets A majoré d’un demi-point ;
b) L’inflation en France.
Comme le taux du Livret A est inférieur à l’inflation c’est cette dernière qui est utilisée pour fixer le taux du LEP.
Le taux du LEP est ainsi passé de 1 à 2,2 % le 1er février 2022 puis à 4,6 % le 1er août 2022 avant d’être relevé à 6,1 % le 1er février 2023. Il est de loin le produit de taux le plus rémunérateur.
Les relèvements du taux du LEP a entraîné une forte hausse de son encours qui est passé de 38,3 à 45,8 milliards d’euros de décembre 2021 à novembre 2022.
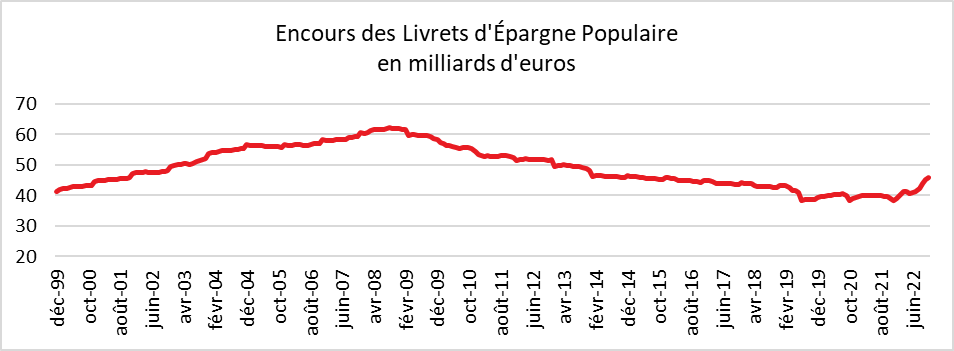
7. Le 1er août 2023, une nouvelle hausse possible
Au vu de la hausse des taux des marchés monétaires et du maintien d’une inflation autour de 6 %, le taux du Livret A sera sans nul doute augmenté à nouveau le 1er août 2023. L’inflation étant censée se modérer durant le second semestre, une pause pourrait intervenir par la suite.
Le projet de réforme des retraites version 2023
La Première Ministre, Elisabeth Borne a présenté le mardi 10 janvier 2023 le projet de réforme des retraites qui a comme objectif de combler les déficits des différents régimes d’ici 2030. Au-delà de la question des déficits, le Gouvernement cherche à améliorer le taux d’emploi. Par ailleurs, la réforme, conformément aux engagements pris par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle, à relever le minimum contributif.
Faire face aux déficits du système de retraite
Le Gouvernement en s’appuyant sur les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites met en avant que sans réforme, le déficit du système de retraite serait de s : 12 milliards d’euros en 2027, de 14 milliards d’euros en 2030 et de 21 milliards d’euros en 2035.
La dégradation des comptes des régimes de retraite est liée au vieillissement de la population et à la faiblesse de la croissance potentielle.
En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité, en 1970, 3 cotisants pour 1 retraité en 1970, en 2000, 2 cotisants pour 1 retraité en 2000, en 2023, 1,7 et en 2050, 1,4.
La France comptait 5 millions de retraités en 1981. En 2023, ils sont 17 millions en 2023 et seront 20 millions d’ici 2040.
La durée passée à la retraite en France atteint 25 ans, ce qui est la plus longue durée d’Europe. Le taux d’emploi des seniors est particulièrement faible en France : seulement 33 % des 60-64 ans sont en emploi en France, contre environ 45 % dans l’ensemble de l’Union européenne et près de 60 % en Allemagne et 70 % en Suède.
.
Les seniors sont pourtant moins exposés au chômage que les autres (6,9 % pour les 60-64 ans contre 7,4 % pour la population générale).
Avec les réformes de 2010 et de 2014, le taux d’emploi des 60-64 ans a presque doublé, passant de 19 % à 33 %.
Le report de l’âge légal de 62 à 64 ans
L’âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, à raison de 3 mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat en 2027, puis atteindra 64 ans en 2030.
La réforme de 2014 du passage la durée de cotisation à 43 ans sera accélérée. Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans, durée de cotisation votée dans le cadre de la loi Touraine de 2014.
Le Gouvernement ne modifie par l’âge de la retraite à taux plein à 67 ans, âge à partir duquel il est possible de partir sans décote.
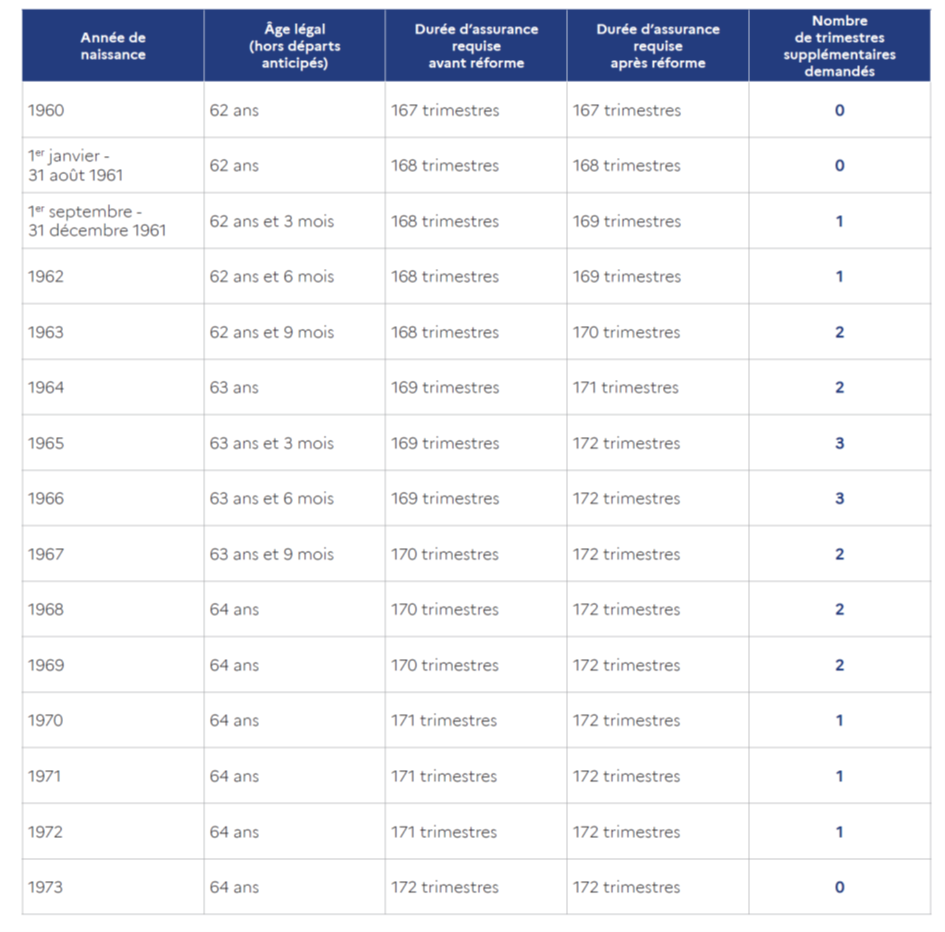
Le dispositif des carrières longues adapté au report de l’âge légal
Le dispositif de carrières longues demeure en vigueur.
Les personnes qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront partir à la retraite dès 58 ans ; entre 16 et 18 ans à partir 60 ans et entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans.
Les périodes de congé parental seront prises en compte pour partir avec le dispositif de carrières longues ainsi que dans le calcul du minimum de pension de ceux qui ont travaillé plus de 30 ans.
Les départs anticipés pour invalidité maintenus
Comme aujourd’hui, les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein, les travailleurs handicapés à compter de 55 ans.
Les salariés ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront sous conditions partir à la retraite 2 ans avant l’âge légal. Les conditions pour accéder à ce départ anticipé seront assouplies.
Le Compte professionnel de prévention modifié
1,9 million de comptes professionnels de prévention (C2P) ont été ouverts depuis la création du dispositif. Ce compte permet d’accumuler des droits pour chaque année d’exposition, qui servent ensuite à financer des formations, un passage à temps partiel payé temps plein ou à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Le Gouvernement semble avoir renoncé à réintégrer le facteur des « port de charges lourdes » supprimé en 2018. En revanche, les seuils des principaux facteurs d’exposition aux risques professionnels seront abaissés pour permettre à davantage de salariés de bénéficier d’un compte. Le seuil de travail de nuit passera de 120 à 100 nuits par an et celui du travail en équipes successives alternantes passera de 50 à 30 nuits par an. Cela permettra, chaque année, à plus de 60 000 personnes supplémentaires de bénéficier d’un compte.
Les points seront acquis plus rapidement pour les salariés exposés à plusieurs risques et sans limite de nombre de points, contrairement à aujourd’hui,/
Une nouvelle utilisation du compte professionnel de prévention sera créée avec la possibilité de financer un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.
Un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exerçant des métiers identifiés comme exposés à la pénibilité, afin de mener des actions de prévention et mieux détecter les situations d’inaptitude permettant un départ anticipé à 62 ans.
Un fonds d’investissement d’un milliard d’euros
Le Gouvernement a décidé d’instituer un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle doté d’un milliard d’euros sur le quinquennat. Il soutiendra les branches professionnelles pour identifier les métiers exposés aux risques ergonomiques (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations), et financer avec les employeurs des actions de prévention et de reconversion.
Les dispositions relatives à la fonction publique
Dans la fonction publique, l’âge d’ouverture des droits sera relevé progressivement de deux ans comme dans le privé. Ce relèvement concernera les différentes catégories de fonctionnaires. Les modalités de calcul des pensions ne sont pas modifiées
La retraite progressive en vigueur dans le privé sera étendue à la fonction publique.
Les fonctionnaires en catégories actives et les militaires conserveront un droit à partir plus tôt compte tenu de leurs sujétions particulières de service public et d’exposition aux risques. La durée de service et l’âge d’annulation de la décote seront inchangés.
La clause du grand père pour les régimes spéciaux
Le gouvernement prévoir de fermer les régimes spéciaux de retraite progressivement. Cela concerne la RATP, la branche des industries électriques et gazières (IEG), les clercs et employés de notaires, les personnels de la banque de France ainsi que les membres du Conseil économique social et environnemental (CESE). Les nouveaux embauchés recrutés à compter du 1er septembre 2023 dans les régimes spéciaux concernés seront affiliés au régime général pour la retraite. Cette méthode avait été retenu lors de la fermeture du régime spécial de la SNCF dans la réforme de 2018.
Les régimes autonomes (professions libérales et avocats) et ceux répondant à des sujétions spécifiques (marins, Opéra de Paris, Comédie Française) ne seront pas concernés par cette fermeture.
Les bénéficiaires des régimes spéciaux seront soumis au report de l’âge de départ à la retraite de deux ans et à l’accélération de la réforme Touraine mais des mesures d’adaptation sont prévues. La prise en compte des précédentes réformes, qui prévoient une augmentation de l’âge jusqu’en 2024, conduit à une entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à l’âge de départ en 2025.
Une réforme de l’assiette sociale des indépendants
Le Gouvernement a prévu d’ici le PLFSS 2024 en concertation avec les professions concernées de réformer l’assiette sociale des indépendants, afin que son calcul soit simplifié et que les droits à la retraite des indépendants soient renforcés.
Le relèvement du minimum contributif et indexation en fonction du SMIC
Reprenant un des objectifs de la loi Fillon de 2003, le gouvernement prévoit que pour une carrière complète cotisée au SMIC, la pension ne pourra être inférieure à 85 % du SMIC net, soit environ 1 200 euros brut par mois. L’objectif est de revaloriser les petites pensions et de créer un écart avec le minimum vieillisse qui est de 963 euros depuis le 1er janvier 2023.
Le minimum de pension augmentera de 100 euros par mois pour une carrière complète dès 2023. Cette mesure concernera tous les retraités bénéficiaires du minimum contributif.
Des trimestres supplémentaires pour certaines catégories d’assurés
Les aidants familiaux, qui sont contraints de réduire leur activité pour s’occuper d’un proche parent ou d’un enfant, bénéficieront de validations de trimestres.
La réforme donnera des trimestres de retraite aux personnes ayant effectué des stages de travaux d’utilité collective
La création d’un index senior
Un index seniors sera créé pour inciter les entreprises à maintenir en emploi les salariés les plus âgés.
Pour aménager son temps de travail tout au long de la carrière, une négociation sera ouverte pour mettre en place un compte épargne-temps universel (CETU).
L’équilibre de la réforme
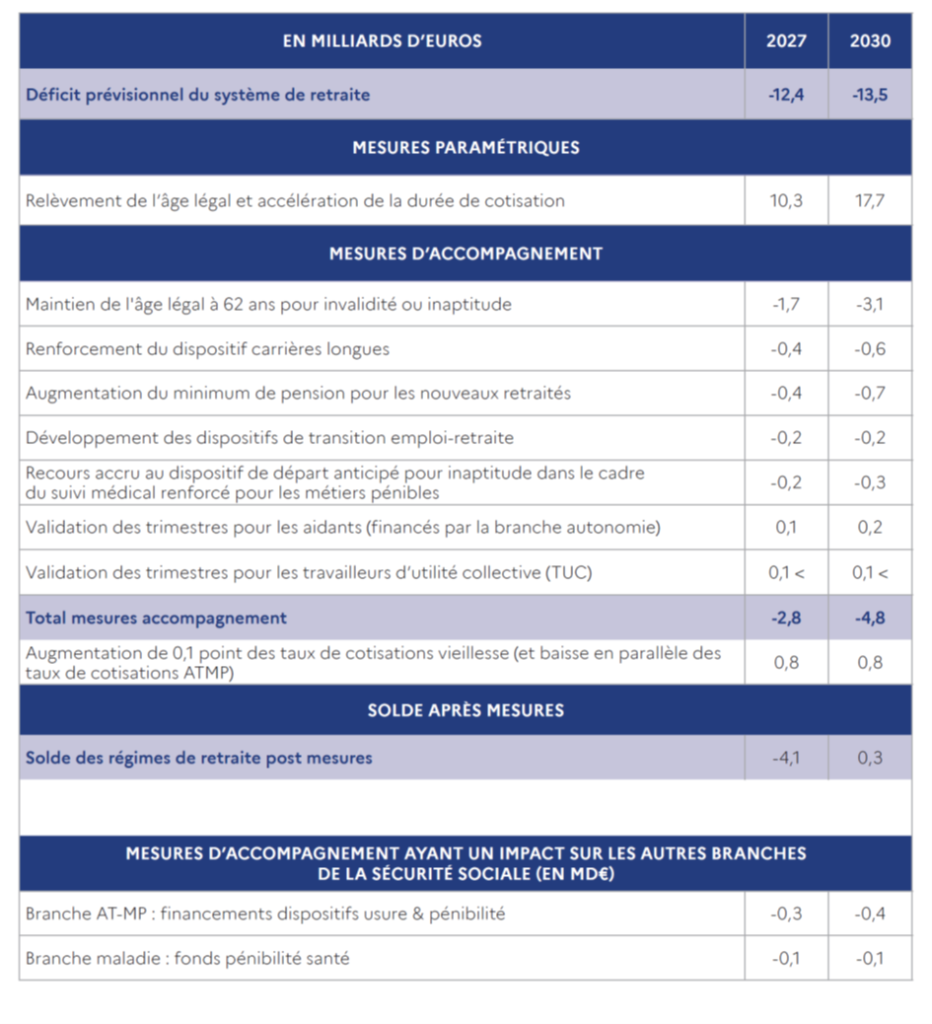
Le Coin des Epargnants du 7 janvier 2023 : un démarrage sur les chapeaux de roue
La première semaine de janvier a été marquée par une forte progression du cours des actions et par un repli des taux des obligations d’Etat. Le CAC 40 a gagné en cinq jours près de 6 % tout comme l’indice européen Eurostoxx 50. Le taux de l’Obligation assimilable du Trésor français est revenu sous la barre des 3 % à 2,7 %.
Les investisseurs ont plébiscité la légère décrue de l’inflation en décembre en zone euro et la décélération de la progression des salaires aux Etats-Unis. Vendredi 5 janvier, le département du travail a, en effet, publié les résultats de l’emploi pour le mois de décembre. Aux Etats-Unis, le secteur non-agricole a créé 223 000 emplois au mois de décembre alors que 200 000 étaient attendues. Il y en avait eu 256 000 en novembre. Le taux de chômage s’élève à 3,5 %, soit au-dessous des 3,7 % anticipés par les analystes, après 3,7 % le mois précédent. Le salaire horaire a augmenté de 4,6 % en décembre en rythme annuel, soit un peu moins que prévu +5 %. Au mois de novembre, la hausse avait été de 4,8 %.
Les investisseurs estiment que la hausse des taux directeurs par les banques centrales dans les prochains mois sera moins forte qu’escompté il y a encore quelques jours. Pour autant, les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne devraient poursuivre leur hausse. Le pic devrait être atteint d’ici l’été avant de se stabiliser le temps qu’il faudra selon François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Celui-ci a également estimé qu’il est encore trop tôt pour déterminer quel sera ce niveau terminal. Dans les minutes de sa réunion de décembre publiées mercredi soir, la banque centrale américaine a confirmé qu’elle n’en a pas terminé avec la lutte contre l’inflation et qu’il ne faut pas s’attendre à une baisse des taux cette année. Les marchés tablent désormais sur un taux des Fed funds à plus de 5 % en juin.
La baisse du cours du pétrole, -7,5 % sur la semaine, est imputable aux conséquences économiques de l’épidémie covid en Chine et au ralentissement de l’activité en Europe comme aux Etats-Unis.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 6 jan. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 860,95 | +5,98 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 630,61 | +1,49 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 895,08 | +1,45 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 10 569,29 | +0,98 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 14 610,02 | +4,93 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 699,49 | +3,32 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 017,83 | +5,83 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 25 973,85 | -1,05 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 157,64 | +2,21 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,720 % | -0,386 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,206 % | -0,358 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,578 % | -0,306 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0636 | -0,76 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 863,2 | +2,03 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 79,29 | -7,49 % | 84,08 | 78,140 |
Actions de part et d’autre de l’Atlantique
La propension des Américains à la détention d’actions est traditionnellement plus importante que celle des Européens. Dans le passé, elle se traduisait par un effet de richesse en actions plus élevé. Leur variation influait sur la consommation et la croissance. Au vu des dernières évolutions, cette dépendance de l’économie américaine aux marchés « actions » semble s’estomper.
La capitalisation boursière des États-Unis représente 220 % du revenu disponible des ménages, contre 110 % a sein de la zone euro. En vingt-cinq ans, ce ratio a été multiplié par 3,6 % aux États-Unis, contre 2,5% pour la zone euro. L’appréciation du cours des actions ne s’est pas traduite de part et d’autre de l’Atlantique par une baisse du taux d’épargne. Logiquement, une augmentation de la valeur des actions induit une augmentation de la valeur du patrimoine, ce qui doit amener les ménages à accroître leur consommation ou à réallouer une partie des plus-values dans d’autres types de placements. Aux États-Unis, les épargnants ont affecté jusqu’en 2021 une partie des plus-values issues de la valorisation des actions. À la différence des périodes d’appréciation d’avant la crise financière de 2007/2009, ils n’ont pas réduit leur effort d’épargne pour augmenter leurs dépenses de consommation. Le vieillissement de la population peut expliquer cette évolution. Les marchés « actions » sont de plus en plus contrôlés par les investisseurs institutionnels (assureurs, fonds d’investissement, fonds de pension). Les variations de cours ont, de ce fait, de moins en moins d’effet sur le comportement des ménages.
Le rendement réel des livrets en territoire négatif
Le taux moyen de rémunération des dépôts continue de progresser. Le taux des livrets ordinaires qui était en 2021 de 0,09% est désormais de 0,3 %, ce qui est compte tenu de l’inflation très faible.
- La rémunération moyenne des dépôts bancaires progresse à 0,88 % en novembre, après 0,80 % en octobre, soit une hausse de 8 points de base (4,4 points de base mensuellement en moyenne sur 11 mois 2022).
- La hausse est portée principalement par les dépôts des SNF, dont la rémunération s’établit à 0,45 % après 0,28% en octobre.
- Le taux de rémunération des dépôts des ménages s’établit à 1,17 % en novembre, après 1,15 % en octobre.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| nov-22 (g) | nov-21 | sep-22 | oct-22 (f) | nov-22 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 123 | 0,41 | 0,74 | 0,80 | 0,88 |
| dont Ménages | 1 823 | 0,63 | 1,13 | 1,15 | 1,17 |
| – dépôts à vue | 620 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 12 | 0,40 | 0,57 | 0,98 | 1,27 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 58 | 0,78 | 0,71 | 0,72 | 0,73 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 575 | 0,53 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| dont : livret A | 337 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| – livrets ordinaires | 278 | 0,09 | 0,22 | 0,28 | 0,33 |
| – plan d’épargne-logement | 280 | 2,59 | 2,56 | 2,58 | 2,57 |
| dont SNF | 892 | 0,09 | 0,16 | 0,28 | 0,45 |
| – dépôts à vue | 662 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,17 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 174 | 0,13 | 0,39 | 0,81 | 1,29 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 56 | 0,63 | 0,71 | 0,85 | 1,10 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | |
| Euribor 3 mois (d) | -0,57 | 1,01 | 1,43 | 1,83 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | -0,41 | 1,95 | 2,34 | 2,27 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Assurance vie, rebond en novembre
Au mois de novembre 2022, selon France Assureurs, l’assurance vie a enregistré un rebond après la décollecte du mois d’octobre. La collecte nette de 1,4 milliard d’euros reste néanmoins inférieure à celle du mois de novembre 2021 (2,2 milliards d’euros).
Le mois de novembre est un mois moyen pour l’assurance vie. Sur ces dix dernières années, la collecte nette moyenne avoisine un milliard d’euros, trois décollectes ayant été constatées. Novembre est un mois creux pour l’épargne, sans aspérité particulière.
La collecte nette est portée, en novembre, par les unités de compte, +1,7 milliard d’euros quand les fonds euros sont en décollecte de 300 millions d’euros. Sur 11 mois, la collecte nette est de 13,7 milliards d’euros en recul de 6,2 milliards d’euros par rapport à la même période de 2021.
En 2022, les cotisations se sont élevées à 12,4 milliards d’euros au mois de novembre, soit un niveau équivalent à celui de 2021. .Depuis le début de l’année, elles s’établissent à 131,6 milliards d’euros, soit −3 milliards d’euros par rapport à la même période en 2021. Les unités de compte représentent 39 % de la collecte depuis le début de l’année. Leur poids est stable malgré la chute des cours boursiers enregistrée au cours de l’année 2022. Les prestations ont été de 10,9 milliards d’euros sur le mois de novembre. Sur onze mois, elle se sont élevées à 117,9 milliards d’euros depuis le début de l’année, en hausse de +3,2 milliards d’euros par rapport à la même période en 2021. À fin novembre, l’encours était de 1 856 milliards d’euros.
L’assurance vie, toujours entre deux eaux
Le retour d’une collecte positive conforte la position de l’assurance vie comme premier placement des ménages. Les ménages arbitrent toujours en faveur des unités de compte dans un contexte boursier moins favorable qu’en 2021. Les rendements des fonds euros, nets d’impôt, sont proches du niveau du taux du Livret A (1,37 % sur l’année 2022). En prenant en compte l’inflation, le rendement réel des fonds euros est en territoire négatif (plus de 3 points en moyenne). Cette situation sans précédent dans l’assurance vie explique tout à la fois le recul de la collecte par rapport aux années d’avant Covid et la montée en puissance des unités de compte, montée en puissance incitée, par ailleurs, par les assureurs.
Les annonces des rendements pour 2022, en hausse par rapport à 2021, devraient contribuer à un léger regain de la collecte. Les ménages pourraient être enclins à réorienter une partie de leurs abondantes liquidités sur des placements longs dont l’assurance vie. Cette réallocation sera d’autant plus facile si, au cours de l’année 2023, l’environnement économique se stabilise. 2022 aura été marquée par une préférence remarquée en faveur de l’épargne de précaution en raison des menaces sur le pouvoir d’achat. Le taux d’épargne est attendu en baisse légère dans les prochains mois mais sans pour autant pénaliser les produits de long terme.
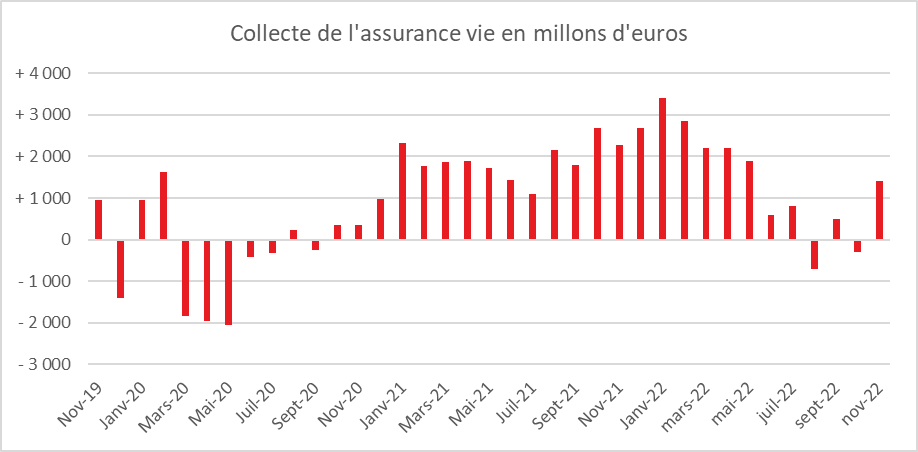
Le Coin des Epargnants : une année 2022 sous tension
Les marchés boursiers, une année à lecture multiple
En 2021, le CAC 40 avait progressé de 28,9 % faisant suite à un recul de 7,1 % en 2020, recul provoqué alors par l’épidémie de covid-19. La place parisienne avait connu alors une véritable « remontada » lui permettant de battre me vieux record datant du 4 septembre 2020, au mois de novembre 2021. Le 5 janvier 2022, le CAC 40 a atteint son plus haut niveau à 7 376 points. La résurgence de l’inflation, la hausse des taux directeurs qui en a résulté et la guerre en Ukraine ont provoqué une chute des cours des actions cotées. A la sortie de l’été, la chute du CAC 40 était de plus de 15 %. Grâce à une belle progression durant l’automne, le CAC 40 n’a abandonné cette année moins de 10 % (-8,95 %). La bourse de Paris comme celle des autres pays européens se distinguent par rapport à la place de New York par des reculs mesurés. Le S&P 500 s’est contracté d’environ 20 % et le Nasdaq plus de 33 %.
Malgré les difficultés économiques et politique, le Footsie londonien a gagné cette année près de 1 % grâce à la dépréciation de la livre sterling (cette baisse est neutralisée par la hausse des cours) et l’appréciation des valeurs des compagnies minières et pétrolières. Les indices boursiers européens sont fin 2022 au-dessus de leur niveau ont pratiquement retrouvé leur niveau d’avant pandémie. Pour le CAC40, le gain est de 7 %.
Les entreprises européennes pourtant exposées à l’augmentation des coûts de l’énergie, aux pénuries de biens intermédiaires ont réussi à sauvegarder leur rentabilité. La croissance dopée par les plans de relance et les mesures de soutien des entreprises et des ménages explique la bonne tenue des bourses européennes. La résilience des entreprises a également prouvé que les actions résistent en période d’inflation à la différence des produits de taux. Les profits des entreprises du CAC 40 ont dépassé 72 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année, en hausse de 26 % par rapport au premier semestre 2021. Les chiffres d’affaires publiés au troisième trimestre ont confirmé la bonne santé des entreprises européennes. Plusieurs secteurs ont contribué à la progression des cours au cours du second semestre : l’énergie, la défense, l’automobile, le transport aérien, le luxe. La récession annoncée à de nombreuses reprises n’est pas encore survenue. De nombreux économistes prédisent qu’elle est imminente, en particulier en Europe. En revanche, les analystes demeurent toujours optimistes, s’attendant à une nouvelle hausse des profits, d’environ 2 %. Pour certains, l’année 2023 connaîtra encore une volatilité sur le front des actions quand pour d’autres, elle donnera lieu à une appréciation de leurs cours, le ralentissement de l’économie ayant déjà été anticipé.
Les obligations d’Etat ont quitté le territoire des taux négatifs
L’année 2022 a été marquée par la progression des taux mettant un terme à une dizaine d’années de décrue. Le taux de l’OAT à 10 ans est ainsi passé, en France de 0,2 à 3,1 % du 1er janvier au 31 décembre. L’obligation à 10 ans allemande a quitté le territoire des taux négatifs pour conclure l’année à 2,1 % quand son homologue américain évolue à plus de 3,8 %.
Le pétrole en mode montagnes russes
Sur l’ensemble de l’année, le cours du baril de Brent a progressé de 8,5 % en terminant à moins de 85 dollars quand au mois de mars et au mois de juin il a dépassé les 120 dollars. L’arrêt des importations européennes de pétrole russe ont pesé sur les cours. Le grand nombre de fournisseurs possibles ainsi que le ralentissement de l’économie chinoise et plus globalement mondiale ont conduit le cours du baril à revenir progressivement à son niveau d’avant la guerre en Ukraine.
Le retour des politiques monétaires conventionnelles
Depuis la crise financière de 2007-2009, les banques centrales avaient mis en œuvre des politiques monétaires non conventionnelles reposant sur des taux d’intérêt historiquement bas et sur de massifs rachats d’obligations afin d’éviter la déflation et de relancer l’économie. Lors de la crise sanitaire de 2020, ces politiques ont été accentuées aboutissant à un gonflement des bilans des banques centrales. Avec la résurgence de l’inflation fin 2021 et surtout en 2022 avec la guerre en Ukraine, elles ont été amenées à revenir à des politiques monétaires classiques. Elles ont progressivement arrêté leurs rachats d’obligations, voire décidé de réduire la taille de leur bilan, notamment pour la FED. Pour casser l’inflation, elles ont procédé à des relèvements. Partant de très bas, ces derniers sont jugés importants même s’ils doivent être relativisés au vu de l’inflation.
Mardi 27 décembre, le taux des obligations françaises à 10 ans a dépassé les 3 %, terminant la séance à 3,048 %. Un niveau inédit depuis le printemps 2012. Une première alerte avait eu lieu en octobre, mais le taux français de référence avait finalement reflué sous ce seuil symbolique avant la clôture. Cette augmentation signifie que le service de la dette augmentera, sachant que l’Etat devrait émettre pour 270 milliards d’euros d’obligations sur les marchés en 2022. Cette hausse est la conséquence du relèvement des taux directeurs par la Banque centrale européenne ainsi que de l’arrêt des rachats d’obligation par cette dernière. Par ailleurs, la progression de l’endettement des Etats incite les investisseurs à demander des intérêts plus élevés, investisseurs qui n’anticipent pas, en outre, une baisse rapide de l’inflation. Pour la juguler, les banques centrales sont contraintes de durcir de plus en plus leur politique monétaire. La Réserve fédérale américaine a déjà relevé ses taux de 375 points de base en six mois, réalisant son resserrement monétaire le plus violent depuis les années 1980. La Banque centrale européenne (BCE) a fait passer son taux de dépôt de -0 50 % en juin à 2 %, un rythme de relèvement sans précédent depuis la création de l’euro. La Banque du Japon, qui était la dernière à n’avoir pas augmenter ses taux, a dû s’y résoudre à la fin du mois de décembre.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 30 déc. 2022 | Évolution sur une semaine | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 471,31 | +0,12 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 147,25 | -0,99 % | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 839,50 | -0,14 % | 4766,18 |
| Nasdaq | 10 466,48 | -1,34 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 13 923,59 | -0,12 % | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 451,74 | -0,28 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 792,28 | -0,65 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 26 094,50 | -0,54 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 089,26 | +1,42 % | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,106 % | +0,094 pt | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,564 % | +0,172 pt | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,884 % | +0,141 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0697 | +0,35 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 815,38 | +0,64 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84,08 | +0,75 % | 78,140 |
Etats-Unis/ Europe : où les actionnaires sont-ils les mieux traités ?
Le rendement des actions se mesure comme la somme du taux de dividende (ratio des dividendes versés au cours boursier) et de la plus-value en capital réalisée sur le cours boursier (sur les actions)
Le rendement total de la détention d’actions sur la période 1995-2022 est supérieur aux Etats-Unis avec un ratio de 11,9 %, contre 9,4 % pour la zone euro. Cet écart provient de la hausse plus rapide des cours boursiers aux Etats-Unis. En revanche, le taux de dividendes est plus élevé en zone euro, sans pour autant compenser l’effet cours. En raison du nombre d’actionnaires et d’entreprises cotées plus important aux Etats-Unis qu’en zone euros, le poids des dividendes au sein du PIB y est bien plus important, 7 % contre 4 %. La rémunération globale des actionnaires est également plus importante. Elle atteint 8 % du PIB, contre 4 % en zone euro. Ce résultat est différent du rendement pour les actionnaires de la détention d’actions. La part des profits bruts qui est distribuée (le taux de distribution), sous forme de dividendes ou de rachats d’actions atteint 50 % aux Etats-Unis, contre 25 % dans la zone euro. Les actionnaires sont ainsi privilégiés outre-Atlantique. Le poids des profits distribués (dividendes et rachats d’actions) en fonction de l’investissement est de 60 % aux États-Unis contre 35 % dans la zone euro.
Les actionnaires sont mieux traités aux Etats-Unis qu’en Europe. Le rendement des actions y est supérieur, la rémunération y est plus élevée et la part des profits distribués y est deux fois plus importante. Les entreprises américaines rémunèrent donc leurs actionnaires nettement mieux que les entreprises européennes. Cette distribution ne pénalise pas pour autant l’investissement qui est plus élevé outre-Atlantique qu’en Europe.
Forte chute des émissions en bourse
En 2022, dans un contexte économique et financier difficile, seulement 1 333 sociétés se sont fait coter à l’échelle mondiale, selon le cabinet EY. Elles ont levé 179,5 milliards de dollars, soit 62 % de moins qu’en 2021. A Wall Street, le nombre d’opérations a reculé de 78 % et leur montant a diminué de 94 % pour s’élever à 9 milliards de dollars, contre 156 milliards en 2021. Ce résultat est le plus bas de ces vingt dernières années. Les SPAC (Special Purpose Acquisition Company, en français société d’acquisition à vocation spécifique) qui portaient ces dernières années le marché des émissions ont été les grandes absentes de l’année (7 % des émissions aux Etats-Unis en 2022, contre 60 % en 2021). Les SPAC sont des sociétés dont les titres sont émis sur un marché boursier en vue d’une acquisition d’une entreprise ou d’une fusion future dans un secteur particulier et avant une échéance déterminée. Les investisseurs n’ont pas souhaité prendre de risque en 2022. Investir dans une entreprise qui décide d’être cotéeconstitue un risque surtout dans un contexte de hausse de prix et de taux.
En Europe, le marché des émissions n’a été animé que par l’introduction en Bourse de Porsche. En quelques heures, Volkswagen a levé la somme record de 9,4 milliards d’euros d’actions ne donnant aucun droit de vote. Mais après Porsche, la deuxième opération a été l’émission des actions de Var Energi, une filiale du pétrolier Eni qui a levé 776 millions d’euros à la Bourse d’Oslo. Au total, en Europe, le nombre d’introductions en Bourse a diminué de 53 %. En revanche, le marché des émissions a été dynamique en Asie Pacifique avec 845 premières cotations. 67 % des fonds levés en 2022 l’ont été au sein de cette zone. 120 milliards de dollars ont été ainsi émis. Cinq des dix plus importantes opérations mondiales se sont déroulées dans cette région.
Les branches professionnelles, un acteur clef dans la gestion de l’emploi
Depuis la fin de la phase aigüe de la crise sanitaire, la France se distingue de ses partenaires par un taux de chômage qui demeure élevé et par l’apparition de fortes tensions de recrutement. Quand l’Allemagne, les Pays-Bas ou la République tchèque sont en situation de plein emploi, la France a toujours un taux de chômage supérieur à la moyenne de la zone euro. Mais à la différence de l’Espagne ou de l’Italie qui sont dans la même situation, plusieurs secteurs économiques sont confrontés à des pénuries de main d’œuvre. La France pourrait être ainsi confrontée à une inadéquation de l’offre et de la demande de travail.
Un déficit d’emploi sur fond de chômage encore élevé
La France qui se caractérise par un faible taux d’emploi au sein de l’Union européenne enregistre sur ce front une réelle amélioration. Le taux d’emploi bat depuis plus d’un an record sur record en dépassant désormais 68 %. Il demeure néanmoins nettement inférieur à celui de l’Allemagne (77 %). Avec un taux de chômage de 7,1 % contre 3 % en Allemagne, la France est confrontée à des pénuries de main d’œuvre importantes dans un grand nombre de secteurs : hébergement, restauration, bâtiment, transports, informatique, etc. A la différence des Etats-Unis, en 2021, il n’y a pas eu de réelle Grande Démission en France. Certes, le taux de démission est élevé mais il a simplement retrouvé son niveau d’avant 2008. Les Français qui démissionnent le font non pas pour arrêter de travailler mais pour changer de travail. Les tensions sur le marché du travail ne sont pas spécifiques à la France et concernent de nombreux Etats européens.
Les entreprises à la chasse des bons éléments
Le secteur des transports qui emploie près de 780 000 salariés en France illustre les difficultés de recrutement que rencontre l’économie française. Les entreprises de ce secteur éprouvent des problèmes à recruter aussi bien pour des postes de conducteurs que de sédentaires. L’arrêt des recrutements à partir de la crise financière de 2008 et des formations a abouti à ce goulot d’étranglement. La pyramide des âges est déséquilibrée avec des départs à la retraite nombreux au moment où les jeunes se détournent de ce secteur qui n’est pas jugé attractif. Parmi les critères entrant en ligne de compte pour expliquer les difficultés de recrutement figurent sans surprise le manque d’attractivité des métiers (conditions de travail difficiles, horaires décalés, bas salaires, etc.), l’inadéquation des compétences (manque de travailleurs avec les qualifications attendues), l’absence de candidats sur certains territoires et l’intensité des embauches en lien avec une concurrence accrue des entreprises. Selon la Dares, l’intensité des embauches serait la principale cause principale des tensions sur le marché de l’emploi en 2021 ; suivi du manque de main d’œuvre, la non-durabilité de l’emploi, les conditions de travail, puis l’inadéquation géographique. Parmi les motifs pouvant expliquer l’inadéquation entre offre et demande de travail figurent les problèmes de logement et de transports. Que ce soit au sein des grandes agglomérations ou en zones touristiques, les entreprises peinent à recruter du fait des difficultés de logement. Ainsi, à Ajaccio, les locations saisonnières réduisent le parc locatif classique provoquant une hausse des loyers. Les entreprises du bâtiment, de la restauration ou de l’hébergement sont conduites bien souvent à loger elles-mêmes leur personnel. L’absence de transports publics peut amener des actifs à renoncer à des emplois.
Les branches professionnelles comme acteur des bonnes pratiques sociales
Les différentes branches concernées par les problèmes de recrutement se sont engagées par négociations collectives à améliorer l’attractivité des métiers. L’amélioration de la protection sociale et notamment de la prévoyance, un effort de prévention accru ainsi que des revalorisations salariales sont les outils les plus utilisés. Dans un contexte concurrentiel, les entreprises doivent en outre travailler à la fidélisation de leurs salariés. En période d’inflation, la question des rémunérations devient plus sensible. Si le SMIC peut être réévalué à plusieurs reprises dans l’année, il n’en est pas de même logiquement pour les autres salaires. Il peut en découler de l’amertume et des frustrations conduisant à des démissions. Les salariés sont par ailleurs de plus en plus sensibles aux avantages accessoires comme la prise en charge totale ou partielle de certains postes de dépenses (transport, logement, garde d’enfants). Le législateur a prévu des mécanismes d’exonération de cotisations sociales pour inciter les entreprises à verser ce type d’aide (exemple de l’aide pour financer des activités de service à la personne ou de garde d’enfants : exonération de cotisations jusqu’à 2 265 euros pour l’année 2022). Les salariés demandent de plus en plus que les formations auxquelles ils peuvent accéder leur permettent d’évoluer au sein de l’entreprise. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) devient pour les entreprises un outil important dans l’optique de la fidélisation de leur personnel. La question du temps de travail est également un facteur de plus en plus déterminant dans le choix des salariés. Ces derniers refusent souvent les postes avec des horaires décalés ou des temps de travail éclaté en de nombreuses plages horaires. Ils souhaitent une concentration de leur période de travail. La branche des hôtels/café-restaurants réfléchit ainsi à l’instauration de la semaine de quatre jours. Certaines entreprises mettent en place des congés de long terme rémunérés (par exemple chez Accenture). Le télétravail s’est imposé en particulier et devient pour certains salariés un élément déterminant dans leur choix professionnel. Les actifs, en particulier, les plus jeunes, sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Plusieurs entreprises ont dû faire face à des demandes de retrait de la part de salariés qui considéraient que leur travail ou leur entreprise pouvaient porter atteinte à l’environnement.
Les tensions de recrutement que rencontrent les entreprises témoignent d’une amélioration de la situation du marché de l’emploi, après une quarantaine d’années de chômage massif. En raison de problèmes de formation et de problèmes d’inadéquation territoriale, la France n’a pas renoué avec un chômage faible à la différence d’un grand nombre de ses partenaires européens. Les tensions actuelles peuvent être dangereuses en particulier pour les PME qui ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre que les grandes entreprises pour attirer et fidéliser les salariés. En la matière, les branches professionnelles ont un rôle à jouer pour canaliser et mutualiser les pratiques.
Hausse du taux d’usure à compter du 1er janvier 2023
Le taux d’usure correspond au taux d’intérêt maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Le taux d’usure vise à protéger les emprunteurs. La Banque de France est en charge du calcul trimestriel du taux d’usure.
Avec la hausse des taux constatée depuis le début de l’année, certains emprunteurs ont pu être confrontés au plafond du taux de l’usure et se voir refuser leurs prêts.
| Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 4ème trimestre 2022 | Taux d’usure applicable au 1er janvier 2023 |
| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,78 | 21,04 |
| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,91 | 10,55 |
| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,34 | 5,79 |
| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,56 | 3,41 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,65 | 3,53 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,68 | 3,57 |
| Prêts à taux variable | 2,51 | 3,35 |
| Prêts relais | 2,82 | 3,76 |
| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 3,19 | 4,25 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,18 | 4,24 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 3,23 | 4,31 |
| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 3,36 | 4,48 |
| Découverts en compte | 12,35 | 16,47 |
| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 3,08 | 4,11 |
| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Découverts en compte | 12,35 | 16,47 |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.
Le Coin des Epargnants du 24 décembre 2022 : en attendant les fêtes de fin d’année
Les investisseurs ont commencé la trêve des confiseurs en avance, le volume des transactions étant faible durant la semaine. Ils sont restés relativement insensibles aux rares résultats économiques. En Asie, les places financières ont, en revanche plus affectés par le changement de politique monétaire intervenu au Japon.
Le mois dernier, les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,4 % sur un mois, tandis que leurs dépenses, qui représentent plus des deux tiers du PIB n’ont progressé que de 0,1 %, soit deux moins qu’attendu. Très surveillée par la Réserve fédérale américaine (Fed), la composante du déflateur « core », ou PCE « core », a augmenté de 0,1 % sur un mois et de 4,7 % sur un an, en phase avec le consensus (+4,6 %). La consommation réelle demeure solide, avec une croissance d’environ 3,5% en rythme annuel au quatrième trimestre, mais elle semble décélérer en fin d’année. La baisse de la demande en biens durables le mois dernier semble prouver que l’économie américaine ralentit, ce qui était l’objectif de la FED. En novembre, les commandes ont diminué 2,1 %, bien plus que le repli de 0,6 % escompté. Selon l’indice de l’Université du Michigan pour le mois de décembre, les ménages américains s’attendent à une inflation de 4,4 %, contre 4,9 % en novembre. Le CAC40 a terminé la séance du vendredi 23 décembre à 6504,90 points en hausse de 0,81 % sur la semaine quand l’indice phare de la place de Tokyo perdait plus de 4 %. Depuis le début de l’année, les pertes pour le CAC 40 ou le Dow Jones atteignent 8 %. Pour le Nasdaq, la contraction est de toujours de 33 % et pour le S&P500, elle s’élève à près de 20 %.
La Banque centrale du Japon était une des dernières à n’avoir pas procédé au relèvement de ses taux directeurs. Le mardi 20 décembre dernier, face à l’accélération de la hausse des prix, à la dépréciation du yen, son Gouverneur, Haruhiko Kuroda a finalement décidé de se rallier à la politique de hausse des taux. Ce changement de cap met fin de manière relative à la spécificité de la politique monétaire japonaise. L’écart de taux entre le Japon et les Etats-Unis restent néanmoins importantes. La banque centrale japonaise en fixant le plafond du taux des obligations d’Etat à 10 ans à 0,5 % au lieu de 0,25 % reste sur une position accommodante, sachant que le taux équivalent aux Etats-Unis dépasse 3,5 %. Ce changement de cap a néanmoins été durement ressenti par les investisseurs au sein de toutes les grandes places financières. Dans son communiqué, la Banque du Japon a tenté d’apaiser les marchés, assurant que l’élargissement de sa bande de fluctuation n’était qu’un ajustement technique de sa stratégie et non une remise en cause de sa philosophie. Elle a aussi rappelé qu’elle maintenait son objectif de taux d’intérêt à court terme à -0,1 %.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 23 déc. 2022 | Évolution sur une semaine | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 504,90 | +0,81 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 203,93 | +0,62 % | 36 338,30 |
| S&P500 | 3 844,82 | -18,69 % | 4766,18 |
| Nasdaq | 10 497,86 | -2,04 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 940,93 | +0,34 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 473,01 | +1,92 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 817,01 | +0,34 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 26 235,25 | -4,69 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 045,87 | -3,58 % | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,922 % | +0,259 pt | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,392 % | +0,251 pt | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,743 % | +0,268 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0628 | +0,35 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 800,94 | +0,34 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 83,68 | +5,65 % | 78,140 |
Le numéraire de moins en moins utilisé mais toujours présent
Selon une enquête réalisée par la Banque centrale européenne, le paiement en espèces représentait, en 2022, 59 % des transactions dans les commerces, contre 72 % en 2019 et 79 % en 2016. La pandémie de Covid a accéléré la baisse, le paiement par carte ou par téléphone se substituant à celui par numéraire. En France, 50 % des transactions sont payées en espèce.
Selon l’étude, la majorité des transactions en espèces sont utilisées pour des achats de moins de cinq euros. Au-delà de 50 euros, les Européens privilégient la carte bancaire . Le paiement par carte au point de vente est passé de 25 % en 2019 à 34 % en 2022. Désormais, la valeur totale des paiements par carte est supérieur à celle des paiements en numéraire. Le sans contact pour le paiement par carte s’est généralisé aidé en cela par le relèvement de son plafond à 50 euros en 2019, il représente aujourd’hui 62 % des transactions par carte, contre 41 % en 2010. En France, ce taux est inférieur (51 %). Le paiement sur mobile progresse en Europe mais de manière moins rapide qu’en Asie ou aux Etats-Unis. Si le paiement par smartphone en magasin a été multiplié par trois depuis 2019 en Europe, il ne représente que 3 % des transactions. Le commerce en ligne favorisé par les confinements se confirme. En 2022, ils représentent 17 % des achats, contre 6 % en 2019.
La diminution de l’usage du numéraire pour les paiements ne se traduit pas par une baisse de leur encours au sein des ménages. A la fin du premier semestre 2022, les ménages détenaient 275 milliards d’euros en pièces et en billets, contre soit près de 10 milliards d’euros de plus qu’à fin décembre 2021. Depuis le début de la crise covid, l’encours des numéraires des ménages a augmente de 63 milliards d’euros (décembre 2019 – juin 2022 : données Banque de France). Les ménages conservent une proportion plus importante de liquidités à leur domicile par précaution. Par ailleurs, certaines activités (services domestiques, petits travaux de bâtiment, location saisonnières) donnent lieu à des paiements en liquide.
Analyse des résultats du mois de novembre du Livret A
Le Livret A plus fort que l’inflation en novembre
Après la décollecte de 1,11 milliard d’euros en octobre, le Livret A a, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, enregistré une petite collecte, positive, de 600 millions d’euros au mois de novembre. Le LDDS a également, de son côté, bénéficié d’une collecte positive de 430 millions d’euros. L’encours cumulé de ces deux produits atteint 500,5 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record (369,1 milliards d’euros pour le Livret A et 131,3 milliards d’euros pour le LDDS).
Novembre est, pour le Livret A, traditionnellement un mois de décollecte ou de faible collecte. Ces dix dernières années, cinq décollectes ont été enregistrées. En 2021, elle avait été modérée, -90 millions d’euros. Ce mois sans relief n’est pas marqué par des rendez-vous fiscaux ou par des versements de primes. En règle générale, les ménages modèrent leurs versements dans la perspective des fêtes. Le résultat de l’année 2022 souligne que, malgré l’accélération de l’inflation, les ménages ne puisent pas dans leur épargne de précaution ; bien au contraire ils ont effectué plus de versements que de retraits.
Le Livret A, le placement de crise
En 2022, sur les onze premiers mois de l’année 2022, la collecte du Livret A s’élève à 25,78 milliards d’euros ce qui la place parmi les collectes les plus importantes après celles de 2012 (crise des dettes souveraines) et de 2020 (crise sanitaire). En 2022, la guerre en Ukraine et la vague inflationniste qui en a résulté conduisent à une augmentation de la collecte qui a été, de plus, dopée par le relèvement du taux à deux reprises (1er février et 1er août).
Dans un climat anxiogène, les ménages ont maintenu, durant toute l’année, un effort important d’épargne de précaution. Malgré la baisse de leur pouvoir d’achat, ils ont tenu à accroître leur épargne liquide pour faire face à des imprévus et aux augmentations à venir des prix. Ce phénomène est assez traditionnel au début des périodes inflationnistes. L’effet « taux du Livret A » l’est également. Les ménages augmentent leurs versements sur le Livret A le mois de l’annonce du relèvement et durant les deux ou trois mois qui suivent.
« Quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console »
La forte collecte du Livret A en 2022 est surprenante au vu de son rendement réel. Sur l’ensemble de l’année 2022, en tenant compte des deux relèvements, le taux de rémunération du Livret A aura été de 1,375 % quand le taux d’inflation devrait être de 6 %. Le rendement réel devrait donc être négatif de plus de 4,6 % ce qui constituera un record depuis le début des années 1980. Mais, par rapport aux autres produits de taux, le Livret A offre un rendement attractif. Ce dernier est ainsi supérieur, net d’impôt, à celui des fonds euros des contrats d’assurance vie. Seul le Livret d’Epargne Populaire offre un rendement supérieur (4,6 % depuis le 1er août) mais ce produit n’est pas accessible à tous les épargnants. Le Livret A en conciliant sécurité, liquidité et zéro prélèvements demeurent la valeur refuge par excellence.
A l’aube d’un nouveau relèvement
Compte tenu des annonces du Gouverneur de la Banque de France, un relèvement substantiel du taux du Livret A est attendu pour le 1er février 2023. Il devrait se situer entre 3 et 3,5 % ; le taux du Livret d’Epargne Populaire pourrait atteindre 6,5 %. Un effet « taux » est probable en début d’année même si les contraintes de pouvoir d’achat pourraient se faire ressentir un peu plus durement qu’en 2021. La collecte de 2023 devrait néanmoins rester positive tout en étant inférieure à celle de 2022.
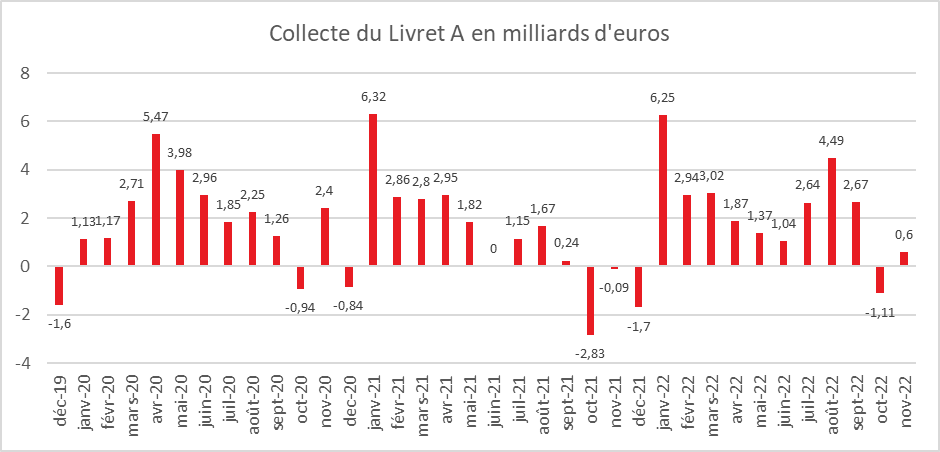
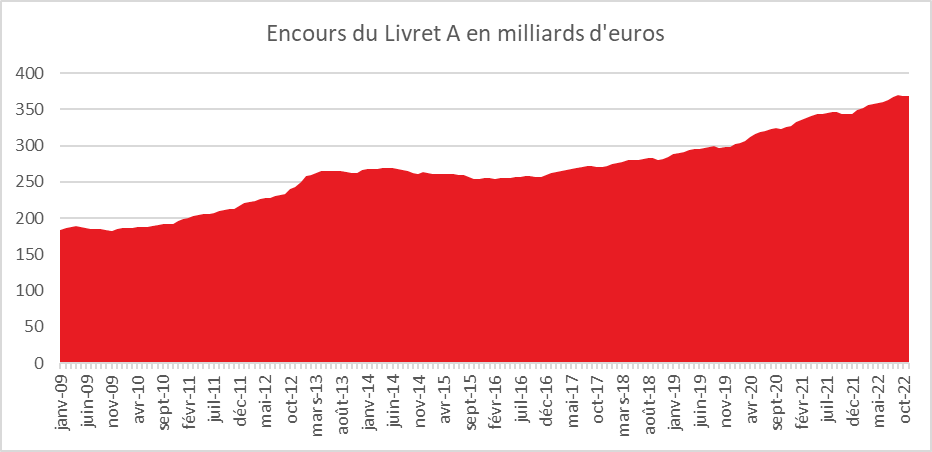
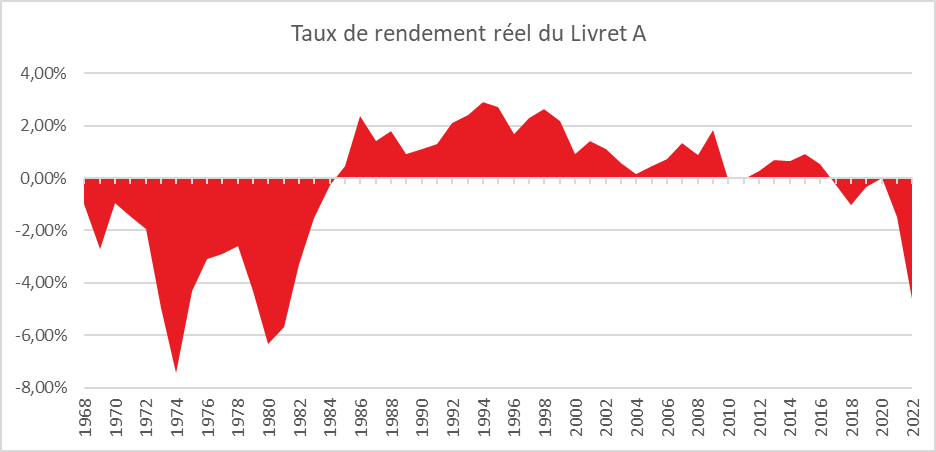
Novembre, le Livret A retrouve des couleurs
Le Livret A plus fort que l’inflation en novembre
Après la décollecte de 1,11 milliard d’euros en octobre, le Livret A a enregistré, selon le communiqué de la Caisse des Dépôts et Consignation, une petite collecte, positive, de 600 millions d’euros au mois de novembre. Le LDDS a également, de son côté, bénéficié d’une collecte positive de 430 millions d’euros. L’encours cumulé de ces deux produits atteint 500,5 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record (369,1 milliards d’euros pour le Livret A et 131,3 milliards d’euros pour le LDDS).
Novembre est, pour le Livret A, traditionnellement un mois de décollecte ou de faible collecte. Ces dix dernières années, cinq décollectes ont été enregistrées. En 2021, elle avait été modérée, -90 millions d’euros. Ce mois sans relief n’est pas marqué par des rendez-vous fiscaux ou par des versements de primes. En règle générale, les ménages modèrent leurs versements dans la perspective des fêtes. Le résultat de l’année 2022 souligne que, malgré l’accélération de l’inflation, les ménages ne puisent pas dans leur épargne de précaution ; bien au contraire ils ont effectué plus de versements que de retraits.
Le Livret A, le placement de crise
En 2022, sur les onze premiers mois de l’année 2022, la collecte du Livret A s’élève à 25,78 milliards d’euros ce qui la place parmi les collectes les plus importantes après celles de 2012 (crise des dettes souveraines) et de 2020 (crise sanitaire). En 2022, la guerre en Ukraine et la vague inflationniste qui en a résulté conduisent à une augmentation de la collecte qui a été, de plus, dopée par le relèvement du taux à deux reprises (1er février et 1er août).
Dans un climat anxiogène, les ménages ont maintenu, durant toute l’année, un effort important d’épargne de précaution. Malgré la baisse de leur pouvoir d’achat, ils ont tenu à accroître leur épargne liquide pour faire face à des imprévus et aux augmentations à venir des prix. Ce phénomène est assez traditionnel au début des périodes inflationnistes. L’effet « taux du Livret A » l’est également. Les ménages augmentent leurs versements sur le Livret A le mois de l’annonce du relèvement et durant les deux ou trois mois qui suivent.
« Quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console »
La forte collecte du Livret A en 2022 est surprenante au vu de son rendement réel. Sur l’ensemble de l’année 2022, en tenant compte des deux relèvements, le taux de rémunération du Livret A aura été de 1,375 % quand le taux d’inflation devrait être de 6 %. Le rendement réel devrait donc être négatif de plus de 4,6 % ce qui constituera un record depuis le début des années 1980. Mais, par rapport aux autres produits de taux, le Livret A offre un rendement attractif. Ce dernier est ainsi supérieur, net d’impôt, à celui des fonds euros des contrats d’assurance vie. Seul le Livret d’Epargne Populaire offre un rendement supérieur (4,6 % depuis le 1er août) mais ce produit n’est pas accessible à tous les épargnants. Le Livret A en conciliant sécurité, liquidité et zéro prélèvements demeurent la valeur refuge par excellence.
A l’aube d’un nouveau relèvement
Compte tenu des annonces du Gouverneur de la Banque de France, un relèvement substantiel du taux du Livret A est attendu pour le 1er février 2023. Il devrait se situer entre 3 et 3,5 % ; le taux du Livret d’Epargne Populaire pourrait atteindre 6,5 %. Un effet « taux » est probable en début d’année même si les contraintes de pouvoir d’achat pourraient se faire ressentir un peu plus durement qu’en 2021. La collecte de 2023 devrait néanmoins rester positive tout en étant inférieure à celle de 2022.
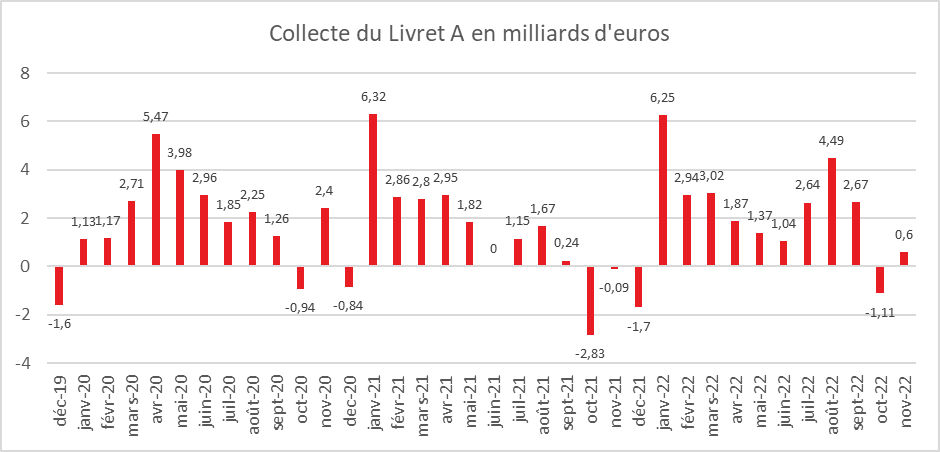
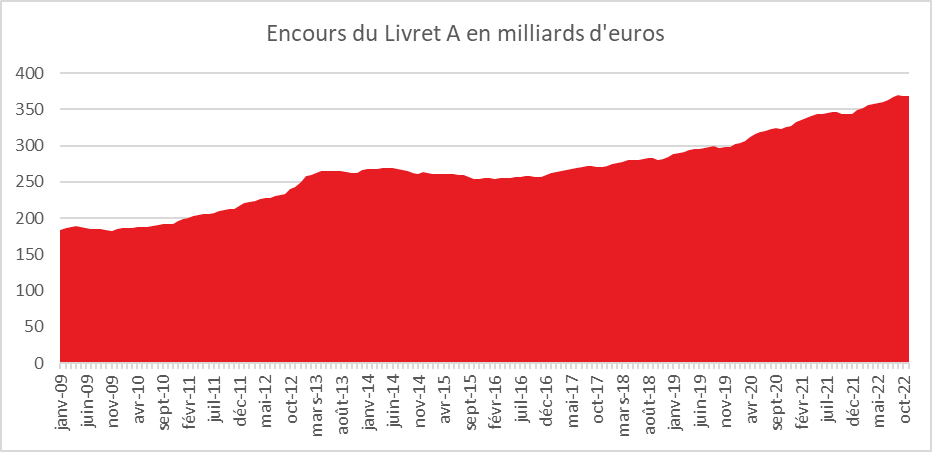
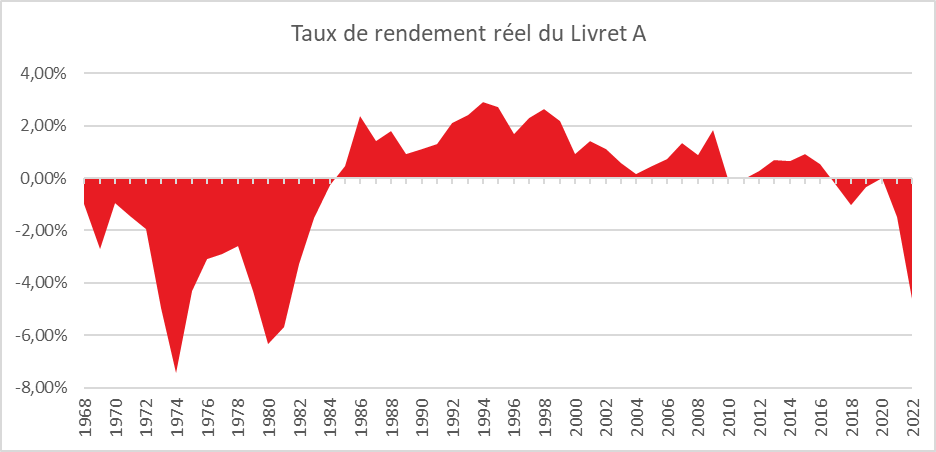
Revalorisation du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale pour 2023
Après 3 années de gel, en 2020, 2021 et 2022, le plafond de la Sécurité sociale (PASS) sera revalorisé de 6,9% à compter du 1er janvier 2023.
Base de calcul du montant des indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou maternité, des pensions d’invalidité, des retraites. du plafond de l’épargne retraite, le plafond de la Sécurité sociale (PASS) est réévalué chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution des salaires. Pour 2023, le plafond mensuel est fixé à 3 666 €, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022 selon l’arrêté publié au Journal officiel du 16 décembre 2022.
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est fixé à 43 992 € en 2023, et le plafond mensuel à 3 666 €, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022.
Le plafond de la Sécurité sociale pour l’année 2023 est fixé à :
- 43 992 € en valeur annuelle ;
- 3 666 € en valeur mensuelle ;
- 202 € en valeur journalière.
- 27 € en valeur horaire.
Le Coin des Epargnants du 17 décembre 2022 : hausse des taux directeurs, marchés en berne
Banques centrales à la manœuvre, marchés en berne
Après un rebond qui aura duré deux mois, le Cac 40 est reparti à la baisse depuis deux semaines avec une accélération en quelques jours du fait des décisions des banques centrales de relever leurs taux directeurs. En deux jours, l’indice parisien a perdu plus de 4 %. Le Cac 40 a terminé la semaine à 6.452,63 points, au plus bas depuis plus d’un mois. Depuis le début de l’année, les pertes sont à nouveau supérieures à 10 %. Les investisseurs ont intégré la poursuite du durcissement de la politique monétaire dans les prochains mois avec, à la clef, un ralentissement plus marqué de l’activité. L’atterrissage était attendu, la hausse depuis la fin du mois d’octobre étant en partie déconnectée des réalités économiques. L’inflation sera plus dure à éliminer que prévu et le poids des incertitudes demeure élevé.
Après les annonces de la BCE, les taux des obligations des Etats européens sont repartis à la hausse et, par ricochet, l’euro s’est également apprécié.
La semaine a été, en effet, marquée par les relèvements de taux directeurs effectués par de nombreuses banques centrales (BCE, FED, Banque d’Angleterre, etc.). Depuis le début de l’année, les banques centrales du monde entier ont procédé à 284 hausses de taux, selon le calcul de la Bank of America Securities.
Comme anticipé par les opérateurs, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux directeurs de 50 points de base qui évoluent désormais dans la fourchette de 4,25 à 4,50 %. Ce relèvement est le septième consécutif, les quatre précédents avaient été de 75 points de base. Les taux directeurs américains sont désormais à leur plus haut niveau depuis 15 ans. Les responsables de la Fed prévoient un taux médian à 4,4 % fin 2022, à 5,1 % fin 2023 et à 4,1 % en 2024. Leurs estimations sont supérieures de 0,5 point à celles formulées au mois de septembre. La banque centrale américaine ne prévoit plus qu’une croissance du PIB de 0,5 % l’année prochaine, contre 1,2 % auparavant. La prévision d’inflation PCE est fixée à 3,1 % fin 2023, contre 2,8 % précédemment. Le taux de chômage devrait, de son côté, passer de 3,7 % fin 2022 à 4,6 % fin 2023 et se stabiliser à ce niveau en 2024 avant de reculer légèrement à 4,5% en 2025.
Durant la conférence de presse du 14 décembre, le Président de la FED, Jerome Powell, a tenu des propos relativement pessimistes en ce qui concerne l’inflation. Il ainsi indiqué que « nous allons entrer dans une nouvelle année avec une inflation supérieure à nos attentes ». Il a souligné que la Fed attendait « des progrès plus importants sur le front des prix » Il a néanmoins reconnu que les résultats de l’inflation du mois de novembre témoignent d’une accalmie, ajoutant que « nous pensons qu’il est désormais approprié de passer à un rythme de hausse des taux plus lent ». Jerome Powell a affirmé malgré tout que la politique monétaire restera restrictive tant que l’inflation dans les services ne ralentira pas.
La Banque centrale européenne a imité la FED en relevant également ses taux directeurs de 50 points de base. Le taux de dépôt est ainsi passé à 2 %, celui de la facilité de refinancement à 2,5 %, et celui de la facilité de prêt marginale à 2,75 %. Ce relèvement de 50 points de base rompt avec les deux hausses de 75 points de base intervenues en septembre et en octobre. En six mois, les taux directeurs ont augmenté de 200 points de base. Une intensité jamais vue depuis la création de la banque centrale en 1999. Comme aux Etats-Unis, le pic d’inflation serait atteint ou en voie d’être atteint. Elle est passée de 10,6 % sur 12 mois en octobre à 10 % en novembre. Les dernières prévisions macroéconomiques de la banque centrale européenne ont été revues à la hausse concernant l’évolution des prix. L’inflation se situerait à 6,3 % en 2023 et s’élèverait encore à 2,4 % en 2025. Dans ce contexte, les taux directeurs devraient dépasser 3 % en 2023. La Présidente de la BCE, Christine Lagarde, a indiqué jeudi 15 décembre que le bilan de la banque centrale sera amené à se réduire. Cette dernière a acquis un portefeuille de 5 000 milliards d’euros d’obligations depuis 2015, afin de soutenir l’économie. Dans un contexte de flambée de l’inflation, la BCE a mis fin à ses achats nets mais continue à réinvestir chaque mois les montants issus du remboursement des obligations arrivées à échéance. Ces opérations constituent une pression à la baisse sur les coûts de financement en zone euro, quand la banque centrale souhaite au contraire les faire progresser pour réduire la hausse des prix. D’après le communiqué, la banque centrale diminuera progressivement les réinvestissements à compter de mars 2023. La réduction sera plafonnée à 15 milliards d’euros par mois jusqu’à la fin du deuxième trimestre, correspondant à la moitié du montant des remboursements mensuels sur cette période. Cette réduction du bilan sera réalisée avec précaution car elle peut générer des écarts de taux pour les emprunts des États de la zone euro. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et membre de droit de la BCE, a indiqué vendredi 16 décembre que le combat contre l’inflation n’était pas encore gagné. Il a précisé que La deuxième mi-temps pourrait durer plus longtemps que la première. » Elle se mène un peu différemment, il y a un jeu plus sophistiqué. Sur les taux d’intérêt, on ne joue pas seulement sur le rythme, que nous avons réduit, mais on joue sur la hauteur, c’est-à-dire le niveau terminal, puis on joue sur la durée », a-t-il ajouté.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 16 déc. 2022 | Évolution sur une semaine | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 452,63 | -3,37 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 920,46 | -2,31 % | 36 338,30 |
| S&P500 | 3 852,36 | -2,66 % | 4766,18 |
| Nasdaq | 10 705,4 | -2,89 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 893,07 | -3,29 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 332,12 | -1,99 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 803,97 | -3,51 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27 527,12 | -1,34 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 167,86 | -1,22 % | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,663 % | +0,272 pt | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,141 % | +0,214 pt | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,475 % | -0,079 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1.0605 | +0,65 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 787.82 | -0,40 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 79.25 | +3,69 % | 78,140 |
L’or, stop ou encore
En période d’inflation, des épargnants, sont tentés de se protéger en investissant une partie de leurs liquidités dans l’or. Cette tentation est plus forte encore quand l’inflation est due à un conflit militaire. Le métal précieux qui a perdu depuis plus de cinquante ans son rôle d’étalon monétaire continue néanmoins de jouer celui de valeur refuge. Si le cours de l’or a connu une augmentation rapide au début de la crise sanitaire, il demeure stable depuis la résurgence de l’inflation, et cela malgré la chute des cryptoactifs.
Depuis le début de l’année 2022, l’once d’or s’échange à environ 1 800 dollars. Au 13 décembre 2022, sur un an, son cours est stable (-0,30 %). Sur 3 ans, en revanche, la hausse est de 20,71 % et de 43,03 % sur cinq ans, offrant d’importantes plus-values pour les détenteurs d’or sur moyenne période.
La crise sanitaire explique les cours actuels de l’or en ayant provoqué un afflux de liquidité sur le métal jaune. La guerre en Ukraine n’a pas, en revanche, entraîné une forte hausse malgré son caractère inflationniste. Le relèvement des taux directeurs par les grandes banques centrales amène les investissements à se porter sur les obligations d’État.
Les tensions inflationnistes et les incertitudes économiques ainsi que géopolitiques favorisent néanmoins le maintien d’un prix élevé de l’or. L’appréciation du dollar depuis le début de la crise sanitaire a minoré facialement le cours de l’or pour deux raisons : les investisseurs ont privilégié les placements en dollars et la valeur de l’or, exprimée dans les autres devises, a augmenté.
Cours de l’or en dollars

Le cours de l’or dépend de la production d’or, de la demande émanant des banques centrales et de celles des investisseurs privés ainsi que des besoins de l’industrie et de la bijouterie/orfèvrerie. L’or sorti de terre ou de l’eau est estimé à 177 200 tonnes qui se répartissent entre la bijouterie (85 900 tonnes), l’épargne (35 500 tonnes), les réserves des banques centrales et autres institutions officielles comme le FMI (30 500 tonnes) ainsi que les applications industrielles (21 600 tonnes). Les réserves des gisements encore à exploiter sont évaluées à 54 000 tonnes d’or (source : World Gold Council).
À court terme, le prix de l’or dépend de plusieurs facteurs : l’inflation, la politique des taux pratiquée par les banques centrales, les tensions internationales, la situation économique et la solvabilité des États.
Le consensus estime que l’inflation devrait s’assagir dans le courant de l’année 2023 en raison d’un effet base (la hausse des cours de l’énergie étant intervenue à la fin du premier trimestre 2022) et du ralentissement de l’économie mondiale en lien avec la hausse des taux d’intérêt. Cette décrue attendue de l’inflation devrait amener à une baisse du cours de l’or.
Malgré tout, plusieurs facteurs pourraient favoriser le maintien d’une inflation élevée : la poursuite de la guerre en Ukraine et des tensions internationales, l’enclenchement d’une spirale prix/salaire, la réaction modérée des banques centrales en lien avec les problèmes de solvabilité des États et des établissements financiers.
Augmentation de la dette publique en France
À la fin du troisième trimestre, la dette publique au sens de Maastricht s’établit, selon l’INSEE, à 2 956,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 40,0 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. Elle s’élève désormais à 113,7 % du PIB, après 113,3 % au trimestre précédent.
L’augmentation de la dette brute des administrations publiques résulte de celles de l’État et des administrations de sécurité sociale. Au troisième trimestre, la contribution de l’État à la dette publique augmente de plus de 36 milliards d’euros. L’État continuant de puiser dans sa trésorerie ce trimestre (‑23,6 milliards d’euros), sa dette nette est en forte augmentation, + 60,6 milliards d’euros sur un trimestre. La contribution des administrations de sécurité sociale (Asso) à la dette publique s’accroît ce trimestre de 8,8 milliards d’euros. en revanche, la contribution des administrations publiques locales est en baisse (-6,2 milliards d’euros). Les collectivités locales se sont désendettées de 5,7 milliards d’euros dont 2,4 milliards d’euros pour les communes, 2,2 milliards d’euros pour les régions et 1,1 milliard d’euros pour les départements.
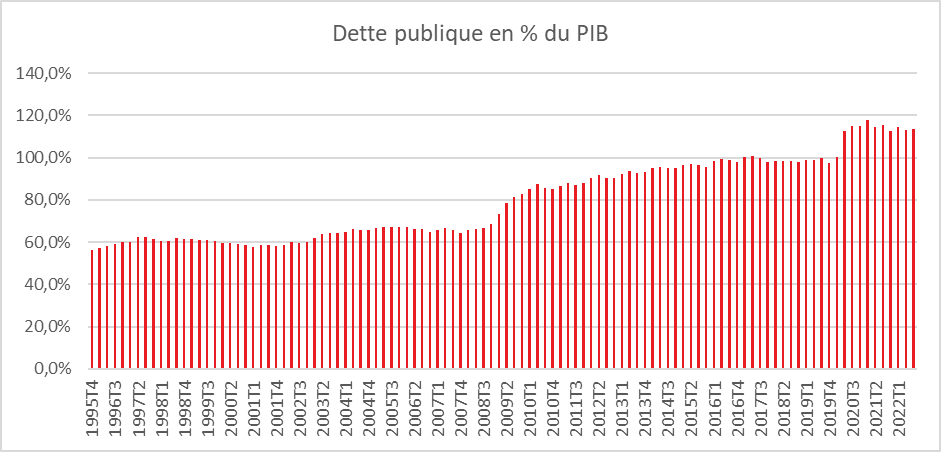
Plan d’Epargne Logement : les nouveaux taux en vigueur au 1er janvier 2023
Le taux de rémunération du Plan d’Epargne Logement qui était de 1% pour tous les plans ouverts depuis le 1er août 2016 passera à 2 %. Après application du prélèvement forfaire unique, le taux net sera de 1,4 % contre 0,7 % précédemment. Le taux des prêts consentis dans le cadre des PEL passera de 2,20 à 3,20 % également à compter du 1er janvier 2023. Ce taux s’applique également aux Plans ou verts après le 1er janvier et pour la totalité de leur durée. Les ménages qui ont ouvert récemment un PEL pourraient avoir intérêt à le fermer pour bénéficier du meilleur de taux de rémunération surtout si leur objectif n’est pas l’obtention d’un prêt. La fermeture des plans de moins de deux ans entraine leur transformation en Compte d’Epargne Logement qui est rémunéré actuellement à 1,25 % (deux tiers du taux du Livret A). Les détenteurs de PEL récents sont même gagnants en cas de fermeture.
Le Coin des Epargnants du 10 décembre 2022 : en attendant les fêtes
Le cours du pétrole en-dessous de 80 dollars le baril
Après neuf semaines consécutives de hausse, le CAC 40 a abandonné cette semaine près de 1 %. Les investisseurs sont toujours attentifs à l’évolution des prix et ont opté pour un profil attentiste en attendant la décision du comité monétaire de la banque centrale américaine sur les taux prévue en milieu de semaine prochaine. Les investisseurs profitent également des augmentations de ces dernières semaines sur les marchés actions pour engranger des plus-values avant la clôture de l’année.
Les taux d’intérêt sur les obligations d’Etat en Europe poursuivent leur mouvement de recul dans un contexte de ralentissement de la croissance qui pourrait amener la BCE à infléchir sa politique dans les prochains mois.
Pour la première fois depuis le mois de janvier, le cours du pétrole est repassé en-dessous des 80 dollars, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les consommateurs et pour l’inflation. Le recul du cours s’explique par des prévisions de demande toujours orientée à baisse. Le redémarrage de trois réacteurs nucléaires français contribue par ailleurs à détendre le marché de l’électricité en Europe. Désormais, sur les 56 réacteurs dont la France dispose, 40 sont en fonctionnement, soit dix de plus qu’au milieu de l’été.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 9 déc. 2022 | Évolution sur une semaine | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 677,64 | -0,96 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 475,60 | -2,77 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 004,62 | -3,59 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 14 370,72 | -1,09 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 476,63 | -1,05 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 939,22 | -0,90 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27 901,01 | -0,73 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 206,95 | +1,31 % | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,391 % | +0,088 pt | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +1,927 % | +0,082 pt | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,554 % | -0,011 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0537 | +0,01 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 800,21 | +0,42 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,61 | -10,29 % | 78,140 |
Le taux du Plan d’Epargne Logement revalorisé à compter du 1er janvier 2023
Environ 14 millions de Français détiennent un Plan d’Epargne Logement. L’encours de ce produit s’élevait à 281 milliards d’euros. Son faible rendement et sa fiscalisation intervenue depuis le 1er janvier 2018 ont entraîné son déclin au niveau de la collecte et à la stagnation de son encours.
Le 1er janvier 2023, le taux du Plan d’Épargne Logement passera de 1 à 2 %. Il était à 1 % depuis le 1er août 2016.
En vertu de l’arrêté du 27 janvier 2011, le taux du Plan d’Épargne Logement est calculé à partir des taux de contrat d’échange de taux d’intérêt (« taux swap ») à 2 ans, 5 ans et 10 ans en application de la formule suivante : la somme des sept dixièmes du taux swap à 5 ans et des trois dixièmes de la différence entre le taux swap à 10 ans et le taux swap à 2 ans, arrondie au quart de point supérieur.
Avec l’augmentation des taux d’intérêt, la formule conduit à un rendement de taux de 2 % pour le PEL. À la différence du Livret A, du LDDS ou du LEP, ce taux s’appliquera à tous les nouveaux plans ouverts à compter du 1er janvier 2023 et durant leur durée de vie. En revanche, les plans qui seront ou qui ont été ouverts avant le 1er janvier 2023, conservent le taux de rendement en vigueur au moment de leur ouverture.
À 2 %, le taux du PEL demeure peu attractif d’autant plus que ce produit est assujetti aux prélèvements obligatoires (prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou prélèvements sociaux et impôt sur le revenu). Net de prélèvements, le taux est de 1,4 %, soit bien moins que celui du Livret A. Compte tenu de l’inflation en cours, son rendement réel restera fortement négatif.
Certains épargnants pourraient avoir néanmoins avantage à fermer leur PEL pour basculer sur un nouveau PEL à 2 %. Cela concerne ceux qui ont souscrit un PEL ouvert depuis le 1er août 2016 et encore plus ceux qui l’ont ouvert après le 1er janvier 2018. Seuls ceux qui souhaitent bénéficier du prêt associé au PEL pourraient trouver avantage à le conserver pour bénéficier d’un taux de crédit plus faible. En revanche, ceux qui ont ouvert leur PEL dans une optique d’épargne pure devraient basculer sur un nouveau PEL.
En outre, en cas de fermeture des plans de moins de quatre ans, ces derniers sont transformés en Compte d’Epargne Logement qui, actuellement, bénéficie d’une meilleur rémunération que le PEL (1,25 % car son taux est égal à deux tiers de celui du Livret A). Il sera même intéressant d’attendre le 1er février 2023 qui sera marqué par l’augmentation du taux du CEL. En effet, logiquement, le taux du Livret A et du LDDS devraient passer à 3 % et celui du CEL à 2 %. Le PEL devrait de ce fait rester peu compétitif. Seuls les détenteurs de vieux Plans d’Épargne Logement bénéficiant de taux élevés ont intérêt à conserver leur placement.
Le Coin des Epargnants du 3 décembre 2022 : les marchés « actions » font une pause avant les fêtes
Novembre sourit aux marchés
Les places boursières ont confirmé, en novembre, le rebond du mois d’octobre au point d’effacer une grande partie des pertes enregistrées depuis le début de l’année. Le CAC 40 était ainsi revenu, à fin novembre, à moins de 6 % de son niveau du 1er janvier 2022 quand le recul dépassait 15 % il y a encore quelques semaines. Les investisseurs estiment que la phase d’amplification de l’inflation est en passe d’être surmontée et qu’une décrue est possible. Avec le ralentissement attendu de la croissance, les banques centrales sont censées réduire les relèvements de leurs taux directeurs avant d’envisager, dans un second temps, leur arrêt. Les perspectives d’un assouplissement de la politique du zéro covid en Chine explique également l’optimisme raisonné des marchés.
L’euro s’est redressé durant le mois de novembre. L’écart de taux avec les États-Unis est, en effet, amené à se réduire encore. La BCE devrait remonter ses taux directeurs de 0,75 point quand la FED devrait passer à des hausses de 0,5 point même si la publication des derniers résultats de l’emploi aux Etats-Unis pourrait aller à l’encontre de ce souhait.
Le changement d’appréciation des investisseurs sur la politique monétaire des banques centrales a provoqué une légère décrue des taux d’intérêt sur les obligations d’État. Le taux de l’OAT à 10 ans est revenu à 2,4 % au 20 novembre quand il avait surfé sur la crête des 3 % en septembre. Celui de son homologue américain est désormais inférieur à 4 %.
Avec une demande mondiale revue en baisse, les prix du pétrole sont orientés à la baisse. Le cours du baril Brent est repassé en-dessous des 90 dollars. Il a diminué sur l’ensemble du mois de novembre de près de 11 %.
Attentisme avant les décisions des banques centrales
Comment interpréter l’inversion des taux ?
Le passage des taux longs au-dessous des taux courts, ce qui est le cas, depuis le mois de juillet aux États-Unis pour les taux à 10 et à 2 ans, signifiait dans le passé l’arrivée prochaine d’une récession. Des doutes se font jour sur la validité de cette corrélation. Dans une situation normale, les taux « courts » sont inférieurs aux taux « longs ». Plus les agents économiques prêtent à long terme, plus ils attendent à être mieux rémunérés. La pente de la courbe est dite dans ce cas positive. La baisse des taux longs intervient quand les investisseurs optent par précaution pour les produits les plus sûrs : les obligations des États les mieux notés ou quand ces derniers anticipent une diminution des taux directeurs des banques centrales. La diminution des taux longs actuels semble provenir avant tout des anticipations sur les taux. Avec le ralentissement de l’économie et compte tenu des niveaux de l’endettement, les investisseurs estiment que le processus de hausse des taux directeurs arrive à son terme. Ils considèrent par ce fait que la bataille contre l’inflation est en voie d’être gagnée. Cette inversion peut également signifier que la récession est dorénavant certaine et qu’elle pourrait durer. Jusqu’en 2008, l’inversion des taux était un bon indicateur avancé des récessions. Depuis la crise financière et le développement des politiques monétaires expansives, le lien de causalité entre ces deux facteurs est plus incertain. La manipulation des taux et de l’évolution de la masse monétaire semblent l’avoir faussé.
Les marchés déçus par les bons résultats de l’emploi américain
Attendues à 200 000, les créations d’emploi, aux Etats-Unis, ont atteint 263 000 en novembre, après 284 000 en octobre. L’économie américaine refuse de ralentir malgré la hausse des taux. S’il s’agit du plus faible gain d’emplois depuis avril 2021, le marché du travail n’en reste pas moins tendu, supérieur à la moyenne de 150 000 à 200 000 emplois créés par mois avant la pandémie. Le taux de chômage est resté stable à 3,7 % de la population active et le salaire horaire moyen a augmenté de 0,6 % au cours du mois, soit le double de l’estimation du marché, et de 5,1 % sur un an, ce qui est également bien supérieur aux prévisions de 4,6 %. Pour la banque centrale américaine, la Réserve Fédérale, cette situation commence à devenir une énigme. Elle pensait pouvoir modérer les relèvements à 50 points de base mais la poursuite des créations d’emploi pourrait la conduire à opter pour une hausse de 75 points de base.
Après plusieurs semaines de hausses, en lien avec l’espoir d’une maîtrise rapide de l’inflation, les marchés ont opté, ces cinq derniers jours, pour l’attentisme. Le CAC 40 a terminé à 6 742,25 points, en légère hausse de 0,44 % sur la semaine. Cette hausse hebdomadaire est la neuvième consécutive, série inédite depuis la période mars-mai 2009. Outre-Atlantique, l’indice Dow Jones est resté stable quand le Nasdaq a progressé de 1,5 % sur la semaine.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 2 déc. 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 742,250 | +0,44 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 429,88 | +0,04 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 461.50 | +1,50 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 14 529,9 | -0,20 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 556,23 | +0,98 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 977,28 | +0,16 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27 777,90 | -1,79 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 156,14 | +1,76 % | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,303 % | -0,116 pt | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +1,845 % | -0,109 pt | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,565 % | -0,131 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0522 | +0,78 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 795,76 | +2,44 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,76 | +3,54 % | 78,140 |
La Première Ministre précise le contour de la réforme des retraites
Après l’élection présidentielle, malgré l’opposition des syndicats sur la question de l’âge de départ à la retraite, un nouveau cycle de concertation a été engagé. Parmi les thèmes de concertation figurent : l’emploi des seniors et l’usure professionnelle; l’équilibre des régimes de retraite ; l’équité entre les femmes et les hommes, les petites pensions, les carrières interrompues ; les régimes spéciaux ; l’équilibre des systèmes de retraite ; le déficit et les mesures à adopter.
La fin des concertations est attendue pour la mi-décembre, le gouvernement devant présenté au Parlement un projet de loi avant la fin du mois de mars. La Première Ministre Elisabeth Borne a présenté lors d’une interview au quotidien Le Parisien ses premières propositions de réforme.
Report de l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans
La Première Ministre a confirmé le principe d’un report à 65 ans de l’âge légal qui commencerait à s’appliquer dès la génération 1961. aurait l’intention de porter progressivement à 65 ans l’âge légal de départ à la retraites. Cet âge serait augmenté de quatre mois chaque année à compter de 2023.
| Génération | Age légal de départ à la retraite | |
| 2023 | Génération 1961 | 62 ans et 4 mois |
| 2024 | Génération 1962 | 62 ans et 8 mois |
| 2025 | Génération 1963 | 63 ans |
| 2026 | Génération 1964 | 63 ans et 4 mois |
| 2027 | Génération 1965 | 63 ans et 8 mois |
| 2028 | Génération 1966 | 64 ans |
| 2029 | Génération 1967 | 64 ans et 4 mois |
| 2030 | Génération 1968 | 64 ans et 8 mois |
| 2031 | Génération 1969 | 65 ans |
Accélération de la réforme Touraine ?
La Première Ministre n’est pas complètement fermée à l’idée de jouer également sur le paramètre de la durée de cotisation avec une accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine. Celle-ci prévoit de porter progressivement le nombre de trimestres cotisés ou validés à 172. Initialement, cette durée est censée s’appliquer totalement à compter de la génération 1973.
L’âge d’annulation de la décote resterait à 67 ans
Le Gouvernement ne modifierait pas l’âge de la retraite à taux plein sans décote qui est actuellement fixé à 67 ans. Actuellement, les assurés qui n’ont pas le nombre requis de trimestres au moment de la liquidation de leur retraite et ayant l’âge d’ouverture des droits subissent une décote. Elle est de 1,25 % par trimestre manquant, sans pouvoir excéder 12,5 % Cette décote ne s’applique plus à compter de 67 ans.
Carrière longue et report de l’âge de départ à la retraite
L’âge de départ des carrières longues devrait être reculé si l’âge légal passe à 64 ou 65 ans. Un dispositif spécifique serait néanmoins prévu pour les carrières « super longues », entamées avant 16 ans.
La clause du grand père pour les régimes spéciaux
En s’inspirant de la réforme de la SNCF en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les régimes spéciaux des industries électriques et gazières et de la RATP s’éteindraient progressivement, les nouveaux entrants dans les entreprises concernées étant rattachés au régime général.
Réforme du Compte Professionnel de Prévention (C2P)
À la fin novembre, selon le ministère du Travail, les partenaires sociaux convergeraient sur certaines évolutions du C2P proposées par le gouvernement. Le nombre de facteurs serait notamment accru en reprenant une partie de ceux éliminés en 2017 (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques) et le compte serait déplafonné. Actuellement, les salariés exposés à certains risques (travail de nuit, bruit, températures extrêmes…) ne peuvent pas accumuler plus de 100 points. Ce plafond serait relevé avec à la clef une « meilleure valorisation de la poly-exposition ». Le C2P pourrait financer une reconversion après une certaine période d’exposition. À la différence du compte de pénibilité, les critères d’application du nouveau C2P seraient plus individualisés et pourraient faire l’objet d’accord au niveau des branches professionnelles.
L’objectif serait de redonner corps au C2P sachant que depuis 2015 moins de 10 000 salariés l’ont utilisé pour partir plus tôt à la retraite.
Création d’un index senior non-contraignant
Parmi les pistes permettant de lutter contre l’usure professionnelle, le gouvernement étudie la possibilité d’instaurer un index senior, qui mesurerait le taux d’emploi des plus de 50 ans, par entreprise ou par branche. À la différence de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes, il pourrait ne pas être accompagné de sanctions.
Revalorisation de la pension minimale servie par les régimes par répartition
Le gouvernement veut fixer le minimum contributif applicable aux assurés ayant une pension à taux plein à 1 130 euros, soit 85 % du Smic net.
**
*
Le calendrier retenu par le gouvernement est serré et pourrait dériver sur l’ensemble du premier semestre. Ce dernier devra obtenir une majorité relative pour l’adoption de son projet de loi ce qui suppose le ralliement ou l’abstention des Républicains à l’Assemblée nationale, Républicains qui sont logiquement favorables au report de l’âge légal. Néanmoins, le soutien sur un texte majeur souhaité par le Président de la République pourrait être interprété comme la création d’une coalition implicite. Le gouvernement pourrait recourir au 49-3 (adoption sans vote avec engagement de la responsabilité du gouvernement). Ce recours est possible hors projets de loi de finances pour un texte par session. Néanmoins, compte tenu de la sensibilité de l’opinion sur le sujet du report de l’âge de départ à la retraite, cette option n’est pas sans danger.
Augmentation de la rémunération des livrets bancaires
Avec la hausse des taux, le taux de rémunération des livrets ordinaires est en augmentation au mois d’octobre et a, selon la Banque de France, atteint 0,28% contre 0,09% en début d’année.
La rémunération moyenne des dépôts bancaires progresse à nouveau à 0,80 % en octobre, après 0,74 % en septembre.
La hausse est portée principalement par les dépôts des SNF, dont la rémunération s’établit à 0,28 % après 0,16% en septembre.
Le taux de rémunération des dépôts des ménages s’établit à 1,15 % en octobre, après 1,12 % en septembre.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| oct- 2021 | août-2022 | sept- 2022 (e) | oct- 2022 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,41 | 0,71 | 0,74 | 0,80 |
| Ménages | 0,63 | 1,12 | 1,13 | 1,15 |
| dont : – dépôts à vue | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,39 | 0,42 | 0,57 | 0,98 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,79 | 0,70 | 0,71 | 0,71 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 2,15 | 2,16 | 2,16 |
| dont : livret A | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| – livrets ordinaires | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,28 |
| – plan d’épargne-logement | 2,58 | 2,58 | 2,56 | 2,58 |
| SNF | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,28 |
| dont : – dépôts à vue | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,13 | 0,22 | 0,39 | 0,80 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,65 | 0,66 | 0,71 | 0,86 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 1,25 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,55 | 0,40 | 1,01 | 1,43 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,35 | 1,11 | 1,95 | 2,34 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
L’assurance vie, du surplace, en octobre
L’assurance vie entre deux eaux
En octobre, la collecte nette en assurance vie est négative, selon France Assureurs, de 300 millions d’euros, faisant suite à la collecte positive de 500 millions du mois de septembre. Depuis le mois de juin, le premier placement des ménages fait du surplace alternant entre collectes positives et négatives. Les assurés ne manifestent pas une défiance à l’égard du placement mais optent pour un attentisme. Le taux d’épargne étant en hausse ces derniers mois, la décollecte n’est pas imputable directement à l’inflation ou à la baisse du pouvoir d’achat. La faiblesse du rendement des fonds euros qui est désormais inférieur, en moyenne, à celui du Livret A et la volatilité des marchés boursiers dissuadent les ménages d’effectuer des versements sur leurs contrats. Par ailleurs, en période d’inflation, les livrets d’épargne de précaution sont traditionnellement privilégiés.
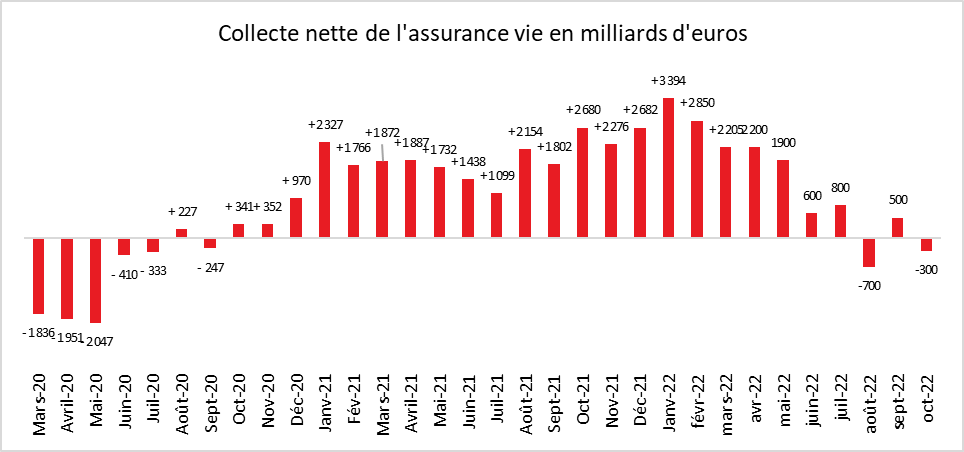
Lors de ces dix dernières années, le mois d’octobre n’avait jamais connu de décollecte, même en 2012, lors de l’annus horribilis de l’assurance vie et en 2020, avec la crise sanitaire, où des petites collectes positives avaient été enregistrées. 2022 marque donc une rupture. Le résultat négatif du mois d’octobre est avant tout imputable à la contraction des cotisations. Elles se sont élevé à 11,5 milliards d’euros en baisse de 1,5 milliard d’euros par rapport à octobre 2021. Depuis le début de l’année, elles atteignent 119,3 milliards d’euros, en recul de 2,5 % par rapport à la même période en 2021. La part des cotisations en unités de compte demeure à 39 % depuis le début de l’année.
En octobre, les prestations ont été en légère augmentation à 11,8 milliards d’euros (+1,3 milliard d’euros par rapport à octobre 2021). Depuis le début de l’année, elles s’établissent à 107,0 milliards d’euros, en hausse de 2,4 milliards d’euros. Cette progression concerne uniquement les supports euros (+2,8 milliards d’euros).
Depuis le début de l’année, la collecte a été +12,3 milliards d’euros, inférieure de 5,4 milliards d’euros par rapport à la même période de 2021. Les fonds euros sont en décollecte de 17,1 milliards d’euros quand les unités de compte enregistrent une collecte nette positive de 29,4 milliards d’euros. Les ménages diminuent à la marge leur exposition au fonds euros, ces derniers demeurant de loin le premier support de l’assurance vie (78 %) au niveau de l’encours qui était de 1 827 milliards d’euros à fin octobre.
L’assurance vie devrait poursuivre son surplace jusqu’à la fin de l’année en raison des incertitudes économique et dans l’attente des communications des rendements sur les fonds euros qui devraient intervenir entre la fin décembre et la fin janvier. Une hausse des taux de rendement est attendue grâce à une mobilisation des réserves des assureurs. Le taux moyen des fonds euros devrait se situer autour de 1,8 % – 2 %. En prenant en compte l’inflation, il sera en territoire négatif mais devrait être proche de celui du Livret A.
Le PER, un produit d’épargne automnal
En octobre, les cotisations sur un PER assurantiel ont atteint 762 millions d’euros. Le produit continue sa montée en puissance avec une hausse de ses cotisation de 55 % en un an. Il bénéficie des transferts en provenance des anciens produits d’épargne retraite. Depuis le début de l’année, les cotisations sur le PER individuels s’élèvent à 5,7 milliards d’euros, en hausse de +38 % par rapport à 2021 sur la même période.
Sur le mois d’octobre, 65 400 nouveaux assurés ont souscrit un PER auprès d’une entreprise d’assurance et 12 700 assurés ont également transféré d’anciens contrats vers un PER.
La collecte nette des PER s’est élevé à +628 millions d’euros en octobre et à +4,5 milliards d’euros depuis le début de l’année. À la fin du mois d’octobre, 3,6 millions d’assurés détenaient un PER pour un encours de 44,4 milliards d’euros.
Le PER qui bénéficie d’un avantage fiscal important est un produit d’épargne d’automne, les ménages effectuant des versements en fin d’année afin de pouvoir bénéficier d’un allégement fiscal en 2023. Le débat sur les retraites qui est par nature anxiogène favorise également la collecte. Une large majorité de Français craint une forte baisse du pouvoir d’achat au moment du passage à la retraite. Selon le sondage du Cercle de l’Épargne (avril 2022), 72 % estiment que leurs pensions seront insuffisantes pour vivre correctement à la retraite.
Le mois de novembre sourit aux marchés
Les places boursières ont confirmé en novembre le rebond du mois d’octobre au point d’effacer une grande partie des pertes enregistrées depuis le début de l’année. Le CAC 40 était fin novembre à moins de 6 % de son niveau du 1er janvier quand le recul dépassait 15 % il y a encore quelques semaines. Les investisseurs estiment que la phase d’amplification de l’inflation est en passe d’être surmontée et qu’une décrue est possible. Avec le ralentissement de la croissance, les banques centrales sont censées réduire les relèvements voire dans un second temps les arrêter. Les perspectives d’un assouplissement de la politique du zéro covid en Chine explique également l’optimisme raisonné des marchés. L’euro s’est redressé durant le mois de novembre, l’écart de taux avec les Etats-Unis est, en effet, amené à se réduire. La BCE devrait remonter ses taux directeurs de 0,75 point quand la FED devrait passer à des hausses de 0,5 point. Le changement d’appréciation des investisseurs sur la politique monétaire des banques centrales a provoqué une légère décrue des taux d’intérêt sur les obligations d’Etat. Le taux de l’OAT à 10 ans est revenu à 2,4 % au 20 novembre quand il avait surfé sur la crête des 3 % en septembre. Celui de son homologue américain est désormais inférieur à 4 %.
Avec une demande mondiale en faible croissance, les prix du pétrole sont orientés à la baisse. Le cours du baril Brent est repassé en-dessous des 90 dollars. Il a baisse sur le mois de novembre de près de 11 %.
Tableau de bord des marchés financiers
| Résultats – novembre 2022 | |
| CAC au 31 décembre 2021 CAC au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 7 153,03 6 738,550 +7,4 % -2,1 % |
| Daxx au 31 décembre 2021 DAXX au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 15 884,86 14 397,040 +8,6 % -7,0 % |
| Footsie au 31 décembre 2021 Footsie au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 7 384,54 7 573,050 +6,0 % -2,6 % |
| Euro Stoxx au 31 décembre 2021 Eurostoxx au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 4 298,41 3 964.72 +9,38 % -2,62 % |
| Dow Jones au 31 décembre 2021 Dow Jones au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 36 338,30 34.589,77 +5,12 % -0,22 % |
| Nasdaq au 31 décembre 2021 Nasdaq au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 15 644,97 11.468,00 +3,18 % -27,03 % |
| Nikkei au 31 décembre 2021 Nikkei au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 28 791,71 27 968,99 +1,38 % +0,53 % |
| Shanghai Composite au 31 décembre 2021 Shanghai Composite au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 3 639,78 3 151,34 +8,91 % -11,58 % |
| Parité euro/dollar au 31 décembre 2021 Parité au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 1,1378 1,032 +4,5 % -9,2 % |
| Once d’or au 31 décembre 2022 Once d’or au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 1 825,350 1 752,050 +7,1 % -3,8 % |
| Pétrole au 31 décembre 2021 Pétrole au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 78,140 85,290 -10,7 % +9,7 % |
Le taux d’épargne des ménage en hausse
Le taux d’épargne des ménages a progressé au cours du troisième trimestre. Il s’est élevé à 16,6 % du revenu disponible brut, après 15,8 % au deuxième trimestre. Cette progression est imputable à une augmentation du revenu disponible brut de 2,6 % supérieur à celle de la consommation, +1,6 %. Les ménages ont consacré une partie de leurs gains de pouvoir d’achat du troisième trimestre à l’épargne.
Les dépenses de consommation des ménages en valeur augmentent en effet de 1,6 % ce trimestre, soit un point de moins que leur revenu disponible brut (+2,6 %).
Le taux d’épargne des ménages reste supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire. L’inflation et les incertitudes économiques conduisent les Français à maintenir un important effort d’épargne de précaution.
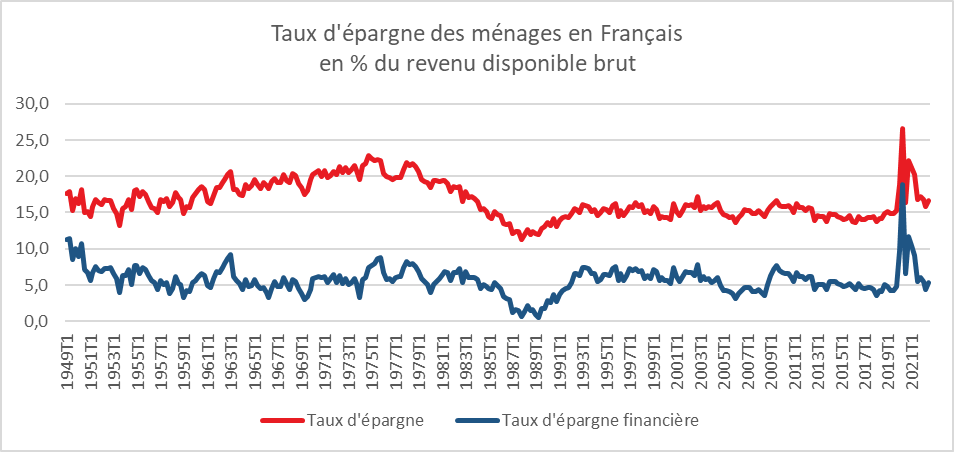
Le Coin des Epargnants du 25 novembre 2022 : les bourses en hausse, le pétrole en baisse
Pour la semaine du « Black Friday », les places boursières occidentales ont conservé leur allant. Les opérations sur les marchés ont été modestes, les investisseurs attendant les résultats de l’inflation du mois de novembre qui seront communiqués la semaine prochaine. Sur la semaine, le Cac 40 est parvenu à progresser de 1 %, avec une poussée jeudi 24 novembre au meilleur de la séance, à 6 730,16 points, au plus haut depuis sept mois, soit un rebond de près de 20% depuis le point bas de septembre (5 628,42 points le 29 septembre). Le CAC 40 a terminé la semaine à 6712 points. La perte sur un an n’est plus désormais que de 0,4 % et de 6,2 % depuis le 1er janvier. Pour le Nasdaq, en revanche, la baisse demeure importante, autour de 27 %.
Le prix du pétrole est toujours orienté à la baisse en raison des menaces qui pèsent sur la croissance de l’économie mondiale et les négociations au sein du G7 concernant les exportations russes. L’augmentation sensible du nombre de cas de covid avec les risques associés de confinement et d’arrêt des usines fait craindre une baisse de la demande en pétrole. Selon le bureau national de la Santé chinois, le pays compterait 31 454 cas de coronavirus, mercredi 25 novembre ; ce chiffre dépasse le précédent record atteint au mois d’avril 2022 quand Shanghai était sous confinement. La Chine, qui compte plus de 1,2 milliard d’habitants, demeure la seule grande économie ayant maintenu un système de confinement s’accompagnant de mesures de restriction de circulation au sein du pays et à l’extérieur. A Pékin, des dizaines d’immeubles résidentiels ont été confinés et les entreprises généralisent le télétravail. Les écoles, les restaurants et les commerces sont à nouveau fermés. Face ces confinements à répétition, des mouvements de contestation commencent à poindre au sein de la population.
Le repli du prix du pétrole a également été favorisé par les informations issues des négociations au sein du G7 concernant le mécanisme de plafonnement des prix du pétrole russe. Les Etats membres du G7 auraient évoqué une fourchette de prix comprise entre 65 et 70 dollars le baril. Ils autoriseraient ainsi la Russie à vendre et exporter son brut à ce prix-là ou en deçà, lui permettant d’échapper partiellement à l’embargo européen qui doit prendre effet le 5 décembre prochain. Ce plafond correspond un peu près au prix de vente actuel du pétrole par les Russes. Il n’y aurait donc pas de réelles conséquences sur le marché. Pour la Russie, ce prix lui garantit sa rente, sachant que le coût de production de son pétrole est estimé à 20 dollars le baril. Si les Russes essayaient de vendre au-dessus du prix plafond, ils ne pourraient pas trouver des transporteurs et des assureurs. La quasi-totalité d’entre eux sont occidentaux et seraient susceptibles d’être soumis à des sanctions de la part des Etats ; pour les autres, il y aurait un risque de ne plus pouvoir commercer au sein des pays membres du G7 et ceux qui accepteront le plafonnement. La fixation du prix autour de 60 dollars a pour objectifs, au-delà de ne pas déstabiliser le marché du pétrole, de ne pas léser les armateurs grecs et les assureurs britanniques. A contrario, le prix du gaz a augmenté ces derniers jours du fait d’une légère baisse des réserves en Europe amenant à de nouveaux achats sur un marché qui reste tendu. Les nouveaux retards dans la remise en réseau des centrales nucléaires françaises a également pesé sur le cours du gaz.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 25 nov. 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 712,480 | +1,00 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 347,03 | +1,78 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 226,36 | +0,80 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 14 541,38 | +0,70 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 486,67 | +1,37 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 962,41 | +0,89 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 28 383,090 | +1,62 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 101,69 | -0,26 % | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,419 % | -0,068 pt | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +1,954 % | -0,065 pt | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,6962 % | -0,116 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0399 | +0,70 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 753,39 | +0,24 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84,01 | -3,83 % | 78,140 |
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com