Le simulateur « d’Info retraite » mis à jour avec les nouvelles règles de départ à la retraite
Union Retraite regroupant les régimes de retraite en France a indiqué que le simulateur « Mon estimation retraite » qui propose aux assurés une évaluation du montant de leur future retraite selon leur âge de départ a été actualisé afin de tenir compte des modifications issues de la réforme de 2023.
La mise à jour intègre les principales évolutions liées à la réforme : relèvement de l’âge légal de départ, modification du nombre de trimestres pour un départ à taux plein (dans certains cas), nouvelles conditions de la retraite anticipée pour carrière longue, augmentation du minimum de retraite (sous certaines conditions) et intégration des modifications liées aux départs en inaptitude pour invalidité. D’autres évolutions sont en préparation et seront développées jusqu’en octobre, pour une nouvelle mise à jour du simulateur prévue en novembre.
En 2022, 29,1 millions d’estimations ont été réalisées sur le compte retraite (+ 63,5 % par rapport à 2021). Plus de 2,3 millions de visiteurs ont été enregistrés sur l’appli « Mon compte retraite ». Le simulateur est notamment accessible sur Info retraite.
Le Coin des Epargnants du 10 juin 2023
Les marchés en mode attentiste
Les indices ont fait du surplace en cette première semaine de juin. Le CAC 40 a reculé de 0,68 % et le Daxx allemand de 0,52 %. De son côté, le S&P 500 a progressé de 0,45 %. Les investisseurs attendent sagement les décisions de la FED et de la BCE de la semaine prochaine. De plus en plus d’investisseurs parient sur le maintien du taux Fed funds dans une fourchette de 5 % à 5,25 %. La probabilité est évaluée à 70%, selon l’outil FedWatch du CME, la Bourse des contrats à terme de Chicago. Malgré tout, sur le front des taux, une surprise n’est pas impossible. La Banque d’Australie et celle du Canada, qui avaient toutes deux observé des pauses, ont, en effet, souligné le risque d’un excès de complaisance face à l’inflation.
Aux Etats-Unis, l’augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage au plus haut depuis octobre 2021, peut être appréciée comme un renversement de tendance sur le marché du travail incitant la FED à temporiser Cette statistique atténue la remontée de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) en données sous-jacentes à 4,7 % sur un an en avril, contre 4,6 % en mars.
Les taux des obligations d’Etat sont restés, cette semaine, également stables en très légère hausse. L’euro demeure toujours proche de la parité avec le dollar (1,07). Le marché du pétrole a fait de même , la réduction de production décidée par l’Arabie saoudite n’ayant eu que peu d’effets sur les cours. Le baril de Brent s’échangeait à 76 dollars vendredi 9 juin.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 9 juin 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 213,14 | -0,68 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 876,78 | +0,36 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 298,86 | +0,45 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 259,14 | +0,33 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 949,84 | -0,52 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 562,36 | -0,47 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 289,79 | -0,63 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 31 641,27 | +0,37 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 213.59 | -0,51 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,917 % | +0,058 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,375 % | +0,062 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,752 % | +0,061 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0750 | +0,25 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 961,64 | +0,79 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,18 | -0,05 % | 84,08 | 78,140 |
Immobilier, la guerre des chiffres et des mots
Depuis plusieurs semaines, les professionnels du bâtiment alarment les pouvoirs publics d’un ralentissement de l’activité en raison notamment de la hausse des taux d’intérêt. La menace d’une baisse de 20 % de l’activité et de la réduction de 200 000 du nombre d’emplois sont, sans nul doute exagérées, le secteur du bâtiment, après plusieurs années de forte croissance est confronté à l’augmentation des coûts de construction et à une moindre solvabilité des acheteurs. En revanche, les besoins en matière de rénovation devraient contribuer à maintenir l’activité. Les difficultés de la construction neuve proviennent autant du manque de foncier que de la hausse des taux. Derrière la bataille des chiffres, se cache un lobbying des professionnels pour obtenir des mesures compensant la fin programmée du dispositif d’aide à l’investissement locatif, le Pinel, fin que le gouvernement a confirmée.
Dans le cadre du Conseil National de la Refondation, le gouvernement a décidé de prolonger le prêt à taux zéro (PTZ), dispositif d’aide à l’accession à la propriété pour les ménages modestes, jusqu’en 2027. Il est néanmoins désormais centré sur l’acquisition de logements collectifs neufs en zones tendues, et sur l’ancien à rénover en zone détendue.
L’exclusion de la maison individuelle du PTZ ne sera pas sans effet. En 2022, 33 000 ménages ont bénéficié d’un PTZ pour acheter une maison, soit 66 % du total des aides ainsi distribuées.
Le défi de la mise aux normes du parc immobilier
12 millions de Français vivent dans des « passoires thermiques » ou sont contraints de se priver de chauffage. Logiquement, d’ici 2050, tout le parc de bâtiments devra atteindre la norme « basse consommation »soit la classe énergétique A ou B.
Actuellement, seulement 5 % des logements dont classés A ou B. 35 millions de logements sont à rénover en 27 ans ce qui signifie qu’il faut logiquement en rénover plus d’un million par an.
En mars 2022, Emmanuel Macron s’est engagé à financer « au moins 700 000 rénovations par an » pendant son second mandat. Selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah), en 2022, 669 890 dossiers de rénovation ont donné lieu à un paiement via MaPrimeRenov ». Une grande partie de ces rénovations aurait des effets limités en matière d’économies d’énergie.
Augmentation de la rémunération des dépôts des ménages en avril
Avec la hausse des taux d’intérêt et le relèvement des taux de l’épargne réglementée, la rémunération moyenne des dépôts bancaires progresse de nouveau à 1,44 % en avril.
Le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages atteint 1,66 %. Celle des livrets bancaires ordinaires passe de à,53 à 0,59%
La rémunération des dépôts des SNF s’établit à 1,13 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et celle, plus limitée, des dépôts à vue.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| avr-2023 (g) | avr-2022 | fév- 2023 | mars- 2023 (f) | avr- 2023 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 117 | 0,50 | 1,32 | 1,37 | 1,44 |
| dont Ménages | 1 848 | 0,79 | 1,60 | 1,63 | 1,66 |
| – dépôts à vue | 592 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 36 | 0,39 | 2,25 | 2,48 | 2,65 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 64 | 0,71 | 1,08 | 1,15 | 1,23 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 628 | 1,07 | 3,21 | 3,22 | 3,22 |
| dont : livret A | 364 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| – livrets ordinaires | 258 | 0,09 | 0,50 | 0,53 | 0,59 |
| – plan d’épargne-logement | 270 | 2,58 | 2,59 | 2,55 | 2,59 |
| dont SNF | 868 | 0,09 | 0,90 | 1,02 | 1,13 |
| – dépôts à vue | 586 | 0,04 | 0,34 | 0,37 | 0,43 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 225 | 0,09 | 2,29 | 2,45 | 2,67 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 58 | 0,61 | 1,74 | 1,97 | 2,26 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Euribor 3 mois (d) | -0,45 | 2,64 | 2,91 | 3,18 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 0,79 | 2,72 | 2,79 | 2,73 | |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Immobilier, une baisse des prix modérée au premier trimestre
Au premier trimestre 2023, les prix des logements anciens en France (hors Mayotte) baissent pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2015. Cette baisse est néanmoins limitée : -0,2 % par rapport au quatrième trimestre 2022 (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après une stabilité au quatrième trimestre 2022 et +1,5 % au troisième trimestre 2022. Sur un an, les prix n’augmentent plus que de 2,7 % après +4,6 % au quatrième trimestre 2022 et +6,4 % au troisième. Dans plusieurs pays dont les États-Unis ou le Royaume-Uni, le processus de baisse est bien plus marqué.
En France, l’augmentation du prix des maisons demeure plus élevée que celle des appartements, soit +3,1 % sur un an au premier trimestre 2023 pour les premiers et 2,2 % pour les seconds. L’augmentation plus rapide du prix des maisons est constatée désormais depuis le troisième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire.
La moindre progression des prix sur un an doit être appréciée au vu des hausses enregistrées depuis vingt ans. Les prix ont été multipliés durant cette période par plus de deux.
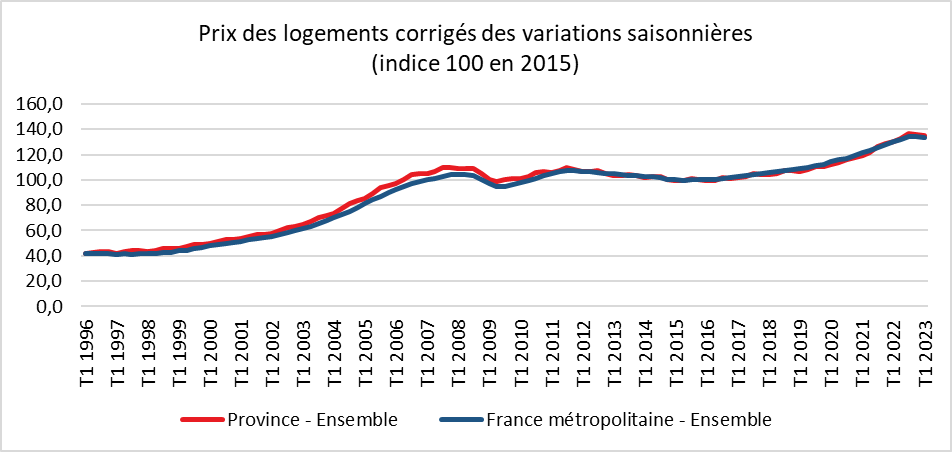
Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS
Paris, des prix en baisse sur un an de 2 %
Les prix des logements anciens en Île-de-France baissent pour le deuxième trimestre consécutif : -1,1 % au premier trimestre 2023, après -0,5 % au quatrième trimestre 2022 et +0,5 % au troisième. Sur un an, les prix des logements anciens en Île-de-France reculent de 0,6 % au premier trimestre 2023, après +1,3 % au quatrième trimestre 2022 et +1,9 % au troisième trimestre 2022. Cette baisse est portée par le repli des prix des appartements (-1,2 % sur un an, après +0,5 % au quatrième trimestre 2022 et +0,2 % au troisième) tandis que les prix des maisons restent en hausse (+0,9 % sur un an, après +3,3 % et +5,5 %).
À Paris, les prix des appartements baissent pour le troisième trimestre consécutif, -1,2 % au premier trimestre 2023 après -0,7 % au quatrième trimestre 2022 et -0,1 % au troisième. Sur un an, les prix des appartements parisiens diminuent de 2,0 % au premier trimestre 2023. Cette baisse demeure limitée au regard du triplement des prix en vingt-cinq ans.
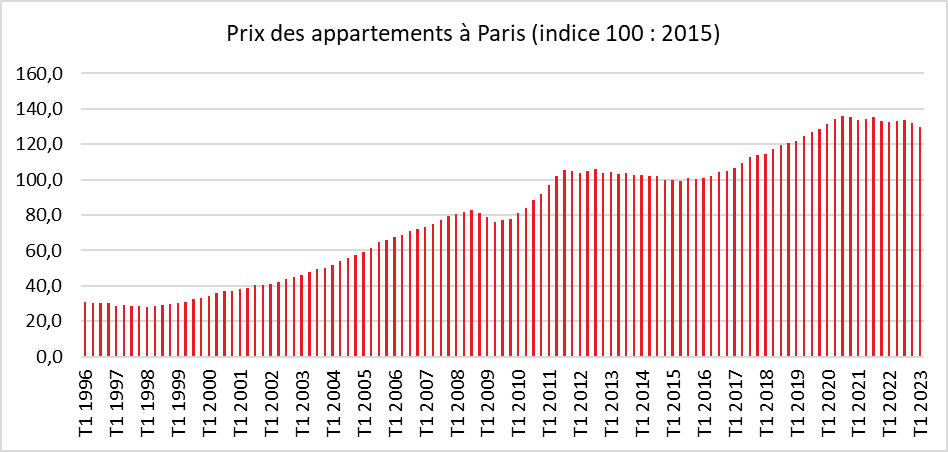
Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS
Province, des prix encore en légère augmentation
Au premier trimestre 2023, les prix des logements anciens en province sont quasi stables, à +0,1 % sur un trimestre, après +0,2 % au quatrième trimestre 2022 et +1,8 % au troisième. Sur un an, les prix restent en hausse malgré une décélération qui se poursuit. La hausse a été de +3,9 % au premier trimestre 2023, après +5,8 % et +8,1 %. Les prix des appartements en province (+4,7% sur un an au premier trimestre 2023) augmentent plus fortement que ceux des maisons (+3,5 %), inversant la tendance observée depuis le début de l’année 2021. Les dépenses de carburant et de chauffage peuvent expliquer cette inversion.
Le nombre de transactions annuelles en légère baisse
Au premier trimestre 2023, le volume annuel de transactions continue de décroître légèrement. En mars, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 1 069 000, après 1 115 000 fin décembre 2022. Si l’on rapporte ce nombre de transactions au stock de logements disponibles, qui augmente d’environ de 1 % par an, la proportion de ventes concerne 2,8 % du stock et dépasse, depuis 2019, le niveau élevé observé au début des années 2000 (autour de 2,6 %), malgré la baisse du nombre de transactions depuis le quatrième trimestre 2021 et la hausse des taux. Le marché reste donc dynamique.
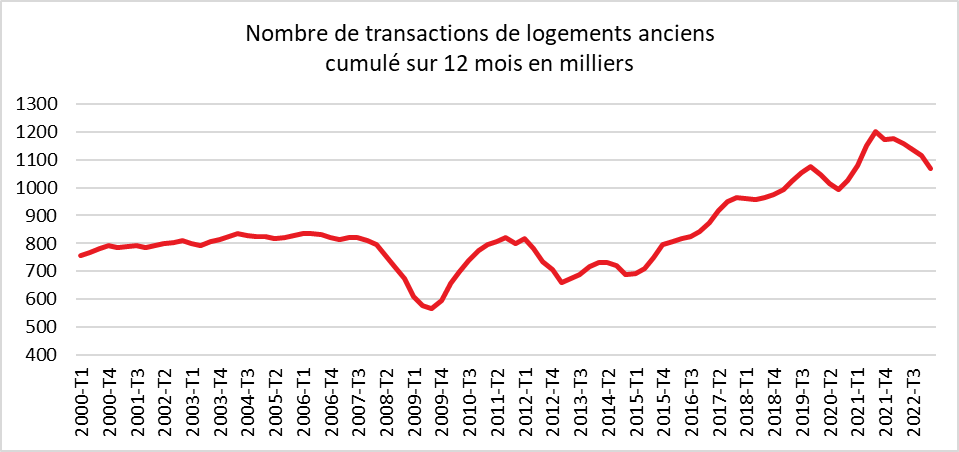
Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS
Le Coin des Epargnants du 3 juin 2023 : le temps du soulagement aux Etats-Unis
Bonnes nouvelles sur le front américain et européen
La Bourse de Paris a fini la semaine mieux qu’elle ne l’avait commencée, malgré les menaces de dégradation de la note française. Les différentes places boursières ont salué l’adoption de la loi reportant de deux ans la question du relèvement du plafond de la dette américaine et la décrue de l’inflation en Europe. La hausse de la fin de la semaine n’empêche pas les indices actions, tant le CAC 40 que l’Eurostoxx ou le Footsie londonien, de reculer légèrement sur la semaine, confirmant leur tendance du mois de mai. Après avoir enregistré des sommets, le marché parisien est dans une phase de consolidation post publication des résultats des entreprises. Les doutes sur la croissance tant au sein de l’OCDE qu’en Chine incitent à la prudence. Aux Etats-Unis, la levée de l’hypothèque du plafond de la dette a contribué à la hausse des cours.
Les résultats de l’emploi américain au mois de mai ont été jugés plutôt encourageants, le maintien d’un fort mouvement de création d’emplois s’étant accompagné d’une modération des salaires. Le secteur non agricole a créé 339 000 postes le mois dernier, contre 294 000 en avril, confirmant que l’économie américaine reste résiliente. Le consensus formé par Bloomberg pariait sur 195 000 créations de postes. Le taux de chômage a légèrement augmenté en mai de 0,3 point à 3,7 % de la population active, contre 3,5 % attendu. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,3 % sur un mois, après +0,4 % en avril, et de 4,3 % sur un an, quand le marché attendait une stabilisation à 4,4 %. Si la fermeté des embauches ne va pas dans le sens d’une pause dans le cycle de hausse des taux de la Fed, l’accalmie sur les salaires et la hausse du taux de chômage sont néanmoins des signaux positifs. Ces derniers pourraient conduire la banque centrale à modérer ses prochains relèvements de taux.
Le Congrès a joué à se faire peur cette semaine en adoptant dans la nuit du 1er au 2 juin la loi relevant le plafond de la dette publique. Par sécurité, l’échéance avant un défaut de paiement du pays, celle du 1er juin, avait été décalée au 5 juin vendredi soir par la secrétaire au Trésor Janet Yellen. En échange d’une suspension du plafond jusqu’en 2025, l’exécutif a accepté un maintien strict des dépenses à leur niveau actuel pour 2024 avec une légère augmentation dans la défense et pour les anciens combattants, avant une hausse plafonnée à 1 % l’année suivante. Les fonds non utilisés dans le cadre du Covid seront réintégrés pour près de 30 milliards de dollars. À la demande des Républicains, l’accord prévoit que les Américains âgés de 49 à 54 ans bénéficiant d’une aide alimentaire devront répondre à certaines exigences en matière de travail s’ils sont valides et sans personne à charge.
Dans ce contexte, les taux d’intérêt sur les obligations d’État sont en recul. Le taux de l’OAT français à 10 ans est repassé en-dessous de 3 %. L’écart avec l’Allemagne est relativement stable à 0,546 point en fin de semaine.
La semaine a également été marquée par la décrue de l’inflation au sein de l’Union européenne en lien avec le recul des prix de l’énergie. La baisse du cours de pétrole a provoqué une vive réaction du prince Abdelaziz ben Salmane, le ministre saoudien de l’énergie. Il condamne l’action des traders et fonds qui spéculeraient sur la chute des cours du pétrole. Pour tenter de relever les cours du pétrole ou tout au moins de les stabiliser, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pourrait décider, le 4 juin, une nouvelle baisse de sa production. L’Arabie saoudite a besoin d’un baril au moins supérieur à 80 dollars pour assurer l’équilibre de son budget, or celui-ci évolue autour de 72 dollars. En 2022, elle avait estimé qu’un niveau de 90 dollars était un « bon prix ». Le ralentissement de la croissance de la Chine conduit à une détente sur les prix. Une partie du pétrole russe trouve preneurs soit dans les pays émergents ou via des circuits parallèles. La Russie doit vendre son pétrole pour financer ses dépenses militaires, ce qui favorise une baisse des cours.
Le tableau de la semaine des marchés
| Résultats 2 juin 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 270,69 | -0,66 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 762,76 | +2,082 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 282,37 | +1,90 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 240,77 | +2,02 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 16 051,23 | +0,48 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 607,28 | -0,30 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 323,52 | -0,37 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 31 524,22 | +0,75 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 229,53 | +0,57 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,859 % | -0,251 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,313 % | -0,306 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,691 % | -0,146 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0716 | -0,03 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 956,05 | +0,91 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,12 | +1,30 % | 84,08 | 78,140 |
Le Livret d’Epargne Populaire en plein boom
L’encours du Livret d’Epargne Populaire (LEP) a atteint à la fin mars 2023 le montant de 55,142 milliards d’euros, contre 41,206 milliards d’euros un an auparavant. Le relèvement du taux du LEP a eu un effet immédiat sur la collecte. Ce produit qui était en décroissance de 2008 jusqu’en décembre 2021 a connu une forte progression depuis. Son encours a augmenté de 44 % de janvier 2022 à mars 2023. Son taux de rémunération qui est indexé à l’inflation explique le regain d’intérêt dont il bénéficie auprès des épargnants éligibles. Ce taux est passé de 1 % en janvier 2022 à 6,1 % depuis le 1er février 2023.
Le LEP se rapproche de son record d’encours qui date de 2008 à 61 milliards d’euros.
Le nombre de livrets ouverts est passé de 8,5 millions fin 2022, à 9,6 millions à fin mars.

Données Banque de France
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, le revenu fiscal de l’année 2021 de votre foyer fiscal (figurant sur l’avis d’imposition de 2022) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
| Quotient familial | Plafond de revenus |
| 1 part | 21 393 € |
| 1,5 part | 27 107 € |
| 2 parts | 32 818 € |
| 2,5 parts | 38 531 € |
| 3 parts | 44 243 € |
| 3,5 parts | 49 956 € |
| 4 parts | 55 667 € |
| Demi-part supplémentaire | 5 714 € |
Le plafond du Livret d’Epargne Populaire est de 7 700 euros. Un seul LEP peut être ouvert par personne. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
L’épargne avant la consommation en avril en France
En avril, les ménages ont à nouveau réduit leurs dépenses de consommation en biens. La baisse a été, selon l’INSEE, de 1,0 % sur un mois en volume après une baisse de 0,8 % en mars 2023. Cette contraction s’explique par le repli de la consommation en énergie (‑1,9 %) et la nouvelle diminution de la consommation alimentaire (‑1,8 %). La consommation de biens fabriqués est quant à elle quasi stable (+0,1 %). Les ménages face à l’érosion de leur pouvoir d’achat préfèrent toujours limiter leurs dépenses. Ils ne puisent pas réellement dans leurs réserves, le taux d’épargne restant toujours supérieur à la moyenne d’avant la crise sanitaire. Le niveau de la consommation est désormais revenu à son niveau de 2012 bien qu’entre temps la population ait continué à augmenter.
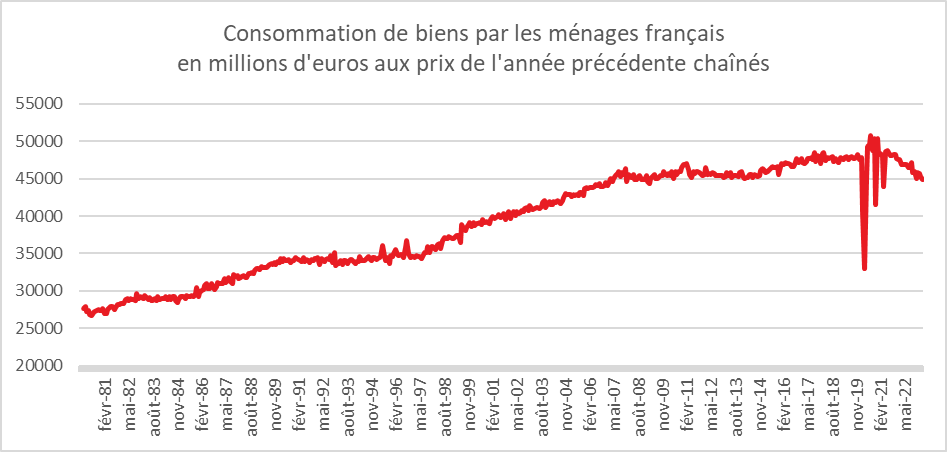
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Baisse de l’inflation en mai
Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’INSEE, les prix à la consommation augmenteraient de 5,1 % en mai 2023, après +5,9 % le mois précédent. Cette baisse de l’inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l’énergie, de l’alimentation, des produits manufacturés et des services. Les prix du tabac augmenteraient, en revanche, pour le troisième mois consécutif. Cette décrue est la plus importante enregistrée depuis le début de la vague inflationniste. Elle est avant tout du à un effet de base, les prix ayant fortement augmenté durant le printemps 2022 après le déclanchement de la guerre en Ukraine.
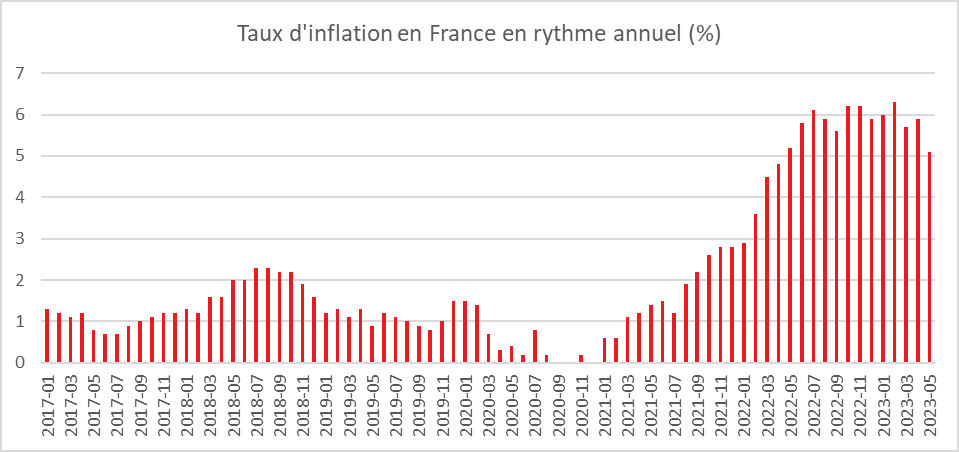
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Petite baisse du taux d’épargne au premier trimestre
Le taux d’épargne des ménages a diminué au premier trimestre 2023. Il s’est établi à 18,3 %, après 18,7 % au quatrième trimestre 2022. Il reste nettement supérieur à son niveau moyen d’avant la crise sanitaire (15,0 % en 2019). Cette baisse est imputable à la diminution du pouvoir d’achat.. Le pouvoir d’achat du Revenu Disponible Brut des ménages a reculé de 0,4 % après un gain de +1,3 % au dernier trimestre 2022. Mesuré par unité de consommation pour être ramené à un niveau individuel, il baisse de 0,6 % au premier trimestre (après +1,2 %).
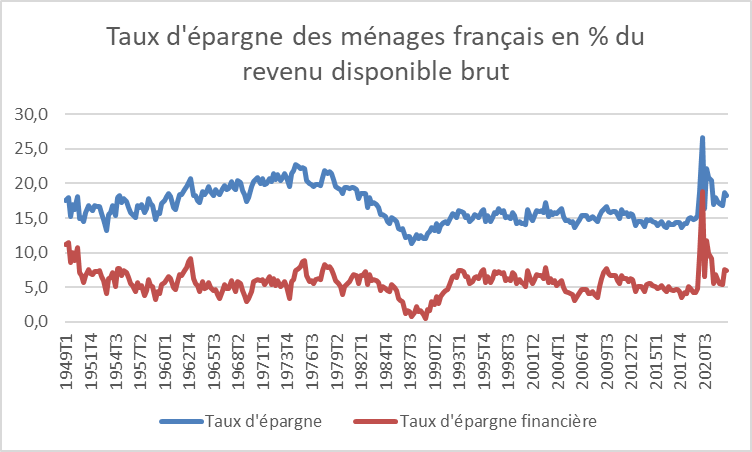
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Le Coin des épargnants du 26 mai 2023
En attendant la fumée blanche du Congrès
Les investisseurs ont attendu, aux Etats-Unis, toute la semaine un compromis entre démocrates et républicains sur le relèvement du plafond de la dette publique et éviter ainsi un shutdown. Un accord pourrait être trouvé d’ici la fin du weekend. Il n’en demeure pas moins que sur le front économique, les indices ne sont guère enthousiasmants. Toujours, aux Etats-Unis, en avril, l’indice PCE core, mesure préférée de l’inflation de la Réserve fédérale américaine (Fed), a augmenté de 0,3 point sur un mois, soit 0,1 point au-delà des attentes. Le taux d’inflation annuel de base est remonté de 4,6 % à 4,7 %. Cette hausse pourrait inciter la FED à remonter plus que prévu ses taux. Dans le même temps, les exportations américaines ont baissé de 5,5 % en variation mensuelle, laissent présager un ralentissement de l’économie. De son côté, l’Allemagne est officiellement entré en récession au cours du premier trimestre dans un contexte toujours de forte inflation. Dans ce contexte, les taux d’intérêt des obligations souveraines ont poursuivi leur hausse. Les indices actions en Europe ont accusé le coup cette semaine en baissant de plus de 2 %. A noter que le Nasdaq s’est apprécié de 2,55 % sur la semaine.
Le tableau de la semaine des marchés
| Résultats 26 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 326,93 | -2,55 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 093,34 | -0,92 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 205,45 | +0,40 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 975,69 | +2,55 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 984,47 | -2,13 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 631,00 | -1,77 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 337.50 | -1,10 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 30 916,31 | +0,35 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 212,50 | -2,01 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,110 % | +0,091 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,537 % | +0,108 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,837 % | +0,156 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0710 | -0,82 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 942,35 | -1,67 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76.88 | +1,54 % | 84,08 | 78,140 |
L’assurance vie entre deux eaux !
Les assureurs n’aiment ni les périodes de faibles taux d’intérêt, ni celles de remontée brutale de ces derniers. Les faibles taux des obligations pèsent sur le rendement des fonds euros. La hausse rapides des taux, de son côté, peut conduire des assurés à effectuer des retraits des fonds euros obligeant les assureurs à vendre des obligations achetés à des prix plus élevés. Le passage d’une période à une autre peut être compliqué pour les assureurs mais est temporaire. Les prochaines années pourraient, en effet, être à nouveau plus porteuses pour les fonds euros.
De 2020 à 2023, les taux d’intérêt des obligations d’État à 10 ans sont passés de -0,2 à 3 %. Les taux d’intérêt à court terme (sur les dépôts à terme, sur les placements monétaires…) sont aussi passés au-dessus du rendement du fonds en euros (2 % en 2022) avec les relèvements successifs des taux directeurs décidés par la Banque centrale européenne (BCE).
Pour les fonds euros, la baisse de leur rendement a conduit à une collecte négative depuis deux ans. Les épargnants arbitrent en faveur des unités de compte ou effectuent des rachats en vue d’une réallocation sur d’autres produits d’épargne (livrets réglementés, dépôts à terme, etc.) plus rémunérateurs.
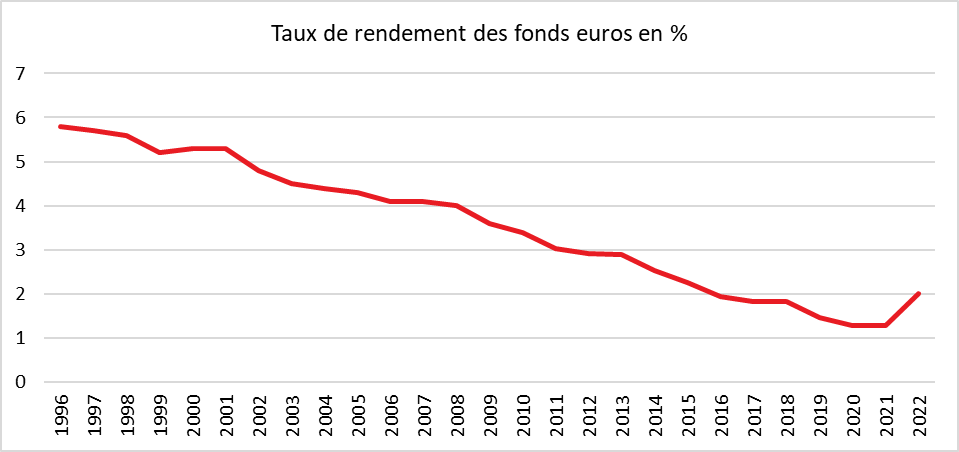
Cercle de l’Épargne – données APCR
La décollecte nette reste pour le moment mesurée, autour d’une trentaine de milliards d’euros au regard du montant total des fonds euros (1 470 milliards d’euros). Les assurés modifient peu leur allocation d’épargne par inertie. Ils ne ferment pas leurs contrats d’assurance vie afin de ne pas perdre les avantages fiscaux qui leurs sont attachés. Face au risque de retraits, les assurés ont réagi en puisant sur la provision pour participation aux bénéfices (PPB) pour doper le rendement de 2022. La grande majorité des assureurs disposent d’importantes PPB constituées ces dernières années et qui ont vocation à être redistribuées au profit des assurés.
Dans les prochaines années, l’attractivité des fonds euros devrait augmenter avec la hausse des taux d’intérêt. Les investisseurs parient sur des taux plus élevés que lors des dix dernières années. Les besoins d’investissement étant en forte augmentation notamment en lien avec la transition énergétique, l’épargne sera davantage convoitée. Devenant plus rare, son prix sera élevée. Depuis 2020, les déficits publics atteignent des niveaux records (4,5 % du PIB en 2022 au sein de la zone euro) obligeant les États à emprunter des sommes croissantes. Les dépenses publiques sont orientées à la hausse en raison du vieillissement et des besoins en matière de défense, de santé ou d’éducation. Le soutien à la transition énergétique, à la recherche & développement et à la réindustrialisation amène les États à accroître également leurs dépenses. L’inflation devrait être plus forte dans les prochaines années que durant la période 2012/2021 ce qui conduit les taux d’intérêt à être plus élevés. La décarbonation de l’économie, le vieillissement qui réduit le nombre d’actifs disponibles, les besoins en services domestiques sont par nature inflationnistes. L’augmentation rapide de la masse monétaire, ces dix dernières années constitue une réserve d’inflation. Celle-ci diminuera le coût de la garantie en capital. La hausse du rendement des fonds euros devrait s’accompagner d’une moindre progression des prix de l’immobilier, voire d’un ajustement à la baisse. Au sein de la zone euro, au premier trimestre 2023, en rythme annualisé, les prix des logements sont en baisse de 3 %. Dans une période à plus volatilité, compte tenu de la forte aversion aux risques des investisseurs, les fonds euros devraient être privilégiés au détriment des actions dont les cours dans ce contexte devraient moins progresser. À moyen terme, les fonds euros devraient donc retrouver de leur attractivité d’autant plus que les épargnants de plus en plus âgés seront à la recherche de placements sûrs.
Livret A : une collecte encore soutenue en avril
Retour progressif à la normale pour le Livret A
Après trois mois de hausses stratosphériques, le Livret A revient, au mois d’avril, à un niveau de collecte plus traditionnel avec +2,33 milliards d’euros, après 9,27 milliards d’euros en janvier, 6,27 milliards d’euros en février et 4,17 milliards d’euros en mars. L’effet taux s’estompe progressivement. La collecte tend, en effet, à diminuer trois mois après l’annonce d’un relèvement. Pour le mois d’avril 2023, cette décrue demeure, malgré tout, limitée, la collecte restant au-dessus de la moyenne de ces dix dernières années (1,9 milliard d’euros). Pour le LDDS, la collecte s’est élevée en avril à 1,15 milliard d’euros, ce qui la place également à un haut niveau.
Les Français, toujours en mode « épargne de précaution »
Les Français restent, en ce début d’année, toujours en mode « épargne de précaution » malgré la baisse de leur pouvoir d’achat. Ils préfèrent diminuer leurs dépenses de consommation plutôt que de puiser dans leur épargne. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte du Livret A s’est élevée à 22,04 milliards d’euros, soit son plus haut niveau depuis 2009 (23,76 milliards d’euros en lien avec la banalisation de sa distribution). Toujours pour les quatre premiers mois, la collecte du LDDS a atteint 6,82 milliards d’euros, ce qui constitue un record depuis l’établissement des séries statistiques par la Caisse des dépôts et consignations (2009).
En avril, l’encours des deux produits atteint de nouveaux sommets : 397,4 milliards d’euros pour le Livret A et 141,1 milliards d’euros pour le LDDS.
La forte collecte du Livret A, depuis le début de l’année, s’explique en partie par le dégonflage des dépôts à vue. Leur encours est, en effet, passé, selon les statistiques de la Banque de France de 542,2 milliards d’euros à 508,7 milliards d’euros de septembre 2022 à mars 2023 (dernier chiffre connu). Cet encours demeure néanmoins nettement supérieur à son niveau d’avant covid (406,5 milliards d’euros en décembre 2019). Pour mémoire, il était de 236 milliards d’euros en avril 2013. Les dépôts à vue ont fortement augmenté durant la période de faibles taux d’intérêt, rendant les livrets peu attractifs, ainsi que durant les crises qui incitent les ménages à conserver, en quantité plus importante, des liquidités. La décrue des dépôts à vue/comptes courants pourrait se poursuivre dans les prochains mois en raison de l’augmentation des taux et de l’inflation. Cette décrue a comme limite le nombre de Livrets A et de LDDS ayant atteint le plafond de versement.
Fin 2021, 4,3 millions de Livrets A étaient au plafond (22 950 euros) sur un total de plus de 55 millions, soit près de 8 % du total. Compte tenu de l’importance de la collecte de ces derniers mois, leur proportion a dû atteindre 10 %. L’encours moyen du Livret A est de 5 500 euros.
Fin 2021, sur un total de 24,5 millions de LDDS, 22 % étaient au plafond (12 000 euros) soit 4,6 millions. L’encours moyen était alors de 5 100 euros. En 2021 320 000 étaient arrivés au plafond. Compte tenu des collectes, le nombre de LDDS au plafond a dû dépasser 25 millions.
En attendant le 1er août 2023
D’ici le mois juillet prochain, mois d’annonce d’une éventuelle hausse du taux du Livret A (dont l’entrée en vigueur se fera au 1er août), la collecte de ce dernier devrait s’estomper quelque peu en raison des dépenses liées aux vacances.
Concernant le taux du Livret A, le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a promis son relèvement sans en préciser le montant. « Ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important », a déclaré, le mercredi 3 mai à France Info, le Ministre. Il a précisé « si jamais la conclusion de la formule et du gouverneur de la Banque de France, c’est que comme l’inflation est très élevée, il faut continuer à augmenter la rémunération du Livret A, je suivrai la recommandation du gouverneur », Il a complété que « c’est une proposition qui est faite par le gouverneur de la Banque de France et qui ensuite est validée par votre serviteur ».
Compte tenu des éléments de la formule, le taux du Livret A pourrait se situer au 1er août 2023 entre 4 et 4,5 %. Un tel taux génèrerait un surcoût pour les établissements financiers et pour les bailleurs sociaux ainsi que pour les collectivités locales et les PME qui empruntent à partir des ressources issues du Livret A ou du LDDS. Les banques pourraient être amenées à répercuter le surcoût de la hausse du taux sur les emprunts dans un contexte où l’accès à ces derniers est de plus en plus difficile. Un taux élevé pourrait également inciter les Français à privilégier l’épargne au détriment de la consommation. Un taux au-delà de 4 % serait un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que des produits de long terme. Du côté des épargnants, quoi qu’il arrive, le taux du Livret A sera inférieur à l’inflation ce qui signifie que le rendement réel restera négatif.
Le gouverneur de la Banque de France pourrait, comme le prévoit l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, proposer de déroger à la stricte application de la formule au nom de « circonstances exceptionnelles ». Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie qui peut alors les suivre ou pas.
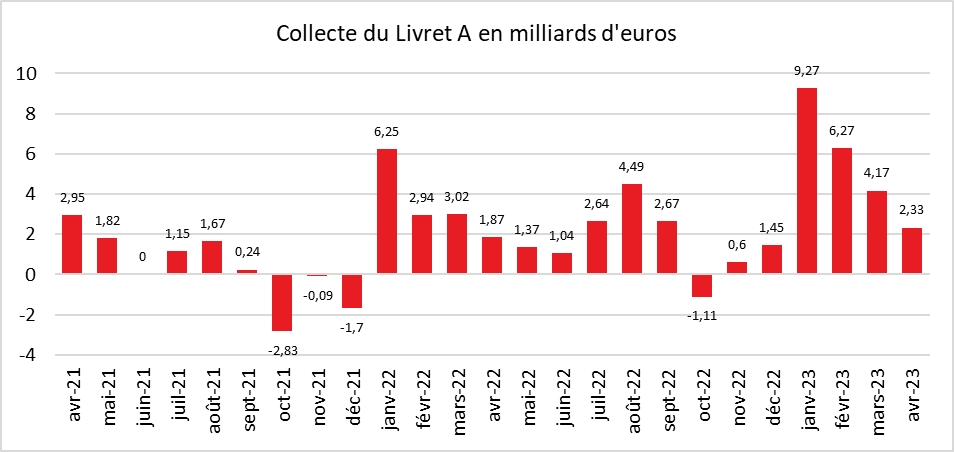
Cercle de l’Épargne – données Caisse des Dépôts et Consignation
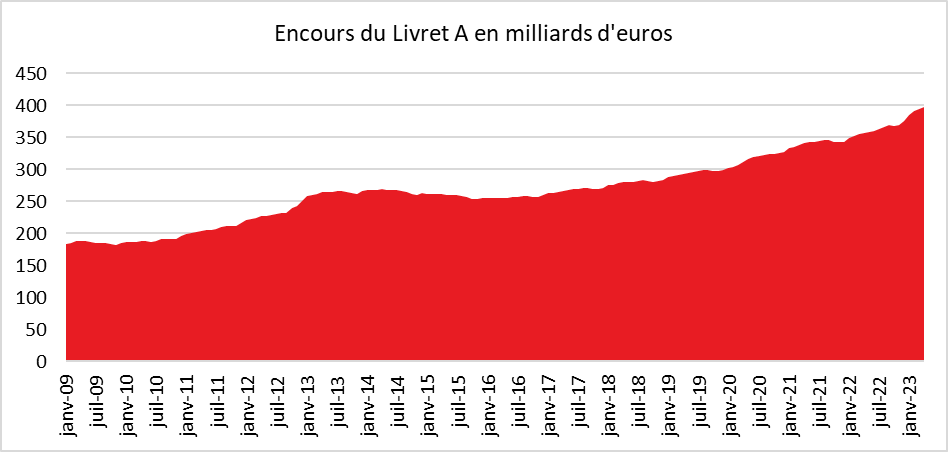
Cercle de l’Épargne – données Caisse des Dépôts et Consignation
Le Coin des Epargnants du 19 juin 2023
Dans l’attente d’un accord sur la dette américaine
Les investisseurs ont, durant cette semaine, fait preuve d’une prudence teintée d’optimisme dans l’attente d’une conclusion espérée heureuse, sur le dossier du plafond de la dette américaine. Les indices « actions » ont ainsi progressé, avec modération, cette semaine. A noter néanmoins que l’indice Nikkei 225 est au plus haut depuis 33 ans avec un gain de plus de 4 % en cinq jours. La hausse des cours au Japon est portée par les bons résultats des entreprises, la bonne tenue de la croissance et le retour de l’inflation dans un pays en déflation depuis des décennies. Le Cac 40 a clôturé, la semaine des « trois sorcières » à 7 491,96 points avec une progression sur la semaine de 1,04 %.
Cette progression des indices européens a été obtenue malgré les incertitudes sur le relèvement de la dette publique américaine, les investisseurs croyant qu’un accord sera obtenu dans les prochaines heures. Si le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, un accord est toujours possible d’ici à ce week-end, ce qui autoriserait un vote au Congrès dès la semaine prochaine, le républicain Garret Graves a déclaré, ce vendredi 19 mai, que l’équipe de la Maison Blanche était « déraisonnable ». il a ajouté que « nous n’allons pas nous asseoir ici et parler tout seuls ». Le « shutdown » se rapprochant, le président américain Joe Biden a décidé d’écourter son déplacement à Hiroshima, au Japon ville dans laquelle se tient le sommet du G7, afin d’être de retour sur le sol américain dimanche. Le président américain a prévu de tenir dimanche une conférence de presse pour faire état des avancées entre les clans républicain et démocrate. Si de nombreux éléments doivent encore être réglés, le schéma général semble être celui d’un relèvement du plafond de la dette jusqu’en 2025 (après l’élection présidentielle de 2024) en échange de l’incorporation de plafonds de certaines dépenses, de la réaffectation des fonds Covid non utilisés et d’une rationalisation des permis d’infrastructure énergétique.
Les tergiversations du Congrès aux Etats-Unis et la persistance de l’inflation en zone euro ont conduit, cette semaine, à une augmentation sensible des taux d’intérêt des obligations d’Etat. Le taux de l’OAT français à 10 ans a ainsi dépassé les 3 %, taux qui n’avait plus été atteint depuis le début du mois de mars.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 19 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 491,96 | +1,04 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 426,43 | +0,23 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 191,91 | +1,63 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 657,90 | +2,83 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 16 275,38 | +2,60 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 756,87 | +0,19 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 395,30 | +1,79 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 30 817,17 | +4,03 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 286,80 | +0,76 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,019 % | +0,153 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,429 % | +0,155 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,681 % | +0,235 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0821 | -1,02 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 978,50 | -1,79 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 75,69 | +2,13 % | 84,08 | 78,140 |
Plan d’épargne avenir climat, quand l’épargne se met au vert
La transition énergétique exige des investissements importants afin de réduire l’empreinte carbone des activités humaines. L’effort est évalué entre 1 et 3 % du PIB chaque année. Pour financer ces investissements, une réorientation de l’épargne est souhaitée par les pouvoirs publics. Dans le cadre du projet de loi relatif à l’industrie verte, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a décidé la création d’un nouveau plan d’épargne avenir climat dédié aux jeunes de moins de 18 ans et destiné au financement de la transition énergétique. Ce plan pourra être ouvert auprès des banques ou des assureurs et les versements seront plafonnés à 23 000 euros, soit un peu plus que le Livret A (22 950 euros).
Ce plan qui pourra être ouvert dès la naissance des enfants et jusqu’à leur 18e anniversaire est un mix entre les livrets réglementés et le Plan d’Épargne Retraite (PER). L’argent versé sur ce plan sera bloqué jusqu’à la majorité, les sommes d’un PER le sont jusqu’à l’âge de départ à la retraite). Le régime fiscal sera celui du Livret A avec zéro fiscalité et zéro prélèvements sociaux.
Les fonds ne seront pas garantis en temps réel comme c’est le cas pour les livrets réglementés ou les fonds euros de l’assurance vie. En revanche, une possible garantie en capital à terme est évoquée, ce qui ressemble aux fonds eurocroissance des contrats d’assurance vie. Une sécurisation progressive en fonction de l’âge sera réalisée par les gestionnaires, ce qui s’apparente à la gestion profilée des PER.
La rémunération ne sera pas fixée, à la différence du Livret A, par les pouvoirs publics. Le ministre de l’Economie a simplement indiqué que le placement étant à long terme, son rendement était susceptible d’être relativement attractif.
Le plan d’épargne avenir climat surfe sur la volonté des jeunes générations de s’engager en faveur de la transition énergétique. Le gouvernement entend inciter les parents à ouvrir ces plans en lieu et place ou en complément des livrets A ou des livrets jeunes.
Les livrets jeunes sont réservés à toute personne âgée de 12 à 25 ans. Leur plafond est faible : 1 600 euros (hors intérêts capitalisés). Le taux d’intérêt annuel est librement fixé par les banques, mais est au moins égal à celui du Livret A, soit au minimum au 1er février 2023, 3 %. À compter du 25e anniversaire, le Livret jeune est clos. À la différence du nouveau plan de Bruno Le Maire, le Livret jeune est complètement liquide. L’encours des livrets jeunes est en baisse constante depuis 2007 et est inférieur à 5 milliards d’euros (4,7 milliards d’euros à fin mars 2023 selon la Banque de France).
Le plan d’épargne avenir climat n’est pas le premier produit fléché développement durable. Figurent dans cette catégorie le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et les fonds ISR (investissement socialement responsable). Depuis l’adoption de la loi PACTE, les assureurs sont tenus de proposer aux assurés des fonds ISR dans le cadre des contrats multi-supports (assurance vie ou PER). Dans le cadre des Plans d’Épargne Entreprise, les gestionnaires d’actifs doivent également faire figurer des fonds ISR dans leurs offres.
Le ministre de l’Économie s’est fixé un objectif de collecte d’un milliard d’euros pour la première année. Les parents et grands-parents pourront être sensibles à l’idée de bloquer l’argent jusqu’à la majorité du titulaire même si, en France, la liquidité est sacrée. La question de la garantie du capital à terme sera sans nul doute regardée de près par les parents. Ce nouveau produit d’épargne épouse parfaitement les spécificités de l’épargne française faite de niches fiscales et de dispositifs plus ou moins réglementés.
Le Coin de l’épargne du 12 mai 2023 : l’inflation et encore l’inflation
Aux Etats-Unis, l’indice de confiance du consommateur, calculé par l’Université du Michigan, est ressorti en dessous des prévisions, à 57,7 points contre 63 escompté, et 63,5 le mois précédent. Le moral des ménages est ainsi au plus bas depuis le mois de novembre. Les investisseurs ont également noté que les anticipations d’inflation à un an, un facteur clef pris en compte par la Réserve fédérale américaine dans le cadre de sa politique monétaire, a été annoncée à 4,5 % pour mai quand elle était attendue en décélération à 4,4 % sur un an, contre 4,6 % en avril. Les anticipations à cinq ans, sont de nouveau en hausse à 3,2 %, contre 3 % en avril. Les prix à l’importation ont augmenté de 0,4 % sur un mois en avril, marquant leur première hausse de l’année. La banque centrale américaine, la Fed doit faire face à un ralentissement de l’économie pouvant amener une récession dans un contexte d’inflation élevée. Pour certains de ses membres, la politique monétaire n’est pas suffisamment restrictive pour casser les transmissions de hausses de prix. Pour un certain temps, le maintien de taux élevés apparaît nécessaire.
Les investisseurs s’inquiètent également de la fixation du plafond de la dette avec un risque de shutdown en cas d’absence dans les prochains jours d’un accord au Congrès. La nouvelle rencontre de Joe Biden avec les responsables démocrates et républicains a été reportée à la semaine prochaine. Des membres du Congrès et des responsables de l’administration ont néanmoins engagé des discussions pour établir les grandes lignes d’un accord portant sur un relèvement du plafond de la dette et une limitation des dépenses publiques ainsi que sur une possible augmentation des impôts.
Dans cet environnement incertain, les investisseurs ont opté cette semaine la prudence. Les indices des grandes places financières sont en léger recul sur la semaine à l’exception du Nasdaq en légère hausse. Le CAC 40 a ainsi enregistré sa troisième semaine consécutive de baisse, cédant 0,24 % en cinq séances. Les taux des obligations d’Etat sont restés stables cette semaine. En revanche, l’euro s’est légèrement déprécié face au dollar.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 12 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 414,85 | -0,24 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 300,62 | -1,12 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 124,08 | -0,29 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 284,74 | +0,40 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 913,82 | -0,30 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 754,62 | -0,31 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 317,88 | -0,37 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 29 388,30 | +1,51 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 272,36 | -1,86 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,857 % | -0,012 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,274 % | -0,008 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,446 % | -0,006 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0853 | -2,43 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 2 010,03 | -0,29 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 74,36 | -1,14 % | 84,08 | 78,140 |
Crise du logement, les taux d’intérêt n’expliquent pas tout
Les professionnels de l’immobilier soulignent la chute de la construction et des transactions. La Fédération française du bâtiment a de son côté alerté : si rien n’est fait, 100 000 emplois sont menacés dans le secteur d’ici à 2024-2025. Dans le même temps, selon la Fondation de l’Abbé Pierre, plus de 14 millions de Français rencontreraient des problèmes pour se loger.
Avec des prix de l’immobilier élevés, la hausse des taux constitue une deuxième peine. La crise ne se résume pas à la question des taux d’intérêt. Au premier trimestre 2023, ils ont retrouvé leur niveau de 2012. En valeur réelle, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation, ils demeurent négatifs. Il n’en demeure pas moins que le taux moyen des crédits immobiliers est passé de 1,06 % en décembre 2021 à 3,15 % en avril, selon l’observatoire Crédit Logement CSA. Associé à des conditions d’accès plus strictes, la production de crédits à l’habitat a diminué en avril de 44,4 % sur un an, selon les estimations de la Banque de France. Le problème numéro 1 est le prix de l’immobilier qui a doublé en vingt ans. Le marché des logements, en France, est un marché de pénurie. La rareté du foncier et l’augmentation des coûts de construction ont favorisé une hausse de l’immobilier, hausse qui a été, par ailleurs, alimentée par la faiblesse des taux d’intérêt entre 2016 et 2021.
Le marché de la location est sous tension en raison de la raréfaction de l’offre. Le développement des locations saisonnières dans les grandes villes et dans les villes touristiques limite les locations à l’année. Plus de 800 000 logements seraient proposés, en France, en location saisonnière. Ce nombre aurait augmenté de près de 20 % en moins de deux ans. Les mesures visant à empêcher la location de logements ne respectant pas les normes énergétiques conduisent les propriétaires à les retirer de l’offre locative ou les vendre. L’offre de biens à louer aurait diminué de 46 % entre 2019 et 2023. La tension serait vive pour les deux pièces, 30 % de l’offre de logements et 40 % des demandes. La raréfaction des logements en location dans le parc privé provoque le gonflement du nombre de candidats pour un logement social. 70 % de la population y est éligible et en un an, 100 000 nouvelles demandes ont été déposées, portant à 2,3 millions le nombre total de ménages en attente d’une HLM. Même si la France a un des parcs les plus importants de logements sociaux d’Europe, la construction est insuffisante. 100 000 constructions ont été engagées en 2022 soit moins que prévu (120 000).
Les besoins en logement sont importants en raison de l’augmentation de la population et de sa concentration croissante sur certaines parties du territoire, grandes agglomérations et régions côtières. Par ailleurs, les divorces et l’essor des familles monoparentales contribuent également à accroître la demande en logements.
La France consacre chaque année plus de 38 milliards d’euros au logement sans pour autant que cela ne contribue à résoudre une crise vieille de plusieurs décennies. Le nombre de logements neufs construits se situe en fonction des années entre 350 000 et 400 000 quand il en faudrait au minimum 500 000. Les lois visant à lutter contre l’artificialisation des sols et à limiter l’urbanisation provoquent une raréfaction du foncier. En outre, les maires en lien avec les souhaits de leur population sont de plus en plus réticents à accroître l’offre de logements. Des candidats, lors des dernières élections municipales, se sont fait élire sur le thème de l’arrêt des constructions. La construction est également freinée par l’augmentation des coûts de construction en lien avec le durcissement des normes énergétiques. La faible industrialisation des process de construction ne facilite pas l’obtention de gains de productivité dans le secteur du bâtiment. Cette industrialisation qui passe par un recours plus important à des éléments préfabriqués nécessite, par ailleurs, un effort de formation en faveur des salariés du secteur du bâtiment.
Le gouvernement devrait dans le prolongement des travaux sur le logement du Conseil national de la refondation (CNR) annoncer plusieurs mesures. Un grand plan d’acquisition de logements neufs par CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts, auprès des promoteurs, est à l’étude.
Le gouvernement devra également indiquer s’il maintient plusieurs dispositifs en faveur de l’immobilier qui doivent s’éteindre en 2023 comme le Prêt à taux zéro (PTZ) ou en 2024 pour le Pinel qui vise à favoriser l’investissement locatif. En lieu et place de ces dispositifs, des experts plaident pour la création d’un statut de bailleur qui permettrait l’amortissement des biens immobiliers voués à la location, ce dispositif est aujourd’hui réservé aux logements loués meublés (statut LMNP). La Cour des Comptes a, à plusieurs reprises, souligné que les aides fiscales en faveur de l’immobilier locatif avaient une faible efficacité et qu’elles contribuent avant tout à la hausse des prix de l’immobilier.
Une refonte de la fiscalité des plus-values pourrait être imaginée. Les abattements en fonction de la durée de détention (23 ans pour la fiscalité et 30 ans pour les prélèvements sociaux) ne favorisent pas la fluidité du marché. Une taxation accrue pour les plus-values de moins de quatre ans et des abattements sur une période de 8 ans seraient certainement souhaitables à la fois pour concilier lutte contre la spéculation et fluidifier davantage le marché. L’instauration d’un régime de plus-values pour les résidences principale bien qu’impopulaire est certainement souhaitable pour limiter les effets d’aubaine, et pourrait donc être imaginée.
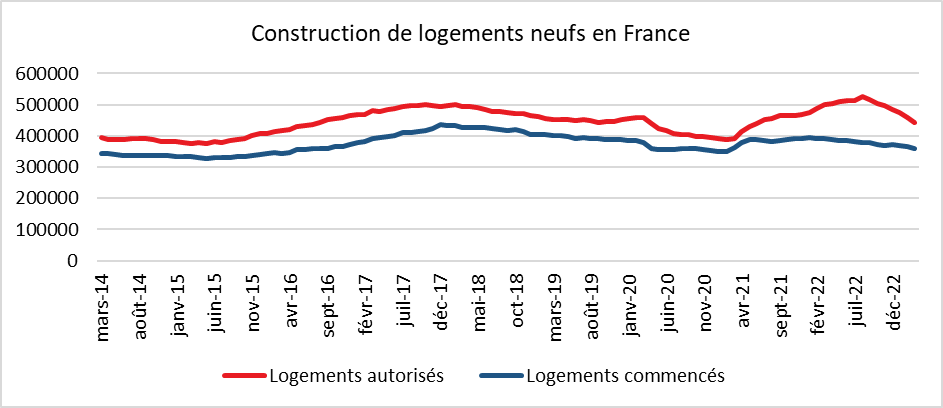
Cercle de l’Épargne – données SDES, Sit@del2, estimations à fin mars 2023
Les ménages français, toujours en mode écureuil
Les ménages français maintiennent un important effort d’épargne depuis plus de trois ans. En 2022, ils ont mis de côté, selon la Banque de France, 158,7 milliards d’euros soit un niveau équivalent à celui de 2021 (161,1 milliards d’euros). Ce flux est inférieur à celui de 2020, année marquée par les confinements (202,1 milliards d’euros). Il reste néanmoins nettement supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (101 milliards d’euros sur la période 2015/2019).
Cette propension à épargner demeure forte comme le prouve la collecte de l’épargne réglementée. Elle a été également soulignée par l’enquête du mois d’avril d’AG2RLAMONDIALE – AMPHITEA – LE CERCLE DE L’EPARGNE. Selon cette enquête, 65 % des Français privilégient la réduction de leurs dépenses pour faire face à la baisse de leur pouvoir d’achat en lien avec la résurgence de l’inflation. Seulement 27 % ont indiqué qu’ils pourraient être amenés à puiser dans leur épargne. 22 % des Français ont, par ailleurs, l’intention d’épargner davantage que dans le passé.
Un taux d’épargne toujours élevé
À fin 2022, le taux d’épargne en France n’a pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire. Cette situation est également constatée en Allemagne et au Royaume-Uni. En revanche, en Italie et en Espagne, le taux a retrouvé son niveau d’avant la pandémie. Aux Etats-Unis, il y est même inférieur en étant à son plus bas niveau depuis 2008.
Au quatrième trimestre 2022, le taux d’épargne était, en France, de 16,3 % du revenu disponible brut, contre 16,1 % au troisième. Pour l’ensemble de l’année, le taux d’épargne était de 18,6 % du revenu disponible brut, contre 15 % avant la crise sanitaire. Le taux d’épargne financière s’est élevé à 8,8 %.
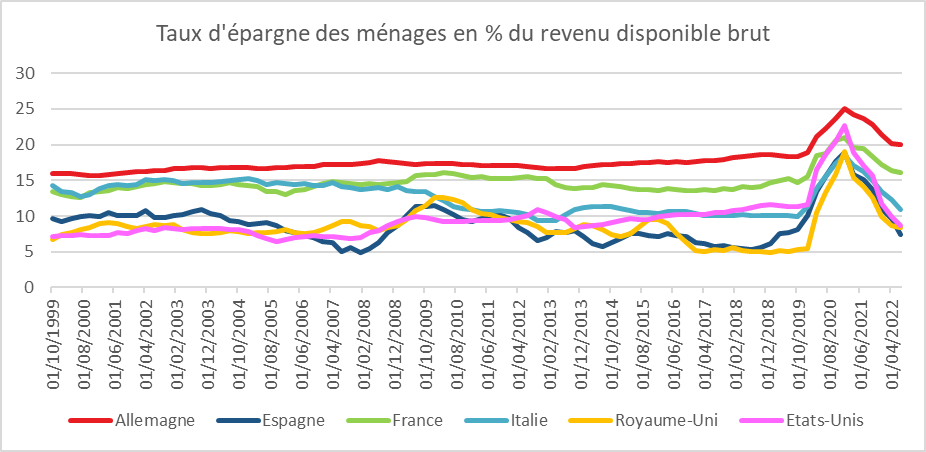
Banque de France
Au quatrième trimestre 2022, le flux trimestriel net de placements des ménages s’est élevé à 26,8 milliards, en recul de 15,1 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. L’épargne investie en produits de taux diminue (14,8 milliards d’euros après 34,6 au troisième trimestre), en raison d’un flux net négatif sur les dépôts à vue (-14,1 milliards d’euros). En revanche, les flux nets d’actifs sous forme de produits de fonds propres augmentent (14,2 milliards d’euros, contre 7,5 au troisième trimestre. Les ménages ont augmenté leurs versements en unités de compte sur les contrats d’assurance vie (8,8 milliards d’euros contre 4,9 au troisième trimestre).
Les premières données collectées par la Banque de France pour le premier trimestre 2023 témoignent d’une forte progression des flux d’épargne vers les produits réglementées et d’un dégonflage des dépôts à vue (-18,2 milliards).
Patrimoine financier des ménages, près de 5800 milliards d’euros
Le patrimoine financier brut des ménages français s’élevait, selon la Banque de France en France, au quatrième trimestre 2022, à 5785 milliards d’euros. Au cours du dernier trimestre 2022, il a progressé de 122,5 milliards d’euros du fait du rebond des cours boursiers et du maintien de flux financiers positifs. Sur un an, le patrimoine financier des ménages est, en revanche, en baisse de 260,9 milliards d’euros, en raison de la perte de valeur des actifs sur cette période.
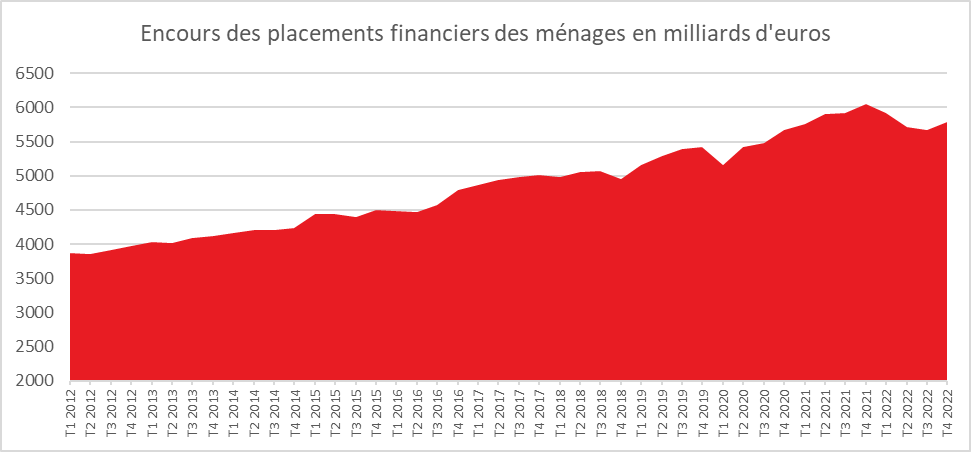
Banque de France
Au quatrième trimestre 2022, l’encours des produits de taux s’élevait à 3638 milliards d’euros. Il représentait 63 % de celui du patrimoine financier. Le numéraire et les dépôts à vue enregistraient un encours de 797 milliards d’euros en recul de 20 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent en raison d’arbitrages en faveur de l’épargne réglementée. L’encours de celle-ci a atteint, au quatrième trimestre 2022, le niveau record de 874 milliards d’euros, contre 862 milliards d’euros au trimestre précédent.
L’encours de l’assurance vie et de l’épargne retraite en fonds euros était de 1470 milliards d’euros au quatrième trimestre 2022.
Sur les 2070 milliards d’euros de produits de fonds propres détenus par les ménages, 326 milliards d’euros l’étaient sous forme d’actions cotées. L’assurance vie et l’épargne retraite en unités de compte représentaient 436 milliards d’euros.
Hausse de la rémunération de l’épargne liquide
La rémunération moyenne des dépôts bancaires a progressé de nouveau à 1,38 % en mars. Selon la Banque de France, le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages a plus que doublé sur un an pour atteindre 1,63 %, en lien avec les hausses des taux de l’épargne réglementée.
La rémunération des dépôts des Sociétés non financières , qui était quasi nulle en mars 2022, s’établit à 1,02 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et celle, plus limitée, des dépôts à vue.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| mars-2023 (g) | mars-2022 | janv- 2023 | févr- 2023 (f) | mars-2023 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 151 | 0,50 | 1,04 | 1,32 | 1,38 |
| dont Ménages | 1 854 | 0,79 | 1,23 | 1,60 | 1,63 |
| – dépôts à vue | 598 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 30 | 0,40 | 2,04 | 2,25 | 2,47 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 63 | 0,72 | 0,96 | 1,05 | 1,14 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 624 | 1,07 | 2,17 | 3,21 | 3,22 |
| dont : livret A | 361 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| – livrets ordinaires | 263 | 0,09 | 0,45 | 0,50 | 0,54 |
| – plan d’épargne-logement | 275 | 2,59 | 2,58 | 2,58 | 2,56 |
| dont SNF | 881 | 0,09 | 0,75 | 0,90 | 1,02 |
| – dépôts à vue | 595 | 0,04 | 0,24 | 0,34 | 0,37 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 228 | 0,13 | 2,10 | 2,29 | 2,45 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 58 | 0,60 | 1,54 | 1,76 | 2,00 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |
| Euribor 3 mois (d) | -0,50 | 2,35 | 2,64 | 2,91 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 0,23 | 2,52 | 2,72 | 2,79 | |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
L’or au plus haut, à qui la faute ?
L’or au plus haut avec les achats des banques centrales
Ces derniers jours, l’once d’or s’échangeait à plus de 2 000 dollars l’once quand son cours ne dépassait pas 1 300 dollars en 2018. En période d’inflation et d’incertitudes, l’or reste une valeur refuge. La volonté de certains pays de réduire leur exposition au dollar explique également la progression de son cours.
Par sa rareté, sa densité, son éclat et sa pérennité, l’or a toujours occupé une place à part dans les échanges. Il y a plus de 6 000 ans, les Égyptiens exploitaient déjà l’or du Nil. Les premières mines ont été ouvertes il y a plus de 5 000 ans. L’utilisation de l’or comme monnaie intervient six siècles avant notre ère, entre 561 et 546 av. J.-C. (dates de début et de fin de règne du roi Crésus sur la Lydie, pays d’Asie Mineure). Il tenait ses richesses du Pactole, la rivière qui cachait une multitude de paillettes d’or. Depuis cette époque, l’or est un symbole de richesse et de puissance. Le métal précieux est également une source de fantasmes. Par sa rareté, l’or permettait une régulation assez facile par les autorités. Sa résistance et sa densité sont deux caractéristiques clés qui lui ont permis de jouer le rôle d’étalon et de réserve.
177 200 tonnes d’or auraient été extraites depuis les origines. Ce volume se répartit entre la bijouterie (85 900 tonnes), l’épargne (35 500 tonnes), les réserves des banques centrales ainsi que des autres institutions officielles comme le FMI (30 500 tonnes) et les applications industrielles (21 600 tonnes). Les réserves des gisements encore à exploiter sont évaluées à 54 000 tonnes d’or (source : World Gold Council).
Malgré la fin de la convertibilité du dollar en or, le 15 août 1971, et les Accords de la Jamaïque des 7 et 8 janvier 1976 qui ont supprimé officiellement son rôle d’étalon, l’or demeure un des éléments de réserve des grandes banques centrales. Il est un marqueur de puissance. Les États émergents ont, à ce titre, acquis de l’or ces dernières années afin de se mettre au niveau de leur nouveau statut économique et financier. Les réserves de change atteignent 12 000 milliards de dollars. Le stock d’or des banques centrales représente de son côté 1 850 milliards de dollars.
Depuis trois ans, le métal précieux bénéficie de la succession des crises en jouant son rôle de traditionnelle valeur refuge. La hausse de son cours est avant tout la conséquence des achats opérés par certaines banques centrales. Ainsi, en janvier, selon le FMI, elles ont acquis, en valeurs nettes, 31 tonnes d’or. Depuis un an, les achats mensuels varient entre 20 et 60 tonnes, ce qui est élevé au regard de la tendance observée avant la crise sanitaire. Les banques centrales mondiales ont ainsi acheté 1 136 tonnes d’or en 2022. Ce chiffre, qui représente la plus grande quantité achetée par les banques centrales en 55 ans, est supérieur de 152 % aux 450 tonnes qu’elles ont achetées en 2021. Les pays émergents continuent à être les principaux acheteurs. Ils placent ainsi une partie de leurs réserves de change en or afin de crédibiliser leur politique monétaire et d’être moins dépendant du dollar qui est la première monnaie de réserve au monde (60 %). Le plus gros acheteur déclaré en 2022 a été la Turquie dont la banque centrale possède 565 tonnes d’or. La Banque populaire de Chine (BPoC) reste très présente sur ce marché, son stock d’or dépassant 2 025 tonnes. La Banque nationale du Kazakhstan est également active et possède un stock de 356 tonnes.
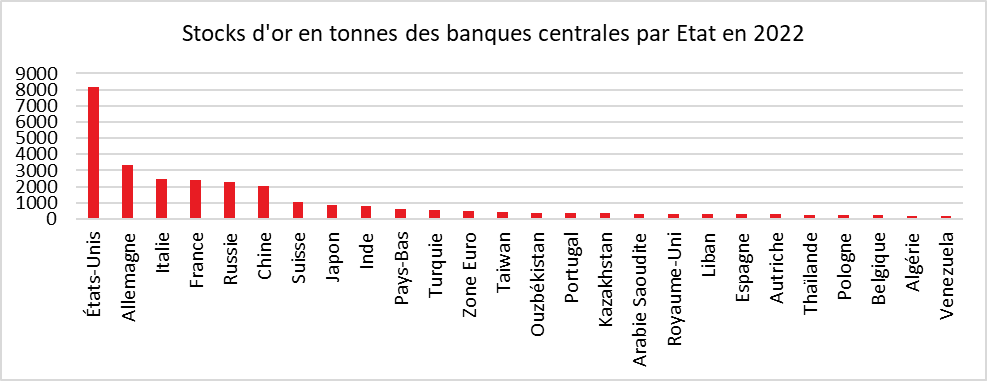
Cercle de l’Épargne – données FMI
Le Coin des Epargnants du 5 mai 2023 : les banques centrales toujours à la manœuvre
Marchés, une semaine aux signaux contradictoires
L’inflation continue à augmenter en Europe. L’emploi américain reste positif tout comme celui de la France. Les banques centrales américaine et européenne relèvent leurs taux directeurs mais le processus de hausses semble se rapprocher de son terme. Dans ce contexte chahuté, le Cac 40 a clôturé ce vendredi 5 mai sur un gain de 1,26 % à 7 432,93 points, mais en petite baisse sur l’ensemble de la semaine. Les indices des grandes places financières ont perdu également un peu de terrain.
L’économie américaine a créé 253 000 postes dans le secteur non agricole au mois d’avril, soit nettement plus que les 185 000 attendus. Les soldes des mois de mars et de février ont été révisés en baisse, de respectivement de 236 000 postes à 165 000 et de 311 000 à 248 000. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 3,4 %, là où le marché tablait sur une hausse à 3,6 %, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a accéléré à 4,4 %, contre une stabilisation à 4,2 % estimée.
Les taux des obligations souveraines ont été peu affectés par les relèvements des taux directeurs qui avaient été largement anticipés. Les investisseurs ont été sensibles à l’idée que les banques centrales allaient bientôt arrêter de resserrer la politique monétaire.
Le prix du pétrole a continué de reculer cette semaine pour s’établir à 75 dollars le baril. Cette baisse intervient malgré la réduction d’un million de barils supplémentaires décidée par l’OPEP+. Le ralentissement de l’économie mondiale explique cet accès de faiblesse. Le rebond économique chinois serait moins fort qu’escompté. Par ailleurs, le pétrole russe arriverait à déjouer les embargos et se retrouverait sur le marché notamment en passant par la Turquie.
Dixième relèvement consécutif des taux d’intérêt aux États-Unis
Mercredi 3 mai 2023, la FED a décidé de relever ses taux directeurs pour la dixième fois consécutive depuis le début de l’année 2022. Ce processus de relèvement est le plus rapide enregistré depuis quarante ans. La hausse d’un quart de point est néanmoins modérée. Après cette décision du comité de politique monétaire, la fourchette de taux s’établit désormais entre 5 % et 5,25 %.
Les marchés n’ont pas été surpris par l’annonce de la banque centrale américaine FED qui avait été largement anticipée. En revanche, les investisseurs espéraient que la banque centrale sonne la fin du cycle haussier avec une possible décrue des taux à partir de l’automne. En la matière, la FED est restée prudente. Son communiqué officiel de mai ne mentionne pas de nouvelles hausses pour les prochaines réunions à la différence du précédent communiqué. Le comité de politique monétaire a précisé qu’il prendra en compte « les restrictions cumulées de la politique monétaire, le retard avec lequel la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, et les développements économiques et financiers » avant de prendre une éventuelle décision de relèvement. En revanche, Jerome Powell a exclu l’hypothèse d’une baisse des taux cette année. Il a déclaré que « nous pensons que l’inflation va diminuer, mais pas si vite ». Dans son communiqué, la Fed indique également qu’elle « serait prête à ajuster sa position de politique monétaire de façon appropriée si des risques émergeaient qui pouvaient empêcher l’atteinte de ses objectifs ». Ces objectifs sont « un taux d’emploi maximal et une inflation qui progresse de 2 % sur le long terme ». Jerome Powell a toutefois souligné qu’en dépit d’une hausse de 5 points des taux directeurs depuis mars 2022, « le chômage est aussi bas qu’avant », et « au plus bas depuis 15 ans ». Le Président de la FED pense qu’il est « possible de refroidir le marché du travail sans grosse augmentation du chômage » tout en soulignant que l’histoire économique a plutôt montré l’inverse.
Parmi les « développements » que la Fed intègrera dans son analyse, figurent la situation des banques et l’évolution de l’accès au crédit qui est en baisse depuis le mois de mars pour les entreprises.
Les prochaines semaines aux États-Unis seront marquées par le problème du relèvement du plafond de la dette publique avec un risque de défaut de paiement en cas de persistance du désaccord politique entre Républicains et Démocrates. La date butoir est fixée au 1er juin.
Septième relèvement consécutif pour la BCE
Jeudi 4 mai 2023, la BCE a relevé ses taux directeurs. La hausse a été de 25 points de base après avoir déjà connu six hausses consécutives entre 0,50 et 0,75 point depuis juillet. Les taux directeurs de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4 %, au plus haut depuis octobre 2008.
La BCE a rappelé que son objectif de réduction de l’inflation était intangible. « Les décisions futures du Conseil des gouverneurs garantiront que les taux directeurs seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l’inflation à l’objectif à moyen terme de 2 % et seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire », précise le communiqué de la Banque centrale européenne.
Le relèvement avait été anticipé comme aux États-Unis. L’inflation est, en effet, toujours élevée et a même enregistré une légère progression en avril, passant de 6,9 à 7 % sur 12 mois. En revanche, l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix très volatils de l’alimentation et de l’énergie, et qui, de fait, est privilégiée par la BCE – a légèrement reculé le mois dernier, passant de 5,7 à 5,6 %. Le choix d’une hausse de 25 points de base a néanmoins surpris un certain nombre d’analystes comme ceux de JP Morgan et de Bank of America qui tablaient sur un relèvement de 50 points de base, comme lors des réunions précédentes. La BCE a certainement pris en compte la dernière enquête publiée mardi sur la distribution du crédit en zone euro au premier trimestre, qui souligne un ralentissement notable du financement de l’économie par les banques. Le relèvement a minima des taux directeurs peut également s’expliquer par le fait qu’en parallèle la BCE a décidé d’arrêter entièrement ses réinvestissements au titre de son principal programme d’achat obligataire, l’Asset purchase programme (APP) à compter du mois de juillet. Depuis deux mois, elle avait commencé à réduire ses achats d’obligations en s’abstenant de réinvestir – pour 15 milliards d’euros par mois – les montants issus du remboursement des obligations inscrites à son bilan. Une forte hausse des taux directeurs aurait pu fragiliser les banques au moment où la BCE réduit les liquidités sur le marché en dégonflant son bilan. Elle a aussi accéléré les remboursements des TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), des prêts ciblés de long terme accordés aux banques à des conditions avantageuses lors de la crise sanitaire. Près de 500 milliards d’euros de ces financements arrivent à échéance en juin.
La hausse du début de mois de mai décidée par la BCE ne devrait pas être la dernière. Les marchés parient sur un relèvement de 0,5 point des taux directeurs d’ici la fin de l’été en une ou deux fois.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 5 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 432,93 | -0,78 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 674.38 | -1,24 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 136,25 | -0,60 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 235,41 | +0,21 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 961,02 | -0,06 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 778,38 | -1,15 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 340,43 | -0,47 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 29 157,95 | +2,46 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 334,50 | +0,34 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,869 % | -0,017 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,282 % | -0,032 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,452 % | +0,015 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1025 | -0,96 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 2 015.80 | +1,11 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 75,12 | -5,77 % | 84,08 | 78,140 |
Le taux du Livret A : une affaire d’Etat
La fixation du taux du Livret A est de tout temps, une affaire d’Etat donnant lieu à d’importants débats. Avec la résurgence de l’inflation, cette question a gagné en acuité. L’épargne du Livret A doit-elle être protégée de la hausse des prix ou pas et dans quelles limites ? A France Info, mercredi 3 mai 2023, le Ministre de l’Economie a indiqué que « ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important ». Avec une inflation annuelle de 6 %, le taux réel du Livret A est négatif de trois points. Il faut remonter aux débuts des années 1980 pour retrouver une telle situation.
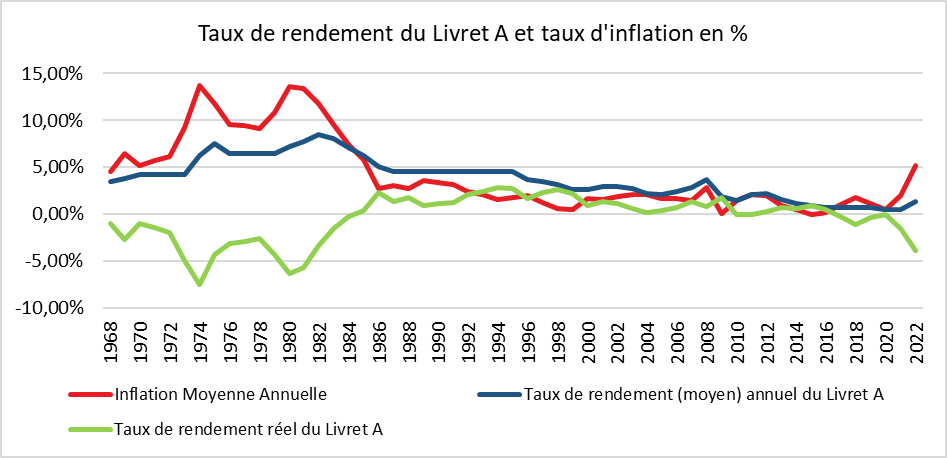
CDE – INSEE
La fixation du taux du Livret A est depuis 2004 établie en fonction d’une formule dont l’instauration visait à protéger les épargnants des effets de l’inflation. L’objectif était, par ailleurs, de déconnecter la fixation de ce taux de considérations d’ordre politique. Les conditions de fixation de ce taux ont été, à plusieurs reprises, modifiées, sans pour autant supprimer l’aspect éminemment politique de la décision. À plusieurs reprises depuis 2004, les gouvernements ont dérogé aux règles de fixation.
La formule en vigueur a été définie par l’arrêté du 21 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée. L’arrêté précise ainsi que :
Le taux des livrets A, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des livrets de développement durable et solidaire sont égaux, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :
- La moyenne arithmétique entre :
- la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;
- l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (série : 001763852) ;
b) 0,5 %.
La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor. Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’Économie dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du taux quand, à l’occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation au nom, notamment, de la préservation du pouvoir d’achat des épargnants. Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie. Les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le ministre chargé de l’économie examine l’opportunité de les modifier. Au mois de janvier, la Banque de France a permis ainsi au ministère de l’Économie de ne pas appliquer la formule. Celle-ci aurait conduit à revaloriser le taux du Livret A à 3,2 %.
L’arrêté du 21 janvier permet également des modifications exceptionnelles en dehors des deux rendez-vous classiques du 1er février et du 1er août. Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l’inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre chargé de l’économie de réviser les taux au 1er mai ou au 1er novembre. À cette fin, il transmet un courrier au ministre chargé de l’économie, dans les quatre jours ouvrés suivant le 15 avril ou le 15 octobre.
Quel taux du Livret A le 1er août 2023 et pour quelles conséquences ?
Avec, sur ces six derniers mois, une inflation moyenne qui devrait se situer autour de 6 % et un taux ester qui devrait avoisiner les 2,5 à 3 %, le taux du Livret devrait se situer autour de 4,3/4,5 % le 1er août prochain. Comme au mois de janvier, la Banque de France devrait laisser la responsabilité au gouvernement de fixer le taux.
Une augmentation du taux du Livret A a des conséquences financières, économiques et fiscales. Tous les acteurs économiques sont concernés par cette revalorisation.
Pour les ménages
Une augmentation d’un point du Livret A permettrait une moindre perte de pouvoir d’achat de l’épargne même si, dans les faits, il est difficile de mettre sur le même plan épargne et l’indice des prix à la consommation. Il faudrait comparer avant tout le rendement du Livret A avec les autres rendements des placements financiers ou immobiliers. Un passage à 4 % voire plus mettrait le rendement réel du Livret A autour de -2 % contre -3 % actuellement.
Le gain pour les épargnants du Livret A et du LDDS serait sur une année de 5,4 milliards d’euros. Pour un Livret A moyen, le gain d’un point de plus serait de 58 euros (encours moyen de 5 800 euros).
Un taux de 4 % devrait inciter les ménages à épargner davantage comme cela est déjà constaté depuis le 4e trimestre 2022. Le taux d’épargne reste supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire, 16,7 % au lieu de 15 %. Depuis le mois de septembre, les ménages réduisent leurs liquidités qui dormaient sur leurs comptes courants. L’encours de ces derniers est passé de 542 à 509 milliards d’euros de septembre 2022 à février 2023 (source Banque de France).
Le relèvement de 2 à 3 % du Livret A a provoqué une forte collecte durant tout le premier trimestre (20 milliards d’euros). Le Livret A ainsi enregistré son meilleur premier trimestre depuis la banalisation de la commercialisation en 2009.
Pour les établissements financiers
Les ressources du Livret A sont centralisées à 60 % par la Caisse des dépôts et consignations et conservées donc à 40 % par les banques.
L’emploi de ces ressources doit permettre de financer la rémunération du Livret A à laquelle s’ajoutent les frais de gestion. La Caisse des dépôts facture ainsi des frais de collecte, autour de 0,3 % au profit des banques.
Les ressources du Livret A et du LDDS servent à financer les bailleurs sociaux, les collectivités locales et des PME. Pour assurer la liquidité du Livret A, la moitié des ressources est affectée au fonds d’Épargne qui acquière des titres publics (titres monétaires et OAT).
Avec un coût global de ressource autour de 4,3 %, les établissements financiers ont peu d’emplois sûrs offrant ce rendement.
Un taux du Livret A élevé peut cannibaliser les autres placements. Des placements à plus long terme comme les fonds euros sont moins bien rémunérés ce qui n’est pas logique. Un placement long est supposé plus à risque qu’un placement court ce qui suppose une meilleure rémunération. Par rapport aux autres produits de court terme comme les livrets bancaires, le taux du Livret A pourrait rapporter plus de deux fois plus. Il serait également nettement plus rémunérateur que le rendement des fonds euros de l’assurance vie.
Depuis le mois de septembre, les épargnants réduisent leurs liquidités non rémunérés sur leurs comptes courants au profit du Livret A et du LDDS, ce qui génère un coût pour les banques.
Pour le logement social et les collectivités locales
Les établissements financiers pourraient être contraints de relever les taux d’emprunts pour les acteurs éligibles. Ces derniers pourraient être tentés de rechercher d’autres moyens de financer ou de renoncer à leurs projets d’investissement. L’autre solution pour les établissements financiers serait de réduire leurs marges.
Pour l’État
Le Livret A comme le LDDS ont un coût pour les pouvoirs publics du fait de la double exonération, fiscalité et prélèvements sociaux. Avec un taux de 4 %, le manque à gagner atteint 6,42 milliards d’euros, contre 4,8 milliards d’euros à 3 %. Ce manque à gagner est à relativiser car il n’est pas prouvé que les ménages auraient placé la totalité des sommes sur un placement fiscalisé.
La revalorisation du taux du Livret A pourrait également réduire les dividendes versés à l’État par la Caisse des dépôts et consignations. Ces dividendes s’étaient élevé, en 2021, à 2,5 milliards d’euros. À la marge, les banques pourraient acquitter moins d’impôt sur les sociétés.
La fixation du taux du Livret A est un sujet éminemment politique qui dépasse l’importance de ce produit dont l’encours est bien plus faible que celui de l’assurance vie. En instituant une formule, les gouvernements espéraient pouvoir échapper aux polémiques sur le taux du Livret A. Or, il n’en est rien. Compte tenu du caractère changeant de la conjoncture, les pouvoirs publics sont amenés à arbitrer entre des objectifs contradictoires. La préférence donnée à la consommation et donc à la croissance peut justifier un faible taux de Livret A. En période d’inflation, les ménages ont tendance à réduire leur consommation – comme cela est constaté par l’INSEE depuis plusieurs mois – tout en essayant de maintenir voire de renforcer leur épargne de précaution. Le développement du logement social que le gouvernement souhaite également encourager exige un taux le plus bas possible pour le Livret A. Si demain, EDF est autorisé à se financer à partir des ressources du Livret A pour réaliser son programme de construction de centrales nucléaires, il en sera de même.
Après l’adoption de la réforme des retraites, le gouvernement est, en revanche, invité à réaliser quelques concessions en faveur des ménages. La revalorisation du taux du Livret A pourrait faire partie de celles-ci. Ce dernier comme l’a indiqué Bruno Le Maire sera donc revalorisé le 1er août prochain mais certainement moins que ce que la simple application de la formule permettrait. Un taux autour de 3,5 % est sans nul doute probable.
La baisse de la note de la France par Fitch, quelles conséquences ?
Le 28 avril dernier, l’agence Fitch a abaissé la note de la dette publique française de AA à AA-. Les deux autres grandes agences, Moody’s et Standard & Poor’s pourraient également réviser à la baisse leur note concernant la France.
Ces notes reflètent les capacités d’emprunt des États. Les agences pour les fixer prennent en compte la situation économique, financière ainsi que politique des Etats. Ces notes influent dans une certaine mesure sur le niveau des taux d’intérêt proposés par les investisseurs sur le marché obligataire et sur la liquidité de ce marché. Elles concernent directement les emprunts publics mais entraînent également des conséquences sur les emprunts souscrits par les autres acteurs économiques qui sont censés ne pas pouvoir être mieux notés que l’Etat dont ils dépendent. L’effet à court terme sur les taux est faible mais, à moyen terme, cela signifie une hausse pour tous les prêts avec à la clef un écart plus important avec les Etats les mieux notés. Pour les pouvoirs publics, c’est un surcoût pour le service de la dette qui absorbe déjà plus de 50 milliards d’euros par an. Pour les autres emprunteurs, c’est également une augmentation des coûts à prévoir.
La France a perdu son triple A est la meilleure note entre 2012 et 2013. Au 28 avril 2023, elle est AA1 pour Moody’s, AA pour Standard & Poor’s et donc AA- pour Fitch. Sont notés triple A par les trois agences, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, Danemark, l’Australie, la Norvège, la Suède et Singapour.
L’agence Fitch pour justifier la baisse de la note de la France a notamment souligné « l’impasse politique et les mouvements sociaux » limitant les capacités de réforme du gouvernement. L’agence n’imagine pas une réduction rapide du déficit public. Ce dernier s’est élevé à 4,7 % du PIB en 2022, soit plus de deux points au-dessus de la moyenne des pays classés AA (2,3 % du PIB). Cette dégradation était, par ailleurs, assez logique compte tenu du niveau atteint par la dette publique, plus de 111 % du PIB, niveau qui était le plus élevé au sein des Etats classés AA. Fitch ne prévoit pas d’amélioration en la matière. En 2027, l’agence s’attend à une dette publique de 114,3 % du PIB, soit 17 points au-dessus de son niveau prépandémie. Autre point d’inquiétude, Fitch considère que la croissance annuelle moyenne du PIB ne sera que de 1,1 % de 2023 à 2027, quand Bercy parie sur un taux se situant entre 1,7 et 1,8 %. La disparition des gains de productivité et la faible croissance du taux d’emploi font craindre une baisse de la croissance potentielle de la France.
Le prochain rendez-vous pour la notation de la France est le 2 juin prochain avec la décision de S&P (aujourd’hui notée AA avec perspective négative).
Le Coin des Epargnants du 28 avril 2023 – Avril a souri aux actions
Le CAC 40 a signé un quatrième mois consécutif de hausse, une série qui n’a été observée qu’à trois reprises depuis la création de l’indice en 1988. Sur les mois de janvier à avril, le marché français a progressé de plus de 15 %, ce qui constitue le quatrième meilleur début d’année en trente-trois ans. L’indice parisien est toujours porté par la forte appréciation des valeurs du luxe, LVMH étant devenue la première capitalisation européenne. Aux Etats-Unis, le Dow Jones a effacé les pertes de la fin de l’année dernière en enregistrant un gain de près de 0,5 %.
Sur la semaine, le CAC40 a perdu un peu de terrain après avoir battu plusieurs fois son record la semaine précédente. Les résultats économiques n’étaient pas une source d’optimisme démesuré. Aux Etats-Unis, l’indice « core PCE » des dépenses de consommation personnelle, mesure de l’inflation la plus suivie par la Fed et composante de la statistique des revenus et dépenses des ménages, n’a que légèrement diminué de 0,1 point de base à 4,6 % sur un an. Il se maintient nettement au-dessus de l’objectif de la banque centrale, dont le comité de politique monétaire rendra sa décision sur l’évolution du loyer de l’argent mercredi prochain. De son côté, l’indice du coût du travail a augmenté de 1,2 % au premier trimestre après une hausse 1,1 % trois mois plus tôt. Ces résultats devraient conduire à une nouvelle hausse de 25 points de base les taux directeurs américains à l’occasion de la prochaine réunion de la FED, début mai.
Dans la zone euro, le ralentissement de l’économie est confirmé. Le PIB s’est accru de 0,1 % au cours du premier trimestre, soit moins que prévu par le consensus (+0,2 %). En glissement annuel, la croissance n’est plus que de 1,3 %, contre 1,8 % sur les trois premiers mois de 2022. L’inflation ne donne toujours pas de signes d’accalmie. En France, elle est encore en hausse de +0,2 point à 6,9 % sur un an. En hausse, elle gagne 0,7 point à 3,8 %. En Allemagne, elle n’a reculé que de 0,2 point à 7,6 %. Philip Lane, l’économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), réclame une nouvelle hausse des taux directeurs qui pourrait intervenir à la réunion des gouverneurs prévue le 4 mai, estimant que la lutte contre l’inflation est loin d’être finie. Il souhaite également une réduction des aides publiques de soutien au pouvoir d’achat qui retardent le recul de l’inflation. Ces aides soutiennent la demande et incitent les entreprises à répercuter la hausse des prix. La récession a été évitée en zone euro au premier trimestre grâce à la décrue des prix énergétiques et à l’atténuation des goulets d’étranglement. L’économiste de la BCE parie toujours sur une croissance de 1 % en 2023 tout en soulignant que les incertitudes demeurent importantes.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 28 avril 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 491.50 | -1,13 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 098.36 | +0,66 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 169.58 | +0,63 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 226.58 | +0,99 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 922.38 | +0,17 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 870.57 | -0,55 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 359.31 | -1,30 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 28 856,44 | +1,02 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 302,62 | +0,87 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,886 % | -0,094 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,314 % | -0,158 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,437 % | -0,123 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1.1032 | -0,41 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 993.00 | +0,43 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 79.57 | -2,73 % | 84,08 | 78,140 |
Vendredi 28 avril, l’agence de notation Fitch a abaissé d’un cran la note de la France à «AA-». Cette dégradation de la note française est imputable aux tensions sociales récentes qui réduisent la capacité du gouvernement à maitriser les finances publiques. L’agence souligne que « l’impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes d’Emmanuel Macron et pourraient créer des pressions en faveur d’une politique budgétaire plus expansionniste ou d’un renversement des réformes précédentes».
La croissance sauvée par son commerce extérieur
Au premier trimestre 2023, le commerce extérieur a sauvé la croissance de l’économique française qui a atteint +0,2 % faisant suite à une stagnation au dernier trimestre 2022 et à une hausse de +0,1 % au troisième trimestre 2023. L’économie est sur un plateau depuis plus de neuf mois du fait d’une demande intérieure étale. Contrairement à ses habitudes, le commerce extérieur a contribué lors du dernier trimestre positivement à la croissance.
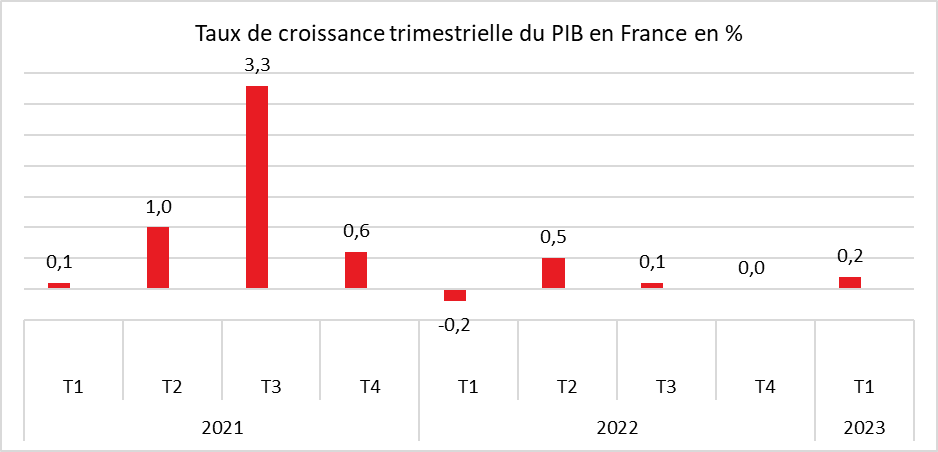
CdE- INSEE
Une production en hausse
La production totale a enregistré, au premier trimestre une progression de +0,4 % après +0,1 %. Cette accélération provient notamment du dynamisme de l’industrie manufacturière (+0,7 % après ‑0,4 %). Après les grèves, la production a augmenté dans les raffineries (+13,1 % après ‑11,4 %). La production dans les matériels de transport est également en hausse (+2,8 % après +1,5 %) tout comme celle des biens d’équipement (+2,1 % après +0,3 %). Par ailleurs, la production d’énergie poursuit son rebond du trimestre précédent à la suite de la réouverture des centrales nucléaires (+3,1 % après +1,3 %). La production de services augmente légèrement (+0,2 % après +0,1 %). Elle reste portée par le secteur du tourisme. L’activité de l’hébergement et de la restauration est en progrès de +1,5 % après +0,2 %. Le secteur de l’information et communication demeure dynamique (+1,3 % après +1,1 %). La production dans les transports est, en revanche, en recul (‑0,7 % après +0,6 %).
La consommation des ménages au point mort
Après une contraction de 1 % au dernier trimestre 2022, la consommation est restée stable au cours du premier trimestre 2023. La baisse des achats de biens par les ménages est moins marquée qu’au trimestre précédent (‑0,2 % après ‑2,2 %), même si la consommation alimentaire recule pour le cinquième trimestre consécutif (‑2,3 % après ‑3,1 %). En revanche, la consommation d’énergie est en nette hausse (+3,7 % après ‑6,4 %), en lien avec une hausse de la consommation effective, mais également avec la réduction des mesures de soutien des pouvoirs publics (ristourne, etc.). La consommation des ménages en services est en hausse de 0,6 % (après +0,5 % au trimestre précédent). Cette légère accélération est portée par l’hébergement et la restauration (+1,6 % après +0,2 %) et les services aux ménages (+1,3 % après +1,1 %). Face à la hausse des prix, les ménages privilégient les activités de loisirs au détriment des achats alimentaires. Les produits bio sont ainsi moins demandés. En revanche, les ménages ne puisent pas dans leur épargne pour maintenir leur consommation.
L‘investissement en mode repli
L’investissement, la formation brute de consommation fixe (FBCF) a reculé de 0,2 % au premier trimestre, après une stagnation au dernier trimestre 2022. Cette diminution s’explique par la baisse de la FBCF en produits manufacturés (‑0,5 % après +0,6 %), pénalisée en particulier par le reflux de l’investissement en biens d’équipement (‑1,2 % après +3,3 %). La FBCF en services marchands est, en revanche, en hausse au premier trimestre (+0,4 % après ‑0,2 %), tirée par le dynamisme de l’investissement en information-communication (+1,5 % après +1,1 %). La FBCF en construction diminue de nouveau au premier trimestre 2023 (‑0,4 % après ‑0,2 %).
La FBCF des ménages, essentiellement composé des achats de biens immobiliers, se replie pour le sixième trimestre consécutif (‑1,4 % après ‑1,6 %). Cette contraction est liée à la baisse de la construction de logements neufs et à celle des transactions immobilières dans le neuf et dans l’ancien.
Le commerce extérieur, vecteur de croissance
La contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est positive au premier trimestre de +0,6 point, après +0,2 point au trimestre précédent). Ce solde positif est imputable à une hausse des exportations et à un recul des importations.
Les exportations augmentent de 1,1 % au premier trimestre après +0,9 % grâce notamment aux ventes de matériels de transport (+9,5 % après +0,1 %). À l’inverse, les exportations en produits agricoles reculent fortement (‑21,5 % après +3,5 %).
Les importations se sont contractées de 0,6 % au premier trimestre, après +0,1 % au dernier trimestre 2022. Les importations en produits manufacturés diminuent de ‑2,4 % après +1,0 %. Les importations de pétrole raffiné se réduisent de 18,5 %), après une forte hausse de +21,8 % au quatrième trimestre 2022 provoquée par les grèves dans les raffineries. Les importations de matériels de transport restent dynamiques (+7,8 % après +3,8 %). Les importations de services restent orientées à la hausse (+3,3 % après +3,9 %), portées par celles des services de transport (+6,1 % après +10,5 %).
Léger déstockage des entreprises
Les variations de stocks contribuent négativement à la croissance du PIB à hauteur de de ‑0,3 point, après +0,2 point au quatrième trimestre 2022. Les entreprises ont réduit leurs stocks du fait des incertitudes sur le cours de la croissance.
La croissance de l’économie française sur le premier trimestre est fragile. Elle résulte avant tout du solde positif du commerce extérieur qui a été dopé par la réduction des achats d’énergie à l’étranger. Celle-ci est la conséquence du redémarrage des centrales nucléaires et de la diminution des achats de produits raffinés. En revanche, la consommation des ménages reste étale. La contraction de l’investissement est, par ailleurs préoccupant. L’objectif d’une croissance de 1 % pour l’ensemble de l’année reste atteignable sous réserve d’une réelle reprise de la consommation au cours du second semestre.
Le PER plus fort que l’assurance vie
L’assurance vie battue par le Livret A
Au mois de mars, la collecte nette de l’assurance vue a été de 400 millions d’euros après 1 milliard d’euros en février et 1,2 milliard en janvier. En 2022, au mois de mars, la collecte nette avait atteint 2,2 milliards d’euros. Sur le premier trimestre 2023, la collecte nette s’est élevée à 2,6 milliards d’euros. L’assurance vie est ainsi nettement distancée par le Livret A qui, sur les trois premiers mois de l’année, a collecté près de 20 milliards d’euros nets.
En dix ans, l’assurance vie a enregistré deux décollectes en mars, en 2020, lors du premier mois de la crise sanitaire et en 2017. La collecte moyenne, toujours sur dix ans, est légèrement inférieure à 2 milliards d’euros. La collecte nette de l’année 2023 est donc en-deçà. La forte concurrence de l’épargne réglementée explique sans nul doute ce résultat en demi-teinte.
L’assurance vie pâtit toujours de l’effet « revalorisation du taux du Livret A », revalorisation intervenue le 1er février dernier. À 3 % net d’impôt, il est, en effet, supérieur aux taux de rendement de contrats d’assurance vie. L’assurance vie, présente l’avantage, à la différence du Livret A, de ne pas être plafonnée. Elle permet une diversification sur un très grand nombre de supports, unités de compte, permettant de résister mieux que le Livret A à l’inflation. Il n’en demeure pas moins que l’assurance vie est de plus en plus challengée par l’épargne réglementée. Pour contrer ce phénomène, la rémunération des fonds euros a été en hausse en 2022 et plusieurs assureurs ont annoncé des taux bonifiés pour 2023 afin d’attirer les assurés.
La collecte nette est toujours portée par les unités de compte. Ces derniers ont contribué, en mars, à celle-ci à hauteur de 3,1 milliards d’euros quand les fonds euros ont enregistré une nouvelle décollecte de 2,7 milliards d’euros. La bonne tenue des marchés incite les assurés à opter pour ce type de supports.
La collecte brute reste dynamique toujours grâce aux unités de compte
La collecte brute pour le mois de mars s’est élevée à 14,4 milliards d’euros. Cette collecte est portée par les unités de compte qui enregistrent une croissance de 10 % par rapport à février. La collecte des fonds euros est en hausse de son côté de 4 %. Sur l’ensemble du premier trimestre, la collecte brute a atteint 41,6 milliards d’euros.
La part des unités de compte dans la collecte brute demeure stable. Au mois de mars, elle était de 41 % et, pour le premier trimestre, de 40 % soit le taux moyen de 2022.
Des prestations au plus haut
Les prestations ont atteint un niveau record au mois de mars 2024 à 14,0 milliards d’euros, contre 11,9 milliards d’euros en février 2023 et 11,6 milliards d’euros en mars 2022. Cette forte progression des prestations s’explique par l’augmentation du nombre de décès en France donnant lieu à des liquidations pour succession ainsi que par des rachats de la part des ménages en vue d’une réallocation de leur épargne. Les conditions d’apports en matière d’emprunts immobiliers dont le coût est en hausse, contraignent les acheteurs de logement de puiser plus abondamment dans leur épargne et notamment dans leur contrat d’assurance vie. Par ailleurs, certains assurés sont tentés de replacer une partie des sommes de leurs fonds euros sur des livrets réglementés non saturés.
Sur le premier trimestre, les prestations sont ainsi en hausse de +6,3 milliards d’euros par rapport à la même période de l’année dernière, à 38,9 milliards d’euros. Les rachats représentent 59 % des prestations contre 57 % au cours du premier trimestre 2022.
Un encours proche de 1 900 milliards d’euros
L’encours de l’assurance atteint 1 884 milliards d’euros à fin mars, en hausse de +1,5 % sur un an, hausse en lien avec la bonne tenue des marchés financiers.
Le Plan d’Épargne Retraite toujours en phase d’ascension
Si l’assurance vie est en mode poussif, le Plan d’Épargne Retraite (PER) poursuit sa croissance. À la du mois de mars, 4 millions de personnes disposent d’un PER assurantiel pour un encours de 51,4 milliards d’euros. La proportion d’unités de compte atteint 46 %. Au mois de mars, la collecte nette a été de 463 millions d’euros, soit plus que celle de l’assurance vie. Elle est en hausse de 12 % par rapport à mars 2022.
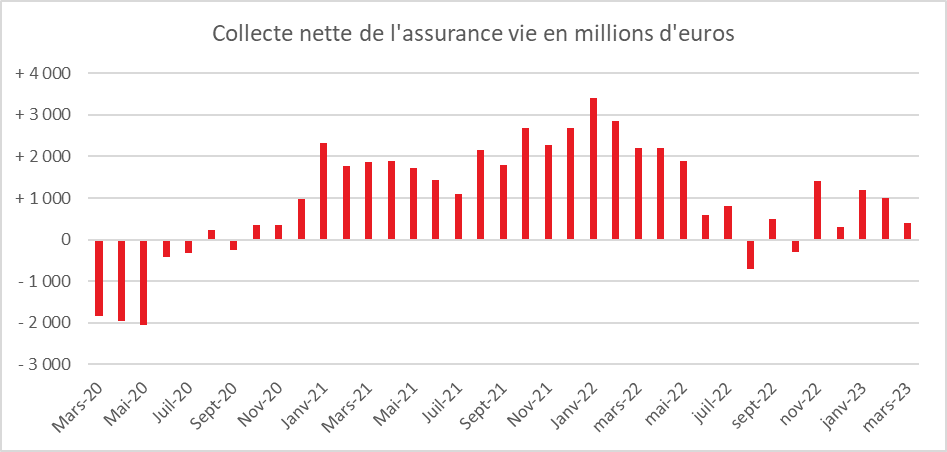
CDE – France Assureurs
Le Coin des Epargnants du samedi 22 avril 2023 – le CAC toujours plus haut grâce au luxe
Cinquième semaine de hausse consécutive pour le CAC 40
Cette semaine, le CAC 40 a une nouvelle fois battu son record en atteignant 7 577 points en clôture, vendredi 21 avril. Avec un gain de 0,76% en cinq jours, l’indice parisien signe ainsi une cinquième semaine de hausse consécutive. La place de Paris est toujours soutenue par les valeurs du secteur du luxe (LVMH, Hermès, Kering, L’Oréal) et par EssilorLuxottica. Le numéro un mondial de l’optique enregistre une forte croissance tant pour les verres que pour les montures. Cette société est de plus en plus assimilée à une marque de luxe. La hausse de cette semaine est plus modérée que les précédentes, les investisseurs attendant les résultats de vingt entreprises la semaine prochaine ainsi que les décisions des banques centrales. Aux Etats-Unis, cet attentisme s’est traduit par un léger recul des indices. La FED devrait procéder à une nouvelle hausse de ses taux de 25 points de base. Pour de nombreux experts, cette hausse pourrait être la dernière du cycle enclenché au début de l’année 2022. En zone euro, la solidité de l’indice PMI composite en avril, à 54,4 en première estimation, soulignant que l’activité reste encore dynamique pourrait conduire la BCE à relever ses taux de 50 points de base le mois prochain.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 21 avril 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 577,00 | +0,76 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 809,03 | -0,27 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 133,55 | -0,24 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 072,38 | -0,54 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 881,66 | +0,41 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 914,13 | +0,51 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 390,75 | +1,20 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 28 564,37 | +0,58 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 302,62 | +0,87 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,980 % | +0,045 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,472 % | +0,036 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,560 % | +0,040 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0976 | -1,13 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 975,61 | -1,46 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 81,71 | -5,76 % | 84,08 | 78,140 |
Le label ISR encore plus vert
Le label ISR est un label d’État créé en 2016 par le ministère de l’Économie destiné à répertorier des fonds d’investissement ainsi que des supports immobiliers (OPCI/SCPI) en fonction de critères environnementaux. Ce label atteste que les gestionnaires ont effectué une sélection d’investissements en fonction de critères environnementaux sociaux et de gouvernance, abrégés critères ESG. Plus de 1 200 fonds sont labellisés. Selon le site du label ISR, l’ensemble de ces fonds labellisés pèse 695 milliards d’euros, (440 milliards d’euros pour les fonds de droit français et 255 milliards d’euros de fonds étrangers).
Compte tenu de l’évolution de la réglementation européenne, le gouvernement a décidé de renforcer le label ISR avec comme objectifs de limiter le greenwashing et d’assurer la crédibilité du label. Jusqu’à maintenant, le label reposait sur un cahier des charges comportant six catégories d’exigences. En fonction des réponses, les certifications sont délivrées par des organismes indépendants agréés par le Comité français d’accréditation.
Le nouveau référentiel du label ISR est soumis à la consultation publique durant six semaines, permettant aux parties prenantes, sociétés de gestion, investisseurs, conseillers financiers, ONG et lobbies de donner leurs opinions. La proposition de référentiel définitif sera soumise au ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, les candidats à la labellisation devraient soumettre un plan d’action concret concernant la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le comité du label propose d’exclure les producteurs de charbon ou d’énergies fossiles non conventionnelles pour plus de 5 % de leur production, ainsi que ceux qui investissent dans tout nouveau projet de ce type. Des indicateurs devraient obligatoirement être mis en place pour mesurer les effets réels des portefeuilles sur les questions sociales, environnementales et de bonne gouvernance.
Dans l’hypothèse d’une publication de la décision du ministre en septembre, le nouveau référentiel entrerait en vigueur en janvier prochain pour les nouvelles labellisations. Les sociétés de gestion auront un an pour mettre les fonds déjà labellisés en conformité avec les nouvelles normes. Valable trois ans, le label est en principe revu tous les ans par les auditeurs de labellisation des fonds (Afnor Certification, EY France et depuis 2020, Deloitte).
La nouvelle version du label devrait être plus exigeante, l’approche reste basée sur des process assez lourds. L’insuffisance d’exclusion sur les énergies fossiles fait l’objet de critiques, tout comme l’absence de gradation des fonds en fonction de leur degré d’exigence. Ce label ISR ne permet toujours pas une harmonisation européenne. Les gérants souhaitent qu’un label européen soit adopté. Actuellement, un fonds distribué dans plusieurs pays doit répondre aux exigences d’exclusion des différents labels, ce qui restreint le choix d’investissement et génère des coûts.
Le trimestre en or du Livret A
Le Livret A achève le premier trimestre 2023 en beauté avec une collecte de 4,17 milliards d’euros. Elle fait suite aux collectes exceptionnelles de janvier (+9,27 milliards d’euros) et de février (+6,27 milliards d’euros). Le Livret A fait mieux qu’en mars 2022 qui s’était soldé par une collecte de 3,02 milliards d’euros. Sur le trois premiers mois de l’année 2023, la collecte atteint 19,71 milliards d’euros, ce qui constitue un record sans précédent.
L’encours du Livret A atteint ainsi un nouveau record à 395,1 milliards d’euros. Depuis la fin décembre 2019, avant la crise sanitaire, soit un gain de 33 %.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire a également enregistré une collecte positive de 1,82 milliard d’euros en mars. La collecte sur le premier trimestre s’est élevée à 5,67 milliards d’euros, ce qui constitue un record. L’encours du LDDS a également atteint un nouveau sommet à près de 140 milliards d’euros
L’encours cumulé de ces deux produits s’élève désormais à 535,1 milliards d’euros.
L’effet taux continue à jouer à plein
Le mois de mars est, en règle générale, un mois sans anicroche pour le Livret A : aucune décollecte lors de ces dix dernières années n’a été constatée. La collecte moyenne sur dix ans est de 1,65 milliards d’euros en mars. Le cru 2023 est donc 2,5 fois supérieur à la moyenne.
Le Livret A a bénéficié, pour le troisième mois consécutif, de l’effet « taux », le relèvement à 3 % ayant été annoncé en janvier et est intervenu au mois de février dernier. Les ménages continuent de recycler leurs liquidités en les transférant vers leur Livret A et leur LDDS. L’encours des dépôts à vue est passé de 542 à 509 milliards d’euros de fin septembre 2022 à fin février 2023. Ce phénomène de reclassement des liquidités favorise le LDDS qui est plus souvent que le Livret A accouplé au compte courant. Dès sa création, en 1983, le LDDS a été distribué par l’ensemble des réseaux bancaires quand la banalisation du Livret A n’est intervenue qu’en 2009.
De plus en plus de Livrets A et de LDDS au plafond
Fin 2021, 4,3 millions de Livrets A étaient au plafond (22 950 euros) sur un total de plus de 55 millions, soit près de 8 % du total. Compte tenu de l’importance de la collecte de ces derniers mois, leur proportion a dû atteindre 10 %. L’encours moyen du Livret A est de 5 500 euros.
Fin 2021, sur un total de 24,5 millions de LDDS, 22 % étaient au plafond (12 000 euros) soit 4,6 millions. L’encours moyen était alors de 5 100 euros. En 2021, 320 000 étaient arrivés au plafond. Compte tenu des collectes, le nombre de LDDS au plafond a du dépasser 25 millions.
La progression du nombre de Livrets A et de LDDS au plafond devrait limiter les versements pur les épargnants, notamment les plus aisés qui seront amenés à se reporter sur les superlivrets les livrets bancaires, les dépôts à terme ou les fonds euros de l’assurance vie.
Le Livret A plébiscité par tous les Français
Selon l’enquête AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – CERCLE DE L’EPARGNE de 2023 « Les Français, l’épargne et la retraite », près des deux tiers des Français (65 %) estiment intéressant de placer son argent sur le Livret A. Il devance ainsi l’immobilier locatif (60 %) et l’assurance vie (56 %). Jamais, lors de ces dix dernières années, le Livret A n’avait occupé la première place de ce classement. Le Livret A est plébiscité par les jeunes comme par les seniors. 61 % des jeunes de 18 à 24 ans, 67 % des 50 à 64 ans et 75 % des plus de 65 ans considèrent comme intéressant de placer son argent sur le Livret A. Ce sont les détenteurs de revenus moyens et élevés qui mettent le plus en avant ce produit (68 % de ceux gagnant entre 2 000 et 3 000 euros, 70 % de ceux qui gagnent entre 3 000 et 4 000 euros par mois et 66 % de ceux gagnant plus de 4 000 euros par mois). 76 % des personnes qui entendent épargner davantage dans les prochains mois placent le Livret A en tête des placements intéressants.
Le Livret A malgré un rendement réel négatif, le placement anti-inflation des Français
Toujours selon l’enquête précitée, le Livret A arrive en tête dans le classement des produits d’épargne protégeant le mieux de l’inflation. Il devance le Livret d’Épargne Populaire pourtant plus rémunérateur (6,1 % contre 3 %) mais moins largement diffusé n’étant pas accessible à tous les Français.
Le rendement réel du Livret A n’en demeure pas moins négatif (-3 points), ce qui signifie qu’il ne permet pas de garantir la valeur du capital.
Vers une collecte record
Traditionnellement, le premier semestre est porteur pour le Livret A. Cette année, il est parti pour battre de nouveaux records. Une reprise de la consommation pourrait intervenir durant le second semestre donnant lieu à un tassement de la collecte.
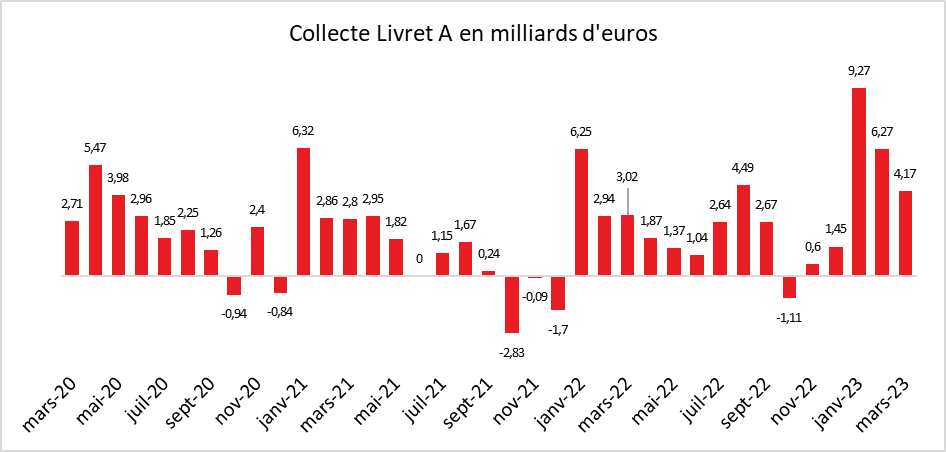
Cercle de l’Épargne – données Caisse des Dépôts et Consignation
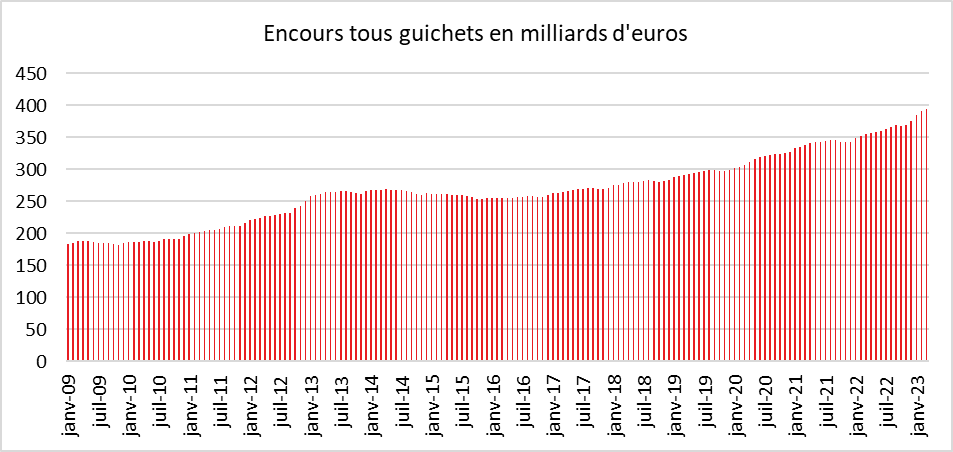
Cercle de l’Épargne – données CdC
La réforme des retraites version 2023 promulguée
La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 qui contient la réforme des retraites a été publiée au Journal officiel le samedi 15 avril 2023 ce qui permet son application. Le Conseil constitutionnel a annulé plusieurs dispositions qui n’avaient pas de conséquences budgétaires et qui n’avaient pas lieu, de ce fait, d’être dans une loi de financement de la Sécurité sociale.
Les principales dispositions de la réforme
Le report de l’âge de départ à la retraite
L’âge légal de départ à la retraite sera donc porté progressivement à 64 ans à compter du 1er septembre 2023. à raison de 3 mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat en 2027, puis atteindra 64 ans en 2030.
La réforme de 2014, dite Touraine, prévoyant le passage la durée de cotisation à 43 ans sera accélérée. La durée de cotisations requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, qui devait passer de 42 à 43 ans (172 trimestres) d’ici à 2035, atteindra finalement cet objectif en 2027.
Les personnes nées dans la deuxième partie de l’année 1961 constituent la première génération concernée par la réforme.
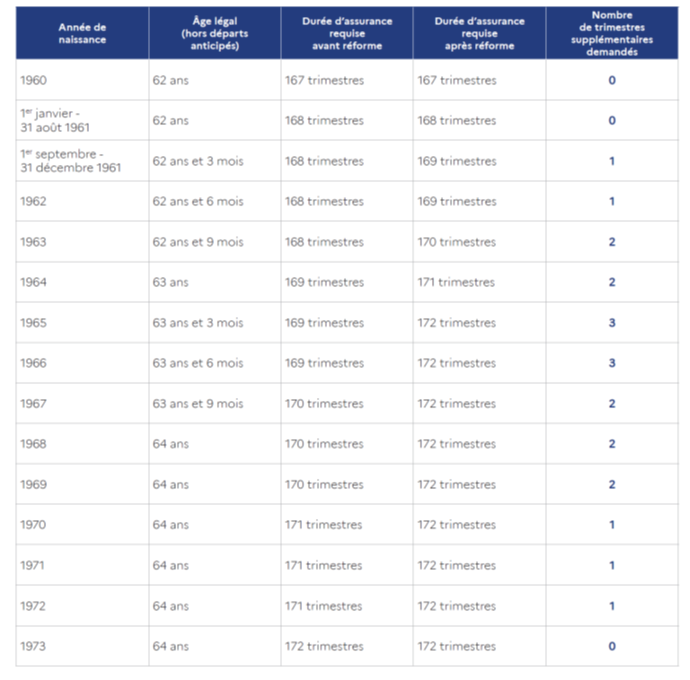
L’âge de la retraite à taux plein à 67 ans, âge à partir duquel il est possible de partir sans décote n’est pas modifié.
Pour les personnes invalides, l’âge de départ à la retraite à taux plein est fixé à 62 ans.
La fermeture des régimes spéciaux (la clause dite du grand père)
La loi prévoit de fermer les régimes spéciaux en respectant la clause dite du grand-père. A partir de septembre 2023, les nouveaux embauchés de la RATP, des entreprises de l’industrie électrique et gazière (IEG), de la Banque de France, du Conseil économique social et environnemental ou encore les clercs et employés de notaire seront affiliés au régime général comme cela avait déjà été prévu pour la SNCF. Ceux qui dépendent d’un de ces régimes spéciaux continueront à en bénéficier. Leur âge de départ à la retraite sera néanmoins reculé de deux ans en prenant comme référence leur borne d’âge actuel. Des régimes spéciaux (SNCF, RATP, EDF…) devraient par ailleurs bénéficier d’un calendrier de mise en œuvre du report de l’âge légal spécifique, du fait d’une montée en puissance progressive de la réforme précédente.
La revalorisation des pensions les plus modestes
Le minimum de pension versée par les régimes de bases (minimum contributif) sera fixé à 85 % du SMIC net (autour de 1 200 euros) pour les personnes ayant eu une carrière complète et ayant travaillé à temps plein. Les personnes partant à la retraite en septembre 2023 et ayant une petite pension pourront voir celle-ci revalorisée jusqu’à 100 euros au prorata de la période effectivement cotisée.
Les retraités actuels ayant cotisé au moins 120 trimestres pourront bénéficier d’une revalorisation allant également jusqu’à 100 euros au prorata du nombre de trimestres cotisés. 1,8 million de retraités sont potentiellement concernés par cette mesure. Cette revalorisation nécessitant de reprendre des données liées à la carrière des personnes intéressées, sa mise en œuvre exige du temps. La loi a fixé comme date butoir pour son application septembre 2024.
L’aménagement du dispositif de carrières longues
Le dispositif de carrières longues permettant à des personnes qui ont commencé à travailler tôt de pouvoir partir avant l’âge légal avec une retraite à taux plein a été aménagé afin de tenir compte du relèvement de deux ans. Initialement réservé aux personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans, le système a finalement été élargi aux personnes ayant commencé à travailler avant 21 ans. Ceux qui ont commencé à 20 ans pourront partir à 63 ans. Il ne sera plus nécessaire d’avoir cotisé au moins 44 ans, comme prévu dans le projet de loi initial. Le minimum de cotisation requis pour bénéficier du dispositif est désormais prévu à 43 ans. Ces mesures devront cependant être précisées par décret.
L’introduction d’une surcote pour les femmes
La réforme instaure une surcote pour les mères de famille ayant cotisé autant de trimestres que nécessaire pour avoir une retraite à taux plein à 63 ans, mais qui doivent attendre encore un an pour pouvoir partir à la retraite. Cette surcote pourra atteindre 5 % ; elle concernera les assurées des secteurs privés et publics ayant obtenu au moins un trimestre de majoration au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation des enfants. Cette mesure vise à compenser les effets du report de l’âge légal pour les femmes qui sans celui-ci aurait pu partir plus tôt du fait des trimestres acquis au titres de la maternité.
L’amélioration de la prise en compte de la pénibilité
La loi renforce les droits associés au compte « pénibilité », prévu pour les salariés exposés à certaines conditions de travail pénibles, comme le travail de nuit, au chaud, au froid ou dans le bruit. Le compte de pénibilité pourra désormais être utilisé pour financer un congé de reconversion.
La loi prévoit aussi la création de fonds de prévention pour financer des mesures de prévention pour les salariés exposés à des certaines conditions de travail pénibles, mais aussi pour les agents du secteur de la santé. Elle fixe aussi à 60 ans l’âge de la retraite pour les personnes reconnues en incapacité permanente à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
L’assouplissement de la retraite progressive
La loi assouplit les conditions d’accès à la retraite progressive. Celle-ci sera désormais accessible aux agents de la fonction publique. Ce dispositif permet aux assurés à partir de 62 ans de réduire son temps de travail, la perte de rémunération étant compensée par le versement d’une partie de la pension.
Les dispositions annulées par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a annulé plusieurs dispositions qui n’avaient pas d’effets budgétaires pour les régimes sociaux. A été ainsi supprimée l’obligation faite aux entreprises de publier une batterie d’indicateurs sur l’emploi des seniors. Il en a été de même pour le nouveau contrat à durée indéterminé pour les seniors. Le texte prévoyait qu’en l’absence d’accord interprofessionnel, ce nouveau type de contrat de travail puisse être expérimenté à partir du mois de septembre 2023.
L’abandon du transfert du recouvrement des cotisations des retraites complémentaires à l’Urssaf a été annulé par le Conseil constitutionnel. En 2022, , le gouvernement avait confirmé ce transfert. Cette décision, justifiée par des motifs de simplification administrative et d’optimisation du recouvrement, avait rencontré l’opposition des partenaires sociaux qui pilotent le régime des retraites complémentaires qui ont la charge du recouvrement. Le gouvernement avait tenté dans un premier temps de reporter à 2024 ce transfert avant de l’abandonner en faisant adopter un amendement a projet de budget rectificatif de la Sécurité sociale 2023. Le Conseil constitutionnel a considéré comme pour les autres mesures qu’il s’agissait d’un cavalier budgétaire.
Dans le cadre de la prise en compte de la pénibilité pour certains métiers, le gouvernement avait proposé de mettre en place un suivi médical spécifique. Ce suivi devait être proposé aux personnes forcées de porter des charges lourdes, de subir des postures pénibles ou encore des vibrations mécaniques. Le fait d’être exposé à ces facteurs de pénibilité ne permet pas aujourd’hui d’acquérir des points pour le compte de pénibilité. A défaut d’élargir ce dernier à ces facteurs de pénibilité, la loi prévoyait que les travailleurs exposés puissent bénéficier d’une visite médicale entre 60 et 61 ans, avec éventuellement à la clé un départ en retraite anticipé. La mesure sans conséquences sur les comptes n’avait pas sa place dans une loi de financement. En revanche, les deux fonds de prévention de l’usure professionnelle ont été validés par le Conseil constitutionnel.
La réforme des retraites prévoyait d’améliorer le sort réservé à certains contractuels de la fonction publique titularisés. Le Conseil a annulé cette mesure car sans effet immédiat sur les comptes.
Le Conseil constitutionnel a également censuré un article visant à informer les assurés sur les possibilités de cumul emploi-retraite. Cet article prévoyait aussi de créer un rendez-vous de conseil sur leur carrière pour les assurés dont la durée cotisée est inférieure à dix années et dont la carrière a été interrompue pour une certaine période, dont la durée devait être déterminée par décret.
Le Gouvernement devrait sans nul doute réintroduire tout ou partie des dispositions annulées dans un prochain texte, notamment celles qui concernent l’emploi des seniors.
Le Coin des Epargnants du 15 avril 2023 : semaine de fêtes pour le CAC 40
Le CAC 40 continue de faire la course en tête en ayant battu son record à quatre reprises cette semaine. Depuis le 1er janvier, le CAC40 a gagné plus de 16 %. La progression de l’indice parisien est en grande partie liée aux bons résultats du secteur du luxe (LVMH, Kering, Hermès, L’Oréal). Ces quatre valeurs représentent 25 % de l’indice, pondéré par les flottants des groupes. LVMH est la première capitalisation boursière en Europe (444 milliards d’euros). Sa capitalisation est, en revanche, quatre à cinq fois inférieure à celle des géants du digital (Apple, Microsoft, Google, etc.). Le CAC 40 affiche une capitalisation totale de 1 680 milliards d’euros, soit moins que celle d’Apple ou de Microsoft.
La réouverture de la Chine contribue à l’amélioration des résultats des entreprises du luxe. Par ailleurs, cette activité est relativement insensible à l’inflation, ces entreprises étant en capacité de répercuter la hausse des coûts. Hormis le luxe, le secteur de la haute technologie se porte bien en Europe. STMicroelectronics a ainsi gagné plus de 40 %.
L’ascension du CAC 40 s’effectue dans un contexte pourtant compliqué, marqué par de fortes incertitudes en ce qui concerne l’inflation et la possibilité d’une récession à moyen terme. L’inflation sous-jacente continue à augmenter en France comme en Europe. Les tensions géopolitiques demeurent vives. La guerre en Ukraine est appelée malheureusement à durer. Les pays producteurs de pétrole n’ont pas l’intention de réduire le prix du baril et les relations entre la Chine et les États-Unis n’en finissent pas de se tendre avec Taïwan en ligne de fond.
La hausse des marchés actions s’appuie en partie sur des anticipations d’assouplissement de la politique monétaire des grandes banques centrales, notamment aux États-Unis. Le scénario d’une prochaine pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale est de plus en plus admis aux Etats-Unis. Une dernière hausse de 25 points de base des taux directeurs est attendue à l’issue de la réunion des 2 et 3 mai prochains. Si cette fin du cycle de hausses est une bonne nouvelle pour les investisseurs, ces derniers commencent à s’inquiéter du ralentissement de l’économie américaine qui provoquerait une entrée en récession. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à près de 239 000 cette semaine et les ventes au détail ont reculé deux fois plus que prévu en mars (1 %, et de 0,3 % hors automobiles, carburants, matériaux de construction et services de restauration).
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 14 avril 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 519,61 | +1,63 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 886,47 | +0,71 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 137,64 | +0,37 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 117,15 | +0,18 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 807,50 | +0,97 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 871,91 | +1,11 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 390,75 | +1,20 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 28 493,47 | +2,04 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 338,15 | +0,74 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,935 % | +0,235 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,436 % | +0,262 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,520 % | +0,215 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0980 | +0,58 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 2 002,82 | -0,33 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,42 | +0,48 % | 84,08 | 78,140 |
Déclaration des revenus 2022, les nouveautés !
Les contribuables sont appelés à compter du 13 avril 2023 à déclarer leurs revenus de l’année 2022. Les personnes imposables ont, pour adresser aux services fiscaux jusqu’au :
- 25 mai pour ceux domiciliés dans les départements numérotés de 01 à 19 (de l’Ain à la Corrèze) ;
- 1er juin pour ceux domiciliés dans les départements numérotés de 20 à 54 (de la Corse-du-Sud à la Meurthe-et-Moselle),
- 8 juin pour ceux domiciliés dans les départements numérotés 55 (Meuse) et au-delà.
Le barème de l’impôt sur les revenus de 2022 a été actualisé de 5,4 %. Le taux d’imposition est de :
11 % pour les revenus situés entre 10 778 et 27 478 euros ;
30 % pour les revenus situés entre 27 479 et 78 570 euros ;
41 % pour les revenus situés entre 78 571 et 168 994 euros ;
45 % pour les revenus supérieurs à 168 994 euros.
La demi-part fiscale des anciens combattants devient plus accessible
A compter de cette année, les veuves et veufs d’anciens combattants âgés de plus de 74 ans dont le conjoint décédé était titulaire de la carte du combattant au moment de son décès ont droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. L’an dernier, seuls les veuves et veufs dont le conjoint décédé avant 74 ans était titulaire de la retraite du combattant de son vivant avaient pu bénéficier de l’élargissement de l’accès à la demi-part « ancien combattant ».
Des pourboires exonérés d’impôt et de cotisations sociales
Les pourboires perçus en 2022 et en 2023 par les salariés en contact avec la clientèle sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. Cette exonération ne concerne que les salariés percevant, au titre des mois concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 fois le SMIC. Les sommes concernées sont celles remises volontairement soit directement aux salariés ; soit à l’employeur et reversées par ce dernier à son personnel.
Heures supplémentaires : hausse du plafond de défiscalisation
Le plafond annuel des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu est relevé de 5 000 à 7 500 euros pour les revenus de 2022. Jusqu’au 31 décembre 2025, les jours de repos ou de RTT non pris convertis en rémunération seront également exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite commune avec les heures supplémentaires et complémentaires de 7 500 euros.
Les frais de covoiturage peuvent être déduits au titre des frais réels
Les frais de déplacement engagés par un salarié passager recourant au covoiturage pour les trajets qu’il effectue entre son domicile et son lieu de travail constituent des frais professionnels déductibles, sur justificatifs, en cas d’option pour la déduction des frais réels.
Emploi à domicile : la nature des activités doit désormais être mentionnée
A compter de la déclaration d’impôts 2023, les contribuables bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile sont appelés à indiquer dans leur déclaration de revenus la nature des services au titre desquels les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal ont été engagées (garde d’enfants, soutien scolaire, entretien de la maison, petit bricolage, jardinage, etc.).
Hausse du crédit d’impôt pour la garde d’enfants de moins de 6 ans
Le plafond annuel des dépenses prises en compte pour le crédit d’impôt lié à la garde d’enfants de moins de 6 ans hors du domicile (crèche, garderie, assistante maternelle agréée) passe de 2 300 à 3 500 euros par enfant.
Le crédit d’impôt étant égal à 50 % des dépenses engagées au cours de l’année, les familles pourront bénéficier d’une aide fiscale pouvant atteindre 1 750 euros au maximum par enfant, soit 600 euros de plus par an que l’an dernier. En cas de garde alternée, l’avantage fiscal s’élèvera à 875 euros maximum.
Réduction d’impôt pour les organisme d’intérêt général étendue aux organismes en charge de la forêt
La réduction d’impôt au taux de 66 % accordée pour les dons à des organismes d’intérêt général est étendue aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, quand les sommes sont destinées à l’entretien, à la restauration ou à l’acquisition de domaines forestiers bénéficiant de certificats de gestion durable. En revanche, le crédit d’impôt accordé pour un premier abonnement à un titre de presse d’information politique ou générale en version papier ou numérique a pris fin le 31 décembre 2022.
Le taux marginal d’imposition mentionné dans l’avis d’imposition
Le taux marginal oublié depuis l’instauration de la retenue à la source fait son retour. L’avis d’impôt sur les revenus de 2022, remis cet été, mentionnera, en plus du taux moyen d’imposition du foyer fiscal, le taux marginal d’imposition.
Les actions sur la corde raide
Le site Boursier.com a publié une tribune de Philippe Crevel sur le marché « actions ». Il s’interroge sur les fondements de la hausse des derniers mois du CAC40 et sur les perspectives de hausse ou de baisse des cours.
Assurance vie : Fonds euros, le retour ?
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne était l’invité de BFM Business mardi 11 avril, invité de Cédric Decoeur. Il est intervenu sur les dernières annonces des assureurs concernant les fonds euros et sur l’avenir de ces derniers.
Les polyphonies du niveau de vie en France, tribune de Philippe Crevel pour les Echos
L’évolution du niveau de vie est un sujet majeur d’inquiétude des Français sur lequel les pouvoirs publics peinent depuis des années à répondre. Ces derniers sont nombreux à ne plus croire en une amélioration possible, estime Philippe Crevel, ce qui nourrit un puissant mouvement de défiance. (lire la suite)
Le Coin des Epargnants du 8 avril 2023
Marchés en trêve pascale
Les marchés ont connu de faibles évolutions en cette semaine sainte. Le CAC 40 n’a progressé que de 0,03 % sur quatre jours, la bourse de Paris comme les autres places occidentales étant fermées vendredi.
L’or au plus haut
Cette semaine, l’once d’or a franchi la barre symbolique des 2 000 dollars et se trouve à un niveau record. Le métal précieux, valeur refuge par excellence, est en hausse de 10 % sur les trente derniers jours. Les problèmes rencontrés par certaines banques, la persistance des tensions internationales et les politiques d’achats de certaines banques centrales expliquent cette hausse. Ces derniers jours, l’once d’or s’est appréciée en lien avec la baisse du dollar et des taux des obligations.
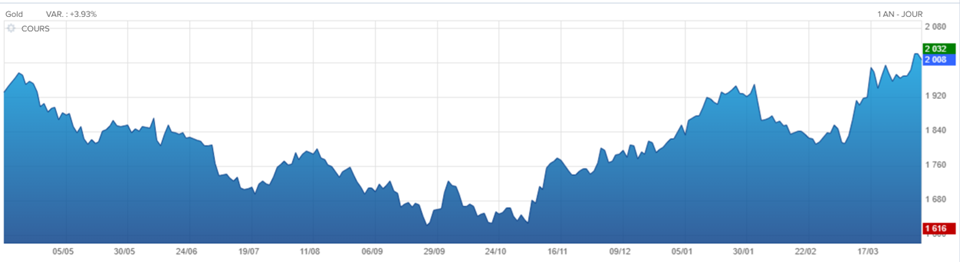
L’emploi américain ne faiblit pas
En mars, les États-Unis ont créé 236 000 postes dans le secteur non agricole, contre +326 000 en février. Ce résultat est conforme à celui attendu par le consensus. Le salaire horaire a augmenté de 0,3 % sur un mois. La hausse sur un an est de 4,2 %, soit un peu moins que celle de 4,3 % qui était anticipée. Le taux de chômage a reculé de 0,1 point, à 3,5 % de la population active.
L’augmentation de 236 000 emplois non agricoles en mars semble traduire un ralentissement de la croissance. Elle confirme que le nombre de créations d’emploi élevé de janvier et février était en partie lié aux conditions météorologiques. En décembre, des entreprises avaient différé la création de nombreux postes en raison de la vague de froid qui s’était abattue sur les États-Unis. La baisse des offres d’emplois et la progression de la demande d’allocations chômage montrent également un ralentissement de la demande de main-d’œuvre. Un ralentissement plus marqué des créations d’emploi est attendu dans les prochains mois. Malgré tout la persistance de l’inflation devrait conduire à une ou plusieurs nouvelles hausses de ses taux directeurs.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 6/7 avril 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 324,75 | +0,03 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 485,29 | +0,63 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 105,02 | -0,10 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 087,96 | -1,10 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 597,89 | -0,20 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 741,56 | +1,44 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 309.45 | -0,13 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 518,31 | -2,03 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 327,65 | +1,22 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,700 % | -0,094 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,174 % | -0,118 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,305 % | -0,214 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1.0919 | +0,44 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 2 007,61 | +1,93 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84.88 | -0,12 % | 84,08 | 78,140 |
Dépôts à vue, baisse confirmée
Après plus de dix ans de hausse, l’encours des dépôts à vue des ménages est en recul depuis le mois de juillet dernier. Cet encours est passé de 543 à 509 milliards d’euros de juillet 2022 à février 2023. Les ménages réaffectent une partie de leurs liquidités sur les produits d’épargne réglementée, sachant que les plus modestes puisent dans leur épargne pour faire face à l’augmentation des prix. En revanche, en moyenne, les Français tendent à réduire leurs dépenses de consommation et à maintenir leur épargne.
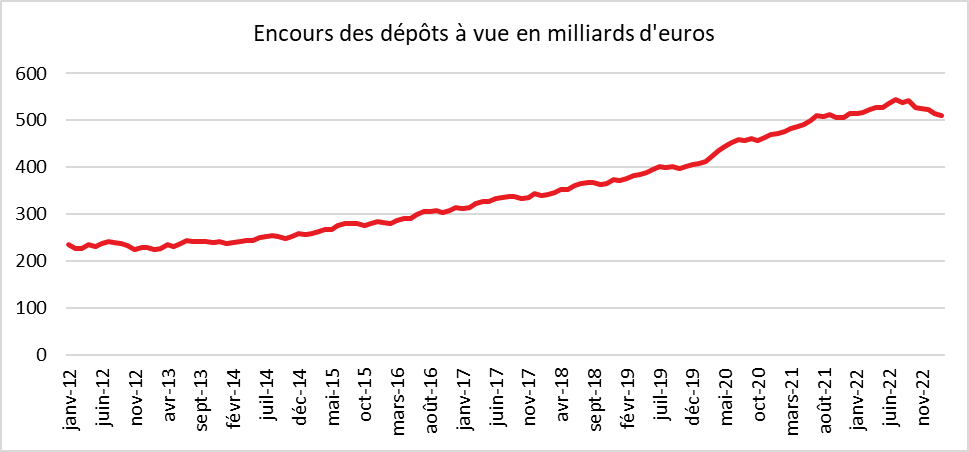
Le Coin des Epargnants : une fin de trimestre sur les chapeaux de roue
Une fin de trimestre sur les chapeaux de roue
Le CAC 40 a progressé de 4,56 % sur les cinq derniers jours du mois de mars, portant la hausse à 13,30 % depuis le 1er janvier. Sur les six derniers mois, elle atteint même 26,59 %. Sur le premier trimestre 2023, le Nasdaq a gagné plus de 16 % et l’indice S&P 500 plus de 7 %/
La crise bancaire des dernières semaines semble être déjà un mauvais souvenir. Les investisseurs semblent croire en la fin de la vague inflationniste et à l’arrêt prochain des hausses des taux directeurs décidées par des banques centrales. La baisse des indices des prix au mois de mars est avant tout due à des effets de base, l’inflation ayant été forte au printemps dernier. Le recul des prix de l’énergie depuis le début de l’année amplifie ce phénomène. L’indice global des prix à la consommation est ainsi passé de février à mars de 8,5 à 6,9 % pour la zone euro, soit légèrement en-dessous du consensus (7,1 %). En revanche et cela devrait porter les acteurs économiques à la prudence, l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire hors énergie, alimentation, alcool et tabac, a toujours pour la zone euro, légèrement augmenté en mars à 5,7 % contre 5,6 % en février. L’inflation globale devrait encore baisser en avril et en mai à mesure que l’inflation énergétique disparaîtra. Une décrue est également attendue au niveau des denrées alimentaires. Aux États-Unis, l’inflation ralentit, mais plus doucement. L’indice « core PCE » des dépenses de consommation personnelle, mesure la plus suivie par la Réserve fédérale, a diminué de 4,7 % à 4,6 % sur un an entre janvier et février et de 0,4 % à 0,3 % en glissement mensuel. L’inflation est attendue aux États-Unis autour de 4 % d’ici la fin de l’année laissant entrevoir la fin du programme de hausses des taux directeurs. Que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, de nouvelles hausses sont néanmoins inévitables.
Cette semaine, le pétrole est au plus haut depuis le début de la crise bancaire aux Etats-Unis. Le cours du baril Brent a progressé de plus de 5 % en une semaine l’amenant aux portes des 80 dollars. La hausse des cours est liée à la crise politique en Irak, qui paralyse les exportations de brut vers la Turquie. Le contentieux qui oppose les autorités irakiennes et le gouvernement régional du Kurdistan irakien a provoqué ce blocage. Une part non négligeable des volumes du Kurdistan bénéficiait à l’Europe et compensait la fin des exportations russes de pétrole.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 31 mars 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 322,39 | +4,56 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 274,15 | +2,98 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 109.31 | +3,15 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 12 221,91 | +3,25 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 628,84 | +4,49 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 631,74 | +3,19 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 315.05 | +4,48 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 28 041,48 | +2,40 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 272,86 | +0,22 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,794 % | +0,146 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,292 % | +0,118 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,519 % | +0,154 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0862 | +1,02 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 977,90 | +0,09 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 78.88 | +5,17 % | 84,08 | 78,140 |
Taux de rémunération des dépôts bancaires en hausse en février
La revalorisation du taux du livret A à 3 % au 1er février provoque selon la Banque de France, une hausse de la rémunération moyenne des dépôts bancaires des ménages, qui atteint 1,60 % en février, contre 1,23 % en janvier. Le taux moyen de rémunération des livrets bancaires passe de 0,45 à 0,50 %. Le taux de rémunération des dépôts des Sociétés non financières s’établit à 0,91 %, après 0,75 % en janvier. La rémunération des dépôts à terme de plus de deux ans se rapproche des 2,3 %.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| févr- 2023 (g) | févr- 2022 | déc- 2022 | janv- 2023 (f) | févr- 2023 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 128 | 0,51 | 0,95 | 1,04 | 1,32 |
| dont Ménages | 1 853 | 0,80 | 1,18 | 1,23 | 1,60 |
| – dépôts à vue | 604 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 25 | 0,37 | 1,67 | 2,04 | 2,25 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 62 | 0,78 | 0,80 | 0,93 | 1,06 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 616 | 1,07 | 2,17 | 2,17 | 3,21 |
| dont : livret A | 357 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| – livrets ordinaires | 268 | 0,09 | 0,33 | 0,45 | 0,50 |
| – plan d’épargne-logement | 278 | 2,59 | 2,57 | 2,59 | 2,58 |
| dont SNF | 881 | 0,09 | 0,60 | 0,75 | 0,91 |
| – dépôts à vue | 612 | 0,04 | 0,21 | 0,24 | 0,34 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 212 | 0,13 | 1,68 | 2,05 | 2,27 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 57 | 0,62 | 1,41 | 1,67 | 1,89 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | |
| Euribor 3 mois (d) | -0,53 | 2,06 | 2,35 | 2,64 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 0,16 | 2,36 | 2,52 | 2,72 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
L’assurance vie challengée en février
La collecte nette sauvée par les unités de compte
En février 2023, l’assurance vie a dégagé une collecte nette de 1,1 milliard d’euros, après 1,2 milliard d’euros en janvier, bien plus faible que celle du Livret A (+6,27 milliards d’euros). Traditionnellement, le mois de février est pourtant un bon cru pour l’assurance vie, avec aucune décollecte lors de ces dix dernières années. La collecte moyenne, lors de ces dix dernières années était de +2,1 milliards d’euros.
L’assurance vie est de plus en plus concurrencée par les livrets d’épargne réglementée ainsi que par les contrats à terme qui proposent, sans risque de capital, des rendements équivalents voire supérieurs (2 % en moyenne pour les fonds euros de l’assurance vie en 2022 contre 3 % depuis le 1er février 2023 pour le Livret A) . Les unités de compte, dans un contexte boursier plutôt favorable même s’il est volatil, demeurent le vecteur de croissance de l’assurance vie. La collecte nette en fonds euros demeure, en effet, négative (-1,7 milliards d’euros) quand elle positive pour les unités de compte (+2,8 milliards d’euros).
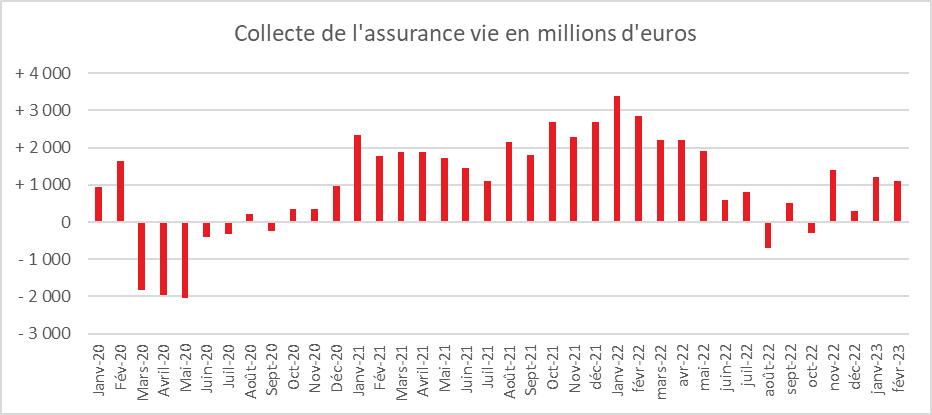
En février, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 13,0 milliards d’euros avec une proportion de 40 % pour les unités de compte. Cette collecte brute est élevée d’autant plus que le Livret A et le LDDS ont bénéficié en février de l’effet « relèvement de leur taux » en cumulant 8,17 milliards d’euros de collecte. Les prestations sont en hausse, de leur côté, à 11,9 milliards d’euros en février. Les prestations sont portées depuis plusieurs années par l’augmentation des décès qui s’accompagne de versements au profit des bénéficiaires désignés ou des héritiers.
Le Plan d’Epargne Retraite assurantiel en mode conquête
Lancé le 1er octobre 2019, le Plan d’Epargne Retraite conquiert, chaque mois, de nouveaux adeptes avec en février 71 600 nouveaux assurés. Les cotisations en février ont atteint 544 millions d’euros, en hausse de +14 % par rapport au même mois de 2022. La collecte nette s’est élevé à +410 millions d’euros, en hausse de +4 % par rapport à février 2022.
Les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté sur le mois 22 900 assurés pour un montant de 563 millions d’euros.
Fin février, 4 millions de personnes avaient souscrit à un PER assurantiel. L’encours de ce produit a atteint de son côté 51,2 milliards d’euros constitué à hauteur de 46 % d’unités de compte.
L’assurance vie de plus en plus challengée
Avec la hausse des taux, de plus en plus d’établissements financiers proposent dans le cadre de leurs « superlivrets » ou de leurs contrats à terme des rendements de plus en plus attractifs concurrençant ceux des fonds euros de l’assurance vie. Cette dernière devrait donc continuer à enregistrer, dans les prochains mois, des petites collectes qui resteront portées par les unités de compte. Les fonds euros ne retrouveront quelques attraits q’avec la décrue attendue de l’inflation et donc des rendements de l’épargne réglementée. L’assurance vie n’en demeure pas moins le premier placement des ménages avec un encours de 1874 milliards d’euros. Elle bénéficie toujours d’un régime incitatif en particulier pour les contrats ouverts depuis plus de huit ans. Ce produit permet en outre de combiner garantie en capital avec les fonds euros et valeurs de marché avec les unités de compte.
Le chômage en baisse en France au mois de février
Au mois de février, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi a continué de baisser. Il est passé de 2,808 millions à 2,780 millions pour les inscrits en catégorie A en France métropolitaine soit une baisse de 1 point. Sur un an, la baisse a été de près de 6 % Pour l’ensemble de la France, le nombre d’inscrits en catégorie A passe pour la première fois depuis août 2011 en-dessous de la barre des 3 millions. Sur un mois la baisse est de 1 % et de 5,7 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits dans toutes les catégories en France métropolitaine comme dans l’ensemble de la France baisse également.
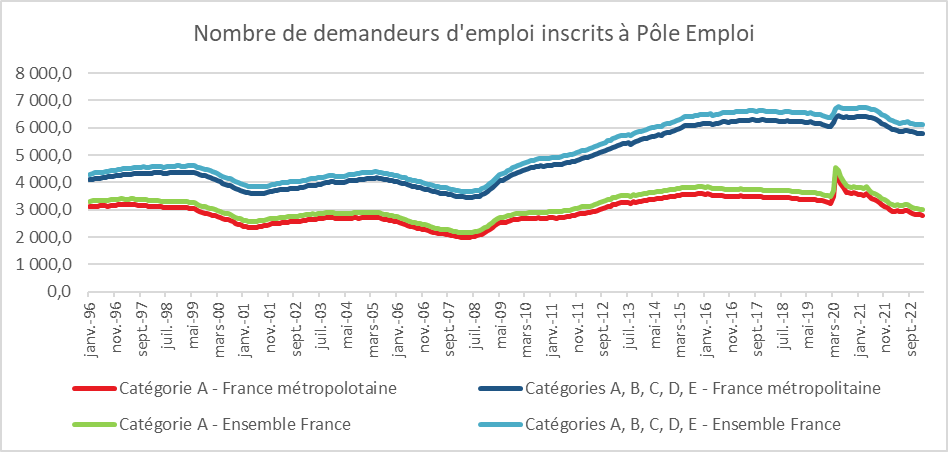
Le Coin des Epargnants du 25 mars 2023 : les banques toujours sous pression
La lutte contre l’inflation continue
Mercredi 22 mars, la banque centrale américaine, la FED, a décidé de relever d’un quart de point ses taux directeurs qui évolueront désormais dans une fourchette entre 4,75 % et 5 %. Cette hausse marque la volonté de la FED de poursuivre le resserrement de sa politique monétaire afin de lutter contre l’inflation. Elle signifie également que le système bancaire américain est solide malgré les faillites de ces dernières semaines. Si elle est mesurée, cette augmentation n’est certainement pas la dernière. La FED a indiqué que d’autres pourraient être nécessaire pour faire revenir l’inflation sous-jacente dans la cible des 2 %. La hausse des prix demeure vive aux États-Unis. Elle a été de 0,4 % sur un mois en février, et de 6 % sur un an.
Selon les prévisions révisées de la FED, une majorité de membres du comité de politique monétaire anticipe toujours un niveau des taux directeurs entre 5 et 5,25 % à la fin de l’année, ce qui correspondrait à une seule hausse de taux supplémentaire mais Jerome Powell, son Président, a prévenu « si nous avons besoin d’augmenter plus les taux, nous le ferons ».
Les banques toujours dans l’œil du cyclone
Après les États-Unis et la Suisse, les inquiétudes sur la santé des banques concernent l’Allemagne avec la Deutsche Bank, la première banque du pays qui depuis des années est confrontée à des problèmes. À Francfort, son titre a perdu jusqu’à 15 % en séance vendredi 23 mars. Le prix des crédits default swaps (CDS) à 5 ans, des produits dérivés qui assurent contre un incident de crédit, est passé au-dessus de 220 points de base, un niveau qui n’avait plus été observé depuis fin 2018. Les propos du chancelier Olaf Scholz, selon qui « il n’y a pas lieu de s’inquiéter », n’ont pas réussi à rassurer les investisseurs. Lors du sommet des Chefs d’État et de gouvernement à Bruxelles, Il a ajouté que la « Deutsche Bank a fondamentalement modernisé et réorganisé son modèle économique, c’est une banque très rentable ». L’ensemble des valeurs bancaires ont baissé vendredi, -5,45 % pour la Commerzbank. -6,13 % pour la Société Générale et 5,27 % pour BNP Paribas. L’annonce par les autorités américaines d’une enquête pour déterminer si les banquiers de Crédit Suisse et d’UBS ont aidé des oligarques russes à contourner les sanctions n’a pas contribué à apaiser la situation de défiance. L’indice KBW des banques américaines est à son plus bas depuis octobre 2020. Les autorités surveillent de part et d’autre de l’Atlantique la situation. Janet Yellen, la Secrétaire d’État au Trésor, a déclaré jeudi soir devant les parlementaires qu’elle se tenait prête à prendre de nouvelles mesures pour garantir les dépôts bancaires contredisant ses propos de la veille selon lesquels elle avait écarté toute extension sur les dépôts au-delà du seuil en vigueur de 250 000 dollars.
Les indices actions s’ils ont accusé le coup vendredi ont néanmoins progressé sur la semaine. Le CAC 40 a ainsi gagné 1,30 % et le Dow Jones plus d’un point. Les taux d’intérêt des obligations d’Etat sont restés stables, la hausse de 25 points de base des taux de la FED n’ayant surpris personne ou presque.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 24 mars 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 015,10 | +1,30 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 237,53 | +1,11 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 970,99 | +1,33 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 823,96 | +1,44 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 14 957,23 | +1,28 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 405,45 | -+0,86 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 130,62 | +1,31 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 385,25 | +0,19 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 265,65 | +1,11 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,648 % | -0,023 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,118 % | +0,019 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,365 % | -0,047 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0756 | -0,22 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 985,35 | -0,08 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 74,78 | +3,05 % | 84,08 | 78,140 |
Livret A : une nouvelle collecte record en février
Le Livret A, seul au monde ou presque
Avec 6,27 milliards d’euros de collecte au mois de février, le Livret A établit un record. Jamais au deuxième mois de l’année, le Livret A avait connu un telle collecte. Le produit d’épargne le plus diffusé confirme et signe ainsi son bel entame d’année 2023. En deux mois, il a colleté 15,54 milliards d’euros. Il faut remonter à 2009 au moment de la banalisation de la distribution du Livret A, pour avoir un tel montant de collecte en janvier et février (20,73 milliards d’euros). L’encours du Livret A bat un nouveau record en février à 391 milliards d’euros, en hausse de 50 % en dix ans.
Toujours l’effet taux
Le résultat de février s’inscrit dans le prolongement logique de celui du mois de janvier (+9,27 milliards d’euros) et trouve son origine dans le relèvement du taux du Livret A intervenu le 1er février dernier. La collecte de février 2023 est plus de cinq fois supérieure à la moyenne des mois de février de ces dix dernières années. Elle est deux fois plus importante que celle du mois de février 2022 qui avait été dopée par le premier relèvement intervenu depuis plus de dix ans, le taux étant alors passé de 0,5 à 1 %.
Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois (mois de l’annonce et les deux qui suivent). La forte collecte de 2023 est liée à l’ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an. Le taux du livret A a été multiplié par six en douze mois. Ce rendement place le produit d’épargne le plus diffusé en France, parmi ceux qui sont les mieux rémunérés. Seul le Livret d’Epargne Populaire avec un taux de 6,1 % se classe au-dessus mais n’est pas accessible à tous les épargnants (18,6 millions de personnes éligibles – 7 millions qui en disposent d’un). Le Livret A tire sa force du triptyque, sécurité, liquidité et zéro prélèvement. Quand à ces trois facteurs, se rajoute une rentabilité relative attractive, il n’est pas surprenant que la collecte s’envole.
Une concurrence limitée
Plusieurs établissements financiers tentent de concurrencer le Livret A en proposant des taux promotionnels dans le cadre de superlivrets mais ces taux ne sont applicables que sur de courtes périodes. Ramenés sur l’année, ces taux sont moins compétitifs que le Livret A surtout en tenant compte de la fiscalité. Seuls les comptes à terme peuvent à la limite concurrencer le Livret A. Ils ne sont pas plafonnés mais l’argent est bloqué, en règle générale, de 12 à 24 moins et le versement doit intervenir souvent en une seule fois avec un montant qui peut se révéler élevé (10 000 à 20 000 euros).
Le paradoxe de l’épargne en période d’inflation
Le passage à 3 % du taux du Livret sur fond d’inflation incite les ménages à réduire leurs liquidités sur leurs comptes courants. Le Livret A apparait pour une large majorité des Français comme le meilleur placement pour se protéger de la hausse des prix même s’il en couvre que la moitié.
Face à la hausse des prix, les Français, en moyenne, ne puissent pas dans leur épargne de précaution. Au contraire, ils la renforcent en préférant diminuer leurs dépenses de consommation. Ils veulent renforcer leur épargne afin de pouvoir faire face à des dépenses qui pourraient coûter, à terme, plus chères. Implicitement, ils veulent également conserver en valeur réelle le montant de leur patrimoine financier ce qui les conduit à épargner d’avantage. Par ailleurs, leurs capacités d’épargne n’ont pas été atteintes car les pertes de pouvoir d’achat sont pour le moment limitées. Même si le ressenti est tout autre, selon la Banque de France et l’INSEE, ces pertes ont été évaluées en 2022 entre 0,1 et 0,2 %.
Reclassement des liquidités
Avec la résurgence de l’inflation, les ménages n’entendent plus laisser dormis leurs liquidités sur leurs comptes courants. Ils arbitrent les sommes accumulées sur ces derniers au profit de l’épargne réglementée. Depuis des années, l’encours des dépôts à vue augmentait au point de dépasser en 2022, 540 milliards d’euros. Depuis le mois de septembre dernier, pour la première fois depuis plus de 7 ans, une baisse est constatée. De fin 2019 à septembre 2022, l’encours des dépôts à vue avait augmenté de 140 milliards d’euros. Il est revenu à 514 milliards d’euros à fin janvier 2023.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire sur les pas de son grand frère
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a enregistré une collecte en février de 1,9 milliard d’euros. En deux mois, celle-ci a atteint 3,85 milliards d’euros portant l’encours à un niveau record de 138,1 milliards d’euros, en hausse de 40 % en dix ans.
Le LDDS est, en règle générale, associée aux comptes courants des ménages du fait, dès sa création en 1983, de la banalisation de sa distribution quand celle-ci n’est intervenue, pour le Livret A, qu’en 2009. Les ménages affectent plus rapidement leurs liquidités entre le LDDS et leurs comptes courants qu’avec le Livret A qui peut être ouvert dans un autre établissement.
Le LDDS ainsi que le Livret A ont pu bénéficier des versements des Primes de Pouvoir d’Achat de 2022 versées en décembre ou en janvier.
Vers une collecte record
Traditionnellement, le premier semestre est porteur pour le Livret A. Cette année, il est partie pour battre des records. Le mois de mars devrait encore être marqué par une collecte élevée toujours sous l’emprise de l’effet taux. Un tassement devrait se produire dans la seconde partie de l’année sauf si une nouvelle revalorisation du taux du Livret A était décidée. Compte tenu de la formule de calcul qui associé inflation et taux des marchés monétaires, le taux du Livret A pourrait atteindre plus de 3,5 %. Il est probable que les pouvoirs publics n’appliquent pas la formule sur la recommandation de la Banque de France comme lors du relèvement du 1er février dernier. En espérant une décrue rapide des prix au cours des prochains mois, les pouvoirs publics pourraient opter pour le statuquo ou pour 3,25 %.
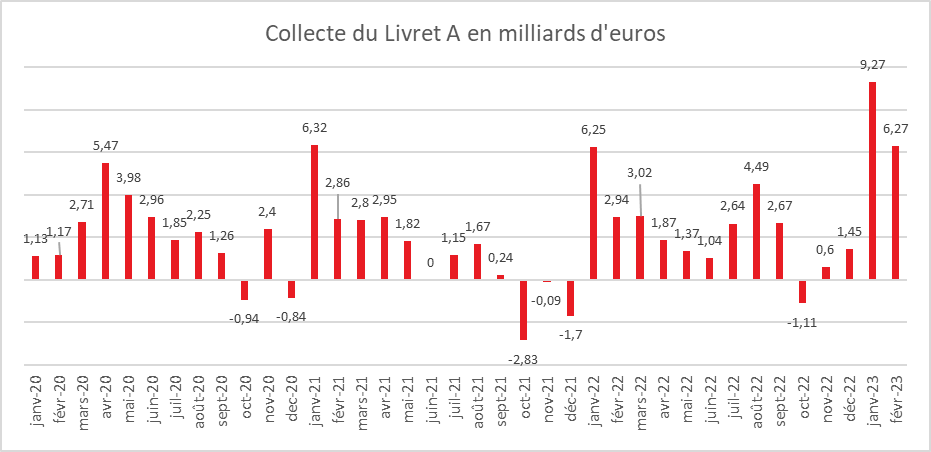
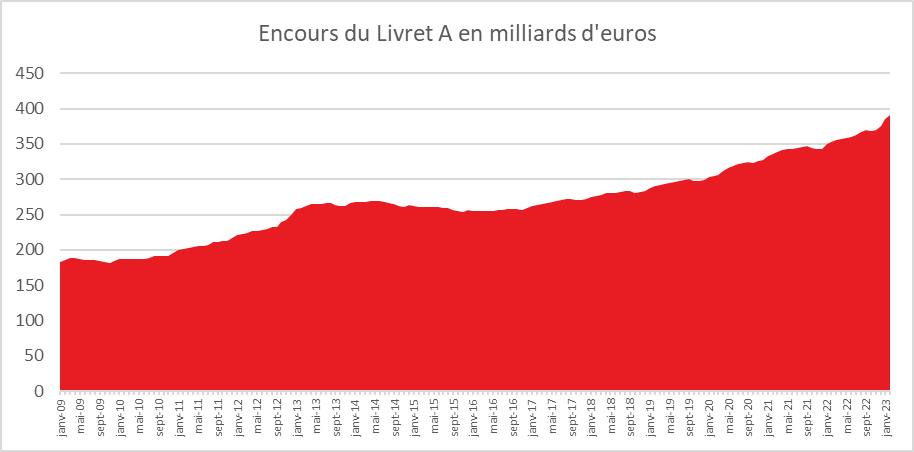
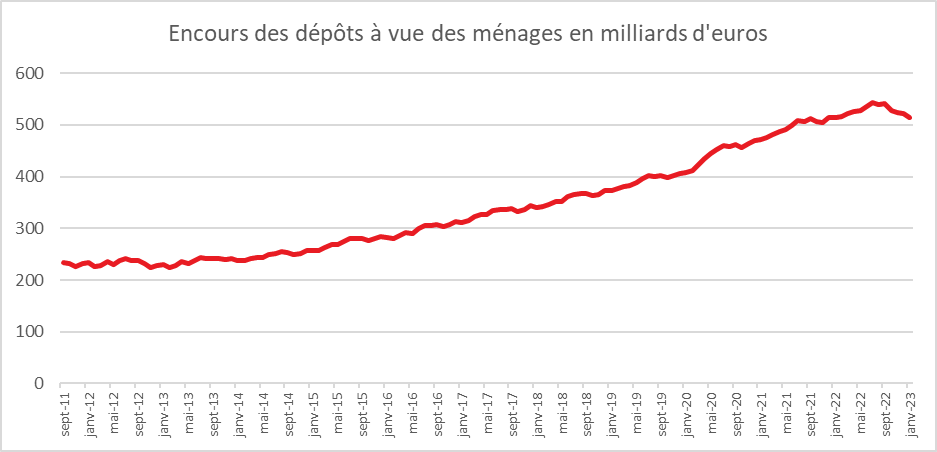
Le Coin des Epargnants du samedi 18 mars 2023
La semaine noire des banques
Les indices « actions » ont connu une semaine compliquée avec la succession de mauvaises nouvelles en provenance de quelques banques américaines et du Crédit Suisse. Le CAC 40 a reculé de plus de 4 % tout comme le Dax allemand ou le Footsie britannique. L’ensemble des valeurs bancaires ont reculé fortement au cours de la semaine comme BNP PARIBAS, la première banque de la zone euro qui a perdu 14 % et la Société générale qui a perdu 17 % sur la semaine. Par ailleurs, dans ce contexte chahuté, les craintes de récession se sont accentuées. L’indice européen des établissements bancaires a reculé de 11,5% sur la semaine.
Les faillites de banques régionales aux Etats-Unis (Silvergate Bank le 8 mars, Silicon Valley Bank le 10, Signature Bank le 12) et les difficultés du Crédit Suisse ont entamé la confiance des déposants et des investisseurs des grandes places financières. Les autorités américaines et suisses ont pris rapidement des mesures pour garantir les dépôts et éviter un effet domino. Aux Etats-Unis, les investisseurs restaient nerveux malgré les annonces de la FED, du Président Joe Biden, et la décision de onze des plus grandes banques des États-Unis, dont JPMorgan, Citigroup, Bank of America et Wells Fargo, de déposer ensemble 30 milliards de dollars non garantis auprès de la First Republic Bank.
Les tensions concernant le secteur bancaire américain et européen ont replacé au cœur de l’actualité la question la stabilité financière et l’éventuelle survenue d’une récession. Traditionnellement, les crises bancaires se traduisent par des reculs de PIB car elles donnent lieu à des resserrements des prêts et à une aversion aux risques plus élevée. Aux Etats-Unis, les petites entreprises se financent souvent auprès de banques locales et sont potentiellement les plus exposées aux problèmes que ces dernières rencontrent. Par prudence liée à la crainte de retrait massif de la part de leurs clients, les banques limiteront le volume de leurs prêts pour préserver leurs liquidités.
Les taux des obligations d’Etat ont fortement reculé durant la semaine. Les obligations d’Etat tout comme l’or ont joué leur rôle de valeur refuge. Les investisseurs anticipent également une modération du programme de relèvement des taux directeurs. Le prix du pétrole a, de son côté, fortement reculé de plus de 10 % en raison d’une moindre croissance de l’économie mondiale.
BCE, « même pas peur ! »
Les soubresauts bancaires n’ont pas amené la Banque Centrale Européenne à différer la hausse de ses taux directeurs. Il ne pouvait en être autrement. L’inflation sous-jacente demeure élevée en Europe et tout arrêt du programme de relèvement aurait été interprété comme une reconnaissance de fait d’un danger imminent pour les banques européennes. Or, en l’état, les banques de la zone euro apparaissent saines et capables d’affronter des chocs extérieurs. L’inflation dans la zone euro a reculé en février pour le quatrième mois consécutif à 8,5 % en glissement annuel, mais l’inflation « sous-jacente » (hors prix volatils comme ceux de l’énergie et de l’alimentation) a atteint 5,6%. Dans ce contexte, jeudi 16 mars, la BCE a donc relevé de 0,5 point ses taux directeurs qui évoluent désormais entre 3 % et 3,75 %, niveau le plus haut constaté depuis octobre 2008. Christine Lagarde a rappelé son engagement de faire revenir le taux d’inflation à 2 % sans préciser le calendrier des éventuelles futures hausses des taux directeurs. La BCE a par ailleurs présenté ses nouvelles prévisions économiques. Pour 2023, grâce au repli des prix de l’énergie, l’inflation pourrait être moins élevée que prévu et s’élever à 5,3 %. Elle reviendrait à 2,9 % en 2024. La croissance serait de 1 % pour la zone euro en 2023 et de 1,6 % en 2024.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 17 mars 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 925,40 | -4,09 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 861,98 | -0,30 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 916,64 | +1,43 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 630,51 | +4,54 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 14 768,20 | -4,30 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 335,40 | -5,36 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 063,31 | -4,00 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 333,79 | -2,88 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 250,55 | +0,63 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,671 % | -0,308 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,099 % | -0,371 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,412 % | -0,306 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0673 | +0,26 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 973,57 | +5,21 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 73,09 | -11,95 % | 84,08 | 78,140 |
La réforme des retraites version 2023 : les grandes lignes
Présenté, le mardi 10 janvier 2023, le projet de réforme des retraites qui a été inséré dans un projet de liu de finances rectificative pour 2023 a été adopté le après le recours à l’article 49-3 de la Constitution par Madame la Première Ministre le jeudi 16 mars. A défaut de l’adoption d’une motion censure, le ^projet de loi sera considéré comme définitivement adopté. Le Conseil constitutionnel sera sans nul doute amené à examiner ce texte dont certains articles pourraient susciter quelques interrogations notamment celui concernant l’index qui n’a pas de conséquences budgétaires.
Réduire les déficits
Le Gouvernement en s’appuyant sur les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites a justifié la nécessité de réformer le système de retraite afin d’éviter une explosion du déficit qui aurait pu atteindre 12 milliards d’euros en 2027, 14 milliards d’euros en 2030 et 21 milliards d’euros en 2035. Cette dégradation des comptes des régimes de retraite est la conséquence de celle du rapport actifs/inactifs. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité, en 1970, 3 cotisants pour 1 retraité, en 2000, 2 cotisants pour 1 retraité, en 2023, 1,7 et 1,4 en 2050. La France comptait 5 millions de retraités en 1981. En 2023, ils sont 17 millions. Ils seront 20 millions d’ici 2040.
Les deux mesures clefs de la réforme des retraites : report de l’âge légal de 62 à 64 ans et accélération du passage à 43 ans de la durée d’assurance requise pour obtenir la retraite à taux plein
L’âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, à raison de 3 mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat en 2027, puis atteindra 64 ans en 2030.
La réforme de 2014 dite Touraine prévoyant le passage la durée de cotisation à 43 ans sera accélérée. Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans.
En revanche, le Gouvernement ne modifie par l’âge de la retraite à taux plein à 67 ans, âge à partir duquel il est possible de partir sans décote.
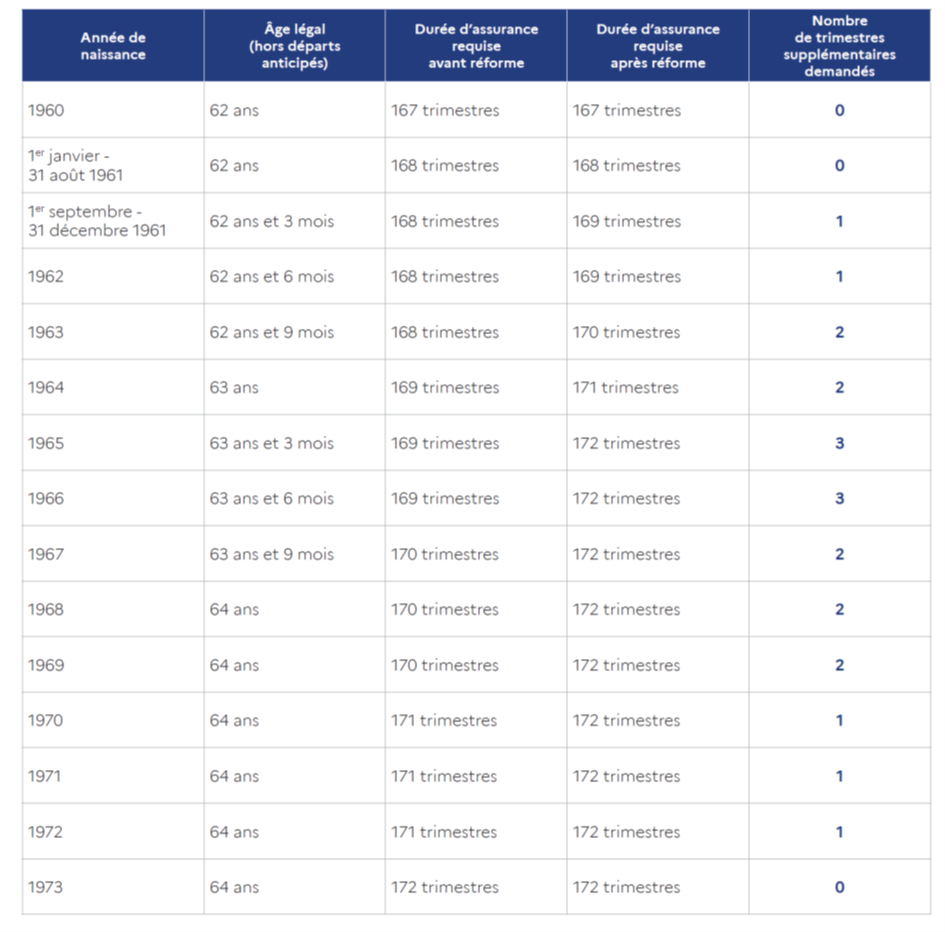
Le dispositif « carrières longues » adapté au report de l’âge légal modifié lors de l’examen par le Parlement
Actuellement, un début de carrière avant 20 ans peut permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans peut donner droit à une retraite anticipée de quatre ans.
Le dispositif actuel va être « adapté » : ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir un an plus tôt, à 63 ans ; ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, soit 62 ans ; ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite quatre ans plus tôt, soit 60 ans ; ceux qui ont démarré avant 16 ans pourront terminer leur carrière six ans plus tôt, soit 58 ans. Le texte prévoit que sous certaines conditions, les bénéficiaires du dispositif « carrières longues » pourront partir non pas avec 44 années validées avec 43 années.
Deux tiers des assurés devraient ainsi pouvoir partir avec 43 années mais tout dépendra du nombre de trimestres cotisés avant 21 ans, de l’année de naissance et des bornes d’âge légal.
Les périodes de congé parental seront prises en compte tant pour le dispositif « carrières longues » que dans le calcul du minimum de pension de ceux qui ont travaillé plus de 30 ans.
Au total, les assouplissements du régime carrières longues coûteront 700 millions d’euros dont 300 millions pour le dispositif en faveur des moins de 21 ans.
Surcote pour les mères
Le Parlement a décidé la création d’une majoration de pension pour certaines mères de famille. Cette surcote, pouvant augmenter jusqu’à 5 % la pension des intéressées sera réservée aux femmes qui, à 63 ans, ont atteint la durée de cotisation nécessaire pour partir à taux plein et ont acquis au moins un trimestre au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation d’enfants. Les bénéficiaires de la surcote devront toujours travailler jusqu’à 64 ans.
Cette mesure s’applique tant aux fonctionnaires qu’aux salariées du secteur privé. Elle vise à atténuer la perte de l’avantage du bénéfice des trimestres acquis au titre de la maternité avec le report de l’âge légal. Le coût de cette mesure est estimé à près de 250 millions d’euros à horizon 2030.
Majoration pour famille nombreuse
Une majoration de pension pour les familles nombreuses des professions libérales a été également ajoutée. Cette disposition permettra aux professionnels libéraux et aux avocats ayant trois enfants et plus de bénéficier de la bonification de pension de 10 % déjà prévue pour les bénéficiaires du régime général.
Les départs anticipés pour invalidité maintenus
Comme aujourd’hui, les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés. Pour les travailleurs handicapés, cette possibilité reste ouverte à compter de 55 ans.
Les victimes d’incapacité permanente pourront, en revanche, partir à la retraite dès 60 ans et non 62 comme prévu par le gouvernement.
La création d’un index senior
Supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture, puis restaurée par le Sénat, la Commission mixte paritaire a proposé une version modifiée de la proposition d’inxe senior.
L’instauration d’un index senior vise à inciter les entreprises à maintenir dans leurs effectifs les salariés de plus de 55 ans. Sur le modèle de l’index égalité homme-femme, les entreprises concernées devront publier une fois par an, sous peine d’amende allant jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires, une liste d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors et aux actions favorisant leur maintien dans les effectifs. Cet index concernera les entreprises de plus de 300 salariés. Un décret définira ces indicateurs, leur méthode de calcul et les modalités de publication, le tout pouvant être amendé par accord de branche. Si l’index d’une entreprise ne s’améliore pas après trois exercices de suite, elle devra définir un plan d’action après négociation avec les représentants du personnel. En revanche, aucun mécanisme de sanction n’est prévu.
Le CDI senior adopté
Le Parlement a adopté un article prévoyant sous certaines conditions la mise en œuvre d’un contrat à durée indéterminée « senior » pour l’embauche des salariés de plus de 60 ans.R. Seuls les demandeurs d’emploi de plus d’un an seront éligibles. La mise en place du dispositif est conditionnée à un accord national interprofessionnel qui définira le contours de ce nouveau CDI. À défaut d’accord avant le 31 août 2023, le dispositif s’appliquera de manière expérimentale du 1er septembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2026. Une convention ou un accord de branche arrêtera les modalités permettant de mettre un terme au CDI quand le salarié aura rempli les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein (donc sans que l’employeur ne soit tenu par la limite des 70 ans actuellement en vigueur) et pour l’inciter à le conserver jusque-là. Le CDI senior sera, dans ce cadre exonéré de cotisations familiales la première année. Les bénéficiaires d’un cumul emploi/retraite ne pourra pas bénéficier de ce CDI. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Le Compte professionnel de prévention modifié
1,9 million de comptes professionnels de prévention (C2P) ont été ouverts depuis la création du dispositif. Ce compte permet d’accumuler des droits pour chaque année d’exposition, qui servent ensuite à financer des formations, un passage à temps partiel payé temps plein ou à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Le Gouvernement a renoncé à réintégrer le facteur des « port de charges lourdes » supprimé en 2018. En revanche, les seuils des principaux facteurs d’exposition aux risques professionnels seront abaissés pour permettre à davantage de salariés de bénéficier du dispositif. Le seuil de travail de nuit passera de 120 à 100 nuits par an et celui du travail en équipes successives alternantes passera de 50 à 30 nuits par an. Cela permettra, chaque année, à plus de 60 000 personnes supplémentaires de bénéficier d’un compte. Les points seront acquis plus rapidement pour les salariés exposés à plusieurs risques et sans limite de nombre de points, contrairement à aujourd’hui.
Une nouvelle utilisation du compte professionnel de prévention sera créée avec la possibilité de financer un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.
Un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exerçant des métiers identifiés comme exposés à la pénibilité, afin de mener des actions de prévention et mieux détecter les situations d’inaptitude permettant un départ anticipé à 62 ans.
Un fonds d’investissement d’un milliard d’euros
Le Gouvernement a décidé la création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle doté d’un milliard d’euros sur le quinquennat. Il soutiendra les branches professionnelles pour identifier les métiers exposés aux risques ergonomiques (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations), et financer, avec les employeurs, des actions de prévention et de reconversion.
Les dispositions relatives à la fonction publique
Dans la fonction publique, l’âge d’ouverture des droits sera relevé progressivement de deux ans comme dans le privé. Ce relèvement concernera les différentes catégories de fonctionnaires. Les modalités de calcul des pensions ne sont pas modifiées.
La retraite progressive en vigueur dans le privé sera étendue à la fonction publique.
Les fonctionnaires en catégories actives et les militaires conserveront un droit à partir plus tôt compte tenu de leurs sujétions particulières de service public et de leur expositionaux risques. La durée de service et l’âge d’annulation de la décote seront inchangés.
La clause du grand père pour les régimes spéciaux
Le gouvernement a maintenu, contre l’avis des sénateurs, la clause du grand-père pour les régimes spéciaux. Tous les salariés actuels resteront régis par leur régime actuel jusqu’à leur retraite. Sont concernés les régimes de la RATP, de la branche des industries électriques et gazières (IEG), des clercs et employés de notaires, des personnels de la banque de France ainsi que des membres du Conseil économique social et environnemental (CESE). Les nouveaux embauchés recrutés à compter du 1er septembre 2023 dans les secteurs ci-dessus seront affiliés au régime général pour la retraite. Cette méthode avait été retenue lors de la fermeture du régime spécial de la SNCF dans la réforme de 2018.
Les régimes autonomes (professions libérales et avocats) et ceux répondant à des sujétions spécifiques (marins, Opéra de Paris, Comédie Française) ne seront pas concernés par cette fermeture.
Les bénéficiaires des régimes spéciaux seront soumis au report de l’âge de départ à la retraite deux ans et à l’accélération de la réforme Touraine mais des mesures d’adaptation sont prévues. La prise en compte des précédentes réformes, qui prévoient une augmentation de l’âge jusqu’en 2024, conduit à une entrée en vigueur, pour ces actifs, des nouvelles règles relatives à l’âge de départ en 2025.
Une réforme de l’assiette sociale des indépendants
Le Gouvernement a prévu de réformer l’assiette sociale des indépendants d’ici le PLFSS 2024 en concertation avec les professions concernées, afin que son calcul soit simplifié et que les droits à la retraite des indépendants soient renforcés.
Le relèvement du minimum contributif et indexation en fonction du SMIC
Reprenant un des objectifs de la loi Fillon de 2003, le gouvernement prévoit que pour une carrière complète cotisée au SMIC, la pension ne pourra être inférieure à 85 % du SMIC net, soit environ 1 200 euros brut par mois. L’objectif est de revaloriser les petites pensions et de créer un écart avec le minimum vieillisse qui est de 963 euros depuis le 1er janvier 2023.
Le minimum de pension augmentera de 100 euros par mois pour une carrière complète dès 2023 pour tous, actuels et nouveaux retraités.
Des trimestres supplémentaires pour certaines catégories d’assurés
Les aidants familiaux, qui sont contraints de réduire leur activité pour s’occuper d’un proche parent ou d’un enfant, bénéficieront de validations de trimestres. La réforme donnera également des trimestres de retraite aux personnes ayant effectué des stages de travaux d’utilité collective.
Des mesures d’ajustement budgétaire
En raison des mesures adoptées en faveur des carrières longues, des retraitées femmes, des personnes en incapacité, etc., le Parlement a prévu de nouvelles recettes pour les régimes de retraite. Il a ainsi retenu le principe d’un relèvement de la contribution sur les indemnités de ruptures conventionnelles (300 millions d’euros à horizon 2030). Le gouvernement prévoirait également d’augmenter les cotisations vieillesse des entreprises d’un côté et de baisser le niveau de cotisations alimentant la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale (AT-MP) de l’autre.
Les parlementaires se sont aussi entendus pour adopter des mesures de lutte contre la fraude. Pour bénéficier du minimum vieillesse, il faudra avoir résidé au moins 9 mois en France (et non plus 6). Par ailleurs, le versement des retraites à l’étranger sera contrôlé grâce à l’usage de la biométrie. Ces dispositions sont censées rapporter 200 millions d’euros de recettes.
Faillites bancaires aux Etats-Unis, quelles conséquences ?
La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et les difficultés de plusieurs autres banques américaines rappellent de mauvais souvenirs datant de la crise des subprimes de 2007/2009. Après l’épidémie de covid, après la guerre en Ukraine, l’économie mondiale peut-elle être confrontée à une nouvelle crise financière ?
La Silicon Valley Bank, la 16e banque américaine, victime de la hausse des taux d’intérêt et des problèmes du secteur de la haute technologie
La Silicon Valley Bank, la 16e banque américaine a été confrontée à des demandes de retraits de liquidités importantes de la part de ses clients, essentiellement des entreprises du secteur de la haute technologie. Cette banque, spécialisée dans le financement des start-ups, géraient les liquidités de ces entreprises qui jusqu’en 2022 levaient des sommes importantes grâce à des fonds de capital-risque ou de capital-investissement. En parallèle, elle prêtait également de l’argent à ces fonds ou aux dirigeants des start-ups. Selon Reuters, elle était le partenaire bancaire de près de la moitié des start-ups américaines financées par capital-risque cotées en Bourse en 2022.
La forte croissance des valeurs technologiques et l’engouement des fonds de capital-risque pour ce secteur ont contribué à l’augmentation des dépôts à SVB qui sont passés de 102 à 189 milliards de dollars en 2021. La banque a investi cet excès de liquidités dans des placements de long termes jugés sûrs, des obligations et des bons du Trésor qui étaient alors faiblement rémunérés.
En 2022, le marché des valeurs de la haute technologie s’est retourné après la forte croissance provoquée par la crise sanitaire. Le resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed) se traduisant par une hausse des taux d’intérêt a conduit les investisseurs à se détourner des valeurs technologiques au profit des obligations. Les taux directeurs sont passés en un an de 0 à 4,75 %. Les start-ups qui, en outre, subissent le ralentissement de leur activité ont besoin de liquidités pour faire face à leurs charges. Ne pouvant plus compter sur l’argent issue des levées de fonds, elles ont puisé dans leurs dépôts placés à la SVB. Celle-ci, ne disposant pas de liquidités suffisantes, a été contrainte de vendre en urgence les titres monétaires et obligataires qu’elle possédait. Or, la hausse des taux a eu pour conséquence de diminuer la valeur de ces derniers. En effet, sur le marché secondaire, les obligations s’échangent au même taux en prenant en compte la duration et le risque liés à l’émetteur. De ce fait, une obligation émise à un taux de 1 % aura une valeur bien plus faible qu’une obligation émise à 4 %. En vendant ses obligations, la SVB a ainsi accusé une perte de 1,8 milliard de dollars et indiqué avoir besoin d’une recapitalisation.
Face à cette annonce de la banque, les clients inquiets ont perdu confiance et ont commencé à vouloir retirer les sommes qu’ils y avaient placées provoquant un « bank run ». Sur la seule journée du jeudi 9 mars, environ 42 milliards de dollars d’ordres de retraits ont été passés. En quelques heures, SVB était dans l’incapacité à faire face aux demandes nécessitant l’intervention des autorités fédérales.
La réaction des pouvoirs publics a été rapide
Vendredi 10 mars, les autorités américaines ont fermé SVB pour protéger les dépôts et limiter le risque de contagion. Son administration a été confiée à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l’agence qui gère l’assurance des dépôts bancaires. Cette procédure garantit jusqu’à 250 000 dollars par déposant. 90 % des sommes de la SVB ne seraient néanmoins pas assurés. Dimanche 12 mars, face au risque de panique, les autorités ont donc décidé d’étendre la garantie et de permettre aux clients de récupérer l’intégralité de leur dû. Pour limiter l’effet de contagion, après la faillite de la « Signature Bank » la Fed s’est engagée à prêter des fonds aux autres banques qui feraient face à d’importantes demandes de retrait. Le Président américain a déclaré que l’État fédéral prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter une crise financière.
Quels sont les risques de contagion aux Etats-Unis ?
La faillite d’une banque n’est jamais anodine car elle touche le cœur de l’économie à travers des mécanismes de financement qui reposent en grande partie sur la confiance. Néanmoins, la faillite de SVB ne devrait pas provoquer un effet domino. Le risque de contagion est relativement faible. Depuis la crise financière de 2008, les pouvoirs publics suivent avec attention les problèmes de liquidité et de solvabilité des acteurs financiers. Des crash test sont réalisés régulièrement. Le portefeuille obligataire des grandes banques américaines est réévalué à la valeur de marché, lors des publications trimestrielles de résultats.
Les banques, dont les résultats ces dernières années étaient bons, disposent d’importantes réserves de liquidités, limitant d’autant leur besoin de vendre des obligations. Le cas de SVB est particulier avec la conjonction de trois problèmes : la hausse des taux, les besoins de cash des start-ups et un bilan dégradé du fait d’une gestion hasardeuse.
L’économie américaine comprend un grand nombre de banques de taille régionale qui sont moins régulées qu’en Europe. D’autres faillites sont donc possibles. Les grandes banques américaines pourraient profiter d’un éventuel transfert de dépôts de la part de clients qui avaient placé des liquidités dans des institutions locales. Aucune banque de taille systémique n’est aujourd’hui concernée par la crise.
Une contagion en Europe est-elle possible ?
Les banques européennes ont des bilans solides. Elles n’ont pas accru, ces dernières années, leur exposition aux obligations. Leur financement provient essentiellement des commissions et des dépôts de leurs clients. Les banques européennes sont peu investies dans le secteur de la haute technologie. Dans le passé, cette prudence leur était même reprochée. Les banques européennes sont plus diversifiées et bien régulées.
Quelles conséquences pour le marché des actions ?
La crise bancaire aux États-Unis pourrait être positive pour les marchés d’actions. Les banques centrales pourraient, en effet, être amenées à tempérer le durcissement de la politique monétaire mise en œuvre pour lutter contre l’inflation. De moindres hausses de taux directeurs favorisent les actions. Par ailleurs, les investisseurs pourraient être incités à privilégier les grandes entreprises cotées aux résultats publiés régulièrement au détriment des start-ups.
Le Coin des Epargnants du 11 mars 2023
Marchés, des hauts et des bas
Le lundi 6 mars dernier, l’indice CAC 40 a établi un nouveau plus haut historique en séance à 7 401,15 points, dépassant ainsi son précédent record de 7 387,29 points du 16 février 2023. Il n’a pas en revanche battu son record de clôture. La bonne tenue de l’indice 40 est liée notamment aux bons résultats des entreprises françaises. Celles du CAC 40 ont dégagé 142 milliards d’euros de bénéfices cumulés en 2022. Ce montant est néanmoins en baisse par rapport à 2021, année de reprise. La guerre en Ukraine et l’inflation ont réduit les bénéfices mais de manière limitée. Le chiffre d’affaires des entreprises du CAC 40 a augmenté de 19 %, en 2022, pour atteindre 1 729 milliards d’euros. Cette augmentation est imputable en partie à l’inflation. Les entreprises du secteur luxe (LVMH, Kering, Hermès et L’Oréal) ont enregistré une hausse de 23% de leurs bénéfices. Ces derniers sont en progression de 80 % par rapport à 2019. Les dividendes versés aux actionnaires ont également augmenté en 2022, atteignant un record de 56,5 milliards d’euros en France et 1 560 milliards de dollars dans le monde. Les entreprises ont également choisi de racheter leurs propres actions pour soutenir leur cours en bourse. Si ces résultats portent le cours des actions, l’évolution de ces derniers dépendent des anticipations d’inflation et des effets de la hausse des taux.
La semaine boursière s’est conclue sur la publication des résultats du mois de février de l’emploi aux Etats-Unis et sur les déboires de deux banques investis dans le secteur de la haute technologie. Les marchés « actions » ont baissé assez nettement jeudi et vendredi entraînant l’ensemble de la semaine dans le rouge. Le CAC40 a perdu 1,73 % en cinq jours. De leur côté, le S&P 500 et le Dow Jones américains ont reculé, de près de 4,5 %
Les créations d’emploi toujours dynamiques aux Etats-Unis
Les créations d’emploi aux Etats-Unis ont atteint 311 000 emplois en février, chiffre encore une fois supérieur au consensus et qui fait suite aux 504 000 créations de postes en janvier. En revanche, le taux de chômage est passé de 3,2 à 3,6 % de janvier à février. Cette hausse est supérieure aux prévisions. Le nombre hebdomadaire d’heures travaillées a diminué. Le salaire horaire moyen n’a augmenté que de 0,2 % après avoir +0,3 % en janvier, portant sa progression sur un an à 4,6 %, contre 4,7 % en janvier. Compte tenu des résultats du marché de l’emploi, difficile de faire un pronostic sur le montant du relèvement des taux directeurs de la part de la FED lors de sa réunion du 22 mars prochain. Il devrait être de 25 ou 50 points de base. Les difficultés rencontres par deux banques américaines ont amené une détente sur les taux obligataires. Les investisseurs estiment que les banques centrales seront contraintes de modérer leurs ardeurs en matière de hausse des taux afin de ne pas fragiliser la sphère financière.
Retour du risque bancaire
Jeudi 9 mars, les quatre plus grandes banques américaines ont perdu 52 milliards de dollars en Bourse. JPMorgan Chase a perdu 5,4 %, Bank of America 6,20 %, Citigroup 4,10 % et Wells Fargo 6,18 %. Ces reculs sont la conséquence de la faillite de la banque Silvergate, spécialisée dans les cryptoactifs et celle de Silicon Valley Bank (SVB) qui finançait des entreprises de la haute technologie. Le cours de Silicon Valley a dû être suspendu vendredi 10 mars après une baisse de 60 % jeudi 9 mars. Si ces deux banques de taille modeste ne sont pas systémiques, des doutes se font jour sur les portefeuilles obligataires détenues par les banques. La remontée des taux provoque une forte dépréciation des cours obligataires, ce qui pourrait mettre en difficulté des établissements qui auraient des besoins urgents en liquidités. En l’état actuel des taux, l’agence américaine chargée de garantir les dépôts bancaires (FDIC) a estimé que si les banques régulées devaient vendre tous leurs portefeuilles de titres financiers, 600 milliards de dollars de pertes seraient alors enregistrés. Les banques doivent également faire face à des transferts des comptes courants non rémunérés vers des placements rémunérés, ce qui peut générer des coûts supplémentaires.
La France, tout va bien pour le moment, « madame la marquise »
Nul ne sait quand la dette publique deviendra un réel problème financier et politique mais le rendez-vous se rapproche sans nul doute. Avec une balance des paiements courants déficitaire, une productivité en baisse et une trajectoire budgétaire toujours mal contrôlée, la France est de plus en plus exposée en cas d’augmentation des taux.
Pour le Président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, « en 2027, nous pourrions nous retrouver dans une situation où la France serait dans le trio de tête pour la dette, aux côtés de l’Italie et de la Grèce. Ce n’est pas notre place ». Que ce soit au sein de la population ou à l’Assemblée nationale où les objectifs de maîtrise relative budgétaire sont récusés par une majorité de députés, la tentation est toujours à l’augmentation des dépenses publiques.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 10 mars 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 220,67 | -1,73 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 909,64 | -4,44 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 3 861,59 | -4,55 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 138,89 | -3,75 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 427.97 | -0,97 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 748.35 | -2,50 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 229.53 | -1,52 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 28 143,97 | +0,78 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 230,08 | -2,95 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,979 % | -0,220 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,470 % | -0,247 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,718 % | -0,273 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1.0665 | +0,35 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 864.77 | +0,20 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 82.90 | -3,99 % | 84,08 | 78,140 |
Le Coin des Epargnants : les marchés maintiennent le cap malgré les écueils
Quand février confirme janvier
Après avoir enregistré le meilleur mois de janvier de son histoire grâce à une progression de 9,4 %, le CAC 40 a gagné 2,62 % en février, à 7.267,93 points. Le 16 février dernier a été marqué par un nouveau record à 7.387,29 points. Sur les deux premiers mois de l’année, la hausse du CAC 40 a été de 12,27 %. Les valeurs les plus en pointe ont été STMicroelectronics et Renault avec des progressions de plus de 35 %, Publicis, Stellantis, BNP Paribas, Saint-Gobain, URW et Alstom ont augmenté de plus de 20 %. Le Cac 40 obtient depuis le début d’année de meilleurs résultats que les indices américains, le Dow Jones perd 1 % depuis le 1er janvier tandis que le S&P 500 ne gagne que 3,8 %.
Compte tenu des menaces et des incertitudes, l’évolution des marchés reste difficile à apprécier. L’inflation demeure toujours inconnue. Pour certains, elle est en voie de régression quand pour d’autres, un second tour serait à l’œuvre avec les hausses de prix dans l’alimentation et celles des salaires. En France, l’indice des prix à la consommation a atteint 7,2 % sur un an en février, selon les données harmonisées de l’Union européenne. Sur un mois, l’inflation a augmenté de 1 %, contre 0,4 % en janvier. Selon l’Insee, les prix des produits manufacturés devraient augmenter avec la fin des soldes d’hiver et ceux des services avec l’augmentation des prix du transport. La France n’est pas le seul pays touché par ce phénomène de réaccélération des prix. En Espagne, le taux d’inflation annuel est passé de 5,9 % à 6,1 % entre janvier et février. La Banque Centrale Européenne ne peut que poursuivre son programme de hausse de ses taux directeurs. L’idée d’un taux de dépôt final de la BCE à 4 % à l’horizon de février 2024, contre 3,5 % estimé en début d’année et 2,5 % actuellement est aujourd’hui pronostiqué. Par voie de conséquence, le rendement sur l’emprunt d’État français à dix ans a atteint 3,18 %, au plus-haut depuis avril 2012. Son équivalent allemand s’est tendu à 2,7 %, également un pic depuis 12 ans.
Un début de mois de mars prometteur
Moins de trois mois après la levée des restrictions sanitaires par les autorités de Pékin et après une période de fort ralentissement, plusieurs indicateurs semblent révéler un redémarrage de l’économie. Pour la première fois depuis le mois de juillet 2022, l’activité manufacturière chinoise a progressé en février. L’indice S&P Global est ressorti à 51,6, contre 49,2 en janvier et 50,7 attendu par le consensus, le seuil des 50 marquant la frontière entre la zone de contraction et la phase d’expansion. Dans le secteur des services, l’activité est également ressortie en hausse, portée par la demande intérieure et la croissance de l’emploi salarié. L’indice PMI S&P Global pour Caixin s’est établi à 55 points le mois dernier, contre 52,9 en janvier. Les entreprises chinoises ont créé des emplois pour la première fois en quatre mois. Les tensions inflationnistes demeurent par ailleurs limitées en Chine. Les investisseurs espèrent que le gouvernement chinois annonce de nouvelles mesures de relance à l’occasion du Congrès national du Peuple qui se réunit à partir du dimanche 5 mars. Ces mesures pourraient concerner le secteur immobilier toujours en difficulté en raison du durcissement des conditions d’accès au crédit.
Plusieurs statistiques favorables pour la zone euro ont également contribué à améliorer le moral des investisseurs. La hausse des prix à la production a été moins importante que prévu en janvier. Elle est revenue à 15 % sur un an, contre 24,5 % en décembre. Le consensus pariait sur 17,8 %. L’indice PMI S&P Global de la zone euro s’est élevé à 52,7 points, son meilleur niveau depuis juin. Cet indice semble conforter l’idée que l’Europe pourra échapper à la récession.
A la clôture vendredi 3 mars, le CAC 40 a terminé à 7 348,12 points avec une hausse de 2,21 % sur la semaine. Le CAC 40 est à moins de 40 points de son record absolu du 16 février à 7387,29 points. Le Dow Jones a progressé de 1,40 % et le S&P 500 de 1,8 %.
Les taux d’intérêt ont poursuivi leur mouvement de hausse en lien avec le maintien de fortes tensions inflationnistes notamment en Europe. Le taux de l’OAT français à 10 ans a dépassé 3,2 %. Le taux de son équivalent américain est désormais sur la ligne de crête des 4 %.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 3 mars 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 348,12 | +2,21 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 390,97 | +1,40 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 045,64 | +1,81 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 11 689,01 | +2,27 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 578,39 | +2,30 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 947,11 | +0,87 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 4 294,80 | +2,59 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 27 927,47 | +1,73 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 328,39 | +1,87 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,201 % | +0,185 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,717 % | +0,178 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,991 % | +0,024 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0618 | +0,53 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 848,12 | +1,79 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 85,46 | +0,66 % | 84,08 | 78,140 |
Lente décrue du taux d’épargne en France
En moyenne sur l’année 2022, selon l’INSEE, le taux d’épargne s’est élevé à 16,6 % du revenu disponible brut. Il a reculé de deux points par rapport à 2021, mais reste supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (+1,6 point par rapport à 2019). Les ménages n’ont pas encore réellement puisé dans leur cagnotte covid qui est évaluée à plus de 145 milliards d’euros. Ils ont maintenu un effort important d’épargne malgré ou à cause de l’inflation. Les ménages mettent de l’argent de côté pour faire face aux dépenses à venir qui pourraient coûter plus chères. Il convient par ailleurs de souligner que les deux tiers de l’épargne représentent les remboursements du capital des emprunts immobiliers. En 2022, le taux d’épargne financière a été de 5,4 % du revenu disponible brut quand la composante immobilière s’élevait à 11,2 % du revenu disponible brut.
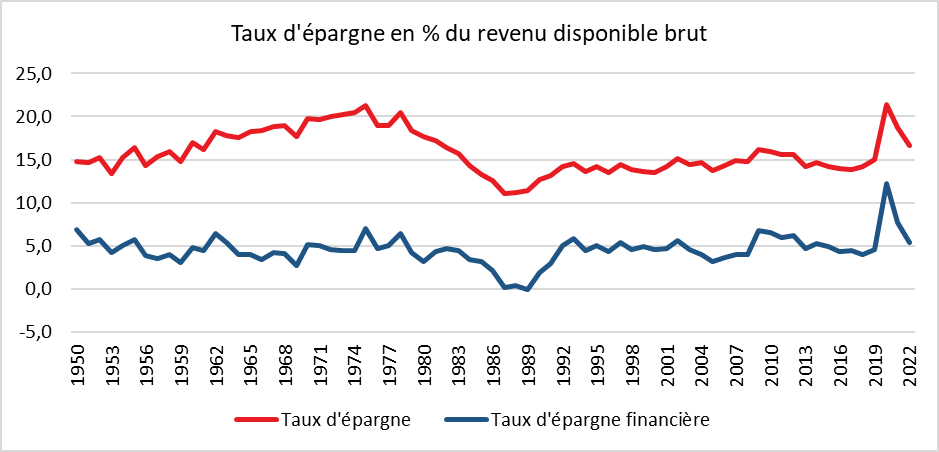
La France, terre d’investissement pour les entreprises étrangères
En 2022, le nombre de projets d’implantation s’est élevé à 1 725 selon les chiffres publiés par Business France. Ce résultat est en hausse de 7 % par rapport à 2021. Ces projets d’investissement auraient permis le maintien ou la création de 58 810 emplois.
Les groupes étrangers ont, implanté ou développé des activités de production sur le territoire français qui représentent un quart des décisions d’investissement (457 projets) et 30 % des emplois recensés. 394 entreprises étrangères ont décidé d’installer des centres de décision en France. En 2022, les Américains sont redevenus les premiers investisseurs, (280 projets) en France, devant l’Allemagne (256) et le Royaume-Uni (176).
Augmentation du taux de rémunération des livrets
La hausse de la rémunération des dépôts bancaires en lien avec celle des taux continue.
La rémunération moyenne des dépôts bancaires augmente, selon la Banque de France, de 9 points de base en janvier à 1,04 %, franchissant ainsi le seuil symbolique de 1 % pour la première fois depuis 2015. La hausse est plus marquée pour les dépôts des SNF, dont la rémunération s’établit à 0,76 % après 0,60 % en décembre. Le taux de rémunération des dépôts des ménages s’établit à 1,23 % en janvier, après 1,18 % en décembre.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| janv- 2023 (g) | janv- 2022 | nov- 2022 | déc- 2022 (f) | janv- 2023 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 130 | 0,40 | 0,88 | 0,95 | 1,04 |
| dont Ménages | 1 851 | 0,62 | 1,17 | 1,18 | 1,23 |
| – dépôts à vue | 612 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 20 | 0,38 | 1,31 | 1,67 | 2,00 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 60 | 0,75 | 0,74 | 0,80 | 0,93 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 604 | 0,52 | 2,16 | 2,17 | 2,17 |
| dont : livret A | 351 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| – livrets ordinaires | 273 | 0,09 | 0,33 | 0,33 | 0,45 |
| – plan d’épargne-logement | 282 | 2,54 | 2,57 | 2,57 | 2,58 |
| dont SNF | 879 | 0,09 | 0,45 | 0,60 | 0,76 |
| – dépôts à vue | 620 | 0,04 | 0,17 | 0,21 | 0,24 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 203 | 0,13 | 1,30 | 1,68 | 2,08 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 56 | 0,62 | 1,09 | 1,41 | 1,74 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Assurance vie – résultats du mois de janvier 2023 : à l’heure des grands arbitrages
En janvier 2023, l’assurance vie a dégagé une collecte nette de 1,2 milliard d’euros bien plus faible que celle du Livret A (+9,27 milliards d’euros). La collecte du premier placement des ménages a été tiré comme les mois précédents par les unités de compte. Leur collecte nette a été positive de 3,6 milliards d’euros quand celle des fonds a été en décollecte de 2,4 milliards d’euros. La collecte en unités de compte se maintient, en effet à un niveau élevé, 39 % en janvier.
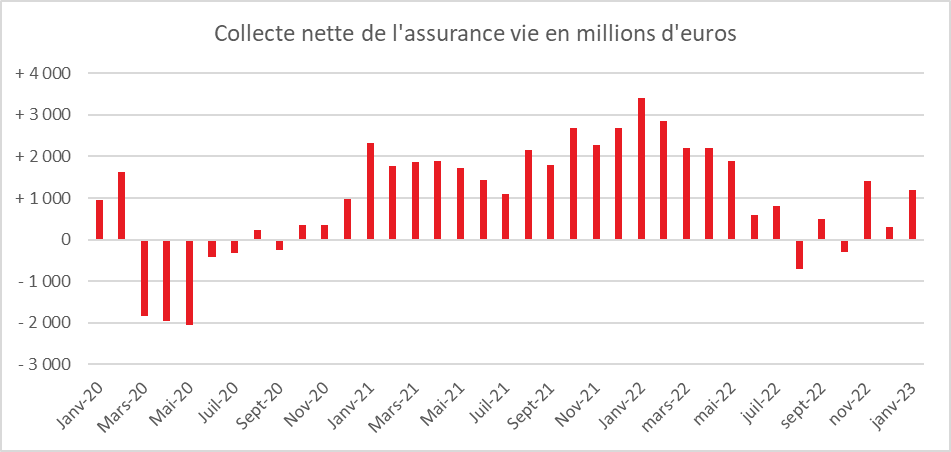
Un mois de janvier paradoxal : des versements et des rachats massifs
La collecte nette du mois de janvier 2023 est faible par rapport à la moyenne de ces dix dernières années (plus de 2 milliards d’euros). Ce résultat décevant est d’autant plus étonnant que la collecte brute a été exceptionnelle. Les ménages ont tout à fois effectué des versements importants tout et réalisé des retraits élevés. Le montant de la collecte brute a atteint 14,1 milliards d’euros et les rachats 12,9 milliards d’euros. De tels montants signifient la réalisation d’arbitrages. Importants dont les fonds euros ont fait les frais.
L’annonce des résultats des rendements des fonds euros n’a pas créé un engouement pour ces derniers. L’assurance vie a certainement pâti de l’annonce du relèvement du taux du Livret A. Les ménages sont également en train d’alléger leurs liquidités non rémunérées (comptes courants) afin de se protéger de l’inflation L’augmentation des taux d’intérêt et le durcissement des conditions d’octroi des prêts conduisent les ménages réalisant un achat immobilier à puiser dans leur contrat d’assurance vie. Les ménages optent également pour le Plan d’Epargne Retraite, placement à long terme qi bénéficie d’un avantage fiscal à l’entrée.
Le PER au-dessus de la barre des 50 milliards d’euros d’encours
Dans un contexte propice, toute annonce de réforme des retraites contribuant à la progression des produits d’épargne retraite, le PER assurantiel poursuit sa montée en puissance. Selon France assureurs, son encours a dépassé, au mois de janvier, 50 milliards d’euros. Les unités de compte représente 45 % de l’encours soit deux fois leur poids pour l’assurance vie. 3,9 millions de personnes disposent désormais d’un PER assurantiel.
Le nombre de nouveaux plans a été de 75 400 dont 22 900 dans le cadre de transferts d’anciens contrats d’épargne (30 %). Les transferts ont porté sur 326 millions, soit près de 40 % de la collecte du mois de janvier. La collecte nette globales s’est élevée à + 668 millions d’euros, en hausse de + 194 millions d’euros par rapport à l’année dernière (+ 41 %).
Belle progression du CAC40 depuis le début d’année malgré les menaces et les incertitudes
Compte tenu des menaces et des incertitudes, l’évolution des marchés reste difficile à apprécier. L’inflation demeure toujours inconnue. Pour certains, elle est en voie de régression quand pour d’autres, un second tour serait à l’œuvre avec les hausses de prix dans l’alimentation et celles des salaires. En France, l’indice des prix à la consommation a atteint 7,2 % sur un an en février, selon les données harmonisées de l’Union européenne. Sur un mois, l’inflation a augmenté de 1 %, contre 0,4 % en janvier. Selon l’Insee, les prix des produits manufacturés devraient augmenter avec la fin des soldes d’hiver et ceux des services avec l’augmentation des prix du transport. La France n’est pas le seul pays touché par ce phénomène de réaccélération des prix. En Espagne, le taux d’inflation annuel est passé de 5,9 % à 6,1 % entre janvier et février. La Banque Centrale Européenne ne peut que poursuivre son programme de hausse de ses taux directeurs. L’idée d’un taux de dépôt final de la BCE à 4% à l’horizon de février 2024, contre 3,5% estimé en début d’année et 2,5% actuellement est aujourd’hui pronostiqué. Par voie de conséquence, le rendement sur l’emprunt d’Etat français à dix ans a atteint 3,18 %, au plus-haut depuis avril 2012. Son équivalent allemand s’est tendu à 2,7 %, également un pic de 12 ans.
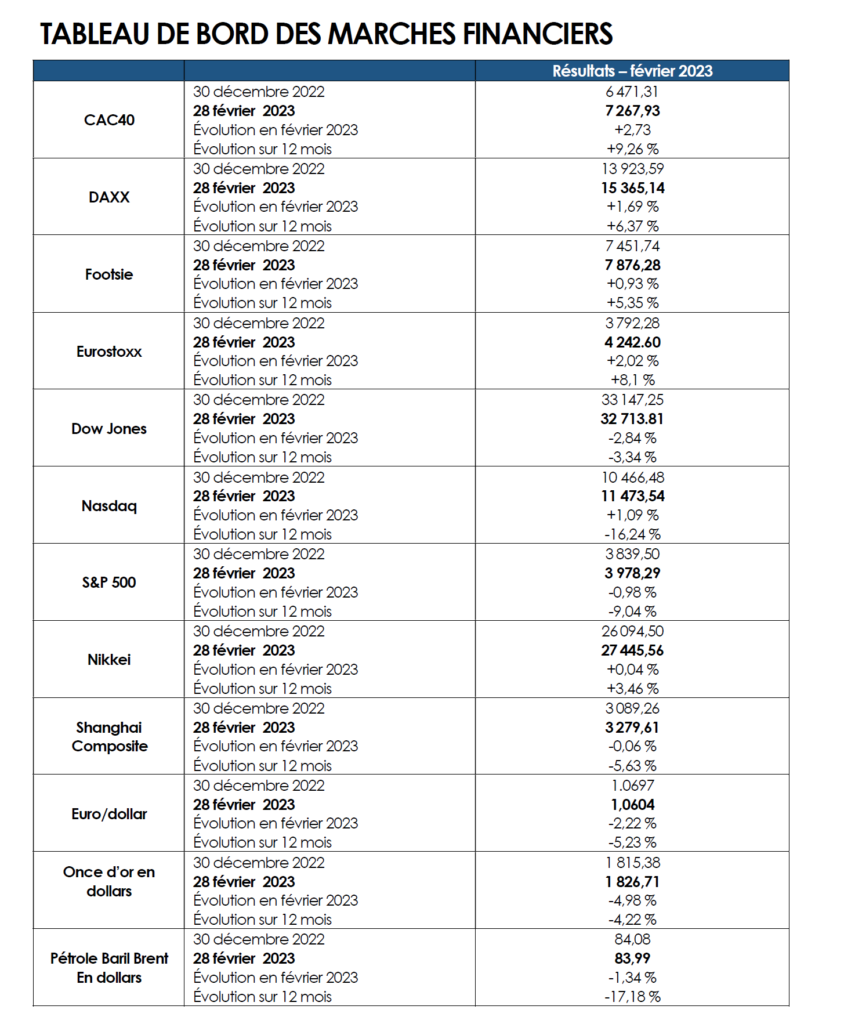
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


