Le Coin des épargnants du 30 septembre 2023 : le retour du risque souverain ?
Retour du risque souverain
Jeudi 28 septembre, des tensions sont apparues sur le marché obligataire européen avec la publication du projet de loi de finances italien laissant apparaître un déficit public en hausse. Le taux des BTP – les obligations d’Etat transalpines – à 10 ans a augmenté de de 16 points de base (pb), se rapprochant des 5 %. L’écart de taux entre l’Allemagne et l’Italie (spread) a atteint 200 points de base, pour la première fois depuis le mois de mars. Il a progressé de 35 pb en un mois, sa plus forte hausse mensuelle en trois ans et demi. Le taux de l’OAT française a également augmenté pour dépasser 3,5 % au plus haut depuis novembre 2011, période marquée par les derniers soubresauts de la crise de la zone euro. Le taux allemand s’est de son côté rapproché des 3 %.
L’arrêt des efforts de réduction de la dette décidé par le gouvernement italien a créé l’émoi sur les marchés d’autant plus que depuis plusieurs années, l’Italie avait été plutôt une bonne élève en matière de finances publiques en dégageant des excédents primaires (soldes positifs avant le paiement des intérêts de la dette). Les investisseurs ont également constaté que la France s’engageait avec lenteur dans la réduction de son déficit public, la Cour des Comptes soulignant sur ce sujet le manque d’ambition du gouvernement.
La zone euro n’a pas l’exclusivité de la remontée des taux d’intérêt. Aux Etats-Unis, les taux à 10 ans ont augmenté d’un point de pourcentage depuis le début de l’année, sachant que la moitié de la hausse a été réalisée depuis le début du mois de septembre. Ils évoluent désormais autour de 4,65 %, leur plus haut niveau depuis 2007. Et en Angleterre, le rendement des Gilts – les obligations souveraines – à 10 ans a progressé de 20 points de base. Même au Japon, où la banque centrale refuse toujours officiellement d’abandonner sa politique de contrôle de la courbe des taux, le rendement de la dette japonaise à 10 ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 2013, à 0,76 %.
Les investisseurs ont un autre sujet d’inquiétude avec l’absence d’accord aux Etats-Unis entre républicains et démocrates sur le financement des administrations fédérales, ces dernières risquant d’être fermées dès la semaine prochaine (shutdown). Cette situation pourrait provoquer une nouvelle hausse des taux et une baisse du cours des actions.
Un troisième trimestre décevant pour les actions
Après un premier semestre de bon aloi, les marchés « actions » ont souffert durant l’été. Le CAC 40 a reculé de près de 2,5 % et le Dax allemand de plus de 3 %. Le Nikkei a perdu de son côté plus de 4 % au troisième trimestre. Les menaces de récession associées à une inflation qui résiste aux hausses des taux directeurs des banques centrales explique cette orientation à la baisse des indices boursiers. S’y ajoute, en particulier en Asie, le ralentissement de l’économie chinoise. Sur le seul mois de décembre, les grands indices « actions » ont perdu du terrain mais la baisse demeure mesurée sachant que le neuvième mois de l’année est, en règle générale, décevant.
L’objectif des 2 % demeure lointain même si la publication des taux d’inflation du mois de septembre en zone euro a rassuré les investisseurs. Malgré la hausse du cours du pétrole, la décrue se poursuit même si elle s’effectue à petite vitesse. En Allemagne, l’indice des prix à la consommation n’a augmenté que de 4,3 % sur un an en septembre, contre 5,2 % en août, son plus bas niveau en près de deux ans. L’inflation sous-jacente s’y est élevée à 4,5 %, après 5,3 % le mois précédent. Le maintien du cours du pétrole entre 95 et 100 dollars le baril pourrait contrarier, dans les prochains mois, ce processus de baisse. Aux Etats-Unis, l’indice « core » PCE (inflation hors éléments volatils), le plus surveillé par la Réserve fédérale, a augmenté de 0,1 % sur un mois – et non de 0,2% comme attendu. Sur un an, il s’élève à 3,9 % en septembre.
L’euro continue de se déprécier par rapport au dollar. Il s’échangeait vendredi 29 septembre contre 1,05 dollar. Il se rapproche ainsi de sa parité. La hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis combinée avec un potentiel de croissance moins élevé que chez ces derniers explique ce mouvement à la baisse de la monnaie européenne.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 29 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 135,06 | -0,61 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 507,50 | -1,34 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 288,05 | -0,67 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 219,32 | +0,06 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 386,58 | -1,03 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 608,08 | -0,71 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 174,66 | -0,27 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 31 857,62 | -1,64 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 110,48 | -0,70 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,401 % | +0,124 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,845 % | +0,116 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,570 % | +0,142 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0585 | -0,73 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 855,25 | -3,64 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 95,47 | +1,92 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
L’assurance vie en chaise longue en août
En août, l’assurance vie signe sa troisième décollecte de l’année avec -1,7 milliard d’euros faisant suite à celle du mois de juillet de -1 milliard d’euros. L’assurance vie est toujours confrontée à la désaffection des ménages à l’encontre des fonds euros. La décollecte sur les fonds euros atteint 2,5 milliards d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, elle s’élève à 20,5 milliards d’euros. L’assurance vie est toujours challengée par les livrets réglementés et par les dépôts ou contrats à terme dont les rendements sont en hausse.
Traditionnellement, le mois d’août est assez favorable à l’assurance vie. En dehors de cette année, seules trois décollectes ont été constatées lors de ces vingt dernières années : en 2011, 2012 et 2022. L’année dernière, elle avait été de -791 millions d’euros. La collecte mensuelle moyenne, en août, de ces dix dernières années a été de 1,3 milliard d’euros. Cependant, ce mois d’août est toujours un peu particulier en raison de la fermeture pour congés de nombreux agences d’assurances conduisant à un faible nombre d’opérations.
Une collecte nette encore positive mais en baisse
En 2023, sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette est de 1,7 milliard d’euros quand l’année dernière, elle avait atteint, de janvier à août, près de 12 milliards d’euros. En 2019, avant la crise sanitaire, elle s’élevait sur la même période à 18 milliards d’euros.
La collecte nette positive des unités de compte de +800 millions d’euros en août n’arrive plus à compenser les retraits sur les fonds euros.
Des cotisations en recul sur les unités de compte
Traditionnellement, les cotisations brutes sont relativement faibles en août en raison des vacances. Elles se sont élevées à 8,3 milliards d’euros en août 2023 contre 8,6 milliards d’euros un an plus tôt. Il n’y a donc pas de réelle rupture d’une année sur l’autre. Pour rappel, les cotisations brutes étaient de 12,1 milliards d’euros en juillet et de 15 milliards d’euros en juin dernier.
Des prestations toujours dynamiques
En août 2023, les prestations ont atteint 10 milliards d’euros contre 9,4 milliards d’euros un an plus tôt. Les prestations et rachats demeurent importants en lien avec les liquidations de contrat après le décès de leur titulaire et en lien à une réaffectation des fonds euros vers d’autres placements. La hausse des taux d’intérêt et le durcissement des conditions d’octroi des prêts conduisent également les ménages à augmenter leurs apports pour leurs achats immobiliers.
L’assurance vie en attendant 2024
L’assurance vie connaît une érosion de sa collecte nette s’expliquant essentiellement par le niveau de rendement des fonds euros. Il n’y pas, néanmoins, de sorties importantes sur le premier placement des ménages dont l’encours a atteint 1907 milliards d’euros fin août, en hausse de 4,2 % sur un an. Les rendements 2023 qui seront annoncés à la fin de l’année et au début de l’année prochaine devraient conduire à une amélioration de la collecte. Ils devaient se situer autour de 2,5/2,7 % en lien avec la hausse des taux d’intérêt. Les fonds euros par leur structure connaissent un effet d’inertie important mais qui a contrario a toujours permis de maintenir un rendement positif même durant les années 2019/2021. Par ailleurs, leur remontée devrait se poursuivre en 2024. Ils devraient passer au-dessus de l’inflation en 2024 et du Livret A en 2025.
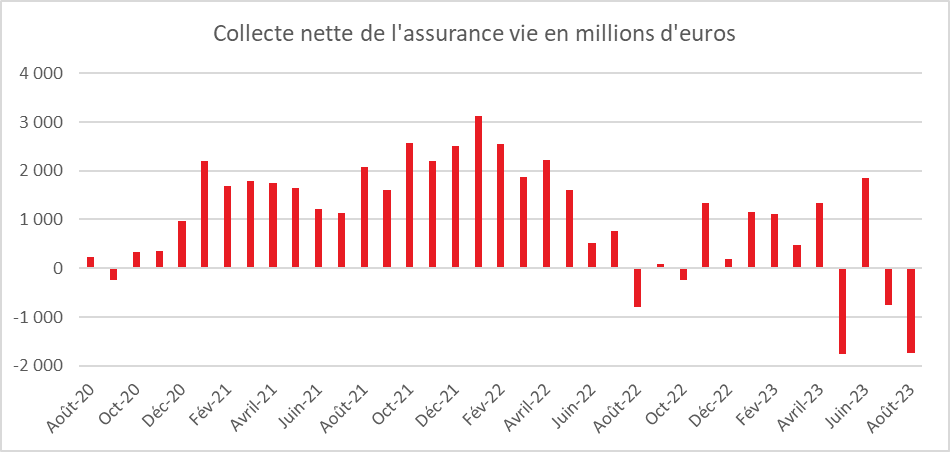
Cercle de l’Epargne – données France Assureurs
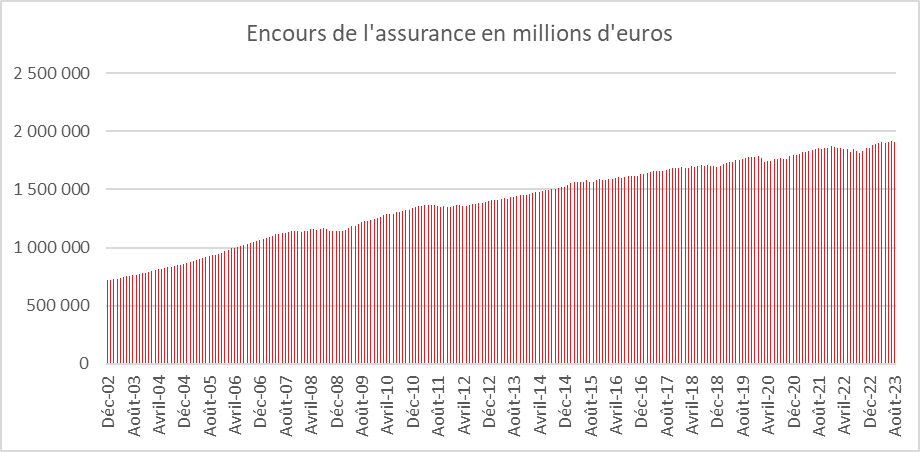
Cercle de l’Epargne – données France Assureurs
Le plafond du Livret d’Epargne Populaire passe à 10 000 euros le 1er octobre
Au Journal Officiel du 29 septembre figure le décret portant de 7700 à 10000 euros le plafond du Livret d’Epargne Populaire. Le relèvement du plafond s’accompagne d’un changement dans les modalités d’application du plafond. Jusqu’au 1er octobre, le plafond concernait les versements sans prendre en compte les intérêts. Avec le nouvel arrêté, le titulaire ne pourra pas effectuer de versements aboutissant à dépasser 10 000 euros.
Le décret indique que « Les versements effectués sur un compte sur livret d’épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros. » quand le précédent indiquait « Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d’épargne populaire est fixé à 7 700 euros. »
Revalorisation des pensions de retraite de base de 5,2 %
Le Ministre de l’Economie a annoncé la revalorisation de 5,2 % des pensions de base, revalorisation qui sera effective le 1er janvier 2024. Elle fait suite à la hausse de 0,8% du 1er janvier 2023 et de 4 % le 1er juillet 2023. Cette revalorisation sera suivie par celle des pensions complémentaires en cours de négociation et qui devrait intervenir dès le 1er novembre 2023. La hausse des pensions est la conséquence de l’augmentation des prix enregistrée ces derniers mois. Elle concerne plus de 16 millions de retraités. Le coût de la revalorisation des pensions de base est de 14 milliards d’euros en 2024 dont 3 milliards d’euros pour les pensions des agents de l’Etat.
Le Coin des Epargnants du 23 septembre 2023 : quand la FED refroidit les marchés
Après une hausse de 1,9 % la semaine dernière, le CAC 40 a perdu 2,63 % cette semaine, repassant sous le seuil des 7 200 points, à 7 184,82 points. Les indices « actions » des autres grandes places financières occidentales ont également reculé ces derniers jours. Sur la semaine, le Nasdaq comme le S&P 500 ont perdu plus de 2 %. Ce mouvement baissier s’explique par les déclarations du Président de la FED, laissant que de nouvelles hausses de taux directeurs sont possibles et par la confirmation du ralentissement économique de la zone euro. Les entreprises européennes sont plus exposées à la hausse des taux que leurs homologues américaines, les premières se finançant avant tout par emprunts bancaires quand les secondes recourent aux marchés. Par ailleurs, la zone euro est plus touchée par l’augmentation du cours du pétrole qui induit des transferts financiers à l’extérieur quand ces transferts sont internes aux Etats-Unis. Ils profitent, en effet, aux producteurs de pétrole américains. Les chiffres PMI préliminaires d’activité dans l’industrie et les services publiés vendredi 22 septembre pour le mois de septembre semblent indiquer une entrée en récession de la zone euro. L’indice composite, synthèse entre l’industrie manufacturière et les services, est certes ressorti à 47,1 points, après 46,7 en août. Mais l’indice reste en territoire négatif (en-dessous de 50) malgré cette hausse. Ce niveau serait cohérent avec une contraction de l’ordre de 0,3 % du PIB de la zone euro au troisième trimestre.
Aux Etats-Unis, l’économie demeure dynamique mais un nombre croissant d’experts s’attendent à un net ralentissement pour la fin de l’année. Ils estiment dans ce contexte que la consommation qui porte la croissance devrait fléchir dans les prochains moins du fait de l’épuisement de la cagnotte covid. Il resterait moins de 500 milliards de dollars dans cette cagnotte sur les 2 200 milliards économisés en 2021.
Dans ce contexte, les propos du Président de la FED ont fait l’effet d’une douche froide. En indiquant que de nouvelles hausses de taux directeurs sont possibles dans les prochains mois, il a occulté sa décision de ne pas les relever en septembre. Le Président de la banque centrale américaine Jerome Powell, a, en effet, affirmé que « nous sommes prêts à relever à nouveau les taux si c’est approprié » et que « nous voulons des preuves convaincantes que nous avons atteint le bon niveau ». Les taux directeurs restent, pour le moment, dans la fourchette 5,25 % – 5,5 %. Il s’agit de la deuxième pause depuis l’engagement du processus de hausse des taux directeurs.
La FED a, par ailleurs, actualisé ses prévisions macroéconomiques. Le PIB réel devrait augmenter de 2,1 % en 2023, contre 1 % attendu en juin, avec un taux de chômage à 3,8 % au lieu de 4,1 % escompté toujours en juin. La croissance américaine apparaît meilleure que prévu malgré les onze hausses des taux directeurs. L’indice des prix des produits de consommation individuelle essentiels (inflation « core PCE ») devrait s’élever à 3,7 % en 2023, au lieu des 3,9 % prévus. En revanche, le niveau des taux de la FED a été revu à la hausse pour 2024, à 5,1 % au lieu de 4,6 %. En 2023, la projection de taux demeure inchangée à 5,6 %, soit un cran plus haut qu’aujourd’hui. En 2025, ils demeureraient élevés, à 3,9 %, et en 2025 ils resteraient à 2,9 %. La baisse des taux directeurs n’interviendrait qu’au milieu de l’année 2024.
Les taux des obligations d’Etat ont poursuivi leur ascension. Vendredi 22 septembre, celui de l’OAT français à 10 ans s’élevait près de 3,3 %. Le taux de son homologue américain était de 4,5 %. Après avoir flirté avec les 100 dollars, le pétrole est redescendu à 93 dollars en fin de semaine en raison des menaces qui planent sur la croissance. Compte tenu d’un maintien d’une politique monétaire américaine restrictive, le dollar s’apprécie face à l’euro.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 22 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 184,82 | -2,63 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 963,84 | -1,89 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 320,06 | -2,41 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 14 701,10 | -2,87 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 557,29 | -2,12 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 683,91 | -0,36 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 207,16 | -2,05 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 402,41 | -3,37 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 132,43 | +0,43 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,277 % | +0,063 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,729 % | +0,058 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,428 % | +0,104 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0655 | -0,16 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 925,56 | +0,20 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 93,29 | -1,01 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Le Livret A ne prend pas de vacances
L’année de tous les records
Au mois d’août 2023, même sans relèvement de son taux, le Livret A a enregistré, selon la Caisse des dépôts, encore une forte, collecte, 2,27 milliards d’euros. Elle est supérieure à celle du mois de juillet (2,16 milliards d’euros). Elle est certes moins exceptionnelle que celle du mois d’août 2022 (4,49 milliards d’euros) mais celle-ci était intervenue après le passage du taux de rémunération de 1 à 2 %. Le résultat du mois d’août 2023 n’en demeure pas moins exceptionnel en étant nettement supérieur à la moyenne de ces dix dernières années (1,3 milliard d’euros). Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte dépasse 30 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. L’année dernière, sur la même période, la collecte était de 23,62 milliards d’euros.
De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a également enregistré une collecte de bon aloi en s’élevant à 740 millions d’euros, portant le total sur les huit premiers mois de l’année à 10,41 milliards d’euros.
Les deux produits d’épargne réglementée ont, ensemble, enregistré une collecte nette en août de 3,02 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte se monte ainsi à pris de 40,5 milliards d’euros, record à battre.
L’encours du Livret A fin août, a atteint 405,7 milliards d’euros et celui du LDDS 144,7 milliards d’euros pour le LDDS. Pour les deux livrets, ces encours sont une nouvelle fois historiques.
Les Français plus fourmis que cigales au cœur de l’été
En ce début de second semestre, le Livret A ne faiblit donc pas. Les Français ont été au cœur de l’été plus fourmis que cigales. Ils ont continué à restreindre leurs dépenses de consommation et réorienter les liquidités présentes sur leurs comptes courants qui ne rapportent rien sur le Livret A et sur le LDDS.
Le comportement des ménages français tranche avec celui des Américains qui vident scrupuleusement leur cagnotte Covid. La cagnotte française demeure voire continue à grossir. Même si le ressenti est tout autre, l’effort d’épargne est entretenu par une bonne résistance du pouvoir d’achat des ménages. La faible confiance des ménages dans l’évolution de la situation économique du pays comme le souligne depuis de nombreux mois l’indice de l’INSEE explique certainement la primauté donnée à l’épargne de précaution. Les ménages mettent de l’argent de côté pour faire face aux dépenses de demain et d’après-demain. Un phénomène d’encaisse réelle peut également jouer, les ménages voulant maintenir constant le pouvoir d’achat de leur épargne. Des facteurs structurels comme le vieillissement de la population sont également à prendre en compte.
Une collecte en légère modération pour la fin de l’année, peut-être mais pas sûre
Le succès du Livret A n’en finit pas de surprendre. Le passage de son taux de rémunération à 3 % a électrisé les épargnants qui se délestent des placements à faible rentabilité. Tant que les incertitudes économiques seront nombreuses et que la vague inflationniste ne sera pas retombée, la collecte restera forte. La crainte d’augmentation des impôts et la hausse des prix des carburants jouent en sa faveur. En fin d’année, la baisse attendue de l’inflation pourrait redonner quelques couleurs à la consommation, actuellement atone, ce qui pourrait alors amener une diminution de la collecte du Livret A et du LDDS.
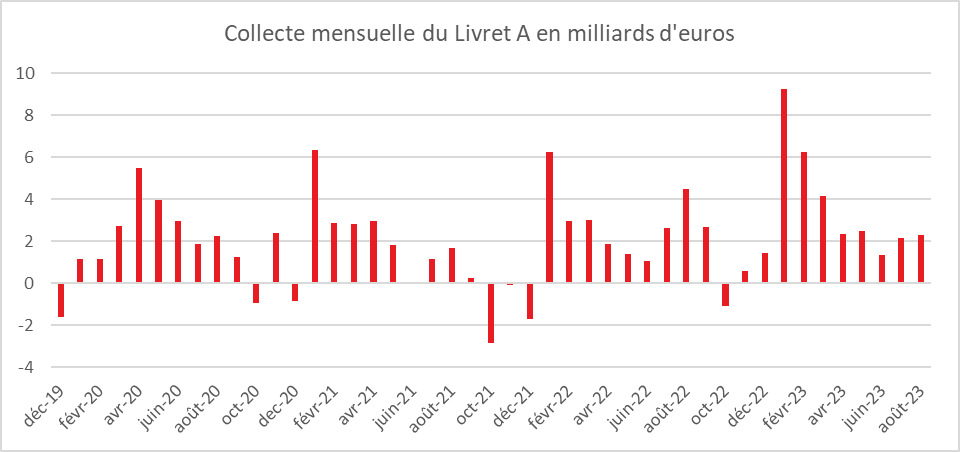
CdE – CDC
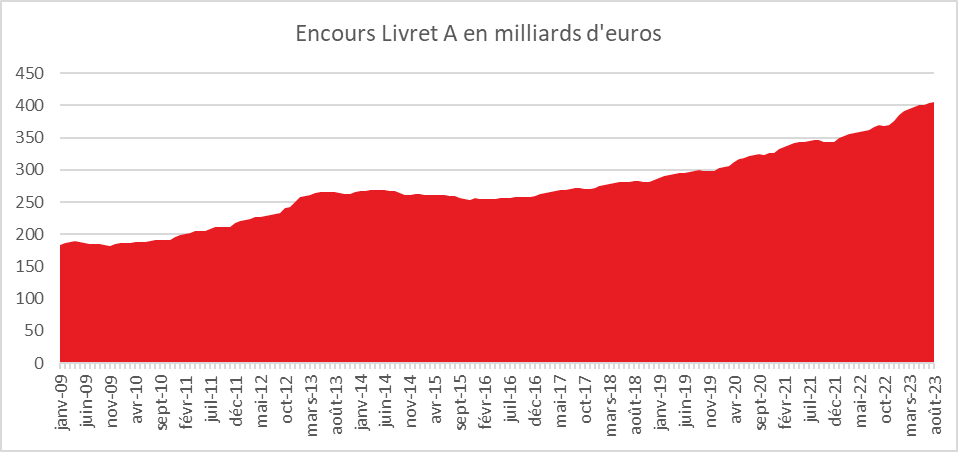
CdE – CDC
Le patrimoine des ménages en 2022, près de 14 800 milliards d’euros
Fin 2022, le patrimoine économique national s’élevait, selon l’INSEE, à 20 052 milliards d’euros en France, soit 9,5 fois le produit intérieur net de l’année. Son augmentation a été de 5,6 % en 2022, contre +9,1 % en 2021. Les actifs non financiers ontconnu une hausse de +5,2 % après +8,9 %. Le prix du foncier a baissé de -0,8 % en 2022 après +8,3 % en 2021. En revanche, les prix de la construction ont augmenté notamment pour le non résidentielle (+9,3 % après 7,0 %).
En 2022, dans le sillage de la baisse des marchés boursiers (-10,3 % pour le SBF 120, après +26,2 % en 2021), les actifs et passifs sous forme d’actions se sont repliés de respectivement -6,2 % après +17,8 %, et -5,8 % après +18,9 %. Il en a résulté une baisse du patrimoine financier net des ménages. En revanche, celui des sociétés non financières et des administrations publiques a augmenté. Quant à celui des sociétés financières, il est devenu négatif en 2022, alors qu’il était positif en 2021.
Le patrimoine des ménages s’est stabilisé en 2022
Fin 2022, le patrimoine des ménages (73,8 % du patrimoine économique national) est resté stable après une forte augmentation en 2021 (+0,3 % après +8,7 %). Il s’élevait à fin 2022 à 14 791 milliards d’euros, soit 9,3 fois le revenu disponible net des ménages contre 9,1 fois en 2021.
Le patrimoine non financier des ménages a augmenté de +3,8 % après +9,2 % pour atteindre 10 435 milliards d’euros. La moindre progression s’explique notamment par celui des prix des biens immobiliers (+3,5 % après +9,1 %). Ces biens constituent 90,8 % des actifs non financiers des ménages. L’augmentation du prix des terrains bâtis n’a téé que +0,6 % après +9,7 % en 2021, tandis que la valeur des logements (hors terrains) est restée portée par la hausse du prix des matières premières (+6,2 % après +8,6 %).
Le patrimoine financier net des ménages a diminué de 7,1 % en 2022, à 4 356 milliards d’euros, après avoir augmenté de 7,7 % en 2021. Cette baisse st imputable à la diminution des actifs, les passifs progressant au même rythme qu’en 2021. Les actifs des ménages en assurance-vie représentant 30 % de leurs actifs financiers totaux, ont diminué de -12,1 % après +1,6 %, sous l’effet de la baisse des cours boursiers et de la hausse des taux d’intérêt et en dépit de flux de collecte nets positifs. Les flux nets d’assurance-vie (+36,4 milliards) sont restés importants, en accélération par rapport à 2021 (+29,0 milliards), en particulier pour les contrats en unités de compte (+35,5 milliards après 27,8 milliards), tandis que les flux nets de contrats en euros sont demeurés faiblement positifs (+0,9 milliard, après 1,1 milliard en 2021). Les placements sous forme d’actions et de parts de fonds d’investissement ont reculé (-4,6 % après +13,5 %).
Au passif des ménages, la progression des crédits a légèrement ralenti (+4,9 % après +5,3 %). Les flux nets de crédits, constitués essentiellement de crédits immobiliers, se sont élevés à 84 milliards d’euros en 2022. Au cours du premier semestre, les crédits ont fortement augmenté, puis leur progression s’est normalisée au second semestre.
Le Coin des Epargnants du 15 septembre 2023 : quand les marchés veulent croire à la fin de la hausse des taux
Les marchés « actions » en mode confiance
L’indice CAC 40 a enregistré, lors de cette deuxième semaine de septembre, son meilleur résultat hebdomadaire depuis la semaine du 14 juillet avec un gain de près de 2 %. Ce rebond après de nombreuses séances de léthargie s’explique par la conviction que le cycle de hausses des taux directeurs de la part des banques centrales arrive à son terme et par la publication d’indicateurs chinois supérieurs aux prévisions. La deuxième économie mondiale semble, en effet, réagir positivement aux mesures de soutien mises en place par le gouvernement. En août, la production industrielle a augmenté de 4,5 % sur un mois, après 3,7 % en juillet et contre 3,9 % attendue. Cette progression est la plus importante depuis le mois d’avril. Les ventes de détail ont augmenté de 4,6 % sur un an, contre 2,5 % en juillet et 3 % estimé par le consensus. En revanche, dans le secteur de l’immobilier, les prix ont continué de reculer en août, de 0,3 %, contre -0,2 % en juillet.
Aux Etats-Unis, la production industrielle a augmenté de 0,4 % sur un an en août, tandis que l’indice d’activité manufacturière de la Fed de New York est en hausse à +1,9 point, contre -19 le mois précédent et -10 attendu. La grève dans le secteur automobile pourrait avoir des effets négatifs pour le mois de septembre. La production informatique serait en recul au vu du ralentissement de la production annoncée par les TSMC, un des principaux producteurs de microprocesseurs. Cette annonce a conduit à la baisse des valeurs technologiques. Le Nasdaq a ainsi reculé de 0,55 % sur la semaine.
L’indice de confiance du consommateur de l’Université du Michigan a diminué, en revanche, de 1,8 point à 67,7 en septembre, mais la composante des anticipations d’inflation à un an n’est plus que de 3,1 %, son plus bas niveau depuis mars 2021. Celle des anticipations à 5-10 ans a reculé à 2,7 %, soit son plus faible score depuis le mois de septembre 2022. Ces résultats pourraient inciter la FED, le 20 septembre prochain, à réaliser une pause dans la hausse des taux. Certes comme pourla BCE, elle pourrait effectuer une hausse de précaution.
Le cours du pétrole a, de son côté, continué de se raffermir en se rapprochant des 95 dollars le baril. La hausse de cette semaine est liée aux déclarations émanant de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui s’attend à un déficit d’offre par rapport à la demande mondiale sans précédent depuis 2007, déficit qu’elle a sciemment organisé avec des accords de régulation de la production. Dans son rapport mensuel, publié mardi12 septembre dernier, l’OPEP a évalué le déficit potentiel à 3,3 millions de barils jours. Si la croissance aux Etats-Unis persiste et la Chine connait un rebond de croissance, la barre des 95 dollars pourrait être assez rapidement franchie et dépassée. L’Europe et le Japon seraient les plus exposés au sein des pays de l’OCDE à cette augmentation qui ralentirait le processus de décrue de l’inflation.
La BCE confirme et signe
La Banque centrale européenne a, jeudi 14 septembre, porté le taux de la facilité de financement (« refi ») à 4,5 %, celui de la facilité de prêt marginal à 4,75 %, et le taux de dépôt à 4 %, son plus haut niveau depuis la naissance de l’euro. Depuis le mois de juillet 2022, les taux ont ainsi augmenté de 4,5 points.
La BCE n’a pas opté pour une pause en septembre malgré la baisse des indices PMI qui semblent indiquer l’arrivée rapide d’une récession. Le Comité de politique monétaire de la banque centrale a pris en compte le maintien d’une inflation élevée, 5,3 % en août pour la zone euro. Au sein de celle-ci, plusieurs pays dont la France ont connu un rebond de l’indice des prix le mois dernier. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) qui est surveillée par la BCE, reste également à des niveaux élevés. Selon les nouvelles projections de la BCE, l’inflation serait plus élevée qu’initialement prévue en 2023 (5,6 %) comme en 2024 (3,2 %). Le retour dans la zone cible des 2 % n’est envisagée qu’en 2025. Face à cette situation, la BCE a voulu prouver sa volonté de casser les anticipations inflationnistes. Elle a préféré réaliser cette hausse dès maintenant pour éviter d’être sous pression en octobre en cas de concrétisation de la récession. Il lui serait en effet plus difficile d’augmenter ses taux en cas de réduction du PIB. Pour une majorité d’investisseurs, l’augmentation du mois de septembre pourrait être la dernière ce qui a abouti à une décrispation sur les taux des obligations d’État. Sur ce sujet, Christine Lagarde, la Présidente de la BCE, n’a pris aucun engagement. La banque centrale n’a pas, par ailleurs, communiqué sur une possible accélération de la réduction de son bilan par la fin des réinvestissements liés à son programme « urgence pandémie » (PEPP) ou par une cession des titres détenus dans le cadre de son principal programme d’achats d’actifs (APP). Elle pourrait utiliser ses outils à l’occasion des prochaines réunions si l’arme des taux devenait moins facile à manier.
Le dollar « never die »
La fin du dollar est une antienne vieille d’un demi-siècle. Depuis la fin des accords de Bretton Woods intervenue en 1976, faisant suite à l’arrêt de sa convertibilité en or le 15 août 1971, le dollar n’en finit pas de défier les mauvais augures. De la crise financière de 2008, à la guerre en Ukraine, en passant par la mise en place des sanctions contre la Chine, la dédollarisation à maintes fois été annoncée sans, à ce jour, se concrétiser. Le dollar reste de loin la première monnaie de réserve, autour de 60 % loin devant l’euro, autour de 20 %.
L’euro, en raison de la guerre en Ukraine et des menaces de récession, avait perdu du terrain face au dollar au point de tomber en-dessous de la parité en septembre 2022. Avec la hausse des taux directeurs décidée par la BCE, la monnaie européenne avait regagné une partie du terrain. Elle s’était ainsi apprécié de 15 % revenant à 1,12 dollar au mois de juillet 2023. Depuis, l’euro a perdu 5 %. Cette baisse est imputable à des prises de bénéfices de la part des hedge funds. Ces derniers ne prévoient pas une amélioration du taux de change de l’euro dans les prochains mois, le cycle de hausse des taux directeurs s’achevant.
Le dollar reste une valeur refuge en période trouble. La monnaie américaine bénéfice par ailleurs de la frénésie d’investissements que génère l’intelligence artificielle (IA). Le dollar profite également de la bonne tenue de la croissance américaine qui est deux fois plus importante que celle de la zone euro depuis 2019. Les investisseurs s’attendent à un ralentissement économique plus long et plus profond en zone euro qu’aux États-Unis.
La monnaie européenne si elle est en souffrance par rapport au dollar résiste néanmoins par rapport à l’ensemble des monnaies. En 2023, son taux de change réel (après inflation) a progressé de 3,4 % et s’établit à son plus haut niveau depuis cinq ans. Depuis sa création en 1999, la monnaie européenne n’a cédé que 6,5 % et a réussi à surmonter de nombreuses crises : crise des subprimes en 2008/2009, crise des dettes souveraines 2010/2014, épidémie de Covid en 2020, guerre en Ukraine en 2022.
Sur les marchés des changes, l’inconnu demeure la monnaie chinoise. Les autorités de Pékin pourraient être tenté de déprécier le yuan pour endiguer la baisse de l’activité et la menace déflationniste et pour favoriser la compétitivité des exportations. Il pourrait en résulter des tensions accrues entre les pays occidentaux et la Chine.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 15 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 378,82 | +1,91 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 618.24 | +0,25 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 450.32 | -0,07 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 708,33 | -0,55 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 893,53 | +0,91 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 711,38 | +3,12 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 294,95 | +1,28 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 33 533,09 | +2,84 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 117,74 | +0,03 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,214 % | +0,071 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,671 % | +0,060 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,324 % | +0,057 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0671 | -0,29 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 924,45 | +0,32 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 93,66 | +3,79 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Le Coin des Epargnants du 9 septembre 2023 : montée des incertitudes
La vie n’est pas toujours rose pour les investisseurs
Ralentissement économique confirmé, hausse du prix du pétrole, persistance des tensions sino-américaines : les investisseurs ne voient pas la vie en rose depuis le début du mois de septembre. Les indices « actions » sont en léger recul sur la semaine de -0,90 % pour le CAC40 à -2,08 % pour le Nasdaq. Le Footsie britannique est le seul à faire exception avec une hausse de 0,20 %.
La croissance est annoncée en baisse un peu partout pour les prochains mois. En France, l’INSEE a prévu une croissance qui ne dépasserait pas 0,1 % au troisième trimestre. Avec l’annonce de Ryad et de Moscou de proroger jusqu’à la fin de l’année, l’accord de réduction de la production de pétrole, les cours de ce dernier ont été orientés à la hausse. Le prix du baril de Brent a dépassé les 90 dollars durant la semaine écoulée. Il a ainsi augmenté de près de 2 % sur la semaine et de 20% en trois mois. Cette remontée du prix du pétrole contrarie le processus de baisse de l’inflation. Celle-ci demeure vive est pourrait conduire les banques centrales à relever, une nouvelle fois, leurs taux directeurs à l’occasion de leur prochaine réunion, le 14 et le 19 septembre. Les investisseurs ont accusé le coup après la décision de l’administration chinoise d’interdire l’usage de l’iPhone et de tout autre smartphone de marque étrangère à ses hauts fonctionnaires et employés gouvernementaux. L’action d’Apple a perdu 6,4 % mercredi 7 et jeudi 8 septembre avant de rebondir de 1 % vendredi 9.
La perspective de nouvelles hausses des taux directeurs de la part de la FED et de la BCE a conduit à une augmentation des taux pour les obligations souveraines. Le taux de l’OAT à 10 ans a dépassé 3,1 % et celui de son homologue américain 4,2 %. Le taux des obligations « corporate » dépasse se situe désormais entre 4 et 6 %. L’euro s’est légèrement déprécié sur la semaine passant en-dessous de 1,08 dollar.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 8 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 240,77 | -0,90 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 576,59 | -0,92 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 457,49 | -1,40 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 761,53 | -2,08 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 740,30 | -0,68 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 478,19 | +0,20 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 237,19 | -1,06 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 606,84 | -0,32 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 116,72 | -0,53 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,143 % | +0,088 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,611 % | +0,079 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,267 % | +0,090 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0702 | -1,24 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 917,68 | -1,14 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 90,85 | +2,10 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Assurance vie : décollecte en juillet
Après un léger rebond en juin (+1,8 milliard d’euros) l’assurance vie enregistre, selon France Assureurs, une nouvelle décollecte nette en juillet (-1 milliard d’euros) après celle de mai (-1,7 milliard d’euros). L’assurance vie est, depuis le début de l’année, concurrencée non seulement par les produits d’épargne réglementée (Livret A et LDDS) mais aussi par les contrats et dépôts à terme. Ces produits d’épargne de court terme offrent actuellement des rémunérations qui sont, en règle générale, supérieures à celles des fonds euros de l’assurance vie.
Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte nette n’a été que de 3,1 milliards d’euros contre +12,7 milliards d’euros sur la même période en 2022. Lors de ces vingt dernières années, seules deux en ont enregistré de plus mauvais (2012 avec la crise des dettes souveraines : – 6 milliards d’euros de janvier à juillet ; 2020 avec l’épidémie de covid : -4 milliards d’euros de janvier à juillet). En juillet, jusqu’à maintenant, l’assurance vie connaissait des collectes nettes plutôt correctes. Une seule décollecte (en 2020 avec l’épidémie de covid) avait été constaté en dix ans (2013/2022).
Des prestations en hausse
Les cotisations brutes en assurance vie se sont élevées à 12,1 milliards d’euros en légère hausse de +1 % par rapport à juillet 2022. Elles sont néanmoins en baisse par rapport au moins de juin (15 milliards d’euros). La progression, en juillet, a été de 0,5 % pour les supports en euros de 1 % pour ceux en unités de compte. La part des unités de compte dans la collecte brute est de 37 %.
Au mois de juillet, les prestations s’établissent à 13,1 milliards d’euros, en hausse de +16 % par rapport à juillet 2022. Elles sont stables par rapport à juin. Cette augmentation souligne que des ménages sortent de l’argent de leur assurance vie afin de la réallouer sur d’autres placements.
La collecte nette est ainsi négative sur le mois, à −1,0 milliard d’euros. Elle demeure positive en UC, à +1,7 milliard d’euros.
Sur les sept premiers mois de l’année, les cotisations atteignent 93,7 milliards d’euros, en hausse de +4,6 milliards d’euros . Les prestations se sont élevées, sur la même période, à 90,6 milliards d’euros, en hausse de +14,2 milliards d’euros (soit +19 %) par rapport à la même période de 2022.
Poursuite de la décollecte nette pour les fonds euros
Au mois de juillet, la décollecte en fonds euros a atteint -2,7 milliards d’euros portant ce montant, sur les sept premiers mois de l’année, à 18 milliards d’euros. Les titulaires d’assurance vie continuent à s’alléger en fonds euros au profit des unités de compte ou d’autres produits de taux (épargne réglementée, dépôts à terme).
La collecte nette en unités compte a été de 1,7 milliards d’euros. De janvier à juillet, elle s’est élevée à 21,2 milliards d’euros.
Depuis le début de l’année, l’assurance vie est sauvée par les unités de compte qui permettent d’éviter une décollecte.
En attendant 2024…
Les Français privilégient toujours l’épargne de précaution qui leur garantit sécurité, liquidité et rendement. Ils se montrent ainsi pragmatiques en optant pour les placements les plus rémunérateurs et sans risque. Cette préférence pour le court terme s’explique également par la persistance des incertitudes économiques avec une inflation qui demeure élevée.
L’assurance vie est condamnée à attendre 2024 pour retrouver quelques couleurs. Concurrencée tout à la fois par le Livret A et les dépôts à terme, sur le segment des fonds euros, le premier produit d’épargne des ménages dont l’encours a atteint fin juillet 1919 milliards d’euros, connaît depuis le début de l’année une petite croissance émaillée de décollectes. Pour la première fois en plus de trente ans, le rendement des fonds euros de l’assurance vie est inférieure à celui de produits d’épargne de court terme et à l’inflation. Cette situation est imputable à l’inertie des fonds euros liée à la duration des obligations d’Etat qui constituent leur socle. Avec la hausse des taux d’intérêt entamée en 2022, une éclaircie devrait se profiler au début de l’année 2024 avec l’annonce des rendements des fonds euros qui seront en hausse et qui se rapprocheront du taux du Livret A. D’
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) trace toujours la route
L’assurance vie est à la peine depuis le début de l’année mais le Plan d4Epargne Retraite continue de progresser grâce à des transferts issus des anciens produits retraite et aux souscriptions réalisées par de nouveaux assurés. En juillet, les cotisations sur les PER assurantiels s’élèvent à 675 millions d’euros. 55 700 nouveaux assurés ont été enregistrés. Par ailleurs, 8 200 assurés ont transféré 219 millions d’euros d’anciens contrats d’assurance retraite vers un PER.
Depuis le début de l’année, les cotisations versées s’élèvent à 4,7 milliards d’euros pour 503 200 nouveaux assurés. La collecte nette des PER s’établit à +3,3 milliards d’euros.
Fin juillet 2023, 5,1 millions d’assurés détiennent un PER pour un encours de 67,7 milliards d’euros, dont 39 % correspondent à des UC.
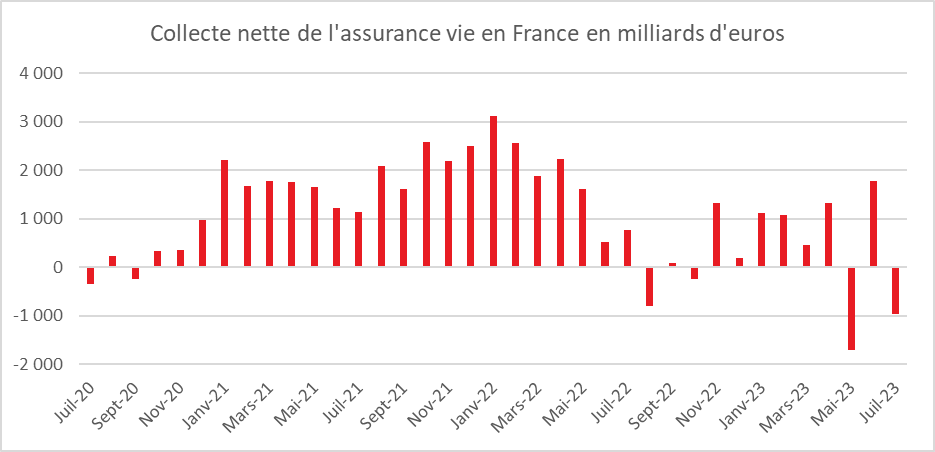
France Assureurs
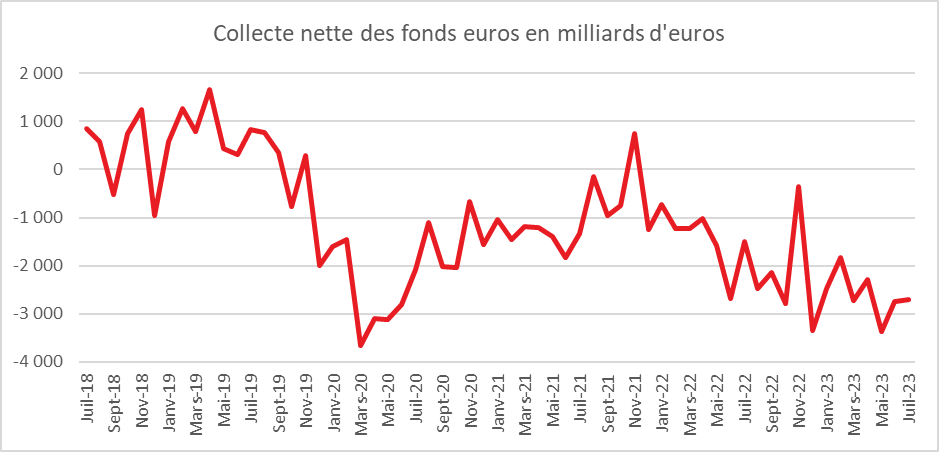
France Assureurs
Le Coin de L’Epargne du samedi 2 septembre 2023 : la malédiction de septembre
Au mois d’août, les indices « actions » ont sur toutes les grandes places financières abandonné du terrain. Le recul a été en moyenne de 2 %. Il a atteint plus de 5 % à Shanghai sur fond de crise immobilière. Les investisseurs commencent à craindre la stagflation, ce mélange corrosif d’inflation et de stagnation économique voire de récession.
Les investisseurs n’aiment pas le mois de septembre qui est traditionnellement le plus mauvais mois de l’année boursière. En 2022, septembre s’est clôturé sur une perte de plus de 9 % pour le S&P 500, le Cac 40 perdant de son côté près de 6 %. Depuis 1928, septembre s’est traduit, une fois sur deux, par un recul de l’indice S& P500. Mais, en jouant avec les statistiques, il s’avère que le mois de septembre est positif pour cet indice quand il a augmenté au cours du premier semestre de plus de 10 % ce qui est le cas cette année.
La malédiction du mois de septembre s’explique par la volonté des traders de réaliser leurs programmes de plus-values sur actions (ventes d’actions et sécurisation des gains). En septembre, les investisseurs commencent à avoir une vision assez fine des résultats des entreprises et une idée de l’année à venir. Ils sont ainsi amenés à effectuer des arbitrages. L’automne après la période estivale émolliente est la saison des prises de conscience et de corrections de trajectoires parfois brutales. Le contexte économique, en ce début de mois de septembre, est source de doutes avec des incertitudes sur la baisse de l’inflation et l’évolution de la croissance. La remontée du cours du pétrole est à nouveau un sujet d’inquiétude tout comme la résurgence du covid.
Le cours du pétrole (BRENT) s’est rapproché des 90 dollars malgré le ralentissement de l’économie mondiale. En trois mois, le baril s’est apprécié de 20 %. Ce rebond du cours du pétrole s’explique par la décision de l’OPEP + de restreindre sa production. Cette semaine, La Russie a avalisé une nouvelle diminution de ses exportations de pétrole, en lien avec ses partenaires de l’OPEP +.de 300 000 b/j en septembre. La décision de la Russie intervient après la prorogation d’un mois, jusqu’en octobre, de la réduction de la production de l’Arabie saoudite, à hauteur d’un million de barils par jour (b/j).
LVMH n’est plus la première capitalisation boursière européenne. Le groupe de luxe est devancé par l’entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk), spécialisée dans le traitement du diabète et dont le cours s’est accru de près de 40 % depuis le début de l’année.
Hausse du chômage aux Etats-Unis, vers un moratoire de la hausse des taux directeurs ?
Les créations d’emploi, aux Etats-Unis se sont élevées à 187 000 en août, soit plus que les 170 000 attendus par le consensus des économistes mais pour le troisième mois consécutif, elles ont été inférieures au seuil des 200 000. Par ailleurs, le nombre de créations de postes pour juillet a été révisé en baisse, à 157 000 contre 187 000 annoncé initialement. Parallèlement, le taux de chômage est en hausse à 3,8 % grâce en partie à une hausse de la participation quand le consensus tablait sur une stabilisation à 3,5 %. La croissance du salaire horaire moyen a ralenti plus que prévu sur un mois à 0,2 % contre 0,3% anticipé. Sur un an, elle revient de 4,4 % à 4,3 %. Ces résultats constituent une bonne nouvelle pour la FED. Sa politique de relèvement des taux directeurs commencent à porter ses fruits. La probabilité que l’institution monétaire américaine fasse une pause lors de sa prochaine réunion n’a jamais été aussi élevée. De plus en plus d’économistes estiment que les taux ont atteint un sommet et qu’une baisse pourrait intervenir au cours du premier semestre de l’année 2024. Néanmoins, certains pensent qu’une hausse est encore possible d’ici la fin de l’année.
.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 1er sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 296,77 | +0,93 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 837,71 | +1,28 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 515,77 | +2,29 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 14 031,81 | +3,13% | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 840,34 | +1,33 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 464,54 | +1,83 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 282,64 | +1,10 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 710,62 | +3,44 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 133,25 | +1,82 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,055 % | -0,032 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,532 % | -0,027 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,177 % | -0,074pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0846 | +0,45 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 938,10 | +1,35 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 88,39 | +3,89 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Croissance des dividendes pour les actionnaires
En matière d’actions, ce qui compte c’est non seulement le cours mais aussi – voire surtout – le dividende. Leur montant dépend des résultats des entreprises et de la politique de distribution décidée par le Conseil d’administration.
Au deuxième trimestre, les grandes entreprises mondiales ont versé l’équivalent de 568 milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires, d’après le gestionnaire d’actifs Janus Henderson. Ces dividendes sont en hausse de 5 % sur un an. En France, les dividendes ont progressé toujours sur un an de 13,3 %. Au niveau de la zone euro, la hausse est de 10 % en moyenne. Au premier trimestre 2023, les versements étaient déjà en hausse de 12 % sur un an, à 327 milliards de dollars.
En France, les versements ont atteint 49,6 milliards d’euros. Parmi les entreprises ayant versé les plus importants dividendes figurent BNP Paribas, Sanofi, AXA, LVMH et Engie. Au niveau mondial, les groupes Nestlé, HSBC et Mercedes ont distribué les dividendes les plus élevés. Les banques ont été à l’origine des dividendes les plus importants (85 milliards de dollars au deuxième trimestre), suivies par les compagnies d’assurances(37 milliards de dollars) et les producteurs de pétrole (36 milliards de dollars).
Au deuxième trimestre 2023, la zone euro a été à l’origine de 37 % des versements de dividendes contre 33 % pour les États-Unis. Ce résultat doit être relativiser car en Europe, les dividendes sont souvent versés en une seule fois quand, aux États-Unis, ils peuvent donner lieu à plusieurs versements. Sur l’ensemble de l’année 2022, les États-Unis arrivaient en tête pour les versements. En Europe, les entreprises espagnoles ont accru leurs versements de dividendes de 29 % entre avril et juin par rapport à 2022. La hausse est de 9 % en Allemagne, et de près de 19 % en Italie.
En 2022, les dividendes à l’échelle mondiale avaient atteint 1 560 milliards de dollars. Ils étaient en progression de 8,4 % par rapport à 2021. L’année 2023, après un premier semestre exceptionnel, devrait néanmoins enregistrer une moindre progression en raison du tassement de la croissance. Les résultats du premier semestre étaient la traduction de l’activité de 2022 qui était encore en hausse. L’année dernière, les entreprises du CAC 40 ont dégagé plus de 142 milliards d’euros de bénéfices.
Poursuite de l’augmentation de la rémunération des dépôts bancaires
Selon la Banque de France, la rémunération moyenne des dépôts bancaires a, en juillet, continué sa progression à 1,57 %, après 1,53 % en juin. Le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages atteint 1,72 % ; il est quasi stable par rapport à juin (1,71 %). Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés était de 0,71 %. La rémunération des dépôts des SNF progresse de 10 points de base à 1,43 %, portée notamment par la remontée des taux des comptes à terme.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| juil-2023 (g) | juil-2022 | mai- 2023 | juin-2023 (f) | juil-2023 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 111 | 0,48 | 1,48 | 1,53 | 1,57 |
| dont Ménages | 1 867 | 0,77 | 1,68 | 1,71 | 1,72 |
| – dépôts à vue | 591 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 52 | 0,42 | 2,81 | 2,97 | 3,04 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 70 | 0,70 | 1,29 | 1,37 | 1,47 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 639 | 1,07 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| dont : livret A | 369 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| – livrets ordinaires | 251 | 0,09 | 0,64 | 0,68 | 0,71 |
| – plan d’épargne-logement | 264 | 2,57 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| dont SNF | 860 | 0,11 | 1,20 | 1,33 | 1,43 |
| – dépôts à vue | 566 | 0,05 | 0,45 | 0,48 | 0,52 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 237 | 0,14 | 2,89 | 3,11 | 3,25 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 57 | 0,69 | 2,34 | 2,59 | 2,83 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
| Euribor 3 mois (d) | 0,04 | 3,37 | 3,54 | 3,67 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 1,14 | 2,69 | 2,79 | 2,93 | |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
La réforme des retraites version 2023 entre en vigueur le 1er septembre
La réforme des retraites entre en vigueur le 1er septembre
La réforme des retraites, adoptée au printemps, entre en vigueur à compter du 1er septembre. L’âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé de 62 ans aujourd’hui à 64 ans en 2030, à raison de trois mois par an. Les actifs nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 sont les premiers concernés. L’âge légal sera de 64 ans pour la génération 1968. Par ailleurs, le passage de la durée de cotisation de 42 à 43 ans est accéléré. Cette mesure sera effective dès la génération 1965 quand initialement elle ne devait s’appliquer totalement qu’à partir de la génération 1973.À compter du 1er septembre, les nouveaux salariés des entreprises bénéficiant d’un régime spécial de retraite ne pourront plus y prétendre, seuls les anciens continueront à en bénéficier.
La retraite minimale sera revalorisée pour être portée à 848 euros brut pour une carrière complète. Le dispositif «carrières longues» sera désormais ouvert, sous conditions, aux assurés qui ont démarré dans la vie active avant 21 ans (contre 20 ans auparavant). Ce dispositif comportera dorénavant quatre bornes d’âge d’entrée. Pour atténuer les effets négatifs de la réforme pour les mères de famille, une surcote a été instituée pour certaines d’entre elles. Le dispositif de retraite progressive est étendu au 1er septembre aux fonctionnaires, aux professionnels libéraux et aux avocats. Son recours sera facilité. Dorénavant, les cotisations retraite versées par les actifs en situation de cumul emploi-retraite ouvriront droit à pension comme cela était le cas avant 2015.
Forte hausse du taux d’épargne au deuxième trimestre en France
Au deuxième trimestre, le taux d’épargne des ménages a atteint 18,8 % du revenu disponible brut en hausse de 0,6 point par rapport au taux du premier trimestre (18,2 %). Cette augmentation du taux d’épargne traduit le niveau élevé d’inquiétude des ménages face à la vague inflationniste. Les Français, en moyenne, n’ont pas touché à la cagnotte qu’ils ont constitué depuis le début de la crise sanitaire en 2020.
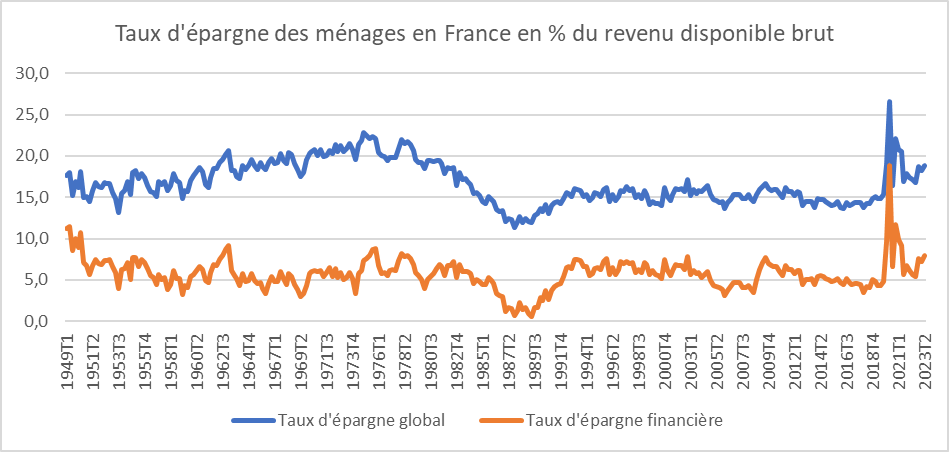
INSEE
La hausse du taux d’épargne est rendue possible par la résistance du pouvoir d’achat des ménages face à la hausse des prix. Au deuxième trimestre, il a augmenté de 0,1 % faisant suite au repli de 0,6 % du premier trimestre. Cette évolution du pouvoir d’achat s’explique par la hausse des salaires et par la légère décrue de l’inflation. Comme dans le même temps, les dépenses de consommation se sont repliés de 0,5 %, la part des revenus consacrée à l’épargne a augmenté de 0,6 point.
Les ménages continuent de privilégier l’épargne de précaution et en particulier les produits réglementés comme le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire(LDDS) ainsi que le Livret d’Epargne Populaire (LEP). Ces produits offrent une rémunération jugée attractive même si elle ne compense pas totalement l’inflation (à l’exception de celle du LEP). Ces produits répondent en matière de sécurité, liquidité et fiscalité aux attentes des Français. Il convient également de souligner que les ménages se tournent de plus en plus vers les dépôts à terme qui ne sont pas soumis à des règles de plafonds et qui offrent des rendements de plus en plus élevés.
Cette préférence pour l’épargne de court s’effectue au détriment des produits de longs termes comme les fonds euros de l’assurance vie ou le Plan d’Epargne Logement.
Au cours du second semestre, une baisse du taux d’épargne devrait intervenir en lien avec une reprise de la consommation attendue avec les vacances, la rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année. Par ailleurs, la décrue de l’inflation, sous réserve qu’elle se confirme pourrait améliorer le moral des ménages et les conduire à consommer davantage.
L’inflation toujours présente
Sur un an, selon l’estimation provisoire de l’INSEE, réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 4,8 % en août 2023, après +4,3 % le mois précédent. Cette hausse de l’inflation s’explique par la remontée des prix du pétrole. Les prix de l’alimentation seraient en baisse pour le cinquième mois consécutif, ainsi que, dans une moindre mesure, ceux des produits manufacturés et des services.
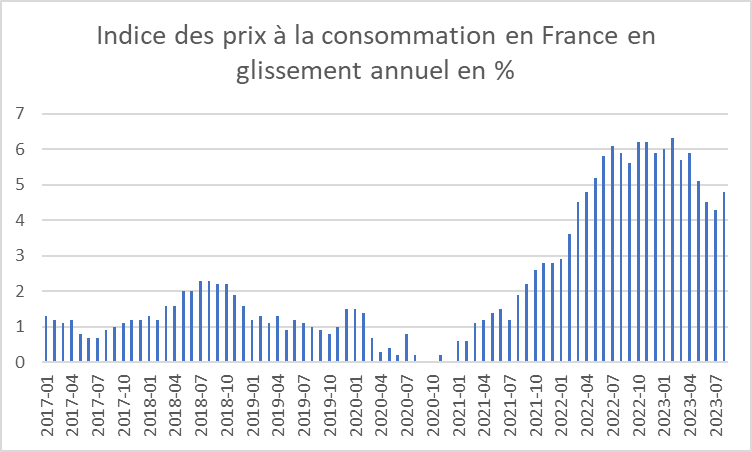
INSEE
Sur un mois, les prix à la consommation seraient en hausse de 1,0 % en août, après +0,1 % en juillet. Les prix de l’énergie contribuerait en grande partie à cette augmentation avec en particulier la hausse des prix des produits pétroliers et des tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er août 2023. Les prix des produits manufacturés seraient également orientés à la hausse avec la fin des soldes d’été. Les prix des produits frais augmenteraient quand ceux de l’alimentation hors frais ralentiraient. Les prix des services ralentiraient aussi, du fait notamment du repli des prix des services de transport et de la décélération des prix des « autres services ».
Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 5,7 % en août, contre +5,1 % en juillet. Sur un mois, il croîtrait de 1,1 %, après avoir été stable en juillet.
La bataille de l’inflation n’est pas terminée. L’augmentation des prix de l’énergie pourrait conduire à un petit rebond obligeant la Banque Centrale à poursuivre sa politique de relèvement des taux directeurs dans les prochains mois avec comme écueil un risque de récession avéré au sein de la zone euro.
Taux d’usure applicable à compter du 1er septembre
De manière dérogatoire, les taux d’usure sont fixés de manière mensuelle. Ceux en vigueur à compter du 1er septembre sont les suivants :
| Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er septembre 2023 | Taux d’usure applicable au 1er septembre 2023 |
| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 16,21 | 21,61 |
| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 9,01 | 12,01 |
| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 5,14 | 6,85 |
| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,17 | 4,23 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,96 | 5,28 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,17 | 5,56 |
| Prêts à taux variable | 3,85 | 5,13 |
| Prêts relais | 4,15 | 5,53 |
| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 4,72 | 6,29 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,68 | 6,24 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,75 | 6,33 |
| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 5,69 | 7,59 |
| Découverts en compte | 13,19 | 17,59 |
| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,01 | 6,68 |
| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Découverts en compte (4) | – | – |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.
(4) Le taux d’usure des découverts en compte des personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale reste fixé sur une base trimestrielle. Sa valeur de 17.33 % au 1er juillet 2023 reste inchangée jusqu’au 1er octobre 2023.
Le Coin des Epargnants du 26 août 2023 : la lutte contre l’inflation continue
Inflation et croissance, le dilemme des banquiers centraux
Lors du symposium de Jackson Hole qui se tient chaque année à la fin du mois d’août aux Etats-Unis et réunit les banquiers centraux, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a confirmé que la politique monétaire restera restrictive jusqu’à ce que l’inflation décélère de manière significative. Il a souligné que la banque centrale était prête à augmenter ses taux directeurs une nouvelle fois, mais les décisions seront prises avec la plus grande « précaution ». La Réserve fédérale américaine pourrait être contrainte de relever davantage que prévu les taux d’intérêt pour s’assurer que l’inflation est contenue, a-t-il ainsi déclaré. L’objectif de la FED reste de faire revenir l’inflation à 2 %. Jerome Powell reste prudent par rapport aux bons résultats de ces deux derniers mois. La Présidente de la BCE doit faire face à une situation plus complexe que celle de son homologue américain. La croissance de la zone euro s’étiole de mois en mois, faisant craindre une récession. Or, si l’inflation baisse, elle demeure élevée. Par ailleurs, la diminution constatée depuis deux mois est avant tout liée à un effet base. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) reste éloignée de la cible des 2 % et tarde à diminuer. La BCE souhaite sans nul doute marquer sa résolution à casser les anticipations inflationnistes en relevant au moins encore une fois ses taux directeurs. Elle devra le faire rapidement afin de ne pas se placer sous la pression des gouvernements en cas d’installation de la récession. Cela pourrait conduire à une nouvelle hausse en septembre quand, il y a quelques temps, l’idée d’une pause avait été émise.
Dans ce contexte, les investisseurs ont, durant la semaine, opté pour la prudence intégrant de plus en plus de nouveaux relèvements des taux directeurs afin de lutter contre l’inflation. Les indices boursiers ont légèrement augmenté les cinq derniers jours. Le CAC40 a gagné 0,89 % et le S&P 500, 0,87 %. Le baril de pétrole Brent est resté stable autour de 84 dollars, les signes de ralentissement de l’activité au niveau mondial s’étant multipliés. Les taux d’intérêt des obligations d’Etat à 10 ans se sont légèrement détendus en Europe.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 25 août 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 229,60 | +0,89 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 346,90 | -0,55 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 405,71 | +0,87 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 14 941,83 | +1,72% | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 631,82 | +0,52 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 338,58 | +0,94 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 236,25 | +0,44 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 31 624,28 | +2,66 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 064,07 | -1,59 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,087 % | -0,070 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,559 % | -0,054 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,251 % | +0,018pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0792 | -1,04 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 908,35 | +1,02 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84,09 | -0,70 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Livret A : résultats du mois de juillet 2023, pas de trêve estivale
Le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire ont enregistré, en juillet, un nouveau mois de forte collecte, avec 3,13 milliards d’euros portant le total, depuis le début de l’année, à 37,67 milliards d’euros. L’encours de ces deux produits s’élevait ainsi, à fin juillet, à 547,4 milliards d’euros.
Le Livret A toujours la course en tête
Au mois de juillet, malgré l’absence d’annonce de revalorisation de son taux de rémunération, le Livret A continue sur la lancée du premier semestre avec une collecte de 2,16 milliards d’euros. Celle-ci fait suite à celles des mois de juin (1,34 milliard d’euros), de mai (2,47 milliards d’euros) et d’avril (2,33 milliards d’euros) qui avaient été exceptionnelles. Cette collecte est proche de celle du mois de juillet 2022, 2,64 milliards d’euros. La collecte du mois de juillet 2023 est supérieure à la moyenne de ces dix dernières années. Toujours sur cette même période, seules deux décollectes, en 2014 et 2015, ont été enregistrées.
Pour les sept premiers mois de l’année, la collecte du Livret A atteint 28 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. L’encours de son côté s’élevait, fin juillet, à 403,4 milliards d’euros, également record à battre.
Le Livret de Développement Durable Solidaire toujours dans les traces de son aîné
La collecte du mois de juillet 2023 du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a été de 0,97 milliard d’euros, contre 0,83 en juin et 1,05 milliard d’euros en mai Elle s’était élevée à 0,48 milliard d’euros en juillet 2022. Sur les sept premiers mois de l’année, le LDDS a enregistré un flux net de 9,67 milliards d’euros portant son encours à 144 milliards d’euros.
Une propension à l’épargne de précaution affirmée
Malgré la décision de non-revalorisation du taux pendant 18 mois, les ménages ne modifient pas leur comportement. Ils privilégient l’épargne de précaution en puisant notamment sur leurs comptes courants dont l’encours est en forte baisse depuis le mois de septembre dernier. Ils effectuent également des arbitrages au détriment des livrets fiscalisés qui sont faiblement rémunérés. Le Livret A et le LDDS sont, en revanche, concurrencés par les dépôts et compte à terme qui peuvent offrir des rendements attractifs et qui ne sont pas soumis à des plafonds de versement. Les dépôts à terme deviennent la solution de placements pour les ménages ayant saturé leurs livrets A et leurs LDDS.
Vers une année record
Les ménages, au cœur de l’été, ont à loisirs de maintenir un taux d’épargne élevé. Ils privilégient toujours l’épargne à la consommation. La collecte se devrait se modérer durant l’automne avec l’augmentation traditionnelle des dépenses. Elle battra néanmoins, en 2023, battre des records. A la différence des Américains mais à l’instar des Allemands, les Français sont en mode fourmis par crainte d’une dégradation de la situation économique ou par simple effet du vieillissement démographique.
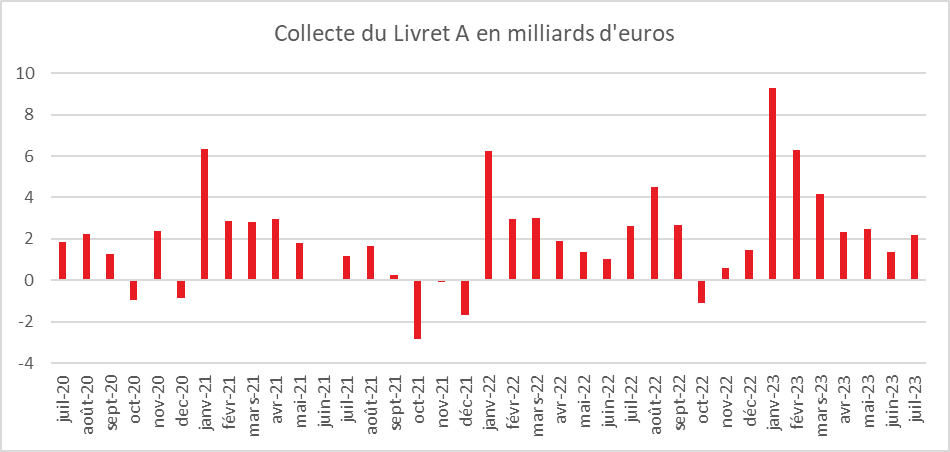
Cercle de l’Epargne – CDC
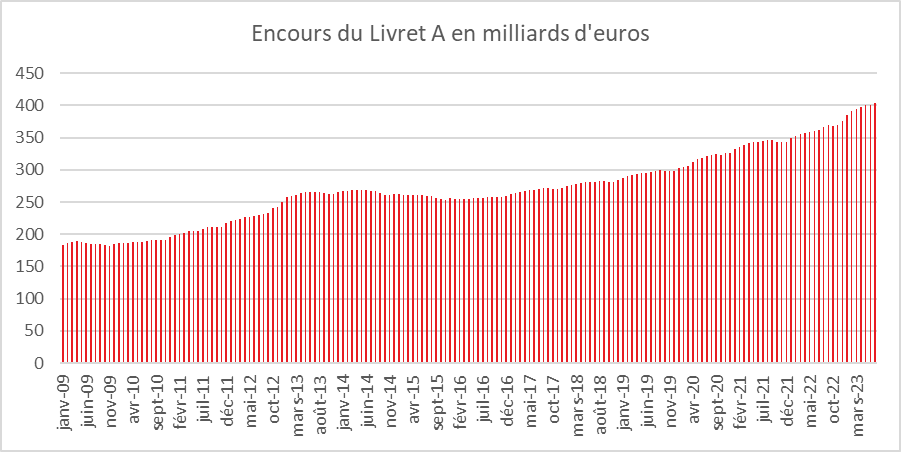
Cercle de l’Epargne – CDC
Le Coin des Epargnants du 19 août 2023 : quand la Chine se rappelle à notre mémoire
Les marchés au creux de la vague
Avec l’aggravation de la crise immobilière en Chine et la montée de nombreux doutes sur l’évolution de la vague inflationniste de part et d’autre de l’Atlantique, les indices boursiers ont été en baisse cette semaine. Le CAC40 a ainsi perdu plus de 2 % et le Dow Jones près de 3 %.
La Chine semble s’enfoncer jour après jour dans la crise. En juillet, les ventes au détail et la production industrielle ont connu des progressions inférieures aux attentes. Les premières, qui constituent un baromètre assez fin de la consommation des ménages, n’ont augmenté que de 2,5 % sur un an le mois dernier. Le consensus Bloomberg visait une accélération à 3,6 % après les 3,1 % de juin. Les Chinois restent frileux en matière de consommation en raison de la crise immobilière qui les incite à épargner. La décision de Pékin d’abaisser le taux de ses prêts à un an n’a pas eu d’effets réels sur les marchés. La production industrielle a été plus faible que prévue le mois dernier, en hausse simplement de 3,7 % sur un an, contre 4,4 % en juin et 4 % attendu par les économistes.
Les taux américains d’intérêt ont augmenté cette semaine sur le marché secondaire de la dette. Celui du papier à dix ans a frôlé son plus haut niveau depuis 2007 jeudi, à plus de 4,2 %, et celui à 30 ans a inscrit un pic depuis 2011, à 4,426 %. Les minutes de la Fed, publiées mercredi en début de soirée, ont révélé que la banque centrale est toujours préoccupée par les niveaux de l’inflation et estime que de nouvelles hausses de taux seront peut-être nécessaires. Les membres du comité monétaire (FOMC) se montrent très divisés. Si une pause est probable pour la réunion de septembre, une ou deux augmentations sont possibles durant l’automne. Parmi les bonnes nouvelles aux Etats-Unis, il faut souligner le résultat de la production industrielle. Cette dernière a augmenté plus que prévu en juillet (+1 % contre +0,3 % anticipé et après un recul de 0,8 % le mois précédent). Pour la zone euro, l’évolution de l’inflation demeure incertaine. Si le taux d’inflation est passé de 5,5 à 5,3 % sur un an de juin à juillet, l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) est restée stable d’un moins sur l’autre à 5,5 %.
Une forte hausse des taux d’intérêt en Russie
En Russie, le mardi 15 août dernier, la banque centrale a été contrainte de relever son taux directeur de 8,5 à 12 % afin d’arrêter la dépréciation du rouble. Lundi 14 août, un dollar s’échangeait conte 100 roubles, contre moins de 80 avant la guerre en Ukraine. L’augmentation du taux directeur a permis une appréciation de 7 % du rouble face au dollar. La décision de relever les taux directeurs vise avant tout à empêcher le retour de l’inflation. Après avoir atteint 14 % en 2022, l’inflation était en recul depuis le début de l’année avant de connaître une nouvelle augmentation à compter de l’été. Les sanctions internationales et le plein emploi génèrent un accroissement des prix. L’objectifs des pouvoirs publics est de maintenir l’inflation en dessous de 6 % afin de limiter les tensions sociales au sein de la population. Les autorités russes sont contraintes de puiser dans leurs fonds souverains afin de financer l’effort de guerre et les prestations sociales. Si le déficit public demeure limité, autour de deux points de PIB, en revanche, les ponctions sur les fonds s’accélèrent. Par ailleurs, les recettes d’exportations tendent à se réduire ce qui pèse sur les finances publiques et la croissance.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 18 août 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 164,11 | -2,79 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 500.66 | -2,99 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 369,71 | -1,92 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 290,78 | -2,59% | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 574,26 | -1,59 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 262,43 | -3,42 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 212,95 | -3,02 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 31 450,76 | -1,90 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 131,95 | -1,89 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,157 % | +0,010 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,613 % | -0,005 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,233 % | +0,083pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0875 | -0,85 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 890,80 | -1,08 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84,27 | -2,52 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
La France, un pays de millionnaires ?
Selon le rapport sur la richesse mondiale de Crédit Suisse et UBS, La France se classe à la troisième place au nveau mondial, derrière les États-Unis et la Chine et devant le Japon pour le nombre de millionnaires. Selon cette étude, près de 1 Français sur 20 serait millionnaire, soit trois millions de personnes. Si dans la grande majorité des pays, le nombre de millionnaires a baissé en 2022, il a augmenté en France. Le patrimoine des ménages français est avant tout de nature immobilière quand chez ses partenaires le poids des actifs financiers y est plus important. La valeur de ces derniers ayant diminué quand celle de l’immobilier a continué à augmenter, il en résulte que les Français ont enregistré une valorisation de leur patrimoine supérieure à celle de leurs voisins.
Selon l’INSEE, les 10 % des ménages les mieux dotés ont un patrimoine brut supérieur à 607 700 euros. Ceux qui détiennent plus d’un million d’euros constituent une sous-partie de cet ensemble. Selon une étude de l’INSEE de 2021 (fondée sur des chiffres de 2018), seuls 3 % des ménages ont un patrimoine brut dépassant le million d’euros. Ces 3 % détiennent près d’un quart du patrimoine national. Pour deux tiers d’entre eux, les actifs immobiliers représentent plus de la moitié de leur fortune. Les 1 % les mieux dotés ont un patrimoine brut supérieur à 2 millions d’euros. Il atteint, en moyenne, 4,3 millions d’euros. Ces ménages possèdent 16 % du patrimoine national. La structure patrimoniale des 1 % des plus riches diffère de celle des autres millionnaires avec un poids plus important des actifs financiers. Ces derniers représentent 34 % de leur patrimoine, contre 30 % pour les actifs immobiliers et 28 % pour les actifs professionnels. Pour les 10 % des ménages les mieux dotés, le poids des actifs financiers n’est que de 16 %.
27 % des ménages les mieux dotés en patrimoine sont des travailleurs indépendants ; 14 % sont des commerçants et chefs d’entreprise, 8 % sont des professions intermédiaires et 6 % sont des agriculteurs. 39 % sont retraités.
La région francilienne ne représente que 19 % de population nationale mais 43 % des personnes à très haut revenu (les 1 % des plus riches) et 54 % des très aisées (les 0,1 % des plus riches). Paris possède 20 % des très hauts revenus français et les Hauts-de-Seine 10 %.
La forte valorisation des prix de l’immobilier au sein des grandes agglomérations explique la progression des millionnaires. Les prix des logements ont, en effet, doublé en vingt ans.
Le Coin des Epargnants du 12 août 2023 : quand le pétrole se rappelle à notre bon souvenir
La bataille contre l’inflation n’est pas terminée
En pleine période estivale, le pétrole s’est rappelé au bon souvenir des consommateurs et des investisseurs. La politique de réduction de l’offre décidée par l’Arabie saoudite porte ses fruits, le baril de Brent s’échangeant, cette semaine, à plus de 85 dollars. Le baril a gagné en un mois près de 10 %.
L’Arabie saoudite a annoncé, le jeudi 3 août dernier une prolongation de la baisse de sa production d’un million de barils par jour instituée en juillet. Cette opération est coordonnée avec la Russie qui a décidé de diminuer sa production de 300 000 barils par jour. Regroupées depuis 2016 au sein de l’OPEP+, représentant 40 % de l’offre mondiale, l’Arabie saoudite et la Russie, entendent maintenir des prix élevés dans un contexte de recul de la croissance qui naturellement pèse sur les cours. Saudi Aramco a, en juillet, limité sa production quotidienne à 9,05 millions de barils, soit trois millions de moins que son niveau de croisière. La Russie a stabilisé, de son côté, sa production à 9,4 millions de barils. L’objectif de l’Arabie saoudite est un cours du pétrole de plus de 80 dollars afin de financer son plan de transformation de son économie, plan « Vision 2030 » qui vise à préparer le pays à l’après pétrole. La Russie a besoin d’un pétrole élevé pour financer son effort de guerre. Logiquement, le pays ne peut pas exporter au-dessus de 60 dollars le baril mais il arrive à contourner cette règle tout en étant contraint d’effectuer des ristournes aux importateurs comme la Chine ou l’Inde.
La réduction de l’offre de la part de l’OPEP+ ne se fait pas complètement ressentir sur les prix en raison du ralentissement de l’économie mondiale et en particulier de la Chine. Avec une croissance plus élevée, l’OPEP+ espère une reprise de la demande en 2024. La consommation pourrait atteindre alors102 millions de barils jour. La hausse des cours actuels est due à une baisse des stocks. Ces derniers pourraient diminuer de 2,2 millions de barils par jour au troisième trimestre et de 1,2 million au quatrième.
Cette hausse du cours du pétrole n’a pas complètement occulté les bonnes nouvelles sur le terrain de l’inflation en provenance des Etats-Unis. Les prix à la consommation y ont augmenté de 3,2 % en juillet, soit moins que les 3,3 % attendus par le consensus. Hors éléments volatils que sont l’énergie et l’alimentation, l’inflation s’est élevée à 4,7 %, en recul parrapport aux 4,8 % de juin. L’autre bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis provient de la série d’émissions obligataires, d’un montant de 103 milliards de dollars en trois jours de la part du Trésor. Les émissions à 10 ans se sont réalisés en dessous des 4 % témoignant de la confiance des investisseurs dans le recul de l’inflation. En revanche, les prix à la production progressé aux Etats-Unis de 0,3 % sur un mois en juillet, contre 0,1% en juin et 0,2% espéré. La Chine de son côté a poursuivi sa politique de libéralisation des voyages en groupe vers plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Corée du Sud et le Japon ce qui conduit à une nouvelle hausse des cours du secteur du luxe (LVMH et Hermès) et de celles des compagnies aériennes ou du secteur de l’hôtellerie.
Dans ce contexte, les indices boursiers ont été cette semaine, étales, le CAC 40 gagnant 0,5 % quand le Daxx allemand a perdu 0,6 % et S&P500, 0,31 %.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 11 août 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 338,40 | +0,51 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 35 281.40 | +0,70 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 464.05 | -0,31 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 644.85 | -1,90% | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 832,17 | -0,78 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 523,01 | -0,47 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 320,75 | -0,39 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 473,65 | -0,87 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 189,25 | -3,01 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,147 % | +0,061 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,618 % | +0,090 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,150 % | +0,071pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1.0959 | -0,51 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 915,60 | -1,16 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 87,00 | +1,10 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Epargne, les ménages continuent à plébisciter les produits réglementés
Le patrimoine financier des ménages s’est rapproché, selon la Banque de France, à la fin du premier trimestre des 6000 milliards d’euros (5956,4) en hausse de 170,7 miliars d’euros grâce à 21,6 milliards d’euros de flux (13 % de la hausse) et à l’augmentation de la valeur des produits de fonds propres (87 % de la hausse). La barre des 6000 milliards d’euros de patrimoine financier avait brièvement dépassé à la fin de l’année 2020 marquée par un taux record d’épargne en lien avec le covid.
Plus de 900 milliards d’euros pour l’épargne réglementée
L’encours de l’épargne réglementée est désormais supérieur à 900 milliards d’euros (902,6 milliards d’euros au premier trimestre 2023), soit 2,5 fois plus que l’encours des actions cotées détenues par les ménages ou 2 fois plus que les unités de comptes des contrats d’assurance vie et d’épargne retraite. Les fonds euros représentent toujours l’encours le plus important en matière d’épargne financière (1478 milliards d’euros) mais sont en décollecte. Au premier trimestre comme au deuxième, les dépôts à terme ont fortement progressé.
Des flux d’épargne en baisse mais une réallocation en cours
Au premier trimestre, les ménages ont puisé dans leurs comptes courants non pas pour consommer mais pour augmenter leur épargne placée sur les produits réglementés et les dépôts à terme. Le flux trimestriel net de placements des ménages s’est élevé, selon la Banque de France, à 21,6 milliards d’euros, en baisse de 5,2 milliards par rapport au trimestre précédent. L’épargne investie en produits de taux a diminué de 10,6 milliards après 15,0 milliards d’euros au quatrième trimestre, en raison d’un flux négatif sur les dépôts à vue (-18,5 milliards contre -14,1 milliards d’euros au quatrième trimestre), et d’une décollecte sur l’assurance-vie en euros (-5,5 milliards d’euros), contrebalancés par un renforcement des placements en épargne réglementée (24,9 milliards d’euros) et en dépôts à terme. Les acquisitions nettes d’actifs sous forme de produits de fonds propres se replient mais dans une moindre mesure (11,7 milliards d’euros contre 14,2 milliards au quatrième trimestre) compte tenu du dynamisme de la collecte en assurance-vie en unités de compte.
Les premières données recueillies par la Banque de France pour le deuxième trimestre 2023 témoignent de la poursuite de la réallocation d’une partie des dépôts à vue (-11,6 milliards d’euros) vers les dépôts rémunérés (+23,5 milliards d’euros). Les flux sont toutefois moins forts que les deux trimestres précédents. Le flux net demeure négatif sur les contrats d’assurance-vie en euros (-3,2 milliards d’euros). Le faible rendement des fonds euros par rapport à celui de l’épargne réglementée explique cette évolution.
Près de 150 milliards d’euros de flux annuel pour l’épargne financière
En cumul sur quatre trimestres glissants, le flux net de placements financiers des ménages s’établit à 146,2 milliards au premier trimestre, en diminution par rapport au trimestre précédent mais il demeure toujours au-dessus du niveau d’avant pandémie (100 milliards en 2019).
Au premier trimestre 2023, le taux d’épargne financière diminue légèrement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, mais progresse en Espagne, tout en restant à un bas niveau. Il est négatif en Italie pour le deuxième trimestre consécutif. Pour la zone euro, il s’établit à 3,3 %, en légère diminution de 0,1 point, tandis qu’il progresse aux États-Unis tout en restant à un faible (1,8 %).
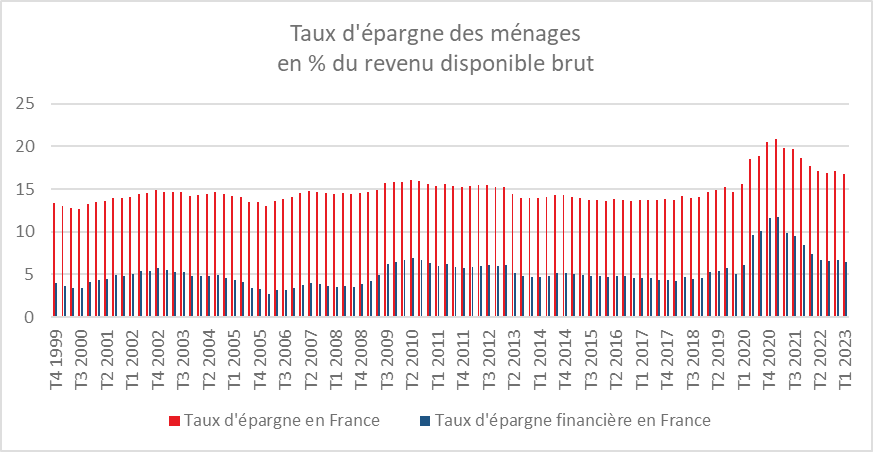
Banque de France
Sortie en capital pour les petits produits d’épargne retraite
Par l’arrêté du 17 juillet 2023 portant soutien au pouvoir d’achat des épargnants bénéficiaires de rentes inférieures à un certain montant minimal, le gouvernement a modifié les règles de sortie en capital des petits plans d’épargne retraite, mesure qui concerne notamment les anciens produits.
Depuis l’adoption de la loi PACTE et l’introduction du Plan d’Epargne Retraite (PER), les sorties en capital se sont généralisées. Néanmoins, les sorties en rente demeurent de mise pour les PERP, les contrats Madelin, les article 83 ou le compartiment 3 du PER (PER obligatoire d’entreprise). Pour ces produits, une sortie en capital est néanmoins possible quand les arrérages annuels sont inférieurs, en vertu de l’arrêté du 7 juin 2021, à 1 200 euros. L’arrêté du 17 juillet porte ce plafond à 1 320 euros par an ce qui qui correspond à un capital d’environ 32 000 euros pour une liquidation à l’âge de 64 ans. Il est possible d’augmenter ce montant en optant, par exemple, pour une réversion ou des annuités garanties, avant de liquider sa retraite. La fiscalité en cas de sortie en capital dans le cadre de ce mécanisme est particulièrement intéressant. Le capital, intérêts compris, est imposé à un prélèvement forfaitaire sur option à 7,50 % après un abattement de 10 % non plafonné. Ce montant est également soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 10,10 %. Ces taux sont inférieurs à ceux d’une sortie en capital dans le cadre du PER. Pour ce produit, la part du retrait issue des versements est soumise au barème de l’impôt sur le revenu mais est exonérée de prélèvements sociaux. La valorisation du contrat est assujettie au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU de 30 % : 12,8 % d’imposition + 17,2 % de prélèvements sociaux).
Pour les produits visés par l’arrêté du 17 juillet, la sortie en capital peut se faire non seulement au moment de la liquidation du contrat mais aussi lorsque les rentes sont en cours de versement. Plus de 70 000 personnes sont potentiellement concernées. Plus de la moitié des contrats existant sur le marché en phase de liquidation génèreraient, en effet, une rente annuelle inférieure à 1 320 euros. L’arrêté du 17 juillet contribue à harmoniser les régimes des différents produits d’épargne retraite et permet aux épargnants de choisir leur mode de sortie
Le Coin des Epargnants du 5 août 2023 : une trêve agitée
Une semaine de hauts et de bas
Le cours des actions a pâti de la dégradation par Fitch de la note de la dette souveraine américaine intervenue cette semaine. Les moindres créations d’emploi aux Etats-Unis en juillet ont permis un rebond des cours vendredi. Selon le Bureau des statistiques du travail, la première économie mondiale a, en effet, créé moins de postes qu’anticipé par les économistes dans le secteur non agricole en juillet : 187 000, contre 185.000 en juin. Le consensus avait parié sur 200 000 créations. Le taux de chômage aux Etats-Unis est en baisse à 3,5 %, contre 3,6 % en juin, revenant ainsi à son niveau le plus bas depuis 50 ans. Ce taux est inférieur à la dernière estimation médiane de la Fed, de 4,1 % pour le quatrième trimestre de cette année. Les salaires ont continué à augmenter à un rythme soutenu avec un gain de 0,4 % en juillet comme en juin, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,3 %. Il affiche sur un an une progression de 4,4 %.
Les indices européens ont perdu en moyenne plus de 2 % durant la semaine. Cette semaine, les taux des obligations d’Etat ont poursuivi leur hausse, le taux de l’OAT à 10 ans repassant au-dessus des 3 % quand celui de son homologue américain dépassait les 4 %. Le cours du pétrole demeure élevé avec la prorogation de la réduction de la production saoudienne d’un million de baril/jour et de la forte réduction des stocks américains.
Fitch dégrade les États-Unis
Mardi 1er août, l’agence de notation financière Fitch a annoncé la dégradation de la note de crédit des États-Unis. Celle-ci passe de AAA à AA +, seule la perspective restant « stable ». « Les impasses politiques répétées sur le plafond de la dette et les résolutions de dernière minute ont érodé la confiance dans la gestion budgétaire », a mentionné l’agence Fitch Ratings pour justifier la baisse de la note. Elle a ajouté que « le gouvernement ne dispose pas d’un cadre budgétaire à moyen terme, contrairement à la plupart de ses pairs, et son processus budgétaire est complexe ». L’administration américaine a réagi immédiatement à cette décision en soulignant que les fondamentaux de l’économie étaient bien orientés avec une croissance plus forte que dans les autres pays de l’OCDE.
Le déficit budgétaire devrait atteindre 6,3 % du PIB cette année, contre 3,7 % l’an dernier en raison du plan en faveur de la transition énergétique. L’augmentation des taux d’intérêt devrait peser sur les comptes publics. La dernière dégradation de la note américaine date de 2011 après la crise des subprimes quand l’agence S&P avait privé le pays de son triple A, abaissant aussi la note d’un cran. Seule Moody’s accorde encore son triple A aux États-Unis.
L’annonce de Fitch a provoqué une baisse des indices actions sur plusieurs places financières. Cette mesure n’avait pas été anticipée. Elle s’est traduite par une augmentation des taux d’intérêt américains favorisant des arbitrages en faveur des obligations. Le dollar s’est ainsi apprécié contre les autres devises.
Le Royaume-Uni, l’inflation et la croissance
Le Royaume-Uni traverse une mauvaise passe avec une inflation qui résiste au traitement de choc de la banque centrale et une atonie économique qui perdure depuis trois ans.
La Banque d’Angleterre a décidé en ce début de mois d’août, pour a quatorzième fois, de relever son taux directeur de 5 % à 5,25 %, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2008. Depuis sa création en 1694, la banque centrale d’Angleterre n’avait jamais augmenté à un tel rythme ses taux.
Même si les autorités monétaires croient à la baisse de l’inflation pour l’automne, la situation britannique se démarque des Etats-Unis et de la zone euro avec une inflation qui demeure plus élevée 7,9 %. Le Royaume-Uni a été fortement touché par l’augmentation du prix du gaz qui assure 40 % de la production de l’électricité du pays. Comme aux Etats-Unis, le marché du travail est, Outre-Manche, tendu, le taux de chômage s’élevant à 4 %. Cette tension conduit à des hausses importantes des salaires. Ceux-ci ont progressé de 7,7 % sur un an, compensant presque intégralement l’inflation. Après avoir subi une violente chute de leur pouvoir d’achat (– 4 % entre avril 2021 et mai 2023), les Britanniques devraient connaître une légère progression d’ici à la fin de 2023. L’inflation au Royaume-Uni s’explique également par les difficultés d’approvisionnement provoquées par le Brexit. Ce dernier a également renchéri le prix des importations en provenance de l’Union européenne.
La hausse des taux d’intérêt est durement ressentie par les ménages britanniques. Sur les 8,5 millions de ménages qui ont contracté un emprunt immobilier, 1,4 million l’ont fait à taux variables. Par ailleurs, 2,2 millions de foyers qui doivent renégocier leur prêt d’ici à la fin de 2024, soit environ 130 000 tous les mois. En moyenne, la hausse de leurs remboursements devrait être de 3 000 livres (3 500 euros) par an.
Le Royaume-Uni est un des pays où la croissance est la plus faible en Europe depuis la crise sanitaire au point que son PIB vient juste de retrouver son niveau de 2019. Le pays a été pénalisé par la baisse des échanges avec l’Union européenne après le Brexit.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 4 août 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 315,07 | -2,30 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 35 065,62 | -0,50 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 478,22 | -2,12 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 909,4 | -2,76 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 951,86 | -3,61 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 564,37 | -1,97 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 332,91 | -2,96 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 192,75 | -1,83 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 288,08 | +0,75 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,086 % | +0,054 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,528 % | +0,065 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,079 % | +0,104 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1038 | +0,21 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 943,75 | -0,78 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,10 | +0,92 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Dépôts à vue, la décrue se poursuit
Les ménages continuent de puiser sur leurs comptes courants pour financer leurs dépenses de consommation et pour alimenter leurs produits d’épargne réglementée.
Depuis le point haut du mois de juillet 2022, l’encours des dépôts à vue a diminué de 43 milliards d’euros à fin juin 2023 soit un montant équivalent à la collecte du Livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) sur la même période (45 milliards d’euros). L’encours est ainsi revenu à 500 milliards d’euros. Il s’élevait à 522 milliards d’euros fin décembre 2022. Fin décembre 2019, avant la crise sanitaire cet encours était de 406 milliards d’euros.
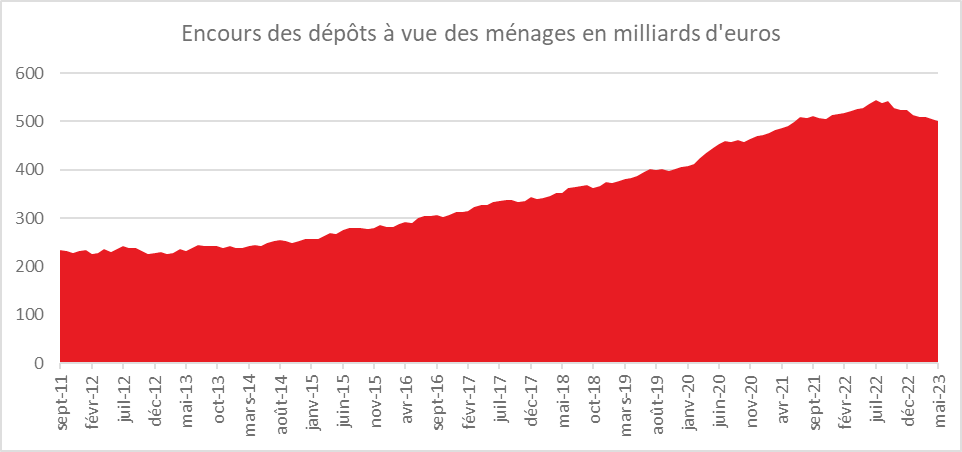
Cercle de l’Épargne – données Banque de France
Poursuite de l’augmentation de la rémunération des dépôts bancaires
En lien avec la hausse des taux d’intérêt, la rémunération moyenne des dépôts bancaires progresse de 5 points de base à 1,53 % en juin. Le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages atteint 1,70 %, selon la Banque de France. De juin 2022 à juin 2023, la rémunération des livrets ordinaires fiscalisés est passée de 0,09 % à 0,68 %. Durant cette période, le taux moyen des livrets réglementés est passé de 1,07 % à 3,22 %. Le taux du PEL est en revanche stable à 2,59 %.
La rémunération des dépôts des Société Non Financières s’établit à 1,32 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et celle, plus limitée, des dépôts à vue. Les banques recommencent à proposer aux PME des dépôts à terme rémunérés.
Forte augmentation des rachats d’actions en France
En Europe, les rachats d’actions ont été importantes au premier trimestre en lien avec les bons résultats des entreprises cotées. Les sociétés françaises ont annoncé pour plus de 19 milliards d’euros de rachats d’actions au premier trimestre ce qui constitue un record. Sur la même période l’an dernier, les programmes de rachats d’actions avaient atteint 7,4 milliards d’euros. Depuis la mi-mars, les annonces ont été plus rares. La polémique sur les « surprofits » et la condamnation par Emmanuel Macron des rachats d’actions ont peut-être incité les entreprises à différer leur programme. Pour l’ensemble de l’année, un volume de 25 milliards d’euros de rachats semble atteignable pour la Bourse de Paris. En 2016, 15 milliards d’euros de rachats d’actions avaient été réalisés.
Les rachats d’actions en utilisant une partie du bénéfice de l’entreprise sont critiqués car ils visent à augmenter le cours des actions en diminuant le nombre de ces dernières. Ces rachats iraient à l’encontre des intérêts des salariés et de l’investissement. En revanche, en redonnant de l’argent aux actionnaires, ces rachats permettent à ces derniers de financer d’autres projets en-dehors de l’entreprise.
Le rajeunissement des actionnaires se poursuit en France
Juste après le déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020, au moment où les cours des actions des entreprises cotées baissaient fortement, de nombreux jeunes avaient décidé d’entrer en bourse afin de se constituer un portefeuille de valeurs. Ils avaient eu alors un comportement opportuniste qui s’est révélé gagnant compte tenu de la remontée rapide des cours. Depuis trois ans, les millenials et les représentants de la génération Z sont de plus en plus nombreux à être des investisseurs actifs en bourse comme le confirme la récente étude de l’institut Kantar pour l’Autorité des Marchés Financiers. Selon cette enquête, près de 40 % des nouveaux venus sur les marchés financiers ont moins de 35 ans. Entre 2019 et 2023, 1,5 million de particuliers se sont lancés dans l’investissement en actions pour la première fois. En quatre ans, la moyenne d’âge des nouveaux arrivants a fortement diminué. Les moins de 25 ans représentaient 14 % des nouveaux investisseurs en 2023, contre 3 % en 2019. A contrario, la proportion des 45-54 ans est passée de 20 % à 13 %. Une tendance à la baisse qui se confirme pour les catégories d’âge supérieures. La part des moins de 25 ans réalisant fréquemment des opérations, a triplé, passant de 1,4 % en 2019 à 4,1 % aujourd’hui. Les moins de 35 ans représentaient 16,8 % des investisseurs actifs au premier semestre 2023. En excluant les stock-options auxquelles les plus jeunes ont rarement accès, la proportion des jeunes de 15-24 ans investisseurs en actions est de 11,2 % soit un taux supérieur à celui des 25-34 ans (8,1 %). Les Français âgés de 45 à 54 ans sont moins nombreux à détenir des actions en 2023 (7,6 %), contre 8 % l’année d’avant. Après avoir délaissé la Bourse en 2008, puis au moment de la crise des dettes souveraines, nombreux sont ceux qui ont été marqués par les crises à répétition.
L’engouement des jeunes pour les actions s’explique par une moindre aversion aux risques que leurs aînés. Ayant connu une longue période de taux d’intérêt bas, l’investissement « actions » se révèle plus lucratif que les produits de taux. Ils sont également ceux qui investissent le plus dans les cryptoactifs. Ils sont friands de nouvelle technologie et passent par les comptes en ligne pour acquérir des actions ou des parts de fonds. Ils plébiscitent, en particulier, les ETF (Exchange Traded Fund, également appelé tracker) qui répliquent les indices et sont peu chargés en frais. Ils ont une approche plus joueuse en lien avec les jeux vidéo que leurs aînés de la bourse. Ils peuvent acheter et vendre rapidement afin de prendre leurs plus-values.
Comptes courants, la décrue au profit du Livret A continue
Les ménages poursuivent de puiser sur leurs comptes courants pour financer leurs dépenses de consommation et pour alimenter leurs produits d’épargne réglementée.
Depuis le point haut du mois de juillet 2022, l’encours des dépôts à vue a diminué de 43 milliards d’euros à fin juin 2023 soit le montant de la collecte du Livret A et du LDDS sur la même période (45 milliards d’euros). L’encours est ainsi revenu à 500 milliards d’euros. Il s’élevait à 522 milliards d’euros fin décembre 2022. Fin décembre 2019, avant la crise sanitaire cet encours était de 406 milliards d’euros.
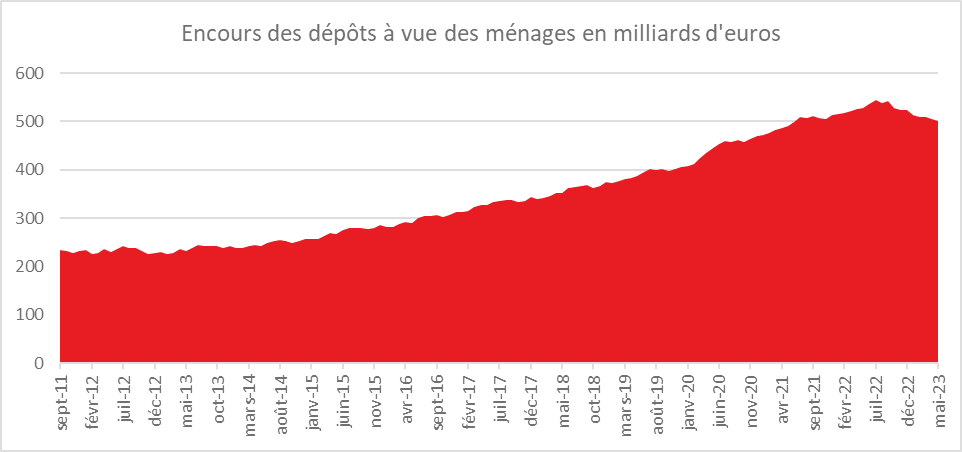
Données Banque de France
Poursuite de l’augmentation de la rémunération des dépôts bancaires des ménages
En lien avec la hausse des taux d’intérêt, la rémunération moyenne des dépôts bancaires, selon la Banque de France, progresse de 5 points de base à 1,53 % en juin. Le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages atteint 1,70 %. La rémunération des livrets ordinaires fiscalisés est passée de juin 2022 à juin 2023 de 0,09 % à 0,68 %. Le taux moyen des livrets réglementés, durant cette période, est passé de 1,07 % à 3,22 %. Le taux du PEL est en revanche stable à 2,59 %.
La rémunération des dépôts des Société Non Financières s’établit à 1,32 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et celle, plus limitée, des dépôts à vue. Les banques recommencent à proposer aux PME des dépôts à terme rémunérés.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| juin-2023 (g) | juin-2022 | avr- 2023 | mai-2023 (f) | juin-2023 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 108 | 0,49 | 1,44 | 1,48 | 1,53 |
| dont Ménages | 1 856 | 0,78 | 1,66 | 1,68 | 1,70 |
| – dépôts à vue | 587 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 46 | 0,39 | 2,65 | 2,81 | 2,97 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 68 | 0,70 | 1,22 | 1,30 | 1,37 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 635 | 1,07 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| dont : livret A | 367 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| – livrets ordinaires | 253 | 0,09 | 0,60 | 0,65 | 0,68 |
| – plan d’épargne-logement | 266 | 2,58 | 2,59 | 2,60 | 2,59 |
| dont SNF | 865 | 0,09 | 1,13 | 1,20 | 1,32 |
| – dépôts à vue | 576 | 0,04 | 0,43 | 0,45 | 0,48 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 232 | 0,11 | 2,67 | 2,87 | 3,06 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 57 | 0,66 | 2,16 | 2,37 | 2,63 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
| Euribor 3 mois (d) | -0,24 | 3,18 | 3,37 | 3,54 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 1,50 | 2,73 | 2,69 | 2,79 | |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Les taux des livrets réglementés le 1er août 2023
Le taux du Livret A et du LDDS reste fixé à 3 % comme cela est le cas depuis le 1er février 2023. Ce taux ne devrait pas être modifié d’ici le 1er février 2025. Le gouvernement a choisi de ne pas appliquer la formule afin de ne pas renchérir le coût des emprunts reposant sur les ressources des Livrets A ou des LDDS. En décidant de ne pas relever le taux du Livret A, le gouvernement entend également de ne pas inciter les ménages à épargner d’avantage au moment où la consommation est à la peine. La stabilisation du taux du Livret A est présentée comme une garantie à terme d’une amélioration du pouvoir d’achat de l’épargne, l’inflation étant amenée à baisser. Concernant le Livret d’Epargne Populaire, le gouvernement n’a pas également appliqué la règle en retenant au lieu des 6,1 % actuels, un taux de 6 % quand il aurait pu choisir 5,6 %. Le plafond du Livret d’Epargne Populaire est passé le 1er août de 7700 à 10 000 euros.
La fin des régimes spéciaux engagée
Le gouvernement a publié au Journal Officiel du 30 juillet les décrets mettant en œuvre la disparition progressive des régimes spéciaux. À compter du 1er septembre 2023, les nouveaux entrant à la RATP, au sein des entreprises des industries électriques et gazières (EDF, Engie, ERDF…), en tant que clercs de notaire ou en tant que salariés de la Banque de France seront ainsi affiliés au régime général des retraites. Le mécanisme dit de la « clause du grand-père », déjà retenue pour la réforme de la SNCF en 2018, s’applique. Cela signifie que pour les salariés entrés avant le 1er septembre, leurs pensions seront calculées selon les anciennes règles spécifiques aux régimes spéciaux. En revanche, ils seront néanmoins concernés par le décalage progressif de deux ans de l’âge légal de départ en retraite avec néanmoins un calendrier qui leur sera propre (en règle générale à partir du 1er janvier 2025) et l’accélération de la réforme Touraine de 2014.
Le Coin des Epargnants du 29 juillet 2023 : inflation et croissance, les bonnes surprises de l’été
Fin de juillet tranquille pour les marchés
Entre les hausses attendues des taux directeurs et les bons résultats de la croissance ainsi que la poursuite de la baisse de l’inflation dans plusieurs pays, les investisseurs demeurent relativement confiants. Le cours des actions ont continué cette semaine à progresser à petit trot.
L’inflation a été de 5 % en juillet en France en données harmonisées de l’Union européenne). Le taux d’inflation en Allemagne devrait être de 6,2 % en juillet 2023 après 6,4 % en juin, a indiqué Destatis. Le taux d’inflation hors alimentation et énergie, devrait être de +5,5% contre 5,8 % en juin 2023. En Espagne, l’inflation a atteint en juillet 2,3 % sur un an en Espagne, soit légèrement plus qu’au moins de juin, en raison notamment d’un rebond du prix des carburants, selon une estimation provisoire publiée vendredi par l’Institut national des statistiques (INE). Ce taux est supérieur de 0,4 point au niveau du mois de juin (1,9%), qui avait permis à l’Espagne de revenir pour la première fois depuis mars 2021 dans la cible de 2 % fixée par la Banque centrale européenne (BCE). Malgré cette légère hausse, l’inflation espagnole demeure en dessous de celle de la zone euro, L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s’est lui aussi établi à 2,1%, soit 0,5 point de plus qu’en juin (1,6%), selon l’institut de statistiques. L’inflation sous-jacente a progressé de 0,3 point, pour atteindre 6,2% sur un an.
Sur le plan de la croissance, la France fait la course en tête avec une progression de son PIB, au deuxième trimestre, de 0,5 %. L’Espagne la suit de près avec un gain de 0,4 %. En revanche, l’Allemagne après deux trimestres de baisse de son PIB enregistre une croissance nulle. Le PIB de l’Autriche a diminué au deuxième trimestre de 0,4 % et celui de la Suède de 1,5 %.
Aux Etats-Unis, l’indice sur la confiance des consommateurs établi par l’Université du Michigan a progressé de 64,4 points en juin à 71,6 en juillet. Il s’agit de son plus haut niveau depuis octobre 2021. La composante de la perception des conditions actuelles s’est également améliorée, passant de 69 points le mois dernier à 76,6 en juillet. Celle des attentes du consommateur s’est elle aussi appréciée à 68,3 points, contre 61,5 en juin. Quant aux anticipations d’inflation, elles ont légèrement augmenté à 3,4 % sur un an, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage. Elles se maintiennent à 3 % pour ce qui est de l’horizon à 5 à 10 ans.
Hausses de taux estivales aux États-Unis et en zone euro
Les deux grandes banques centrales, la BCE et la FED, ont relevé en cette fin de mois de juillet leurs taux directeurs sur fond de décrue des taux globaux d’inflation. Leurs présidents respectifs ont martelé leur objectif est de réduire l’inflation sous-jacente (inflation hors prix de l’alimentation et de l’énergie) qui demeure élevée. Ils ne veulent pas relâcher l’effort de peur d’un redémarrage de la hausse des prix à la rentrée. Leurs décisions avaient été anticipées par les investisseurs et n’ont pas donné lieu à des turbulences sur les marchés « actions ».
Les taux de la BCE, un niveau sans précédent depuis 2001
Jeudi 27 juillet, la Banque centrale européenne a relevé, pour la neuvième fois en un an, ses taux directeurs d’un quart de point jeudi. À partir du 2 août, ces taux seront de 3,75 % pour le taux de dépôt, 4,25 % pour le « refi » (le taux de refinancement des banques auprès de la BCE) et 4,50 % pour celui de la facilité de prêt marginal. Pour retrouver un taux de dépôts aussi élevé, il faut remonter à la période d’octobre 2000 à mai 2001. Le « refi », retrouve son niveau de 2008, juste avant la faillite de Lehman Brothers.
La réunion du Comité de Politique Monétaire de jeudi marque tournant car la BCE a annoncé qu’elle ne relèvera plus systématiquement ses taux à chaque réunion. La décision de septembre et les suivantes dépendront des données publiées. Christine Lagarde a, en effet, indiqué lors de la conférence de presse « lors des prochaines réunions, nous pourrons choisir soit de relever les taux, soit de faire une pause. Cela pourra varier d’une réunion à l’autre ». Le communiqué de presse de la BCE mentionne, par ailleurs, que « les futures décisions du Conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux d’intérêt directeurs de la BCE soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs, aussi longtemps que nécessaire, pour assurer un retour au plus tôt de l’inflation au niveau de notre objectif de 2 % à moyen terme ».
Les investisseurs prédisent encore une hausse des taux avant la fin de l’année. Ces derniers resteraient stables durant plusieurs mois afin d’éviter toute résurgence de l’inflation.
La Réserve fédérale face à la force de l’économie américaine
La Réserve fédérale américaine a relevé, mercredi 26 juillet, pour la onzième fois depuis le mois de mars ses taux directeurs les portant à leur plus haut niveau depuis 2001. Ils se situent désormais entre 5,25 % et 5,5 % quand il y a un an et demi, ils évoluaient entre 0 % et 0,25 %.
La banque centrale a justifié cette nouvelle hausse en soulignant que l’activité progresse, les créations d’emploi restent « robustes » et que l’inflation est « élevée ». Elle a noté que le système bancaire demeure « sain et résistant » malgré la crise du printemps. En sens inverse, elle mentionne que l’accès plus difficile au crédit pourrait « peser sur l’activité économique, le recrutement, l’inflation ».
Le Président de la FED lors de la conférence de presse a souligné qu’une ou deux augmentation des taux directeurs étaient envisageables d’ici la fin de l’année et qu’il n’avait pas prévu de les baisser avant 2024. Il a expliqué que la FED allait piloter aux instruments, « réunion après réunion » afin d’éviter de trop resserrer ou de trop relâcher. Il y aura deux mois supplémentaires de statistiques de l’emploi d’ici à la prochaine réunion de la FED. Il a indiqué qu’il sera alors « possible de relever encore » les taux, ou de les « stabiliser ».
Les investisseurs pensent que la fin du processus de durcissement de la politique est proche. Face à cet optimisme, Jerome Powell est dans son rôle de banquier en répétant inlassablement les objectifs de la banque centrale, le retour de l’inflation dans la cible des 2 %. L’euphorie des marchés, aux États-Unis, est liée à un recul rapide de l’inflation qui s’est contractée de 6 points en un an et est revenue à 3 % en juin sur douze mois. Le nombre de créations d’emplois s’il est élevé tend néanmoins à baisser. En revanche, le retournement de l’immobilier est perçu comme une mauvaise nouvelle car pouvant déboucher sur une hausse des loyers. L’hypothèse d’une récession en fin d’année aux États-Unis n’est plus jugée inéluctable. Goldman Sachs a révisé sa prévision en la matière de 30 % à 20 % de risque.
Après les décisions des banques centrales, les taux des obligations d’Etat à 10 ans ont légèrement augmenté de part et d’autre de l’Atlantique.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 28 juillet 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 476,47 | +0,59 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 35 459,29 | +0,28 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 582,23 | +0,90 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 14 316,66 | +2,15 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 16 469,75 | +1,71 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 694,27 | +0,51 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 466,50 | +1,60 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 759,23 | +1,41 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 275,93 | +3,42 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,032 % | +0,041 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,463 % | +0,027 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,975 % | +0,145 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1031 | -0,94 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 963,51 | -0,61 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 83,84 | +3,75 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
L’assurance vie retrouve des couleurs en juin
Petit rebond en juin de la collecte nette de l’assurance vie
Après la contreperformance du mois de mai (-1,6 milliard d’euros), l’assurance a renoué, en juin, avec une collecte nette positive de 1,7 milliard d’euros. Ce résultat est meilleur que celui enregistré l’an dernier pour le même mois (528 millions d’euros). Le mois de juin est en règle générale moyenne pour l’assurance vie. Il a enregistré, en vingt ans, trois décollectes (2012, 2013 et 2020). En moyenne, la collecte nette est de 0,95 milliard d’euros.
Le mois de juin, comme les précédents, a été marqué par une décollecte sur les fonds euros toujours victimes de leur faible rendement et de la concurrence de l’épargne réglementée. La décollecte a été ,en juin, de 2,8 milliards d’euros. Sur les six premiers mois, elle a atteint 15,5 milliards d’euros. Sur la même période, la collecte des unités de compte a été positive à hauteur de 19,5 milliards d’euros.
Au total, pour le premier semestre, la collecte nette a, pour l’assurance vie, atteint 4,1 milliards d’euros soit bien moins que celle du Livret A (25,84 milliards d’euros). Ce résultat est en-deçà de la moyenne de l’assurance vie ces dernières années. En 2022, la collecte nette du premier semestre avait été de 9,5 milliards d’euros. Avant la crise sanitaire, en 2019, elle s’était élevée à 14 milliards d’euros. Il y a indéniablement un effet taux de rendement.
Des cotisations brutes en forte augmentation, preuve d’une forte propension des ménages à l’épargne
Si les ménages délaissent les fonds euros, cela ne les empêche pas d’effectuer d’importants versements sur leurs contrats d’assurance vie prouvant leur propension à l’épargne. Sur la première moitié de l’année, les cotisations en assurance vie s’élèvent à 81,8 milliards d’euros, en hausse de +6 % par rapport à la même période de 2022. Le montant des cotisations brutes s’est élevé, en effet, à 15,6 milliards d’euros en juin, contre 10,1 milliards d’euros en mai. L’année dernière, pour le mois de juin, il était de 12 milliards d’euros.
En juin, la part des cotisations en Unités de Compte (UC) s’établit à 46 %, soit plus que la moyenne de ces derniers mois (41 %). La bonne tenue des marchés financiers explique cet engouement alimenté également par la désaffection dont sont victimes les fonds euros.
Les ménages en plein arbitrage au niveau de leur épargne
Au mois de juin, les prestations s’élèvent à 13,9 milliards d’euros, en hausse de +21 % par rapport à juin 2022. Les assurés effectuent de nombreux rachats sur leurs fonds euros (11,2 milliards d’euros). Les rachats sur les UC sont plus modestes (2,6 milliards d’euros). Sur les six premiers mois de l’année, le montant des prestations est élevé, 77,7 milliards d’euros en hausse de 19 % sur un an.
En encours au-dessus de 1900 milliards d’euros
Pour la première fois de son histoire, l’encours de l’assurance vie dépasse 1900 milliards d’euros (1910,8 milliards d’euros). En plus de la collecte nette positive, le premier produit d’épargne en volume des ménages français a bénéficié de la bonne tenue de la bourse. Cet encours a progressé de +5 % sur un an. En juin 2006, il s’élevait à 1010 milliards d’euros.
L’assurance vie entre deux eaux
L’assurance vie est pénalisée par la faiblesse des rendements des fonds euros mais profite de la bonne tenue des marchés financiers qui dopent les unités de compte. Par ailleurs, le retournement du marché immobilier incite les ménages à revenir vers l’épargne financière et en premier lieu sur l’assurance vie. Ces derniers effectuent d’importants arbitrages en sortant des fonds euros et en réallouant les sommes concernées sur les unités de compte ou sur d’autres produits d’épargne et notamment sur les livrets réglementés.
Le rendement des fonds euros devrait continuer à s’améliorer en 2023 et se situer autour de 2,8 % ce qui les rapprochera du taux du Livret A. D’ici leur publication, au début de l’année 2023, il est fort probable que leur décollecte se poursuive. Elle sera sans nul doute compensée par la collecte des unités de compte et cela d’autant plus si les marchés financiers restent bien orientés.
Le Plan d’Epargne Retraite trace sa route
Si l’assurance vie doute quelque peu, le Plan d’Epargne continue à enregistrer une croissance dynamique. Les cotisations ont atteint 716 millions d’euros en juin 2023, en progression également de +30 % sur un an et 62 000 nouveaux assurés ont été signés (+10 %).
Au 1er semestre 2023, les cotisations versées s’élèvent à 4,1 milliards d’euros pour près de 450 000 nouveaux assurés, soit +22 % et +20 % respectivement par rapport au 1er semestre 2022. La collecte nette des PER s’élève à +2,8 milliards d’euros (+8 % par rapport au 1er semestre 2022). Fin juin 2023, 5,1 millions d’assurés détiennent un PER pour un encours de 66,8 milliards d’euros, dont 39 % correspondent à des UC.
Le PER continue à attirer de nouveaux clients grâce notamment à l’avantage fiscal dont il est doté à l’entrée. Si son encours progresse, il demeure néanmoins modeste par rapport à celui de l’assurance vie (1910 milliards d’euros).*
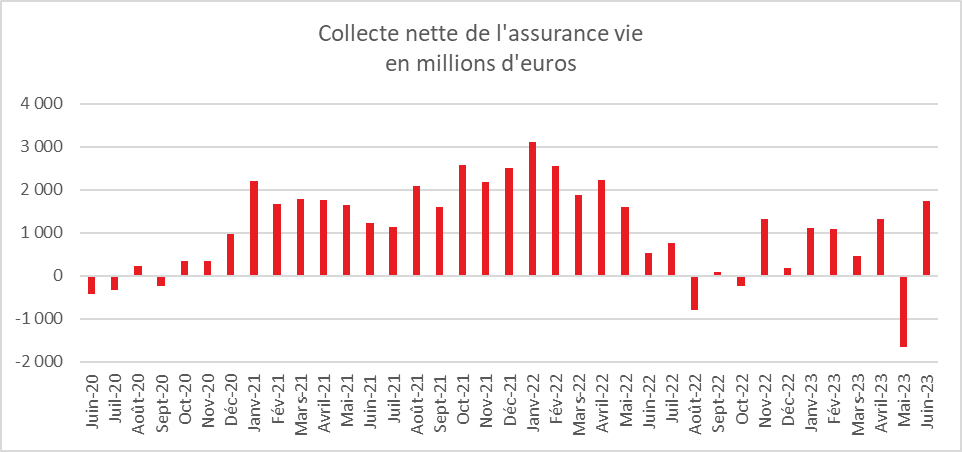
France Assureurs
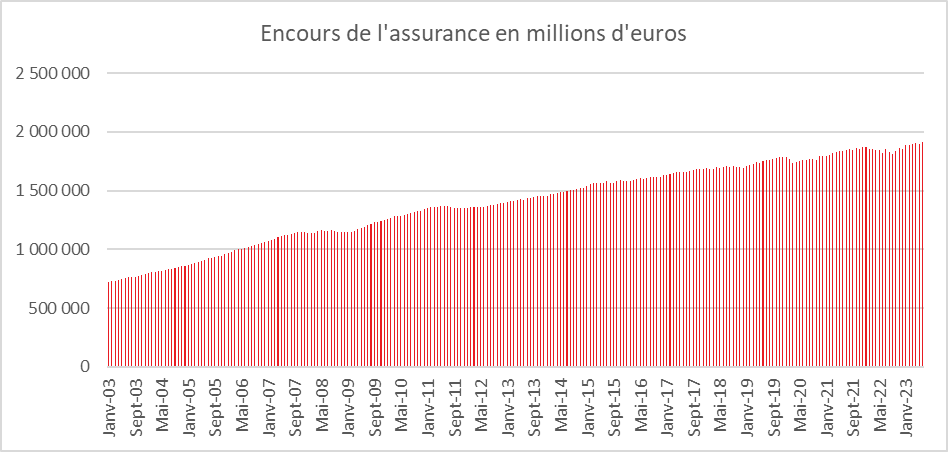
France Assureurs
Le Coin des Epargnants du 22 juillet 2023 par Philippe Crevel : attentisme estival
Attentisme des marchés
Le CAC 40 a gagné plus de 0,6 % sur la semaine et s’est installé au-dessus des 7400 points. Le compartiment du luxe a porté le marché parisien. L’attentisme a été de mise à Paris comme pour les autres places financières occidentales. Les investisseurs attendent les résultats des entreprises et les décisions des banques centrales. A paris, la semaine prochaine sera, en effet, marquée par la publication des résultats de trente-deux des 40 sociétés composant le CAC 40 publieront leur chiffre d’affaires et/ou leurs résultats semestriels à partir du mardi 25 juillet. Aux Etats-Unis, trois Gafam – Alphabet, Microsoft et Meta Platforms – feront de même, sans oublier Intel, AMD, Boeing ou McDonald’s. Dans ce contexte, l’attentisme était de mise cette semaine d’autant plus que celle à venir sera également marquée par les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, prévues respectivement mercredi 26 et jeudi 27 juillet.
Sur le plan économique, la semaine a confirmé la baisse de l’inflation en zone euro.
Au Royaume-Uni, le taux d’inflation a été de 7,9 % en glissement annuel en juin, contre 8,7 % en mai. L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) décroît également en passant de +7,1 % en mai à 6,9 % en juin. Le taux d’inflation de la zone euro a été de 5,5 % en glissement annuel en juin, contre 6,1 % en mai et 9,2 % en décembre 2022. La baisse des prix de l’énergie et, dans une moindre mesure, de l’alimentation concourent à cette diminution. L’inflation sous-jacente, hors éléments volatils, demeure sur un plateau depuis le début d’année 2023 à +5,5% en juin (5,3 % en mai).
Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage décélèrent légèrement en passant de 237 000 à 228 000 alors que le marché attendait plutôt une légère augmentation. De son côté, le marché immobiliser semble se stabiliser après de fortes baisses enregistrées en 2022.
La Chine a publié des chiffres de croissance au deuxième trimestre en-deçà des attentes des investisseurs : +6,3 % en glissement annuel contre +7,1 % attendus. Cette contreperformance a pesé sur les indices « actions » chinois.
Les tensions géopolitiques ont augmenté avec la dénonciation par Moscou de l’accord concernant le transport des céréales ukrainiennes grâce à la création d’un corridor commercial en mer noire. Même si pour le moment, les perspectives de récoltes de céréales sont bonnes, ces tensions pourraient générer une augmentation des cours.
La Banque centrale de Russie (BCR) a décidé vendredi 21 juillet un relèvement de son taux directeur d’un point, à 8,5 %. La Banque centrale maintient son objectif de ramener l’inflation à 4 % en 2024, quand elle devrait se situer entre 5 % et 6,5 % fin 2023. La BCR a été incité à relever son taux du fait de l’érosion du rouble et pour éviter un nouveau dérapage des prix. En 2022, la hausse des prix avait atteint 17,8 % en avril. La dépréciation du rouble est liée à la baisse des recettes d’exportation en raison de la faiblesse du cours du pétrole et des effets des embargos. Le produit intérieur brut de la Russie s’est contracté de 1,9 % au premier trimestre, selon Rosstat.
Quand l’euro reprend des couleurs
Au fil des semaines, l’euro s’apprécie par rapport aux autres devises. Depuis le 1er janvier, Il a gagné 3,5 % par rapport au dollar, 9 % par rapport yuan et 11 % par rapport au yen. Son taux de change global nominal, calculé par la Banque centrale européenne (BCE), a gagné 4 % cette année et a dépassé son plus haut de 2009. À 1,11 dollar (vendredi 21 juillet), l’euro reste néanmoins loin de son record atteint face au billet vert, 1,58 dollar en mars 2008. L’euro est revenu simplement à son niveau d’avant la guerre en Ukraine qui avait provoqué son passage en-dessous de la parité. Il avait ainsi enregistré son plus faible niveau depuis vingt ans.
Le taux de change de l’euro s’améliore car le potentiel de hausse des taux d’intérêts est désormais du côté de l’Europe. Aux États-Unis, la FED arrive au terme de son processus de revalorisation de ses taux quand, en zone euro, il pourrait se poursuivre quelques temps. L’euro pourrait donc continuer sa marche en avant avec comme limite le risque d’une récession. Il pourrait d’ici la fin de l’année atteindre 1,2 dollar ce qui réduira le coût de la facture énergétique et contribuera à la baisse de l’inflation.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 21 juillet 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 432,77 | +0,68 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 35 227,69 | +2,14 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 536,34 | +0,72 % | 3839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 14 032,81 | -0,56 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 16 177,22 | +0,42 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 28 855,09 | +0,67 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 391,41 | -0,39 % | 3792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 304,25 | +0,31 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3167,74 | -2,11 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,991 % | -0,048 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,436 % | -0,043 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,830 % | +0,013 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1116 | -1,11 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 961,40 | +0,36 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 80,49 | +1,04 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Résultats du Livret A du premier semestre 2023 : une pluie de records
Le Livret A a conclu le premier semestre 2023 avec une collecte positive de 1,34 milliard d’euros. Sur les six premiers mois, la collecte aura atteint le niveau record de 25,84 milliards d’euros. L’encours du Livret A a battu en juin également un nouveau record à 401,3 milliards d’euros.
En prenant en compte le LDDS, la collecte des deux produits a été, en juin, de 2,16 milliards d’euros et sur les six premiers mois de l’année de 34,54 milliards d’euros. L’encours total a atteint fin juin 544,2 milliards d’euros.
Lors de ce premier semestre, le Livret A a conforté sa place de placement préféré des Français. Il a profité de la propension des ménages français à épargner dans cette période d’incertitudes économiques. Ces derniers privilégient toujours l’épargne à la consommation. La crainte de l’inflation et d’une dégradation éventuelle de la situation économique a incité les ménages à opter pour un comportement attentiste voire prudent. Les trois relèvements réalisés entre le 1er février 2022 et le 1er février 2023 du taux du Livret A ont conduit les ménages à réduire les liquidités disponibles sur leurs comptes courants.
Un mois de juin encore exceptionnel
La collecte du mois de juin 2023 (1,34 milliard d’euros) est certes inférieure à celle de mai (2,47 milliards d’euros) et à celle d’avril (2,33 milliards d’euros) mais reste supérieure à celle de juin 2022 (1,2 milliard d’euros).
Si une décrue de la collecte est constatée, elle demeure exceptionnelle. Le mois de juin n’est pas, en effet, traditionnellement porteur pour le Livret A. Depuis la banalisation de sa commercialisation en 2009, ce produit a connu quatre décollectes en juin (2009, 2010, 2014, 2015). Le montant moyen des collectes de ces dix dernières années (2013/2022) a été de 0,75 milliard d’euros. En ne retenant que les années d’avant la crise sanitaire (2013/2019), le montant moyen est de 0,23 milliard d’euros. 2023 tranche donc avec la tendance passée. L’effet taux demeure la principale explication de ce bon résultat. En période d’inflation, les ménages tentent de limiter au maximum l’érosion de leur patrimoine en cherchant les meilleurs rendements. Dans les années 2015/2021, les ménages ont laissé sur leurs comptes courants d’importantes liquidités car l’inflation était faible tout comme le rendement du Livret A. Il n’y avait pas un réel intérêt à placer son argent à court terme. Avec une inflation de plus de 5 %, la donne a changé. Avec un rendement de 3 %, le rendement réel du Livret A n’en demeure pas moins négatif.
Le semestre en or du Livret A
Sur les six premiers mois de l’année 2023, le Livret A connait une collecte historique de 25,84 milliards d’euros. Le précédent record datait de 2009 (21,36 milliards d’euros). En 2020, durant le premier semestre marqué par l’épidémie covid, la collecte s’était élevée à 20,41 milliards d’euros.
Le Livret de Développement Durable Solidaire dans les pas de son aîné
La collecte du mois de juin 2023 du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a été de 0,83 milliard d’euros, contre 1,05 milliard d’euros en mai 2023. Elle s’était élevée à 0,25 milliard d’euros en juin 2022. Sur les six premiers mois, le LDDS a enregistré un flux net de 8,70 milliards d’euros portant son encours à 143 milliards d’euros.
En 2023, le LDDS signe ainsi son meilleur premier semestre depuis 2009. Sur les six premiers mois de l’année, son précédent record datait de 2013 (6,43 milliards d’euros) au moment du doublement de son plafond (12 000 euros au lieu de 6 000 euros).
De plus en plus de Livrets A et LDDS au plafond
Avec les versements de ces trois dernières années, le nombre de Livrets A et de LDDS au plafond augmente à grande vitesse. Selon le rapport de l’Observatoire de l’Épargne Réglementée, 5,3 millions de livrets A détenus par des personnes physiques dépassaient le plafond réglementaire de 22 950 euros, soit 9,6 % des livrets. En 2022, ce nombre a augmenté d’un million, contre + 400 000 en 2020 et +380 000 en 2021). 24 % des LDDS sont également au plafond (12 000 euros), soit 6 millions. Ce nombre est également en hausse de 670 000 en 2022 contre 320 000 en 2021.
Les ménages ayant atteint les plafonds réglementaire peuvent compléter ceux des autres membres de la famille ou se rabattre sur les livrets ordinaires mais dont le rendement est moindre.
Une collecte plus mesurée dans les prochains mois ?
La décision du gel du rendement à 3 % durant 18 mois ne devrait pas affecter fondamentalement la collecte du Livret A même si l’effet « relèvement du taux » s’estompera avec le temps. Avec un taux de 3 %, le Livret A comme le LDDS reste compétitif par rapport à la grande majorité des placements.
Une érosion de la collecte est néanmoins à attendre d’autant plus si l’inflation se résorbe. Traditionnellement, les six derniers mois de l’année sont propices aux dépenses (vacances, rentrée scolaire, fêtes de fin d’année). Le gouvernement, en ne relevant pas le taux de 3 à 4 % du Livret A et du LDDS, entend justement inciter les ménages à retrouver le chemin de la consommation afin de sauver la croissance de l’année.
Le Coin des Epargnants du samedi 15 juillet 2023 : toujours l’inflation au menu
Inflation, des jours avec, des jours sans
Cette semaine a donné lieu à plusieurs publications marquant le recul de l’inflation. Aux Etats-Unis, En juin aux États-Unis, le taux d’inflation s’élevait à 3,0 % sur un an contre 4 % le mois précédent. Il est revenu à son plus bas niveau depuis mars 2021, selon l’indice CPI publié mercredi par le département du Travail. Ce niveau qui reste toutefois encore au-dessus de la cible des 2 % fixée par la FED. Les investisseurs ont favorablement réagi à cette publication. La baisse de l’inflation concerne, par ailleurs, la zone euro. En France, l’INSEE a confirmé qu’en juin, elle n’était que de 4,5 %. Le moral des ménages américains s’est encore s’amélioré en juillet, selon l’estimation préliminaire de l’Université du Michigan. L’indice a gagné 8,2 points, à 72,6, son meilleur niveau depuis septembre 2021. Cette amélioration est imputable au ralentissement général de l’inflation et par la résistance du marché de l’emploi. » Le loyer de l’argent culminant déjà entre 5% et 5,25% aux Etats-Unis, un nombre croissant d’économistes prévoient que les prochains relèvements de taux de la Réserve fédérale (Fed) seront peu nombreux et de faible d’ampleur. Les taux auraient à leurs yeux pratiquement atteint leur plus haut niveau. Les mesures de Pékin afin de relancer son économie ont contribué à la progression du cours des actions. Les banques et le secteur du luxe ont été en pointe durant cette semaine. Le CAC a gagné en cinq jours plus de 3 % tout comme le Dax ou l’Eurostoxx. Le Nasdaq a également, aux Etats-Unis, gagné plus de 3 %.
Les taux des obligations souveraines ont légèrement baissé et l’euro s’est apprécié par rapport au dollar passant la barre de 1,10 dollar pour un euro. Cette remontée s’explique par la volonté affichée de la BCE de relever ses taux directeurs la semaine prochaine quand la probabilité d’une stabilité aux Etats-Unis augmente avec la publication des dernières statistiques de l’inflation.
Le baril de Brent s’est apprécié en franchissant les 80 dollars durant la semaine. La fermeture de nombreux gisements libyens ainsi que des incidents sur des champs pétroliers au Nigeria a créé des tensions sur l’offre quand dans le même temps la demande était orientée à la hausse notamment celle des Etats-Unis.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 14 juillet 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 374,54 | +3,69 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 509,03 | +2,37 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 505,42 | +2,49 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 14 113,70 | +3,15 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 16 105,07 | +3,21 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 434,57 | +3,40 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 400,11 | +3,91 % | 3 792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 391,26 | +0,01 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 237,70 | +1,25 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,039 % | -0,134 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,479 % | -0,145 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,817 % | -0,219 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1236 | +2,307 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 957,70 | +1,75 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 80,24 | +1,95 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Livret A, un taux gelé sur fond de recul de l’inflation
Selon le calcul émanant de la formule du taux du Livret A, ce dernier aurait dû être de 4,1 % le 1er août prochain. Le ministre de L’Économie a suivant les recommandations du Gouverneur de la Banque de France visant à maintenir le taux de 3 % en vigueur depuis le 1er février dernier. En contrepartie, ce taux sera gelé dix-huit mois au lieu d’être révisé tous les six mois. Le taux du Livret d’Epargne Populaire est certes abaissé mais moins que ce que permettait l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux des produits d’épargne réglementée. Le ministre de L’Économie a, en effet, retenu pour ce produit, un taux de 6 % quand il aurait pu retenir 5,6 % correspondant à la moyenne de l’inflation de ses six derniers mois. Le taux du livret d’épargne populaire (LEP) ne baissera donc que de 0,1 point le 1er août prochain. Le plafond de ce produit passera, par ailleurs, de 7700 à 10 000 euros.
Privilégier la consommation et faire le pari de la baisse de l’inflation
Les Français privilégient l’épargne à la consommation. Le taux d’épargne était de 18,3 % du revenu disponible brut au cours du premier trimestre, soit trois points au-dessus de son taux d’avant crise sanitaire.
Depuis le 1er février 2022, tout relèvement du taux du Livret A provoque une hausse de la collecte qui bat ainsi record sur record. Du mois de janvier à mai, elle a atteint 24,5 milliards d’euros, soit la collecte la plus importante depuis la banalisation de la distribution du Livret A en 2009. En ajoutant le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), la collecte, toujours sur les cinq premiers mois de 2023, a dépassé 32 milliards d’euros.
En ne relevant pas le taux du Livret A, Bruno Le Maire entend donner la priorité de la consommation qui est le principal moteur de la croissance. Il appelle de ses vœux une reprise de cette dernière. Avec le gel à 3 % du taux du Livret A durant 18 mois, le Ministre fait le pari de la poursuite de la baisse de l’inflation. Au fil des mois, l’inflation, le taux d’inflation devrait se rapprocher de celui de du taux du Livret A, le rendement réel sera ainsi de moins en moins négatif. En bloquant le Livret A à 3 %, il se préserve de l’impopularité qu’aurait occasionné sa baisse le 1er février ou le 1er aout prochain.
Ne pas désespérer les emprunteurs
En maintenant le Livret A à 3 %, Bruno Le Maire souhaite ne pas pénaliser les bénéficiaires des ressources de l’épargne réglementée, en particulier les bailleurs sociaux. Une augmentation du taux du Livret A constitue une charge pour les banques et pour la Caisse des dépôts et consignations qui centralise jusqu’à 60 % des ressources collectées. Par sa décision, le ministre de l’Économie a voulu éviter de nouveaux surcoûts pour les banques afin d’éviter une augmentation accrue des taux d’intérêt.
Respecter la hiérarchie des taux
Une des raisons de la non-application de la formule est liée également au respect de la hiérarchie des taux. Un taux autour de 4 % pour le Livret A aurait constitué un pic au sein des différents placements. Le Livret A aurait été rémunéré de manière plus élevé qu’un grand nombre de produits d’épargne. Le taux moyen des livrets ordinaires de banque est inférieur à 0,7 %. Le Livret A, produit d’épargne de court terme, liquide et sans risque, serait également mieux rémunéré que de nombreux produits de long terme, qui peuvent comporter une part de risque. Il aurait été, par ailleurs, mieux rémunéré que les fonds euros de l’assurance vie qui sont déjà en décollecte depuis le début de l’année.
Préserver l’équilibre budgétaire
Les intérêts des Livrets A, du LDDS et du Livret d’Épargne Populaire étant exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l’augmentation du taux du Livret A aurait constitué un surcoût pour les finances publiques au moment où le gouvernement est invité à sortir du « quoi qu’il en coûte ».
Pas de rebond estival pour le Livret A en perspective
La non-revalorisation du Livret A ne devrait pas se traduire par un rebond de la collecte en juillet et en août. Faute de relèvement de la rémunération, l’effet taux ne pourra pas jouer sur la collecte. Cette dernière devrait néanmoins se maintenir à un bon niveau sans pour autant égaler les montants records enregistrés sur le premier semestre.
Le Livret d’Epargne Populaire améliore, en revanche, son attractivité avec un rendement de 6 %, supérieur à l’inflation et un plafond remonté à 10 000 euros.
Le second semestre étant en règle générale, plus axé « dépenses » qu’« épargne », la collecte devrait s’atténuer surtout en fin d’année. 2023 devrait néanmoins être une excellente année pour le Livret A, le produit le plus diffusé au sein de la population française.
Le taux du Livret A gelé à 3 % jusqu’au 1er février 2025
Les épargnants attendaient un taux du Livret A à 4 ou 3,5 %, ils auront le droit à un taux maintenu à 3 % et cela durant les dix-huit prochains mois. En prenant cette décision, le Ministre de l’Économie fait le pari de la baisse de l’inflation. Il souhaite également une reprise de la consommation qui est, depuis des mois, en berne.
Priorité à la consommation
Depuis le début de l’année, les Français privilégient l’épargne à la consommation. Le taux d’épargne était de 18,3 % du revenu disponible brut au cours du premier trimestre, soit trois points au-dessus de son taux d’avant crise sanitaire.
Depuis le 1er février 2022, tout relèvement du taux du Livret A provoque une hausse de la collecte qui bat ainsi record sur record. Du mois de janvier à mai, elle a atteint 24,5 milliards d’euros, soit la collecte la plus importante depuis la banalisation de la distribution du Livret A en 2009.
Depuis 2022, les Français ont privilégié l’épargne de précaution sur la consommation. Face à l’érosion de leur pouvoir d’achat, ils ont préféré mettre de l’argent de côté par crainte de nouvelles hausses des prix. En ne relevant pas le taux du Livret A, Bruno Le Maire entend donner la priorité de la consommation qui est le principal moteur de la croissance. Il appelle de ses vœux un reprise de cette dernière. Il fait le pari de la poursuite de la baisse de l’inflation. Le taux de 3 % sera plus compétitif au fur et à mesure de la décrue de cette dernière.
Ne pas désespérer les emprunteurs
En maintenant le Livret A à 3 %, Bruno Le Maire souhaite ne pas pénaliser les bénéficiaires des ressources de l’épargne réglementée, en particulier les bailleurs sociaux. .
Une augmentation du taux du Livret A constitue une charge pour les banques et pour la Caisse des dépôts et consignations qui centralise jusqu’à 60 % des ressources collectées. Par sa décision, le Ministre de l’Économie a voulu éviter de nouveaux surcoûts pour les banques au moment où les taux d’intérêt sur les emprunts augmentent.
Préserver l’équilibre budgétaire
Les intérêts des Livrets A, du LDDS et du Livret d’Épargne Populaire étant exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l’augmentation du taux du Livret A aurait constitué un surcoût pour les finances publiques au moment ou le gouvernement est invité à sortir du « quoi qu’il en coûte ».
Ne pas désespérer les autres placements et en premier lieu l’assurance vie
Une des raisons de la non-application de la formule est liée à la hiérarchie des taux. Un taux autour de 4 % aurait constitué un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que les autres produits de court terme (dépôts à terme, livrets bancaires) mais aussi que certains produits de long terme et en particulier les fonds euros de l’assurance vie qui sont en décollecte depuis le début de l’année.
Pour le moment, la collecte du Livret A et du LDDS est essentiellement alimentée par les dépôts à vue qui avaient connu une forte croissance depuis le début de la crise sanitaire mais cela n’est pas sans conséquence sur les fonds euros des contrats d’assurance vie.
Pas de rebond estival pour le Livret A en pespective
La non-revalorisation du Livret A ne devrait pas se traduire par un rebond de la collecte en juillet et en août. Faute de relèvement de la rémunération, l’effet taux ne pourra pas jouer sur la collecte. Cette dernière devrait néanmoins se maintenir à un bon niveau sans pour autant égaler les montants records enregistrés sur le premier semestre.
Le second semestre étant en règle générale, plus axé « dépenses » qu’« épargne », la collecte devrait s’atténuer surtout en fin d’année. 2023 devrait néanmoins être une excellente année pour le Livret A, le produit le plus diffusé au sein de la population française.
Le Livret A, quel taux le 1er août 2023 ?
La fixation du taux du Livret A, deux fois par an, le 1er février et le 1er août, est devenue un rendez-vous incontournable et un enjeu qui dépasse de loin le poids et l’importance de ce produit d’épargne. En raison de sa notoriété, de sa large diffusion, de sa simplicité, le Livret A est devenu une forme d’étalon de l’épargne française. Son caractère administré est unique en soi, aucun autre pays ayant un produit d’épargne comparable.
Le nouveau taux du Livret A applicable à compter du 1er août sera connu après l’annonce officielle du taux de l’inflation du mois de juin prévue le jeudi 13 juillet.
Pourquoi le débat sur le taux du Livret A est-il devenu incontournable ?
Le Livret A n’est pas le produit le plus important en France. Son encours, fin mai 2023, a atteint 399,9 milliards d’euros quand celui de l’assurance vie dépasse 1883 milliards d’euros. Mais tous les Français ou presque ont un Livret A, quatre Français sur cinq. En comparaison, moins d’un ménage sur deux a un contrat d’assurance vie. En 2021, 54,9 millions de livrets étaient détenus par des personnes physiques. Le Livret A est souvent ouvert dès le plus jeune âge, voire à la naissance, par les parents ou les grands parents. Il accompagne durant toute leur vie les Français.
Le Livret A est à tort ou à raison considéré comme un produit d’épargne populaire. Y toucher est sacrilège. Ce caractère est en partie usurpé car une part importante de l’encours est réalisée par les ménages dits aisés. L’encours moyen d’un Livret A est de 5 800 euros mais 8 % des détenteurs ont atteint le plafond de 22 950 euros. Ces derniers détiennent 32 % de l’encours. Les plus de 65 ans représentent 34 % de l’encours.
Le Livret A, au-delà de sa large diffusion, bénéficie d’une aura au sein de la population. Le produit est simple à comprendre, son rendement s’applique à tous les livrets quel que soit leur date d’ouverture. Il est sans risque, avec à la clef une garantie totale du capital et des revenus capitalisés, garantie assurée par l’Etat. L’épargne est liquide, l’épargnant pouvant verser et retirer de l’argent à sa guise. Le livret A est, en outre, ce qui est un atout indépassable en France, exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux. Il n’y pas de frais apparents.
La fixation du taux du Livret A, une affaire éminemment politique
À la différence de l’assurance vie et de ses fonds euros dont leur rendement est fixé par les compagnies d’assurance, le taux du Livret A est national et est décidé par le gouvernement. Le taux des fonds d’assurance vie est une affaire privée quand celui du Livret A est une affaire éminemment politique.
Depuis une vingtaine d’années, l’idée que l’épargne du Livret A doit être protégée de l’inflation s’est imposée. Cela a été le cas de 2003 à 2016. Durant les années 1970 et au début des années 1980, le rendement réel du Livret A a été négatif.
De l’art de la formule ou comment y échapper
Les gouvernements ont essayé d’échapper à la politisation de la fixation du taux du Livret A en instituant une formule de calcul. La première règle de fixation a été institutionnalisée par du Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2004 avec comme objectif de maintenir le pouvoir d’achat des épargnants. Dès le départ, la formule prend en compte deux facteurs, l’inflation et les taux des marchés monétaires. Mais face aux variations des taux d’intérêt et de l’indice des prix ainsi qu’en raison de considérations d’ordre politique, les gouvernements successifs ont été amenés, à plusieurs reprises, soit à ne pas respecter la formule, soit à la modifier. Quatre formules se sont ainsi succédé depuis 2004.
La formule en vigueur date de l’arrêté du 27 janvier 2021. Le taux des livrets A, des livrets d’épargne est égal, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :
a) La moyenne arithmétique entre :
– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) ;
– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus
b) 0,5 %
Le gouverneur de la Banque de France peut proposer au Ministre de l’Economie de déroger à la stricte application de la formule au nom de « circonstances exceptionnelles ». Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre qui retrouve ainsi un pouvoir discrétionnaire.
Cette formule, en prenant la moyenne de l’inflation et des taux monétaire, ne garantit pas un rendement réel positif. Son élaboration visait à éviter que le taux du Livret A soit déconnecté des taux des marchés monétaires qui influencent les taux de rémunération des produits de court terme (dépôts à terme, livrets bancaires, etc.).
Sur les six premiers mois de l’année, le taux Ester est de 2,19 % et l’inflation devrait se situer autour de 5,7 % faisant une moyenne de 4 %.
Pour l’actualisation du 1er août une forte probabilité de circonstances exceptionnelles
Le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a promis un relèvement du taux du Livret A au nom de la protection de l’épargne des Français mais sans préciser s’il s’en tiendrait ou non à la formule. « Ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important », avait déclaré, le mercredi 3 mai à France Info, le Ministre. Il avait précisé « si jamais la conclusion de la formule et du gouverneur de la Banque de France, c’est que comme l’inflation est très élevée, il faut continuer à augmenter la rémunération du Livret A, je suivrai la recommandation du gouverneur », Il a complété que « c’est une proposition qui est faite par le gouverneur de la Banque de France et qui ensuite est validée par votre serviteur ».
Le taux du Livret A issu de la formule devrait ressortir à 4 %. Ce taux aurait comme avantage d’être proche de l’inflation et de garantir un rendement réel faiblement négatif voire nul.
Cette légitime protection des détenteurs du Livret A entre en conflit avec d’autres impératifs de la politique économique et financière des pouvoirs publics.
Une incitation à l’épargne au détriment de la consommation
Tout relèvement du taux du Livret A provoque une hausse de la collecte. Depuis le début de l’année, celle-ci bat record sur record. Elle s’est élevée du mois de janvier à mai à du Livret A a 24,5 milliards d’euros, soit la collecte la plus importante depuis la banalisation de la distribution du Livret A en 2009. Cette année, sur cinq mois, la collecte avait 22,76 milliards d’euros.
Les Français privilégient l’épargne de précaution à la consommation qui a reculé lors du premier trimestre 2023. Une nouvelle augmentation du Livret A pourrait accentuer cette préférence qui, par ricochet, porte préjudice à la croissance.
Un surcoût pour les emprunteurs
Une augmentation du taux du Livret A constitue une charge pour les banques et pour la Caisse des dépôts et consignations qui centralise jusqu’à 60 % des ressources collectées. Pour s’acquitter des 4 % dus aux détenteurs du Livret A, les banques doivent générer un rendement de plus de 4,3 % (0,3 point pour les frais de collecte) à partir de l’argent collecté. Cela peut les conduire à augmenter le taux des emprunts aux bailleurs sociaux, aux collectivités locales et aux PME (pour les ressources du LDDS). Par ailleurs, pour assurer la liquidité du Livret A, une partie des ressources est placée en titres monétaires et obligataires (essentiellement publics). Or les taux de ces derniers sont inférieurs à 4 %.
Pour le Livret A, le coût annuel de l’augmentation d’un point de sa rémunération est de 4 milliards d’euros pour les établissements financiers, sur la base de l’encours de fin mai (399,9 milliards d’euros). En prenant en compte le LDDS, le coût de la majoration d’un point est de 5,4 milliards d’euros.
Un surcoût pour l’État
Les intérêts des Livrets A, du LDDS et du Livret d’Épargne Populaire sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il en résulte un manque à gagner pour l’État et les régimes sociaux. Le manque à gagner sur l’encours est de 6,5 milliards d’euros (en appliquant le prélèvement forfaitaire unique à 30 %).
L’augmentation du taux du Livret A pèse également sur les bénéfices de la Caisse des dépôts et consignations, réduisant d’autant le montant des dividendes versés à l’État.
Une concurrence déloyale vis-à-vis des autres produits d’épargne ?
Un taux au-delà de 4 % constituerait un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que les autres produits de court terme (dépôts à terme, livrets bancaires) mais aussi que certains produits de long terme et en particulier les fonds euros de l’assurance vie. Pour le moment, la collecte du Livret A et du LDDS est essentiellement alimentée par les dépôts à vue qui avaient connu une forte croissance depuis le début de la crise sanitaire mais cela n’est pas sans conséquence sur les fonds euros des contrats d’assurance vie qui sont en décollecte depuis plusieurs mois.
Plus facile à augmenter qu’ à baisser
Le ministre de l’Économie pourrait justifier le non-respect de la formule en soulignant que l’inflation a amorcé sa décrue depuis deux mois. Une augmentation importante du taux du Livret A pourrait être perçue comme une crainte de reprise de l’inflation à l’automne. Si l’inflation diminue dans les prochains mois et que la hausse des taux directeurs arrive à son terme, le ministre de l’Économie pourrait être amené à baisser le taux du Livret A le 1er février 2024. Or, toute baisse du taux du Livret A constitue un psychodrame en puissance. En augmentant moins que la simple application de la formule le commande, le ministre sera moins exposé, le 1er février 2024, aux critiques.
Les pronostics
La fixation d’un taux à 4 % est peu probable. Un tel choix viserait à faire un geste aux épargnants au cœur de l’été après la séquence des retraites et des émeutes dans les banlieues.
La fixation d’un taux autour de 3,5 % permettrait de couper la poire en deux. Elle améliorerait le rendement du Livret A tout en tenant compte des intérêts des emprunteurs, des établissements financiers et de l’État.
Les gains pour les épargnants
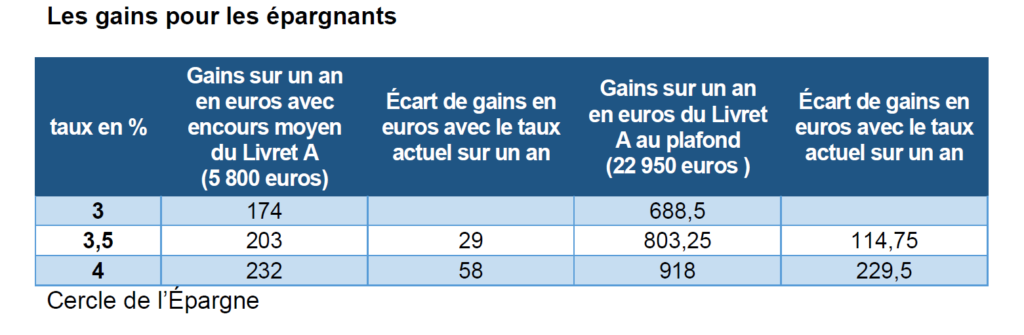
Le Coin des Epargnants du 7 juillet 2023 : les marchés en plein doute
Retour de manivelle pour les marchés financiers
Les investisseurs imaginaient que le péril inflationniste était derrière eux ; la publication, le jeudi 6 juillet dernier, des résultats l’enquête mensuelle ADP aux États-Unis leur a rappelé que ce n’était pas encore le cas. Selon l’enquête mensuelle ADP, 497 000 créations de poste dans le secteur privé ont été dénombrées en juin, un plus haut depuis plus d’un an et bien au-delà des 225 000 postes attendus par les économistes. Quant aux inscriptions hebdomadaires au chômage, elles n’accélèrent pas par rapport aux semaines précédentes. Cette annonce a provoqué un net recul, jeudi 6 juillet, des marchés « actions » et un rebond des taux d’intérêt des dettes souveraines.
Les résultats de l’emploi du mois de juin du Département du Travail, vendredi 7 juillet, ont néanmoins légèrement rassuré les investisseurs. Si le chômage y est toujours au plus bas à 3,6 % en juin, contre 3,7 % en mai, les créations d’emploi pour l’ensemble des secteurs d’activité se sont légèrement tassées. Elles se sont élevées en juin à 209 000 contre 220 000 attendues. Quant aux créations d’emplois des mois d’avril et de mai, elles ont été revues à la baisse, avec respectivement 217 000 et 306 000 emplois. Des signes de ralentissement se manifestent, la moyenne du nombre d’emplois créés par mois sur les six premiers mois de l’année est significativement moins élevée que la moyenne observée sur l’ensemble de l’année 2022 (respectivement 278 000 contre 399 000 emplois en moyenne). Parallèlement, le salaire horaire moyen a augmenté, en juin, de 0,4% par rapport au mois précédent, et de 4,4 % sur un an, un chiffre légèrement au-dessus des prévisions du marché, qui envisageait plutôt 0,3 % de hausse sur un mois.
Quoi qu’il en soit, Les investisseurs ont pris conscience que plusieurs hausses de taux directeurs seront peut-être encore nécessaires pour venir à bout de l’inflation. La pause décidée en juin par la FED dans le cycle de resserrement monétaire pourrait n’être que de courte durée. Les marchés avaient été rassurés par cette pause intervenue après dix hausses de taux consécutives des « Fed funds », ainsi portés dans une fourchette comprise entre 5 et 5,25 %. L’inflation aux États-Unis reste à un niveau élevé, à 4 % sur un an en mai, et 5,3 % hors produits volatiles comme l’alimentation et l’énergie.
Cette semaine, les investisseurs ont été également échaudés par la publication confirmant une baisse de l’activité au sein de toutes les zones économiques. Si celui-ci est logique au vu des politiques monétaires mises en œuvre, il commence à inquiéter car il touche, en même temps, l’ensemble des zones économiques. Le recul des indices PMI en Europe comme aux États-Unis fait craindre la survenue d’une récession. Les PMI de la zone euro indiquent que les économies des États membres sont tombées en contraction (de 52,8 vers 49,9) et la France n’est pas épargnée avec un vrai basculement de l’activité globale de 52,5 vers 48 dans le secteur privé. L’indice Markit PMI manufacturier américain final du mois de juin ressort à 46,3, contre une lecture de 48,4 en mai. Il traduit donc une nouvelle contraction de l’industrie manufacturière nationale américaine sur la période. L’indice PMI des « services » calculé par Caixin/S&P est en baisse passant de mai à juin de 57 à 53,9.
Dans ce contexte, les indices « actions » ont fortement reculé. Le CAC 40 a cédé sur la semaine près de 4 % et le Dax allemand près de 3,4 %. En contrepartie, les taux d’intérêt des obligations souveraines sont en hausse, le taux de l’OAT à 10 ans a dépassé les 3 % quand son homologue américain a franchi, de son côté, la barre des 4 %.
Pétrole, vers une nouvelle augmentation des cours ?
L’Arabie saoudite a annoncé, le lundi 3 juillet dernier, qu’elle prolongeait la réduction de sa production de pétrole d’un million de barils par jour pour soutenir le prix du baril en baisse. La réduction, qui a pris effet en juillet, se poursuivra en août et pourra être prolongée au-delà de cette période. Cette décision maintient à environ 9 millions de barils par jour la production de ce pays. Moscou compte, pour sa part, réduire ses exportations de 500 000 barils par jour, a assuré le vice-premier ministre, Alexandre Novak. Le pétrole russe est essentiellement acheté par la Turquie, l’Inde et la Chine.
Au premier semestre, le cours du baril de pétrole Brent ou WTI a perdu 12 %, du fait d’une demande atone tant en Chine qu’au sein de l’OCDE. Les baisses de production de l’OPEP+ ne sont pas encore pleinement ressenties ce qui permet le maintien du cours entre 72 et 75 dollars le baril. En avril dernier, plusieurs membres de l’OPEP+ avaient décidé de réduire volontairement leur production de plus d’un million de barils par jour.. Les producteurs de pétrole sont confrontés à une demande atone et à la forte volatilité des marchés en lien avec les effets persistants de la guerre en Ukraine. L’Arabie saoudite souhaite un cours entre 80 et 90 dollars afin de financer un programme de réformes ambitieux visant à préparer l’après pétrole d’où sa volonté de restreindre l’offre. Une augmentation au cours du second semestre n’est pas impossible en cas de redémarrage de l’économie mondiale. Sur la semaine, le pétrole s’est un peu réaffermi atteignant vendredi 7 juillet 77 dollars (baril de Brent).
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 7 juillet 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 111,88 | -3,81 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 734,88 | -1,540 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 398,95 | -1,09 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 15 036,85 | -0,94 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 603,40 | -3,39 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 27 746,80 | -1,71 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 236,60 | -3,54 % | 3 792,28 | 4,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 388,42 | -2,41 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 196,61 | -0,17 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,173 % | +0,143 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,624 % | +0,232 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,036 % | +0,215 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0964 | -0,07 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 928,25 | +0,80 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 77,74 | +3,48 % | 84,08 | 78,140 |
Cercle de l’Épargne
Poursuite de l’augmentation de la rémunération des dépôts bancaires
Avec la hausse des taux d’intérêt, la rémunération moyenne des dépôts bancaires progresse de 4 points à 1,48 % en mai. Celle des dépôts des ménages atteint 1,68 %. La rémunération des dépôts des sociétés non financières s’établit à 1,20 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et celle, plus limitée, des dépôts à vue.
Le taux des livrets ordinaires a atteint en mai 0,65 %.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| mai-2023 | mai-2022 | mars-2023 | avr- 2023 (f) | mai-2023 (g) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 102 | 0,50 | 1,38 | 1,44 | 1,48 |
| dont Ménages | 1 857 | 0,79 | 1,63 | 1,66 | 1,68 |
| – dépôts à vue | 592 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 41 | 0,38 | 2,48 | 2,65 | 2,81 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 66 | 0,69 | 1,12 | 1,20 | 1,29 |
| – livrets à taux réglementés (c) | 632 | 1,07 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| dont : livret A | 366 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| – livrets ordinaires | 257 | 0,09 | 0,54 | 0,60 | 0,65 |
| – plan d’épargne-logement | 269 | 2,58 | 2,56 | 2,60 | 2,55 |
| dont SNF | 857 | 0,09 | 1,01 | 1,13 | 1,20 |
| – dépôts à vue | 581 | 0,04 | 0,37 | 0,43 | 0,45 |
| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 218 | 0,09 | 2,45 | 2,67 | 2,87 |
| – comptes à terme > 2 ans (h) | 57 | 0,63 | 1,92 | 2,18 | 2,39 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | |
| Euribor 3 mois (d) | -0,39 | 2,91 | 3,18 | 3,37 | |
| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 0,94 | 2,79 | 2,73 | 2,69 | |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Moyenne mensuelle.
e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
f. Données révisées.
g. Données provisoires.
h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Le Coin des Epargnants du 30 juin 2023 : un semestre hors normes
3000 milliards d’euros d’un côté pour la dette publique française et 3000 milliards de dollars pour la capitalisation d’Apple : voilà qui pourrait résumer le premier semestre. Les marchés actions ont connu une croissance vive déjouant les pronostics quand, dans le même temps, les Etats sont de plus en plus confrontés au problème du financement de leurs dette. Les Etats-Unis ont évité le défaut de paiement au début du mois de juin avec un accord au dernier moment entre Républicains et Démocrates. En Europe, la France a été dégradé par l’agence Fitch mais a sauvé son double A chez Standard and Poors, pour combien de temps ?
Au cours du premier semestre, le CAC 40 a battu plusieurs records et a gagné au total 14 % porté notamment par le secteur du luxe. La hausse des taux d’intérêt et les craintes d’une récession ont pu freiner la hausse mais sans jamais l’interrompre durablement. Pour le mois de juin, l’indice parisien a progressé de 1,8 % sachant que sur la dernière les gains ont atteint 3,3 %.
Les grands indices « actions » internationaux ont fortement progressé durant le premier semestre. L’indice allemand, Daxx, a gagné 16 % en six mois. L’indice japonais s’est apprécié de son côté de 27 %. A New York, l’indice S&P 500 a progressé de 16 % quand le Nasdaq a augmenté de plus de 30 %, preuve du retour en force des valeurs technologiques.
Les investisseurs ont salué les bons résultats des entreprises tout en anticipant un retour rapide à la normale de l’inflation éludant les risques de récession. Cette analyse a été confortée à la fin du mois de juin par la baisse de l’inflation même si elle est avant tout provoquée par un effet de base (les prix de l’énergie avaient fortement augmenté en mai et juin 2022). Hors prix de l’énergie et de l’alimentation, la hausse des prix continue à être soutenue. Pour la zone euro, elle a augmenté, en juin, à 5,4 % contre 5,3 % en mai. Pour Christine Lagarde, l’inflation demeure encore présente et nécessite le maintien d’une politique monétaire restrictive.
Aux Etats-Unis, l’indice PCE des dépenses de consommation a augmenté de 3,8 % sur un an après 4,3 % en avril. Hors alimentation et énergie, critère considéré comme le plus pertinent par la Fed, le déflateur marque même un ralentissement surprise à 4,6 % sur un an, après 4,7 % en avril. Quant à la composante des anticipations d’inflation à 1 an, elle a été confirmée à 3,3%, après 4,2 % en mai et celle des anticipations à 5-10 ans est également maintenue à 3 %, après 3,1 % le mois précédent.
En six mois, le cours du baril de Brent a perdu près de 13 %. Plus globalement, les cours de l’énergie et des matières premières sans totalement retrouver leur cours d’avant la guerre en Ukraine ont enregistré ces six derniers mois une forte décrue qui se répercute en partie sur l’inflation des pays de l’OCDE.
Les taux des obligations d’Etat ont peu évolué, malgré la hausse des taux directeurs des banques centrales, les investisseurs ayant anticipé une grande partie de ces dernières. Les obligations bénéficient par ailleurs toujours de l’aversion aux risques des détenteurs de capitaux.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 30 juin 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 400,06 | -3,05 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 407,60 | +2,0 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 450.38 | +2,45 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 787,92 | 2,2 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 16 147,90 | +2,0 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 531,53 | +0,9 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 401,39 | +2,98 % | 3 792,28 | 4 ,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 33 189,04 | +1,24% | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 202,06 | +0,13 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,930 % | +0,046 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,392 % | +0,031 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,821 % | +0,081 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0914 | -0,23 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 917,96 | +0,00 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 73,92 | -3,42 % | 84,08 | 78,140 |
Assurance vie : trou d’air en mai !
Au mois de mai, l’assurance vie a connu un trou d’air avec une décollecte de 1,6 milliard d’euros. La précédente décollecte était intervenue au mois d’octobre 2022 (-155 millions d’euros). Pour retrouver une décollecte aussi importante, il faut remonter en pleine crise covid, en mai 2020 (-2 milliards d’euros). Sur les cinq premiers mois de l’année, la collecte nette n’est plus que de 2,7 milliards d’euros loin de celle du Livret A (24,5 milliards d’euros). La collecte nette de 2023 de l’assurance vie est en net repli par rapport à celle de 2022 (11,7 milliards d’euros).
La collecte nette est toujours pénalisée par les sorties sur les fonds euros (-3,3 milliards d’euros en net). La collecte nette des unités de compte demeure, de son côté, positive (+1,7 milliard d’euros).
Avant le cru 2023, mai pour l’assurance vie était logiquement un mois tranquille à l’exception de la décollecte en 2020 lors de la crise sanitaire. Le montant moyen de la collecte nette de la décennie passée était de 0,8 milliard d’euros.
Une baisse des cotisations brutes
Les cotisations brutes du mois de mai 2023 (10,1 milliards d’euros) ont reculé de 13 % par rapport à leur niveau de 2022 (11,5 milliards d’euros). Au mois d’avril dernier, elles avaient atteint 13,8 milliards d’euros. La baisse a concerné les fonds euros comme les unités de compte. La part des unités de compte au sein des cotisations reste constante autour de 40 %.
Sur les cinq premiers mois de l’année, les cotisations brutes se sont élevées à 65,6 milliards d’euros en hausse d’1,1 milliard d’euros par rapport à 2022.
Des prestations toujours élevées
Les prestations se sont maintenues à un haut niveau au mois mai 2023, 11,7 milliards d’euros, contre 12,8 milliards d’euros en avril et 10,8 milliards d’euros en mai 2022.
Depuis le début de l’année, les prestations s’établissent à 62,9 milliards d’euros, en hausse de +10,1 milliards d’euros par rapport à la même période de 2022.
Un encours proche de 1900 milliards d’euros
L’encours atteint 1 883 milliards d’euros à fin mai, en hausse de +2,0 % sur un an grâce à la bonne tenue du marché « actions »
L’assurance vie victime de l’engouement pour l’épargne de précaution
Si les Français persistent à mettre de l’argent de côté, ils privilégient l’épargne de précaution comme en témoigne la série de records du Livret A. Ce produit dont l’encours est près de cinq fois inférieur à celui de l’assurance vie et qui est plafonné par titulaire à 22 950 euros réussit le tour de force d’avoir une collecte neuf fois supérieure. Au-delà du Livret A, l’ensemble des produits d’épargne réglementée profite de l’effet taux. Ces derniers sont, en effet, supérieurs, au rendement moyen des fonds euros ce qui conduit à la décollecte de ces derniers. Si les unités de compte avaient, jusqu’au mois d’avril, compensé les sorties sur les fonds euros, ce ne fut pas le cas en mai.
Preuve que les ménages réalisent des arbitrages au niveau de leur patrimoine, les prestations des contrats d’assurance vie sont toujours soutenues. Les annonces des assureurs concernant une revalorisation des taux de rendement pour 2023 (taux boostés par exemple) n’ont pas eu de réels effets sur la collecte. En période d’inflation, la préférence pour l’épargne liquide est de mise.
Des prochains mois en demi-teinte pour l’assurance vie
Le relèvement du taux du Livret A et du LDDS, le 1er août prochain, fort probable au vu des déclarations du ministre de l’Economie, devrait conduire à un nouveau rebond de la collecte pour ces produits. L’assurance vie devrait en pâtir. La fin d’année avec une décrue de l’inflation pourrait conduire les épargnants à revenir sur des produits de long terme.
Le Plan d’Epargne Retraite toujours en pleine croissance
Le Plan d’Epargne Retraite (PER) ne souffre pas, bien au contraire du trou d’air de l’assurance vie. Il continue de progresser avec, en mai, une collecte nette de 484 millions d’euros en hausse de 97 millions d’euros par rapport à mai 2022. Plus de 70 000 personnes ont ouvert un PER en mai portant le total à 4,8 millions. Sur les cinq premiers mois de l’année, ce sont près de 440 000 nouveaux assurés qui ont été comptabilisés pour ce produit.
Le Plan d’Epargne Retraite, avec son avantage fiscal à l’entrée, sa sortie en capital et la possibilité de s’en servir avant même l’âge de la retraite pour acquérir sa résidence principale en fait un concurrent de plus en plus marqué de l’assurance vie.
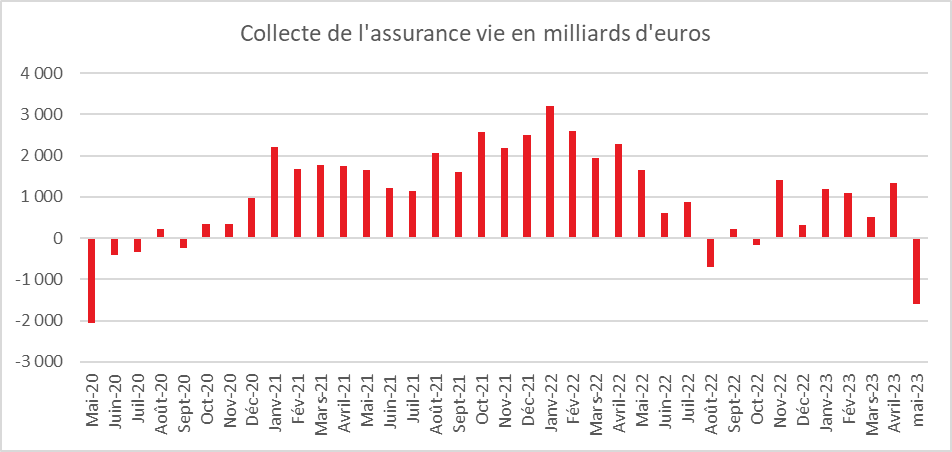
Cercle de l’Epargne – France Assureurs
Le Coin des Epargnants du 24 juin 2024 : mauvaise passe pour les marchés « actions »
Une semaine en creux pour les marchés
Mauvaise, passe, le Cac 40 a enchainé cinq séances de recul. Sur la semaine, l’indice parisien a ainsi perdu 3,05 %, soit son plus mauvais résultat depuis les annonces mi-mars, de faillites bancaires aux Etats-Unis. Les indices des grandes places financières ont également été en baisse sur la semaine.
La publication de mauvais indicateurs économiques en zone euro et aux Etats-Unis a amené les investisseurs à se dégager du marché actions pour privilégier les obligations. Selon l’indice avancé PMI de Standard and Poors, la croissance économique du secteur privé dans la zone euro a fortement ralenti en juin, tombant à un niveau proche de zéro, En France, l’activité économique a subi en juin sa plus forte contraction en 28 mois, avec notamment un repli dans le secteur des services.
La semaine a été encore très animée par les banques centrales, avec plusieurs réunions au cours de la semaine, et deux prises de parole du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell devant le Congrès américain. La Banque de Norvège, de Suisse et d’Angleterre ont, cette semaine, suivant la BCE, relevé leurs taux directeurs. Les augmentations ont été supérieures aux attentes. Le Forum de Sintra, au Portugal, qui rassemblera, à partir du 26 juin, quelques grands argentiers de la planète est attendu par les investisseurs.
Les taux des obligations d’Etat se sont détendus du fait des arbitrages en leur faveur des investisseurs. Compte tenu du contexte économique peu porteur, le pétrole a perdu sur la semaine plus de 3 %.
Baisse des taux en Chine
Si les banques centrales occidentales augmentent leurs taux directeurs, celle de Chine pour ranimer la croissance, a abaissé les siens. Le 19 juin, le taux préférentiel des prêts à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,65 % à 3,55 %, et celui à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, a été abaissé de 4,3 % à 4,2 %. Ces deux taux sont désormais à leur plus bas historique. Ils avaient été réduits pour la dernière fois en août 2022.
Ce desserrement de la politique monétaire vise à endiguer le ralentissement de l’économie chinoise qui est pénalisée par le surendettement du secteur immobilier et par une consommation atone dans un contexte international peu porteur pour les exportations. Pour décourager l’épargne et favoriser les dépenses de consommation ou d’investissement, les principales banques publiques ont déjà, en début de mois, abaissé les taux d’une série de produits de dépôt. Le gouvernement chinois espère un taux de croissance d’environ 5 % en 2023, un taux qui serait pour le pays l’un des plus faibles depuis des décennies.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 23 juin 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 163,42 | -3,05 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 727,43 | -1,98 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 348,33 | -1,39 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 14 891,48 | -1,28 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 15 829,94 | -3,23 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 461,87 | -2,37 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 271,61 | -2,80 % | 3 792,28 | 4 ,298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 32 781,54 | -2,74 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 197,90 | -2,30 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,884 % | -0,087 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,361 % | -0,107 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,740 % | -0,040 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0892 | -0,72 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 919,57 | -1,84 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 73,92 | -3,42 % | 84,08 | 78,140 |
Les Français, l’inflation et la hausse des taux
Selon l’enquête réalisée par MIS Groupe pour le salon Patrimonia, 82 % des Français sont inquiets face à l’inflation. 55 % craignent tout particulièrement l’impact de la hausse des prix des produits alimentaires. Cette enquête souligne néanmoins que par rapport à 2022 moins de Français déclarent être contraints de puiser dans leur épargne. Selon l’enquête AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – CERCLE DE L’ÉPARGNE, les Français préfèrent diminuer leurs dépenses de consommation que de puiser dans leur bas de laine.
44 % se sentent également préoccupés par l’évolution des taux d’intérêt. 30 % des Français craignent de ne plus pouvoir emprunter ou rembourser leur prêt immobilier, tandis que 14 % redoutent de ne pas pouvoir vendre leur bien ou de devoir en baisser le prix. En revanche 24 % estiment que la hausse des taux permet une meilleure rémunération de leur épargne. 32 % des Français déclarent ne pas être touchés par la hausse des taux.
Les Français restent pessimistes : 39 % pensent qu’une crise financière et économique est inévitable. Cette proportion est néanmoins en recul par rapport à 2022.
Face à l’inflation et la hausse des taux, 53 % n’ont toujours pas modifié leurs placements Seuls un quart des sondés ont effectué de réels changements. 19 % sont à la recherche de solutions pour sécuriser leur patrimoine et 15 % ont renoncé à investir dans l’immobilier.
Rapport du COR 2023 : des déficits et une baisse du niveau de vie à venir des retraités
Des régimes de retraite de nouveau déficitaires
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) dans son rapport annuel publié le jeudi 22 juin souligne que les régimes de retraite après deux années d’excédents en 2022 et 2023 renoueraient avec les pertes en 2024. Ces pertes perdureraient malgré la réforme des retraites jusqu’en 2030, en se situant entre 0,2 et 0,3 point de PIB, soit entre 5 et 8 milliards par an. Au-delà, les comptes resteraient déficitaires dans trois des quatre scénarios de croissance étudiés et ne redeviendraient positifs qu’ « après 2045 » dans le meilleur des cas.
Les déficits seraient en grande partie imputables aux régimes de la fonction publique et en particulier de celui des agents des agents territoriaux et hospitaliers (CNRACL). La faible progression de la masse salariale du fait d’un nombre réduit de création de postes pèserait sur les cotisations et donc sur l’équilibre général. Le régime général resterait à l’équilibre jusqu’en 2030 avant d’enregistrer de nouvelles pertes dans trois scénarios sur quatre. À l’inverse, le régime complémentaire du secteur privé, Agirc-Arrco serait excédentaire sur toute la période.
Un taux de remplacement et niveau de vie des retraités en baisse
Le taux de remplacement (rapport entre les pensions et les revenus d’activité) baisserait, selon le Conseil d’Orientation des Retraites, en moyenne de 8 points dans les prochaines années pour les générations qui liquideront leurs droits à la retraite. La baisse sera assez sensible pour les fonctionnaires du fait de l’augmentation des primes dans leur rémunération.
Le niveau de vie des retraités qui était de 5 % au-dessus de celui de l’ensemble de la population dans les années 2010 ne l’est plus que de 1,5 %. Les augmentations de prélèvements et la sous-indexation des pensions par rapport aux prix et aux revenus d’activité expliquent cette dégradation. D’ici 2035, le niveau de vie des retraités passera en-dessous de celui de l’ensemble de la population. En 2045, il serait 10 % en-deçà.
Le Livret A ne faiblit pas en mai
L’épargne réglementée, en ce premier semestre 2023, n’en finit pas d’accumuler des records. La collecte du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire a ainsi atteint, selon la Caisse des dépôts et consignations (CDC), au mois de mai dernier, 3,52 milliards d’euros portant le total sur cinq mois à 32,38 milliards d’euros, montant sans précédent depuis 2009 (première année de la série statistique tenue par la CDC).
Le Livret A en marche pour une nouvelle année exceptionnelle
La collecte du Livret A s’est élevée, en mai, à 2,47 milliards d’euros soit plus qu’en avril dernier (2,33 milliards d’euros) et qu’en mai 2022 (1,37 milliard d’euros). Le montant de la collecte est plus de deux fois supérieur à la moyenne de ces dix dernières années (1 milliard d’euros). Sur les cinq premiers mois de l’année, la collecte du Livret A a été de 24,5 milliards d’euros ce qui constitue un nouveau record. Le précédent datait de 2009 au moment de la banalisation de la distribution du Livret A (22,76 milliards d’euros).
Le Livret A contredit la tradition
En règle générale, le mois de mai est poussif pour le Livret A. Quatre décollectes ont été enregistrées depuis 2009 (2009, 2010, 2014, 2015). A contrario, la plus forte collecte pour un mois de mai a été enregistrée durant la crise covid en 2020 (3,98 milliards d’euros). Jusqu’à maintenant, les résultats décevants du mois de mai s’expliquaient par la présence de jours fériés et par l’absence de versements de primes. En mai, logiquement, l’effet « actualisation du taux de rémunération », quatre mois après son annonce, s’estompe. Or, ce n’est pas le cas en 2023. Les déclarations du ministre de l’Économie, au début du mois (le 3 mai) confirmant qu’une hausse du taux pourrait intervenir le 1er août prochain, ont pu conduire les ménages à poursuivre leur effort d’épargne. Par ailleurs, ces derniers, comme l’ont confirmé les enquêtes de l’INSEE, restent inquiets face à l’évolution de la situation économique. Ils persistent à privilégier l’épargne à la consommation qui est en baisse constante depuis le début de l’année. Au premier trimestre 2023, selon l’INSEE, le taux d’épargne était de 18,3 % soit trois points au-dessus de son niveau d’avant crise sanitaire. Les ménages estiment, en effet, nécessaire de maintenir un fort niveau d’épargne de précaution afin de faire face à la hausse à venir des prix. Ils poursuivent également la réallocation d’une partie de leurs liquidités logées sur leurs comptes courants au profit du Livret A ou du LDDS. Selon la Banque de France, l’encours des dépôts à vue est, en effet, passé de septembre 2022 à avril 2023 (dernier chiffre connu) de 542 à 506 milliards d’euros. Conscients des conséquences de l’inflation sur leurs liquidités, les ménages les placent sur des livrets rémunérés. Si le taux de rémunération ne couvre pas totalement l’inflation, il permet d’en réduire les effets.
Le Livret A flirte avec les 400 milliards d’euros
L’encours du Livret A a atteint, à la fin du mois de mai 399,9 milliards d’euros, un niveau sans précédent dans son histoire.
Le Livret de Développement Durable Solidaire, sur les pas de son grand frère
La collecte du mois de mai du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a été de 1,05 milliard d’euros, contre 1,15 milliard d’euros en avril et 0,16 au mois de mai 2022. Sur les cinq premiers mois, le LDDS a enregistré un flux net de 7,87 milliards d’euros portant son encours à 142,2 milliards d’euros. En 2023, le LDDS signe ainsi son meilleur début d’année depuis 2009. Sur cinq mois, le précédent record datait de 2013 (6,21 milliards d’euros) au moment du doublement de son plafond (12 000 euros au lieu de 6 000 euros).
Le LDDS bénéficie de la saturation des Livrets A. Les ménages ayant atteint le plafond de 22 950 euros sur leur Livret A se reportent sur leur LDDS. Par ailleurs, les LDDS sont, en règle générale, ouverts dans la même banque que le compte courant ce qui permet de réaliser facilement des transferts.
Quel taux pour le Livret A et le Livret d’Épargne Populaire, le 1er août prochain ?
Le taux du Livret A devrait être révisé à la hausse, le 1er août prochain, compte tenu de l’engagement pris au début du mois de mai par Bruno Le Maire. L’annonce sera réalisée, à la mi-juillet, après la communication officielle du taux d’inflation du mois de juin.
La question est donc de savoir si la formule du taux comme elle est définie par l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée sera respectée ou si le Gouverneur de la Banque de France invitera le ministre, en raison de circonstances exceptionnelles, de fixer le taux.
Un taux d’au moins 4 % selon la formule
Compte tenu des éléments de la formule, le taux du Livret A pourrait se situer au 1er août 2023 autour de 4 %. Le taux du Livret A est en effet égal à la moyenne de l’inflation (hors tabacs) des six derniers mois (certainement autour de 5,6 %) et du taux €STR du marché monétaire des six derniers mois (environ 2,5 %).
Vers une non-application de la formule
Le Gouverneur de la Banque de France pourrait recommander de ne pas suivre la formule pour plusieurs raisons. Une hausse d’un point du taux du Livret A génèrerait un surcoût non négligeable pour les établissements financiers (4 milliards d’euros sur un an), pour les bailleurs sociaux ainsi que pour les collectivités locales ou les PME qui empruntent à partir des ressources issues du Livret A ou du LDDS. Les banques pourraient être amenées à répercuter le surcoût de la hausse du taux sur les emprunts. Un taux élevé pourrait également conforter les Français à privilégier l’épargne au détriment de la consommation ce qui nuirait à la croissance. Un relèvement du taux du Livret A pénaliserait les autres placements. À 4 %, il ferait un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que des produits de long terme. Enfin, l’inflation étant orientée à la baisse, une hausse importante pourrait apparaître en décalage par rapport à la tendance à venir. Le gouvernement pourrait être contraint d’opérer une baisse significative du taux de rendement d’ici quelques mois, ce qui serait impopulaire. Compte tenu de ces différents éléments, le ministre de l’Économie pourrait retenir le taux de 3,5 %, un taux à mi-chemin entre celui actuellement en vigueur et celui résultant de l’application de la formule. Pour le Livret d’Épargne Populaire, le taux pourrait passer de 6,1 à 5,6 % le 1er août prochain.
Logiquement, une décrue de la collecte est attendue pour le second semestre en raison des besoins financiers liés aux vacances d’été, à la rentrée scolaire et aux fêtes de fin d’année. Un relèvement du taux du Livret A devrait contrarier cette tradition, du moins dans les premiers mois suivant l’annonce. Les ménages devraient, par ailleurs, continuer de réallouer leurs liquidités des comptes courants vers les produits d’épargne réglementée. En fin d’année, si l’inflation se modère, les ménages pourraient reprendre le chemin de la consommation et modérer ainsi leur effort d’épargne.
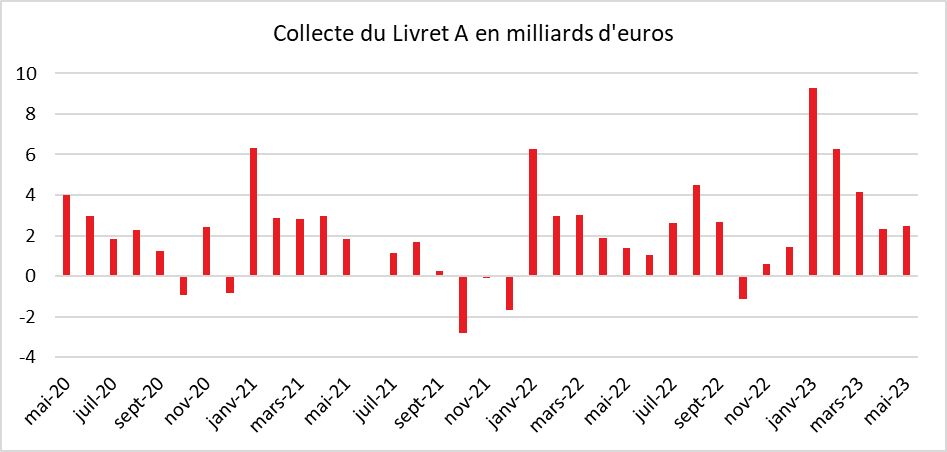
Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations
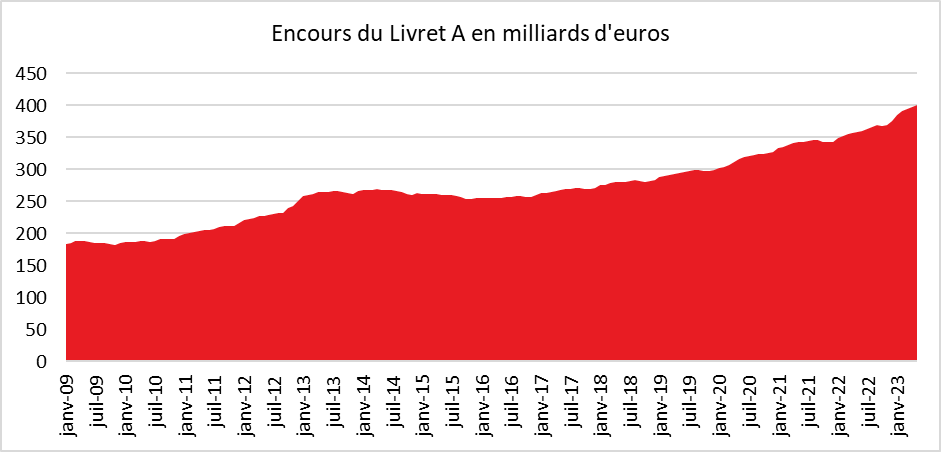
Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations
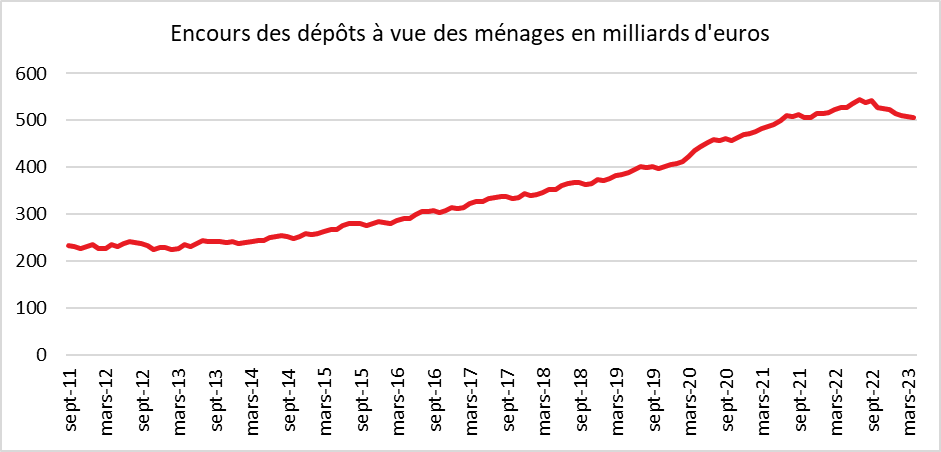
Cercle de l’Épargne – Banque de France
Epargne retraite, une belle progression en 2021
En 2021, les contrats d’épargne retraite supplémentaire ont donné lieu, selon la DREES, à près de 20 milliards d’euros de cotisations, en hausse de 23,7 % en euros constants par rapport à 2020 marquée par la crise covid. Par ailleurs, l’année 2021 a été la première année pleine de commercialisation du nouveau Plan d’Epargne Retraite. Le montant des prestations versées au titre de contrats de retraite supplémentaire s’est élevé à plus de 7,6 milliards d’euros. Les provisions mathématiques de l’ensemble des contrats d’épargne retraire a atteint 266 milliards d’euros en 2021, contre 219 milliards d’euros en 2016.
La place de la retraite supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite (légalement obligatoires ou non) reste, en France, faible. La part des cotisations versées à ce titre par rapport à l’ensemble des cotisations acquittées a atteint 5,8 % en 2021, tandis que les prestations servies augmentent à 2,3 % de l’ensemble des prestations de retraite versées. En moyenne, au sein de l’OCDE, ce ratio est de 15 %.
Le Coin des Epargnants du 17 juin 2023 : les actions plus fortes que les taux
Le CAC 40 met fin à trois semaines de disette
Cette semaine, le CAC 40 40 a gagné 2,43 %, dont 1,34 % vendredi 16 juin, mettant fin à trois semaines consécutives de repli. Les autres grands indices sont également en hausse ces cinq derniers jours. Les investisseurs n’ont pas surréagi à la hausse des taux de la BCE ni aux annonces de la FED laissant entrevoir également de nouvelles augmentations de taux. En revanche, ils anticipent l’annonce d’un plan de relance en Chine. Cet espoir a profité au secteur du luxe (Kering, Hermès, L’Oréal et LVMH).
Avec le relèvement des taux directeurs par la BCE, l’euro s’est apprécié face au dollar, les taux des obligations souveraines étant en légère progression. Les investisseurs avaient largement anticipé les décisions des banques centrales.
Politique monétaire, stabilité des taux aux États-Unis, hausse en zone euro
La FED temporise
Après dix augmentations successives de ses taux directeurs, la Réserve fédérale américaine (FED) a décidé, mercredi 14 juin, de les maintenir dans une fourchette comprise entre 5 % et 5,25 %. Cette pause était largement anticipée par les investisseurs. Cette stabilisation ne signifie pas que la FED se résigne à ne plus les augmenter dans le futur.
Cette décision de la FED s’inscrit dans le contexte de léger recul de l’indice des prix. Au mois de mai, celui-ci est revenu à 4 % sur un an, quand il avait atteint un record de 9,1 % en juillet 2022. Malgré tout, hors énergie et alimentation, le taux d’inflation annuel reste de 5,3 %, c’est-à-dire un niveau bien supérieur à la cible de 2 % voulue par la FED. Il n’est donc pas impossible que, d’ici à la fin de 2023, la banque centrale relève de nouveau ses taux à deux reprises pour atteindre la fourchette 5,5 %-5,75 %. La bonne tenue de l’emploi est un des facteurs pouvant justifier de nouvelles hausses de taux. L’économie américaine reste dynamique et la FED n’entend pas réitérer les erreurs des années 1970, quand elle avait assoupli trop rapidement sa politique monétaire. Au niveau des prévisions économiques, la FED prévoit désormais une croissance d’1 % pour les États-Unis en 2023, contre 0,4 % initialement prévu en mars. Elle table sur un taux de chômage annuel de 4,1 % (contre 4,5 % prévu en mars) et une inflation hors énergie et alimentation de 3,9 % (contre 3,6 % en mars). Ces prévisions confortent l’idée d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine.
La BCE poursuit son programme de relèvement de ses taux directeurs
Jeudi 15 juin, la BCE a relevé ses taux directeurs pour la huitième fois. La hausse d’un quart de point était attendue. Le taux de dépôt est passé à 3,5 %, le taux de refinancement à 4 % et celui de la facilité de prêt marginal à 4,25 %. Le taux de dépôt évolue désormais à son plus haut niveau depuis mai 2001.
Lors de la conférence de presse, Christine Lagarde a souligné que cette augmentation se justifiait par l’absence de signes clairs concernant l’inflation sous-jacente (hors prix de l’énergie et de l’alimentation). Elle s’est inquiété des effets des hausses de salaires en cours. Celle-ci atteint désormais 4,6 % en rythme annuel. À ce titre, la BCE a relevé ses anticipations d’inflation sous-jacente pour 2023 et 2024. Elles sont passées respectivement de 4,6 % et 2,5 % à 5,1 % et 3 %. Les prévisions portant sur la croissance européenne ont été revues à la baisse pour notamment prendre en compte le fait que la zone euro est entrée en légère récession. La croissance en 2023 serait de 0,9 % pour la zone euro. Elle passerait à 1,5 % en 2024 et 1,6 % en 2025. Dans ce contexte, Christine Lagarde a indiqué que l’heure n’était pas à la pause.
La BCE a confirmé l’arrêt définitif des réinvestissements dans le cadre de son principal programme d’achat d’actifs (Asset purchase programme ou APP). Les obligations de son portefeuille arrivant à maturité ne donneront plus lieu à des rachats de nouvelles obligations. Le retrait de liquidité devrait désormais approcher les 30 milliards par mois. Ce non-renouvellement des obligations vise à diminuer le bilan de la BCE qui a atteint avec la crise sanitaire près de 9 000 milliards d’euros. Plus que l’arrêt des achats obligataires, c’est le remboursement des TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations) qui devrait avoir le plus d’impact en termes de réduction du bilan. Le 28 juin prochain, les banques vont en effet rembourser pour plus de 500 milliards d’euros de ces prêts de long terme aux taux très attrayants. La BCE n’a pas prévu de prolonger ces TLTRO, ni de proposer de nouvelle source de financement exceptionnelle. Cette situation pourrait créer quelques tensions pour des banques en manque de liquidités. La BCE a précisé que les banques pouvaient accéder à la facilité de refinancement de la BCE – désormais à 4 % – pour faire face à cette situation.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 16 juin 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 7 388,65 | +2,35 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
| Dow Jones | 34 299,12 | +1,39 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
| S&P 500 | 4 409,59 | +2,87 % | 3 839,50 | 4766,18 |
| Nasdaq | 13 689,57 | +3,35 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 16 378,75 | +2,62 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
| Footsie (Royaume-Uni) | 7 641,95 | +1,09 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
| Eurostoxx 50 | 4 394,82 | +2,45 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
| Nikkei 225 (Japon) | 33 706,08 | +4,47 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 273,33 | -1,30 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
| Taux OAT France à 10 ans | +2,971 % | +0,054 pt | +3,106 % | +0,193 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,468375 % | +0,093 pt | +2,564 % | -0,181 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,780 % | +0,028 pt | +3,884 % | +1,505 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0925 | +1,58 % | 1,0697 | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 956,71 | -0,04 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 75,87 | +1,36 % | 84,08 | 78,140 |
Les Français épargnent malgré et à cause de l’inflation
A priori, cela ressemble à un paradoxe. Le taux d’épargne des ménages français reste élevé malgré l’inflation et l’érosion du pouvoir d’achat. Dans sa note de conjoncture du 15 juin 2023, l’INSEE prévoit un taux d’épargne de 18,1 % du revenu disponible brut cette année, contre 17,5 % en 2022. Ce taux d’épargne reste nettement supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %).
En 2023, toujours selon l’INSEE, le pouvoir d’achat par unité de consommation devrait être étale après avoir baissé de 0,4 % en 2022. Le maintien d’un fort taux d’épargne s’effectue au détriment de la consommation. En 2023, celle-ci devrait baisser de 0,2 %. La contraction atteint 6,6 % pour les produits agricoles et 3,5 % pour les produits manufacturés. En revanche, les services sont préservés avec une hausse de 2,7 % (les dépenses de transports augmentent du fait de l’inflation de plus de 6 %). Cette baisse de la consommation prévue par l’INSEE confirme les résultats de l’enquête d’AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – Cercle de l’Épargne (réalisée par l’IFOP) d’avril 2023. 43 % des sondés déclaraient vouloir réduire leurs dépenses de consommation quand seulement 13 % pensaient puiser dans leur épargne. Par ailleurs, les ménages ont fortement réduit leurs dépenses d’investissement, ce qui leur permet d’épargner davantage.
Inquiétudes à tous les étages : inflation, transition énergétique, géopolitique et retraite
Cette propension à l’épargne témoigne de la persistance d’un fort niveau d’inquiétude chez les Français qui est confirmé, mois après mois, par le faible indice de confiance des ménages. Craignant que la situation économique continue à se dégrader, ils préfèrent mettre de l’argent de côté. L’épargne de précaution prédomine comme en témoigne la forte collecte du Livret A (plus de 22 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de 2023 et la modestie de la collecte de l’assurance vie sur la même période). Cette volonté de disposer d’une importante épargne de court terme vise à faire face à des achats dont le montant pourrait encore augmenter en raison de la poursuite de l’inflation. D’autres facteurs anxiogènes sont également à prendre en compte comme la transition énergétique ou la situation géopolitique. Le vieillissement démographique qui est de nature structurelle contribue également à la hausse de l’épargne qui avait commencé avant la crise sanitaire. Le poids des personnes de plus de 45 ans au sein de la population augmente ; or ces tranches d’âge sont celles qui préparent financièrement leur retraite en épargnant. Toujours selon l’enquête d’AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – Cercle de l’Épargne, 72 % des Français en âge de travailler estiment que leurs pensions ne suffiront pas pour vivre correctement et 59 % mettent de l’argent de côté pour leur retraite.
La hausse du rendement des produits de taux incite à l’épargne
Même si le rendement réel des livrets reste négatif (sauf pour le Livret d’épargne populaire), les ménages ont accru leurs versements dès les annonces de relèvement des taux. Sur le premier trimestre, le Livret A a ainsi obtenu sa meilleure collecte depuis 2009.
Une reprise de la consommation pour la fin de l’année
La baisse de l’inflation attendue au cours du second semestre devrait conduire les ménages à relâcher leurs efforts en matière d’épargne en se faisant davantage plaisir. Les dépenses de consommation pourraient repartir alors à la hausse.
En privilégiant l’épargne, les Français se distinguent des Américains qui restent des adeptes invétérés de la consommation. Ils ont en grande partie épuisé leur cagnotte covid quand les Français n’y touchent pas en moyenne. Il faut, en effet, souligner que les 20 % des Français les plus modestes ont été contraints de ponctionner leur épargne pour faire face à la hausse des prix. Ce sont les 40 % les plus riches et surtout les 20 % disposant les revenus les plus élevés qui, en France, placent leur argent sur des produits financiers.
La French Tech française toujours en pointe
La French Tech tenait salon (VivaTech) à Paris du 14 au 17 juin à Paris Expo. Malgré le ralentissement des levées de fonds et la baisse des valorisations, elle demeure dynamique en étant à l’origine de 13 000 créations d’emplois depuis janvier. La profession s’attend à une hausse des emplois de plus de 12 % sur un an (30 000 au total), loin du mouvement de destruction que les États-Unis connaissent. Néanmoins, certaines start-ups ont dû réduire leurs effectifs (Payfit, Back Market et Ankorstore par exemple). Sur le plan européen, la France se classe au deuxième rang dans le domaine des start-ups, derrière le Royaume Uni.
Parmi les start-ups en France, celles en lien avec la transition énergétique sont en forte croissance. Dans un contexte baissier pour les levées de fonds (-60 %), ces dernières ont récolté 172 % de fonds en plus en 2022, selon le dernier rapport EY, pour atteindre 2 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, les levées de fonds sont de nouveau orientées à la hausse, +40 % par rapport au dernier trimestre 2022. Le nombre d’opérations a enregistré une hausse 15,6 % sur la même période. Sur le premier quadrimestre, plus de 300 entreprises ont levé des fonds et leur nombre devrait avoisiner 1 000 sur l’ensemble de l’année 2023.
Note de Conjoncture de l’INSEE : les Français épargnent malgré et à cause de l’inflation
A priori, cela ressemble à un paradoxe. Le taux d’épargne des ménages français reste élevé malgré l’inflation et l’érosion du pouvoir d’achat. Dans sa note de conjoncture du 15 juin 2023, l’INSEE prévoit un taux d’épargne de 18,1 % du revenu disponible brut cette année, contre 17,5 % en 2022. Ce taux d’épargne reste nettement supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %).
En 2023, toujours selon l’INSEE, le pouvoir d’achat par unité de consommation devrait être étale après avoir baissé de 0,4 % en 2022. Le maintien d’un fort taux d’épargne s’effectue au détriment de la consommation. Celle-ci devrait baisser en 2023 de 0,2 %. La contraction atteint 6,6 % pour les produits agricoles et 3,5 % pour les produits manufacturés. En revanche, les services sont préservés avec une hausse de 2,7 % (les dépenses de transports augmentent du fait de l’inflation de plus de 6 %). Cette baisse de la consommation prévue par l’INSEE confirme les résultats de l’enquête du Cercle de l’Epargne (réalisée par l’IFOP) d’avril 2023. 43 % des sondés déclarent vouloir réduire leurs dépenses de consommation quand seulement 13 % pensaient puiser dans leur épargne. Par ailleurs, les ménages ont fortement réduit leurs dépenses d’investissement ce qui leur permet d’épargner davantage.
Inquiétudes à tous les étages : inflation, transition énergétique, géopolitique et retraite
Cette propension à l’épargne témoigne de la persistance d’un fort niveau d’inquiétude chez les Français qui est confirmé mois après mois par le faible indice de confiance des ménages. Craignant que la situation économique continue à se dégrader, ils préfèrent mettre de l’argent de côté. L’épargne de précaution prédomine comme en témoigne la forte collecte du Livret A (plus de 22 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de 2023 et la modestie de la collecte de l’assurance vie sur la même période). Cette volonté de disposer d’une importante épargne de court terme vise à faire face à des achats dont le montant pourrait encore augmenter en raison de la poursuite de l’inflation. D’autres facteurs anxiogènes sont également à prendre en compte comme la transition énergétique ou la situation géopolitique. Le vieillissement démographique qui est de nature structurelle contribue également à la hausse de l’épargne qui avait commencé avant la crise sanitaire. Le poids des personnes de plus de 45 ans au sein de la population augmente ; or ces tranches d’âge sont celles qui préparent financièrement leur retraite en épargnant. Toujours selon l’enquête du Cercle de l’Epargne, 72 % des Français en âge de travailler estiment que leurs pensions ne suffiront pas pour vivre correctement et 59 % mettent de l’argent de côté pour leur retraite.
La hausse du rendement des produits de taux encourage à l’épargne
Même si le rendement réel des livrets restent négatifs (sauf pour le Livret d’épargne populaire), les ménages ont accru leurs versements dès les annonces de relèvement des taux. Le Livret A a ainsi obtenu sur le premier trimestre sa meilleure collecte depuis 2009.
Une reprise de la consommation pour la fin de l’année
La baisse de l’inflation attendue au cours du second semestre devrait conduire les ménages à relâcher leurs efforts en matière d’épargne en se faisant davantage plaisir. Les dépenses de consommation pourraient repartir alors à la hausse.
Les Français en privilégiant l’épargne, se distinguent des Américains qui restent des adeptes invétérés de la consommation. Ils ont en grande partie épuisé leur cagnotte covid quand les Français n’y touchent pas en moyenne. Il faut, en effet, souligner que les 20 % des Français les plus modestes ont été contraints de ponctionner épargne pour faire face à la hausse des prix. Ce sont les 40 % les plus riches et surtout les 20 % les plus riches qui, en France, placent leur argent sur des produits financiers.
Epargne solidaire, un bon cru en 2022
Selon l’association spécialisée dans la finance solidaire, Fair qui gère le label Finansol, la collecte d’épargne solidaire a atteint, en 2022, le montant de 26,3 milliards d’euros, en hausse de 1,8 milliard d’euros (+ 7,4 %) par rapport à 2021. La croissance est plus faible qu’en 2021 qui était marquée encore par le covid, celui-ci contribuant à maintenir un taux d’épargne élevé. Dans un contexte plus incertain, avec un retour de l’inflation, les ménages ont privilégié l’épargne de précaution et en particulier le Livret A qui a bénéficié de deux revalorisations en 2022. La part du solidaire dans l’épargne financière des ménages était de 0,45 % en 2022, contre 0,41 % en 2021.
La collecte d’épargne solidaire est portée par l’épargne salariale qui demeure le principal canal de l’épargne solidaire. L’encours de l’épargne salariale solidaire s’élevait à la fin de 2022 à 15,3 milliards d’euros, en hausse de 8,5 % sur un an quand l’encours de l’épargne salariale a reculé de 3,2 %.L’épargne solidaire via les banques et les mutuelles d’assurance progresse de 5,5 %, soit un encours total légèrement supérieur à 10 milliards d’euros. Les livrets d’épargne solidaire continuent à croître, avec + 7,4 % en 2022 et atteignent 2,9 milliards d’euros. Depuis le 1er janvier 2022, les assureurs ont l’obligation de proposer au moins une unité de compte solidaire sur les contrats d’assurance vie multisupports et les Plans d’Epargne Retraite.
Grâce à l’épargne collectée, le montant total engagé par les acteurs de la finance solidaire en 2022 a augmenté de 22 %, à 841,5 millions
d’euros. Près de 1 600 projets à impact social ou environnemental ont été ainsi financés Ces projets ont été essentiellement portés par les fonds solidaires, les banques, les assureurs.
La collecte a été essentiellement fléchée vers des projets à dimension sociale (62 %), puis à 28 % vers des projets à impact environnemental et à 7 % vers des projets de solidarité internationale. Les financements de projets environnementaux ont enregistré une hausse de 114 %. En revanche, les actions de solidarité internationale ont connu une baisse de 13 %.
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


