La création d’entreprise toujours vivace en France
Selon l’INSEE, au mois d’octobre, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises a augmenté de +4,3 % après +1,1 % en septembre en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. La progression des créations d’entreprises classiques ralentit passant de 1,6 à 0,8 % quand que les immatriculations de micro-entrepreneurs sont en forte hausse (+8,4 % après +0,4 %).
Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)
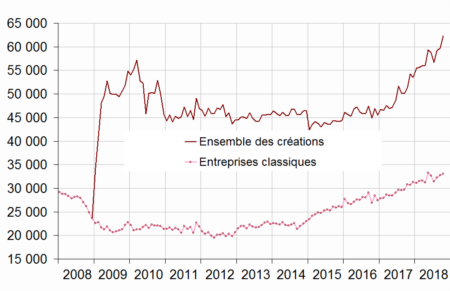
Selon l’INSEE, en données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois poursuit son accélération (+18,5 % après +17,8 % en septembre et +16,7 % en août). Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs (+30,4 %), les créations d’entreprises individuelles classiques (+22,4 %) et, dans une moindre mesure, celles de sociétés (+1,5 %).
En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois est en essor (+20,0 % sur un an). Le secteur « transports et entreposage » est celui qui contribue le plus à cette hausse. Sur les trois derniers mois et par rapport aux mêmes mois un an auparavant, le nombre de créations croît de 8 800 dans ce secteur (dont +7 500 pour les autres activités de poste et de courrier – y compris la livraison à domicile).
En octobre 2018, en données brutes, la part des immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois croît pour le douzième mois consécutif et atteint 44,3 %.
Allemagne et Japon réunis dans l’adversité économique
Le Japon comme l’Allemagne ont enregistré des mauvais résultats économiques lors du troisième trimestre. Le PIB a été en recul au Japon quand chez notre partenaire d’Outre-Rhin, il a connu une progression limitée.
L’économie japonaise n’est pas en récession mais s’en rapproche. En effet, le pays a a subi une deuxième contraction en trois trimestres. Selon les premiers calculs du gouvernement, le PIB a diminué de 0,3 % sur la période de juillet à septembre. Projetée en rythme annualisé, cette baisse atteindrait 1,2 %.
L’économie nippone a souffert de de l’impact de plusieurs catastrophes naturelles : inondations, typhons, tremblements de terre. Ces évènements ont pesé sur la consommation des ménages et ont pesé sur la production de nombreuses usines. Au cours du troisième trimestre, la consommation privée, qui représente près de 60 % du PIB nippon, a ainsi reculé de 0,1 % en glissement trimestriel quand les dépenses d’investissement des entreprises reculaient, elles, de 0,2 %. Par ailleurs, l’activité a été touchée par les mauvais résultats du commerce extérieur. Sur le troisième trimestre, les exportations ont diminué de 1,8 % en valeur, par rapport aux montants enregistrés entre avril et juin, ce qui constitue le recul le plus important de ces trois dernières années. Cette contraction est la conséquence du ralentissement chinois et de la guerre commerciale sino-américaine. Le relèvement à 25 %, au 1er janvier prochain, des droits de douane imposés par les Etats-Unis sur des centaines de milliers de marchandises chinoises est une source majeure d’inquiétude au Japon.
Les analystes japonais ne croient pas à l’entrée en récession du pays au cours du dernier trimestre 2018. Ils tablent sur un rebond de la croissance grâce à l’augmentation des dépenses publiques rendues nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles. Les analystes semblent partager cette prudence. Tous misent sur un rebond du PIB nippon sur les trois derniers mois de 2018, du fait notamment des dépenses publiques ordonnées dans les régions touchées par des catastrophes. En revanche pour 2019, la prudence est de mise en ce qui concerne les prévisions de croissance.
Le Japon n’est pas le seul pays de l’OCDE à avoir connu une contraction de son PIB. C’est également le cas de l’Allemagne. Au troisième trimestre, le PIB de ce pays a reculé de 0,2 % par rapport au précédent trimestre, selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis). Cette diminution met un terme à une progression de treize trimestres du PIB. Le refroidissement a été assez rapide car la croissance de la première puissance européenne avait atteint au 1er et 2e trimestre respectivement 0,4 et 0,5 %.
Comme au Japon, la baisse de l’activité est imputable aux mauvais résultats de la consommation freinée par la hausse des prix et par ceux du commerce extérieur. La chute du 3e trimestre est également liée à l’entrée en vigueur des nouvelles normes environnementales pour l’industrie automobile qui a désorganisé la production et a conduit les constructeurs à réduire leur activité. La production dans l’industrie automobile a diminué de 8 %, ce qui ponctionné la croissance de 0,5 point selon le cabinet Oxford Economics.
Comme pour le Japon, nul n’attend la survenue d’une récession pour la fin de l’année 2018. En revanche, l’idée d’un ralentissement de l’activité est admise. L’économie allemande dispose de peu de marges de manœuvre du fait du plein emploi. L’accumulation des nuages sur le commerce international ne peut, en outre, que pénaliser le deuxième exportateur mondial.
61 % des nouveaux retraités considèrent qu’il est difficile de préparer seul son départ à la retraite
Les régimes de retraite Agirc-Arrco dans le cadre de la 3ème édition nationale des Rendez-vous de la retraite qui sont prévus du lundi 12 au samedi 17 novembre 2018, pour aider les actifs – quel que soit leur âge – à être acteur de leur future retraite, tout au long de leur vie, ont commandé une enquête à OpinionWay. Cette enquête est centrée sur les nouveaux retraités.
Selon le sondage de l’AGIRC / ARRCO, 82% des nouveaux retraités auraient souhaité être informés de l’impact de leurs choix de vie sur le montant de leur retraite. Ce souhait recoupe la difficulté qu’éprouvent les Français pour apprécier le montant de leur future retraite. 68% auraient adapté leurs choix de vie s’ils avaient eu connaissance de cet impact.
Malgré tout, les deux tiers des nouveaux retraités (65%) déclarent avoir eu connaissance de l’impact qu’un temps partiel, un congé parental ou encore un congé sabbatique pouvait avoir sur la retraite; mais l’impact d’autres situations de vie est moins connu. 48% des nouveaux retraités sont informés de la possibilité de créer une entreprise, 47 % du changement d’orientation professionnelle; 28% seulement d’entre eux savent que le mariage ouvre des droits à la réversion, contrairement au PACS ou concubinage, qui n’en génèrent pas.
Près d’une femme retraitée sur deux juge important l’impact généré sur le montant de sa pension de retraite d’un arrêt de travail pour maladie ou chômage (51% contre 39% pour les hommes), d’un travail à temps partiel (52% contre 20% pour les hommes) ou d’un congé parental (46% contre 15% pour les hommes).
Les nouveaux retraités ont préparé leur retraite en moyenne à 53 ans. Ils pensent que les jeunes générations doivent s’y prendre plus tôt. Ils recommandent aux jeunes actifs de commencer à s’en préoccuper à 42 ans. 58% des nouveaux retraités se sont informés sur leurs droits de retraite après 55 ans, 29% cinq ans avant contre 13% avant 50 ans. L’âge moyen se situe à 53 ans. Le premier conseil qu’ils donnent aux actifs est ainsi de s’y prendre tôt (36%) et de s’informer notamment via les sites internet des organismes de retraite (17%).
Une fois à la retraite, la grande majorité des nouveaux retraités jugent faciles les démarches liées à la retraite, notamment la demande de retraite (74%), l’accès à un interlocuteur retraite (62%) et aux informations pour préparer son départ à la retraite (60%).
84% des nouveaux retraités ont déclaré avoir réalisé une estimation de leur retraite avant leur départ : 31% entre 5 ans et 1 an avant et 36% la dernière année. Cette estimation leur a permis, pour 81% d’entre eux,d’avoir une idée assez proche du montant de leur retraite actuelle : conforme ou légèrement supérieure (51%) et légèrement inférieure (30%).
61% des nouveaux retraités considèrent qu’il n’est pas facile de préparer seul son départ à la retraite.
Danger sur l’investissement ?
Depuis un an, l’investissement a joué un rôle clef dans la croissance française. Or, un changement d’attitude des dirigeants d’entreprise pourrait changer la donne. En effet, selon l’INSEE, au mois d’octobre, les chefs d’entreprise de l’industrie manufacturière qu’il a interrogés anticipent une baisse de 1 % en valeur de leur investissement en 2018 par rapport à 2017. Pour 2019, ils prévoient néanmoins des dépenses d’investissement en hausse de 4 % par rapport à 2018.
Avec une baisse globale prévue de 1 % des investissements pour 2018, les industriels abaissent leur estimation de juillet 2018 de 5 points. Cette révision à la baisse est plus marquée que la révision moyenne observée à cette période de l’année depuis 2004 (–3 points).
Les dépenses d’investissement du secteur de la fabrication de matériels de transport reculeraient nettement en 2018, alors qu’en juillet les entreprises de ce secteur anticipaient de les accroître sur l’année. Dans le secteur des biens d’équipement, les dépenses augmenteraient moins vivement qu’annoncé en juillet mais resteraient dynamiques. Dans les autres secteurs, les entreprises revoient également à la baisse leurs dépenses d’investissement pour 2018.
Ces prévisions moins optimistes s’expliquent par la multiplication des incertitudes, pas d’accord sur le Brexit, guerre commerciale Etats-Unis / Chine, hausse des taux de la part de la FED, ralentissement de la croissance en Allemagne, etc.
Comment financer la protection sociale ?
La France consacre environ un tiers de son revenu national au financement de la protection sociale et d’après le Baromètre d’opinion réalisé par le service des études du Ministère des Solidarités et de la Santé, six Français sur dix estiment que cette part est normale, 22 % la jugent insuffisante contre 14 % qui la considèrent comme excessive.
Les trois quarts du financement de la protection sociale proviennent des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée (CSG) qui relèvent plutôt d’une logique « proportionnelle » que « progressive ». Néanmoins, pour les cotisations sociales, les bas salaires bénéficient d’exonérations. Pour la CSG, le taux de prélèvement est moins important pour les revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage) que pour les revenus du patrimoine, un taux intermédiaire étant appliqué pour les revenus d’activité.
Selon la DREES, près des deux tiers des Français sont favorables à la progressivité des prélèvements qui participent au financement de la protection sociale. C’est davantage le cas parmi les personnes appartenant aux ménages modestes (70 %). Néanmoins, ce taux est de 60 % chez les ménages les plus aisés (60
%. Plus de la moitié des sondés souhaitent que les pensions de retraite participent moins qu’aujourd’hui au financement de la protection sociale. Un tiers des Français serait favorable à une augmentation de la contribution pesant sur les revenus du patrimoine. Les Français les plus modestes et les moins diplômés privilégient plus souvent le financement par l’État alors que les plus aisés et les plus diplômés citent davantage la CSG. La taxation des revenus du patrimoine est également mise en avant pour le financement de la protection sociale.
Les ménages privilégient toujours la liquidité
Le patrimoine des ménages a atteint, selon la Banque de France, au 2e trimestre 2018, 5106,9 milliards d’euros contre 5038,8 milliards d’euros au 1er trimestre.
Au 2e trimestre 2018, le flux annuel de placement des ménages s’établit à 86,8 milliards, en baisse par rapport au trimestre précédent (99,9 milliards). Les Français conservent un volume croissant de liquidités. En effet, en rythme annuel, les acquisitions nettes d’actifs sous forme de produits de taux augmentent (67,7 milliards après 60,2 milliards), principalement en raison de la hausse du flux de numéraire et dépôts à vue (40,4 milliards après 33,4 milliards). En revanche, sur un an, les flux d’actifs sous forme de produits de fonds propres diminuent de 12,2 milliards (17,2 milliards après 29,4 milliards). Les ménages continuent de céder des actions cotées et des titres d’Organismes de Placement Collectif.
Les premiers éléments pour le troisième trimestre, en glissement trimestriel, montrent une moindre croissance des placements bancaires (15,3 milliards après 23,1 milliards) et une accélération de l’assurance-vie en support euros (9,7 milliards d’euros contre 6,4 milliards d’euros) . Les dépôts à vue et le numéraire ont progressé de 9,1 milliards d’euros au 3e trimestre contre 14 milliards d’euros au 2e trimestre. Les flux vers les unités de compte des contrats d’assurance vie sont en retraite (3,9 milliards d’euros au 3e trimestre contre 6,2 milliards d’euros au 2e).
Cette préférence pour la liquidité est une constante depuis la crise de 2008. L’encours des dépôts à vue s’est accru de plus de 200 milliards d’euros en dix ans. Les dépôts à vue s’élevaient à la fin du mois de septembre, plus de 447 milliards d’euros.
Automobile, l’effet normes toujours présent
Les immatriculations de voitures neuves ont, en France, en octobre, reculé de 1,52 % pour les particuliers. Cette baisse prolonge celle du mois de septembre qui avait atteint près de 13 %. Ce mouvement de correction est lié à l’entrée en vigueur des nouvelles normes anti-pollution au 1er septembre. Les constructeurs avaient écoulé en masse les véhicules ne répondant aux normes en juillet et en août, mois durant lesquelles les immatriculations ont augmenté respectivement de19 % et 40 %. Les achats réalisés durant l’été l’ont été en grande partie par anticipation, les ménages profitant des ristournes alors proposées. Par ailleurs, les constructeurs ont immatriculé de nombreuses voitures sans les vendre afin de ne pas à acquitter les pénalités pour non-respect des normes. Ce stock de voitures non vendues qui coûtent cher aux constructeurs devrait se réduire dans les prochains mois, ce qui pèsera d’autant sur les immatriculations. Ce déstockage attendu devrait avoir une conséquence négative sur la croissance du dernier trimestre.
la France, championne d’Europe de l’Assurance
La France est championne d’Europe de l’assurance. selon le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, au premier trimestre 2018, le marché français de l’assurance est devenu le premier marché européen, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni, qu’il s’agisse des plus de 35 milliards d’euros de primes émises en affaires directes non-vie ou des plus de 2100 milliards d’euros de provisions techniques. Le total des actifs par l’assurance atteint 2700 milliards d’euros en septembre 2018. De ce fait, le secteur assurantiel français est le premier investisseur institutionnel en Europe, représentant plus du tiers du total des actifs des assureurs de la zone euro, la France représentant 21 % du PIB de celle-ci.
La France fait mieux que la moyenne européenne
Ces derniers temps, la croissance française était inférieure à la moyenne européenne. Au 3e trimestre, ce fut l’inverse. En effet, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2 % dans la zone euro et de 0,3 % au sein de l’Union européenne au 3e trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, le PIB français a augmenté de son côté de 0,4 %.
Au cours du deuxième trimestre 2018, le PIB avait progressé de 0,4 % dans la zone euro et de 0,5 % dans l’Union contre 0,2 % pour la France. En comparaison avec le même trimestre de l’année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré une hausse de 1,7 % dans la zone euro et de 1,9 % dans l’Union au troisième trimestre 2018, après respectivement +2,2% et +2,1% au deuxième trimestre 2018.
Chute de la consommation au mois de septembre
Le beau temps du mois de septembre n’a pas inspiré les consommateurs dont les dépenses ont reculé de 1,7 %, effaçant la hausse du mois d’août de 1,1 %. Les ménages sont en mode économie. Ils ont réduit leurs dépenses en biens fabriqués (−2,5 %) et en produits énergétiques (−1,2 %). La hausse des prix de ces derniers et la clémence du climat ont pu inciter les ménages à reporter leurs achats en la matière. Par ailleurs, la consommation alimentaire a reculé de 0,9 % en juillet.Les dépenses en habillement-textile sont également en léger repli en septembre (−0,5 % après +0,1 %), du fait notamment de la baisse des ventes de chaussures.
Sur l’ensemble du troisième trimestre, la consommation des ménages en biens se redresse par rapport au trimestre précédent (+0,6 % après −0,3 %).
Rebond mesuré de la croissance au 3e trimestre en France
Après deux premiers trimestres décevants, la croissance s’est légèrement accéléré au troisième trimestre en passant de 0,2 à 0,4 %. Cette amélioration est imputable à la consommation et aux échanges extérieurs. Compte tenu du retard accumulé sur le premier semestre, ce résultat est néanmoins décevant. Avec la fin des grèves dans le secteur des transports, les experts s’attendaient à un rattrapage plus important avec une croissance du PIB espérée à +0,5 %. La multiplication des incertitudes et une moindre confiance tant des consommateurs que des entreprises ont limité l’ampleur du rebond.
La reprise de la consommation confirmée
Après avoir reculé de 0,1 % au 2e trimestre, la consommation a enregistré une hausse de 0,5 % au 3e. La consommation en biens a progressé de 0,6 % faisant suite à une contraction de 0,4 %; celle des services a connu une hausse de +0,3 % après +0,1 %. Cette évolution positive est imputable aux dépenses de l’énergie qui obéissent à des facteurs de prix et de conditions climatiques. Elles ne sont pas révélatrices du moral des consommateurs.
Les dépenses alimentaires, après deux trimestres de recul, se sont stabilisées avec un gain de +0,1 %.
Dans les services, les dépenses de transport augmentent de 3,7 % mais cela est imputable à la fin des grèves qui avaient provoqué une contraction au 2e trimestre de 2,9 %.
La consommation des ménages reste convalescente. Elle est handicapée par le ralentissement des créations d’emploi. La légère augmentation du chômage enregistrée au 3e trimestre ne peut jouer que défavorablement sur les dépenses des ménages. Par ailleurs, la question du pouvoir d’achat est devenue un sujet majeur au cours du 3e trimestre avec l’augmentation du prix des carburants. Son amélioration est attendue au 4e trimestre qui sera marqué par la diminution des cotisations chômage et par la poursuite de la réduction de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages.
L’investissement des entreprises reste dynamique
Au troisième trimestre 2018, les dépenses d’investissement totales (formation brute de capital fixe) ont augmenté de 0,8 % soit au même rythme qu’au deuxième (+0,9 %). L’investissement des entreprises reste dynamique avec un gain de +1,4 % après +1,3 %. Les secteurs de l’informatique, les services d’information et l’automobile ont été à l’origine de ce bon résultat.
Atterrissage de l’investissement des ménages
L’investissement des ménages poursuit son mouvement de correction après la forte hausse de 2017. Il se contracte, en effet, de 0,2 % après 0,0 %, en lien avec le recul des mises en chantiers de logements depuis fin 2017.
Légère contribution positive du commerce extérieur
Au troisième trimestre, les exportations ont augmenté de 0,7 % contre +0,1 % au deuxième trimestre quand les importations n’ont progressé que de 0,3 % après +0,7 %. De ce fait, les échanges extérieurs contribuent positivement à la croissance : +0,1 point, après −0,2 point au deuxième trimestre. Au cours du premier semestre, le commerce extérieur avait pénalisé la croissance française. L’augmentation des livraisons d’avion a permis ce rétablissement qui ne permet pas de réduire de manière significative le déficit commercial. Au mois d’août, le déficit cumulé sur les 12 derniers du commerce extérieur français a atteint 61,9 milliards d’euros contre 63,8 milliards pour l’année 2017.
L’objectif de croissance de 1,6 % en ligne de mire
La croissance française pourrait atteindre sur l’année le taux prévu par l’INSEE et la Banque de France, 1,6 % sauf contreperformance notable au dernier trimestre. Elle pourrait en cas d’accélération se rapprocher de l’objectif du Gouvernement de 1,7 %. Le dernier trimestre bénéficiera de la baisse des charges sociales et de la baisse de la taxe d’habitation. Les pouvoirs publics espèrent également une diminution du taux d’épargne des ménages qui avait atteint 14,3 % du revenu disponible brut au 2e trimestre. Parmi les facteurs pouvant entraver la croissance française figurent le ralentissement du commerce international, la hausse du prix du pétrole, la stagnation des créations d’emploi et l’absence de confiance des consommateurs et des investisseurs. Au regard des chiffres des trois premiers trimestres, l’année 2018 est sur le plan économique une année passable voire décevante. L’embellie de la fin de l’année 2017 a fait long feu en raison du fait de la hausse du pétrole et d’une demande intérieure moins vive que prévu.
Revenu et consommation des ménages en hausse au sein de la zone euro au 2e trimestre
Dans la zone euro, en termes réels, le revenu des ménages par habitant a, selon Eurostat, augmenté de 0,4% au deuxième trimestre 2018, après une hausse de 0,3% au trimestre précédent. La consommation réelle des ménages par habitant a progressé de 0,3% au deuxième trimestre 2018, après une hausse de 0,4% au premier trimestre 2018.
Dans l’ensemble de l’Union européenne, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 0,4% au deuxième trimestre 2018, après avoir resté stable au trimestre précédent. La consommation réelle des ménages par habitant a progressé de 0,3% au deuxième trimestre 2018, après avoir resté stable au premier trimestre 2018.
Chômage, un troisième trimestre décevant !
La France est loin de connaître une situation de plein emploi comme en Allemagne, en République tchèque ou aux Etats-Unis. En effet, au 3e trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi s’est accru en France en phase avec le ralentissement des créations d’emploi. Cette année, l’INSEE ne prévoit que 129 000 créations nettes contre 342 000 en 2017. La faible croissance du 1er et 2e trimestre semble avoir enrayer le processus de baisse des demandeurs d’emploi. Le 3e trimestre est le 2e consécutif marqué par une progression.
En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a, au cours du 3e trimestre augmenté de 0,5 % (+16 300) et s’élève à 3 456 800 Sur un an, une baisse est toujours constatée, -1,2 %. En prenant en compte les catégories A, b et C, le nombre de demandeurs d’emploi atteint 5 649 600.
En incluant les départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’élève à 3 718 500 en progression de 0,4 %sur le trimestre et en recul de 1,0 %sur un an. Pour les catégories A, B, C, ce nombre s’établit à 5 963 500 en augmentation de 0,4 % sur le 3e trimestre et de 0,7 % sur un an.
Le nombre de demandeurs d’emploi augmente, au 3e trimestre, pour toutes les catégories d’âge. Celui des moins de 25 ans augmente de 0,3 % soit deux fois vite que celui des plus de 50 ans (0,6 %). Les nombre de demandeurs d’emploi chez les 25 / 50 ans de 0,5 %. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 1 % chez les jeunes, de 1,9 % chez les 25 / 50 ans mais augmente de 0,2 % chez les seniors.
L’assurance vie en retrait en septembre mais toujours vaillante
La collecte nette de l’assurance vie, avec + 900 millions d’euros, est, selon la Fédération Française de l’Assurance, restée positive, elle est néanmoins en net retrait par rapport à celle du mois d’août 2018 (2,4 milliards d’euros). Elle est, en revanche, en phase avec le résultat moyen de ces dix dernières années (925 millions d’euros). Elle est nettement supérieure à celle du mois de septembre de l’année dernière (500 millions d’euros). Lors de ces dix dernières années, la collecte n’a été qu’à trois reprises négative au mois de septembre. La collecte nette s’établit à 18 milliards d’euros depuis le début de l’année contre 6,2 milliards d’euros sur la même période l’année dernière.
Au mois de septembre, la baisse de la collecte nette s’explique par la diminution des cotisations qui sont passées de 10,6 à 9,6 milliards d’euros. Les ménages ont réduit leur effort d’épargne. Ce relâchement a été également constaté pour le Livret A. Les dépenses de rentrées, les derniers tiers de l’impôt sur le revenu et la perte de pouvoir d’achat occasionnée par la hausse des prix ont réduit les capacités d’épargne des ménages. Au cours des neuf premiers mois de 2018, le montant des cotisations collectées a dépassé les 100 milliards d’euros (104,7 milliards d’euros) soit près de 5 milliards d’euros de plus que sur la même période de 2017 (99,6 milliards d’euros)
2,5 milliards d’euros ont été placés en unités de compte contre 2,7 milliards d’euros. C’est le plus mauvais résultat des unités de compte depuis le début de l’année. Elles ont représenté 26 % de la collecte le mois derniers quand la moyenne des neuf premiers mois est de 29 %. Le caractère plus volatil des marchés peut dissuader les épargnants à s’engager sur la voie d’une diversification en unités de compte.
Les prestations et les rachats sont restés stable à 8,8 milliards d’euros contre 8,2 au mois d’août. Ils sont inférieurs à la moyenne des huit premiers mois de l’année (9,7 milliards d’euros). Les prestations versées par les sociétés d’assurances sur les neuf premiers mois de l’année s’élèvent à 86,8 milliards d’euros contre 92,4 milliards d’euros sur la même période en 2017.
L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 711 milliards d’euros à la fin du mois de septembre, en progression de 2% sur un an.
L’assurance conforte donc sa place de premier placement des ménages français. Depuis le début de l’année, il profite de la perte d’attractivité du Plan d’Epargne Logement. La diminution du nombre de transactions immobilières conduit également les ménages à réduire les sorties d’assurance vie.
Les ménages semblent avoir bien digérer l’assujettissement, partiel, de l’assurance vie au Prélèvement Forfaitaire Unique. De même, la baisse du rendement des fonds euros n’occasionne pas une remise en cause de l’assurance vie.
Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait maintenir le cap avec une collecte moins forte qu’en début d’année mais qui resterait positive. Dans ces conditions, une collecte nette de plus de 20 milliards d’euros est envisageable, ce qui constituerait le meilleur résultat enregistré depuis 2015.
Le Climat des affaires recule en octobre
Le dernier trimestre commence en demi-teinte. En effet, l’indicateur établi par l’INSEE qui mesure le climat des affaires est en recul au mois d’octobre d’un point. Il demeure malgré tout à un niveau relativement élevé. Il se situe à 104, au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Par rapport au mois de septembre, l’indicateur de climat des affaires perd quatre points dans le commerce de détail et trois points dans l’industrie. Il est stable dans le bâtiment et les services.
En octobre, le climat de l’emploi reste stable. L’indicateur qui le synthétise se situe pour le troisième mois consécutif à 107, soit bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Pour l’essentiel, la hausse des soldes d’opinion relatifs à l’emploi dans les services compense des baisses dans les autres secteurs considérés.
L’indicateur de retournement qui signale un climat conjoncturel favorable ou défavorable reste bien orienté.
Malgré l’accumulation des incertitudes, la confiance des milieux économiques demeurent. Affaire à suivre !
Coup d’arrêt pour le Livret A au mois de septembre
Le mois de septembre marque une rupture pour le Livret A avec une décollecte de 410 millions d’euros, la première depuis le mois de décembre 2017. Le mois de septembre est en règle générale peu porteur pour le Livret A. déjà, en 2017, une décollecte avait été constatée (-120 millions d’euros). A la rentrée, les ménages sont contraints de puiser dans leur épargne de précaution pour faire face aux dépenses de rentrées et pour s’acquitter des impôts notamment du dernier tiers de l’impôt sur le revenu. Ainsi, sur ces dix dernières années, 4 décollectes ont été enregistrées
Si dans un premier temps, le retour de l’inflation avait conduit à une hausse de la collecte, il semble aujourd’hui avoir un effet inverse. Les ménages sont face à la contraction de leur pouvoir d’achat obligé de puiser dans leur épargne de précaution. L’augmentation du prix des carburants et les augmentations de certaines taxes pèsent sur leur capacité d’épargne à court terme. Le rendement réel négatif du Livret A peut également avoir inciter les ménages à relâcher leur effort. Il faut remonter à 1983 pour avoir un rendement négatif d’un point.
Ce mouvement de décollecte est en phase avec la prévision de l’INSEE qui table sur une baisse du taux d’épargne. Malgré tout sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du Livret A reste très nettement positive, + 10,93 milliards d’euros, légèrement inférieur à son montant sur la même période en 2017, + 12,05 milliards d’euros.
L’encours s’inscrit dans ces conditions en légère baisse à 282,6 milliards d’euros. Il demeure néanmoins à un niveau très élevé.
Pour les prochains mois, la collecte nette du Livret A devrait rester voisine de zéro. Les fêtes de fin d’année et les impôts locaux devraient peser sur les capacités d’épargne des ménages. Une amplification du mouvement de correction en cours sur les marchés financiers pourrait évidemment créer un report sur le Livret A comme cela avait été constaté lors des précédentes crises surtout quand elles s’accompagnent d’un ralentissement de la croissance. Les prochains jours permettront d’y voir plus clair avec la publication des résultats de la croissance du 3e trimestre.
* : prévisions
La bourse de Paris en-dessous des 5000 points
Entre l’assassinat d’un journaliste et le ralentissement chinois en passant par des résultats en demi-teinte des entreprises américaines, un point en commun, la chute des valeurs financières. La place de Paris est en net recul sur le mois d’octobre qui pourrait être le plus mauvais depuis 2011. Les sources d’inquiétude se multiplient : Brexit, guerres commerciales, Italie, Arabie Saoudite, ralentissement en Chine, stagnation en zone euro….
La dette publique en baisse au sein de l’Union européenne
Selon Eurostat, à la fin du deuxième trimestre 2018, le ratio de la dette publique par rapport au PIB s’est établi à 86,3% dans la zone euro contre 86,9% à la fin du premier trimestre 2018. Pour l’ensemble de l’Union, le ratio est passé de 81,5 à 81 % du PIB. Par rapport au deuxième trimestre 2017, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a baissé tant dans la zone euro (de 89,2% à 86,3%) que dans l’Union (de 83,4% à 81,0%). Le taux est, au 2e trimestre 2018, de 99,1 % du PIB pour la France contre 99,4 % au premier trimestre 2018 et de 100,9 au 2e trimestre 2017.
Déficits publics et dettes publiques, la France pourrait mieux faire
La Commission de Bruxelles a publié les résultats définitifs pour 2017 des déficits publics et des dettes publiques au sein de l’Union européenne. La France figure toujours en fin de classement malgré le passage de son déficit en dessous des 3 % du PIB.
Selon l’institut statistique européens, le déficit ainsi que la dette publique se sont réduits en termes relatifs en 2017 par rapport à 2016, tant dans la zone euro que dans l’Union européenne. Le ratio du déficit public par rapport au PIB a baissé dans la zone euro est passé de 1,6% en 2016 à 1,0% en 2017, ainsi que dans l’Union de 1,7% à 1,0%. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB a diminué dans la zone euro, passant de 89,1% à la fin de l’année 2016 à 86,8% à la fin de l’année 2017, ainsi que dans l’Union, de 83,3% à 81,6%.
13 pays sur 28 ont dégagé un excédent budgétaire en 2017 : Malte (+3,5%), Chypre (+1,8%), la Suède (+1,6%), la Tchéquie (+1,5%), le Luxembourg (+1,4%), les Pays-Bas (+1,2%), la Bulgarie et le Danemark (+1,1% chacun) ainsi que l’Allemagne (+1,0%), la Croatie (+0,9%), la Grèce (+0,8%), la Lituanie (+0,5%) et la Slovénie (+0,1%). Les déficits publics les plus faibles, par rapport au PIB, ont été enregistrés en Irlande (-0,2%), en Estonie (-0,4%), en Lettonie (-0,6%) et en Finlande (-0,7%). Deux États membres n’ont pas respecté la barre des 3 % : l’Espagne (-3,1%) et le Portugal (-3,0%). La France a réussi à revenir sous cette barre pour la première fois depuis 2007 avec un déficit de 2,6 % du PIB
À la fin de l’année 2017, les plus faibles ratios de dette publique par rapport au PIB ont été relevés en Estonie (8,7%), au Luxembourg (23,0%), en Bulgarie (25,6%), en Tchéquie (34,7%), en Roumanie (35,1%) et au Danemark (36,1%). Quinze États membres ont affiché un ratio de dette publique supérieur à 60% du PIB, les plus élevés ayant été enregistrés en Grèce (176,1%), en Italie (131,2%), au Portugal (124,8%), en Belgique (103,4%), en France (98,5%) et en Espagne (98,1%).
En 2017, les dépenses publiques dans la zone euro ont représenté 47,0% du PIB et les recettes publiques 46,1%. Dans l’Union, elles ont été respectivement de 45,8% et 44,8% du PIB. Entre 2016 et 2017, le ratio des dépenses publiques a baissé et le ratio des recettes publiques a augmenté dans les deux zones. Les dépenses publiques ont atteint 56,5 % du PIB, ce qui place la France au 1er rang au sein de l’Union européenne., 12,6 points au-dessus de l’Allemagne.
Le PERCO continue sa progression
Selon l’Association Française de gestion, près de 2.760.000 salariés disposent d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) et ont au moins effectué un versement, soit 11 % de plus sur un an. Le nombre d’entreprises équipées a progressé de 6 % en un an et s’élève à 244 000. L’encours du PERCO a atteint fin juin 16,9 milliards d’euros en hausse de 11 % sur un an.
Plus de la moitié des entreprises ont transformé leur PERCO en PERCO Plus pour y intégrer un fonds PME et bénéficier du taux réduit de forfait social à 16%.
Sur 6 mois, les versements bruts sur le PERCO se sont élevés à 1,6 milliard d’euros, soit une hausse de 7% par rapport au 1er semestre 2017. Les retraits se sont élevés à 500 millions d’euros. La collecte nette a donc atteint 1,1 milliard d’euros, en hausse de 10%.
L’encours moyen détenu par chaque épargnant sur son PERCO est stable à 6.120 euros.
L’épargne salariale en hausse au 1er semestre 2018
Selon l’Association Française de gestion, au 30 juin 2018, 11,3 millions de salariés étaient couverts par un produit d’épargne salariale .Chaque salarié épargnant détient en moyenne 12.000 euros dans le cadre de l’épargne salariale.
Sur le 1er semestre 2018, les versements bruts (intéressement, participation, abondement et versements volontaires) ont atteint près de 11 milliards d’euros, en hausse de 3,8 % par rapport au 1er semestre 2017. Les retraits se sont réduits de 11% et passent de 8,3 à 7,4 milliards d’euros. De ce fait, la collecte nette a été en augmentation passant de 2,1 à 3,4 milliards d’euros sur le s six premiers mois de l’année (+62%).
L’encours de l’épargne salariale a atteint, toujours au 30 juin, atteint 135,4 milliards d’euros en progression de 3 % sur 6 mois et de 3,8% sur un an, en raison principalement d’une augmentation de la collecte nette.
L’épargne salariale est investie à près de 60% en actions, dont 38% via les fonds d’actionnariat salarié, 12% via les fonds actions et le solde via les fonds mixtes
Plan de relance pour le Livret d’Epargne Populaire
Eurocroissance : que la route est longue
Selon les chiffres clés de la Fédération française de l’assurance (FFA), à la fin de l’année 2017, 183 000 contrats d’assurance-vie sont investis pour tout ou partie en fonds euro-croissance. L’encours atteint 2,2 milliards d’euros. Ce résultat est très éloigné des objectifs de 2013, une centaine de milliards d’euros espérés. Le Gouvernement avec les mesures prévues dans le projet d loi PACTE compte sur un encours de 20 milliards d’euros d’ici 2022.
Plus de 600 000 décès en France en 2017
En 2017, selon l’INSEE, la France a enregistré 606 000 décès, soit 12 000 de plus qu’en 2016. Le nombre de décès avait stagné en 2016, après avoir augmenté de 34 000 en 2015. Du fait de de l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom (nées entre 1946 et 1974) à des âges de forte mortalité, le nombre décès a tendance à augmenter En dix ans, le nombre de décès en France hors Mayotte a augmenté de 14 % : il était de 531 000 en 2007. Des phénomènes conjoncturels expliquent également la progression de 2017. L’épidémie de grippe hivernale amorcée fin 2016 a entraîné un pic de décès exceptionnel en janvier 2017 (67 000 décès en France métropolitaine). Ce niveau mensuel a été dépassé pour la dernière fois en décembre 1969, quand la grippe hivernale dite « de Hong Kong » avait atteint la France.
25 % des décès concernent des personnes de plus de 90 ans
Parmi les personnes décédées en 2017, la moitié a plus de 83 ans et 25 % plus de 90 ans. Les hommes décèdent plus jeunes que les femmes : la moitié des hommes décédés en 2017 ont plus de 79 ans et la moitié des femmes décédées cette année-là ont plus de 87 ans. En 2017, 60 % des décès féminins ont eu lieu après 84 ans, contre seulement 35 % pour les hommes. Moins de 8 % des femmes décédées avaient moins de 60 ans, contre 14 % pour les hommes.
Les femmes nées en 1926, qui ont ou auraient pu atteindre leur 91e anniversaire en 2017, sont les plus nombreuses parmi les femmes décédées en 2017. Pour les hommes, le pic du nombre de décès se situe à 87 ans, c’est-à-dire pour ceux nés en 1930.
À chaque âge jusqu’à 84 ans, le nombre de décès masculins dépasse le nombre de décès féminins. La surmortalité masculine est marquée en particulier chez les jeunes, les hommes étant davantage exposés aux morts violentes (accidents de la route, suicides, conduites à risque…). Entre 20 et 29 ans, les décès masculins sont 2,9 fois plus nombreux que les décès féminins. Entre 30 et 39 ans, ce rapport passe à 2,2. Il diminue ensuite, même s’il reste élevé : entre 60 et 69 ans, il est encore de 2,0. À 85 ans, le rapport s’inverse. Entre 90 et 99 ans, les décès féminins sont 2,1 fois plus nombreux que les décès masculins du fait de la surreprésentation des femmes au sein de la population de cet âge.
13 % des entreprises et 11 % des salariés couverts par des suppléments « retraite » collectifs
La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques du Ministère des Solidarités et de la Santé a publié une notre sur l’épargne retraite supplémentaire en France. Ainsi, en France, en 2015, 13 % des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole proposent un dispositif de retraite supplémentaire à tout ou partie de leurs salariés, sous la forme de contrats à prestations définies ou de contrats à cotisations définies. Ces derniers sont présents dans 12 % des entreprises quand les premiers ne le sont que dans 1,4 % des entreprises. 11 % des salariés travaillant au sein d’entreprises de plus de 10 salariés sont couverts par un produit retraite collectif.
Sans surprise, les entreprises les plus grandes sont plus nombreuses à proposer à leurs salariés des dispositifs de retraite supplémentaire.33 % des entreprises de 1 000 salariés ou plus ont souscrit un contrat à cotisations définies, contre 11 % des entreprises de 10 à 49 salariés. Pour les contrats à prestations définies, cette proportion varie de 7,4 % pour les très grandes entreprises (1 000 salariés ou plus) [5,5 % pour les retraites chapeau] à 1,2 % pour les entreprises de 10 à 49 salariés (0,6 % pour les retraites chapeau).
31 % des entreprises du secteur financier et de l’assurance proposent une couverture retraite supplémentaire. Ce taux est de 16 % dans l’industrie
1,4 million de salariés bénéficient d’un contrat à cotisations définies et seulement 120 000 un contrat de retraite supplémentaire à prestations définies en cours de constitution, dont 60 % – soit 73 000 personnes – un contrat de retraite chapeau. Ce nombre est inférieur à certaines évaluations précédentes qui estimaient le nombre à plus de 200 000.
La part des personnes adhérentes à un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies croît avec la taille de l’entreprise. Ce taux varie de 4 % de personnes concernées parmi l’ensemble des salariés des entreprises de 10 à 49 salariés, à 18 % parmi les salariés des entreprises de 1 000 salariés ou plus.
Pour les contrats à prestations définies, le lien avec la taille de l’entreprise pour la proportion de salariés couverts est moins net du fait que ces produits ne sont pas diffusés en règle général au sein de l’ensemble du personnel. La part des personnes ayant effectivement des droits sur ce type de contrat est à peine supérieure à la moyenne dans les très grandes entreprises. Dans les entreprises de 1 000 salariés ou plus, elle ne concerne que 1,5 % de personnes, dont 0,9 % pour une retraite chapeau. Les salariés réellement adhérents aux contrats à prestations définies représentent 21 % de l’ensemble des salariés des entreprises ayant mis en place de tels contrats. Ils en représentent 17 % pour les contrats de retraites chapeau et 44 % pour les contrats à cotisations définies.
Dans un quart des entreprises ayant souscrit un contrat à cotisations définies, la part de salariés couverts par ce dispositif parmi l’ensemble des salariés de l’entreprise est inférieure à 9 %, mais pour un autre quart, elle est supérieure à 46 %. Seules un quart des entreprises ayant souscrit un contrat à prestations définies en font bénéficier à plus de 24 % de leurs salariés. La part de salariés couverts par un contrat à prestations définies est inférieure à 8 % dans un quart de ces entreprises. Cependant, pour au moins 10 % des entreprises ayant souscrit un contrat de retraite supplémentaire à prestations définies,les dispositifs mis en place concernent tous les salariés de l’entreprise.
Réforme des retraites, le privé paiera-t-il pour le public ?
Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a, mercredi 10 octobre, dans le cadre d’un point d’étape avec les partenaires sociaux, présenté quelques épures de la future réforme qui vise à instituer un système dit universel des retraites. Figure parmi les pistes envisagées la possibilité de retenir un taux moyen de cotisation à 28 % ce qui pourrait générer d’importants transferts de charges au profit du secteur public qui dans les prochaines années sera confronté à une dégradation rapide du ratio cotisants / retraités.
Un régime par répartition à points
Sans surprise, le futur système « universel » qui « remplacera les 42 régimes de retraite existants » sera « public et par répartition ». Comme aujourd’hui, les retraités toucheront des pensions financées sur les cotisations des actifs. Le plafond de cotisation devrait se situer autour de 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Les actifs cotiseront dans la limite de 120.000 euros bruts annuels de revenus d’activité, soit moins qu’actuellement. Pour les complémentaires, le plafond de cotisation est de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le nouveau système concernera les régimes spéciaux, la fonction publique et les régimes fit alignés (régime général, régime agricole, indépendants, professions libérales). Néanmoins, les travailleurs indépendants, bénéficieront d’un régime de cotisations adapté afin de ne pas bouleverser les équilibres économiques de leur activité. Leur taux de cotisation actuel est plus faible que celui en vigueur pour le régime général.
À la différence du système du régime général qui retient les 25 meilleures années ou celui des régimes spéciaux qui prend en compte le salaire des six derniers mois, dans le nouveau système, l’ensemble de la carrière sera retenu. Les actifs acquérons des points durant toute leur vie professionnelle. Ces points accumulés seront convertis en pension au moment du départ à la retraite.
Des mécanismes de solidarité seront conservés
Les interruptions d’activité comme le chômage, l’invalidité, la maladie ou la maternité resteront compensées dans ce système par points, qui accordera une bonification « pour chaque enfant, dès le premier enfant » et non plus à partir du troisième.
La réforme maintiendra les pensions de réversion pour les veuves et veufs et un minimum de pension pour les bas salaires et les carrières hachées. Aujourd’hui, cohabitent 16 régimes de réversion, dans le cadre du futur régime universel, le Gouvernement, avec les partenaires sociaux, sera contraint de retenir de nouvelles règles. Est-ce que la réversion sera totalement mise sous condition de ressources et quel en sera le taux ? Nul ne le sait pour le moment.
La délicate question de l’âge de départ à la retraite
Si l’âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans, le Gouvernement a lancé l’idée d’un âge pivot à 63 ans. Avant 63 ans, la pension pourrait souffrir d’une décote comme cela existe pour les régimes actuels pour les assurés n’ayant pas la totalité des trimestres requis. L’objectif du Gouvernement est d’inciter les assurés à continuer à travailler au-delà de 62 ans sachant que disparaît le critère de la durée de cotisation. Aujourd’hui, pour obtenir une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé 166 trimestres pour les actifs nés en 1956. Les syndicats sont assez opposés à la fixation d’un âge pivot qui est jugé injuste socialement en pénalisant ceux qui ont commencé à travailler tôt. La notion de durée de cotisation pourrait revenir au cours de la concertation.
Le Gouvernement semble avoir abandonné, en revanche, l’idée d’instituer des comptes notionnels qui auraient permis de calculer le montant de la pension en fonction de l’espérance de vie de chaque génération. Ainsi, en vertu de ce système, une personne partant à la retraite à 62 ans toucherait une pension plus faible qu’une personne partant à 67 ans car son espérance de vie à la retraite serait plus longue.
La délicate question de l’alignement des taux de cotisation entre le privé et le public
Le Gouvernement souligne dans son rapport que le taux de cotisation dans le nouveau régime sera proche de 28 % pour les assurés et les employeurs qu’ils soient publics ou privés. Or, aujourd’hui, si pour les cotisations salariées, une convergence est en cours entre le public et le privé, les taux sont très différents au niveau des employeurs. Le taux fictif pour l’Etat (taux correspondant à la dotation d’équilibre pour le compte d’affectation des pensions civiles) est de 74 %. Le taux de cotisation employeur pour les pensions militaires est de 126 %. Le taux de cotisation pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière est de 30 %. Une harmonisation du taux à 28 % sans soultes versées par les administrations publiques aboutirait à un transfert de charge sur le privé qui pourrait atteindre une vingtaine de milliards d’euros d’ici 2040. Les taux de cotisation élevés traduisent des ratio cotisants / retraités dégradés. Or, ceux-ci sont amenés à se dégrader nettement dans les prochaines années pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Dans un système universel, la solidarité démographique jouera plus facilement que dans le système actuel (dispositif complexe des compensations).
La génération 63 ou 64 inaugurera le nouveau système
Comme prévu, la réforme ne concernera pas les actuels retraités, ni ceux qui partiront d’ici 2025. La réforme devrait s’appliquer à partir de la génération 1963 ou 1964. Le Gouvernement semble privilégier une bascule avec prise en compte des droits acquis dans l’ancien système. Ainsi, cohabiteront durant une quarantaine d’année les deux modes de calcul (voire plus si est prise en compte la délivrance des pensions). Le Gouvernement semble avoir écarté l’idée de calculer les pensions uniquement sur la base des points. Dans une telle bascule, il aurait été nécessaire d’attribuer des points en fonction des rémunérations passées ce qui supposait de reconstituer toutes les carrières. Il semblerait que cette reconstitution soit difficile à opérer dans la fonction publique. Un tel transfert aurait pu occasionner un nombre important de gagnants et de perdants.
Le chantier est loin d’être clos
Ces quelques pistes n’épuisent pas loin de là le sujet de la réforme. Il reste à traiter la question de la gouvernance (système étatisé ou paritaire), l’intégration des régimes spéciaux et de la fonction publique, les compensations éventuelles pour les perdants, les règles d’indexation du point et l’articulation avec les régimes par capitalisation. La question des personnels des différentes caisses de retraite et la dévolution des réserves qu’elles ont pu constituer au fil des années demeurent en suspens.
Le FMI revoit ses prévisions de croissance à la baisse
Selon le dernier rapport du FMI, sur les « Perspectives Economiques », la croissance de l’économie mondiale resterait stable sur la période 2018–19, pour atteindre le taux de 3,7 % observé l’an dernier. Cette croissance reste néanmoins supérieur au niveau moyen constaté entre 2012 et 2016. Le FMI souligne que de nombreux pays ont atteint le plein emploi ou s’en approchent. Par ailleurs grâce aux politiques monétaires non conventionnelles et à la reprise, les craintes déflationnistes antérieures se sont dissipées.
Le FMI indique malgré tout qu’il a été contraint de revoir à la baisse ses prévisions de croissance par rapport à celle établies en avril dernier. Ainsi, le taux de croissance a été abaissé de 0,2 point pour 2018 et pour 2019.
Le FMI a délivré dans ses projections d’automne un message épris de pessimisme. L’organisation internationale note que des risques de dégradation se multiplient. Il estime que dans plusieurs grands pays, la croissance est portée par des politiques qui semblent intenables à long terme. Il souligne que la politique économique américaine est porteuse de déséquilibres. La croissance fléchira lorsque certaines des mesures de relance prennent fin. Le FMI a abaissé sa prévision de croissance pour 2019 en raison des droits de douane qui ont été imposés récemment sur une large gamme d’importations chinoises, ainsi que des mesures de rétorsion prises par la Chine. La croissance chinoise attendue pour 2019 a été régalement revue à la baisse. Les mesures prises au niveau national permettront de contenir le ralentissement de l’activité mais au prix de l’accroissement des déséquilibres financiers internes.
Le FMI a abaissé de 0,1 point la croissance de la zone euro et du Royaume-Uni. Les révisions à la baisse pour les pays émergents et les pays en développement sont plus marquées, à -0,2 et -0,4 point de pourcentage, respectivement, pour cette année et l’année prochaine.
De manière plus globale, le FMI enregistre des signes d’une baisse de l’investissement et de l’activité manufacturière, conjuguée à un affaiblissement de la croissance du commerce.
Du fait d’une inflation hors alimentation et énergie très mesurée, les pays avancés bénéficient toujours d’une politique monétaire toujours favorable ; en revanche, les conditions financières se durcissent au sein des pays émergents et des pays en voie de développement. Ce durcissement est lié aux relèvements des taux directeurs aux Etats-Unis et à des facteurs propres à certains pays. L’Argentine, le Brésil, l’Afrique du Sud et la Turquie doivent faire face à des sorties de capitaux, à une dépréciation de leur monnaie et à une augmentation des taux pour endiguer la crise financière. Cet enchaînement conduit à un ralentissement de l’activité.
Parmi les menaces qui attirent l’attention du FMI figure l’endettement élevé des entreprises et des ménages qui s’est accumulé pendant les années de conditions financières favorables à l’échelle mondiale.
Les entreprises continuent de s’endetter auprès des banques
Le coût moyen des financements des entreprises à 5 ans atteint 1,36 %, son niveau le plus élevé depuis janvier 2017. Cela est dû à un renchérissement assez net depuis 1 an des émissions sur les marchés, les taux des crédits bancaires étant relativement stable au-delà de fluctuations mensuelles.
| Encours | Flux annuel net | Taux de croissance annuel | Coût des financements nouveaux (moyenne mensuelle) |
|||||
| août-2018 | août-2018 | juil- 2018 | août-2018 | juil- 2018 | août-2018 | |||
| Financement des SNF | 1 634 | 83 | 5,2 | 5,3 | 1,29 | 1,36 | ||
| – dont crédits bancaires | 992 | 54 | 5,3 | 5,7 | 1,40 | 1,55 | ||
| – dont financement de marché | 641 | 29 | 5,2 | 4,7 | 1,12 | 1,08 | ||
| en euros | 526 | 36 | 7,0 | 7,4 | ||||
| en devises | 115 | -7 | -2,3 | -6,0 | ||||
Le taux de pauvreté stable à 14 % en France en 2017
Selon une première estimation réalisée par l’INSEE, le taux de pauvreté serait stable en 2017, à 14,0 % de la population. En 2017, 8,8 millions de personnes seraient en situation de pauvreté monétaire. Les inégalités de niveau de vie mesurées par le rapport interdécile et le ratio (100-S80)/S20 seraient également stables . une légère augmentation est constatée en ce qui concerne l’indicateur de Gini qui mesure également les inégalités (+ 0,002), mais en dessous du seuil de significativité. L’amélioration de la situation sur le marché du travail en 2017 par rapport à 2016 serait compensée par un moindre effet redistributif des transferts sociaux et fiscaux, ce qui expliquerait la stabilité du taux de pauvreté et des inégalités.
Les prix de l’immobilier poursuivent leur hausse au sein de la zone euro
Le prix des logements, tel que mesuré par l’indice des prix des logements, a augmenté de 4,3% tant dans la zone euro que dans l’UE au deuxième trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Par rapport au premier trimestre 2018, les prix des logements ont progressé de 1,4% tant dans la zone euro que dans l’UE au deuxième trimestre 2018.
Les plus fortes augmentations annuelles du prix des logements au deuxième trimestre 2018 ont été enregistrées en Slovénie (+13,4%), en Irlande (+12,6%), au Portugal (+11,2%) ainsi que’en Hongrie (10,4%). En France, les prix ont augmenté de 2,8 % en u quand la hausse atteint 4,7 % en Allemagne, 6,8 % en Espagne, 11,2 % au Portugal et 3,4 % au Royaume-Uni. Deux pays enregistrent des baisses, en Suède (-1,7%), et en Italie (-0,2%).
Les faibles taux d’intérêt concourent à la hausse des prix en augmentant la demande de biens immobiliers.
Les Français continuent toujours de profiter des taux d’intérêt historiquement bas
Selon la Banque de France, les particuliers continuent à s’endetter profitant des taux bas. Ainsi, au mois d’août, la croissance des crédits aux particuliers a progressé de 6,1 % soit le même taux qu’en juillet. Les prêts à l’habitat ont cru de 5,9 % après + 5,8 %. De leur côté, les crédits à la consommation ont augmenté de + 6,9 %, inchangé par rapport à juillet. Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat (à long terme et à taux fixe) est de 1,53 % en août contre 1,58 % fin mars 2018.
L’INSEE révise à la baisse la croissance 2018 à 1,6 %
Dans sa note de conjoncture du mois d’octobre, l’INSEE prévoit, en 2018, pour la France, une croissance de 1,6 % grâce à une accélération de l’activité au second semestre. Après une quasi-stagnation au 1er et 2e trimestre, l’institut statistique reste optimiste en se fondant sur le maintien à un haut niveau des indicateurs qui mesurent le climat des affaires tant en France que dans l’ensemble des économies avancées. Cette prévision est en retrait par rapport à sa précédente prévision de 0,1 point. La France devrait faire moins bien que la moyenne de la zone euro.
Plusieurs points noirs pourraient remettre en cause cet optimisme. L’INSEE considère que l’activité aux États-Unis pourrait se ralentir avec une croissance de +0,7 % par trimestre. Elle serait soutenue par la consommation des ménages et l’investissement des entreprises mais freinée par le commerce extérieur. Au second semestre 2018, l’économie japonaise devrait également être moins fringante qu’au printemps. Au Royaume-Uni, l’activité serait pénalisée dans l’attente d’un éventuel accord pour le Brexit.
Pour la Chine, l’INSEE ne croit pas une décélération brutale de la croissance. Si les exportations peuvent être affectées par une demande extérieure moins dynamique qu’en 2017, en raison des mesures américaines, l’investissement immobilier et la consommation des ménages restera dynamiques.
La Turquie, le Brésil et la Russie et d’autres pays émergents d’Asie et d’Amérique latine verraient leur activité nettement plus pénalisée au second semestre par les tensions financières. Ces pays émergents doivent faire face à la hausse des taux et à la dépréciation de leur monnaie.
Une amélioration espérée pour la zone euro
Dans le prolongement du premier semestre 2018 marqué par le repli du climat des affaires, la croissance du PIB de la zone euro demeurerait plus modérée au second semestre (0,4 % par trimestre) qu’en 2017 (0,7 % par trimestre). Le PIB s’accroîtrait de 0,4 % à 0,5 % par trimestre en Allemagne et en Espagne, mais seulement de 0,1 % par trimestre en Italie. Cette situation ne devrait pas faciliter l’exécution du budget 2019 qui a été bâti sur des hypothèses économiques très optimistes.
L’INSEE prévoit une hausse de la consommation au cours des prochains mois, hausse qui s’est fait attendre durant tout le premier semestre. Cela suppose que les cours du pétrole se stabilisent voire baissent légèrement. Pour fonder son analyse, l’INSEE met en avant la confiance des ménages qui demeure à un haut niveau. En France, cette confiance tend néanmoins à s’effriter. La consommation serait favorisée par la baisse du chômage et par l’augmentation des salaires et cela malgré la hausse des prix.
Au second semestre 2018, l’investissement en construction ralentirait un peu en zone euro, le nombre de permis de construire n’augmentant plus depuis le début d’année. Dans un contexte de tensions croissantes sur l’appareil productif, l’investissement en équipement serait porté par les perspectives de demande et l’amélioration de la situation financière des entreprises. Les résultats des premiers du second semestres ne confirme pas pour le moment cette prévision.
Pour la France, l’INSEE note qu’en septembre, le climat des affaires en France, à 106, est au-dessus de sa moyenne de long terme (100). Il est néanmoins e retraite de 5 points par rapport à son niveau de décembre 2017, son sommet depuis 10 ans. Durant les derniers mois, le moral des entrepreneurs s’est stabilisé dans les principaux secteurs malgré la baisse observée en septembre dans l’industrie et le commerce de détail.
L’INSEE considère que la contre-performance de la France au 2e trimestre est imputable en partie aux grèves dans les transports qui ont pesé sur la consommation des ménages et gêné la production intérieure. L’arrêt pour maintenance de raffineries ainsi que la faible consommation d’énergie ont également modéré la production. Le retour à la normale devrait créer un rebond favorable au cours du 3e trimestre. La production manufacturière renouerait ainsi avec la croissance au second semestre après la baisse observée au premier. Par ailleurs, la consommation des ménages devrait bénéficier de l’augmentation du pouvoir d’achat. Il est à noter qu’au cours du 2e trimestre, les ménages ont affecté quasi totalement à l’épargne. Les achats importants de voitures en juillet et en août par anticipation du changement de procédure d’homologation des véhicules neufs (WLTP) devraient également contribuer à la hausse de la croissance. Selon l’INSEEE, le PIB français progresserait de 0,5 % au troisième trimestre puis de 0,4 % à l’automne. La croissance annuelle pourrait alors atteindre 1,6 % après 2,3 % en 2017.
Une nette décrue des créations d’emploi
En 2017, la France avait enregistré la création nette de 342 000. Pour 2018, le résultat serait moins florissant avec simplement 129 000 créations en lien avec le ralentissement de l’activité. L’emploi dans les services devrait conserver un rythme de croissance moins dynamique qu’en 2017 quand l’industrie continuerait de réduire ses effectifs d’ici la fin de l’année.
De son côté l’emploi non marchand a baissé avec la diminution du nombre de bénéficiaires de contrats aidés au premier semestre. Au second semestre, cette diminution serait atténuée par la montée en charge graduelle du nouveau dispositif de contrats aidés « Parcours emploi compétences ». Malgré ce tassement des créations d’emploi, le taux de chômage repasserait en-dessous de la barre des 9 % à 8,9 %.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie, la prestation dépendance
L’APA est la principale allocation visant à répondre au problème financier de la dépendance. Cette allocation permet aux personnes âgées dépendantes de financer des dépenses engendrées par l’accompagnement dont elles ont besoin au quotidien : aide technique, aide professionnelle à domicile, soutien aux proches aidants. Elle est accordée sous condition de ressources et en fonction de l’état de santé du bénéficiaire. 3,8 % des personnes âgées de 60 ans ou plus perçoivent l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), soit 1,2 million de personnes. 59 % vivent à domicile et 41 % en établissement. Entre 2008 et 2013, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 11 %. 90 % des bénéficiaires ont plus de 75 ans. Trois-quarts des bénéficiaires de l’APA sont des femmes et la moitié a plus de 85 ans. Les prestations versées dans le cadre de l’APA s’élèvent à plus de 5,5 milliards d’euros. Elles représentent le cinquième des dépenses publiques à la dépendance. Selon une étude du Ministère des Solidarités et de la Santé. La durée moyenne de perception de l’APA est de 3 ans et demi. Pour les hommes, cette durée est de 3 ans et pour les femmes de 4 ans.
Les hommes commencent à percevoir l’APA plus tôt, à partir de 81 ans et demi en moyenne, contre 83 ans et demi pour les femmes. Les hommes sont, en moyenne, moins dépendants et plus souvent pris en charge uniquement à domicile. En revanche, les femmes sont plus souvent prises en charge uniquement en établissement et perçoivent l’APA.
Le taux de rémunération des livrets bancaires est resté stable à 0,27 % en août
Sur un an, la rémunération moyenne des dépôts des ménages diminue de 5 points de base (0,89% en août 2018, après 0,94% en août 2017), comme celle des Sociétés Non Financières (0,29%, après 0,34%).
| août-2017 | juin-2018 | juil- 2018 (e) | août-2018 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,69 | 0,65 | 0,64 | 0,64 |
| Ménages | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,01 | 0,78 | 0,79 | 0,78 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,86 | 1,71 | 1,69 | 1,67 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| – plan d’épargne-logement | 2,71 | 2,69 | 2,69 | 2,68 |
| SNF | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| dont : – dépôts à vue | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,33 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,65 | 1,44 | 1,43 | 1,40 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,12 | -0,07 | -0,14 | -0,11 |
Revalorisation des pensions complémentaires de 0,6 % au 1er octobre
Lors d’une réunion le 2 octobre 2018, les partenaires sociaux du régime de retraite Agirc-Arrco des salariés du secteur privé ont confirmé la revalorisation en novembre des pensions complémentaires de 0,6%. Cette revalorisation fait suite à l’application de la formule instituée par l’accord de 2015. Le taux de revalorisation est égal au taux d’inflation moins un point sans pouvoir être négatif. Etant donné que le taux moyen d’inflation a été ces 12 derniers mois de 1,6 %, le taux de revalorisation ressort donc à 0,6 %. Pour 2019 et 2020, les partenaires sociaux n’ont pas précisé s’ils maintenaient le système actuel de revalorisation ou s’ils s’alignaient sur le taux de revalorisation des pensions de base, 0,3 %.
L’Assemblée nationale a adopté la réforme de l’épargne retraite (projet de loi PACTE)
L’Assemblée nationale a, vendredi 28 septembre dernier, adopté l’article 20 du projet de loi PACTE qui concerne la réforme de l’épargne retraite.
Le projet redessine le paysage de l’épargne retraite autour de deux grands principes harmonisation et transférabilité.
Le projet de loi autorise le gouvernement de réformer par ordonnances les dispositions qui concernent l’épargne retraite. Deux gammes de produits seront créés, une à vocation collective et la seconde à vocation individuelle qui prendra le nom de Plan d’Epargne Retraite Individuel.
Les primo-accédants à la propriété pourront utiliser leur produit d’épargne retraite pour acquérir leur résidence principale et cela sans attendre la liquidation de leurs pensions. Ce déblocage anticipé ne sera autorisé que pour l’achat de la première résidence principale.
Des sorties en capital à l’âge de la retraite seront ajoutés aux produits qui n’en étaient pas assorties. Elles pourront intervenir dans certaines limites en une fois ou de façon fractionnée. La fiscalité des sorties en capital pourrait être plus pénalisante que celle de la sortie en rente ou du moins que celle en vigueur actuellement pour les produits qui en sont déjà dotés. Les mesures fiscales ne sont pas encore connues. Le projet de loi prévoit la généralisation de la gestion pilotée des fonds par défaut. Les frais en cas de transfert d’un produit d’épargne retraite seront limités à 3 %.
lire la discussion en séance publique de l’article 20 à l’Assemblée nationale
Lire le texte de l’article 20 modifié en première lecture par l’Assemblée nationale
58 % des Français propriétaires de leur résidence principale
En 2018, selon l’INSEE 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Cette part n’a cessé de croître depuis les années 1980 jusqu’en 2010, mais depuis, elle est restée stable. L’augmentation des prix de l’immobilier ces vingt dernières années constituent un handicap à l’augmentation du nombre de propriétaires. La baisse des taux d’intérêt ne compense que partiellement l’augmentation des prix surtout en région parisienne. Par ailleurs, la crise qui s’est accompagné d’une plus grande insécurité en matière d’emploi et de salaire peut expliquer la stagnation de la proportion de propriétaires constatée depuis 2010.
La France compte 35,4 millions de logements
Selon l’INSEE, au 1er janvier 2018, la France métropolitaine compte 35,4 millions de logements. le nombre de logements s’accroît de 1,1 % par an en moyenne depuis trente ans. Aujourd’hui, sur 100 logements, 82 sont des résidences principales, 10 sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels, et 8 sont des logements vacants.
Le nombre de résidences principales s’établit à 29,0 millions. Il a crû à un rythme un peu plus élevé que l’ensemble du parc depuis le début des années 1990 jusqu’au milieu des années 2000. Depuis, il suit une progression annuelle moyenne d’environ 0,8 %.
La part des résidences secondaires et logements occasionnels est légèrement moins élevée en 2018 qu’il y a trente ans, tandis que celle des logements vacants est un peu plus élevée. Cette dernière a d’abord diminué lentement, descendant jusqu’à 6 % en 2006, avant de remonter ensuite. Depuis 2006, le nombre de logements vacants s’accroît dans l’ensemble des unités urbaines, mais de façon plus contenue dans celle de Paris. Cette hausse concerne à la fois les logements individuels et collectifs. Néanmoins, elle est un peu moins soutenue sur les dernières années.
Le parc de logements collectifs augmente plus que l’habitat individuel. Les dispositions législatives favorisant la densification de la construction expliquent cette évolution. Néanmoins l’habitat individuel reste majoritaire en représentant 56 % des logements : il est majoritaire parmi les résidences principales comme parmi les résidences secondaires et les logements occasionnels. Mais, depuis 2013, les logements achevés dans l’année sont en effet plus nombreux dans le collectif que dans l’individuel, alors que leurs niveaux étaient proches les années précédentes et que c’était l’inverse jusqu’en 2008.
Les résultats du mois de septembre des marchés financiers
Une rentrée tristounette pour les marchés « actions »
La rentrée boursière s’est effectuée à petit trop rythmée par les annonces de Donald Trump sur les sanctions commerciale à l’encontre de la Chine et les menaces contre l’Iran. Le pétrole en a profit pour repasser au-dessus de la barre des 80 dollars le baril.
Forte hausse des crédits à la consommation
| 2016 | 2017 | 2018 | Taux de croissance annuel | ||||||
| Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Mars 2018 | Juin 2018 | |
| Total crédit à la consommation aux particuliers | 159,6 | 162,2 | 163,8 | 166,3 | 169,0 | 171,1 | 173,7 | 5,5% | 6,0% |
| dont Prêts amortissables y compris créances titrisées | 111,6 | 113,4 | 114,6 | 116,3 | 118,5 | 119,1 | 121,0 | 5,0% | 5,5% |
| Comptes ordinaires débiteurs | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,1 | 2,5% | 5,4% |
| Crédits renouvelables | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | -3,0% | -1,6% |
| Crédits-bails | 9,1 | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 12,1 | 13,0 | 13,6 | 36,3% | 30,8% |
Les taux de l’usure pour le 4e trimestre sont publiés
Le Gouvernement a publié au Journal Officiel du 26 septembre les taux de l’usure applicables pour le 4e trimestre.
| Catégories | Taux effectif pratiqué au troisième trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er octobre 2018 |
|---|---|---|
| Contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) | 15,91 % | 21,21 % |
| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) | 9,44 % | 12,59 % |
| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros (1) | 4,42 % | 5,89 % |
| (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. | ||
| Catégories | Taux effectif pratiqué au troisième trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er octobre 2018 |
|---|---|---|
| Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
| Prêts à taux fixe (3) : | ||
| – prêts d’une durée inférieure à 10 ans ; | 2,12 % | 2,83 % |
| – prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ; | 2,14 % | 2,85 % |
| – prêts d’une durée de 20 ans et plus ; | 2,31 % | 3,08 % |
| Prêts à taux variable | 1,84 % | 2,45 % |
| Prêts-relais | 2,44 % | 3,25 % |
|
(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l’opération de regroupement de crédit ; (3) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus. |
||
| Catégories | Taux effectif pratiqué au troisième trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er octobre 2018 |
|---|---|---|
|
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale |
||
| Découverts en compte | 10,47 % | 13,96 % |
| Catégories | Taux effectif pratiqué au troisième trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er octobre 2018 |
|---|---|---|
|
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale |
||
| Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 3,41 % | 4,55 % |
| Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 1,47 % | 1,96 % |
| Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 1,7 % | 2,27 % |
| Découverts en compte | 10,47 % | 13,96 % |
| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 1,47 % | 1,96 % |
Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d’associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du troisième trimestre de 2018 pour cette catégorie de prêts est de 1,47 %.
Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.
Stabilisation de l’inflation en septembre
Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de +2,2 % après +2,3 % en août, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’INSEE Cette légère baisse du rythme de croissance de l’inflation résulterait, d’une part, d’un ralentissement des prix des services et de l’énergie et, d’autre part, d’un recul un peu plus marqué de ceux des produits manufacturés. En revanche, la baisse de l’inflation serait atténuée par une nette accélération des prix des produits alimentaires liée à celle des prix des produits frais.
Sur un mois, les prix à la consommation enregistrent un petit recul de −0,2 % après +0,5 % en août. Ce repli s’expliquerait par celui, saisonnier, des prix des services liés au tourisme. En revanche, les prix énergétiques augmenteraient sur le mois après une stabilité en août. Ceux des produits manufacturés accéléreraient après la fin, en août, des soldes d’été sur le territoire métropolitain. Enfin, les prix des produits alimentaires seraient plus dynamiques que le mois précédent.
Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait légèrement : +2,5 % en septembre après +2,6 %. Sur un mois, il se replierait à −0,2 % après un rebond à +0,5 % le mois précédent.
La dette publique à un point de PIB de la barre des 100 %
Au cours de l’année, en fonction des émissions de titres, des échéances des emprunts souscrits et des rentrées fiscales, l’endettement public varie. Il est en règle générale plus élevé au cours du 1er semestre qu’au cours du second. Pour le deuxième trimestre, la dette publique s’est établi à 99 % du PIB en légère baisse par rapport au 1er (-0,3 point). En volume, elle augmente de 5,2 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent et elle s’élève à 2 299,8 milliards d’euros. La dette publique nette augmente plus fortement (+14,4 milliards d’euros).
La contribution de l’État à la dette croît de 19,5 milliards d’euros au deuxième trimestre 2018. Celle des organismes divers d’administration centrale (Odac) diminue de 2,0 milliards d’euros. La contribution des administrations publiques locales (Apul) à la dette diminue un peu plus modérément (−0,7 milliard d’euros) : les communes se désendettent de 0,5 milliard d’euros, les départements comme les régions de 0,3 milliard d’euros. Au contraire, les organismes divers d’administration locale (Odal) s’endettent de 0,5 milliard d’euros. La contribution des administrations de sécurité sociale (Asso) à la dette diminue fortement (−11,7 milliards d’euros), surtout du fait de la Cades (−10,8 milliards d’euros) et dans une moindre mesure de l’Acoss (−1,0 milliard d’euros), de la Cnaf (−0,8 milliard d’euros), de la Cnam (−0,3 milliard d’euros) et des hôpitaux publics (−0,1 milliard d’euros). A contrario, l’Unedic s’endette à hauteur de 1,3 milliard d’euros.
Rebond de la consommation en août !
Selon l’INSEE, en août, les dépenses de consommation des ménages en biens ont augmenté de 0,8 % en volume, après une stabilité en juillet (+0,0 %). Cette hausse est portée par l’augmentation de la consommation en biens fabriqués (+2,5 % après +0,0 %), malgré le repli de la consommation alimentaire (−0,6 %) et des dépenses d’énergie (−0,5 %).
La confiance des ménages toujours en berne
Au mois de septembre, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique diminue. L’indicateur qui la synthétise perd 2 points et atteint son plus bas niveau depuis avril 2016. Il demeure au-dessous de sa moyenne de longue période.
L’opinion des ménages sur leur situation financière future se dégrade de 5 points. En revanche, l’opinion des ménages sur leur situation personnelle passée est stable et se maintient au-dessous de sa moyenne de longue période.
La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est quasi stable. Le solde correspondant se situe au-dessus de sa moyenne de longue période depuis janvier 2016.
En septembre, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner diminue fortement. Le solde correspondant perd 6 points et s’éloigne de sa moyenne de long terme. De même, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future continue de diminuer nettement. Le solde correspondant perd 4 points, soit autant qu’en août. Il se situe désormais au niveau de sa moyenne de longue période. Le solde sur la capacité d’épargne actuelle des ménages est quant à lui presque inchangé et se maintient légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période.
Sans surprise, les ménages sont plus nombreux à estimer que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois. Le solde correspondant gagne 11 points. Il dépasse ainsi sa moyenne de longue période. Les ménages sont également plus nombreux que le mois précédent à estimer que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois : le solde correspondant, déjà au-dessus de sa moyenne de long terme, gagne 4 points. Cette prise en compte de l’inflation explique, en grande partie, l’inquiétude plus marquée des ménages sur l’évolution du niveau de vie. En effet, l’opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France est également en baisse. Le solde correspondant perd 2 points et atteint son plus bas niveau depuis mai 2017. En outre, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie futur en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois diminue très fortement : le solde correspondant perd 7 points et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période.
Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage diminuent en septembre : le solde correspondant perd 4 points après en avoir gagné 8 en août. Il demeure au-dessous de sa moyenne de longue période.
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


