Petite faiblesse estivale pour l’assurance vie en juillet
L’assurance vie tout en restant dans le vert en juillet connaît un petit accès de faiblesse avec une collecte nette de 1,6 milliard d’euros ce qui constitue le plus mauvais mois de l’année 2019. Ce résultat est décevant pour un mois de juillet. Lors de ces dix dernières années, la collecte moyenne de l’assurance vie en juillet est de 3,3 milliards d’euros. En juillet 2018, elle s’était, par ailleurs, établie à 2,5 milliards d’euros.
Les ménages ont été très actifs en juillet avec leurs contrats d’assurance vie tant sur le plan des versements que des rachats. La collecte brute s’est élevée à 13,1 milliards d’euros (près d’un milliard de plus qu’en juin dernier, 11,5 milliards d’euros contre 9,8 milliards en juin dernier et 9,7 milliards d’euros un an plus tôt. Ces rachats ont profité aux biens de consommation durables qui ont progressé de 1,6 % en juillet dernier avec principalement une relance des dépenses en biens d’équipement du logement qui ont progressé de 1,9 % sur le mois. Après avoir différé leurs dépenses de consommation et après avoir épargné fortement au premier trimestre, les ménages ont retrouvé le chemin des magasins.
Dans un contexte économique et financier toujours compliqué, les ménages optent pour la prudence et investissent moins que dans le passé en unités de compte. Leur poids dans la collecte a atteint au mois de juillet 23,6 % contre 28 % en moyenne l’année dernière.
Le second semestre 2019 comme en 2018 devrait être moins porteur pour la collecte de l’assurance vie du fait des dépenses de rentrée scolaire et de fin d’années. Par ailleurs, les dépenses en biens d’équipement et en biens durables devraient s’accroître. L’assurance vie dont l’encours a atteint 1754 milliards d’euros au mois de juillet devrait conforter sa position de premier placement des ménages.
Le taux d’épargne baisse légèrement au 2e trimestre 2019
Selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages a été de 14,9 % du revenu disponible brut au 2e trimestre contre 15,3 % au premier. le taux d’épargne financière passe de 5,3 à 4,8 % du revenu disponible brut.
Cette légère baisse est imputable à la moindre progression du pouvoir d’achat des ménages par rapport au premier. Néanmoins, le taux d’épargne reste supérieur à sa moyenne de ces dernières années.
Le revenu disponible brut (RDB) des ménages ralentit au deuxième trimestre (+0,3 % après +1,0 %). La masse salariale reçue par les ménages marque le pas (+0,2 % après +1,3 %) par contrecoup des primes exceptionnelles versées par certaines entreprises au premier trimestre. Les prestations sociales en espèces ralentissent également (+0,3 % après +1,0 %) après la mise en place au premier trimestre des mesures sur la prime d’activité
Les ménages français veulent épargner plus
Au mois d’août, la confiance des ménages dans la situation économique est, selon l’INSEE, stable. À 102, l’indicateur qui la synthétise demeure légèrement supérieur à sa moyenne de longue période (100). La multiplication des signaux négatifs concerne la croissance de l’économie mondiale n impacte pas pour le moment les ménages français. La tenue d’un bon niveau de confiance de la part des ménages français peut s’expliquer par l’évolution favorable du chômage et par la résistance correcte sans être exceptionnelle de l’activité économique du pays.
Les ménages de plus en plus en mode épargne
Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée augmente légèrement en augmentant de deux points. Il se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. Par ailleurs, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future est stable et demeure légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période.
La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est inchangée par rapport au mois dernier et se maintient donc également au-dessus de sa moyenne. En revanche, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente de trois points tout en demeurant inférieur à sa moyenne de longue période. L’opinion des ménages sur leurs capacités d’épargne actuelle et future est quasi stable. Les soldes correspondants se maintiennent tous deux nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.
Pouvoir d’achat, un ressenti un peu négatif
Les Français ne ressentent pas réellement l’augmentation de leur pouvoir d’achat. Ainsi, en août, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie passé s’est amélioré au cours des douze derniers mois diminue légèrement. Le solde correspondant perd deux points et retrouve son niveau de juin, à peine au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France est quasi stable. Il se situe légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période
Marché de l’emploi, un réel optimisme
En matière d’emploi, les Français sont de plus en plus optimistes. Ainsi, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage diminuent de nouveau en août ; le solde correspondant perd quatre points après en avoir perdu deux en juillet. Il atteint ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2018 et se maintient bien au-dessous de sa moyenne de longue période.
Les ménages craignent le retour de l’inflation
Malgré la baisse continuelle de l’inflation depuis la fin de l’année dernière, les ménages pensent que cette situation n’est pas amenée à perdurer. En août, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont légèrement plus nombreux que le mois dernier. Le solde correspondant gagne deux points et demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période. En revanche, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est quasiment stable.
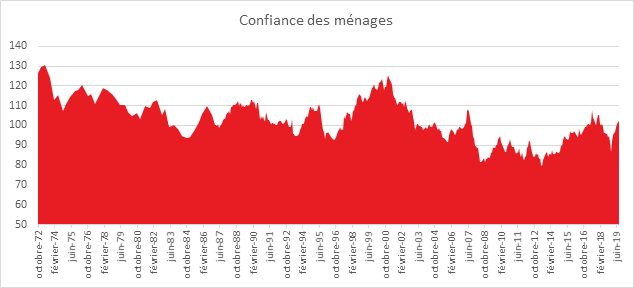
Le Coin de l’Epargne du 24 août 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 23 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 326,87 | +0,49 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 25 628,90 | -0,99 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 7 751,77 | -1,83 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 11 611,51 | +0,42 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 094,98 | -0,31 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 334,25 | -0,16 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 20 640,00 | +1,08 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 897,43 | +2,61 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,381 % | +0,034 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,676 % | +0,008 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,528 % | -0,033 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1140 | +0,46 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 526,578 | +0,92 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 58,660 | +0,07 % | 52,973 |
La guerre Trump vs Powell supplantera-t-elle celle avec la Chine ?
Donald Trump continue d’accroître ses pressions sur la banque centrale américaine. Ainsi, par Tweet, après le discours de Jay Powell à Jackson Hole, le Président de la FED, il a déclaré que « Ma seule question est de savoir qui est notre plus grand ennemi, Jay Powell ou le Président Xi ? » Il a ajouté « comme d’habitude, la Fed n’a rien fait ! C’est incroyable qu’ils puissent parler sans savoir ni demander ce que je fais, ce qui sera annoncé sous peu. Nous avons un dollar très fort et une Fed très faible ».
Le Président de la FED avait dans son discours réaffirmé ses positions maintes fois exprimées. « Nous agirons de manière appropriée pour soutenir la croissance », a-t-il déclaré en soulignant que l’économie américaine est dans une « position favorable » mais qu’elle est confrontée à des « risques importants » car la croissance à l’étranger se ralentit dans un contexte de conflit commercial.
Les relations avec la Chine se sont encore tendues vendredi 23 août. Les autorités chinoises ont annoncé leur intention d’instituer des droits de douane supplémentaires de 5 à 10 % sur 75 milliards de dollars de marchandises américaines en réponse aux dernières surtaxes annoncées par l’administration américaine. Certaines de ces taxes entreront en vigueur dès le 1er septembre, celles de 5% sur le soja et le pétrole brut, d’autres le 15 décembre, en particulier celles sur l’automobile. Le Président Donald Trump a demandé, toujours par Tweet, aux entreprises d’abandonner la Chine et de produire dans leur pays. Ces différentes réactions du Président américain ont amené à un fléchissement du cours des actions. L’indice des valeurs technologiques, le NASDAQ, a perdu 3 % lors de la séance du 23 août. Les firmes du secteur de la haute technologie sont les premières concernées par les mesures prises par les Etats-Unis et la Chine. De son côté, le Dow Jones a reculé de 2,37 %. Sur l’ensemble de la semaine, le statu quo a prévalu avant la reprise des affaires qui devrait s’amorcer à partir de la semaine prochaine.
Les Français optent pour le liquide et le garanti
Selon la Banque de France, les placements financiers des ménages au premier trimestre 2019 s’élevaient à 5153,8 milliards d’euros. Cette augmentation est imputable à la hausse du cours des actions et aux flux d’épargne. En rythme annuel, leur flux d’épargne a atteint 135,4 au premier trimestre 2019 contre 113,7 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Les produits de taux sont les grands gagnants. Leur encours s’élève à 3 322 milliards d’euros au premier trimestre 2019. Les flux correspondants se sont élevés à 35,0 milliards d’euros au premier trimestre 2019 contre 32 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Le numéraire et les dépôts à vue poursuivent leur hausse avec un flux de janvier à mars 2019 de 20,3 milliards contre 9,1 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Pour le deuxième trimestre 2019, la hausse serait plus faible, 8,5 milliards d’euros. L’encours du numéraire et des dépôts à vue atteint un nouveau sommet à 576,2 milliards d’euros. La préférence pour la liquidité demeure forte dans un contexte d’incertitudes économiques et sociales. Avec la crise des « gilets jaunes », de nombreux ménages ont reporté des achats en particulier durables, ce qui a conduit à augmenter la poche d’épargne de précaution.
L’épargne réglementée (Livret A, LDDS, PEL, etc.) continue à enregistrer des flux importants. Ainsi au deuxième trimestre 2019, ils ont atteint 11 milliards d’euros contre 11,9 milliards au premier et 7,5 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. L’encours de l’épargne réglementée s’élevait au deuxième trimestre 2019 à 759,2 milliards d’euros. Les ménages continuent à placer leur argent sur ces produits malgré leur faible taux de rendement. Au regard de la situation du marché monétaire, il faut néanmoins relativiser la faiblesse de ces rendements dans la mesure où, sans leur fixation réglementée, ils devraient être nuls voire négatifs. En effet, le taux des obligations d’État deuxième à 10 ans était, mi-août, inférieur à 0,4 %.
L’assurance vie en euros maintient le cap. Ainsi, les flux ont été de 11,3 milliards d’euros au deuxième trimestre 2019 contre 10,1 milliards d’euros au cours du premier. L’encours des fonds euros au premier trimestre 2019 était de 1 625 milliards d’euros. La garantie en capital constitue toujours le premier atout des fonds euros.
Au premier trimestre, les ménages se sont désengagés du marché actions. Le flux a été négatif d’un milliard d’euros. Cette décollecte s’explique par les mauvais résultats des cours boursiers à la fin de l’année 2018. En revanche, en raison de l’appréciation des cours au premier trimestre 2019, l’encours est en hausse pour les actions cotées à 253 milliards d’euros contre 245,9 milliards d’euros au quatrième trimestre 2018. Les flux des actions détenues indirectement via les Organismes de Placement Collectif (OPC) sont également négatifs, et cela tant au quatrième trimestre 2018 qu’au premier trimestre 2019. Les unités de compte des contrats d’assurance vie ont enregistré une collecte trimestrielle d’un milliard d’euros au premier comme au deuxième trimestre 2019. L’encours est de 362,8 milliards d’euros au 1er trimestre 2019.
Les ménages français restent très averses aux risques en limitant autant que possible leur exposition aux produits ne bénéficiant pas de garantie en capital. Les produits de taux représentent 64 % de l’ensemble des placements financiers. En outre, parmi ces produits, figurent les parts sociales des entrepreneurs indépendants sous forme d’actions non cotées (1 036 milliards d’euros). Les actions cotées, les unités de compte (qui ne sont pas tous investies en actions) et les actions contenues dans les OPC représentent un total de 705,3 milliards d’euros, soit moins de 14 %.
Le Livret A comme symbole d’une stratégie de précaution absolue
Le mois de juillet 2019 a bien réussi au Livret A avec une collecte de 1,44 milliard d’euros contre 880 millions en juillet 2018. L’encours a ainsi atteint à la fin du mois de juillet 296,8 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées pour le Livret A au mois de juillet, en 2009, 2014 et 2015. La collecte moyenne en juillet sur ces dix dernières années s’établit à 520 millions d’euros. Le cru de 2019 est donc nettement supérieur.
Le mois de juillet est logiquement un mois de bascule pour le Livret A. En effet, si le premier semestre est, en règle générale, porteur pour le produit d’épargne le plus répandu de France, le second l’est moins en raison de l’accumulation des dépenses : vacances, rentrées scolaires et universitaires, fêtes de fin d’année.
Au mois de juillet 2019, 3 millions de contribuables ont bénéficié du versement de 2,5 milliards comme solde de tout compte des réductions d’impôt auxquels ils avaient le droit au titre de l’exercice 2018. Cela a pu les conduire à la fin du mois à effectuer des versements sur leur Livret A.
Au-delà de ce facteur lié à la mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu, depuis le début de l’année, les ménages ont tendance à accroître leur effort d’épargne et à privilégier les placements liquides et garantis. Le Livret A correspond parfaitement à ce souhait.
Par ailleurs, le contexte économique reste anxiogène avec les annonces répétées d’une probable récession ainsi que les tensions internationales entre la Chine et les Etats-Unis. A contrario, la baisse du chômage conduit les titulaires de Livret A ayant retrouvé un emploi à reconstituer leur épargne de précaution.
Un facteur structurel joue également en faveur de l’augmentation du taux d’épargne, le vieillissement de la population. En effet, l’effort d’épargne est avant tout réalisé par les plus de 45 ans. Or cette partie de la population augmente du fait de l’évolution de la pyramide des âges. En Allemagne, le taux d’épargne est plus élevé qu’en France en raison du poids plus important des seniors au sein de la population totale.
Au deuxième trimestre, la construction toujours en recul
Si les Français s’endettent pour acquérir des biens immobiliers, et si le nombre de transactions devrait dépasser un million en 2019, la construction est toujours en recul. Néanmoins, les autorisations sont en augmentation ce qui est de bon augure pour les prochains moins.
D’avril à juin 2019, les mises en chantier ont diminué de 6,1 % après – 2,0 % au premier trimestre. Le collectif et les logements en résidences connaissent une diminution de 8 % après – 3,9 % et l’individuel se replie de 3,1 % après + 1,0 %.
Sur un an, 409 300 logements ont été mis en chantier, soit une baisse de 22 300 unités (- 5,2 %) par rapport aux douze mois précédents.
Les autorisations de logements à la construction ont augmenté au deuxième trimestre de + 2,5 % par rapport aux trois mois précédents, après une contraction de 0,2 % au premier trimestre. Les autorisations pour les logements individuels sont en hausse de 1 % après une baisse de 3,2 %. Les logements collectifs ou en résidence poursuivent leur progression (+ 3,5 % après + 2,0 %). En un an, de juillet 2018 à juin 2019, 446 900 logements ont été autorisés à la construction en baisse de 31 500 unités (- 6,6 %) par rapport aux douze mois précédents.
Le Livret A n’a pas pris de vacances en juillet
Le mois de juillet 2019 a bien réussi au Livret A avec une collecte de 1,44 milliard d’euros contre 880 millions en juillet 2018. L’encours a ainsi atteint à la fin du mois de juillet 296,8 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées pour le Livret A au mois de juillet, en 2009, 2014 et 2015. La collecte moyenne en juillet sur ces dix dernières années s’établit à 520 millions d’euros. Le cru de 2019 est donc nettement supérieur.
Le mois de juillet est logiquement un mois de bascule pour le Livret A. En effet, si le premier semestre est, en règle générale, porteur pour le produit d’épargne le plus répandu de France, le second l’est moins en raison de l’accumulation des dépenses : vacances, rentrées scolaires et universitaires, fêtes de fin d’année.
Au mois de juillet 2019, 3 millions de contribuables ont bénéficié du versement de 2,5 milliards comme solde de tout compte des réductions d’impôt auxquels ils avaient le droit au titre de l’exercice 2018. Cela a pu les conduire à la fin du mois à effectuer des versements sur leur Livret A.
Au-delà de ce facteur lié à la mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu, depuis le début de l’année, les ménages ont tendance à accroître leur effort d’épargne et à privilégier les placements liquides et garantis. Le Livret A correspond parfaitement à ce souhait.
Par ailleurs, le contexte économique reste anxiogène avec les annonces répétées d’une probable récession ainsi que les tensions internationales entre la Chine et les Etats-Unis. A contrario, la baisse du chômage conduit les titulaires de Livret A ayant retrouvé un emploi à reconstituer leur épargne de précaution.
Un facteur structurel joue également en faveur de l’augmentation du taux d’épargne, le vieillissement de la population. En effet, l’effort d’épargne est avant tout réalisé par les plus de 45 ans, or cette partie de la population augmente du fait de l’évolution de la pyramide des âges. En Allemagne, le taux d’épargne est plus élevé qu’en France en raison du poids plus important des seniors au sein de la population totale.
Les épargnants aiment le liquide et le garanti !
Selon la Banque de France, les placements financiers des ménages au 1er trimestre 2019 s’élevaient à 5153,8 milliards d’euros. Cette augmentation est imputable à la hausse du cours des actions et aux flux d’épargne. En rythme annuel, leur flux d’épargne a atteint 135,4 au premier trimestre 2019 contre 113,7 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Les produits de taux sont les grands gagnants. Leur encours s’élève à 3322 milliards d’euros au 1er trimestre 2019 Les flux se sont élevés à 35,0 milliards d’euros au premier trimestre 2019 contre 32 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Le numéraire et les dépôts à vue poursuivent leur hausse avec un flux de janvier à mars 2019 de 20,3 milliards contre 9,1 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Pour le 2e trimestre 2019, la hausse serait plus faible, 8,5 milliards d’euros. L’encours du numéraire et des dépôts à vue atteint un nouveau sommet à 576,2 milliards d’euros. La préférence pour la liquidité demeure forte dans un contexte d’incertitudes économiques et sociales. Avec la crise des gilets jaunes, de nombreux ménages ont reporté des achats en particulier durables, ce qui a conduit à augmenter la poche d’épargne de précaution.
L’épargne réglementée (Livret A, LDDS, PEL, etc.) continue à enregistrer des flux importants. Ainsi au deuxième trimestre 2019, ils ont atteint 11 milliards d’euros contre 11,9 milliards au premier et 7,5 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. L’encours de l’épargne réglementée s’élevait au 2 e trimestre 2019 à 759,2 milliards d’euros. Les ménages continuent à placer leur argent sur ces produits malgré leur faible taux de rendement. Au regard de la situation du marché monétaire, il faut néanmoins relativiser la faiblesse de ces rendements. En effet, sans leur fixation réglementée, ils devraient être nuls voire négatifs. En effet, le taux des obligations d’Etat à 10 ans était mi août inférieur à 0,4 %.
L’assurance vie en euros maintient le cap. Ainsi, les flux ont été de 11,3 milliards d’euros au deuxième trimestre 2019 contre 10,1 milliards d’euros au cours du premier. L’encours des fonds euros au 1er trimestre 2019 était de 1625 milliards d’euros. La garantie en capital constitue toujours le premier atout des fonds euros.
Les ménages se sont désengagés au premier trimestre des actions. Le flux a été négatif d’un milliard d’euros. Cette décollecte s’explique par les mauvais résultats des cours boursiers à la fin de l’année 2018. En revanche, en raison de l’appréciation des cours au 1er trimestre 2019, l’encours est en hausse pour les actions cotées à 253 milliards d’euros contre 245,9 milliards d’euros au 4e trimestre 2018. Les flux des actions détenues indirectement via les Organismes de Placement Collectif sont également négatifs et cela tant au 4e trimestre 2018 qu’au 1er trimestre 2019. Les unités de compte des contrats d’assurance vie ont enregistré une collecte trimestrielle d’un milliard d’euros tant au 1er qu’au 2e trimestre 2019. L’encours est de 362,8 milliards d’euros au 1e trimestre 2019.
Les ménages français restent très averses aux risques en limitant autant que possible leur exposition aux produits ne bénéficiant pas de garantie en capital. Les produits de taux représentent 64 % de l’ensemble des placements financiers. En outre, dans ces derniers figurent les parts sociales des entrepreneurs indépendants sous forme d’actions non cotées (1036 milliards d’euros). Les actions cotées, les unités de compte (qui ne sont pas tous investies en actions) et les actions contenues dans les OPC représentent un total de 705,3 milliards d’euros, soit moins de 14 %.
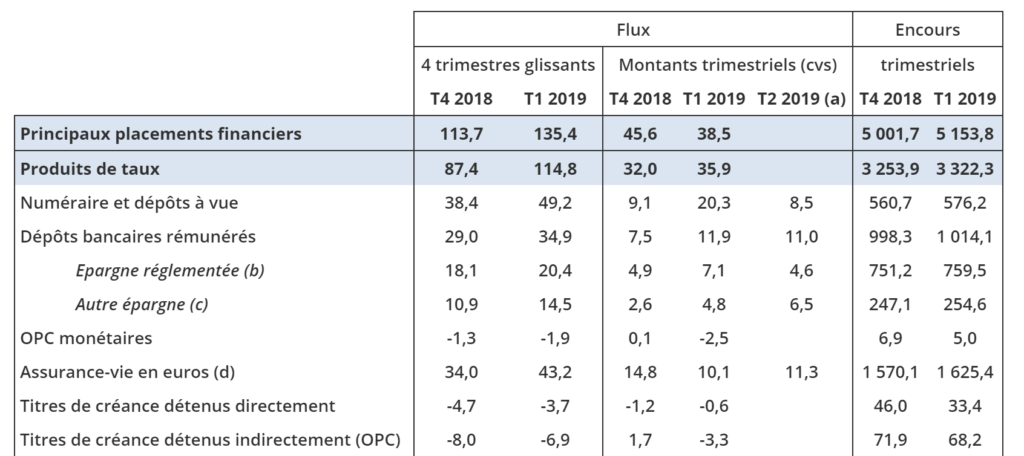
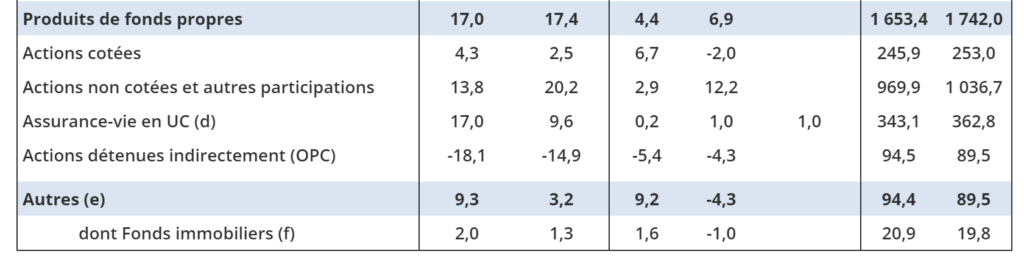
Le Coin de l’Epargne du 17 août 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 16 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 300,79 | -0,51 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 25 886,01 | -1,53 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 7 895,99 | -0,79 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 11 562,74 | -1,12 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 117,15 | -1,88 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 329,08 | -0,14 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 20 418,81 | -1,29 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 823,82 | +1,77 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,415 % | -0,148 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,688 % | -0,121 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,561 % | -0,175 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1092 | -0,97 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 511,660 | +0,98 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 58,620 | +0,62 % | 52,973 |
Accalmie boursière en attendant la rentrée sur fond de baisse des taux ?
Après deux semaines difficiles, les investisseurs ont décidé de faire la trêve de l’assomption. En fin de semaine, certains ont même estimé qu’il était temps de revenir sur les marchés. Les principaux indices ont gagné plus de 1 % vendredi 16 août. Ils ont considéré que ni le Président américain, ni la FED ne veulent une chute des cours. Le premier est conscient que sa réélection passe par le maintien du niveau de vie des Américains, or ce dernier est en partie conditionné par le cours des actions. La seconde n’a aucun intérêt à être à l’origine d’une crise économique de grande ampleur. Dans ces conditions, même si les menaces de récession se renforcent, l’idée que le cours des actions pourrait augmenter est de plus en plus partagée.
La situation concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reste complexe. Les informations et déclarations sont nombreuses et contradictoires. Pékin a évoqué, jeudi, la possibilité de « mesures de représailles » contre Washington en cas de mise en œuvre de surtaxes sur les biens d’importations chinoises au 1er septembre. S’exprimant devant des journalistes depuis le New Jersey, où il est en déplacement, le Président américain Donald Trump a prédit une issue rapide au conflit commercial. Logiquement, les négociations doivent reprendre en septembre mais aucune rencontre à haut niveau n’a été programmée pour le moment.
Dans un tel contexte, les investisseurs suivront de près le symposium économique de Jackson Hole, qui se tiendra du jeudi 22 au samedi 24 août. Le discours du Président de la Fed, Jerome Powell qui est surveillé de près par Donald Trump est attendu.
Par ailleurs, à Hong Kong, aucun signe d’apaisement n’est perceptible. Les troupes chinoises se sont concentrées à la frontière, les manifestants prodémocratie semblent, de leur côté, déterminés à ne pas arrêter leur mouvement. Ils appellent désormais à créer une panique bancaire, en retirant massivement leur argent aux distributeurs ou à le convertir en dollars américains. L’option d’une intervention militaire est de plus en plus envisagée. Cela pourrait durcir les relations avec l’Occident dont le G7 se réunit à Biarritz du 24 au 26 août. La sécurité et les inégalités seront les deux principaux thèmes de ce sommet des chefs d’État et de Gouvernement.
Au niveau des taux d’intérêt, de nouveaux records ont été atteints. Ainsi, pour la première fois, le taux des obligations d’État en France à 10 ans est inférieur au taux de dépôt de la BCE (-0,4 %). Les investisseurs anticipent de nouvelles baisses de taux.
Les entreprises empruntent de plus en plus à taux négatifs
Après les États, les entreprises et les ménages accèdent aux emprunts à taux négatifs. Ainsi, les dettes d’entreprise traitant à taux négatifs représentent, selon les données de Bloomberg, plus de 1 000 milliards de dollars dans le monde, dont une majorité en Europe (plus de 825 milliards). Ce montant est en forte progression depuis le mois de juin. D’après des informations provenant de Bank of America Merrill Lynch (BofAML), sept obligations d’entreprise ont été échangées avec un rendement inférieur au taux de dépôt de la Banque centrale européenne (-0,40 %). Ces titres, dans leur grande majorité, n’ont pas été émis à taux négatifs. C’est la demande croissante des investisseurs pour les obligations d’entreprise sûres qui a tiré les prix à la hausse sur les marchés secondaires, rognant peu à peu les rendements affichés jusqu’à les faire basculer en territoire négatif. Malgré tout, des entreprises comme Schneider Electric au début du mois de juillet, peuvent émettre des emprunts à taux négatif et donc se retrouver dans une situation très inhabituelle, être rémunérées pour s’endetter.
Cet accès à un endettement gratuit devrait conduire à une forte augmentation de l’investissement. Or, la progression de ce dernier reste assez limitée. Les entreprises s’endettent en partie pour racheter leurs actions. Elles profitent également de la situation des taux bas pour restructurer leurs dettes passées.
L’argent pas cher pourrait amener à des opérations de rachats d’entreprises. En effet, dans certains secteurs d’activité, les entreprises sont sous cotées, (automobile, banque, assurances, transports, énergie), pouvant inciter à des raids boursiers financés par emprunts. Pour le moment, les opérations de rachats d’entreprises sont assez limitées en raison de la forte aversion aux risques des investisseurs. Mais, cela pourrait changer dans les prochains mois si les taux continuaient à baisser.
En Europe du Nord, les particuliers peuvent accéder à des prêts à taux zéro pour acheter des biens immobiliers. Au Danemark, la « Juske Bank », troisième banque du pays propose un taux négatif de -0,5 % pour un crédit, à dix ans, destiné à financer une rénovation de logement.
L’inflation sousjacente nettement inférieur à 2 points
En juillet, selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,2 % sur un mois, après une hausse de 0,2 % en juin. Ce repli provient d’un recul saisonnier des prix des produits manufacturés (−2,8 % après une stabilité en juin) dû aux soldes d’été et d’une baisse accentuée des prix de l’énergie (−1,1 % après −0,1 %). En revanche, les prix des services progressent de +1,0 % après +0,5 %, notamment ceux des transports aériens avec le début des vacances scolaires. Les prix alimentaires sont également plus dynamiques que le mois précédent (+0,5 % après +0,1 %). Enfin, les prix du tabac augmentent légèrement sur le mois (+0,2 % après une stabilité en juin).
Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation décélèrent à +0,1 % sur un mois, après +0,3 % en juin.
Sur un an, les prix à la consommation augmentent de +1,1 % en juillet, après +1,2 % en juin 2019. Cette légère baisse de l’inflation résulte d’un ralentissement, sur un an, des prix de l’énergie, des services et du tabac. En revanche, l’accélération des prix des produits alimentaires et le moindre recul de ceux des produits manufacturés limitent la baisse de l’inflation.
L’inflation sous-jacente est stable à +0,9 % sur un an, comme le mois précédent. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) se replie à −0,2 % en juillet après +0,3 % en juin ; sur un an, il ralentit à +1,3 % après +1,4 % le mois précédent.
Le taux de chômage revient à son niveau de 2009 en France
Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail s’élevait au deuxième trimestre à 8,5 % de la population active. Il a diminué de 0,2 point après une baisse de 0,1 point le trimestre précédent. il est inférieur de 0,6 point à son niveau du deuxième trimestre 2018. Il s’agit de son plus bas niveau depuis début 2009.
Pour la seule France métropolitaine, le taux de chômage est de 8,2 % au deuxième trimestre en recul de 0,2 point par rapport au premier. 2,4 millions de personnes sont au chômage. Le taux de chômage diminue pour toutes les tranches d’âge. La baisse est plus prononcée pour les jeunes (−0,6 point) que pour les personnes de 25 à 49 ans (−0,2 point) et les 50 ans ou plus (−0,2 point). Sur un an, le taux de chômage en France métropolitaine diminue de 0,6 point, avec une baisse plus marquée pour les jeunes (–1,5 point), en particulier les jeunes femmes (−1,8 point).
Parmi les chômeurs, 900 000 déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée s’établit à 3,2 % de la population active au deuxième trimestre 2019. Il est en baisse légère par rapport au trimestre précédent (−0,1 point) et est inférieur de 0,4 point à son niveau un an auparavant.
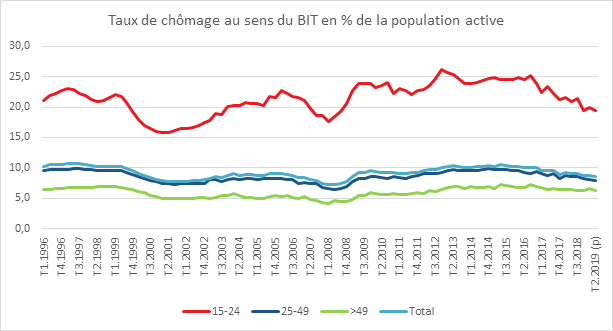
En France métropolitaine, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,5 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage. Elles sont dans le halo autour du chômage. Leur nombre augmente de 63 000 entre les premier et deuxième trimestres 2019, après une forte baisse au trimestre précédent, et retrouve son niveau atteint un an auparavant.
Après la publication de l’arrêté sur l’épargne retraite, le cadre réglementaire est prêt pour le PER
Le Ministère de l’Economie a publié l’arrêté portant application de la réforme de l’épargne retraite au Journal Officiel du 11 août 2019.
Cet arrêté précise notamment les règles pour la gestion profilée de l’épargne retraite.
Avec la publication de cet arrêté, le cadre réglementaire est désormais au complet pour le Plan d’Epargne Retraite dont le début de commercialisation a été fixé au 1er octobre 2019.
Quand Donald Trump inquiète les marchés
Durant les deux premières années de la présidence de Donald Trump, les marchés « actions » américains ont battu record sur record. Avec l’intensification de la guerre commerciale et avec l’inquiétude croissante de l’arrivée du retournement conjoncturel américain après plus de 10 ans de croissance, les marchés commencent à s’inquiéter d’autant plus que les mois d’août sont, depuis quelques années, annonciateurs de mauvaises nouvelles
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 9 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 327,92 | -0,58 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 26.287,44 | -0,75 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 7 959,14 | -0,56 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 11 693,80 | -1,50 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 253,85 | -2,07 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 333,74 | -1,26 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 20 684,82 | -1,91 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 774,75 | -3,25 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,267 % | -0,034 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,567 % | -0,088 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,736% | -0,111 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1201 | +0,87 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 498,210 | +4,07 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 58,280 | -4,86 % | 52,973 |
La montée aux extrêmes de la guerre commerciale
La guerre commerciale s’étend après l’annonce du début du mois d’août de Donald Trump de taxer tous les produits chinois et avec la décision de Washington de ne plus avoir de ne plus avoir de liens commerciaux avec Huawei sauf si un accord commercial avec Pékin était conclu.
En réaction, les Chinois ont répliqué en laissant se déprécier leur devise qui est passée sous la barre symbolique de 7 yuans pour un 1 dollar, au plus bas depuis 2008. Ils ont également d’arrêter les importations de produits alimentaires américains. Par ailleurs, la Chine pourrait également décider de limiter ses exportations de terres rares vers les Etats-Unis. Ces minerais sont indispensables aux industries de la « tech » (téléphones portables, ordinateurs, écrans de télé, etc.) et de la défense (armes de précision avancées). La Chine assure 90 % de la production de terres rares. La perspective d’une contraction de l’offre a entraîné l’augmentation des actions des entreprises qui vendent les terres rares.
Face au risque de ralentissement, la banque centrale chinoise a annoncé qu’elle entendait assouplir ses conditions monétaires. Les marchés ont vivement réagi à la dépréciation de la monnaie chinoise, répétant ainsi ce qui s’était produit déjà en 2015. La dévaluation surprise de la devise chinoise avait alors alimenté la panique boursière. Donald Trump a vivement réagi à la décision de la banque centrale chinois déclarant que « cela s’appelle une manipulation des changes ». Certains analystes dont ceux de Morgan Stanley affirment que, si elle se poursuivait durant quatre à six mois, cette aggravation des relations entre la Chine et les Etats-Unis pourrait plonger l’économie mondiale dans une grave récession d’ici neuf mois.
Les marchés « actions » européens ont fait du yo-yo au gré des annonces. Les taux d’intérêt ont battu de nouveaux records à la baisse. Compte tenu des menaces de ralentissement de la croissance, le cours du pétrole s’est contracté et est repassé en-dessous des 60 dollars le baril.
Des taux abyssaux
Face aux turbulences des marchés actions provoquées par l’accroissement des tensions commerciales et monétaires, les investisseurs se sont rués sur les titres obligataires entraînant une nouvelle décrue des taux. Le Bund allemand à 10 ans, considéré comme la valeur de référence pour les taux longs en Europe, a battu un nouveau plancher historique à – 0,53 % en séance. Les titres souverains allemands sont négatifs jusqu’à 30 ans. C’est également le cas pour la dette néerlandaise. Pour la dette suisse, les taux sont négatifs jusqu’à 50 ans. En France, le taux de l’OAT de référence à 10 ans est négatif depuis le mois de juillet. Il a battu cette semaine un nouveau record historique à – 0,27 % en séance. Les taux à 10 ans sont négatifs pour une quinzaine de pays en Europe. La fuite vers la qualité est rendue d’autant plus difficile que les banques centrales ont acheté des stocks importants de titres, ce qui conduit à accélérer la baisse des taux. La Banque centrale européenne détient ainsi plus de 500 milliards d’euros de dette allemande, un montant considérable comparé à l’encours total d’environ 1 800 milliards d’euros (chiffres BRI). Au Japon, la banque centrale détient plus de 40 % du stock de dette souveraine.
Sur les marchés « actions », les grands investisseurs américains réduisent toujours leur exposition à l’Europe pour se replier sur leur propre marché en période de tension, ce qui accentue la pression à la baisse.
L’Europe est confrontée à une série de défis : crise italienne, ralentissement de la première puissance de la Zone euro et Brexit. Avec des élections anticipées en Italie et un hard Brexit qui se profile à la fin du mois d’octobre, la situation s’assombrit. La Banque centrale européenne devrait, dans ces conditions, abaisser ses taux directeurs au mois de septembre.
La production industrielle française en demi-teinte
Les tensions commerciales internationales et la baisse des achats automobile pèsent sur la production industrielle française même si elle est moins exposée que celle de l’Allemagne. Ainsi, au cours du deuxième trimestre, la production a diminué, selon l’INSEE, dans l’industrie manufacturière de 0,3 %. Elle a malgré tout augmenté dans l’ensemble de l’industrie (+0,3 %).
Par rapport au premier trimestre, la production augmente fermement dans les industries extractives, énergie, eau (+3,8 %) et est quasi stable dans les « autres industries » (+0,1 %). À l’inverse, elle diminue dans les matériels de transport (−2,1 %) et dans la cokéfaction et raffinage (−6,4 %). Elle est quasi stable dans les industries agroalimentaires (−0,1 %) et stable dans les biens d’équipement.
Sur un an, l’industrie française est toujours en progression. Dans l’industrie manufacturière, la production du deuxième trimestre de 2019 est supérieure à celle du même trimestre de 2018 (+1,0 %), de même que dans l’ensemble de l’industrie (+1,6 %).
Sur cette période, la production augmente dans les industries extractives, énergie, eau (+5,0 %), dans les « autres industries » (+1,1 %), dans les biens d’équipement (+3,8 %) et dans la cokéfaction et raffinage (+4,4 %). Cependant elle baisse dans les matériels de transport (−0,5 %) et dans les industries agroalimentaires (−0,2 %).
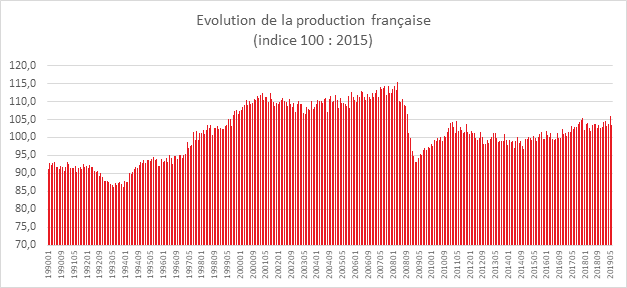
Les entreprises profitent des faibles taux d’intérêt pour s’endetter
Les entreprises françaises continuent à s’endetter en profitant des taux d’intérêt extrêmement bas. Ainsi, les crédits bancaires progressent, selon la Banque de France, en juin de 7,1 % sur un an. De leur côté, le financement de marché augmente de 4,5 % toujours sur un an. Le coût moyen du financement à 5 ans des entreprises enregistre une baisse de 21 points de base, passant de 1,26 % en mai à 1,05 % en juin. Le financement des sociétés non financières atteint à fin juin 1670 milliards d’euros contre 1088 milliards d’euros en juin 2018.
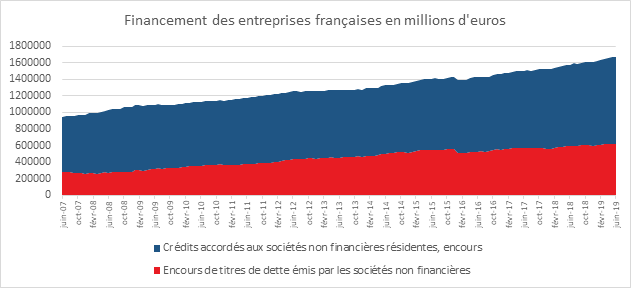
L’emploi se maintient
La croissance de l’emploi salarié privé a ralenti, selon l’INSEE, au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, +0,3 % après +0,5 %. 62 100 créations nettes d’emploi ont été enregistrées après 95 600. Sur un an, l’emploi s’accroît de 1,3 % (soit +259 400). Hors intérim, la dynamique est identique avec un taux de croissance de 0,3 % sur le trimestre (soit +61 100) et +1,4 % sur un an (+266 300).
La construction, toujours en pointe
L’emploi salarié privé augmente de nouveau solidement dans la construction : +0,7 % au deuxième trimestre (soit +9 800), après +1,2 %. Sur un an, l’emploi salarié privé s’accroît de 41 400 dans la construction. Le secteur est porté par le niveau élevé des transactions immobilières et par la fin des chantiers des collectivités avant le début du cycle électoral (municipales, départementales et régionales).
L’industrie crée des emplois
Après avoir perdu des emplois durant de nombreuses années, l’industrie française réussit à se stabiliser avec même une création nette d’emplois. Au deuxième trimestre, l’emploi industriel a cru de 0,1 % (soit +3 000), après +0,2 % au premier. Sur un an, le scréations d’emploi s’élèvent à 20 000.
Les services restent dynamiques
L’emploi privé continue d’augmenter dans les services marchands,: +0,4 % soit +47 500, après +0,6 % au premier trimestre, portant à +1,5 % la hausse sur un an (soit +186 300). Hors intérim, le nombre d’emplois dans les services a progressé de +0,4 % (soit +46 500), après +0,5 % le trimestre précédent, et +1,7 % sur un an. L’emploi privé dans les services non marchands demeure stable sur le trimestre, à un niveau légèrement plus élevé qu’un an auparavant (+0,3 %).
L’emploi intérimaire diminue légèrement sur un an
Après un rebond au premier trimestre (+1,3 %), l’emploi intérimaire ralentit nettement : +0,1 % (soit +1 000 après +10 600). Il reste inférieur à son niveau atteint un an auparavant (−0,9 %, soit −6 900).
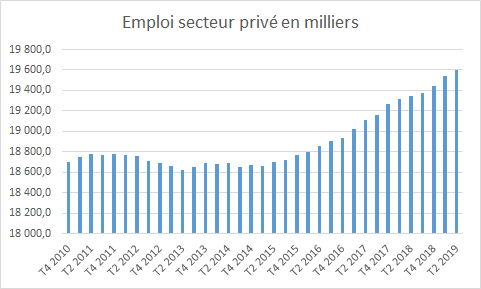
Le Coin des Epargnants du 2 août 2019 : cela gite en période estivale
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 2 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 359,00 | -4,48 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 26 485,01 | -2,60 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 004,07 | -3,92 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 11 872,44 | -4,41 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 407,06 | -1,88 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 376,12 | -4,21 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 21 087,16 | -2,64 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 867,84 | -2,60 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,233 % | -0,111 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,488 % | -0,112 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,847% | -0,230 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1106 | -0,18 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 440,490 | +1,57 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 61,260 | -3,22 % | 52,973 |
Le mois d’août serait-il maudit ?
Depuis plusieurs années, le mois d’août ne porte pas chance aux marchés « actions ». Le cru 2019 commence sous de mauvais hospices. Le CAC 40 a reculé vendredi 2 août de 3,57 % du fait des annonces de sanctions commerciales du Président Donald Trump. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée depuis le mois de juin 2016 qui avait été marqué par le Brexit. En cinq jours, le CAC 40 abandonne près de 4,5 % quand l’indice allemand DAXX perd plus de 4,4 %. Les indices américains reculent mais dans une moindre proportion que ceux du vieux continent. Le Dow Jones cède 2,6 % sur la semaine et le Nasdaq 3,92 %.
Cette chute des cours est donc intervenue essentiellement après l’annonce du Président Donald Trump concernant l’application d’une majoration, à compter du 1er septembre, des droits de douanes de 10 % sur les 300 milliards de dollars d’importations chinoises jusque-là épargnées. Le ministère chinois du commerce a menacé Washington de représailles en cas d’application des droits de douane alourdis. Le Président américain a dans le cadre d’une réunion publique justifié cette surtaxe par le fait que la Chine ne respectait pas ses engagements d’achat de produits américains. Il a accusé ses prédécesseurs de faiblesses vis-à-vis des autorités chinoises. Malgré et à cause de ses majorations, la balance commerciale américaine continue à se dégrader notamment avec la Chine, les importateurs multipliant les achats de précaution. Le déficit commercial s’est élevé à -55,2 milliards de dollars en juin, contre -54,6 espéré, tandis que le solde avec la Chine a été négatif de 30,2 milliards de dollars.
La crainte du durcissement du conflit commercial durable entre Washington et Pékin a provoqué une forte demande de titres obligataires sur les marchés des dettes d’Etat provoquant ainsi une nouvelle baisse des taux. Celui de l’obligation de l’Etat américain à 10 ans est tombé en dessous de 1,84 %, son plus bas niveau depuis octobre 2016. Celui du Bund allemand de même échéance, qui fait référence en Europe, a inscrit un nouveau plancher absolu à -0,4976%, tandis que celui de l’échéance à 30 ans est passé en territoire négatif pour la première fois de son histoire.
La menace de Donald Trump a de fortes consonances intérieures. Le Président a, en effet, décidé de lancer sa campagne électorale pour sa réélection. Par ailleurs, elle est également destinée à Jerome Powell afin d’obtenir une nouvelle baisse des taux d’intérêt américains au mois de septembre.
Les marchés échaudés tant par les récentes annonces des banques centrales que celles du Président des Etats-Unis ont fortement reculé durant la semaine. Les résultats en demi-teinte de l’emploi ont eu peu d’impact. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a annoncé que l’économie américaine a créé 164 000 emplois non-agricoles en juillet, contre 165 000 anticipées par le marché. Le solde des deux mois précédents a été révisé en baisse de 41 000. Le taux de chômage est resté stable à 3,7 %, contre un repli de 0,1 point attendu, tandis que le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % sur un mois et de 3,2 % sur un an, là où les analystes tablaient sur respectivement +0,2 % et +3,1 %.
L’habitat porte le crédit en France
La croissance des crédits aux particuliers a augmenté de 6,2 % au mois de juin. Cette franche progression est toujours portée par les crédits à l’habitat (6,3 %, stable par rapport à mai).
La croissance des prêts à la consommation est en décélération (+5,5 %, après +6,0 % en mai et 6,1% en avril) tout en restant soutenue.
Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux diminue en juin, à la fois pour les prêts à l’habitat à long terme et à taux fixe (1,39 %, après 1,44 % en mai), pour ceux à court terme et à taux variable (1,41 %, après 1,48 % en mai) et pour les crédits à la consommation (3,81 %, après 3,99 % en mai).
Epargne retraite, le décret d’application du 1er août précise les règles
Après l‘ordonnance du 24 juillet 2019, le Gouvernement a publié au Journal Officiel du 1er août le premier décret d’application sur l’épargne retraite. ce décret précise les mécanismes de transfert des plans, le fonctionnement des associations souscriptrices de contrats de groupe et les dates d’application du nouveau régime. Ainsi, il est précisé que les Plans d’Epargne Retraite pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 et que les produits antérieurs cesseront de l’être à compter du 1er octobre 2020.
Le Coin de l’épargne du mois de juillet 2019 : un début d’été en demi-teinte
Le mois de juillet aura été chafouin pour les marchés européens avec un léger recul des indices actions. Les prévisions de croissance revues à la baisse, les tergiversations sur les taux, la poursuite des tensions commerciales, la proximité croissante d’un hard Brexit n’ont pas joué en faveur des marchés. L’attentisme a été de mise. Même si New York aurait espéré une baisse des taux directeurs de la FED plus importante, les indices actions ont battu de nouveaux records. Au niveau monétaire, l’euro est en forte baisse par rapport le dollar. Les taux d’intérêt des dettes publiques sont également en fort recul.
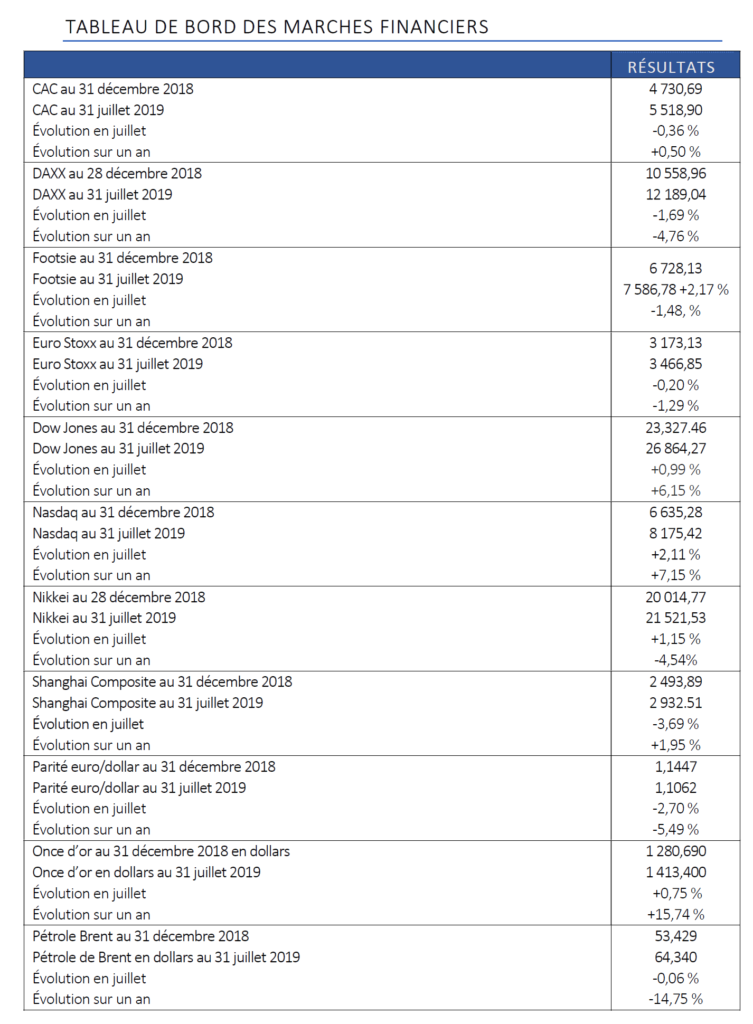
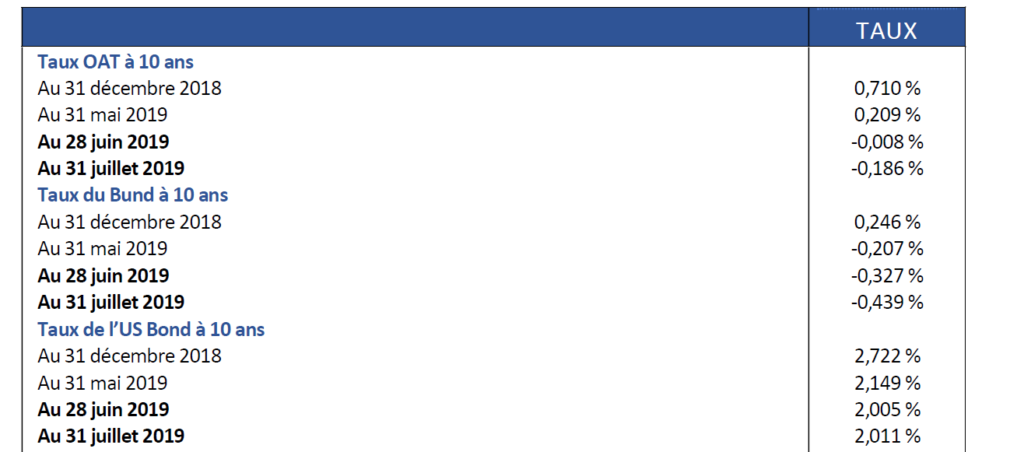
La rémunération des livrets bancaires toujours en baisse
Avec la baisse des taux d’intérêt constatés depuis plusieurs semaines, selon la Banque de France, en juin le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires a diminué (0,60 %, après 0,61 % en mai). Ce taux a baissé de 5 points de base sur un an (0,60 % en juin, après 0,65 % en juin 2018). La diminution observée sur ces 12 derniers mois est principalement portée par les comptes à terme supérieurs à 2 ans, dont la rémunération a fléchi de 29 points de base pour les ménages et de 21 points de base pour les SNF. Le taux de rémunération des livrets bancaires est passé en un mois de 0,25 à 0,24 %.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
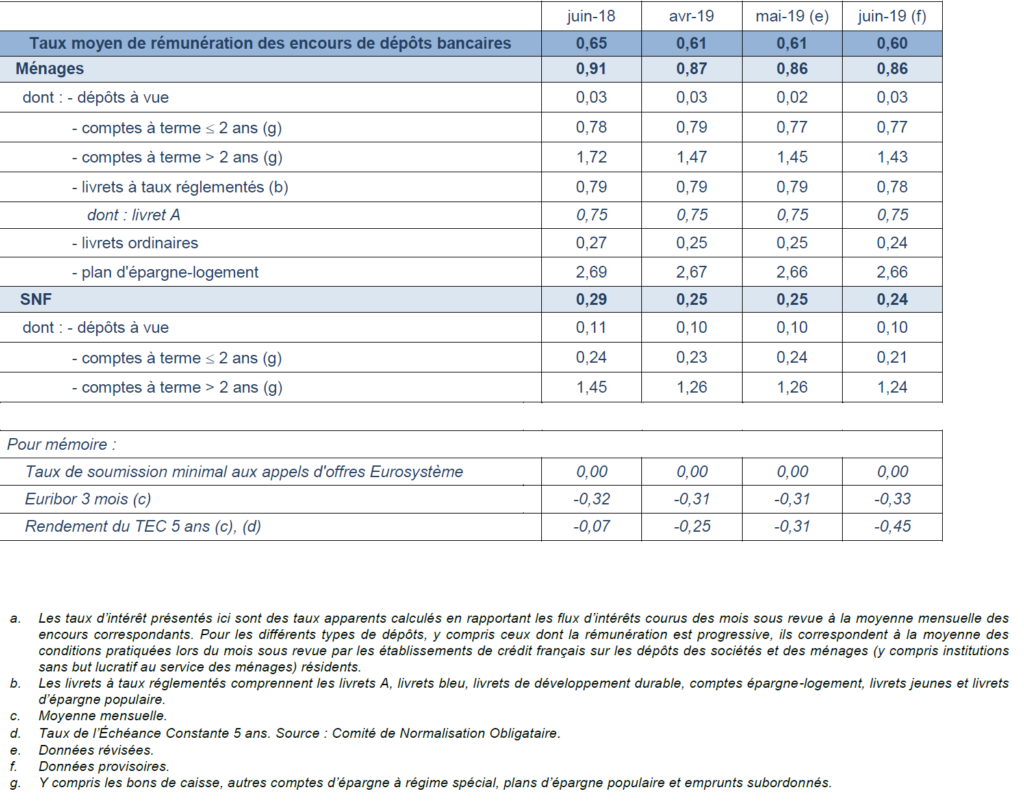
La croissance française à petite vitesse
L’économie française continue de croître mais à un rythme d’escargot. Après avoir enregistré un gain de 0,3 % au premier trimestre, le PIB ne s’est accru que de 0,2 % au deuxième. Ce résultat en demi-teinte est imputable à la faiblesse de la consommation qui n’a augmenté que de 0,2 % contre +0,4 % au premier trimestre. Avec ce résultat, l’objectif de croissance de 1,4 % sur l’ensemble de l’année semble de plus en plus hors d’atteinte. Une révision à la baisse à 1,2 % est probable avec à la clef un risque de dérapage du déficit public.
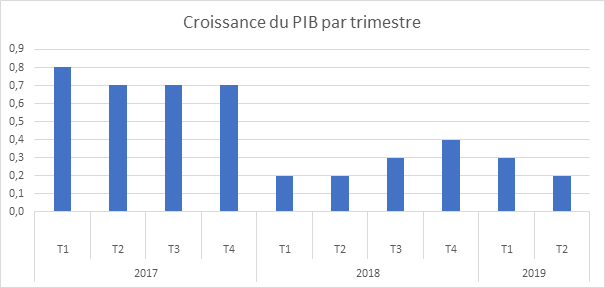
L’épargne avant la consommation
Les Français restent toujours très prudents en matière de dépenses de consommation. Le rebond après la crise des gilets jaunes ne s’est pas réalisée. En effet, au premier trimestre, la progression de la consommation avait été jugée faible, +0,4 %. Malgré les gains de pouvoir d’achat, primes défiscalisées, versement anticipé des réductions d’impôt, amélioration de certains minimas sociaux, etc., les ménages n’ont pas accru leurs dépenses. Ils ont préféré épargner comme l’indique le montant élevé des collectes du Livret A (+11,57 milliards d’euros) et de l’assurance vie (+15,1 milliards d’euros).
L’épargne avant la consommation
Les Français restent toujours très prudents en matière de dépenses de consommation. Le rebond après la crise des gilets jaunes ne s’est pas réalisé. En effet, au premier trimestre, la progression de la consommation avait été jugée faible, +0,4 %. Malgré les gains de pouvoir d’achat, primes défiscalisées, versement anticipé des réductions d’impôt, amélioration de certains minimas sociaux, etc., les ménages n’ont pas accru leurs dépenses. Ils ont préféré épargner comme l’indique le montant élevé des collectes nettes du Livret A (+11,57 milliards d’euros) et de l’assurance vie (+15,1 milliards d’euros). Le montant des dépôts à vie a été multiplié par deux en douze ans. Les Français, face à la multiplication des incertitudes économiques, tensions commerciales sino-américaines ou le Brexit demeurent très prudents et reportent leurs achats de biens durables. L’achat de véhicules neufs est ainsi en retrait au cours du premier trimestre. Dans ces conditions, il est assez logique que la production manufacturière soit orientée à la baisse (-0,4 % au deuxième trimestre contre +0,5 % au premier). La production a été, de ce fait, portée par les services qui ont connu une progression de 0,5 %.
L’investissement des entreprises en hausse
La bonne nouvelle des résultats de la croissance du deuxième trimestre provient de l’investissement qui augmente de 0,9 % contre +0,5 % au premier trimestre. Cette progression est imputable aux entreprises dont les investissements sont en hausse de 1,2 % après +0,7 %. Elles se sont équipées en matériel informatique et de télécommunication afin de compenser le retard accumulé en la matière ces dernières années. L’investissement des ménages a enregistré une petite croissance de 0,1 % stable par rapport à celle du premier trimestre.
La hause de l’investissement traduit la confiance maintenue des chefs d’entreprise dans la croissance de l’économie française. Par ailleurs, cela est un gage d’amélioration de la compétitivité de notre économie.
Le commerce extérieur neutre pour la croissance
Dans un contexte de ralentissement du commerce international, le commerce extérieur de la France n’a pas pesé sur le cours de l’économie française. La croissance des importations s’est ralentie passant de 1,1 % à 0,1 % du premier au deuxième trimestre. Les exportations ont de leur côté cru au même rythme, +0,2 %. La contribution à la croissance du PIB a été neutre quand elle avait été négative de 0,3 point au premier trimestre. La France est moins touchée que certains de ses partenaires dont l’Allemagne par le ralentissement des échanges extérieurs du fait du poids plus faible de son industrie.
Les variations de stocks ont joué négativement
Au deuxième trimestre, les entreprises ont réduit leurs stocks faisant que ces derniers ont pesé sur la croissance, -0,2 % contre +0,3 % au premier trimestre.
Un deuxième semestre plus porteur ?
Les ménages, avec l’amélioration de leur pouvoir d’achat, +2,5 % attendu en 2019, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 2007, devraient reprendre le chemin de la consommation au cours du deuxième semestre. En effet, depuis plusieurs années, les comportements des ménages diffèrent d’un semestre à un autre. Au cours du premier, les Français épargnent quand au cours du second, du fait des vacances, de la rentrée scolaire ou des fêtes de fin d’année, ils dépensent davantage.
Pour expliquer l’atonie des dépenses, il faut prendre en compte le fait que les ménages sont toujours dubitatifs en cas d’augmentation soudaine de leur pouvoir d’achat considérant que cette situation ne soit pas amenée à perdurer. Ils craignent que les pouvoirs publics leur reprennent d’une main ce qu’ils ont donné de l’autre. Il en est de même en matière d’inflation. Après plusieurs mois de hausse des prix durant l’année 2018, ils intègrent lentement la désinflation. Il est à noter également que l’indice de confiance des ménages qui avait fortement baissé entre la fin de l’année 2018 et le printemps 2019 est à nouveau en hausse.
**
*
La poursuite de l’amélioration de la situation de l’emploi pourrait jouer positivement en faveur de la croissance d’ici le mois de décembre. Si dans les années 80/90, il fallait un taux de croissance de 2 % pour créer des emplois, désormais, une faible croissance suffit. Cette situation est liée à la tertiarisation de l’économie et à la plus grande flexibilité de notre marché du travail. La décrue du chômage est également facilitée par les nombreux départs à la retraite.
Le Coin des Epargnants du 27 juillet 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 26 juillet 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 610,05 | +1,04 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 27 192,45 | +0,14 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 330,21 | +2,26 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 12 419,90 | +1,30 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 549,06 | +0,54 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 524,47 | +1,27 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 21 658,15 | +0,89 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 944,54 | +0,70 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,122 % | -0,051 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,376 % | -0,053 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 2,077% | +0,020 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1121 | -0,88 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 418,480 | -0,43 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 63,380 | +0,86 % | 52,973 |
La ligne rouge des 5600 points franchie sur fond de BCE et de croissance américaine
Depuis la mi-juillet, la bourse de Paris jouait avec la ligne des 5600 points sans réellement pouvoir la franchir sur la durée. Entre les prises de bénéfices, le contexte économique toujours instable, cette ligne constitue une barre symbolique. Atteinte au mois de mai 2018, elle ne fut franchie à nouveau de manière fugace qu’au mois d’avril 2019. Le CAC 40 a gagné 18,59 % depuis le début de l’année. Sur un an, la hausse est plus modeste (+3,38 %).
Cette semaine a été marquée par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication des résultats de la croissance américaine.
La BCE a, comme prévu, laissé inchangés ses taux directeurs lors de sa réunion du mois de juillet, aux plus bas depuis mars 2016. Le principal taux de refinancement a été maintenu à zéro tandis que les banques vont continuer à payer auprès de la BCE un intérêt négatif de 0,40 % pour les liquidités dont elles n’ont pas l’utilité immédiate.
La BCE a confirmé que le contexte mondial (ralentissement de la croissance en zone euro, perspective d’un hard Brexit, guerres commerciales, inflation inférieure aux objectifs) imposait le maintien d’une politique très accommodante pour « une période prolongée ». Lors de la conférence de presse de la BCE, il a été indiqué qu’une baisse des taux est donc désormais « envisagée ». « Les taux resteront à leurs niveaux actuels ou plus bas au moins jusqu’au premier semestre 2020 ». Le calendrier est ainsi modifié car, auparavant, la date butoir pour la politique monétaire accommodante était le premier trimestre 2020. La BCE estime par ailleurs qu’un « haut degré » de soutien à l’économie restera requis « pendant longtemps », intégrant une possible reprise du programme de rachat d’obligations arrêté fin 2018. Dans ces conditions, un assouplissement de la politique monétaire est attendu lors la réunion de septembre. Le taux de dépôt pourrait, en un ou deux mouvements à l’automne, être porté de -0,40 % à -0,60% d’ici la fin de l’année. Les annonces de la BCE ont eu comme conséquence de peser sur le cours de l’euro qui est passé en dessous de 1,12 euros.
La croissance américaine surprend encore
La croissance américaine ralentit, mais porte encore beau. Selon les chiffres du Département du Commerce publiés vendredi 26 juillet, elle s’est établie à 2,1 % au deuxième trimestre. Elle est certes en retrait d’un point par rapport à celle du premier trimestre mais supérieure aux prévisions qui se situaient entre 1,8 % et 2 %. La baisse du rythme de croissance est imputable aux reports d’investissement de la part des entreprises qui sont attentistes compte tenu de l’évolution des relations commerciales avec la Chine. Le commerce extérieur a joué contre la croissance. Les exportations ont chuté de 5,2% sur la période, quand les importations n’ont augmenté que de 0,1 %. En revanche, les dépenses des ménages ont augmenté de 4,3 % sur le trimestre, portées par un fort rebond de la consommation de biens durables (+12,9 %). Les dépenses publiques ont augmenté de 5 %, soit la plus forte hausse depuis dix ans, ce qui devrait conduire à une progression du déficit public.
L’inflation est en légère hausse tout en restant en-deçà de l’objectif des 2% fixé par la Fed. Hors prix de l’alimentation et de l’énergie, les prix à la consommation ont augmenté de 1,8 %, contre 1,1 % au premier trimestre. Avec ce ralentissement, la Réserve fédérale pourrait bien annoncer une réduction de ses taux à la fin du mois, une première en dix ans.
La décrue du rendement des Plans d’Épargne Logement (PEL)
Le rendement moyen des PEL baisse régulièrement depuis 2012, passant de 3,14 à 2,66 % de 2017 à 2019. À la différence du Livret A, le taux de rendement du PEL pour les adhérents est celui en vigueur au moment de la souscription, ce qui explique que le taux moyen reste assez élevé.
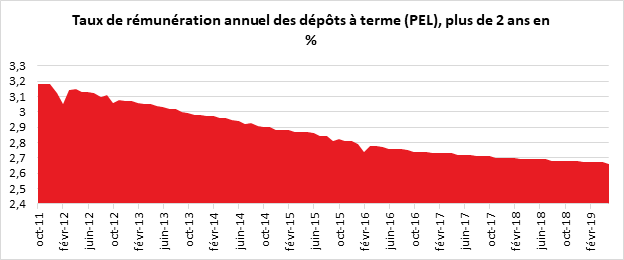
Évolution du rendement du PEL
100 % de hausse en douze ans pour les dépôts à vue des ménages
En juin 2007, les dépôts à vue des ménages s’élevaient à 194 milliards d’euros. En mai 2019, ils atteignent 388 milliards d’euros, soit une hausse 100 %. Les Français maintiennent une poche de liquidités de plus en plus importante, se rapprochant ainsi du comportement des Allemands. Cette tendance n’empêche pas les livrets d’épargne réglementée comme le Livret A ou le LDDS de battre record sur record.
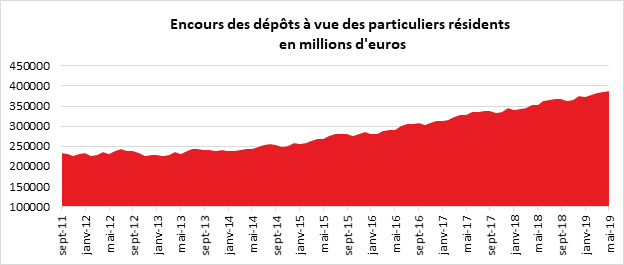
Le Livret A et l’Assurance vie en pleine forme
La collecte du mois de juin est en net retrait par rapport à celle des mois précédents. Elle s’est élevée à 510 millions d’euros contre 1,22 milliard au mois de mai. Il s’agit de la plus faible collecte depuis le début de l’année. Il faut remonter au mois d’octobre dernier pour enregistrer un plus faible résultat. Depuis le début de l’année, la moyenne mensuelle est de 1,9 milliard d’euros. De ce fait, la collecte nette du premier semestre pour le Livret A est de 11,57 milliards d’euros contre 9,11 milliards d’euros pour la même période en 2018. À fin juin, l’encours du Livret A est à son plus haut historique avec 295,4 milliards d’euros.
Pour le sixième mois consécutif, l’assurance vie a enregistré en juin une collecte nette positive, +2,4 milliards d’euros contre +1,8 milliard d’euros en mai et un an auparavant. Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre, la collecte nette a été de 15,1 milliards d’euros, soit 3,5 milliards d’euros de plus qu’en 2018.
Au mois de juin, la collecte brute à 12,1 milliards d’euros s’est bien tenue quand, dans le même temps, les prestations sont restées stables à 9,8 milliards d’euros. Au cours des six premiers mois, le montant total des cotisations a atteint 74,0 milliards d’euros et les prestations 58,9 milliards d’euros. Au mois de juin, la souscription des unités de compte a représenté 25,6 % de la collecte totale en progression par rapport aux mois précédents en liaison avec l’amélioration des cours des actions. Pour les six premiers mois, la part des unités de compte (UC) est de 24 % en retrait par rapport à l’année 2018 (28 %). L’encours des contrats d’assurance vie s’élève à 1 750 milliards d’euros à fin juin 2019, en progression de 3 % sur un an.
Le mois de juin a conforté la tendance constatée depuis le début de l’année. Les ménages français ont accru leur effort d’épargne, ce qui a profité à l’assurance vie et au Livret A. Ces deux produits d’épargne ont bénéficié de l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’aversion des ménages aux risques, d’où le poids important de la collecte des fonds euros. La crise des « gilets jaunes » et les incertitudes économiques ont amené les Français à mettre de l’argent de côté sous une forme assez liquide et sûre. Il semble néanmoins qu’une inflexion soit en cours. L’évolution de l’indice de confiance des ménages dans la situation économique pourrait amener une progression plus soutenue des dépenses de consommation. Au mois de juin, l’indicateur de l’INSEE qui la synthétise est, en effet, en hausse pour le sixième mois consécutif et est repassé au-dessus de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis avril 2018. Depuis plusieurs années, les comportements des ménages diffèrent d’un semestre à un autre. Après avoir épargné durant les premiers mois de l’année, les ménages entrent au cours du second semestre dans un cycle de dépenses vacances-rentrée scolaire-fêtes de fin d’année. Cette année, en revanche, la disparition du paiement du dernier tiers d’impôt sur le revenu avec l’instauration du prélèvement à la source devrait limiter les décollectes sur le Livret A.
LE PEPP, le plan d’épargne européen officiellement lancé
Après son adoption par le Parlement européen et le conseil le 20 juin dernier, la Commission européenne a publié un règlement concernant le produit paneuropéen-retraite individuelle (PEPP) le 25 juillet 2019 au JO de l’Union européenne.
Les institutions européennes ont souhaité que les actifs européens puissent accéder à un produit d’épargne retraite portable au sein de l’Union. Ce produit s’adresse en premier lieu aux expatriés. En 2015, 11,3 millions de citoyens en âge de travailler résidaient dans un État membre autre que celui dont ils étaient ressortissants, et 1,3 million travaillaient dans un État membre autre que celui où ils résidaient. Un des autres objectifs de ce produit est de favoriser la réorientation de l’épargne européenne sur des placements longs.
Un PEPP est donc selon le règlement un produit de retraite individuelle non professionnelle que souscrit volontairement un épargnant PEPP en vue de sa retraite. Il est indiqué que le PEPP devrait privilégier la sortie en rente. Les possibilités de retrait de capital anticipé devraient être limitées et pourraient être pénalisées.
Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir accéder à l’ensemble du marché de l’Union avec un seul enregistrement de produit à accorder sur la base d’un ensemble unique de règles.
Afin de ne pas mettre en péril la stabilité financière et de tenir compte des différences en matière de structure organisationnelle et de surveillance, la fourniture des PEPP sera assurée par des Institutions de Retraite Professionnelle (IRP) agréées et font qui l’objet d’une surveillance. Un cantonnement a été prévu afin de mieux garantir la stabilité financière.
Les caractéristiques du PEPP seront les suivantes :
- la portabilité: le fournisseur d’un PEPP devra donner la possibilité à l’épargnant qui souhaite s’installer dans un autre État membre de passer, sans frais, à une autre fournisseur de l’autre État membre
- les frais de contrat qui seront limités à 1 % du capital accumulé
- La transparence des informations fournie exigée des fournisseurs du contrats.
Le nombre de demandeurs d’emploi continue à baisser
Malgré le ralentissement de la croissance constatée depuis le milieu de l’année 2018, le nombre de demandeurs d’emploi a continué de baisser au cours du deuxième trimestre 2019.
En moyenne au deuxième trimestre en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 5 579 500. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a baissé de 0,4 % (-14 600) au deuxième trimestre et de 1,9 % sur un an. 3 377 300 personnes sont inscrites dans cette catégorie. Pour l’ensemble de la France (y compris départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie 1 s’élève à 3 632 500 pour la catégorie A. Toutes catégories, le nombre atteint 5 887 900 en baisse de 0,5 % au deuxième trimestre et de 0,9 % sur un an.
En France métropolitaine, au deuxième trimestre le nombre moyen de demandeurs d’emploi en catégorie A diminue de 0,1 % pour les hommes (–2,0 % sur un an) et de 0,8 % pour les femmes (–1,8 % sur un an). Ce nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 0,2 % pour les moins de 25 ans (–1,4 % sur un an), recule de 0,6 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–2,6 % sur un an) et de 0,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–0,6 % sur un an).
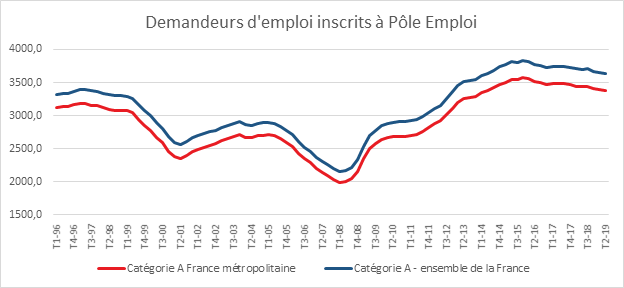
La durée moyenne au chômage augmente
L’ancienneté moyenne des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 631 jours au deuxième trimestre 2019 (+6 jours par rapport au trimestre précédent). La durée moyenne d’inscription en catégories A, B, C des demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C au deuxième trimestre 2019 est de 318 jours (+5 jours par rapport au trimestre précédent).
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an est en progression. Ils représentent, au deuxième trimestre, 47,5 % de l’ensemble des demandeurs. Ce taux était inférieur à 38 % avant la crise de 2008.
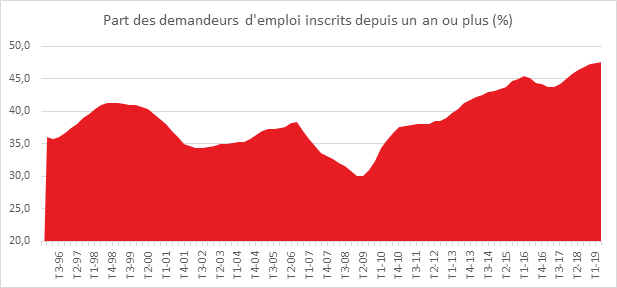
Les ménages de plus en plus confiants
Pour le septième mois consécutif, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique s’accroît. L’indicateur qui la synthétise gagne 1 point. À 102, il est légèrement supérieur à sa moyenne de longue période (100) et retrouve son niveau de début 2018.
La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants continue à augmenter et cela également pour le septième mois consécutif. Le solde d’opinion correspondant gagne 3 points et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. Cela est lié à une meilleure appréciation des ménages sur leur situation financière future
En juillet, l’opinion des ménages sur leurs capacités d’épargne actuelle et future est quasi stable. Les soldes correspondants gagnent un point et se maintiennent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période mais la proportion des ménages estimant qu’il convient d’épargner est en baisse.
En juillet, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie passé en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente pour le septième mois consécutif. Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France reste stable. Il se situe légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période.
En juillet, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois diminue de 6 points. Le solde correspondant demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période. En revanche, la part des ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois reste quasiment stable : le solde correspondant perd un point mais se maintient nettement au-dessus de sa moyenne de long terme.
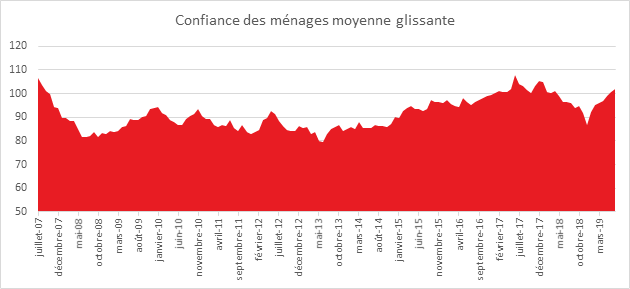
L’ordonnance sur le Plan d’Epargne Retraite publiée au Journal Officiel
L’ordonnance relative au Plan d’Epargne Retraite a été publiée au Journal Officiel du 25 juillet 2019.
L’ordonnance fixe les règles de fonctionnement ainsi que le régime fiscal et social des futurs PER qui pourront être souscrits avant la fin de l’année (certainement à partir du 1er octobre 2019).
L’ordonnance prévoit que les anciens produits d’épargne retraite (PERP, Madelin, PERCO, article 83, etc.) ne pourront plus être souscrits au plus tard après le 1er décembre 2020 (date qui sera précisée par arrêté)
Le PER se décompose en deux sous-ensemble : le Plan d’Epargne Retraite Individuel et le Plan d’Epargne Retraite Entreprise. Le premier sous ensemble regroupe les versements aujourd’hui effectués sur les PERP et les Contrats Madelin. Le second reprend les PERCO et les contrats article 83. Le PER entreprise se subdivise ainsi en deux bloc, le PER collectif et le PER obligatoire.
Le PER pourra prendre la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte titres.
Le Plan d’Épargne Retraite Entreprise
Pour le plan des produits d’entreprise dits collectifs, l’ordonnance définit deux produits :
- un produit collectif bénéficiant à l’ensemble des salariés (ex PERCO) ;
- un produit à adhésion obligatoire, le PER entreprise obligatoire, et pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés, qui succèdera aux contrats (ex « article 83 » – PERE). Ce produit est également qualifié de catégoriel.
Les plans investis uniquement en Fonds Communs de Placement en Entreprise (FCPE) bénéficieront toujours d’une gouvernance paritaire. Pour les autres produits, un comité de surveillance paritaire devra être institué. En ce qui concerne les produits catégoriels qui ne sont pas alimentés par l’épargne salariale, cette création sera facultative. De ce fait, cela signifie que les produits catégoriels au nom de la portabilité pourront recevoir des sommes issues de l’épargne salariale.
L’intéressement et la participation pourront donc être versés sur un PERCO, ou sur un plan catégoriel sous réserve que celui-ci dispose d’une gouvernance paritaire (et que tous les salariés soient couverts par un Plan d’Épargne Retraite.
L’intéressement et la participation ne pourront pas en revanche être versés sur les produits individuels retraite, sauf en cas de transfert.
Les entreprises disposant à la fois d’un produit collectif et d’un produit catégoriel auront la faculté de les regrouper en un produit unique cumulant toutes les possibilités des différents produits. Les salariés pourront effectuer des versements provenant de l’épargne salariale, effectuer des versements volontaires, recevoir les abondements de l’employeur et les cotisations des produits dits catégoriels.
Le Plan d’Épargne Retraite Individuel
Le PERP et le contrat Madelin sont fusionnés mais les avantages fiscaux à l’entrée restent distincts. Le Plan d’Épargne Individuel pourra être proposé par les assureurs et par les gestionnaires d’actifs.
Pour les produits proposés par les gestionnaires d’actifs, un compte titre et un compte espèce seront ouverts. Comme actuellement, pour les PERP et les Contrats Madelin, les PER assurantiels seront souscrits par l’intermédiaire d’une association souscriptrice de contrats de groupe. Un comité de surveillance qui intègrera des représentants des épargnants disposera de pouvoirs de contrôle. Les décisions importantes concernant les PER assurantiels seront soumises aux votes des assemblées générales des adhérents.
Les produits ouverts auprès d’un assureur pourront inclure des garanties optionnelles, par exemple en cas de perte d’autonomie, d’invalidité de perte d’emploi subie ou de décès. La liste des garanties optionnelles, inspirée des produits actuels.
Au niveau fiscal, les versements volontaires et les versements obligatoires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR) à l’entrée dans la limite de plafonds de déductibilité. A la sortie, les versements obligatoires et les versements volontaires déduits de l’IR sont soumis à l’IR, en rente comme en capital (dispositif du report d’imposition). A l’inverse, pour les versements volontaires non déduits de l’assiette de l’IR à l’entrée, seules les plus-values sont fiscalisées en sortie. Les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur et jours de compte-épargne temps) conservent leur régime d’exonération fiscale à l’entrée et à la sortie.
Pour les prélèvements sociaux, à l’entrée le dispositif d’exonération de cotisation sociale et d’assujettissement au forfait social est maintenu pour les versements de l’employeur, par parallélisme avec les produits actuels. En sortie, l’ordonnance prévoit d’appliquer les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires.
La transférabilité
L’ordonnance mentionne que tous les produits seront transférables. Pour les produits obligatoires, cela s’entend en cas de changement d’entreprise. Par ailleurs, les règles fiscales prévoient qu’en cas d’avantage à l’entrée, il ne saurait y avoir avantage à la sortie ce qui obligera à réaliser une traçabilité des versements.
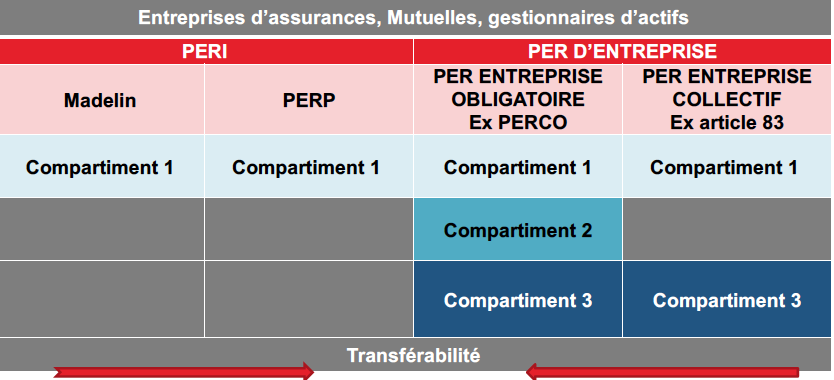
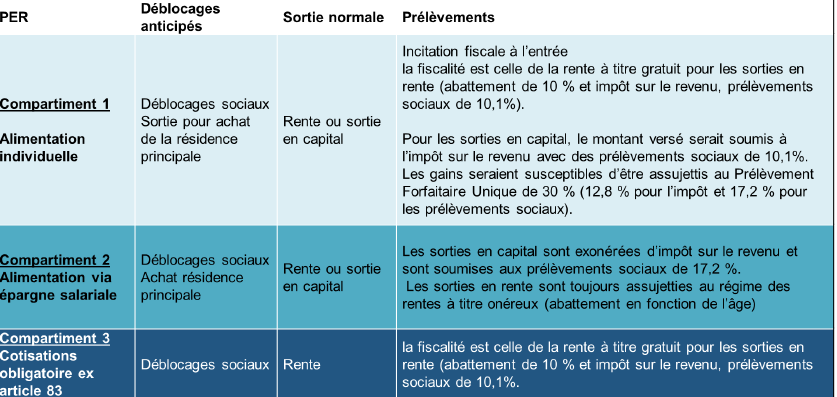
L’assurance vie maintient le cap
Pour le sixième mois consécutif, l’assurance vie a enregistré en juin une collecte nette positive, +2,4 milliards d’euros contre +1,8 milliard d’euros en mai et un an auparavant. Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre, la collecte nette a été de 15,1 milliards d’euros soit 3,5 milliards d’euros de plus.
Au mois de juin, la collecte brute, à 12,1 milliards d’euros, s’est bien tenue quand dans le même temps les prestations sont restées stables à 9,8 milliards d’euros. Au cours des six premiers mois, le montant total des cotisations a atteint 74,0 milliards d’euros et les prestations 58,9 milliards d’euros.
Au mois de juin, la souscription des unités de compte a représenté 25,6 % de la collecte totale en progression par rapport aux mois précédents en liaison avec l’amélioration des cours des actions. Pour les six premiers mois, la part des UC est de 24 % en retrait par rapport à l’année 2018 (28 %).
L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 750 milliards d’euros à fin juin 2019, en progression de 3 % sur un an.
Le mois de juin a conforté la tendance constatée depuis le début de l’année. Les ménages français ont accru leur effort d’épargne ce qui a profité au premier placement financier des ménages. Juin est en règle générale un mois correct pour l’assurance, deux décollectes ont été enregistrés lors de ces dix dernières années (2012 et 2013). Il y a dix ans, la collecte nette était de plus de 4,6 milliards d’euros. La proportion d’unités de compte dans la collecte était de 11 %. Pour mémoire, l’encours était de 1 188 milliards d’euros.
L’assurance vie bénéficie de l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’aversion des ménages aux risques d’où le poids important de la collecte des fonds euros. L’assurance vie ne souffre pas de la vitalité de l’immobilier voire même il en profite. Les ménages pour acquérir un logement sont contraints de disposer d’apports personnels plus importants ce qui les conduit à épargner davantage. Par ailleurs, le vieillissement de la population conduit à une hausse naturelle du taux d’épargne et à la progression de l’assurance vie qui est le produit d’épargne de référence des plus de 45 ans.
Climat des affaires, petite baisse de régime
Au mois de juillet, selon l’INSEE, le climat des affaires s’est légèrement dégradé. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, a perdu un point et retrouve son niveau d’avril à 105. Il reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Par rapport à l’enquête précédente, l’indicateur de climat des affaires gagne un point dans le commerce de détail, mais il en perd deux dans le commerce de gros et un dans l’industrie manufacturière et dans les services. Il est stable dans le bâtiment. Dans tous ces secteurs, il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.
Pour l’emploi, en revanche, le climat s’améliore de nouveau légèrement. L’indicateur qui le synthétise gagne un point et se situe à 107, au-dessus de sa moyenne de longue période. Cette amélioration est le fait de la hausse du solde d’opinion relatif à l’emploi prévu dans les services hors agences d’intérim, et, dans une moindre mesure, de celui relatif à l’emploi passé dans les agences d’intérim.
L’indicateur de retournement qui mesure l’évolution ressentie de l’économie reste dans la zone indiquant un climat conjoncturel favorable.
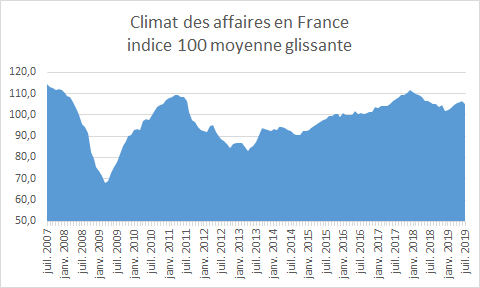
Livret A, collecte en baisse au mois de juin, retour à la normale ?
La collecte du mois de juin est en net retrait par rapport à celle des mois précédents. Elle s’est élevée à 510 millions contre 1,22 milliard d’euros au mois de mai. Il s’agit de la plus faible collecte depuis le début de l’année. Il faut remonter au mois d’octobre dernier pour enregistrer une plus faible. Depuis le début de l’année, la moyenne mensuelle est de 1,9 milliard d’euros. De ce fait, la collecte nette du premier semestre pour le Livret A est de 11,57 milliards d’euros contre 9,11 milliards d’euros pour la même période en 2018. A fin juin, l’encours du Livret A avec plus de milliards est à son plus haut historique avec 295,4 milliards d’euros.
Malgré un rendement réel négatif, après prise en compte de l’inflation, le Livret A a donc été plébiscité au cours du premier semestre. Les ménages ont décidé d’y affecter une grande partie des gains de pouvoir d’achat engrangés depuis la fin de l’année dernière (prime défiscalisée, versement anticipé des réductions d’impôt, etc.). Le climat économique anxiogène a contribué au report de dépenses en biens durables nécessitant de puiser dans l’épargne. Par ailleurs, du fait de l’introduction de la retenue à la source, certains ménages ont pu modifier leurs comportements en augmentant leur épargne de court terme de peur de ne pouvoir pas faire face à leurs dépenses courantes.
Après avoir accentué leur effort d’épargne, les ménages commencent néanmoins à relâcher leur effort. La proximité des vacances qui s’accompagnent de dépenses importantes ainsi que la nécessité d’effectuer des achats reportés depuis plusieurs mois expliquent ce changement de rythme. Après s’être restreints depuis la fin de l’année dernière, les ménages semblent reprendre goût à la consommation. La fin de la crise des gilets jaunes et l’amélioration du pouvoir d’achat expliquent également ce petit regain d’optimisme rendant moins nécessaire le renforcement de l’épargne de précaution. L’évolution de l’indice de confiance des ménages dans la situation économique symbolise ce changement de climat. Au mois de juin, l’indicateur de l’INSEE qui la synthétise est, en effet, en hausse pour le sixième mois consécutif et est repassé au-dessus de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis avril 2018.-
Juin est toujours un mois charnière pour le Livret A. Ainsi, sur ces dix dernières années, quatre décollectes ont été enregistrées. Les ménages, après avoir épargné durant les premiers mois de l’année, entrent dans un cycle de dépenses, vacances, rentrées scolaire, puis fêtes de fin d’année. Cette année, en revanche, la disparition du paiement du dernier tiers d’impôt sur le revenu avec l’instauration du prélèvement à la source, devrait limiter les décollectes sur le Livret A.
Comme l’année dernière, les six derniers mois de l’année devraient donc être moins favorables au Livret A. Malgré tout, sur l’ensemble de l’année, la collecte devrait rester positive et dépasser les 10 milliards d’euros.
Le Coin des Epargnants du 20 juillet 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 19 juillet 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 552,34 | -0,37 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 27 154,41 | -0,65 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 146,49 | -1,18 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 12 260,07 | -0,51 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 508,70 | +0,04 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 480,18 | -0,50 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 21 466,99 | -1,01 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 924,20 | -0,22 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (21 heures) | -0,071 % | -0,126 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (21 heures) | -0,323 % | -0,070 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (21 heures) | 2,057% | -0,057 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (21 heures) | 1,1212 | -0,52 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (21 heures) | 1 422,501 | +0,51 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (21 heures) | 62,530 | -6,48 % | 52,973 |
La guerre des changes aura-t-elle lieu ?
En marge de la réunion du G7, Steven Mnuchin, le secrétaire du Trésor américain, a sous-entendu assez clairement que les Etats-Unis pourraient entrer dans « une guerre des changes ». Il a indiqué « que s’il n’y a pas de changement de la politique de changes des Etats-Unis pour le moment, c’est quelque chose que nous pourrions envisager à l’avenir ». Ces propos interviennent après ceux du Président Donald Trump selon qui les Etats-Unis seraient victimes des politiques de dépréciation monétaire organisées par les banques centrales européenne, nippone et chinoise.
Selon Bloomberg, à titre personnel, le secrétaire du Trésor ne serait pas partisan de cette solution radicale qui romprait avec 25 ans de non-interventionnisme. Il s’opposerait sur ce sujet au Président Donald Trump
Compte tenu des résultats de la balance des paiements courants, le dollar est surévalué de 10 à 15 % par rapport aux principales monnaies. Cette surévaluation n’est pas exclusivement la conséquence des politiques monétaires accommodantes des banques centrales européennes et asiatiques. Elle s’explique par le l’écart de croissance des Etats-Unis avec le reste du monde. En soulignant l’excès de valorisation du dollar par rapport aux monnaies concurrentes, Donald Trump entend faire pression sur la banque centrale américaine afin qu’elle baisse ses taux. Les marchés d’options commencent à intégrer un risque d’intervention des autorités américaines sur l’euro-dollar qui ferait grimper la devise européenne vers 1,20 dollar.
Si les Etats-Unis devaient s’engager dans une guerre de change, les ventes de dollars devraient être réalisées sur une durée assez longue afin de peser réellement sur les cours. Les sommes à mobiliser pourraient atteindre entre 200 et 500 milliards de dollars. Dans ce cas, la baisse est évaluée à 2 % du taux de change. Actuellement, les réserves de change des Etats-Unis sont de 127 milliards de dollars et les actifs du fonds de stabilisation des changes, l’Exchange Stabilization Fund (ESF), de 95 milliards de dollars. Pour augmenter leur force de frappe sur le marché et intimider les spéculateurs, les Etats-Unis pourraient accroître les capitaux de l’ESF. Une telle intervention aurait des conséquences diplomatiques et économiques importantes. Elle relancerait la guerre commerciale en donnant une dimension mondiale à ce conflit. Des réactions en chaine pourraient se produire avec une augmentation des monnaies refuge comme le franc suisse et l’or. Les banques centrales européennes et asiatiques pourraient contrattaquer, ce qui ne ferait qu’accroître la volatilité sur le marché des changes. Cela pourrait également conduire de nombreux Etats à se délester de leurs réserves en dollars et qui pourrait créer un effet boule de neige sur le taux de change de cette monnaie.
Les marchés toujours dans l’attentisme
Si la menace de guerre des changes est dans les esprits, les marchés, pour le moment, espèrent simplement la baisse des taux même si le bienfondé de cette dernière se pose toujours. La Bourse de Paris a réagi favorablement aux déclarations du président de la Fed de New York qui ont ravivé l’espoir d’une détente de 50 points de base du taux des Fed funds à l’issue de la réunion des 30 et 31 juillet.
Pour la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) rendra sa décision de politique monétaire jeudi 25 juillet. Une majorité d’experts estiment qu’une baisse de 0,10 point du taux de dépôt est possible.
Les premières orientations de la réforme des retraites
En décidant de réformer les régimes de retraites, le Gouvernement touche au premier poste de dépenses sociales du pays, plus de 320 milliards d’euros. Pour les Français, le système social est un des éléments clefs du pacte social.
La réforme systémique voulue par le Président de la République repose sur un principe simple « un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous ». Ce slogan plébiscité durant la campagne présidentielle de 2017 ne sera pas, malgré tout, aisé à traduire en actes car un système de retraite est par nature complexe et intègre de nombreux éléments de solidarité. Le passage de notre système actuel comportant 42 régimes de base et une centaine de régimes complémentaires vers un régime universel à points
Un régime universel par points
Le système actuel de retraite est constitué de 42 régime de base et d’une centaine de régimes complémentaires obéissant à des règles différentes rendant les comparaisons difficiles, ce qui laisse place à une forte suspicion d’inégalités entre les assurés.
Seront intégrés les régimes des salariés, les régimes spéciaux, les différents régimes de la fonction publique et les régimes des indépendants ainsi que celui des agriculteurs.
Le nouveau système sera par points. Il remplacera les régimes « en annuités » tel que le régime général des salariés ou celui à prestations définies de la fonction publique (75 % des salaires des six derniers mois). Comme pour les régimes complémentaires AGIRC/ARRCO, les points seront accumulés durant toute la carrière professionnelle. Le dispositif du calcul de la pension de base en prenant en compte les 25 meilleures années est ainsi abandonné.
Chaque salarié sera doté d’un compte personnel retraite qui retracera le nombre de points accumulés au fil de sa carrière. Des points seront accordés au cours d’une période de maladie ou de maternité ou de chômage.
L’entrée en vigueur progressive du régime universel
L’entrée en vigueur est prévue à partir de 2025 et concernerait les générations 1963 et postérieures. Sur ce point, le Haut Commissaire laisse le débat ouvert.
Les retraités et les actifs à moins de cinq ans de la retraite en 2025 ne sont donc pas concernés.
Il y aura par ailleurs une trajectoire de convergence variable des régimes spéciaux, à négocier avec chacun des régimes concernés, dans les prochains mois. La phase de transition devrait durer 15 ans.
Les droits dans l’ancien système garantis
Le système universel garantira 100 % des droits acquis au 1er janvier 2025. Ses droits seront comptabilisés selon les règles de l’ancien système et « transformés en points à l’euro près », selon des modalités à fixer. Les mécanismes de transition seront par ailleurs « adaptées » à chaque régime et achevées « environ quinze ans » après l’entrée en vigueur du nouveau système.
L’âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans mais un âge d’équilibre à 64 ans est institué
L’âge l’égal de départ restera fixé à 62 ans, mais cela deviendra un âge minimum de départ. Un âge « d’équilibre » à 64 ans sera instauré. Les assurés partant avant 64 ans pourraient subir une décote. Pour les départs, au-delà, une surcote pourra être appliquée.
les départs anticipés des régimes spéciaux et de la fonction publique, notamment ceux des emplois classés en « catégorie active », seront progressivement fermés. Le système universel garantira toutefois les départs anticipés à 60 ans pour les assurés ayant effectué une carrière longue, comme aujourd’hui.
La pénibilité sera également prise en compte avec la possibilité de partir avant 62 ans à la retraite. En outre, des départs anticipés seront conservés pour les militaires et les fonctionnaires ayant des fonctions dangereuses dans le cadre de missions régaliennes (policiers, douaniers, pompiers, surveillants pénitentiaires).
Pour certains métiers, des départs anticipés seraient maintenus. Ils ne seraient plus liés à l’existence de régimes spéciaux mais à la pénibilité de certaines professions.
Un taux de cotisation à 28,12 % sauf pour les indépendants
Pour les indépendants, le taux de cotisation sera de 12,94 % à partir 40 000 euros de revenus par an, et ce jusqu’à 120 000 euros, par exception au taux de 28,12 % pour les salariés et les fonctionnaires. ce taux sera partagé entre l’employeur (60 %) et le salarié (40 %). L’ensemble des primes des fonctionnaires seront désormais prises en compte pour le calcul de la retraite tandis qu’aujourd’hui, seule une petite part l’est. e.
Le taux de cotisation sera par ailleurs identique pour les salariés: 28,12%, partagé entre l’employeur (60%) et le salarié (40%). Ce taux s’appliquera jusqu’à 120.000 euros de revenus. Au-delà, une cotisation de 2,81% s’appliquera. Elle ne sera pas créatrice de droits et participera au financement de la solidarité.
Le taux de cotisation sera cependant différent pour les indépendants, qui cotiseront à hauteur de 28,12% sur les 40.000 premiers euros gagnés puis à hauteur de 12,94% sur 80.000 euros suivants. Dans les faits, cela représente une hausse par rapport à leur régime actuel. Celle-ci sera compensée par une baisse de la CSG.
La valeur des points et le montant de la pension
10 euros de cotisation permettront d’acquérir un point, qui sera revalorisé tout au long de la carrière en fonction de l’évolution des salaires. Pour 100 euros cotisés pendant sa carrière, un retraité percevra 5,5 euros par an pendant toute sa retraite, s’il a travaillé jusqu’à 64 ans, ce qui représente le taux de rendement du régime à taux plein.
L’indexation des points et des pensions
La valeur du point « ne pourra pas baisser dans le temps » et sa revalorisation prendra en considération l’évolution des « revenus moyens en France ». Le niveau des pensions sera fonction de l’inflation « pour [préserver] le maintien du pouvoir d’achat des retraités, comme c’est le cas aujourd’hui »
L’équilibre du régime, l’adoption d’une règle d’or
Le Haut Commissaire à la Réforme des retraites a indiqué qu’au moment du grand basculement, en 2025, le régime devrait être à l’équilibre ce qui suppose que d’ici là des mesures d’ordre paramétrique soit adoptées. Le Gouvernement, afin de ne pas polluer la négociation sur le régime universel, de ne pas en introduire dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 mais cela ne serait que partie remise.
Un régime unique de réversion
Les règles de réversion diffèrent en fonction des régimes. Plus de 13 cas cohabitent en la matière. Les pensions de réversion peuvent être attribuées sous condition ou pas de ressources ainsi qu’à à des âges et des taux différents. De même, en fonction de l’évolution maritale, elles peuvent ou pas suspendues ou supprimées.
L’idée retenue par Jean-Paul Delevoye serait de garantir à 70 % des pensions constatées du couple avant le décès du conjoint. La réversion sera financée par l »impôt et sera identifiée dans un Fonds de solidarité vieillesse universel.
Les majorations pour enfant
Une majoration des points de 5 % sera attribuée dès le premier enfant et pour chaque enfant. Ces points pourront être partagés entre les parents et seront par défaut attribués à la mère.
Des mesures de solidarité pour les petites pensions
Les assurés bénéficient dans le système actuel de dispositifs garantissant des minimas de pension : minimum contributif pour le régime général et garantie de pension pour la fonction publique. Dans le nouveau système, des filets de sécurité seront également institués pour les assurés à faibles revenus mais ayant un nombre suffisant d’années de cotisation. Conformément aux engagements pris, ce minimum sera fixé à 1 000 euros, soit 85 %. Par ailleurs, la réforme ne remet pas en cause le minimum vieillesse.
Des points de solidarité seront par ailleurs accordés pour les périodes de chômage indemnisé, maternité, invalidité et maladie,
L’équilibre du régime
Le Haut Commissaire à la Réforme des retraites a indiqué qu’au moment du grand basculement, en 2025, le régime devrait être à l’équilibre ce qui suppose que d’ici là des mesures d’ordre paramétrique soit adoptées. Le Gouvernement, afin de ne pas polluer la négociation sur le régime universel, a décidé de ne pas en introduire dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 mais cela ne serait que partie remise.
Une règle d’or d’équilibre sera instituée en pour garantir la pérennité de la trajectoire financière du système. Cette règle prévoira que le solde cumulé soit positif ou nul par période de cinq années avec un horizon de long terme.
Un établissement public paritaire pour gérer le nouveau système
Le gouvernement devrait créer une caisse nationale de retraite universelle sous la forme d’un établissement public. Son conseil d’administration, sera paritaire et pourrait comporter treize représentants des assurés et treize représentants des employeurs et des indépendants. Il aura à se prononcer sur le pilotage du système dans le cadre de la trajectoire définie par le Parlement et l’exécutif. Une assemblée générale rassemblera l’ensemble des assurés et des employeurs afin de donner « un avis », notamment sur le pilotage du système, tandis qu’un « conseil citoyen » fera, chaque année, des propositions au conseil d’administration et au gouvernement.
L’adoption de la réforme après les municipales
Le calendrier d’adoption de la réforme apparaît complexe. En effet, Jean-Paul Delevoye a prévu un nouveau cycle de négociation avec les partenaires sociaux. Un texte devrait être présenté au mois de novembre en Conseil des Ministres avec une discussion au Parlement avant, ou plus probablement, après les municipales.
Régimes spéciaux, la Cour des Comptes met les pieds dans le plat !
Dans un récent rapport du mois de juin 2019, la Cour des Comptes s’immisce dans le débat de la réforme des retraites. La Cour, saisie par la Présidente de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale d’une demande d’enquête sur les régimes spéciaux de retraite, a étudié les trois régimes les plus importants, ceux de la SNCF, de la RATP et des industries électriques et gazières (IEG). Les conclusions sont sans appel. Les réformes pour harmoniser ces régimes ont été adoptées tardivement et n’ont pas éliminé toutes les différences. Par ailleurs, leur bilan sur un point de vue comptable est négatif. La Cour attire l’attention du Gouvernement sur le fait que dans le cadre de la fusion des régimes prévue par la réforme systémique les assurés du privé n’aient pas à financer les spécificités des actuels régimes spéciaux. Elle réclame à ce titre une comptabilité précise des droits spécifiques et un financement idoine avec comme possibilité la création d’un régime dédié par capitalisation.
Des réformes tardives et incomplètes
La réforme des régimes spéciaux a été engagée en 2007 et 2008 quand celle du régime général à débuté en 1993 et celle de la fonction publique en 2003. Compte tenu des entrées en vigueur progressive des réformes, le report de l’âge légal de départ à la retraite sera effectif pour les régimes spéciaux en 2024 contre 2017 pour le régime général. Un décalage existe également pour l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans. Selon les calculs de la Cour des Comptes, en raison des mesures d’accompagnement pris lors de l’adoption des réformes, le coût de ces dernières dépasse celui des gains escomptés.
Le maintien de nombreuses spécificités
Le mécanisme de la décote est plus avantageux au sein des régimes spéciaux que dans le régime général de la fonction publique. Les primes entrent dans l’assiette de calcul des pensions à la différence de ce qui est de mise dans la fonction publique. Le minima de pension est plus élevé à la SNCF. Les retraités des régimes spéciaux continuent à bénéficier d’avantages (transports, électricité à tarif réduit).
Un départ plus précoce à la retraite
Si l’âge conjoncturel de départ à la retraite est de 63 ans dans le régime général et de 61 ans dans la fonction publique d’Etat, il est de 57,7 ans pour le régime des industries électriques et gazières, de 56,9 ans pour la SNCF et de 55,7 ans pour la RATP.
Des montants moyens de pensions supérieurs mais à relativiser
Les montants de pension sont supérieurs au sein des régimes spéciaux par rapport à ceux des autres régimes mais il faut prendre en compte la structure des emplois et les niveaux de rémunération. Il n’en demeure pas moins que la retraite moyenne est de 3592 euros pour le régime des industries électriques et gazières, de 3705 euros pour la RATP et de 2 636 euros pour la SNCF contre 2 206 euros pour la fonction publique d’Etat. Les agents de conduite de la SNCF touchent en moyenne 3156 euros de retraite à la retraite. Le taux de remplacement des pensions par rapport au dernier salaire est de 88 %.
Un coût élevé pour les finances publiques
Les régimes spéciaux sont financés par des contributions publiques à hauteur de 5,5 milliards d’euros (pour les trois régimes). Les cotisations ne couvrent que 36 % des dépenses pour la SNCF, 41 % à la RATP et 68 % pour les IEG. La dotation d’Etat est de 681 millions d’euros pour la RATP et de 3,280 milliards d’euros pour la SNCF. La contribution tarifaire d’acheminement payée par les consommateurs d’électricité et de gaz s’élève à 1,509 milliard d’euros. 1,8 milliard d’euros de contribution publique couvrirait des droits spécifiques des régimes, droit à départ précoce, avantages aux retraités, etc ; le solde pouvant être assimilé à une compensation démographique.
La Cour des Comptes souhaite que dans le cadre de la réforme une transparence soit garantie en matière de prise en charge des droits spécifiques avec le cas échéant le versement d’une contribution de la part des entreprises concernées. Elle n’interdit pas l’idée de la mise en place d’un régime supplémentaire par capitalisation pour financer les droits spécifiques. D’autre part, elle réclame un effort dans la gestion des caisses des régimes spéciaux.
Réforme des retraites, entre ambition et danger : réponse le 18 juillet 2019
En décidant de réformer les régimes de retraites, le Gouvernement touche au premier poste de dépenses sociales du pays, plus de 320 milliards d’euros. Pour les Français, le système social est un des éléments clefs du pacte social.
La réforme systémique voulue par le Président de la République repose sur un principe simple « un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous ». Ce slogan plébiscité durant la campagne présidentielle de 2017 ne sera pas, malgré tout, aisé à traduire en actes car un système de retraite est par nature complexe et intègre de nombreux éléments de solidarité. Le passage de notre système actuel comportant 42 régimes de base et une centaine de régimes complémentaires vers un régime universel à points est une véritable révolution nécessitant la résolution de nombreuses équations. Les questions de l’âge de départ, de la réversion, des droits familiaux devront être tranchées. Il faudra également déterminer les modalités de la convergence des régimes actuels vers le nouveau régime. À ce titre, des règles de transfert des cotisants des anciens régimes vers le nouveau devront être fixées. Cette réforme aura des conséquences pour les personnels qui sont en charge de la gestion des régimes existants.
Une réforme d’une telle ampleur occasionnera des gagnants mais aussi des perdants ; les premiers resteront assez silencieux quand les seconds exprimeront leur mécontentement.
- L’ÉTAT DE L’OPINION PUBLIQUE
Un soutien ambigu à la réforme
Les Français demandent plus d’équité en matière de retraite mais ils craignent que cette réforme serve avant tout à reculer l’âge de départ ou à diminuer les pensions.
Toute l’ambiguïté provient du fait que si le souhait d’une égalité de traitement est fort, il n’interdit pas le maintien de spécificités. Ainsi, selon la dernière enquête du Cercle de l’Épargne, 48 % des Français se prononcent en faveur d’un régime universel intégrant certaines spécificités (pénibilité, missions de nuit ou dangereuses, etc.). 34 % des Français sont pour l’application d’un régime universel total visant à traiter tous les assurés de manière identique. En revanche, seuls 18 % des sondés sont pour le statu quo.
Les retraités, les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques, craignant de figurer parmi les perdants de la réforme en cas d’unification totale, sont les plus enclins au statu quo en matière de retraite.
Seuls 34 % des Français considèrent que le futur système de retraite respectera l’engagement présidentiel, « un euro cotisé donnera les mêmes droits pour tous ». En revanche, ils sont 37 % à penser que les pouvoirs publics veulent profiter de cette réforme pour reculer l’âge effectif de départ à la retraite. Ce jugement est partagé par 52 % des fonctionnaires. Par ailleurs, 29 % des Français estiment que l’objectif de la réforme est de réduire les pensions.
- LES ÉQUATIONS EN PARTIE RÉSOLUES
Le calendrier, le périmètre de la réforme, les spécificités
Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites souhaite que le projet de loi soit adopté en 2020 avec une entrée en vigueur progressive à compter de 2025, après l’élection présidentielle de 2022. Cette réforme pourrait concerner les générations nées après 1963 ou 1964. Pour les générations antérieures, les règles de liquidation ne seraient pas changées. Par ailleurs, pour les retraités, il n’y aurait pas de modification.
Une période transitoire sera sans nul doute instituée pour passer d’un système à un autre. Les pays européens qui ont, ces dernières années, mené des réformes systémiques ont prévu des dispositifs de transition. En 1998, la Suède, pour la mise en place des « comptes notionnels », a prévu une période transitoire qui a duré 17 années. L’Italie avait, en 1995, décidé de réaliser sa grande réforme des retraités sur 40 ans. Sur la pression de Bruxelles, ce délai a été légèrement réduit. En Allemagne, le passage d’un régime par annuités à un régime par points en 1992 a en revanche été instantané, les droits anciens ayant été convertis d’emblée.
La réforme française devra prévoir un mécanisme particulier pour ceux qui ont cotisé dans l’ancien système et qui liquideront leurs droits à retraite dans le nouveau.
La réforme est censée concerner 42 régimes de base et les régimes complémentaires qui y sont associés. Les régimes spéciaux et le système de la fonction publique devront converger et se fondre dans le futur régime universel.
Le Gouvernement a déjà prévu le maintien de règles de cotisations spécifiques pour les indépendants. La question des départs anticipés à la retraite a été en partie réglée. Ils seront admis au regard de la pénibilité subie durant la période d’activité. Ils ne seront plus liés à un statut mais à un emploi.
Un régime à points
Le nouveau régime unique devrait prendre la forme, a priori, d’un
système par points qui offre de nombreux avantages en matière de pilotage.
Aujourd’hui, les deux principaux régimes par points sont l’ARRCO et l’AGIRC.
Les cotisations versées par les actifs servent à acquérir des points à un prix
déterminé. Au moment de la liquidation, les points accumulés sont convertis en
rente en prenant en compte la valeur de rachat du point.
Le taux de cotisations
Jean-Paul Delevoye a indiqué que le taux de cotisation dans le nouveau régime sera proche de 28 % pour les assurés et les employeurs qu’ils soient publics ou privés. En 2017, les taux de cotisation salarial et employeur sont de 27,5 % (sous plafond de la Sécurité sociale) pour un salarié non cadre et de 84,57 % pour un fonctionnaire civil de l’État (taux virtuel car les sommes sont prélevées sur le budget de l’État). Ce taux est de 10 % pour un professionnel libéral. Il dépasse 120 % pour les militaires.
Ce taux unique prévu pour le futur régime accompagnera de fait la suppression des mécanismes de compensation démographique qui existent à l’heure actuelle.
En matière de cotisation, il a été admis que les actifs ayant des revenus mensuels supérieurs à 10 000 euros bruts continueraient à cotiser au-delà de ce montant sans se constituer de nouveaux droits. Cela aboutit à introduire un mécanisme de redistribution fiscale dans le système par points. Cette mesure pénalisera les cadres supérieurs.
La gouvernance
Jean-Paul Delevoye a indiqué que le futur régime donnerait lieu à la création d’un établissement public à gestion paritaire. Cet établissement pourrait être adossé à la Caisse des dépôts et consignations.
- LES ÉQUATIONS A RÉSOUDRE
La question sensible de l’âge de départ à la retraite
Initialement, le Président de la République souhaitait la suppression des durées de cotisations et permettre à tout à chacun de prendre librement sa retraite. Compte tenu de l’inclinaison naturelle des Français, le risque d’un grand nombre de départs précoces est à craindre. Il en résulterait un déséquilibre financier avec en outre un problème de niveau de vie pour les retraités qui auraient accumulé peu de points.
Pour contrarier ce risque, plusieurs propositions ont été émises mais aucune n’a reçu l’assentiment des partenaires sociaux. L’opinion publique reste pour le moment opposée à un report de l’âge de départ à la retraite.
79 % des Français considèrent qu’il faut maintenir la retraite à 62 ans
voire revenir à 60 ans. 41 % des Français pensent qu’il est possible de revenir
à la retraite à 60 ans. Ce sentiment est partagé par 59 % des employés et 57 %
des ouvriers. 59 % des actifs âgés de 35 à 49 ans pensent de même. Seuls 21 %
des sondés estiment qu’il est nécessaire de faire progressivement évoluer l’âge
légal de départ à la retraite vers 65 ans. Ce report n’est accepté que par les
actifs qui traditionnellement partent déjà au-delà de 62 ans à la retraite (les
cadres, les indépendants, les professions libérales).
La problématique du passage d’un système à l’autre
Le Gouvernement devra fixer les règles de transition d’un système à un autre. Si pour les actuels retraités, le basculement ne devrait pas avoir d’incidences, tel ne serait pas le cas pour les actifs.
Pour les actuels actifs concernés par la réforme, un dispositif de transfert devra être adopté permettant de convertir leurs droits à retraite et donc garantir un certain montant de pension compte tenu de la carrière professionnelle passée. Plusieurs options sont possibles. Les pouvoirs publics pourraient réaliser une photographie des droits accumulés au moment du transfert et faire une conversion en points. Il y aurait aussi la possibilité au moment de la liquidation de calculer deux pensions, une en vertu des règles passées et l’autre constituée à partir des points accumulés. Moins probable, il serait possible de faire une attribution de points au regard des rémunérations perçues avant l’entrée en vigueur de la réforme. Quelle que soit la méthode choisie, il y aura obligatoirement des gagnants et des perdants qu’il faudra le cas échéant indemniser.
Les questions de solidarité à résoudre
L’article 4 de la loi de 2003 prévoit que « la Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance ». En 2018, ce taux est de 78 % pour les salariés au SMIC. Il est en moyenne de 61 % (chiffres OCDE – 2016). Dans un système par points, la pension ne sera plus proportionnelle aux revenus d’activité. De ce fait, pour garantir un taux de remplacement supérieur aux actifs à faibles revenus, des mécanismes de solidarité seront nécessaires. Ils devront être financés certainement par l’impôt.
La question de la réversion devra être également abordée. Aujourd’hui, les pensions de réversion essentiellement touchées par les veuves représentent 34 milliards d’euros. Les règles d’attribution diffèrent d’un régime à l’autre. Le choix des nouvelles règles ne sera pas sans incidence sur le niveau de vie des veufs et des veuves.
Le Gouvernement a prévu de changer les modalités d’octroi des majorations pour enfants. Elles seraient accordées dès le premier enfant. La question de leur financement sera à trancher. Il en est de même avec celles liées à la prise en compte des périodes de chômage, de congés maternité, etc. Il faudra également fixer les règles applicables pour les retraites des handicapés.
Le devenir des réserves des caisses de retraite
Les régimes de retraite par répartition disposent de 137 milliards
d’euros de réserves qui font l’objet d’un débat concernant leur éventuelle
dévolution avec la mise en œuvre du futur régime universel de retraite. À ces
réserves, il faut ajouter celles du Fonds de réserve des retraites
(36,4 milliards d’euros) et celles des régimes par capitalisation
obligatoires (RAFP : 22,4 milliards d’euros, CAVP :
5,8 milliards d’euros). La dévolution de ces réserves sera un des enjeux
de la réforme. Serviront-elles à indemniser les perdants ou pourront-elles être
conservées par les caisses quand bien même ces dernières auront perdu leur
mission de délivrer des pensions. Pourront-elles alors être affectés à de
futurs produits d’épargne retraite ?
En guise de conclusion, la question de l’équilibre et l’essor des suppléments de retraite
L’instauration d’un régime dit universel ne résout pas les problèmes de financement soulignés récemment par le Conseil d’Orientation des Retraites et le Comité de Suivi des Retraites. L’augmentation du nombre de retraités et la stagnation de la population active dans un contexte de faible croissance posent le problème de l’évolution du pouvoir d’achat des retraités. Certes, le système par points sera par nature plus facile à gérer que celui actuellement en vigueur en jouant sur le montant d’achat et de rachat, mais, ce système pourrait aboutir, pour certaines catégories de la population, à des pensions plus faibles comme cela a été constaté en Allemagne ou en Suède.
Pour les cadres et en particulier les cadres supérieurs, le maintien d’un niveau de vie correct à la retraite passera sans nul doute par l’adhésion à des suppléments d’épargne retraite qu’ils soient collectifs ou individuels. Cette réforme pourrait relancer l’idée d’accord de branche sur l’épargne retraite.
La croissance en Chine en berne
Au second trimestre, la croissance chinoise n’a été que de +6,2 %, signant sa plus faible performance depuis au moins 27 ans, en dépit des efforts de soutien engagés par Pékin. Il fallait remonter à 1992 pour trouver une croissance plus faible selon l’agence Bloomberg.
La Chine est touchée par les mesures commerciales des Etats-Unis. Au mois de mai, Washington a décidé de porter ces surtaxes douanières de 10 à 25 % sur 200 milliards de biens chinois exportés annuellement vers les Etats-Unis.
Pour soutenir l’économie réelle, le gouvernement chinois s’est engagé en mars à baisser de près de 2000 milliards de yuans (265 milliards d’euros) la pression fiscale et sociale sur les entreprises. P
Le Comité de Suivi des Retraites et le Gouvernement temporisent
Le Comité de Suivi des Retraites a émis son 6e avis concernant les éventuelles mesures que le Gouvernement devrait prendre pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Dans l’avis de 2019, il prend en compte qu’un projet de réforme de systémique qu’il estime compatible avec ses préconisations. Néanmoins, il attend de connaître le contenu pour se prononcer sur le sujet. Sur un point de vue plus court terme, le Comité de Suivi réitère ses demandes de 2017 réitérées en 2018. Le Comité intègre le fait que la situation financière devrait se dégrader plus vite que prévu. Le besoin de financement varierait de -0,3% du PIB en cas de croissance annuelle de la productivité de 1,8% à -0,7% du PIB avec une croissance de la productivité de 1% (et un taux de chômage de 7% à long terme dans les deux scénarios) qui, des quatre scénarios proposés, est le plus en ligne avec la trajectoire de croissance des dix dernières années. Le Comité de Suivi mentionne que le taux de remplacement devrait chuter plus rapidement que prévu. Ce dernier attend donc que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Pour le moment, afin d’éviter d’avoir trop de fronts ouverts, le Gouvernement s’est interdit d’insérer dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale des mesures d’ordre paramétriques telle que l’accélération de l’entrée en vigueur de la durée de cotisation. Face à l’hostilité croissante de l’opinion publique vis=à-vis de la future réforme et la nécessité de retisser des liens avec les syndicats, la prudence gouvernemental n’est pas une surprise. Il eût été difficile d’annoncer des mesures conjoncturelles une semaine avant la présentation des grandes lignes de la réforme prévue le 18 juillet prochain. Affaire à suivre !
Le Coin des Epargnants
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 12 juillet 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 572,86 | -0,37 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 27 333,03 | +1,53 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 244,69 | +1,02 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 12 323,32 | -1,95 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 505,97 | -0,62 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 497,63 | -0,86 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 21 685,90 | -0,28 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 930,55 | -2,67 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (21 heures) | +0,055 % | +0,147 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (21 heures) | -0,253 % | +0,112 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (21 heures) | 2,114% | +0,069 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (21 heures) | 1,1273 | +0,43 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (21 heures) | 1 415,460 | +1,22 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (21 heures) | 66,780 | +3,63 % | 52,973 |
Les marchés dans l’attentisme
Dans l’attente d’une éventuelle baisse des taux de la part de la Banque centrale américaine, à défaut de quartiers d’été, les marchés optent pour l’attentisme en ce milieu du mois de juillet. Les jours à venir seront marqués par les annonces des résultats de la croissance au 2e trimestre. Plusieurs indicateurs laissent à penser que le ralentissement maintes fois annoncé pourrait prendre forme. En Asie, les effets de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis se font ressentir de plus en plus vivement. Ainsi, Le PIB de Singapour s’est contracté de 3,4 % au 2e trimestre, soit sa pire performance depuis 2012. En Chine, les exportations et les importations ont connu au mois de juin dernier une forte baisse, dans un contexte de durcissement de la guerre commerciale avec Washington Les ventes de la Chine à l’étranger ont ainsi reculé de 1,3 % le mois dernier sur un an et les importations se sont contractées de -7,3 % sur un an après une chute le mois précédent (-8,5 %) selon administration générale des douanes. Cette diminution est supérieure aux prévisions. Dans ce contexte, l’indice chinois Shanghai Composite a perdu, cette semaine, plus de 2,5 %. En Europe, les valeurs « actions » se sont érodées quand les indices américains battaient de nouveaux records.
Après avoir enregistré des baisses importantes au début du mois de juillet, les taux d’intérêt des dettes publiques ont été en hausse. Le taux de l’OAT à 10 ans est ainsi repassé en territoire positif.
Hausse des prix de l’immobilier au sein de l’Union européenne
Au cours du 1er trimestre de cette année, le prix des logements a augmenté de 4,0 % par rapport au même trimestre de l’année précédente tant dans la zone euro qu’au sein de l’Union européenne.
Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmentations annuelles du prix des logements au premier trimestre 2019 ont été enregistrées en Hongrie (+11,3 %), en République tchèque (+9,4 %) et au Portugal (+9,2 %). En revanche, les prix ont baissé de 0,8 % en Italie. En France, contrairement à une idée reçue, la progression de la hausse des prix de l’immobilier est de 2,9 %, soit un niveau inférieur à la moyenne de la zone euro.
Les faibles taux d’intérêt expliquent la progression des prix de l’immobilier. Les pays enregistrant de forts taux de croissance sont ceux qui, en moyenne, connaissent une valorisation rapide de leur immobilier. Il y a, par ailleurs, des phénomènes de rattrapage comme en Allemagne où les prix de la pierre étaient restés faibles durant de nombreuses années.
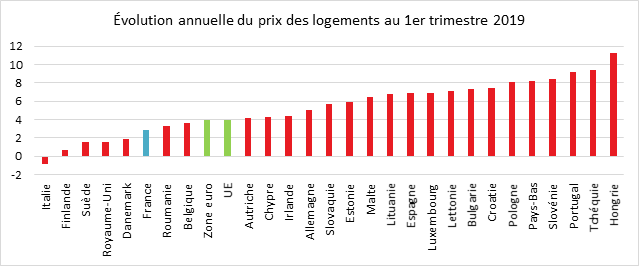
L’épargne réglementée au rapport
Le Livret A, un succès total pour ses 200 ans
Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, 82,5 % des Français disposent d’un Livret A. Depuis la mise en place des dispositifs de recherche des comptes et livrets en déshérence (Loi Eckert) et la lutte accrue contre la multi-détention, la proportion de détenteurs a diminué lors de ces dix dernières années. En 2011, ce taux était de 95 %. pour la seule France métropolitaine, le taux de détention du livret A s’établit à 82,5% (82,9 % en 2017). Plus de 6 millions de comptes avaient été fermés en 2016 et 2017.
Le nombre de livrets A augmente pour les personnes morales (+ 35 000 livrets). Elles détiennent 850000 livrets fin 2018 (+ 4% sur un an). Ces ouvertures sont portées essentiellement par les syndicats de copropriétaires. Ils détiennent 130000 livrets A en 2018, contre 50000 en 2016.
L’encours détenu par les personnes morales a dépassé 20 milliards d’euros en 2018, en hausse de 1,5 milliard d’euros par rapport à 2017. Les encours sont détenus pour moitié par les organismes HLM (9,6 milliards d’euros). Le reste est détenu à parts égales par les associations et les autres organismes habilités (dont les syndicats de copropriétaires). Les personnes morales détiennent ainsi 7% de l’encours de livrets A en 2018
La France compte ainsi 55 millions de Livret A pour un encours de 263,5 milliards d’euros à la fin de l’année 2018. 35,2 millions de Livret A sont gérés par les réseaux historiques (Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel et Banque Postale) et 19,8 millions par les réseaux bancaires.
Le nombre de clôtures brutes de livrets A atteint 2,8 millions en 2018, un plus bas depuis 2009, à comparer à un niveau annuel moyen de 3,8 millions depuis 2009. Le nombre d’ouvertures de livrets A reste stable depuis plusieurs années, autour de 2,5 millions par an. Les nouveaux réseaux représentent en moyenne 60 % des ouvertures brutes quand les réseaux historiques concentrent 60 % des fermetures brutes. Au total, les nouveaux réseaux enregistrent 600 000 ouvertures de livrets en solde net tandis que les réseaux historiques comptabilisent 800 000 fermetures nettes de comptes .
L’application de la loi Eckert
Les restitutions aux bénéficiaires au titre de la loi Eckert sont multipliées par plus de deux La Caisse des dépôts et consignations a reçu plus de 450 000 livrets réglementés inactifs en 2018, de 149 millions d’euros. Les livrets A représentent toujours l’essen‑ tiel (95%) de ces livrets inactifs.
Les taux de détention des livrets de développement durable et solidaire (LDDS) et livrets d’épargne populaire (LEP) sont stables eux aussi, à respectivement 36 % et 13 %.
18 499 LDDS ont été également transférés à la Caisse des Dépôts pour un encours de 7,3 millions d’euros. 874 ont été restitués. Leur montant total était de 1,9 million d’euros.
965 Livrets d’Epargne Populaire ont été transmis. Leur montant global s’élevait à 1,3 million d’euros. 27ont été restitués à leurs ayant-droit avec à la clef 200 000 euros.
Au total, la Caisse des Dépôts a restitué à leurs bénéficiaires plus de 20 000 comptes pour un encours global de 36 millions d’euros au titre de l’épargne réglementée. Les restitutions ont plus que doublé par rapport à 2017 (16 millions d’euros).
Le nombre de livrets d’épargne populaire (LEP) : des clôtures toujours nombreuses, un début de reprise des ouvertures Le nombre de LEP a diminué chaque année depuis 2009, sauf en 2015. Il se replie de 260 000 comptes en 2018, après 170 000 comptes en 2017.
Le Plan d’épargne logement en recul
Une baisse amplifiée du nombre de plans d’épargne-logement (– 7,3%) Le nombre total de PEL s’établit à 14,3 millions d’unités à fin 2018, en baisse de 7,3% sur un an. Cette diminution de 1,1 million de compte est la plus importante depuis 2009). Le nombre d’ouvertures brutes est lui aussi en très forte baisse : 0,7 million de PEL ouverts en 2018 à comparer à 1,7 million en 2017. La chute des ouvertures de PEL est essentiellement influencée par la baisse de son taux de rémunération net de la fiscalité.
Une concentration de plus en plus forte
Les livrets A supérieurs au plafond 11 représentent 6 % du nombre de livrets en 2018. En six ans, cette proportion a été multiplié par trois. Leur poids au sein de l’encours global est passé de 11,3 % en 2013 à 28,3 % en 2018. Les livrets de montant inférieur à 1 500 euros totalisent 60 % du nombre de livrets et représentent 3 % de l’encours
Les LDDS supérieurs au plafond (12 000 euros) représentent 18 % du nombre de livrets et un peu moins de la moitié des encours (49 %). Les LDDS inférieurs à 6000 euros 13 (deux tiers du nombre de livrets) ne représentent que 16% des encours. Les LEP supérieurs au plafond (7 700 euros) dépassent deux tiers des encours (69 %, comme en 2017) pour 38 % du nombre de livrets en 2018.
| Montant de l’encours par Livret A | Proportion de livrets par rapport au total | Proportion d’encours par rapport à l’encours total |
| Supérieur à 22 950 euros | 6 % | 28 % |
| Compris entre 19 125 et 22 950 euros | 5 % | 21% |
| Compris entre 15 300 et 19 125 euros | 3 % | 12 % |
| Compris entre 1500 et 15 300 euros | 28 % | 36 % |
| Compris entre 150 et 1500 euros | 19 % | 3 % |
| Inférieur à 150 euros | 40 % | 1 % |
Un montant moyen par Livret A en hausse
L’encours moyen des Livrets A et des LDDS était fin 2018 respectivement de 4 800 et 4 500 euros en hausse de plus de 1500 euros par rapport à son montant de 2009. Celui des Livrets d’Epargne Populaire est stable depuis 10 ans autour de 5000 euros
Le nombre moyen de mouvements constatés sur les livrets actifs s’établit en 2018 à 4,74 pour les versements et 5,14 pour les retraits soit environ un mouvement par mois, Le montant moyen des mouvements sur l’ensemble des livrets s’établit à 527 euros pour les livrets A, 434 euros pour les LEP et 658 euros pour les LDDS.
Les plus de 65 ans détiennent 38% des encours de livrets réglementés Les épargnants de plus de 65 ans, qui représentent 20% de la population française au 1er janvier 2019, détiennent 38 % des encours de livrets d’épargne réglementée. Les jeunes détiennent en proportion quatre fois moins d’épargne réglementée que la moyenne de la population française. Ils représentent 29% de la population et détiennent seulement 9 % des encours. Leur argent est placé principalement sur des livrets A (80%) et sur des livrets jeunes (16%). Malgré un taux de rendement (1,4% en 2018) supérieur à celui du livret A, l’encours des livrets jeunes est en baisse depuis plusieurs années
La France à la peine au 2e trimestre 2019
A quelques jours de la présentation officielle des résultats de la croissance du 2e trimestre par l’INSEE, la Banque de France a affiné ses prévisions en les corrigeant à la baisse.
La croissance n’aurait été que de 0,2 % d’avril à juin en repli par rapport au 0,3 % atteint lors des trois premiers mois de l’année. La Banque de France attribue ce recul à une baisse « significative » en juin de la production industrielle, en particulier dans l’automobile, le caoutchouc-plastique et l’informatique-électronique.
Dans la pharmacie et la fabrication d’autres matériels de transport, l’activité est restée favorablement orientée. Malgré tout, les chefs d’entreprises s’attendent toutefois à une reprise de l’activité en juillet dans l’ensemble des secteurs. Dans le bâtiment, l’activité s’est contractée au deuxième trimestre, « pénalisée par une météo défavorable », en particulier dans le gros œuvre. « Les carnets de commandes demeurent toutefois à un haut niveau, et les prix des devis augmentent ».
L’activité des services aurait progressé faiblement en raison du ralentissement de la demande. Elle reste toutefois dynamique dans le transport, l’informatique et l’édition. Selon la Banque de France, les chefs d’entreprise attendent une accélération de l’activité en juillet.
Cette estimation intervient dans un contexte incertain pour l’économie française, qui avait fait bonne figure au cours du premier trimestre au ralentissement mondial, sans toutefois atteindre le niveau espéré par certains économistes. Pour l’ensemble de l’année, les économistes de la Banque de France prévoit 1,4 % de croissance contre 1,1 % en moyenne pour la zone euro.
Le Coin des Epargnants
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 5 juillet 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 593,72 | +0,99 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 26 924.83 | +1,72 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 161,79 | +1,94 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 12 568,53 | +1,37 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 553,14 | +1,72 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 527,98 | +1,56 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 21 746,3 | +2,21 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 3 011,06 | -1,08 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,092 % | -0,084 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,365 % | -0,038 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 2,044 % | +0,037 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1221 | -1,31 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 399,010 | -0,77 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 64,280 | -0,16 % | 52,973 |
Un monde de fous
Pour la première fois, le taux d’intérêt de l’obligation à dix ans de l’Etat allemand est tombé en-dessous de -0,3 %, soit en-dessous du taux de dépôt de la Banque centrale européenne. Cela signifie que des investisseurs préfèrent des titres obligataires allemands que des titres monétaires. Pour forcer le trait, cela signifie qu’ils font plus confiance à l’Etat allemand qu’à la BCE. Le taux de l’OAT à 10 ans de l’Etat français a dépassé le -0,1 %, un nouveau record.
Cette semaine, la bataille entre Mario Draghi et Donald Trump a repris de la vigueur. Le 18 juin dernier, le premier avait reconnu que la BCE avait mené une politique visant à baisser le cours, le second a répliqué en indiquant que les Etats-Unis ne pouvaient pas rester inactifs face à cette manipulation. Il a également visé la Chine qui est accusé de favoriser la dépréciation de sa monnaie pour amoindrir le coût des sanctions. Le Président des Etats-Unis n’a pas totalement tort en ce qui concerne la sous-appréciation des monnaies européenne et chinoise compte tenu des excédents commerciaux de ces deux zones économiques. Les sorties de Donald Trump visent avant tout à faire pression sur la FED afin qu’elle diminue ses taux.
Les résultats de l’emploi n’incitent pas la FED à diminuer ses taux
Une fois de plus l’économie américaine a surpris avec la création de 224 000 emplois au mois juin quand le consensus n’en espérait que 160 000. En revanche, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,7 %, quand il était attendu stable à 3,6%. Le taux de participation au marché du travail est resté à peu près inchangé à 62,9 % et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a augmenté de 3,1 % en rythme annuel. Dans ces conditions, une baisse des taux directeurs de la part de la FED ne semble pas s’imposer de manière immédiate.
Les résultats de l’emploi américain ont conduit les indices « actions » à reculer, les baisses de taux étant moins probables. Néanmoins, sur la semaine, les cours « actions » ont augmenté permettant au CAC 40 de se rapprocher de la barre des 5 600 points. Le Nasdaq a gagné près de 2 % et le Dow Jones plus de 1,7 % en cinq jours.
Pour certains, malgré le bon résultat de juin, le marché du travail américain a commencé à montrer quelques signes de faiblesse. Les créations d’emploi moyenne par mois s’est établie à 164 000 cette année aux Etats-Unis, contre plus de 223 000 l’an dernier.
Le solde commercial replonge
En France, il faut relever qu’avec l’l’augmentation de la consommation dopée par la hausse du pouvoir d’achat, le solde commercial de la France s’est détérioré de 1,6 milliard d’euros au mois de mai pour s’établir à -3,3 milliards, soit son niveau le plus haut depuis le point exceptionnel de décembre 2017 (-2,5 milliards).
Libra, le réveil des autorités politiques et monétaires
Le Congrès américain a demandé à Facebook de reporter la création de sa crypto-monnaie, libra. Ce souhait est partagé par les banques centrales. Les autorités monétaires et politiques craignent que le libra soit tout à la fois une source de déstabilisation de la sphère financière et un vecteur pour le financement d’activités illégales. Cette réaction n’est pas en soi une surprise. La CIA avait, il y a plus de 5 ans, dans le cadre de son rapport public annuel, souligné que la création d’une monnaie de la part d’un réseau constituait un risque majeur de déstabilisation. Jusqu’à maintenant, un État se définit par la monnaie, le monopole des forces coercitives (armée, police), la justice et l’administration fiscale. Qu’une entreprise de taille mondiale tente s’arroger un symbole fort de la puissance étatique n’est pas sans conséquence. L’objectif de Facebook est d’équiper ses membres et au-delà d’offrir des services financiers à des personnes qui n’y ont pas accès (pays émergents et en voie de développement notamment). Ce moyen d’échange supranational pourrait modifier les règles en vigueur en matière d’échanges. Le contrôle du libra serait par nature plus complexe. A la différence du bitcoin, la monnaie de Mark Zuckerberg serait assise sur un panier de devises bien réelles comme l’euro et le dollar. En l’état actuel, le libra n’est pas une monnaie mais un actif financier. Ce n’est pas un étalon, ni un instrument de réserve mais l’objectif du libra est bien d’intégrer le cénacle, un jour ou l’autre, des monnaies reconnues.
Les taux bas ne dissuadent pas les épargnants
Selon la Banque de France, au mois de mai 2019, le taux moyen de rémunération des livrets bancaires fiscalisés reste fixé à un niveau historiquement bas à 0,25 %. Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux est inchangé sur un mois. Ce taux a baissé de 5 points de base sur un an (0,61 % en mai, après 0,66 % en mai 2018). La diminution observée sur ces 12 derniers mois est principalement portée par les comptes à terme supérieurs à 2 ans, dont la rémunération a fléchi de 30 points de base pour les ménages et de 20 points de base pour les Sociétés non financières.
Les faibles taux ne dissuadent pas les ménages à épargner. Le taux d’épargne est en effet au-dessus des 15 % du revenu disponible brut en France depuis la fin de l’année 2018. La collecte nette de l’assurance vie a été durant les cinq premiers mois de l’année de 13 milliards d’euros quand celle du Livret A et du LDDS a dépassé 11 milliards d’euros sur la même période.
Le Mensuel N°63 du Cercle de l’Epargne – Juillet 2019
Dans notre numéro du mois de juillet 2019 plusieurs études sur la situation des retraités ainsi qu’un état des lieux de l’épargne retraite en France. ce mois-ci, le Cercle de l’Epargne aborde également la question de la digitalisation des activités financières. Enfin, comme chaque mois, vous retrouvez les derniers chiffres sur l’épargne et la retraite.
SOMMAIRE DU MENSUEL DE L’ÉPARGNE
ET DE LA RETRAITE
DU MOIS DE JUILLET 2019
L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
LE COIN DE L’ÉPARGNE
État des lieux de l’épargne-retraite avant déménagement
LE COIN DE LA RETRAITE
Retraite, Madame la Marquise, tout va très bien…
LE COIN DE LA PATRIMOINE
Plus-values comment vendre sa résidence secondaire sans payer d’impôts
LES DOSSIERS DU MOIS DE JUILLET
La révolution du secteur des finances est-elle en marche ?
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Les retraités, leur retraite et l’avenir des régimes
Par Sarah Le Gouez, Secrétaire générale du Cercle de l’Épargne
LES CHIFFRES DU CERCLE DE L’ÉPARGNE
Tableau de bord des produits d’épargneTableau de bord des marchés financiersTableau de bord du crédit et des taux d’intérêtTableau de bord retraite
Télécharger le PDF du Mensuel
Les Français continuent à adorer l’épargne réglementée malgré son faible rendement
Le passage en rendement réel négatif des principaux produits d’épargne réglementée n’a pas eu d’effet sur la collecte en 2018. Bien au contraire, les Français ont privilégié les placements courts, défiscalisés et offrant une garantie en capital. Le dernier rapport de l’épargne réglementée publié par la Banque de France souligne la préférence des Français pour la sécurité et la liquidité au détriment du rendement. Pour le moment, les épargnants ne semblent pas disposés à répondre favorablement aux demandes du Gouvernement de s’orienter sur le long terme (loi PACTE en particulier).
L’encours de l’épargne réglementée a atteint, fin 2018, 751 milliards d’euros, un nouveau record. Elle représente à ce jour 15% du patrimoine financier des ménages français, plus de 5000 milliards d’euros. Les placements en unités de compte représentent de leur côté 7% des placements, les actions cotées 5% et les fonds d’actions 2%.
Les taux des livrets bancaires toujours à des niveaux historiquement bas
Selon la Banque de France, au mois de mai 2019, le taux moyen de rémunération des livrets bancaires fiscalisés reste fixé à un niveau historiquement bas à 0,25 %. Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux est inchangé sur un mois. Ce taux a baissé de 5 points de base sur un an (0,61 % en mai, après 0,66 % en mai 2018). La diminution observée sur ces 12 derniers mois est principalement portée par les comptes à terme supérieurs à 2 ans, dont la rémunération a fléchi de 30 points de base pour les ménages et de 20 points de base pour les SNF.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| mai-2018 | mars-2019 | avr- 2019 (e) | mai-2019 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,66 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| Ménages | 0,91 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,82 | 0,77 | 0,79 | 0,76 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,74 | 1,50 | 1,47 | 1,44 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| – plan d’épargne-logement | 2,69 | 2,67 | 2,67 | 2,66 |
| SNF | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,46 | 1,28 | 1,27 | 1,26 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,31 | -0,31 | -0,31 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) |
Les retraites à prestations définies réformées
Le Gouvernement a commencé à publier les textes réformant les régimes à prestations définies également appelées « retraites chapeaux ». Le nouveau régime sera applicable à compter du 1er janvier 2020.
Le Gouvernement a décidé de plafonner les retraités issues de ces régimes et de le rendre portable afin qu’ils soient conformes au droit européen. Désormais, la pension des régimes à prestations définies sera fonction du nombre d’années en entreprises et sera plafonnée à 3 % du salaire par année de présence et ne pourra pas dépasser 30 % de la rémunération. L’ordonnance ne permet aucune rétroactivité dans l’acquisition de droits. Un salarié ne pourra faire racheter des années d’ancienneté pour bénéficier d’un montant de prestation supérieur.
Les salariés ayant des rémunérations supérieures à 324.000 euros par an, pour bénéficier de la pension devront respecter des objectifs fixés par le Conseil d’administration. Si la performance devient une condition du régime fiscal et social de faveur des régimes supplémentaires, cela signifie que la justice pourra être amené à vérifier l’atteinte des objectifs de performance.
Réforme des retraites, des pistes et des grimaces ?
Jean-Paul Delevoye devrait présenter les grandes lignes de son projet de réforme des retraites au milieu du mois de juillet. Cette présentation déclenchera un nouveau cycle de négociation. A son terme, un projet de loi sera présenté avec une discussion parlementaire qui devrait intervenir après les municipales de 2020. Le contexte de cette réforme a changé avec la publication du rapport du Conseil d’Orientation des Retraites qui a indiqué que le système de retraite renouerait dès 2020 avec les déficits. Le Gouvernement est ainsi amené à prendre des mesures de rééquilibrage en urgence qui pourraient être intégrées dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.
Le principe de base de la réforme des retraites est toujours la constitution d’un système par points qui s’appliquerait aux actifs des 42 régimes de base actuels avec comme règle « un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous ».
L’âge d’équilibre du système de retraites vers 64 ans
Depuis plusieurs mois, le Gouvernement essaie de trouver une solution afin d’inciter les Français à reporter leur âge de départ à la retraite.
L’idée d’une accélération de l’allongement de la durée de cotisation est de plus en plus admise. Initialement prévu pour la génération 1973, le passage à 43 ans pourrait s’appliquer dès 2025 pour la génération 1964. Cette mesure pourrait être adoptée dès cette année. Une autre piste consisterait à introduire un mécanisme de bonus-malus.
L’objectif serait de porter en moyenne le départ à la retraite à 64 ans. Jean-Paul Delevoye a admis que les métiers dits pénibles seraient soumis à des conditions particulières avec notamment des départs anticipés. Cela pourrait concerner les fonctionnaires d’actives, le personnel soignant, etc. Le départ anticipé ne sera plus lié au statut mais au métier.
Réversion et droits familiaux
Au sujet de la réversion, l’idée d’un partage des points au moment du décès d’un conjoint fait son chemin. Ce système s’inspirerait des pratiques en cours en Allemagne ou dans les pays d’Europe du Nord. Cette option serait privilégiée à la « garantie des ressources » mais le débat reste ouvert.
Pour les droits familiaux, les pensions seraient majorées « dès le premier enfant » et non plus à partir du troisième. La bonification pourrait être proportionnelle. Elle prendrait donc la forme d’un pourcentage de la pension plutôt qu’un nombre de points forfaitaire par enfant, ce qui profitera mathématiquement plus aux riches qu’aux pauvres.
Cotisation déplafonnée au-delà de 10.000 euros/mois
Les hauts revenus pourraient être mis à contribution. Au-delà de 10.000 euros brut par mois, une « cotisation déplafonnée non créatrice de droits », pourrait être instituée selon un document de travail projeté durant l’intervention publique du Haut commissaire.
Ce prélèvement supplémentaire serait contraire au projet du chef de l’État, fondé sur la promesse qu' »un euro cotisé donnera les mêmes droits à tous ».
Le Coin de l’Epargne du mois de juin 2019
Les marchés à la veille du G 20 ont joué la prudence dans l’attente d’une éventuelle avancée en ce qui concerne la crise commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les indices sont restés assez stables durant la dernière semaine du mois de juin.

Un premier semestre schizophrène
Aussi étrange que cela puisse paraître mais les indices « actions » ont connu un premier semestre florissant malgré les incertitudes économiques et géopolitiques. Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que les menaces de guerre avec l’Iran ont rythmé les six premiers mois de l’année sans pour autant empêcher une réelle appréciation des cours boursiers. Celle-ci est certes le produit d’un rattrapage intervenant une chute exagérée des valeurs actions à la fin de l’année dernière.
Le premier semestre 2019 du CAC 40 aura été le meilleur enregistré depuis 1998. En six mois, il a gagné tout comme le DAXX allemand plus de 17 %. Pour le Footsie britannique, la hausse a été de 10,37 % malgré les tergiversations sur le Brexit. Pour l’Eurostoxx 50, le gain a été de plus de 15 %. Le Dow Jones a progressé lors du 1er semestre de plus de 14 % et le Nasdaq de plus de 20 %.
Le premier semestre 2019 aura été marqué par une nouvelle baisse des taux d’intérêt avec à la clef celui de l’OAT à 10 ans qui est entré en territoire négatif, une première pour la France. Cette baisse des taux est la conséquence du ralentissement pronostiqué de plusieurs grandes économies mondiales dont la Chine et les Etats-Unis sur fonds de ralentissement du commerce international. Il est aussi le résultat du maintien d’un haut niveau d’épargne à l’échelle mondiale combinée à une aversion aux risque importante. Par ailleurs, les investisseurs anticipent une baisse des taux de la part des banques centrales.
Si le pessimisme règne au niveau des anticipations portant sur le cours de l’économie mondiale, les résultats réels sont pour le moment moins mauvais qu’attendus. Le début du deuxième semestre sera conditionné par les résultats de la rencontre entre les Président des Etats-Unis et celui de la Chine à Osaka, au Japon, à l’occasion du sommet du G20.
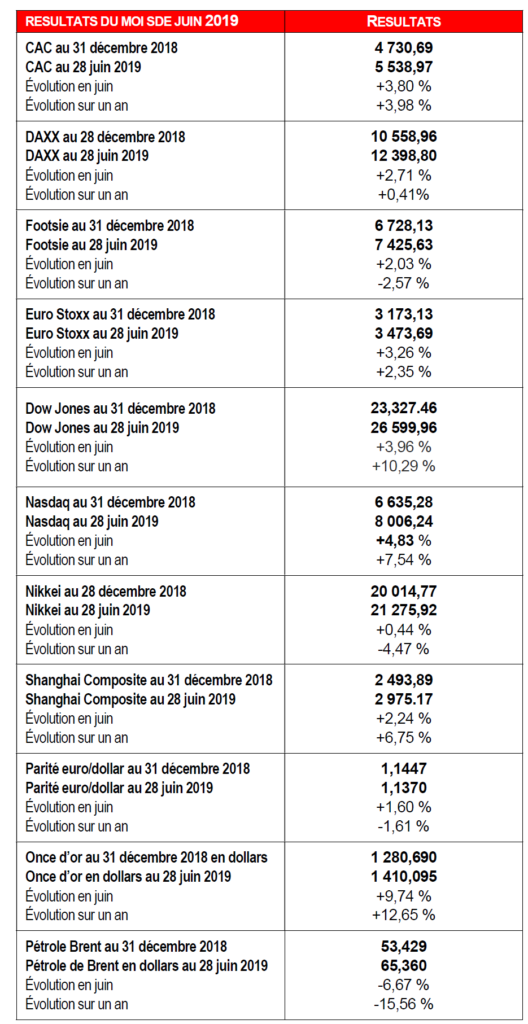
Taux de l’usure pour le 2e semestre 2019
A compter du 1er juillet 2019, les taux de l’usure seront les suivants :
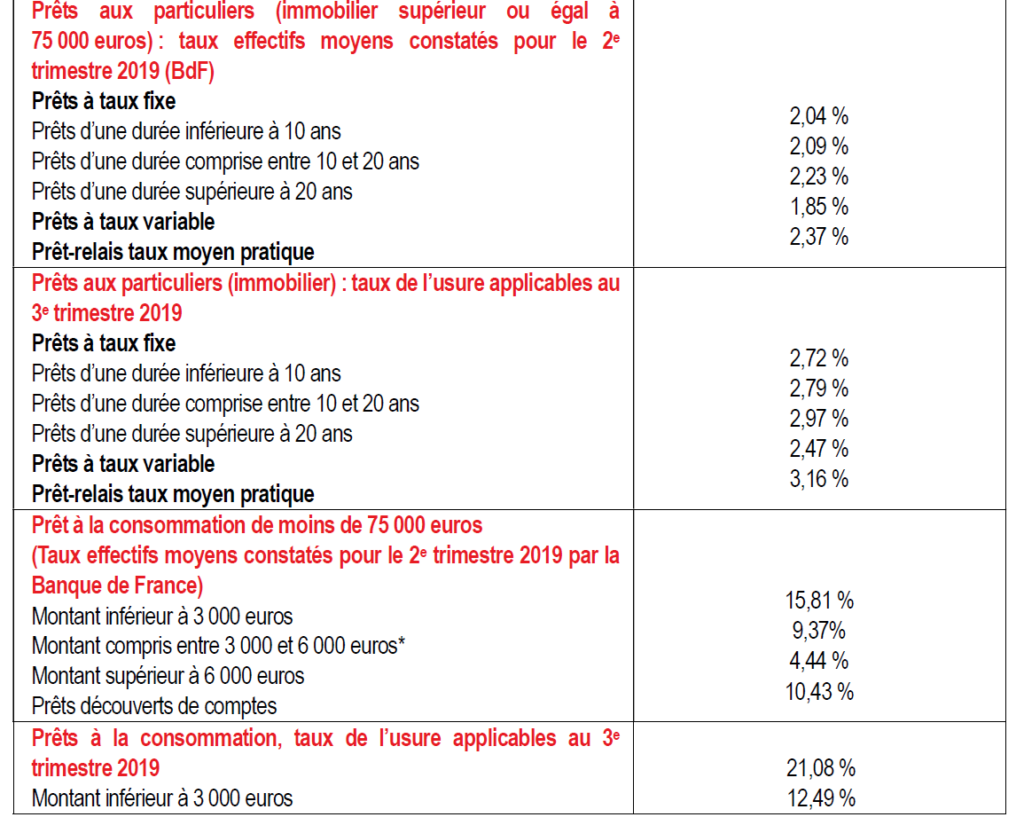
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


