Le Coin de l’agenda du 30 décembre au 19 janvier
Lundi 30 décembre
En Allemagne, il faudra regarder les ventes au détail de novembre.
Aux États-Unis, les promesses de vente immobilières de novembre seront rendues publiques.
Mardi 31 décembre
Marchés fermés au Japon, en Allemagne.
Clôture anticipée à la bourse de Londres et pour Euronext
En Chine, seront publiés les indices PMI officiels de décembre.
Mercredi 1er janvier
Marchés fermés au Japon, en Europe et aux Etats-Unis.
En France, seront connues les immatriculations automobiles de décembre et de l’année 2019.
Jeudi 2 janvier
Marchés fermés au Japon et en Suisse
Il faudra suivre l’indice PMI manufacturier du mois de décembre pour la Chine, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro.
Vendredi 3 janvier
Marchés fermés au Japon
En France, il faudra regarder l’indice des prix à la consommation de décembre (estimation provisoire).
En Allemagne, il faudra regarder le nombre de demandeurs d’emploi et le taux de chômage de décembre.
Pour la zone euro, la première estimation de l’inflation de décembre sera connue. Les résultats de la masse monétaire M3, du crédit au secteur privé de novembre seront publiés.
Aux Etats-Unis, il faudra suivre l’indice ISM manufacturier de décembre, les dépenses de construction de novembre et le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 10/11 décembre.
Lundi 6 janvier
L’indice PMI IHS Markit manufacturier de décembre sera connu pour l’Allemagne, la France, la zone euro et le Royaume-Uni.
Pour l’Allemagne, seront publiées les ventes au détail de novembre.
Pour la zone euro, l’indice « Sentix » de janvier sera publié.
Mardi 7 janvier
L’indice PMI IHS Markit des services de décembre seront publiés pour le Japon, le Royaume-Uni, la France et la zone euro.
Le taux d’inflation de la zone euro (1e estimation) de décembre sera publié. Seront rendues publiques les ventes au détail et la balance commerciale de novembre.
Mercredi 8 janvier
Les résultats des commandes à l’industrie de novembre pour la zone euro seront publiés. Seront également connus les indices du climat des affaires et du sentiment économique du mois de décembre.
L’enquête ADP sur l’emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de décembre sera publiée.
En France, il faudra regarder les résultats du commerce extérieur de novembre, l’enquête de conjoncture auprès des ménages de décembre.
Jeudi 9 janvier
En France, sera attendu l’indicateur conjoncture de la Banque de France (3e projection du taux de croissance du PIB pour le 4e trimestre).
Pour l’Allemagne, la production industrielle de novembre sera publiée.
Pour la zone euro, seront communiqués la balance commerciale et le taux de chômage.
Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine au 4 janvier.
Vendredi 10 janvier
Au Japon, la consommation des ménages de novembre sera publiée.
Aux Etats-Unis, les créations d’emploi, le taux de chômage et les salaires de décembre seront publiés.
En France, l’indice de la production industrielle de novembre sera publié.
Lundi 13 janvier
Marchés fermés au Japon
Mardi 14 janvier
Aux Etats-Unis, il faudra suivre les prix à la consommation de décembre.
Mercredi 15 janvier
Pour la zone euro, il faut regarder la balance commerciale et la production industrielle de novembre.
Aux Etats-Unis, sera connu l’indice manufacturier « Empire State » de janvier.
En France, l’indice des prix à la consommation de décembre (définitif) sera connu.
Jeudi 16 janvier
En Allemagne, le taux d’inflation de décembre sera publié.
Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine au 11 janvier seront communiquées tout comme l’indice d’activité « Philly Fed » de janvier. Les ventes au détail de décembre seront connues ainsi que l’indice NAHB du marché immobilier de janvier.
Vendredi 17 janvier
Pour la zone euro, le taux d’inflation de décembre sera publié.
Aux Etats-Unis, les mises en chantier, le permis de construire de décembre seront publiés tout comme la production industrielle et l’indice de confiance du Michigan (1e estimation).
Vendredi 5 janvier
Pour la zone euro, seront connus le taux d’inflation de décembre et les prix de production de novembre.
Aux Etats-Unis, il faudra suivre les créations d’emploi et le taux de chômage de décembre, la balance commerciale de novembre et l’indice ISM des services de décembre. Seront également publiées les commandes à l’industrie de novembre.
Dimanche 7 janvier
En Chine, seront rendues publiques les réserves de changes de décembre.
Le salon de l’électronique grand public, CES, se tiendra à Las Vegas, jusqu’au 8 janvier.
Lundi 8 janvier
Marchés fermés au Japon
En Allemagne, seront rendues publiques les commandes à l’industrie de novembre.
Pour la zone euro, seront publiées les ventes au détail de novembre.
Mardi 9 janvier
En Allemagne, le résultat de la balance commerciale et celui de la production industrielle de novembre seront connus.
Pour la zone euro, le taux de chômage de novembre sera publié.
Mercredi 10 janvier
Au Royaume-Uni, il faudra suivre les résultats de la production industrielle et de la balance commerciale de novembre.
Aux Etats-Unis, seront connus les stocks et ventes des grossistes de novembre.
Jeudi 11 janvier
Sera connue, pour la zone euro, la production industrielle de novembre.
Pour les Etats-Unis, il faudra regarder l’indice « Philly Fed » de janvier, les inscriptions au chômage de semaine au 6 janvier, le résultat du budget fédéral de décembre.
Vendredi 12 janvier
Aux Etats-Unis, seront connus le taux d’inflation et les ventes au détail de décembre ainsi que les stocks des entreprises de novembre.
Lundi 15 janvier
Marchés fermés aux Etats-Unis (Martin Luther King, Jr. Day)
Pour la zone euro, il faudra suivre le résultat de la balance commerciale de novembre.
Mardi 16 janvier
En Allemagne, le taux d’inflation de décembre sera publié.
Au Royaume-Uni, il faudra regarder le taux d’inflation de décembre.
Aux Etats-Unis, il faudra suivre l’indice manufacturier « Empire State » de janvier et les stocks des entreprises de novembre.
Mercredi 17 janvier
Pour l’ensemble de l’Union européenne seront publiées les immatriculations automobiles de décembre et pour l’année 2019. Le taux d’inflation de la zone euro sera connue.
Aux Etats-Unis, la production industrielle de décembre et l’indice immobilier NAHB de janvier.
Jeudi 18 janvier
Aux Etats-Unis, il faudra regarder les mises en chantier, les permis de construire de décembre, les inscriptions au chômage de la semaine au 13 janvier et l’indice d’activité « Philly Fed » de janvier.
Vendredi 19 janvier
En Allemagne, les prix à la production de décembre seront rendus publics.
Au Royaume-Uni, il faudra suivre les ventes au détail de décembre.
Aux Etats-Unis, l’indice de confiance du Michigan (1e estimation) de janvier sera connu.
Fixation du taux d’intérêt légal applicable au 1er janvier 2020
Pour le premier semestre 2020, le taux de l’intérêt légal a été fixé à :
1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,15 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,87 %.
Ces taux ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel du 26 décembre 2019.
Eurocroissance – publication d’un décret organisant les modalités de son fonctionnement
Le Gouvernement a publié au Journal Officiel du 26 décembre 2019 un décret du 23 décembre 2019 en application de l’article 72 de la loi PACTE concernant notamment les fonds eurocroissance et les Plans d’Epargne Retraite. Ce décret vise à préciser les règles applicables
aux engagements d’assurance donnant lieu à constitution d’une provision de diversification. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L’assurance vie en novembre, les unités de compte en plein boom
N
En pleine polémique sur le devenir des fonds euros, la collecte nette de l’assurance vie a fléchi au mois de novembre tout en restant positive. Elle a été ainsi de 1,2 milliard d’euros contre 1,7 milliard en octobre et 2,9 milliards d’euros en septembre. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à 25,2 milliards d’euros contre 22,2 milliards d’euros sur la même période en 2018.
Le mois de novembre est traditionnellement positif pour l’assurance vie sans être exceptionnel. Le cru de 2019 n’échappe pas à la règle. Il est néanmoins inférieur à celui de 2018 (+2,5 milliards d’euros). Sur ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées en novembre.
Plus du tiers de la collecte en unités de compte en novembre
Le montant des cotisations d’assurance vie a baissé au mois de novembre. Il s’est élevé à 11,1 contre 12,1 milliards d’euros en octobre. Les unités de compte ont représenté 37 % de la collecte en novembre contre 32 % en octobre. Sur les onze premiers mois de l’année, le taux est de 26 %. Cette augmentation est imputable non seulement aux bons résultats de la bourse mais aussi aux recommandations des compagnies d’assurance vie. La baisse de la collecte brute s’explique certainement par le refus de certains assurés de prendre des unités de compte. Ils préfèrent alors renoncer à leurs versements ce qui pèse sur la collecte. Néanmoins, sur les onze premiers mois, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance est de 132,8 milliards d’euros contre 129,2 milliards d’euros sur la même période en 2018).
Les prestations se sont élevées à 9,9 milliards d’euros en novembre contre 10,3 milliards d’euros. Elles se situent dans la moyenne de ces derniers mois. De janvier à novembre, elles ont atteint 107,6 milliards d’euros contre 107,1 milliards d’euros sur la même période en 2018. Les épargnants n’ont pas effectué de retraits massifs après les annonces sur les fonds euros.
L’assurance conforte sa place de numéro 1
L’encours des contrats d’assurance-vie était, à fin novembre, de 1 785 milliards d’euros à fin novembre 2019, en progression de 5 % sur un an, ce qui constitue un record.
L’assurance vie à la croisée des chemins
En 2019, les ménages français ont accru leur effort d’épargne malgré la baisse des rendements des produits de taux. Ils ont souhaité renforcer la poche d’épargne de précaution dans un contexte d’incertitudes élevées. Par ailleurs, compte tenu des faibles rendements, pour obtenir le niveau souhaité d’épargne, il faut davantage d’argent de côté. En outre, l’augmentation des prix de l’immobilier entraine celle des apports personnels. Par ailleurs, comme les Français s’endettent fortement pour acquérir leur logement, cela se traduit par une progression du taux d’épargne.
L’assurance vie a connu des années 90 à maintenant une ascension provoquée par l’engouement envers les fonds euros. Les annonces des compagnies d’assurance de baisser fortement, pour 2019, les taux de leurs fonds euros et d’en restreindre éventuellement l’accès constituent un changement de cap qui devrait se matérialiser l’année prochaine. Avec des marchés financiers en forte hausse, plus de 25 % pour le CAC 40 depuis le mois de janvier, cette réorientation est plus facile à faire passer auprès des assurés. Ce contexte porteur encourage à une prise accrue de risques. Compte tenu du poids des fonds euros (environ 80 % de l’encours), le rééquilibrage en faveur des unités de compte mettra du temps et nécessite un effort de pédagogie évident.
Le Livret A ne faiblit pas en novembre
Quand novembre sourit au Livret A
Après la décollecte de 2,13 milliards d’euros du mois d’octobre dernier, le Livret A a renoué, en novembre, avec des résultats positifs, + 610 millions d’euros, soit une collecte équivalente à celle de 2018 (670 millions d’euros).
Pour le Livret A, novembre ressemble, en règle générale, à octobre en n’étant pas très porteur. Les impôts locaux à acquitter, la proximité des dépenses de fin d’année et l’absence de versement de primes freinent logiquement les ardeurs des épargnants. Lors de ces dix dernières années, le Livret A a, ainsi, enregistré cinq décollectes au mois de novembre.
L’année 2019 se démarque avec un résultat positif. Le contexte incertain sur le plan économique et social pousse les ménages à épargner. Les gains de pouvoir d’achat engrangés en 2019, les plus importants constatés depuis 2007, ont été, en grande partie, mis de côté amenant le taux d’épargne à 15 % du revenu disponible brut. Ce constat est confirmé par la faible progression, depuis un an, de la consommation. Les Français estiment que l’amélioration économique qui se traduit notamment par une baisse du chômage demeure fragile. Le caractère plus précaire des emplois avec l’essor des CDD, du temps partiel ou de l’intérim, peut expliquer l’accès actuel de prudence. Le rendement faible du Livret et sa baisse possible le 1er février prochain n’influent en rien sur le comportement des ménages. Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte nette a atteint 14,24 milliards d’euros contre 9,54 milliards d’euros, l’année dernière, sur la même période. Le Livret A est en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2012 (28,16 milliards d’euros), année qui avait été marquée par le relèvement de plafond et par la crise des dettes souveraines (le taux du Livret A était alors de 2,25 %).
Le Livret de développement durable et solidaire a enregistré de son côté une collecte nette nulle après deux mois de décollecte. Ce livret qui est l’antichambre des comptes courants des ménages suit plus finement que le Livret les évolutions de leurs dépenses d’où des résultats différents de ceux du Livret A qui est davantage un outil d’épargne.
Le 1er février prochain, baisse ou pas du taux, les paris sont ouverts ?
Compte tenu du taux d’inflation constaté depuis un an et des taux d’intérêt à trois des marchés interbancaires, le rendement du Livet A pourrait, en application de la nouvelle formule, passer au taux plancher de 0,5 % au 1er février prochain (le taux est logiquement égal à la moyenne des taux monétaires à trois et du taux de l’inflation sur 12 mois avec un plancher fixé à 0,5 point). Le Gouverneur de la Banque de France a plaidé en ce sens. Le taux actuel de 0,75 % est nettement supérieur aux taux pratiqués pour des produits de même nature. Le taux de rémunération des livrets bancaires avoisine 0,20 %. Le Livret A coûte cher à la Caisse des dépôts et aux réseaux bancaires au regard du rendement des placements et des prêts issus du Livret A. Le taux de 0,75 % rend peu attractif les emprunts financés à partir des ressources collectées. Cette situation pénalise les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les PME, les structures de l’économie sociale et solidaire qui peuvent se financer via le Livret A. S’il décidait de ne pas baisser le taux, le Gouvernement portrait un coup à la nouvelle formule.
La proximité des élections municipales ainsi que les débats complexes sur la réforme des retraites pourraient dissuader le Gouvernement de baisser le taux du Livret A. le taux de 0,5 % serait le plus faible jamais appliqué aux épargnants. Symbole de l’épargne populaire, le Livret A rapporterait 0,5 à 0,7 point de moins que l’inflation. Au début des années 2000, les gouvernements avaient instauré une formule de fixation du taux visant à garantir le pouvoir d’achat des épargnants, mais cela, c’était avant les taux d’intérêt négatifs.
Le Coin des Epargnants du 20 décembre 2019 : le CAC 40 et l’endettement public toujours plus haut
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 20 décembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 6 021,53 | +1,73 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 28 454,89 | +1,14 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 925,55 | +2,18 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 318,90 | +0,27 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 582,48 | +3,11 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 776,56 | +1,22 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 816,63 | -0,86 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 3 004,94 | +1,26 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (20 heures) | +0,051 % | +0,052 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (20 heures) | -0,252 % | -0,044 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (20 heures) | 1,917 % | +0,091 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (20 heures) | 1,1070 | -0,43 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (20 heures) | 1 477,764 | +0,15 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (20 heures) | 65,960 | +1,66 % | 52,973 |
Le CAC 40 termine la semaine au-dessus de 6000 points
La barre des 6000 points avait été franchie, pour le CAC 40, le 16 décembre dernier en cours de séance mais elle ne l’avait pas en clôture. Vendredi 20 décembre, la Bourse de Paris a réussi enfin à clôturer au-delà de 6000 points, portée par les records de Wall Street et par un effet technique qui se produit chaque trimestre, appelé les « quatre sorcières ». Chaque troisième vendredi des mois de mars, juin, septembre et décembre intervient le débouclement simultané de plusieurs types de contrats à terme et options sur les indices et actions. Ce débouclement s’accompagne, en règle générale, d’une forte poussée des volumes et de volatilité. Ce trimestre, le mouvement a été nettement haussier et les volumes échangés (plus de 7 milliards d’euros) en ont profité.
Vendredi 20 décembre, le CAC 40 a donc terminé la séance à 6 021,53 points, après avoir inscrit un nouveau pic annuel à 6.024,17 points en séance. L’indice parisien est en hausse de plus de 27% depuis le début de l’année. La bourse de Londres a gagné plus de 3 % en une semaine dans le prolongement de la victoire de Boris Johnson.
Aux Etats-Unis, le S&P 500, a franchi, jeudi 19 décembre, le seuil des 3 200 points pour la première fois de son histoire et a aligné une quatrième semaine de progression consécutive. La bourse de New York anticipe toujours un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Cette semaine, le Secrétaire d’Etat au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré dans une interview à la chaîne d’informations financières CNBC que l’accord commercial partiel avec la Chine serait signé début janvier. Les dépenses des ménages américains ont enregistré une hausse de 0,4 % en novembre, comme anticipé par le consensus, les revenus ayant augmenté de 0,6 %, au-delà de la hausse du 0,4 % visée par les économistes. L’indice de confiance du consommateur selon l’université du Michigan, s’élève à 99,3 points, contre 99,2 points attendus. La croissance du PIB au troisième trimestre a été, par ailleurs, confirmée à +2,1 %.
276 000 euros, le patrimoine moyen des ménages en France
Début 2018, le patrimoine brut (sans prendre en compte les remboursements des emprunts) moyen des ménages français s’élève à 276 000 euros, en augmentation de 2,6 % par rapport à début 2015. Le patrimoine net moyen des ménages s’élève, quant à lui, à 239 900 euros. Le patrimoine médian brut (patrimoine brut partageant en deux parts égales les ménages) est de 163 100 euros, le patrimoine net médian étant de 117 000 euros. Cela signifie que 50 % des ménages disposent d’un patrimoine inférieur à 117 000 euros.
Début 2018, le patrimoine brut des ménages est majoritairement constitué de biens immobiliers (61 %). Cette part du patrimoine immobilier est stable depuis 2004. 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en France (qu’ils aient ou non terminé d’en rembourser l’achat). 84 % de la valeur du patrimoine immobilier des ménages est constituée par la résidence principale. Les propriétaires et les accédants à la propriété de leur résidence principale disposent ainsi d’un patrimoine brut moyen 7 fois plus élevé que celui des locataires et des personnes logées gratuitement.
Le patrimoine financier représente 20 % du patrimoine brut. Quasiment tous les ménages en possèdent, mais les actifs financiers et les montants associés sont très différents selon le niveau de patrimoine. Le patrimoine résiduel (voiture, équipement de la maison, bijoux, œuvres d’art, etc.) constitue 8 % du patrimoine. Cette composante est majeure dans le patrimoine des ménages les plus modestes. Elle représente 71 % du patrimoine total des 10 % des ménages les moins dotés. Ceux-ci ne détiennent en effet quasiment pas de patrimoine immobilier. Le patrimoine professionnel représente 11 % du patrimoine brut. Il est surtout détenu par les ménages les mieux dotés.
Les sexagénaires sont les mieux dotés
Sans surprise, le patrimoine varie en fonction de l’âge. Le patrimoine net moyen passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires. Pour les ménages avec une période de référence de plus de 70 ans, le montant moyen de patrimoine est de 305 500 euros. Avant 2010, une diminution du patrimoine était constatée dès la soixantaine ; désormais, elle intervient après 70 ans. Cette baisse de patrimoine était aussi observée pour les sexagénaires alors qu’elle ne concerne plus que les ménages de plus de 70 ans depuis le début de la décennie.
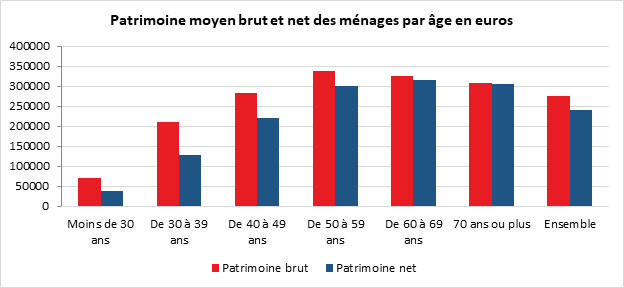
Le patrimoine brut médian qui partage en deux parties égales les ménages s’élève pour les 60/69 ans à 200 300 euros. Il est très légèrement inférieur à celui des 50/59 ans (204 200 euros et 11 fois supérieur au patrimoine net médian des moins de 30 ans.
Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans du fait des emprunts qu’ils ont contractés pour l’achat de leur résidence détiennent un patrimoine brut près de deux fois supérieur à leur patrimoine net (69 900 euros contre 38 500 euros). Dans cette tranche d’âge, 91 % des ménages propriétaires de leur résidence principale sont accédants à la propriété et ont un emprunt. Pour les ménages les plus âgés, le patrimoine brut est quasiment à hauteur du patrimoine net, seuls 2 % des ménages propriétaires étant accédants à la propriété de leur résidence principale.
De manière générale, jusqu’à 60 ans, le montant du patrimoine immobilier détenu croît avec l’âge de la personne de référence, puis décroît légèrement ensuite. En revanche, le patrimoine financier progresse continûment au cours du cycle de vie. Ainsi, le patrimoine financier brut des plus de 70 ans est de 82 600 euros contre 14 300 pour les moins de 30 ans.
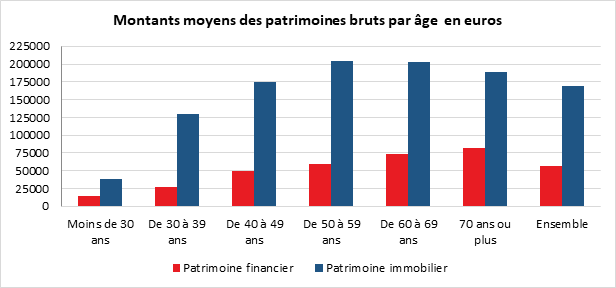
Le montant médian des patrimoines bruts immobilier atteint un maximum entre 50 et 59 ans à 149 500 euros pour légèrement baisser après. Le patrimoine financier médian est au plus haut après 70 ans.
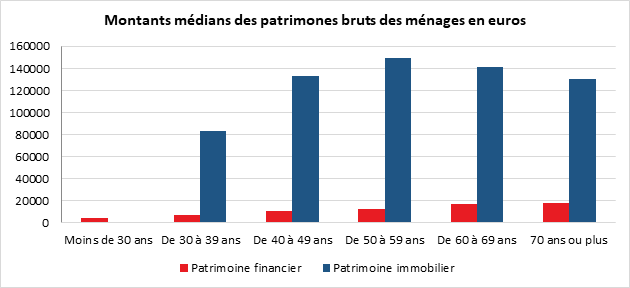
Des écarts de patrimoine plus importants qu’en matière de revenus
La moitié des ménages déclarent un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros. Les 10 % de ménages les mieux dotés en patrimoine brut disposent d’au moins 607 700 euros d’actifs alors que les 10 % les plus modestes possèdent au maximum 3 800 euros chacun, soit 160 fois moins. Les 1 % de ménages les plus dotés possèdent au moins 1 941 600 euros de patrimoine brut.
Les inégalités de patrimoine sont plus marquées que celles des revenus. En 2017, le rapport interdécile est de 4,6, c’est-à-dire que le revenu maximal des 10 % de ménages les plus modestes est 4,6 fois moins élevé que le revenu minimum des 10 % les plus aisés. Les inégalités de patrimoine brut sont stables entre 2015 et 2018. Après avoir fortement augmenté entre 2004 et 2010, puis légèrement diminué entre 2010 et 2015, l’indice de Gini est stable entre 2015 et 2018 et s’établit, début 2018, à 0,637, contre 0,635 début 2015. L’évolution des dernières années est fonction des valorisations des actifs et des revenus qu’ils génèrent. La crise de 2008/2009 ainsi que la baisse des taux qui s’en est suivie pèsent sur le rendement des produits de taux. Si les prix de l’immobilier, après une petite baisse entre 2008 et 2012, sont, depuis, orientés à la hausse, la valeur des actions connait d’amples fluctuations.
Début 2018, la moitié la mieux dotée des ménages vivant en France possédait 92 % du patrimoine total des ménages. Les 5 % les mieux dotés en détenaient un tiers et les 1 % les mieux dotés, 16 %. Cette répartition du patrimoine brut est stable depuis 2015.
Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Ils en détiennent une partie importante dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).
La concentration du patrimoine est encore plus nette pour la composante financière. Les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine financier en détiennent plus de la moitié et 1 % des ménages en possèdent 31 %. Par comparaison, les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine immobilier détiennent 28 % du patrimoine immobilier total.
Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Une part importante est détenue dans des actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans du patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).
L’évolution des patrimoines est relativement stable depuis la crise des dettes souveraines. Le renchérissement de l’immobilier renforce le poids de ce dernier au sein du patrimoine des ménages. Les retraités sont ceux dont le patrimoine est le plus élevé. Les générations du baby-boom qui ont bénéficié des Trente Glorieuses, de l’inflation pour acquérir un patrimoine et dont la valorisation a augmenté à partir des années 90 sont propriétaires d’une part non négligeable du patrimoine des ménages.
La dette publique française dépasse 100 % du PIB
La dette publique française a atteint au troisième trimestre 2019 100,4 % du PIB. Elle avait déjà dépassé la barre symbolique des 100 % aux premier et deuxième trimestres 2017. En fonction des opérations d’émissions, de tombées de titres et de rachats, elle pourrait revenir en-dessous des 100 % au cours du quatrième trimestre. Au premier trimestre 1995, la dette publique représentait 56 % du PIB.
À la fin du troisième trimestre, la dette publique de Maastricht s’élève à 2 415,1 milliards d’euros en hausse de 39,6 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. La dette publique nette augmente plus modérément (+15,0 milliards d’euros) et s’établit à 90,3 % du PIB.
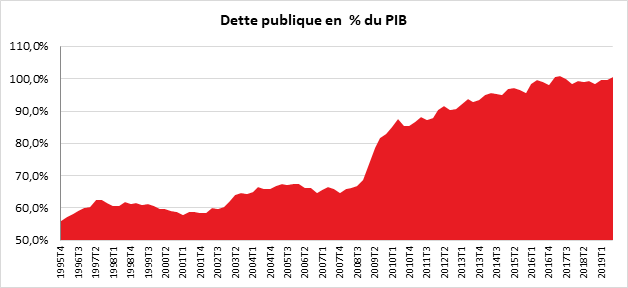
La dette publique français dépasse le montant du PIB
La dette publique française a atteint au 3e trimestre 2019 100,4 % du PIB. Elle avait déjà dépassé la barre symbolique des 100 % au 1er et 2e trimestres 2017. En fonction des opérations d’émissions, de tombées de titres et de rachats, elle pourrait revenir en-dessous des 100 % au cours du 4e trimestre. Au 1er trimestre 1995, la dette publique représentait 56 % du PIB.
À la fin du troisième trimestre, la dette publique de Maastricht s’élève à 2 415,1 milliards d’euros en hausse de 39,6 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. La dette publique nette augmente plus modérément (+15,0 milliards d’euros) et s’établit à 90,3 % du PIB.
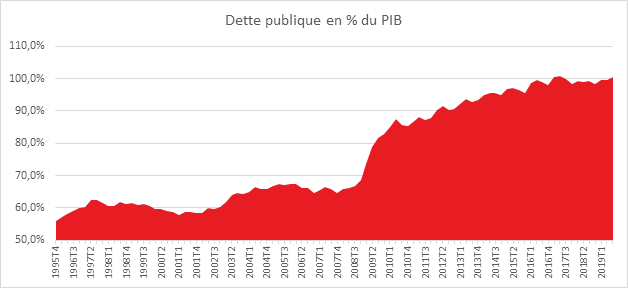
Réforme des retraites, poursuite des négociations, ouvertures, avancées et blocages
Après les rencontres avec les partenaires sociaux des 18 et 19 décembre, le Premier Ministre a fait une déclaration à la presse dans laquelle il récapitule les avancées, les blocages et les discussions à venir. Sur plusieurs chantiers, il a précisé et amendé les propositions énoncées devant le Conseil Economique, Social et Environnemental le 11 décembre dernier.
Le Premier Ministre a tenu à rappeler son engagement de mettre à l’équilibre le système de retraite d’ici 2027, soit un peu plus tard que ce qui était initialement prévu. Il a, à ce sujet, mentionné qu’il faudrait accepter de travailler un peu plus pour atteindre cet équilibre. Il a rappelé que « ni le président de la République ni moi-même, ni aucun des ministres du gouvernement ne voulons annoncer les bonnes nouvelles en renvoyant les additions à plus tard. Sur l’âge d’équilibre, il laisse laissait le soin aux partenaires sociaux de faire des propositions . A défaut de solution alternative, le Gouvernement appliquerait le concept d’âge d’équilibre. A ce titre, il a rappelé que si ce dispositif entraînerait un départ plus tardif pour certains, cela aurait pour d’autre comme conséquence de pouvoir partir plus tôt. Dans le système actuel, certains actifs doivent attendre 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il a souligné que son système de bonus malus se rapprochait de celui de l’AGIRC/ARRCCO mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2019 par les partenaires sociaux. Au sujet de l’augmentation des cotisations, il n’a pas fermé complètement la porte tout en reconnaissant que les marges de manœuvre étaient très étroites.
Le Premier Ministre a indiqué qu’il était prêt à des aménagements sur l’âge d’équilibre afin de tenir compte de la pénibilité, des carrières longues ou du handicap. Une individualisation de l’âge de départ à la retraite à taux plein serait ainsi envisagé. Dans le dispositif de l’AGIRC/ARRCO, 40 % des personnes partant à la retraite ne sont pas concernés par le dispositif de bonus/malus temporaire.
Le Premier Ministre a indiqué que le compte de pénibilité pourrait être amélioré avec une meilleure reconnaissance des activités donnant lieu à attribution de points. Le dispositif serait accessible aux fonctions publiques. Des aménagements seraient pris pour les aides soignants et les infirmiers.
Des discussions seront engagées pour une meilleure gestion des fins de carrières, pour l’amélioration des transitions des anciens vers les nouveau système et pour le minimum contributif. Ce dernier pourrait être supérieur à 85 % du SMIC. Au niveau du basculement, des négociations sont prévues en particulier pour les modalités de prise en compte des rémunérations servant au calcul des pensions. Quelle rémunération sera adoptée pour évaluer la règle 75 %. Edouard Philippe a rappelé son intention de revaloriser les traitements du personnel enseignant.
Le Premier Ministre a indiqué sa volonté de supprimer les régimes spéciaux. Pour le régime spécial de la SNCF, la négociation avec les partenaires sociaux et avec la direction aurait débouché sur des avancées notamment sur la question de la transition. L’Unsa-Cheminots a, en contrepartie, promis une pause. Pour la RATP, des « avancées » sont « sur la table » mais n’auraient pas été actées. Il a indiqué que les négociations devaient se poursuivre dans l’industrie électrique et gazière.
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a souligné qu’Edouard Philippe a « montré une volonté de dialogue ». Il a aussi reconnu des ouvertures, tout en redisant que « la recherche de l’équilibre à court terme est un point dur ». « La réforme paramétrique est pour 2022. Nous, on veut inverser la tendance », a-t-il ajouté. La CFDT participera à tous les chantiers de discussions, sans s’interdire de mobiliser à nouveau en janvier.
La CGT et FO maintiennent leur hostilité au régime par points et ont appelé à une journée interprofessionnelle d’action le 9 janvier prochain.
276 000 euros, le patrimoine moyen des ménages en France
Début 2018, le patrimoine brut (sans prendre en compte les remboursements des emprunts) moyen des ménages français s’élève à 276 000 euros, en augmentation de 2,6 % par rapport à début 2015. Le patrimoine net moyen des ménages s’élève quant à lui à 239 900 euros. Le patrimoine médian brut (patrimoine brut partageant en deux parts égale les ménages) est de 163 100 euros, le patrimoine net médian étant de 117 000 euros. Cela signifie que 50 %des ménages disposent d’un patrimoine inférieur à 117 000 euros.
Début 2018, le patrimoine brut des ménages est majoritairement constitué de biens immobiliers (61 %). Cette part du patrimoine immobilier est stable depuis 2004. 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en France (qu’ils aient ou non terminé d’en rembourser l’achat). 84 % de la valeur du patrimoine immobilier des ménages est constituée par la résidence principale. Les propriétaires et les accédants à la propriété de leur résidence principale disposent ainsi d’un patrimoine brut moyen 7 fois plus élevé que celui des locataires et des personnes logées gratuitement.
Le patrimoine financier représente 20 % du patrimoine brut. Quasiment tous les ménages en possèdent, mais les actifs financiers et les montants associés sont très différents selon le niveau de patrimoine.
Le patrimoine résiduel (voiture, équipement de la maison, bijoux, œuvres d’art, etc.) constitue 8 % du patrimoine. Cette composante est majeure dans le patrimoine des ménages les plus modestes. Elle représente 71 % du patrimoine total des 10 % des ménages les moins dotés. Ceux-ci ne détiennent en effet quasiment pas de patrimoine immobilier. Le patrimoine professionnel représente 11 % du patrimoine brut. Il est surtout détenu par les ménages les mieux dotés.
Les sexagénaires sont les mieux dotés
Sans surprise, le patrimoine varie en fonction de l’âge. Le patrimoine net moyen passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires. Pour les ménages avec une période de référence de plus de 70 ans, le montant moyen de patrimoine est de 305 500 euros. Avant 2010, une diminution du patrimoine était constatée dès la soixantaine ; désormais, elle intervient après 70 ans. Cette baisse de patrimoine était aussi observée pour les sexagénaires alors qu’elle ne concerne plus que les ménages de plus de 70 ans depuis le début de la décennie.
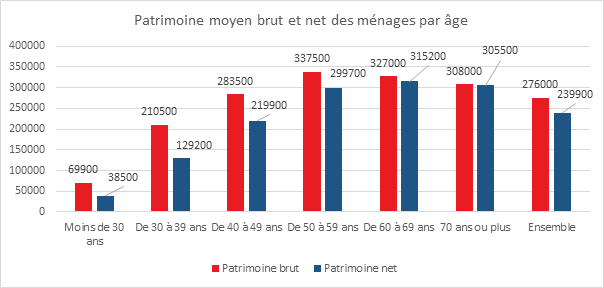
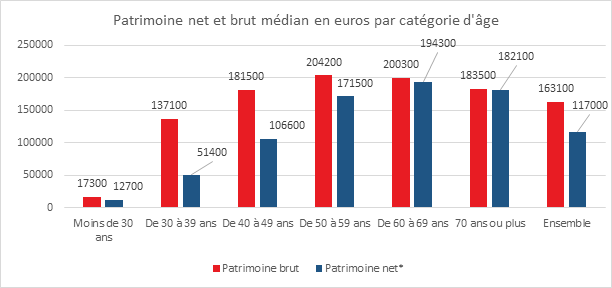
Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans du fait des emprunts qu’ils ont contractés pour l’achat de leur résidence détiennent un patrimoine brut près de deux fois supérieur à leur patrimoine net (69 900 euros contre 38 500 euros). Dans cette tranche d’âge, 91 % des ménages propriétaires de leur résidence principale sont accédants à la propriété et ont un emprunt. Pour les ménages les plus âgés, le patrimoine brut est quasiment à hauteur du patrimoine net, seuls 2 % des ménages propriétaires étant accédants à la propriété de leur résidence principale.
De manière générale, jusqu’à 60 ans, le montant du patrimoine immobilier détenu croît avec l’âge de la personne de référence, puis décroît légèrement ensuite. En revanche, le patrimoine financier progresse continûment au cours du cycle de vie.
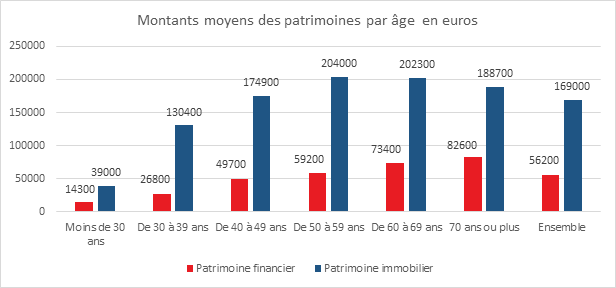
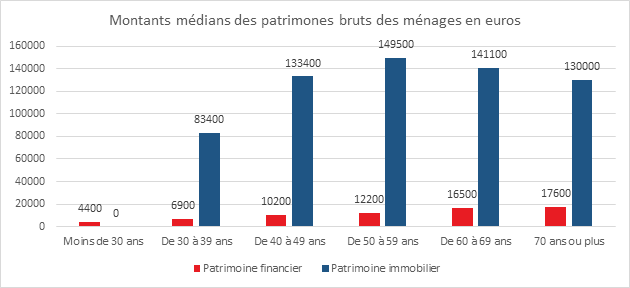
Des écarts de patrimoine plus importants qu’en matière de revenus
La moitié des ménages déclarent un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros. Les 10 % de ménages les mieux dotés en patrimoine brut disposent d’au moins 607 700 euros d’actifs alors que les 10 % les plus modestes possèdent au maximum 3 800 euros chacun, soit 160 fois moins ; les 1 % de ménages les plus dotés possèdent au moins 1 941 600 euros de patrimoine brut.
Les inégalités de patrimoine sont plus marquées que celles des revenus. En 2017, le rapport interdécile est de 4,6, c’est-à-dire que le revenu maximal des 10 % de ménages les plus modestes est 4,6 fois moins élevé que le revenu minimum des 10 % les plus aisés. Les inégalités de patrimoine brut sont stables entre 2015 et 2018. Après avoir fortement augmenté entre 2004 et 2010, puis légèrement diminué entre 2010 et 2015, l’indice de Gini est stable entre 2015 et 2018 et s’établit, début 2018, à 0,637, contre 0,635 début 2015. L’évolution des dernières années est fonction des valorisations des actifs et des revenus qu’ils génèrent. La crise de 2008/2009 ainsi que la baisse des taux qui s’en est suivi pèsent sur le rendement des produits de taux. Si les prix de l’immobilier, après une petite baisse entre 2008 et 2012, sont, depuis, orientés à la hausse, la valeur des actions connait d’amples fluctuations.
Début 2018, la moitié la mieux dotée des ménages vivant en France possédait 92 % de du patrimoine total des ménages. Les 5 % les mieux dotés en détenaient un tiers et les 1 % les mieux dotés, 16 %. Cette répartition du patrimoine brut est stable depuis 2015.
Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Ils en détiennent une partie importante dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).
La concentration du patrimoine est encore plus nette pour la composante financière.. Les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine financier en détiennent plus de la moitié et 1 % des ménages en possèdent 31 %. Par comparaison, les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine immobilier détiennent 28 % du patrimoine immobilier total.
Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Ils en détiennent une partie importante dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).
Le taux du Livret A pourrait baisser à 0,5 % le 1er février 2020
Le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau a indiqué mercredi 18 décembre à BFM que le taux du Livret pourrait baisser l’année française. Il a ainsi déclaré qu' »il y a une formule qui est fixée, maintenant, en fonction du taux d’inflation et des taux d’intérêt, cette formule, début février, pourrait donner un taux de 0,5%. Donc il reste positif, sauf s’il y a des circonstances exceptionnelles. (…) Aujourd’hui, il ne me semble pas qu’il y ait de raison d’invoquer des circonstances exceptionnelles ». Selon la formule, le taux du Livret A est égal à la moyenne de l’inflation des douze derniers mois et des taux constatés sur les titres du marché interbancaire à 3 mois. Actuellement, le taux d »inflation est de 1,1 % et ceux des titres à 3 mois de -0,395. la moyenne est donc de 0,35 % mais comme un plancher a été fixé à 0,5 %, c’est ce dernier taux qui pourrait être retenu.
Dans le passé, à plusieurs reprises, la formule de fixation des taux n’a pas été appliquée. La proximité des élections municipales pourrait inciter à différer cette baisse.
taux de rémunération du Livret A
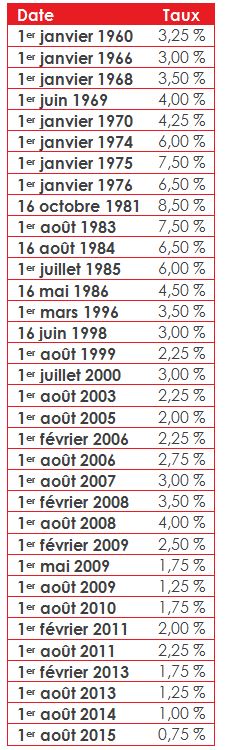
Réforme des retraites
Le député Laurent Pietraszewski nommé secrétaire d’Etat chargé des retraites pour remplacer Jean-Paul Delevoye
Le député Laurent Pietraszewsk aété nommé secrétaire d’Etat chargé des retraites en remplacement du Haut Commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye. Laurent Pietraszewski, 53 ans, était destiné, en tant que député, à être le rapporteur du projet de réforme des retraites lors de son examen au Parlement prévu en février.
Le Coin de l’Agenda
Lundi 16 décembre
En Chine, il faudra regarder la production industrielle, les ventes au détail et l’investissement et les prix immobiliers de novembre.
Aux États-Unis, il faudra suivre l’indice manufacturier « Empire state » et l’indice NABB du marché immobilier de décembre.
Mardi 17 décembre
En France, sera rendue publique la note de conjoncture de l’INSEE.
Pour l’Union européenne, seront publiées les immatriculations automobiles de novembre. Sera également rendue publique le résultat de la balance commerciale en zone euro d’octobre.
Pour le Royaume-Uni, il faudra suivre le nombre de demandeurs d’emploi, le taux de chômage, et les salaires de novembre.
Pour les États-Unis, seront communiquées les mises en chantier, le permis de construire et la production industrielle de novembre.
Mercredi 18 décembre
Au Japon, il faudra suivre le résultat de la balance commerciale de novembre et la réunion de politique monétaire de la banque centrale.
Pour l’Allemagne, il faudra regarder l’indice Ifo du climat des affaires de décembre.
Pour le Royaume-Uni, sera connu le taux d’inflation de novembre.
Pour la zone euro, sera attendu le taux d’inflation (définitif) de novembre.
Jeudi 19 décembre
En France, les enquêtes de conjoncture de l’INSEE de décembre seront communiquées.
Pour le Japon, il faudra suivre les décisions de politique monétaire de la banque centrale.
Pour le Royaume-Uni, seront publiés les ventes au détail de novembre et le communiqué de politique monétaire de la Banque d’Angleterre.
Aux États-Unis, seront connus les inscriptions au chômage de semaine au 14 décembre, l’indice d’activité « Philly Fed » de décembre et les reventes de logements de novembre.
Vendredi 20 décembre
En France, les dépenses de consommation des ménages en biens de novembre seront publiées.
Au Japon, sera connu le taux d’inflation de novembre.
Au Royaume-Uni, il faudra regarder le taux de croissance du PIB du troisième trimestre (valeur révisée).
Aux États-Unis, le taux de croissance définitif du troisième trimestre sera connu. Seront communiqués les revenus et les dépenses des ménages de novembre, l’indice de confiance du consommateur de l’université du Michigan (définitif) de décembre.
Lundi 23 décembre
Les indices PMI Markit flash de décembre seront publiés pour l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, et la zone euro.
Aux États-Unis, il faudra suivre les ventes de logements neufs de novembre.
Mardi 24 décembre
Clôture anticipée des marchés financiers pour raison de fête de Noël.
Aux États-Unis, seront publiées les commandes de biens durables de novembre.
Mercredi 25 décembre
Marchés fermés en Europe et aux États-Unis (noël)
Jeudi 26 décembre
Marchés fermés pour Euronext, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Aux États-Unis, seront publiées les inscriptions au chômage de la semaine au 21 Décembre.
Vendredi 27 décembre
En Chine, seront connus les bénéfices dans l’industrie de novembre.
En France, il faudra suivre la construction de logements de novembre.
Lundi 30 décembre
En Allemagne, il faudra regarder les ventes au détail de novembre.
Aux États-Unis, les promesses de vente immobilières de novembre seront rendues publiques.
Mardi 31 décembre
Marchés fermés au Japon, en Allemagne.
Clôture anticipée à la bourse de Londres et pour Euronext
En Chine, seront publiés les indices PMI officiels de décembre.
Un vendredi 13 qui réussit aux marchés
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 13 décembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 919,02 | +0,80 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 28 135,38 | +0,43 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 734,88 | +0,91 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 282,72 | +0,88 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 353,44 | +1,37 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 692,34 | -0,30 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 24 023,10 | +2,86 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 967,68 | +1,91 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,001 % | -0,030 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,296% | -0,007 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,826 % | -0,017 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1120 | +0,55 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 474,978 | +1,03 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 65,010 | +1,04 % | 52,973 |
En avant pour le Brexit et l’accord sino-américain
La large victoire des Conservateurs aux élections législatives ouvre la voie pour une sortie négociée du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les investisseurs redoutant une Chambre des Communes se sont félicités de cette victoire sans appel. Au-delà des considérations d’ordre politique et des craintes qu’inspirait le programme travailliste, les marchés jugent désormais de tourner la page. La fin supposée de l’hypothèque britannique s’est accompagnée de l’annonce d’un accord entre les Etats-Unis et la Chine.
Vendredi 13 décembre, la Chine a indiqué avoir conclu un accord commercial de phase 1 avec les Etats-Unis. Les surtaxes douanières prévues pour le 15 décembre ne rentreront pas en vigueur et celles déjà en application seront, de manière graduelle, supprimées. Dans le détail, les taxes imposées en septembre seront réduites de moitié (elles passeront de 15 à 7,5 % sur 110 milliards de dollars d’importations). En revanche, les taxes de 25 % sur une tranche de 250 milliards de dollars d’importations seront maintenues. Les autorités chinoises ont promis d’augmenter les importations de produits américains, notamment agricoles. Pour le moment, le montant n’a pas été précisé pour l’instant. Donald Trump a confirmé l’accord sur Twitter en indiquant les négociations pour la phase 2 seront prochainement engagées. Aucune date de rencontre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping n’a été annoncée.
Ces bonnes nouvelles ont porté les indices à la hausse. Ainsi le CAC 40 a dépassé la barre de 5 900 points. Le gain depuis le début de l’année dépasse désormais 25 %.
Les élections britanniques sont riches d’enseignements. Premièrement Boris Johnson dispose d’une large majorité, 365 sièges sur 650 (leur plus large victoire depuis 1987) pour conduire à rythme soutenu le Brexit. Deuxièmement, le revers sans précédent des Travaillistes sonne l’échec personnel de leur responsable Jeremy Corbyn et son programme très à gauche. Le Parti travailliste a enregistré avec ces élections son plus mauvais résultat depuis 1935 (203 sièges). Troisièmement, les Libéraux-Démocrates ont connu également un échec, ils n’obtiendraient que 11 sièges, soit un de moins qu’actuellement, leur ligne pro-européenne n’a pas séduit. Quatrièmement, le Parti National Ecossais (SNP) de Nicolas Sturgeon remporte au moins 55 des 59 sièges en Ecosse, relançant les spéculations sur un nouveau référendum d’indépendance.
Le mandat clair reçu par Boris Johnson permet la mise en œuvre rapide du processus de sortie. La période d’attentisme et de tergiversation a de fortes chances de prendre fin. La levée de l’hypothèque a été saluée sur les marchés avec un redressement de la livre sterling.
Le Royaume-Uni quittera sans doute l’Union européenne d’ici le 31 janvier 2020. Après ce départ, la Commission de Bruxelles sera amenée à négocier un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni d’ici à la fin de l’année prochaine. Cette période de transition sera peut-être prolongée jusqu’en décembre 2022 afin de fixer les règles précises des échanges entre les deux entités. Fidèle à sa méthode, Boris Johnson souhaite que ces négociations s’achèvent avant le mois de décembre 2020.
Quand la croissance des crédits à l’habitat ne porte pas l’immobilier
Le taux de croissance des crédits des ménages, en France, a, en 2019, atteint 6 % en rythme annuel. Fort logiquement, cette progression est liée aux taux d’intérêt bas en vigueur depuis 2010. Les taux des crédits à taux fixe des ménages sont passés en dix ans de 4 à 1 %.
Les autorités s’inquiètent des effets de l’augmentation de l’encours des crédits à l’habitat des ménages. Il s’élevait à 1066 milliards d’euros au mois d’octobre 2019 contre 650 milliards d’euros en octobre 2009. La progression du crédit s’accompagne d’une forte hausse des prix de l’immobilier et d’une baisse des mises en chantier. Cette situation génère un déséquilibre croissant sur le marché pouvant amener à la constitution d’une bulle. Pour le moment, à la différence des années 84/87 et 1990/1993, l’envolée des prix n’est pas purement spéculative. La demande en biens immobiliers est portée par le métropolisation du territoire. Les prix de l’immobilier augmentent essentiellement dans les grandes agglomérations. La demande est également vive sur le littoral atlantique et en Corse du fait de l’installation sur ces territoires de nombreux retraités. ;
Face à cette hausse rapide du crédit, les autorités ont décidé de renforcer le coussin contracyclique de fonds propres afin de la limiter. Jeudi 12 décembre, le Haut Conseil a recommandé aux banques de respecter un taux d’effort pour l’octroi de crédit d’au maximum 33 % du revenu net de l’emprunteur. Les banques conditionnent traditionnellement l’octroi d’un prêt au fait que le poids du remboursement ne dépasse pas un tiers des revenus de l’emprunteur, mais dans 28 % des prêts accordés, cette règle tacite ne serait pas respectée. Le Haut Conseil préconise de limiter la durée de crédit à 25 ans. Depuis des mois, en raison de l’augmentation des prix de l’immobilier de la baisse des taux, la durée moyenne des prêts a augmenté de 31 mois. Jusqu’à 15 % de la production pourrait s’écarter du strict respect de ces critères dont les trois quarts réservés exclusivement aux primo-accédants et aux acquéreurs de leur résidence principale, dans la limite d’un endettement inférieur à sept années de revenus,
La France n’est pas la seule à connaître une forte hausse des crédits des ménages avec hausse des prix et baisse des mises en chantier. Sur le plan des prix, leur augmentation est, entre 2010 et 2019, plus importante aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Belgique. Elle est plus faible en Italie, en Grèce ou en Espagne. Pour les mises en chantier, la France est dans la moyenne basse de l’OCDE avec la Belgique, la Suède ou l’Allemagne. En revanche, en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce, la baisse y est plus bien marquée. A la différence des autres pays latins, la France n’a pas été confrontée directement à la crise des dette souveraines entre 2011 et 2015. Par ailleurs, sa croissance démographique devrait conduire à une augmentation des mises en chantier. Le coût élevé du foncier, les règles d’urbanisme, les règles locatives, la fiscalité expliquent en partie cette anomalie française.
L’essor du crédit-bail en France
En 2018, les investissements nouveaux financés par crédit-bail et location avec option d’achat (LOA) ont atteint, selon l’INSEE, 33,6 milliards d’euros. Les particuliers ont porté cette activité avec une croissance des crédits de 26 % (9,5 milliards d’euros). Les investissements nouveaux auprès des entreprises ont été également en hausse en 2018 avec un gain de 7,5 % après +0,9 %. Le volume de crédit-bail s’est pour les entreprises élevé à 24,1 milliards d’euros. Cet essor repose sur la baisse des taux et sur l’amélioration de la conjoncture économique constatée depuis 2017. Le marché automobile a été assez porteur jusqu’au mois d’août 2018 amenant de nombreuses opérations de financement par crédit-bail.
La hausse du crédit-bail mobilier s’explique essentiellement par son recours croissant pour l’acquisition d’automobiles (+18,2 % après +12,9 %). Elle est également assez nette pour les machines et les équipements (+10,8 % après +7,3 %). Ces produits représentent près de 80 % des investissements en crédit-bail mobilier effectués en France. Le crédit-bail immobilier a atteint, en 2018, 4,4 milliards d’euros contre 3,9 en 2017. La progression a concerné le financement des bâtiments (+19,2 %), suivis de celui des terrains (+10,6 %) et de celui des nouveaux contrats de construction et génie civil (+3,9 %). Le crédit-bail immobilier a été très dynamique pour les usines (+22,1 %) ainsi que pour les magasins et commerces (+12,5 %).
La large victoire des Conservateurs aux élections législatives ouvre la voie pour une sortie négociée du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les investisseurs redoutant une Chambre des Communes se sont félicités de cette victoire sans appel. Au-delà des considérations d’ordre politique et des craintes qu’inspirait le programme travailliste, les marchés jugent désormais de tourner la page. La fin supposée de l’hypothèque britannique s’est accompagnée de l’annonce d’un accord entre les Etats-Unis et la Chine.
Vendredi 13 décembre, la Chine a indiqué avoir conclu un accord commercial de phase 1 avec les Etats-Unis. Les surtaxes douanières prévues pour le 15 décembre ne rentreront pas en vigueur et celles déjà en application seront, de manière graduelle, supprimées. Dans le détail, les taxes imposées en septembre seront réduites de moitié (elles passeront de 15 à 7,5 % sur 110 milliards de dollars d’importations). En revanche, les taxes de 25 % sur une tranche de 250 milliards de dollars d’importations seront maintenues. Les autorités chinoises ont promis d’augmenter les importations de produits américains, notamment agricoles. Pour le moment, le montant n’a pas été précisé pour l’instant. Donald Trump a confirmé l’accord sur Twitter en indiquant les négociations pour la phase 2 seront prochainement engagées. Aucune date de rencontre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping n’a été annoncée.
Ces bonnes nouvelles ont porté les indices à la hausse. Ainsi le CAC 40 a dépassé la barre de 5 900 points. Le gain depuis le début de l’année dépasse désormais 25 %.
Les élections britanniques sont riches d’enseignements. Premièrement Boris Johnson dispose d’une large majorité, au moins 362 sièges sur 650 (leur plus large victoire depuis 1987) pour conduire à rythme soutenu le Brexit. Deuxièmement, le revers sans précédent des Travaillistes sonne l’échec personnel de leur responsable Jeremy Corbyn et son programme très à gauche. Le Parti travailliste a enregistré avec ces élections son plus mauvais résultat depuis 1935 (203 sièges). Troisièmement, les Libéraux-Démocrates ont connu également un échec, ils n’obtiendraient que 11 sièges, soit un de moins qu’actuellement, leur ligne pro-européenne n’a pas séduit. Quatrièmement, le Parti National Ecossais (SNP) de Nicolas Sturgeon remporte au moins 55 des 59 sièges en Ecosse, relançant les spéculations sur un nouveau référendum d’indépendance.
Le mandat clair reçu par Boris Johnson permet la mise en œuvre rapide du processus de sortie. La période d’attentisme et de tergiversation a de fortes chances de prendre fin. La levée de l’hypothèque a été saluée sur les marchés avec un redressement de la livre sterling.
Le Royaume-Uni quittera sans doute l’Union européenne d’ici le 31 janvier 2020. Après ce départ, la Commission de Bruxelles sera amenée à négocier un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni d’ici à la fin de l’année prochaine. Cette période de transition sera peut-être prolongée jusqu’en décembre 2022 afin de fixer les règles précises des échanges entre les deux entités. Fidèle à sa méthode, Boris Johnson souhaite que ces négociations s’achèvent avant le mois de décembre 2020.
Quand la croissance des crédits à l’habitat ne porte pas l’immobilier
Le taux de croissance des crédits des ménages, en France, a, en 2019, atteint 6 % en rythme annuel. Fort logiquement, cette progression est liée aux taux d’intérêt bas en vigueur depuis 2010. Les taux des crédits à taux fixe des ménages sont passés en dix ans de 4 à 1 %.
Les autorités s’inquiètent des effets de l’augmentation de l’encours des crédits à l’habitat des ménages. Il s’élevait à 1066 milliards d’euros au mois d’octobre 2019 contre 650 milliards d’euros en octobre 2009. La progression du crédit s’accompagne d’une forte des prix de l’immobilier et d’une baisse des mises en chantier. Cette situation génère un déséquilibre croissant sur le marché pouvant amener à la constitution d’une bulle. Pour le moment, à la différence des années 84/87 et 1990/1993, l’envolée des prix n’est pas purement spéculative. La demande en biens immobiliers est portée par le métropolisation du territoire. Les prix de l’immobilier augmentent essentiellement dans les grandes agglomérations. La demande est également vive sur le littoral atlantique et en Corse du fait de l’installation sur ces territoires de nombreux retraités. ;
Face à cette hausse rapide du crédit, les autorités ont décidé de renforcer le coussin contracyclique de fonds propres afin de la limiter. Jeudi 12 décembre, le Haut Conseil a recommandé aux banques de respecter un taux d’effort pour l’octroi de crédit d’au maximum 33 % du revenu net de l’emprunteur. Les banques conditionnent traditionnellement l’octroi d’un prêt au fait que le poids du remboursement ne dépasse pas un tiers des revenus de l’emprunteur, mais dans 28 % des prêts accordés, cette règle tacite ne serait pas respectée. Le Haut Conseil préconise de limiter la durée de crédit à 25 ans. Depuis des mois, en raison de l’augmentation des prix de l’immobilier de la baisse des taux, la durée moyenne des prêts a augmenté de 31 mois. Jusqu’à 15 % de la production pourrait s’écarter du strict respect de ces critères dont les trois quarts réservés exclusivement aux primo-accédants et aux acquéreurs de leur résidence principale, dans la limite d’un endettement inférieur à sept années de revenus,
La France n’est pas la seule à connaître une forte hausse des crédits des ménages avec hausse des prix et baisse des mises en chantier. Sur le plan des prix, leur augmentation est, entre 2010 et 2019, plus importante aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Belgique. Elle est plus faible en Italie, en Grèce ou en Espagne. Pour les mises en chantier, la France est dans la moyenne basse de l’OCDE avec la Belgique, la Suède ou l’Allemagne. En revanche, en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce, la baisse y est plus bien marquée. A la différence des autres pays latins, la France n’a pas été confrontée directement à la crise des dette souveraines entre 2011 et 2015. Par ailleurs, sa croissance démographique devrait conduire à une augmentation des mises en chantier. Des facteurs liés à l’immobilier explique les déséquilibres constatés en France. Le coût élevé du foncier, les règles d’urbanisme, les règles locatives, la fiscalité expliquent en partie cette anomalie française.
L’essor du crédit-bail en France
En 2018, les investissements nouveaux financés par crédit-bail et location avec option d’achat (LOA) ont atteint, selon l’INSEE, 33,6 milliards d’euros. Les particuliers ont porté cette activité avec une croissance des crédits de 26 % (9,5 milliards d’euros). Les investissements nouveaux auprès des entreprises ont été également en hausse en 2018 avec un gain de 7,5 % après +0,9 %. Le volume de crédit-bail s’est pour les entreprises élevé à 24,1 milliards d’euros. Cet essor repose sur la baisse des taux et sur l’amélioration de la conjoncture économique constatée depuis 2017. Le marché automobile a été assez porteur jusqu’au mois d’août 2018 amenant de nombreuses opérations de financement par crédit-bail.
La hausse du crédit-bail mobilier s’explique essentiellement par son recours croissant pour l’acquisition d’automobiles (+18,2 % après +12,9 %). Elle est également assez nette pour les machines et les équipements (+10,8 % après +7,3 %). Ces produits représentent près de 80 % des investissements en crédit-bail mobilier effectués en France. Le crédit-bail immobilier a atteint, en 2018, 4,4 milliards d’euros contre 3,9 en 2017. La progression a concerné le financement des bâtiments (+19,2 %), suivis de celui des terrains (+10,6 %) et de celui des nouveaux contrats de construction et génie civil (+3,9 %). Le crédit-bail immobilier a été très dynamique pour les usines (+22,1 %) ainsi que pour les magasins et commerces (+12,5 %).
Réformes des retraites, les grandes lignes du futur projet de loi présentées par le Premier Ministre le 10 décembre 2019
La réforme des retraites
Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a dévoilé mercredi 11 décembre les grandes lignes du futur de projet de loi de réforme des retraites. Ce dernier devrait être présenté le 22 janvier prochain en vue d’une discussion, à partir de la fin du mois de février, au Parlement. Cela signifie que celle-ci commencera avant les élections municipales, l’adoption définitive du texte n’intervenant qu’après. Compte tenu de l’examen obligatoire du Conseil d’Etat avant la présentation du projet de loi en Conseil des Ministres, le texte devrait être finalisé dans les prochains jours.
Avec son intervention au Conseil Economique, Social et Environnemental ainsi qu’avec celle aux 20 heures deTF1, le Premier Ministre a, souhaité, après une semaine de grève dans les transports publics, reprendre la main en s’attelant en priorité à préciser les dates d’entrée de la réforme et à proposer des voies de discussion au sein de la fonction publique. Il a été, plus elliptique au sujet des régimes spéciaux. Ce choix est certainement dicté par la volonté d’éviter une cristallisation des oppositions. En-dehors des dates d’entrée de la réforme, il a retenu les propositions de Jean-Paul Delevoye. Il a ainsi réaffirmé son souhait d’imposer un âge d’équilibre pour le système universel à 64 ans.
Sans surprise et comme lors des précédentes réformes, le Premier Ministre a commencé son intervention en répétant l’attachement indéfectible de la nation au régime par répartition. Il a inscrit sa démarche dans le prolongement de celle des pères fondateurs de la Sécurité sociale. Il a précisé que la refondation de la couverture retraite est devenue indispensable afin, à ses yeux, de « corriger les injustices » et d’adapter le système « aux nouvelles trajectoires de carrière ».
Les générations concernées
Le Premier Ministre a décalé de 1963 à 1975 l’année de la première génération qui serait concernée par la réforme. De ce fait, ce n’est qu’à partir de 2037 que partiront les premiers retraités ayant une partie de leur pension issue du régime universel. La génération 2004 sera la première à être intégralement concernée par le régime universel par points. Les générations se situant entre 1975 et 2004 disposeront de pensions calculées selon les anciennes et les nouvelles bases. La génération 75, qui prendra sa retraite vers 2037, aura 70 % de sa retraite calculée selon l’ancien système et 30 % dans le nouveau.
Ce lissage a pour objectif de sortir du débat de la clause du grand père. Les actifs âgés de plus de 44 ans sont de fait exclus de la réforme, soit plus 15 millions d’actifs sur un total de 30 millions. Conséquence de ce report, le Premier Ministre (né en 1970) échappe à la réforme mais pas Emmanuel Macron (né en 1977).
Les fonctions publiques, revalorisation des rémunération et prise en compte de la pénibilité
Le Premier Ministre s’est engagé à maintenir le niveau des pensions des enseignants. Cette garantie sera fixée par la loi. Avant la fin du quinquennat, des revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions seront prévues avec un début d’application dès 2021.
Au niveau de la fonction publique hospitalière, le Gouvernement adaptera les seuils sur la reconnaissance de la pénibilité liée au travail de nuit, en lien avec la réalité de leur rythme de travail effectif. Cela permettra à près d’un quart des aides-soignantes à l’hôpital de partir plus tôt à la retraite. Un nouveau dispositif permettant le financement d’un temps partiel sans perte de revenu en fin de carrière pour les aides-soignantes qui le solliciteraient sera institué.
Les régimes spéciaux, du temps au temps
S’agissant des régimes spéciaux ou de ceux qui ont des âges dérogatoires, le Premier Ministre a indiqué que des dispositions spécifiques seront prises pour adapter les âges de départ à la retraite et le chemin de convergence des dits régimes. Il a admis à demi-mot le principe de la clause du grand père pour la SNCF en faisant référence à la réforme précédente. En 2018, le gouvernement a fait adopter un nouveau cadre pour la SNCF qui prévoit que tous les cheminots embauchés avant le 1er janvier 2020 conservaient leur statut. Or, celui-ci intègre par nature la couverture retraite. Le représentant de la CFDT a demandé l’application de la clause du grand père comme condition sine qua non du retrait de son organisation du mouvement de grève actuel.
Dans tous les cas, la transition sera longue. Avant une éventuelle adoption de la clause du grand père, seuls les salariés nés à partir de 1980 (pour ceux qui liquident leurs droits à 57 ans) et 1985 (pour ceux qui partent à 52 ans) seraient concernés.
Le débat passionnel sur l’âge d’équilibre
Le Premier Ministre a repris à son compte l’introduction d’un âge d’équilibre à 64 ans. Il a privilégié la notion d’âge d’équilibre à celle d’âge pivot. Pour inciter les Français à travailler plus longtemps, un mécanisme de décote et de surcote serait ainsi prévu. L’âge d’équilibre de 64 entrerait en vigueur en 2027. La solution s’apparente à celle mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019 au sein de l’AGIRC/ARRCO. L’âge d’équilibre est le pendant de l’abandon de la durée de cotisation qui est au cœur des régimes par annuité actuellement en vigueur. En cas de durée inférieure, une décote est appliquée et inversement, en cas de dépassent du nombre de trimestres exigé, l’assuré bénéficie d’une surcote. La durée de cotisation est aujourd’hui de 42 ans et devrait atteindre 43 ans pour la génération 1973. L’âge d’entrée sur le marché du travail est, en 2019, en moyenne, de 22 ans, ce qui conduit à un âge de retraite à taux plein de 65 ans. L’âge de 64 ans est un an au-dessus de l’âge effectif de départ au sein du régime général. Selon le Conseil d’Orientation des Retraite, l’atteinte d’un âge de départ à 64 ans est un élément clef pour le bouclage financier du ou des régimes de retraite. Dans un système par points, la tentation des assurés pourrait être de partir dès 62 ans ce qui pourrait générer tout à la fois un surcroît de dépenses et le versement de petites pensions. En Suède, les autorités confrontées à la grogne des retraités ayant de faibles pensions pensent relever l’âge à partir duquel il est possible de liquider ses droits. Pour compenser cet âge d’équilibre, le Premier Ministre a affirmé que la pénibilité au travail serait mieux prise en compte, en particulier pour les personnes qui sont en service la nuit. Le dispositif de carrière longue qui permet à ceux qui ont commencé tôt de partir avant l’âge légal serait adapté au régime par points. Ainsi, les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, pourront continuer de partir deux ans avant les autres tout comme les personnes qui exercent des métiers usants. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l’hôpital. Le seuil du travail de nuit, afin que davantage d’agents puissent bénéficier d’un départ anticipé.
La valeur du point
Edouard Philippe a indiqué que « la loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point ». Il a précisé que les partenaires sociaux seront appelés à fixer la valeur du point et son évolution, sous le contrôle du Parlement. Il a retenu le principe d’une indexation du point en fonction du salaire et non des prix, ce qui est un gage de maintien du niveau de vie.
Un minimum de pension fixé à 85 % du SMIC
Comme cela avait été mentionné dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, la pension minimale est fixée pour les assurés à 85 % du SMIC, soit 1000 euros en 2019.
Mesures en faveur des femmes et des familles
Le Premier Ministre a prévu que les ménages ayant au moins trois enfants bénéficient d’un dispositif spécifique de revalorisation de pension. Au-delà des 5% par enfant prévu par le rapport Delevoye, les parents de plus de trois enfants auraient le droit à une majoration de 2 % supplémentaires. Le rapport de Jean-Paul Delevoye prévoyait, en effet, qu’une majoration de pension de 5 % soit accordée dès le premier enfant à la mère sauf choix contraire des parents. Les familles de 3 enfants perdaient, en contrepartie, la majoration de 10 % applicable à toutes les pensions. Le nouveau système se révélait ainsi moins généreux pour cette catégorie de la population.
Le Premier Ministre a annoncé que les femmes qui choisiraient d’arrêter de travailler pour élever leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans à partir du 3e bénéficieraient de de l’assurance vieillesse.
Edouard Philippe a également confirmé que le système de réversion garantira au conjoint survivant 70 % des ressources du couple.
Les professions libérales, une convergence sur 15 ans des taux de cotisation
Pour les professions libérales, le Premier Ministre a indiqué que la convergence des cotisations serait progressive avec un horizon fixé à 15 ans. Pour les réserves, il a rappelé les préconisations de Jean-Paul Delevoye. Ce dernier avait mentionné que les caisses des professionnels concernés pourraient les conserver (en partie ou pas, le Premier Ministre n’a rien dit sur le sujet) pour accompagner la transition vers le système universel. Cela concernerait les auxiliaires médicaux, avocats, et les médecins concernés. Le Premier Ministre a annoncé qu’il n’y aurait « pas d’hold-up, pas de siphonnage pour combler tel ou tel trou, tel ou tel déficit ».
Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a dévoilé mercredi 11 décembre les grandes lignes du futur de projet de loi de réforme des retraites. Ce dernier devrait être présenté le 22 janvier prochain en vue d’une discussion au Parlement prévue pour la fin du mois de février. Cela signifie que celle-ci commencera avant les élections municipales, l’adoption définitive du texte n’intervenant qu’après. Compte tenu de l’examen obligatoire du Conseil d’Etat avant présentation du projet de loi en Conseil des Ministres, le texte devrait être finalisé dans les prochains jours. Compte tenu des éléments encore ouverts à la négociation, l’option d’un projet de loi cadre avec des renvois à des textes ultérieurs est fort probable.
Avec son intervention au Conseil Economique, Social et Environnemental ainsi qu’à TF1 le mercredi 10 décembre, le Premier Ministre a devant la situation de blocage matérialisée par la grève des transports publics, souhaité reprendre la main en s’attelant en priorité à préciser les modalités concernant la fonction publique. Il a été, plus elliptique au sujet des régimes spéciaux. Ce choix est dicté par la voté de distinguer les problèmes et d’éviter une cristallisation des oppositions. L’absence de sortie de crise rapide avec les syndicats des transports publics peut également expliquer ce choix. Sur le terrain de l’âge de départ à la retraite, le Premier Ministre a réaffirmé sa volonté d’imposer un âge pivot de 64 ans.
Sans surprise et comme lors des précédentes réformes, le Premier Ministre a réaffirmé l’attachement indéfectible de la nation au régime par répartition. Il a rattaché sont projet dans le prolongement des travaux du Conseil national de la résistance. La refondation de la couverture retraite est devenue indispensable afin, à ses yeux, de « corriger les injustices » et d’adapter le système « aux nouvelles trajectoires de carrière ».
Les générations concernées
Le Premier Ministre a décalé de 1963 à 1975 l’année de la première génération qui serait concernée. De ce fait, ce n’est qu’à partir de 2037 que partiront les premiers retraités ayant une partie de leur pension issue du régime universel. La génération 2004 sera la première à être intégralement concernés par le régime universel par points. Les générations se situant entre 1975 et 2004 disposeront de pensions calculées selon les anciennes bases et de pension issue du nouveau système. Pour les anciennes règles, cela concerne toute la partie de la carrière effectuée avant 2025. La génération 75, qui prendra sa retraite vers 2037, aura 70 % de sa retraite calculée selon l’ancien système et 30 % dans le nouveau.
Ce lissage a pour objectif de sortir du débat de la clause du grand père. Les actifs âgés de plus de 44 ans sont de fait exclus de la réforme, soit plus 15 millions d’actifs sur un total de 30 millions. Conséquence de ce report, le Premier Ministre (né en 1970) échappe à la réforme mais pas Emmanuel Macron (né en 1977).
Les fonctions publiques, revalorisation des rémunération et prise en compte de la pénibilité
Le Premier Ministre s’est engagé à maintenir le niveau des pensions des enseignants. Cette garantie sera fixée par la loi. A cette fin, avant la fin du quinquennat des revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions seront prévues. Avec un début d’application dès 2021.
Au niveau de la fonction publique hospitalière, il a annoncé que le Gouvernement adaptera les seuils sur la reconnaissance de la pénibilité liée au travail de nuit, en lien avec la réalité de leur rythme de travail effectif. Cela permettra à près d’un quart des aides-soignantes à l’hôpital de partir plus tôt à la retraite. Un nouveau dispositif permettant le financement d’un temps partiel sans perte de revenu en fin de carrière pour les aides-soignantes qui le solliciteraient sera institué.
Les régimes spéciaux, du temps au temps
S’agissant des régimes spéciaux ou de ceux qui ont des âges dérogatoires, le Premier Ministre a indiqué que des dispositions spécifiques seront prises pour adapter les âges de départ à la retraite et le chemin de convergence. Il a admis à demi-mot le principe de la clause du grand père pour la SNCF en faisant référence à la réforme précédente.
Dans tous les cas, la transition sera longue. Seuls les salariés nés à partir de 1980 (pour ceux qui liquident leurs droits à 57 ans) et 1985 (pour ceux qui partent à 52 ans) seraient concernés. Dans le cadre de la négociation, il est fort probable que la clause du grand père s’impose pour les régimes spéciaux. En 2018, le gouvernement a fait adopter un nouveau cadre pour la SNCF qui prévoit que tous les cheminots embauchés avant le 1er janvier 2020 conservaient leur statut. Or, celui-ci intègre par nature la couverture retraite. Le représentant de la CFDT a demandé l’application de la clause du grand père comme condition sine qua non du retrait de son organisation du mouvement de grève actuel.
Le débat passionnel sur l’âge d’équilibre
Le Premier Ministre a repris à son compte que l’âge souhaitable pour le départ à la retraite était d’au moins 64 ans. Il n’a pas évoqué le concept d’âge pivot mais celui d’âge d’équilibre. Pour inciter les Français à travailler plus longtemps, un mécanisme de décote et de surcote. L’âge d’équilibre de 64 entrerait en vigueur en 2027. La solution s’apparente à celle mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019 au sein de l’AGIRC/ARRCO. L’âge d’équilibre est le pendant de l’abandon de la durée de cotisation qui est au cœur des régimes par annuité actuellement en vigueur. En cas de durée inférieure, une décote est appliquée et inversement, en cas de dépassent du nombre de trimestres exigé, l’assuré bénéficie d’une surcote. La durée est aujourd’hui de 42 ans et devrait atteindre 43 ans pour la génération 1973. L’âge d’entrée sur le marché du travail est, en moyenne, de 22 ans, ce qui conduit à terme à un âge de retraite à taux plein de 65 ans. L’âge de 64 ans est un an au-dessus de l’âge effectif de départ au sein du régime général. Selon le Conseil d’Orientation des Retraite, l’atteinte d’un âge de départ à 64 ans est un élément clef pour le bouclage financier du ou des régimes de retraite. Dans un système par points, la tentation des assurés pourrait être de partir dès 62 ans ce qui pourrait générer tout à la fois un surcroît de dépenses et le versement de petites pensions. En Suède, les autorités confrontées à la grogne des retraités à faibles pensions pensent relever l’âge à partir duquel il est possible de liquider ses droits. La CFDT a répété son hostilité à cet âge pivot à 64 ans. Pour adresser un geste de bonne volonté à ce syndicat, le Premier Ministre a affirmé que la pénibilité au travail serait mieux prise en compte, en particulier pour les personnes qui sont en service la nuit. Le dispositif de carrière longue qui permet à ceux qui ont commencé tôt de partir avant l’âge légal serait adapté au régime par points. Ainsi, les personnes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront continuer de partir deux ans avant les autres. Les personnes qui exercent des métiers usants pourront également partir deux années plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l’hôpital. Le seuil du travail de nuit, afin que davantage d’agents puissent bénéficier d’un départ anticipé.
La valeur du point
Edouard Philippe a indiqué que « la loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point ». Il a précisé que les partenaires sociaux seront appelés à fixer la valeur du point et son évolution, sous le contrôle du Parlement. Il a retenu le principe d’une indexation en fonction du salaire et non des prix, ce qui est un gage de maintien du niveau de vie.
Un minimum de pension fixé à 85 % du SMIC
Comme cela avait été mentionné dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, la pension minimale est fixée pour les assurés à 85 % du SMIC, soit 1000 euros en 2019.
Mesures en faveur des femmes et des familles
Le Premier Ministre a prévu que les ménages ayant au moins trois enfants bénéficient d’un dispositif spécifique de revalorisation de pension. Le rapport de Jean-Paul Delevoye prévoit qu’une majoration de pension de 5 % soit accordée dès le premier enfant à la mère sauf choix contraire des parents. Les familles de 3 enfants perdaient la majoration de 10 % applicable à toutes les pensions. Le nouveau système se révélait ainsi moins généreux pour les parents ayant au moins trois enfants. Le Premier Ministre a annoncé que les femmes qui choisiraient d’arrêter de travailler pour élever leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans à partir du 3e bénéficieraient de de l’assurance vieillesse. Au-delà des 5% par enfant prévu, les parents de plus de trois enfants auraient le droit à une majoration de 2 % supplémentaires.
Edouard Philippe a confirmé que le système de réversion garantira au conjoint survivant 70 % des ressources du couple.
Les professions libérales, une convergence sur 15 ans des taux de cotisation
Pour les professions libérales, il a indiqué que la convergence des cotisations serait progressive avec un horizon fixé à 15 ans. Pour les réserv
Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a dévoilé mercredi 11 décembre les grandes lignes du futur de projet de loi de réforme des retraites. Ce dernier devrait être présenté le 22 janvier prochain en vue d’une discussion, à partir de la fin du mois de février, au Parlement. Cela signifie que celle-ci commencera avant les élections municipales, l’adoption définitive du texte n’intervenant qu’après. Compte tenu de l’examen obligatoire du Conseil d’État avant la présentation du projet de loi en Conseil des Ministres, le texte devrait être finalisé d’ici la fin du mois de décembre.
Avec son intervention au Conseil Économique, Social et Environnemental ainsi qu’avec celle aux 20 heures deTF1, le Premier Ministre a, souhaité reprendre la main, après une semaine de grève dans les transports publics, en s’attelant en priorité à préciser les dates d’entrée en vigueur de la réforme et à proposer des voies de discussion au sein de la fonction publique. Il a été, plus elliptique au sujet des régimes spéciaux. Ce choix est certainement dicté par la volonté d’éviter une cristallisation des oppositions. En-dehors des dates d’entrée de la réforme, il a retenu les propositions de Jean-Paul Delevoye. Il a ainsi réaffirmé son souhait d’imposer un âge d’équilibre pour le système universel à 64 ans.
Sans surprise et comme lors des précédentes réformes, le Premier Ministre a commencé son intervention en répétant l’attachement indéfectible de la nation au régime par répartition. Il a inscrit sa démarche dans le prolongement de celle des pères fondateurs de la Sécurité sociale. Il a précisé que la refondation de la couverture retraite est devenue indispensable afin, à ses yeux, de « corriger les injustices » et d’adapter le système « aux nouvelles trajectoires de carrière ».
Les générations concernées
Le Premier Ministre a décalé de 1963 à 1975 l’année de la première génération qui serait concernée par la réforme. De ce fait, ce n’est qu’à partir de 2037 que partiront les premiers retraités ayant une partie de leur pension issue du régime universel. La génération 2004 sera la première à être intégralement concernée par le régime universel par points. Les générations se situant entre 1975 et 2004 disposeront de pensions calculées selon les anciennes et les nouvelles bases. La génération 75, qui prendra sa retraite vers 2037, aura 70 % de sa retraite calculée selon l’ancien système et 30 % dans le nouveau.
Ce lissage a pour objectif de sortir du débat de la clause du grand père. Les actifs âgés de plus de 44 ans sont de fait exclus de la réforme, soit plus 15 millions d’actifs sur un total de 30 millions. Conséquence de ce report, le Premier Ministre (né en 1970) échappe à la réforme mais pas Emmanuel Macron (né en 1977).
Est-ce que celles et ceux qui sont nés après le 1er janvier 1975 seront pénalisés par rapport à ceux nés avant ? Sur le sujet, la réponse est loin d’être unique. Tout dépend des règles de basculements et des situations individuelles.
Fonctions publiques : revalorisation des rémunération et prise en compte de la pénibilité
Le Premier Ministre s’est engagé à maintenir le niveau des pensions des enseignants. Cette garantie sera fixée par la loi. Avant la fin du quinquennat, des revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions seront prévues avec un début d’application dès 2021.
Au niveau de la fonction publique hospitalière, le Gouvernement adaptera les seuils sur la reconnaissance de la pénibilité liée au travail de nuit, en lien avec la réalité de leur rythme de travail effectif. Cela permettra à près d’un quart des aides-soignantes à l’hôpital de partir plus tôt à la retraite. Un nouveau dispositif permettant le financement d’un temps partiel sans perte de revenu en fin de carrière pour les aides-soignantes qui le solliciteraient sera institué.
Régimes spéciaux, laisser du temps au temps
S’agissant des régimes spéciaux ou de ceux qui ont des âges dérogatoires, le Premier Ministre a indiqué que des dispositions spécifiques seront prises pour adapter les âges de départ à la retraite et le chemin de convergence des dits régimes. Il a admis à demi-mot le principe de la clause du grand père pour la SNCF en faisant référence à la réforme précédente. En 2018, le gouvernement a fait adopter un nouveau cadre pour la SNCF qui prévoit que tous les cheminots embauchés avant le 1er janvier 2020 conservaient leur statut. Or, celui-ci intègre par nature la couverture retraite. Le représentant de la CFDT a demandé l’application de la clause du grand père comme condition sine qua non du retrait de son organisation du mouvement de grève actuel.
Dans tous les cas, la transition sera longue. Avant une éventuelle adoption de la clause du grand père, seuls les salariés nés à partir de 1980 (pour ceux qui liquident leurs droits à 57 ans) et 1985 (pour ceux qui partent à 52 ans) seraient concernés.
Le débat passionnel sur l’âge d’équilibre
Le Premier Ministre a repris à son compte l’introduction d’un âge d’équilibre à 64 ans. Il a privilégié la notion d’ « âge d’équilibre » à celle d’« âge pivot ». Pour inciter les Français à travailler plus longtemps, un mécanisme de décote et de surcote serait ainsi prévu. L’âge d’équilibre de 64 ans entrerait en vigueur en 2027. L’introduction serait progressive à partir de 2022. Tous les actifs partant à la retraite au-delà de 2022 sont susceptibles d’être concernés par ce relèvement. Cela concernera les générations nées après 1960. Il est fort à parier que le dispositif d’âge d’équilibre donnera lieu à négociation et à modification et qu’il ne sera pas conservé en l’état. Un report de plusieurs années avec une meilleure prise en compte de la pénibilité est envisageable.
Le concept d’âge d’équilibre s’apparente à celui mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019 au sein de l’AGIRC/ARRCO. L’âge d’équilibre est le pendant de l’abandon de la durée de cotisation qui est au cœur des régimes par annuité actuellement en vigueur. En cas de durée inférieure, une décote est appliquée et inversement, en cas de dépassement du nombre de trimestres exigé, l’assuré bénéficie d’une surcote. La durée de cotisation est aujourd’hui de 42 ans et devrait atteindre 43 ans pour la génération 1973. L’âge d’entrée sur le marché du travail est, en 2019, en moyenne, de 22 ans, ce qui conduit à un âge de retraite à taux plein de 65 ans. L’âge de 64 ans est un an au-dessus de l’âge effectif de départ au sein du régime général. Selon le Conseil d’Orientation des Retraite, l’atteinte d’un âge de départ à 64 ans est un élément clef pour le bouclage financier du ou des régimes de retraite. Dans un système par points, la tentation des assurés pourrait être de partir dès 62 ans ce qui pourrait générer tout à la fois un surcroît de dépenses et le versement de petites pensions. En Suède, les autorités confrontées à la grogne des retraités ayant de faibles pensions pensent relever l’âge à partir duquel il est possible de liquider ses droits. Pour compenser cet âge d’équilibre, le Premier Ministre a affirmé que la pénibilité au travail serait mieux prise en compte, en particulier pour les personnes qui sont en service la nuit. Le dispositif de carrière longue qui permet à ceux qui ont commencé tôt de partir avant l’âge légal serait adapté au régime par points. Ainsi, les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, pourront continuer de partir deux ans avant les autres tout comme les personnes qui exercent des métiers usants. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l’hôpital. Le seuil du travail de nuit sera abaissé , afin que davantage d’agents puissent bénéficier d’un départ anticipé.
La valeur du point
Édouard Philippe a indiqué que « la loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point ». Il a précisé que les partenaires sociaux seront appelés à fixer la valeur du point et son évolution, sous le contrôle du Parlement. Il a retenu le principe d’une indexation du point en fonction du salaire et non des prix, ce qui est un gage de maintien du niveau de vie des retraités.
Un minimum de pension fixé à 85 % du SMIC
Comme cela avait été mentionné dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, la pension minimale est fixée pour les assurés à 85 % du SMIC, soit 1 000 euros en 2019.
Mesures en faveur des femmes et des familles
Le Premier Ministre a prévu que les ménages ayant au moins trois enfants bénéficient d’un dispositif spécifique de revalorisation de pension. Au-delà des 5 % par enfant prévu par le rapport Delevoye, les parents de plus de trois enfants auraient le droit à une majoration de 2 % supplémentaires. De ce fait, un enfant donnerait donc droit à une majoration de 5 %, deux de 10 %, trois de 17 % et quatre de 22 %.
Le rapport de Jean-Paul Delevoye prévoyait, en effet, qu’une majoration de pension de 5 % soit accordée dès le premier enfant à la mère sauf choix contraire des parents. Les familles de 3 enfants perdaient, en contrepartie, la majoration de 10 % applicable à toutes les pensions.
Le Premier Ministre a annoncé que les femmes qui choisiraient d’arrêter de travailler pour élever leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans à partir du troisième bénéficieraient de l’assurance vieillesse.
Édouard Philippe a également confirmé que le système de réversion garantira au conjoint survivant 70 % des ressources du couple.
Les professions libérales, une convergence sur 15 ans des taux de cotisation
Pour les professions libérales, le Premier Ministre a indiqué que la convergence des cotisations serait progressive avec un horizon fixé à 15 ans. Pour les réserves, il a rappelé les préconisations de Jean-Paul Delevoye. Ce dernier avait mentionné que les caisses des professionnels concernés pourraient les conserver (en partie ou pas, le Premier Ministre n’a rien dit sur le sujet) pour accompagner la transition vers le système universel. Cela concernerait les auxiliaires médicaux, les avocats, et les médecins. Le Premier Ministre a annoncé qu’il n’y aurait « pas d’hold-up, pas de siphonnage pour combler tel ou tel trou, tel ou tel déficit ».
La carte des perdants et les gagnants, un jeu complexe
La carte des perdants et des gagnants donne lieu à une polémique sur la fiabilité des simulateurs. Compte tenu du nombre de données à intégrer liées à l’âge, la carrière professionnelle, les charges de famille, l’âge de départ, la réalisation de modèle de calculs des pensions est d’une rare complexité. Il faut intégrer d’importants éléments individuels pour avoir une vision juste du montant potentiel de la retraite. En l’état actuel des informations fournies par l’exécutif, il est difficile de prédire des montants évaluatifs de pension.
Est-ce que les générations nées avant 1975 sont-elles gagnantes et celles nées après les perdantes ? Dans les faits, la barrière de la génération n’est pas aussi nette car les anciennes règles resteront en vigueur pour toutes les années professionnelles accomplies avant 2022. La génération 2004 sera la première à être à 100 % dans le nouveau système.
Le régime par points est favorable aux personnes qui dans l’ancien système avait des emplois dont les rémunérations ne permettaient pas d’acquérir des trimestres. En revanche, il peut pénaliser ceux qui connaissent des ascensions en fin de carrière. Le minimum garanti avantagera ceux qui ont des carrières incomplètes. L’âge d’équilibre favorisera ceux qui étaient contraints d’aller au-delà de cet âge pour avoir une retraite à taux plein. Au-delà de ces considérations, le système dépend évidemment de la valeur donnée au point. Dans le système actuel, le montant de la pension du régime de base et des régimes alignés est conditionné par l’évolution du plafond de la Sécurité sociale fixé chaque année, par les règles d’indexation des salaires de référence et par le nombre de trimestres validés. Le changement des règles d’indexation, à partir de 1993, a érodé de manière non négligeable le montant des pensions, de manière assez indolore. En s’engageant à indexer le point sur le salaire moyen, le Premier Ministre mettrait ainsi un terme à un processus engagé il y a 27 ans.
es, il a rappelé les préconisations de Jean-Paul Delevoye. Ce dernier avait mentionné que les caisses des professionnels concernés pourraient les conserver (en partie) pour accompagner la transition vers le système universel. Cela concernerait les auxiliaires médicaux, avocats, et les médecins concernés. Le Premier Ministre a annoncé qu’il n’y aurait « pas d’holdup up, pas de siphonage pour combler tel ou tel trou, tel ou tel déficit ».
Le Coin des Epargnants du 7 décembre 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 6 décembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 871,9 | -0,56 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 28 015,06 | -0,13 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 656,53 | -0,10 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 166,58 | -0,53 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 239,66 | -1,45 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 692,34 | -0,30 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 354,40 | +0,26 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 912,01 | +1,39 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | +0,029 % | +0,074 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,289 % | +0,073 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 1,843 % | +0,069 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,1051 | +0,28 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 460,380 | -0,22 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 64,280 | +5,79 % | 52,973 |
L’emploi américain, un allié indéfectible des marchés
L’emploi américain résiste à tout ou presque, du moins jusqu’à présent. Les créations du mois de novembre attendues par les experts à 180 000 se sont élevées à 266 000 selon le rapport du Bureau of Labor Statistics (BLS). Ce bon résultat est, en partie, dû à la réintégration des grévistes de General Motors. Il convient également de souligner que le solde des deux mois précédents a été révisé en hausse de 41 000. Le taux de chômage a diminué le mois précédent de 0,1 point à 3,5% de la population active. Par ailleurs, l’indice préliminaire de la confiance du consommateur (calculé par l’Université du Michigan) est à nouveau en hausse à 99,2, contre 97 attendu et 96,8 en octobre. Il s’agit de son plus haut niveau depuis mai.
L’optimisme est également de mise pour les négociations commerciales sino-américaines. A moins de dix jours de l’entrée en vigueur de nouvelles surtaxes douanières américaines, selon des informations des deux parties, un accord serait sur le point d’être annoncé. Sur ce sujet, la prudence reste toutefois de rigueur.
La réunion de l’OPEP à Vienne a débouché sur une réduction plus forte de la production afin de faire remonter le cours au-delà de 60 dollars le baril. La diminution supplémentaire portera sur 500.000 barils par jour jusqu’à la fin du premier trimestre 2020, soit une réduction totale de 1,7 million de barils par jour. Dans la foulée, le cours du baril de Brent s’est rapproché de 65 dollars.
Malgré quelques signes encourageants, les indices boursiers se sont érodés très légèrement cette semaine. Les prochains jours seront encore très politiques avec les élections législatives au Royaume-Uni et le Congrès du SPD en Allemagne où pourrait être débattu une sortie anticipée de la Grande Coalition.
Les monnaies en proie aux tensions politiques et sociales
Jusqu’à maintenant, la grève qui bloque les transports ferroviaires en France n’a pas eu d’effets réels sur la valeur de l’euro. Cependant, les facteurs sociaux et politiques sont de plus en plus pris en compte par les investisseurs. Du fait de l’augmentation des tensions sociales, de la montée du populisme, dans plusieurs pays, la tentation du relâchement budgétaire gagne du terrain.
Les incertitudes politiques sont alimentées par les dernières décisions du Président américain. Après avoir taxé certains produits français en réaction de l’instauration de la taxe GAFA par le gouvernement d’Edouard Philippe, Donald Trump a annoncé le rétablissement immédiat des taxes douanières sur l’acier et l’aluminium en provenance du Brésil et d’Argentine en raison de la dépréciation de la monnaie de ces deux pays qui, dans les faits, ne possèdent plus de réserves monétaires pour les soutenir. Au Brésil, la montée de la contestation sociale menace la poursuite des réformes et inquiète les investisseurs étrangers. Le Chili est également confronté à une forte dépréciation de sa monnaie en raison de la paralysie de l’économie par des grèves. La crise en Amérique latine contribue à l’appréciation du dollar au grand dam du Président américain qui a demandé à maintes reprises à la banque centrale de le faire baisser. Depuis l’été 2011, le billet vert a gagné près de 65 % par rapport aux devises émergentes.
Les devises européennes sont pour le moment plutôt épargnées par ce regain de volatilité sur le marché des changes. La Roumanie est intervenue pour soutenir sa monnaie, le leu, et mais elle a dépensé un peu moins d’un milliard d’euros pour stopper sa chute. Elle est parvenue à restaurer le calme. Et le Danemark a défendu l’arrimage historique de la couronne à l’euro en mobilisant des sommes modestes.
Malgré la proximité des élections britanniques et les problèmes sociaux dans plusieurs pays européens, l’euro reste stable autour de 1,11 dollar. En 2018, le mouvement gilets jaunes n’avait pas eu d’impact sur l’euro. Entre le début des manifestations le 17 novembre et la fin de l’année, l’euro avait évolué entre 1,1250 et 1,1450 dollar.
Pourquoi les actions ne valent-elles pas plus cher ?
Malgré la forte augmentation des indices boursiers depuis le début de l’année (plus de 20 % pour le CAC 40), la valorisation des actions peut apparaître faible en fin de cycle d’expansion. Malgré la bonne tenue des profits et les très faibles taux d’intérêt, les investisseurs demeurent méfiants vis-à-vis des actions des entreprises cotées.
L’évolution des prix des actifs subit des influences contradictoires : d’un côté la baisse des taux ; de l’autre des perspectives moyennes de croissance. L’effet « taux » et l’effet « conjoncture » ne jouent pas de manière identique selon les classes d’actifs. La valorisation des actions de la zone euro reste faible aujourd’hui malgré les taux d’intérêt bas. Le ratio valeur des actions sur les dividendes futurs en 2019 est de 16, à un niveau relativement stable depuis 2014 quand, sur cette période, les taux d’intérêts des obligations à 10 ans sont passés de 3 à 0 %. Les perspectives de croissance semblent l’emporter pour les actions même si la profitabilité des entreprises reste forte. Au sein de la zone euro, le poids des profits après taxes, intérêts et dividendes est de 12 % du PIB en 2019 contre 10 % dix ans auparavant. Le bénéfice par action est en progression sur moyenne période. Dans ces conditions, la valorisation devrait être plus forte. Les investisseurs se montrent frileux vis-à-vis de cette classe d’actifs au nom de l’aversion aux risques. Si les actions cotées peinent à conquérir de nouveaux épargnants, en revanche, les valorisations des entreprises dans le cadre des opérations de private equity ou de LBO sont en hausse du fait de l’effet de levier procuré par les emprunts à faible taux d’intérêt.
L’immobilier bénéficie des taux bas avec une forte appréciation de son prix. En contrepartie, le ratio loyers/prix de l’immobilier diminue. Au sein de la zone euro, de 2002 à 2019, les prix des maisons et de l’immobilier commercial ont, pour l’ensemble de la zone euro, augmenté de 60 %. Sur la même période, le ratio loyers/prix des maisons s’est contracté de 20 %.
Une autre thèse peut expliquer la situation paradoxale des actions. Les investisseurs doutent de la pérennité de la croissance ; les dividendes importants seraient la conséquence de leur méfiance et non l’expression d’une bonne santé des entreprises. Cette nécessité de conserver les actionnaires passe par la multiplication des plans de rachats d’actions qui génèrent une valorisation artificielle. En raison de la transition énergétique et de la digitalisation, les investisseurs craignent des disruptions dans de nombreux secteurs et une obsolescence d’investissements non encore amortis. L’absence de visibilité provoquée par ces mutations incite les acteurs financiers à opter pour l’attentisme.
Les ménages s’endettent toujours plus pour la pierre
Les ménages français sont endettés à hauteur de 1 254 milliards d’euros dont 1 066 au titre des emprunts immobiliers et 188 au titre de la consommation. Le taux de croissance de l’endettement est de 6,5 %. En octobre, la croissance des crédits à l’habitat aux particuliers a été de +6,7 %, après +6,6 % en septembre, tandis que celle des crédits à la consommation se tasse quelque peu (+5,6 %, après +6,5 % en septembre).
La production de crédits à l’habitat qui s’établit en octobre à 24 milliards d’euros, un plus haut depuis mai 2017, est très largement soutenue par les renégociations. Leur part dans les crédits nouveaux augmente à nouveau en octobre pour atteindre 26 % (après 23,6 % en septembre et 16,4 % en octobre 2018).
Au mois d’octobre, selon la Banque de France, les particuliers ont emprunté pour l’achat de leurs biens immobilier avec un taux moyen de 1,23 % contre 1,27 % en septembre. Le taux des crédits à la consommation est de 3,68 %.
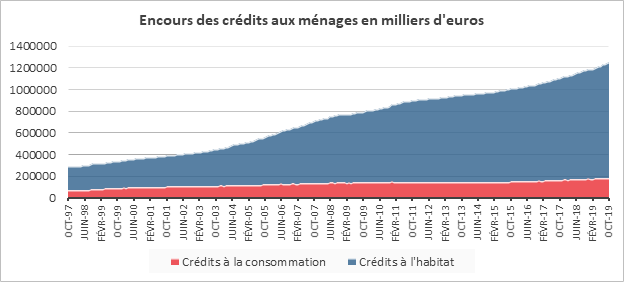
Des crédits toujours moins chers pour les particuliers
Au mois d’octobre, les particuliers ont emprunté, selon la Banque de France, pour l’achat de leurs biens immobilier avec un taux moyen de 1,23 % contre 1,27 % en septembre. Le taux des crédits à la consommation est de 3,68 %.
En octobre, la croissance des crédits à l’habitat aux particuliers a été de +6,7 %, après +6,6 % en septembre, tandis que celle des crédits à la consommation se tasse quelque peu (+5,6%, après +6,5% en septembre).
La production de crédits à l’habitat qui s’établit en octobre à 24 Mds €, un plus haut depuis mai 2017, est très largement soutenue par les renégociations. Leur part dans les crédits nouveaux augmente à nouveau en octobre pour atteindre 26 % (après 23,6 % en septembre et 16,4 % en octobre 2018).
La rémunération des livrets bancaires en baisse à 0,20 %
Selon la Banque de France, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires a diminué, en octobre (0,58 %, après 0,59 % en septembre). Ce taux a baissé de 6 points de base sur un an. La diminution observée sur ces 12 derniers mois est principalement portée par les comptes à terme supérieurs à 2 ans, dont la rémunération a fléchi de 32 points de base pour les ménages et de 25 points de base pour les sociétés non financières. Le taux de rémunération des livrets bancaires est passé de 0,22 à 0,20 % de septembre à octobre
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en %
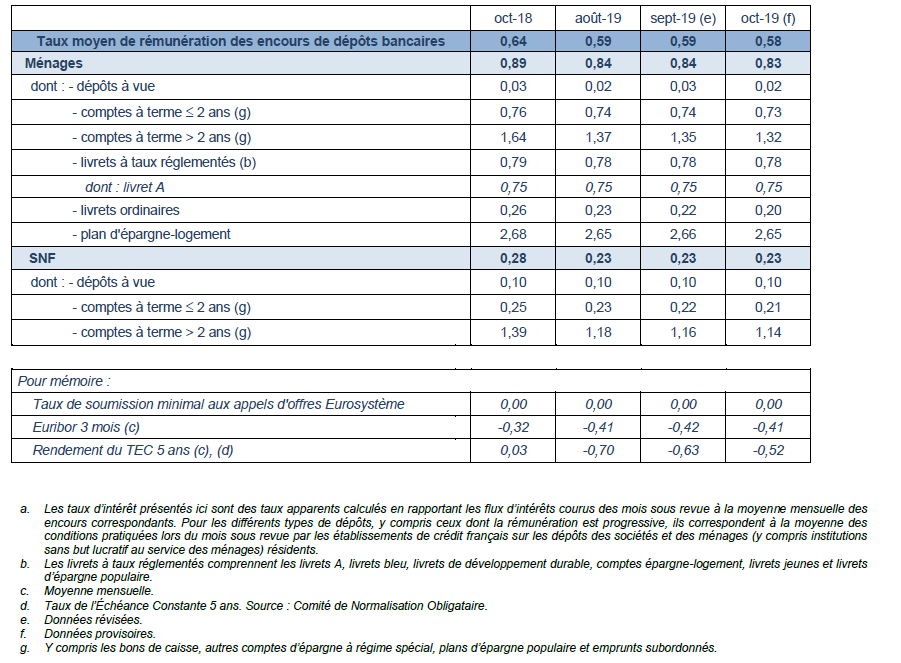
Le Coin de l’Agenda du 1er au 15 décembre 2019
Samedi 30 novembre
En Chine, il faudra suivre la publication des indices PMI officiels de novembre.
Dimanche 1er décembre
Les résultats des immatriculations du mois de novembre en France seront connus.
Lundi 2 décembre
Pour la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la zone euro, les indices PMI manufacturier de novembre seront publiés.
Aux États-Unis, seront connues les dépenses de construction d’octobre.
Mardi 3 décembre
Pour la zone euro, seront publiés les prix à la production d’octobre.
Mercredi 4 décembre
Les indices PMI des services et composite de novembre seront rendus publics pour la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la zone euro, la Chine et les États-Unis.
Aux États-Unis, il faudra regarder l’Enquête ADP sur l’emploi privé de novembre.
Jeudi 5 décembre
Pour l’Allemagne, seront communiquées les commandes à l’industrie d’octobre.
Pour la zone euro, le résultat définitif du PIB du troisième trimestre 2019 sera connu. Seront publiées les ventes au détail d’octobre.
À Vienne, une réunion ministérielle de l’OPEP est prévue.
Aux États-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine au 30 novembre seront publiées. Les résultats de la balance commerciale et les commandes à l’industrie d’octobre seront connus.
Vendredi 6 décembre
Pour la France sera connu le résultat des échanges extérieurs d’octobre
Au Japon, il faudra suivre la consommation des ménages d’octobre.
En Allemagne, il faudra regarder la production industrielle d’octobre.
Aux États-Unis, seront attendus les créations d’emploi, le taux de chômage et les salaires de novembre. Sera également connu l’indice de confiance du consommateur de l’université du Michigan (première estimation) pour le mois de décembre.
Dimanche 8 décembre
En Chine, la balance commerciale de novembre sera publiée.
Lundi 9 décembre
Pour la France, la banque centrale publiera son indicateur de conjoncture avec une projection de la croissance au dernier trimestre 2019.
Au Japon, le taux de croissance révisé pour le troisième trimestre sera connu.
Pour la zone euro, il faudra regarder l’indice Sentix du climat des affaires de décembre.
En Allemagne, la balance commerciale d’octobre sera rendue public.
Mardi 10 décembre
En France, seront connus les résultats de l’emploi salarié du troisième trimestre et l’indice de la production industrielle d’octobre.
En Chine, il faudra regarder le taux d’inflation de novembre.
Au Royaume-Uni, il faudra regarder la production industrielle, la balance commerciale, et l’estimation du PIB d’octobre.
En Allemagne, il faudra suivre la publication de l’indice ZEW du sentiment des investisseurs de décembre.
Aux États-Unis, sera publiée la productivité (révisée) du troisième trimestre. Le FOMC de la Réserve fédérale (première journée) se réunit.
Mercredi 11 décembre
À Vienne, sera publié le rapport mensuel de l’OPEP.
Aux États-Unis il faudra suivre les prix à la consommation de novembre et la fin du FOMC de la Réserve fédérale ainsi que le communiqué de politique monétaire.
Jeudi 12 décembre
En France sera publié l’indice des prix à la consommation de novembre (définitif).
En Allemagne, le taux d’inflation (définitif) de novembre sera rendu public.
Pour la zone euro, il faudra suivre le résultat de la production industrielle d’octobre.
Le Conseil des gouverneurs de la BCE se réunit avec des décisions sur les taux.
Aux États-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine du 7 décembre seront connues. Il en sera de même pour les prix à la production de novembre.
Vendredi 13 décembre
Au Japon, il faudra suivre l’enquête Tankan sur le climat des affaires du quatrième trimestre.
Aux États-Unis, seront publiés les ventes au détail de novembre et les stocks des entreprises d’octobre.
En Espagne, il faudra regarder la revue de la note souveraine par Fitch.
Le Coin des Epargnants du 29 novembre
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 29 novembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 905,17 | +0,20 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 28 051,41 | +0,62 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 665,47 | +1,71 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 236,38 | +0,55 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 346,53 | +0,27 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 703,58 | +0,44 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 293,91 | +0,78 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 871,98 | -0,46 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | -0,045 % | +0,004 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,362 % | +0,004 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 1,774 % | +0,002 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,1018 | -0,02 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 463,600 | +0,21 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 60,750 | -4,35 % | 52,973 |
Un mois de novembre porteur pour les marchés
Au cours du mois de novembre, les marchés américains ont enregistré de nouveaux records portés par les espoirs d’un accord avec la Chine et par les résultats économiques moins décevants que prévus. La politique monétaire accommodante a maintenu les taux d’intérêt à des niveaux toujours très faibles. Le cours du baril de pétrole Brent s’est stabilisé autour de 60 dollars.
La légère amélioration de l’inflation a pu rassurer certains investisseurs. Ainsi, les prix ont augmenté au sein de la zone euro de 1 % en novembre sur un an, un plus haut de trois mois, après 0,7 % en octobre. Hors alimentation et énergie, les prix ont progressé de 1,3 % par rapport à novembre 2018, soit un pic de sept mois. Dans les services, la hausse atteint 1,9 % après 1,5 % en octobre.
Depuis le 1er janvier, la hausse du CAC atteint près de 25 % et celle de l’indice allemand, Daxx s’élève à près de 22 %. Le Nasdaq a progressé sur les onze premiers mois de l’année de plus de 30 %, le Dow Jones gagnant de son côté plus de 20 %.
Tableau de bord des marchés financiers en novembre
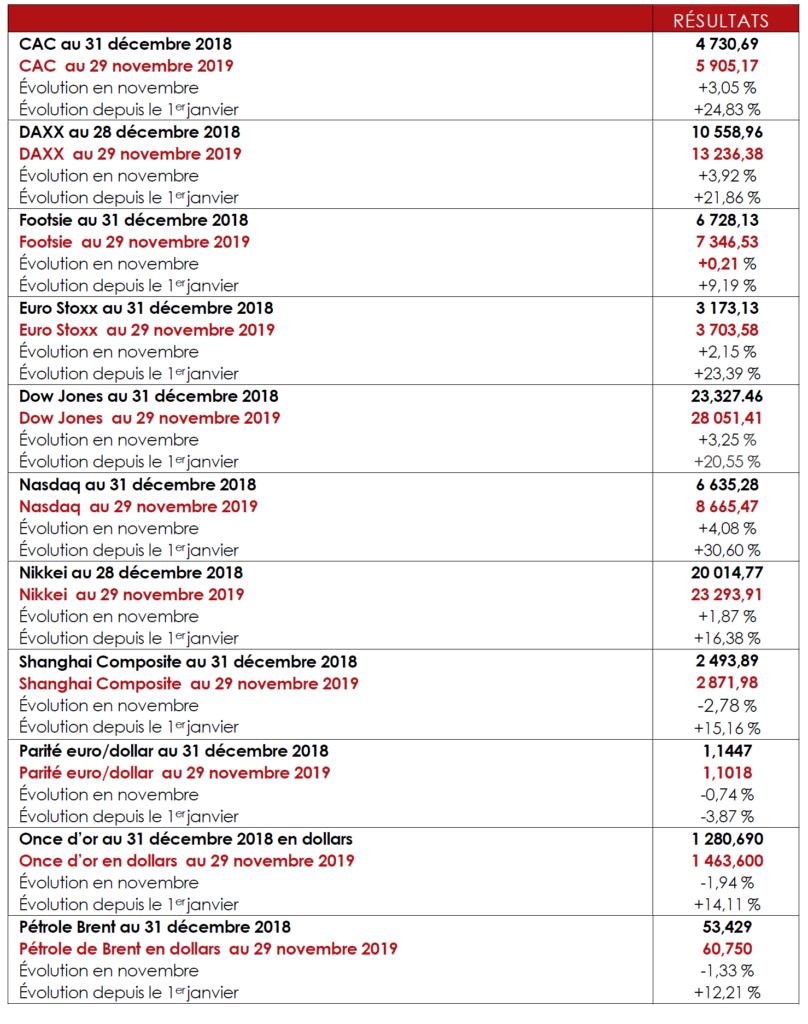
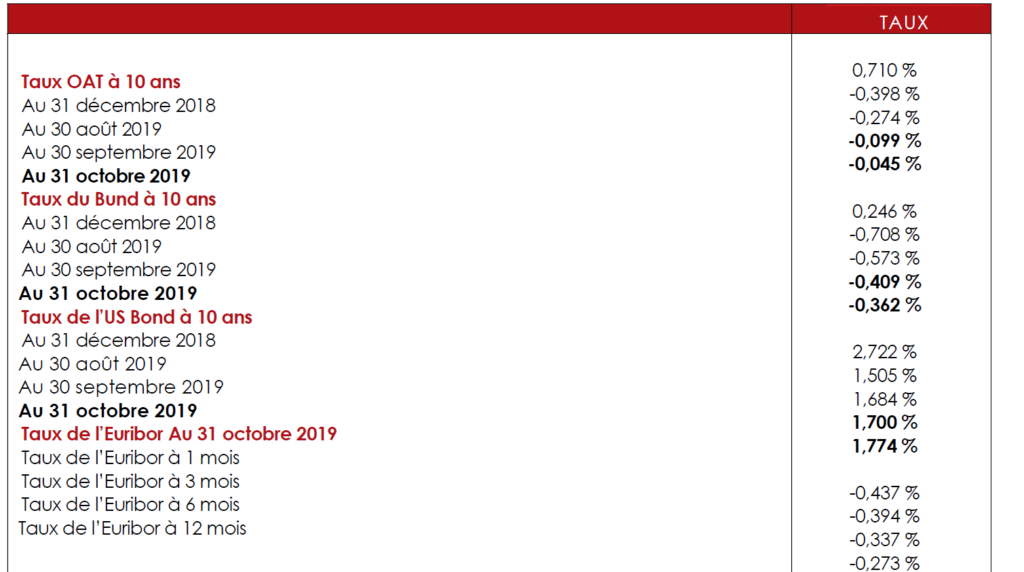
Consommation étale malgré une petite hausse en octobre
Depuis le milieu de l’année 2018, les dépenses de consommation des ménages varient peu. Au fil des mois, des petites variations à la hausse et à la baisse sont enregistrées autour de 47,5 milliards d’euros de dépenses mensuelles. Ainsi, au mois d’octobre 2019, elles ont progressé de +0,2 % en volume, après –0,3 % en septembre. Cette hausse est imputable à l’augmentation des achats alimentaires, +0,8 % et aux achats de biens fabriqués, +0,3 %. En revanche, la consommation d’énergie s’est repliée de 1,5 %.
Les ménages français n’utilisent pas leurs gains de pouvoir d’achat pour accroître leurs dépenses de consommation.
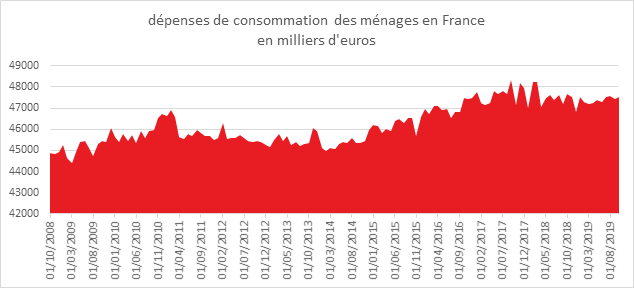
Calme plat pour les prix en France
Sur un an, au mois de novembre, les prix à la consommation progresseraient, selon l’INSEE de 1,0 %, après +0,8 % le mois précédent, Cette hausse de l’inflation résulterait d’un dynamisme plus marqué des prix du tabac, des services et de l’alimentation, et d’une moindre baisse de ceux de l’énergie. En revanche, les prix des produits manufacturés baisseraient davantage qu’en octobre.
Sur le seul mois de novembre, les prix à la consommation seraient en hausse de 0,1 %, après une stabilité en octobre.
Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé accélérerait à +1,2 %, après +0,9 % en octobre.
Avec ce taux, logiquement le taux du Livret A devrait être fixé à 0,5 % le 1er février si le Gouvernement décide d’appliquer la nouvelle formule.
Le taux d’épargne des ménages progresse au 3e trimestre
Selon l’INSEE, au 3e trimestre, le taux d’épargne des ménages a été de 14,8 % du revenu disponible brut contre 14,6 % au deuxième. Les ménages ont décidé une partie de leurs gains de pouvoir d’achat qui se sont élevés à 0,6 % au 3e trimestre.
L’augmentation des revenus des ménages est imputable à celle de la masse salariale. Cette dernière augmente de +0,8 %, après le ralentissement du deuxième trimestre (+0,3 %) qui reflétait le contrecoup des primes exceptionnelles versées par certaines entreprises en début d’année. Les prestations sociales ont de leur côté augmenté de +0,7 % après +0,2 %. En négatif pour le pouvoir d’achat, les cotisations sociales à la charge des ménages ont progressé de +0,5 % les impôts sur le revenu et le patrimoine sont quasi stables (+0,1 %). Les prix de la consommation des ménages ont enregistré une faible croissance (+0,2 % après +0,4 %). Mesuré par unité de consommation pour être ramené à un niveau individuel, augmentation du pouvoir d’achat a été de 0,5 % après –0,4 % au deuxième trimestre.
Au troisième trimestre 2019, la consommation des ménages en volume progresse (+0,4 % après +0,2 %), mais de façon moins dynamique que le pouvoir d’achat. Par conséquent, le taux d’épargne des ménages augmente : il s’établit à 14,8 % après 14,6 % au deuxième trimestre
Réforme des retraites, le Premier Ministre entre fermeté et ouverture
A l’issu du Conseil des Ministres du 27 novembre 2019, le Premier Ministre a dans le cadre d’une conférence de presse souligné sa volonté à mener à bien le projet visant à instituer un régime universel qui doit s’accompagner de la fin des régimes spéciaux. Il s’est déclaré prêt à revoir les dates et les modalités de la mise en oeuvre de cette réforme. Il serait prêt à reculer l’application aux générations encore en activité en 2030 ou en 2035 et non plus en 2025 comme le rapport le préconisait. Cela signifierait que seules les générations nées après 1968 ou 1973 seraient concernées. La clause du grand père prévoyant que seuls les nouveaux entrants dans la vie active seraient concernés par la réforme est pour le moment abandonné.
Le Premier Ministre a également rappelé que la réforme reposait sur trois idées :
- l’universalité, ce qui passe par une solidarité entre tous les actifs et non plus seulement profession par profession ;
- la justice, avec des systèmes de redistributions sociales
- la responsabilité, ce qui suppose de bâtir un régime de retraite financièrement équilibré.
Lors de sa conférence de presse, Edouard Philippe a rappelé son intention d’équilibrer les comptes des régimes de retraite avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Les Français déclarent vouloir moins épargner tout en faisant le contraire
Pour le douzième mois consécutif, l’indice de confiance des ménages dans la situation économique, calculé par l’INSEE, ne baisse pas. Pour le mois de novembre, il augmente à nouveau, après deux mois de stabilité. À 106, l’indicateur qui la synthétise gagne deux points et demeure au-dessus de sa moyenne de longue période (100).
En novembre, les Français sont plus optimistes qu’au mois précédent concernant l’évolution future de leur situation financière future. Leur appréciation sur leur situation financière passée est également positive. Les deux indices mesurant ces sentiments sont au-dessus de leur moyenne de longue période. Par ailleurs, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement par rapport au mois dernier.
En novembre, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future reste stable tandis que le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle baisse d’un point. Les deux soldes demeurent néanmoins nettement au-dessus de leur moyenne.
Même si les Français ont tendance depuis un an à épargner davantage, leur appréciation sur ce point est tout autre. Ainsi, en novembre, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner baisse légèrement. Le solde correspondant perd un point et demeure ainsi inférieur à sa moyenne de longue période.
En novembre, la part des ménages qui considèrent que leur niveau de vie passé en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente de nouveau. Le solde correspondant poursuit sa progression en gagnant trois points ; il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période. Cet optimisme prévaut également pour l’évolution à venir du niveau de vie. L’indice augmente d’un point après trois mois de stabilité. Les craintes de chômage sont, de leur côté, en baisse.
Cet optimisme ne se reflète qu’imparfaitement dans la consommation à moins que les comportements des ménages en la matière soient en train de se modifier. Lors des dernières décennies, une forte corrélation était constatée entre le moral des ménages et les dépenses de consommation, il apparaît que depuis la crise de 2008, le lien soit plus faible.
21 % des Français ont l’intention de puiser dans leur épargne pour financer les cadeaux de fin d’année
Selon une enquête réalisée par COFIDIS, les Français prévoient de dépenser pour les fêtes de fin d’année 549 euros. Ce montant est en retraite par rapport à 2018 (-22 euros).
Le premier poste de dépenses est constitué par les cadeaux, avec un budget en constante augmentation depuis 2 ans (355 euros), devant les repas (131 euros). L’époque serait à la modération. Les Français comptent réduire le nombre de cadeaux qu’ils ont l’attention d’offrir.
Plus d’un tiers du budget (39%), soit 215veuros en moyenne, sera dépensé en ligne, sur des sites web ou des applications mobiles. Ainsi 4 cadeazux sur 7 devraient être réalisés en ligne. Sont en premier lieu concernés les produits culturels (56%), les jouets ou les jeux (55%) et les produits de haute technologie (31 % téléphone, ordinateur, etc.).
Afin de financer leurs cadeaux de Noël, 68 % des Français puisent en priorité dans leur budget dédié aux dépenses courantes. 29 % utilisent des chèques ou bons cadeaux et 21 utilisent leur épargne personnelle (21%). Plus d’un français sur 10 (11%) a recours à une facilité de paiement ou un crédit à la consommation pour financer l’achat de cadeaux.
Près de 2 Français sur 3 (60%) anticipent leurs dépenses de Noël, principalement en se constituant une « Cagnotte Noël » tout au long de l’année. Plus d’un tiers d’entre eux (36%) achètent leurs cadeaux lors de périodes promotionnelles comme le Black Friday.
Le Coin des Epargnants du 22 novembre 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 22 novembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 893,13 | -0,78 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 27 875,62 | -0,46 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 519,88 | -0,25 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 163,88 | -0,59 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 326,81 | +0,33 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 687,32 | -0,65 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 112,88 | -0,82 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 885,29 | -0,21 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | -0,049 % | -0,025 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,366 % | -0,030 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 1,772 % | -0,072 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,1020 | -0,29 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 462,256 | -0,35 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 63,540 | +0,27 % | 52,973 |
Marchés, le retour de la conjoncture
La semaine n’a pas été marquée par de nouveaux événements sur le front des négociations commerciales sino-américaines ou sur le front monétaire. Ce sont les résultats macro-économiques qui ont donné le la aux marchés. Les indices ont faiblement évolué lors des cinq dernières séances.
La publication des indices PMI, dits préliminaires, pour le mois de novembre, du sentiment des directeurs d’achats dans la zone euro a rassuré, en partie, les investisseurs. Ils sont en effet meilleurs que prévu pour l’industrie mais décevants pour services.
A 43,8 points, la composante manufacturière est en Allemagne au-dessus des 42,1 points d’octobre et même des 42,8 points attendus par le consensus. Pour la France, l’indice reste au-dessus des 50, barre fatidique entre croissance et repli. Il s’est élevé à 51,6 points contre 50,7 en octobre et 50,9 attendu. Etant donné le poids de l’Allemagne et de la France dans l’économie de la zone euro, les chiffres pour l’ensemble de la région sont donc en hausse pour la composante industrielle à 46,6 points, contre 46,4 anticipé et 45,9 le mois précédent.
Les services sont, en revanche, en recul à 51,5 contre 52,2 en octobre et 52,4 espéré. De ce fait, l’indice global d’activité pour novembre est en retrait de 0,3 point d’un mois sur l’autre, à 50,6 points. que le ralentissement économique se propage désormais au secteur des services.
Ces indices ne sauraient pas masquer le basculement d’une grande partie de la zone euro dans la stagnation voire le repli pour la première fois depuis 2013.
Le changement de paradigme en matière d’épargne, un défi à relever !
Le patrimoine financier des ménages a atteint, à la fin du deuxième semestre 5 176,8 milliards d’euros contre 5 000 milliards d’euros au troisième trimestre 2018. L’augmentation enregistrée lors des derniers trimestres est imputable à la valorisation des actifs financiers sur les marchés avec notamment la très bonne tenue des indices boursiers et aux flux importants d’épargne. Le montant du patrimoine financier s’élevait à 3 622 milliards d’euros au deuxième trimestre 2007. Ce patrimoine a fortement augmenté du fait du maintien d’un fort taux d’épargne et d’une rémunération assez élevée durant les décennies 1990 et 2000 des produits de taux. La crise de 2008 a provoqué une légère baisse du patrimoine financier des ménages, baisse qui a été rapidement compensée.
Les produits de taux représentaient au deuxième trimestre 2019 65 % de l’encours du patrimoine des ménages, contre 69 % au premier trimestre 2012. Corrigé des valorisations de marché, le déséquilibre entre les placements de taux et les autres est encore plus patent. En effet, les premiers représentaient en moyenne au deuxième trimestre 71 % de l’encours du patrimoine des ménages contre 60 % au premier trimestre 2012. En sept ans, il n’y a donc eu guère d’inflexion dans la composition du patrimoine financier des ménages.
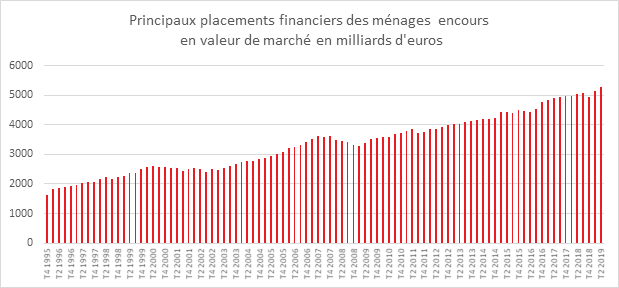
Source : Cercle de l’Epargne – Banque de France
Au deuxième trimestre 2019, en rythme annuel, les flux d’épargne des ménages ont atteint un niveau record de 149,4 milliards d’euros. Il faut remonter au 1er trimestre 2007 pour retrouver un montant aussi élevé. Les ménages français ont, au cours du premier semestre de cette année, épargner une grande partie des gains de pouvoir d’achat générés par les mesures post crise des gilets jaunes te par la baisse de l’inflation.
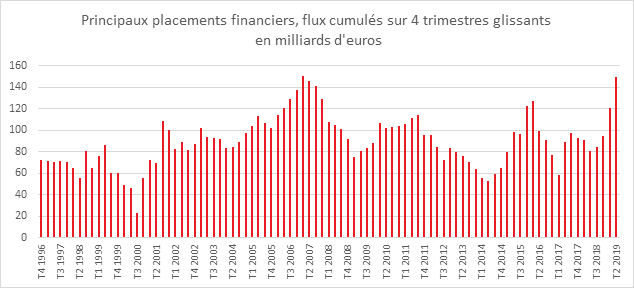
Source : Cercle de l’Epargne – Banque de France
Du premier au deuxième trimestre, les flux d’épargne en rythme annuel ont progressé de plus de 28,4 milliards d’euros. Les produits de taux ont été les grands bénéficiaires de cette augmentation. Plus de 110 milliards d’euros toujours en rythme annuel se sont investis sur ces produits, contre 98,0 milliards au premier trimestre. Les fonds euros de l’assurance vie ont bénéficié d’un apport de 31,3 milliards au deuxième trimestre, contre 25,5 milliards au premier. Les placements en titres de créances acquis via des Organismes de Placement Collectif (SICAV, FCP, etc.) ont connu un fort dynamisme.
Les dépôts à vue enregistrent toujours une forte croissance avec un gain en rythme annuel de 47 milliards d’euros. Ils constituent le premier emploi de l’épargne, suivis des produits de fonds propres (33 milliards), de l’assurance-vie en euros (31 milliards) et de l’épargne réglementée (21 milliards).
Avec l’amélioration des indices des marchés actions et la baisse des taux, les ménages se sont mis à acheter un peu plus d’actions que les trimestres précédents. Les achats d’actions cotées toujours en rythme annuel sont passés de 2,6 à 10,1 milliards d’euros du premier au deuxième trimestre. Ils ont, par ailleurs, cédé moins d’actions détenues via les OPC (-4,1 milliards au deuxième contre -11,6 milliards au premier trimestre).
Selon les premières informations communiquées par la Banque de France pour le troisième trimestre, la tendance constatée au deuxième se confirmerait avec un maintien d’un fort taux d’épargne et un engouement persistant des ménages pour les produits de taux. Ainsi, les dépôts à vue auraient augmenté de 12,4 milliards d’euros au troisième trimestre contre 11,1 milliards d’euros au deuxième. Les dépôts bancaires rémunérés auraient bénéficié d’un apport de 10,2 milliards d’euros et l’épargne réglementaire de 5 milliards d’euros. L’assurance vie aurait enregistré un flux positif, au troisième trimestre, de 12,1 milliards d’euros. Les unités de compte auraient bénéficié d’un flux de 0,8 Milliard d’euros contre 0,9 milliard au deuxième trimestre et 1,1 milliard au premier.
Les épargnants, malgré la baisse des taux d’intérêt, demeurent attachés aux livrets d’épargne réglementés ou non ainsi qu’aux fonds euros des contrats d’assurance vie. Le succès de la privatisation de la Française des Jeux ne saurait masquer la forêt. L’évolution des comportements et la réorientation de l’épargne exige du temps et de la pédagogie.
L’assurance vie toujours en haut de l’affiche en octobre
L’assurance vie est un roc. A la différence du Livret A, elle n’a pas, en octobre, failli. Loin des polémiques sur l’avenir des fonds euros et de leur rendement, les ménages français ont continué à faire confiance au premier produit d’épargne. Ainsi, contre vents et marées, elle reste le phare de l’épargne française. En octobre, l’assurance vie a, en effet, enregistré sa dixième collecte positive consécutive avec un gain, selon la Fédération Française de l’Assurance, de 1,9 milliard d’euros. Cette collecte nette est, certes, en retrait par rapport à celle du mois de septembre (2,9 milliards d’euros). Elle est également légèrement inférieure à la moyenne de ces douze derniers mois (2,2 milliards d’euros).
La collecte nette est sur les dix premiers mois de l’année 2018 de 24,1 milliards d’euros soit près de 5 milliards au-dessus du montant de 2018 (19,7 milliards d’euros). L’assurance vie fait ainsi preuve d’une belle résilience.
Le montant des cotisations (euros et unités de compte) a été en octobre de 12,2 milliards d’euros en phase avec les résultats de ces derniers mois. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance au cours des dix premiers mois de 2019 est de 121,8 milliards d’euros contre 117,5 milliards d’euros sur la même période en 2018 prouvant que les ménages dégagent une plus forte épargne en faveur de l’assurance vie.
Les prestations sont, en revanche, en légère hausse et ont atteint 10,3 milliards d’euros. Elles s’étaient élevées à 9,1 milliards d’euros au mois de septembre. Sur les dix premiers mois, les prestations versées par les sociétés d’assurance ont représenté 97,7 milliards d’euros, un montant équivalent à celui de 2018 (97,8 milliards d’euros).
Au mois d’octobre, les cotisations en unités de compte ont représenté 27 % des cotisations versées en retrait par rapport au résultat de septembre (30 %). Depuis le début de l’année, 25 % des cotisations ont été effectuées en unités de compte. La progression sensible du cours des actions explique la petite augmentation de la part des unités de compte mais le rapport de force reste nettement en faveur des fonds euros. La modification des comportements des ménages risque d’être un exercice difficile et long.
L’encours des contrats d’assurance-vie se rapproche doucement mais surement de la barre des 1800 milliards d’euros (1 779 milliards d’euros à fin octobre 2019, en progression de 5 % sur un an).
Octobre est en règle générale un mois correct pour l’assurance qui n’a connu durant ce mois, lors de ces dix dernières, qu’une seule décollecte. Après la période de vacances et avant les dépenses de fin d’année, les ménages prennent en relation avec leur conseiller en assurance ou bancaire, en octobre et en novembre, des décisions d’arbitrage concernent leur patrimoine. Les ménages français plébiscitent toujours la garantie en capital qu’offre les fonds euros. Il faudra suivre dans les prochains mois l’évolution de la collecte quand les assureurs auront mis en application leur souhait de restreindre plus fortement la collecte en fonds euros. Actuellement, l’objectif était un minima de 30 % d’unités de compte pour les nouveaux versements. Il est en grande partie atteint. Les ménages sont-ils prêts à aller au-delà et sont-ils prêts à modifier la répartition de leur encours ? Un effort important de pédagogie sera sans nul doute nécessaire.
Le Livret A n’aime pas le mois d’octobre
Le Livret A n’a pas réussi la passe de 12 collectes successives positives. En effet, comme en 2018, le Livret A a enregistré, cette année encore, une décollecte importante de 2,13 milliards d’euros en octobre. L’année dernière, elle s’était élevée à 2,52 milliards d’euros. Il faut remonter à 2012 pour retrouver une collecte positive en octobre. L’année 2012 est très atypique car elle a été marquée par la crise des dettes souveraines et par le relèvement du plafond du Livret A. Depuis 2009, il n’y a eu en tout et pour tout que deux années de collectes positives. Avec cette décollecte, l’encours du Livret A revient à 297,4 milliards d’euros. Le LDDS quant à lui enregistre une décollecte de 430 millions d’euros et son encours est désormais de 110,8 milliards d’euros.
La malédiction du Livret A en octobre trouve son explication dans le paiement des impôts locaux. Même si la taxe d’habitation a été allégée pour 80 % des ménages français, elle constitue une dépense de l’automne tout comme la taxe foncière versée par les propriétaires (près de 60 % des ménages).
Depuis le début de l’année, les gains de pouvoir d’achat étaient en grande partie épargnés par crainte d’un retournement de la situation économique et sociale. Ces gains ont été concentrés sur le premier semestre. Il est possible que les ménages aient décidé de puiser dans leur cagnotte afin de financer un certain nombre de dépenses d’automne.
En 2019, aux facteurs traditionnels de décollecte, s’est ajouté le débat sur le taux de rendement du Livret A. Le teasing du Gouvernement sur une éventuelle baisse du taux le 1er février prochain a pu conduire des titulaires du Livret A à ne pas effectuer de versement. Les épargnants sont assez sensibles aux annonces faites sur l’évolution du taux de rendement. Le passage de 0,75 à 0,5 % pourrait entraîner plusieurs mois de décollecte comme cela a été constaté lors des dernières baisses. Le risque est que cette décollecte conduise à un nouveau gonflement des dépôts à vue qui dépassent en France, 400 milliards d’euros.
L’atypique mois d’octobre ne devrait pas trop porter atteinte à la collecte annuelle qui devrait se situer autour de 16 milliards d’euros. Malgré la décollecte d’octobre, les dix premiers mois de l’année se soldent, pour le moment par une collecte nette de xx milliards d’euros pour le Livret A, soit un montant supérieur à celle de 2018 (8,87 milliards d’euros). Les mois de novembre et de décembre étant marqués par les dépenses de fin d’année, le dernier trimestre devrait être atone pour la collecte. L’encours du Livret A devrait rester proche de la barre des 300 milliards d’euros.
Déficit confirmé pour le système de retraite français et retour de l’âge pivot
Le Président de la République et le Haut-Commissaire aux retraites se sont engagés à ce qu’en 2025 lors de l’éventuelle mise en place du système de retraite, les comptes de l’assurance vieillesse soient à l’équilibre. Or, au mois de juin 2019, le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites avait créé un choc en soulignant que le déficit pourrait alors atteindre 0,7 à 0,9 % du PIB. En outre, afin de maintenir le système à l’équilibre, le Haut-Commissaire a intégré dans ses préconisation au mois de juillet le concept d’âge pivot à 64 ans. Face aux réactions négatives des syndicats, le Président de la République a indiqué que cela n’était qu’une piste et que celle de la durée de cotisation pouvait être également retenue. Par ailleurs, il a demandé au Conseil d’Orientation des Retraites d’affiner ses projections financières. Pour répondre à la commande gouvernementale, le COR ne s’est pas contenté de recalculer les besoins de financement du système de retraite à horizon 2025 ou 2030. Il a également mesuré les efforts nécessaires pour rétablir l’équilibre en 2025. D’ici 5 ans, le déficit devrait se situer entre 8 et 17 milliards d’euros. Sans surprise, le COR a indiqué que l’instauration de l’âge-pivot serait plus efficace que l’allongement de la durée de cotisation.
Si le Gouvernement optait pour un relèvement des cotisations, il faudrait les augmenter de 0,7 point par rapport à la trajectoire prévue, et les porter à 31,4 % en 2025. En jouant sur les pensions, il faudrait abaisser le taux de remplacement de 1,2 point et le ramener à 48,6 %..
En retenant la notion de l’âge de départ effectif qui était prévu initialement de 62,8 ans en 2025, il faudrait le reporter dans le scénario optimiste de 4 mois et demi supplémentaires pour. Dans le scénario sombre, il faudrait le reporter de 8 mois. Ces mois de travail supplémentaires se surajouteraient de toute façon à ceux déjà prévus dans le cadre de la réforme Touraine, qui doit porter à 43 annuités la durée de cotisation requise pour le taux plein, en ajoutant un mois chaque année jusqu’en 2035. Dans un scénario médian, l’âge effectif devrait augmenter de 3 mois et demi par an à partir de 2020 pour atteindre 63,4 ans en 2025. Le Président de la République a indiqué qu’il ne souhaitait pas toucher à l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans en 2010. Si l’option de l’allongement de la durée de cotisation était retenue, il faudrait la porter à 44,7 ans cotisés en 2025, au lieu de 42 ans. La loi Touraine avait prévu de la porter à 43 ans pour les générations nées après 1973. Aller jusqu’à 44,7 ans apparaît difficile à réaliser.
Face au défi du financement, la solution de « l’âge minimum du taux plein », qui s’ajouterait aux bornes d’âge qui existent déjà constitue une piste étudiée par le Gouvernement. Cela revient à instituer un âge pivot avec décote et surcote.
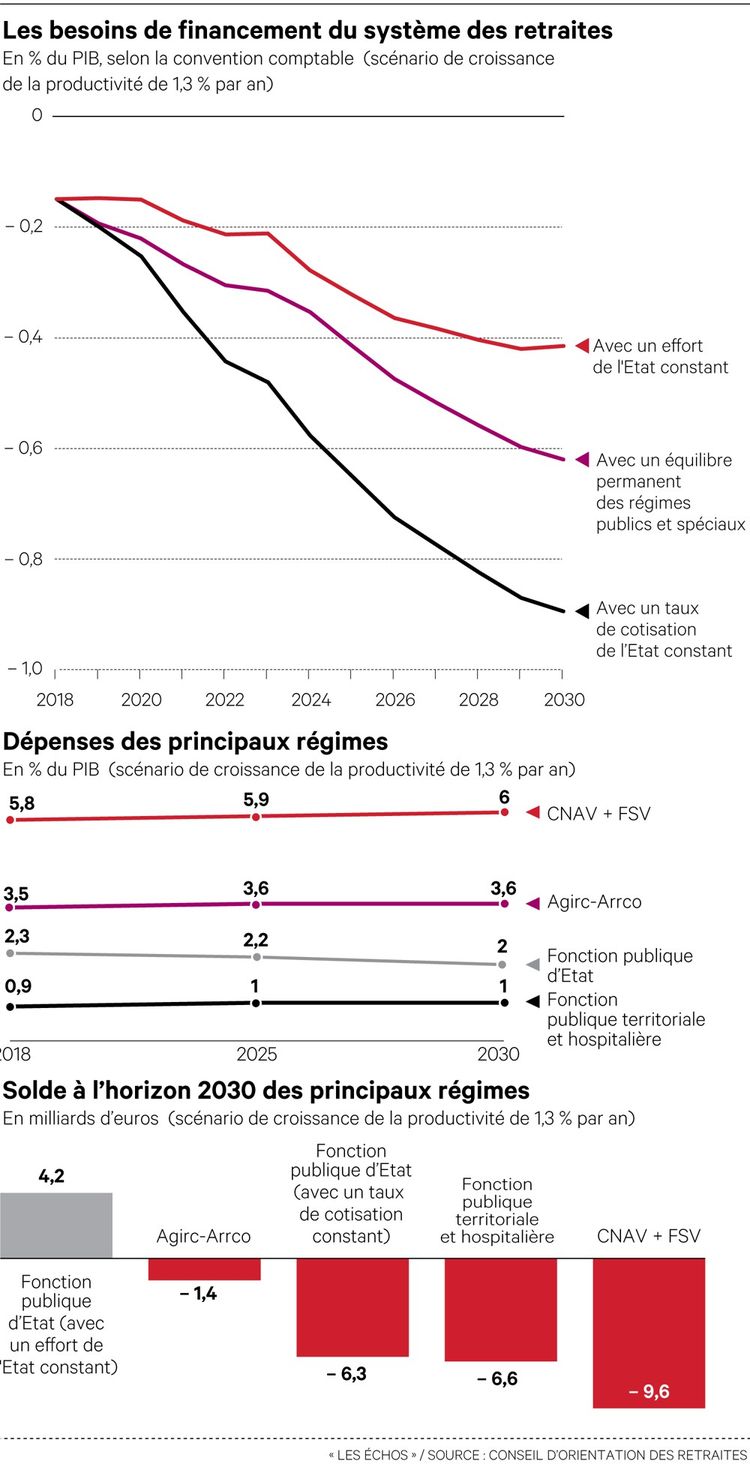
Les Français ont répondu favorablement à la privatisation de la Française des Jeux
La Française des Jeux est une entreprise qui est connu par tous les Français et qui par son activité a un capital sympathie. Dégageant des bénéfices de manière récurrente, la Française des Jeux a été constitué par de nombreux Français comme un bon placement. La campagne publicitaire et l’implication de l’Etat ont également joué en faveur de la souscription.
Plus d’un milliard d’euros » d’actions ont été souscrits par les particuliers dans le cadre de l’opération de privatisation. L’entreprise entrera officiellement en bourse le jeudi 21 novembre.
La fourchette du prix de l’action est comprise entre 16,50 et 19,90 euros pour les institutionnels, les particuliers bénéficiant d’une décote de 2 % ramenant cette fourchette entre 16,17 et 19,50 euros. Au vu de la forte demande, le prix devrait se situer dans le haut de la fourchette. Le Ministre de l’Economie a indiqué que les petites demandes seront privilégiées. l’Etat pourrait par ailleurs exercer son option de surallocation en mettant un d’un lot ultime d’actions qui est gardé en réserve en cas de forte demande.
L’opération de privatisation devrait rapporter 1,9 milliard d’euros avec 99,32 millions de titres émis sur le marché. Au total, La Française des jeux serait valorisée entre 3,15 et 3,8 milliards d’euros, selon sa PDG, Stéphane Pallez.
L’opération de privatisation de la Française des Jeux est la plus forte émission de titres depuis celle d’Amundi de 2015 et c’est la première grande privatisation depuis 2005 (EDF).
Le Coin des Epargnants du 16 novembre 2019 – Les actions en pointe !
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 15 novembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 939,27 | +0,84 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 28 004,89 | +1,17 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 540,83 | +0,77 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 241,75 | +0,10 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 302,94 | -0,77 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 711,6 | +0,32 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 303,32 | -0,38 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 891,34 | -2,46 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,024 % | -0,046 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,336 % | -0,072 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,834 % | -0,076 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1045 | +0,23 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 466,285 | +0,54 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 63,300 | +1,09 % | 52,973 |
Du feuilleton sino-américain à l’absence de récession en Allemagne
Les marchés américains ont battu des nouveaux records cette semaine. Le Dow Jones a franchi la barre des 28 000 points. La hausse de cet indice dépasse 20 % depuis le début de l’année. Rassurés par un probable accord pour le Brexit, ils ont apprécié les annonces de Larry Kudlow, le principal conseiller économique de la Maison-Blanche. Ce dernier a déclaré jeudi soir que Washington et Pékin étaient proches d’un accord commercial. Il a souligné que les deux parties étaient dans « la dernière ligne droite », précisant que les deux États étaient en relation tous les jours en ce moment. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce avait auparavant indiqué que les deux pays discutaient « en profondeur » en vue d’un accord commercial de phase 1. L’obtention d’un accord demeure conditionnée par la levée des droits de douane supplémentaires décidés par les États-Unis. Les marchés sont également dopés par la politique monétaire. Même si la FED ne devrait pas baisser une nouvelle fois ces taux d’ici la fin de l’année, son interventionnisme demeure important. La FED a effectué de fortes injections de liquidités, de près de 100 milliards de dollars lors des opérations « repo ». Elle a lancé également un programme d’achats de bons du Trésor de 60 milliards de dollars par mois.
Le CAC 40 est à son plus haut niveau depuis le 23 janvier 2007 et se rapproche de la barre des 6000 points. Il a enregistré sa quatrième semaine consécutive de hausse.
Le Japon renoue avec la stagnation
La croissance du Japon, a été de 0,1 % au troisième trimestre. L’archipel du soleil levant est pénalisé par le ralentissement du commerce international. La croissance est en nette décélération. Elle est passée de 0,5 à 0,1 % du premier au troisième trimestre (0,4 % au deuxième).
Au troisième trimestre, les exportations nippones se sont contractées de 0,7 %. De son côté, la consommation a progressé de 0,3 % stimulée par l’approche d’un relèvement de la TVA dans le pays. Cette hausse a notamment permis d’éviter un repli du PIB. En septembre, avant le passage du taux de TVA de 8 à 10 % intervenue le 1er octobre dernier, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 9,5 % par rapport à leur montant du mois de septembre 2018. Par ricochet, les dépenses devraient baisser au cours du quatrième trimestre qui devrait se solder par une contraction du PIB mettant un terme à quatre trimestres consécutifs de hausse. Au mois d’octobre, les seules ventes de véhicules neufs au Japon ont diminué de 26,4 % sur un an en volume après avoir augmenté de 13 % en septembre.
Le Gouvernement japonais compte sur une reprise du commerce mondial et sur les Jeux Olympiques de 2020 pour endiguer l’effet récessionniste de l’augmentation de la TVA. Par ailleurs, l’exécutif prépare un plan de soutien à l’économie pour l’an prochain, visant notamment à reconstruire ou moderniser des infrastructures touchées par le violent typhon Hagibis en octobre.
La croissance devrait rester faible dans les prochains mois. Ainsi, fin octobre, la Banque du Japon a abaissé sa prévision de croissance pour l’exercice 2019/20 (courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020), soit 0,6 % contre 0,7 % précédemment. Elle a aussi revu négativement ses prévisions de progression du PIB pour 2020/21 et 2021/22.
Le Fonds monétaire international (FMI) qui établit quant à lui ses prévisions sur une année civile, table actuellement sur une augmentation du PIB japonais de 0,9 % en 2019 (contre 0,8 % en 2018), et de 0,5 % en 2020.
L’Allemagne sauvée sur le fil de la récession
De nombreux experts avaient prédit l’entrée de l’Allemagne en récession lors du troisième trimestre. Or, le PIB Outre-Rhin a cru de 0,1 %, évitant ainsi au pays d’enregistrer deux trimestres de recul.
Cette progression du PIB, qui intervient après une contraction de 0,2 % au deuxième trimestre, s’explique en partie par une évolution favorable du commerce extérieur, les exportations de l’Allemagne ayant augmenté alors que ses importations ont stagné. Du côté de la demande intérieure, la consommation des ménages et des administrations a aussi contribué positivement à la croissance du PIB, de même que la FBCF en construction. L’investissement en machines et en équipements s’est, en revanche, contracté.
Les taux bas viennent de loin !
Depuis cinq ans, l’Europe est confrontée à des taux très faibles voire négatifs qui remettent en cause les fondamentaux économiques et financiers. Ce processus jugé anormal l’est-il réellement en prenant en compte les évolutions sur longue période des taux ? Les taux évoluent en fonction de facteurs de court et moyen terme : la politique monétaire des banques centrales, l’inflation, les gains de productivité. Des cycles de hausses et de baisses peuvent se succéder mais au-delà de ces facteurs, les taux pourraient s’inscrire dans une tendance de fond les amenant à devenir nuls.
L’étude des taux d’intérêt sur longue période a donné lieu à peu de travaux à l’exception de ceux conduits par Thomas Piketty, Gregory Clark en 2005 ou Paul Schmelzing. Thomas Piketty s’est avant tout concentré sur l’évolution des taux du capital privé et peu sur ceux des titres souverains. Paul Schmelzing a porté son analyse sur l’évolution des taux de rendement réels des titres publics depuis 1311. Il en conclut que sur sept cents ans, les taux ont tendance à diminuer en connaissant des cycles de baisse et de hausse. En moyenne, depuis 1311, ils se sont élevés à 4,78 % et, sur les deux cents dernières années, le taux moyen s’affaisse à 2,55 %. Pour Paul Schmelzing, les taux ne devaient tangenter le zéro qu’autour de 2030. Ils sont donc en avance sur le cycle de très longue période, à moins que cela soit la conséquence temporaire d’un cycle court.
L’emboitement de cycles courts dans les cycles longs accentue ou réduit la tendance de longue période. Les cycles courts sont en phase avec les cycles économiques. Leurs durées ne sont pas néanmoins identiques. Les cycles financiers sont plus longs que les cycles de production.
La phase actuelle de dépression des taux a commencé en 1989 et s’est amplifiée après la crise de 2008. Cette phase de très faibles taux n’est pas unique. Cependant, sa longue durée la différencie des six précédentes. L’économie n’évolue au même rythme qu’auparavant.
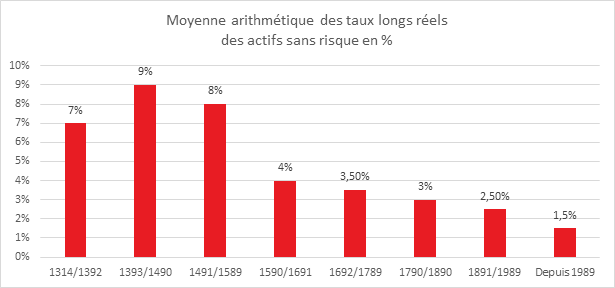
Le cycle baissier en cours date de plus de trente ans. Pour retrouver une aussi longue période de diminution, il faut remonter aux années 1325/1353. En moyenne, les phases de baisse des taux sont de 26 ans. Ce cycle fait suite à une période également atypique de forts taux. La période 1955/1989 a été marquée par une vive remontée des taux réels. La sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec la nécessité d’opérer d’importantes reconstructions et d’accompagner la forte croissance de la population, peuvent expliquer ce mouvement haussier.
Au-delà des fluctuations de moyen terme, la baisse de long terme s’expliquerait par la diminution de la prise des risques. Dans des économies rudimentaires avec peu de transparence, les taux incorporent une forte prime de risques. Le développement des techniques financières et la sécurisation des processus de financement conduisent à cette diminution. Au cours des siècles, la hausse des profits anticipés limite le risque de défaut et permet donc de prêter à moindres coûts.
La longueur inhabituelle du cycle en cours est à mettre en relief avec celle de la phase de croissance américaine. Elle s’inscrit également dans un processus de contraction de la croissance potentielle de l’ensemble des économies. Les tenants de la stagnation séculaire mettent l’accent sur des facteurs de très long terme, le rendement décroissant de la recherche et des facteurs plus conjoncturels comme le changement des règles de répartition des fruits de la croissance entre salariés et actionnaires.
Le cycle enclenché depuis les années 80 s’inscrit dans un processus sans précédent de vieillissement de la population. Dans le passé, un taux d’intérêt élevé était la contrepartie d’une vie brève. L’allongement de l’espérance de vie permettrait une moindre rémunération. Par ailleurs, le vieillissement de la population conduit à une moindre prise de risque surtout dans la deuxième partie de vie. Sur des générations plus longues, la rémanence des crises passées est plus prégnante d’autant plus que l’information est plus présente. La succession des crises, 1987, 1997, 2000 et 2008, n’est pas, en soi, une première mais leur souvenir est plus vivace que dans le passé.
Une financiarisation sans action cotée
Le capitalisme s’est financiarisé à grande vitesse à partir des années 80. La capitalisation des entreprises a fortement augmenté concomitamment au renforcement du rôle des actionnaires. Ce processus a conduit à une forte concentration du capital avec la multiplication des opérations de fusion acquisition et les rachats d’actions. Cette concentration a eu comme conséquence une meilleure rémunération des actionnaires. Elle s’accompagne d’une diminution des entreprises cotées. Celle-ci est non seulement due à une diminution du nombre de grandes entreprises mais aussi à une moindre appétence pour la cotation des actions de la part des dirigeants d’entreprise. L’exigence de transparence comptable et financière et les coûts de la cotation sont dissuasifs. Par ailleurs, les dirigeants d’entreprise jugent que les cours boursiers ne sont pas un bon indicateur pour évaluer la valeur réelle de celle-ci. En 10 ans, leur nombre d’entreprises cotées en Europe a baissé de près de 25 %, soit d’un peu plus de 10 000 à environ 8 000. Aux États-Unis, il est passé de 8 000 à 4 500 de 1998 à 2018.
Le marché des actions cotées s’atrophie du fait de la diminution du nombre des émissions et par les rachats effectués par les entreprises. En 2018, les entreprises du S&P 500 ont racheté pour plus de 1000 milliards de dollars de leurs propres actions. Cette année, en 10 mois, Apple a racheté 75 milliards de dollars de ses propres actions, Microsoft, 40 milliards, Bank of America 30,9 milliards et JPMorgan Chase 29,4 milliards, selon TrimTabs. En Europe, la société Iliad a lancé un projet d’offre public de rachat portant sur 20 % de son capital. Les entreprises se tournent beaucoup plus volontiers vers le private equity et vers le crédit d’autant plus que les taux sont faibles.
Cette attrition du marché « actions » a comme conséquence que ce dernier est de moins en moins représentatif de l’économie réelle. Il en résulte une plus forte volatilité des cours, entretenue par les rachats d’obligations des banques centrales. Les investisseurs évincés du marché de la dette de bonne qualité par la BCE se reportent en nombre sur des titres plus risqués, non éligibles au programme de rachat (high yield, emprunts subordonnés, dette hybride…).
Du fait de l’absence de titres, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les obligations d’entreprises, ce qui amène également à une baisse des taux sur ce type de placements. Les entreprises ont bien compris l’attraction de leurs obligations. Ainsi, depuis début 2014, le marché de la dette en euro dédié aux entreprises notées en catégorie dite d’investissement (au moins triple B) a augmenté de 75 %. Pour les dix premiers mois de l’année 2019, il a crû de 10 %, de 2 100 milliards à 2 400 milliards d’euros. L’écart entre le coût des actions et celui de la dette est au plus haut depuis 100 ans.
Calme plat pour l’inflation
En octobre, selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation en France est resté stable sur un mois, après un repli de 0,3 % en septembre. Cette stabilité résulte d’une légère hausse des prix des produits manufacturés (+0,3 % après +1,5 %), compensée par un recul des prix des services (-0,1 % après -1,3 %) et de l’alimentation (-0,4 % après -0,5 %). Les prix de l’énergie demeurent inchangés d’un mois sur l’autre. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables, comme en septembre.
Sur un an, les prix à la consommation ralentissent pour le quatrième mois consécutif. Ils ne progressent plus que de 0,8 % en octobre, contre +0,9 % en septembre. Cette légère baisse de l’inflation résulte d’un repli des prix de l’énergie et d’un ralentissement des prix de l’alimentation, en partie compensés par une moindre baisse de ceux des produits manufacturés.
L’inflation sous-jacente augmente en octobre à 1,0 % sur un an, contre +0,9 % le mois précédent. Cet indice est calculé en excluant du panier les biens et les services soumis à l’intervention de l’État (électricité, gaz, tabac…) et les produits à prix volatils (produits pétroliers, produits frais, produits laitiers, viandes, fleurs et plantes, etc.). Ces biens et services subissent des mouvements très variables dus à des facteurs climatiques ou à des tensions sur les marchés mondiaux qui peuvent affecter de manière conjoncturelle l’indice des prix.
L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) diminue de nouveau sur un mois (-0,1 % après -0,4 % en septembre) ; sur un an, il augmente de 0,9 %, après +1,1 % le mois précédent.
La persistance d’une faible inflation devrait conduire au
mois de janvier le Gouvernement à annoncer une diminution du taux de l’épargne
réglementée à moins que la proximité des élections municipales l’en dissuade.
La France continue à créer des emplois !
A la fin du 3e trimestre 2019, le secteur privé comptait 19,650 millions d’emplois soit un million de plus qu’il y a cinq ans à la fin du 3e trimestre 2014.
Malgré le ralentissement de la croissance, l’économie française continue à créer des emplois. Ainsi, le nombre d’emploi dans le secteur privé s’est accru de 54 300 au cours du 3e trimestre, soit une hausse de 0,3 %, après +0,2 % le trimestre précédent.
Sur un an, la progression du nombre d’emplois atteint 1,4 %, soit un gain de 263 200. Hors intérim, la dynamique est similaire avec une augmentation de 0,3 % sur le trimestre (soit +57 900) et de 1,5 % sur un an (+273 200).
L’emploi salarié privé accélère légèrement dans la construction, +0,7 % au troisième trimestre (soit +9 900), après +0,5 %. L’emploi industriel augmente à nouveau légèrement : +0,2 % (soit +6 200), après 0,0 %. Sur un an, l’emploi salarié privé s’accroît de 43 400 dans la construction et de 23 200 dans l’industrie.
Dans les services marchands, l’emploi privé continue sa progression, +0,3 %, soit +36 300, comme au deuxième trimestre, portant à +1,5 % sa hausse sur un an, soit +182 600. Hors intérim, sa progression est comparable : +0,3 %, comme au trimestre précédent, et +1,7 % sur un an. L’emploi privé dans les services non marchands est stable sur le trimestre, mais supérieur de 0,4 % à son niveau un an auparavant. L’emploi intérimaire diminue de nouveau modérément : –0,5 % après –0,3 % le trimestre précédent (soit –3 600 après –2 200). Sur un an, il baisse de 1,2 % (soit –10 000).
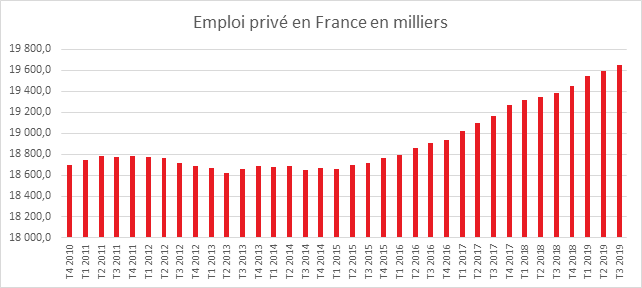
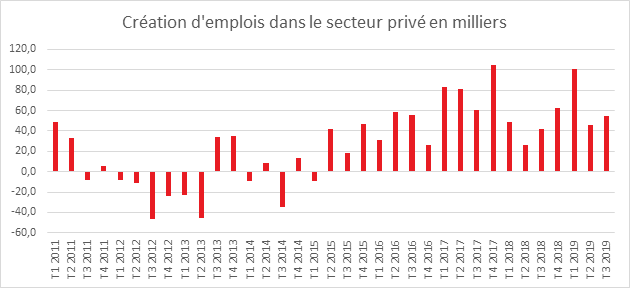
Le Coin des Epargnants du 9 novembre 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 8 novembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 889,70 | +2,22 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 27 681,24 | +1,22 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 475,31 | +1,06 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 228,56 | +2,06 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 359,38 | +0,78 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 699,65 | +2,09 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 391,87 | +2,37 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 964,18 | +0,20 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,022 % | +0,091 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,264 % | +0,119 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,910 % | +0,177 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1017 | -1,31 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 464,245 | -3,29 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 62,320 | +1,09 % | 52,973 |
Quand Américains et Chinois jouent au chat et à la souris
La hausse des marchés a été mise à mal vendredi avec les tergiversations de Washington sur l’acceptation de la proposition chinoise d’un retrait progressif et mutuel des droits de douane supplémentaires mis en place ces derniers mois. Malgré tout, les réactions des investisseurs ont été modérées car ils estiment que les relations entre les deux premières économies mondiales sont entrées dans une phase de désescalade. Au-delà de ces doutes sur la suite donnée au dossier commercial, cette semaine aura été marquée par des records de clôture signés pour le Dow Jones et le S&P 500. Les gains sont importants également pour les indices européens. Le CAC 40 a gagné plus de 2 % en 5 jours tout comme le Daxx allemand et l’Eurostoxx 50. Depuis le 31 décembre dernier, le CAC 40 s’est apprécié de près de 25 % et le Daxx allemand de 25,2 %, et cela malgré le ralentissement de l’économie européen.
Sur le plan macroéconomique, la confiance du consommateur américain s’est améliorée en ce début de mois. L’indice établi par l’Université du Michigan progressant de 0,2 point à 95,7, son meilleur niveau depuis juillet, contre une stabilisation à 95,5 attendue. La composante des attentes progresse quant à elle de 1,7 point à 85,9, marquant également un plus haut de quatre mois.
Retour de l’OAT à 10 ans en territoire positif
Le taux sur les Obligations Assimilables du Trésor français à 10 ans sont repassés en territoire positif en ce début novembre, une première depuis le mois de juillet dernier. Cette remontée n’est pas spécifique à la France ; elle affecte toutes les dettes souveraines. Elle s’explique par le retour des investisseurs sur les marchés actions avec l’atténuation des tensions commerciales, la possible sortie négociée du Royaume-Uni et la publication de plusieurs indicateurs économiques rassurants. En zone euro, les derniers résultats des enquêtes PMI auprès des directeurs d’achat révèlent une amélioration de l’activité dans le secteur privé en octobre. Ce retour vers les actions provoque, par ricochet, une hausse des taux d’intérêt. Le taux de l’OAT s’élevait à 0,02 % bien loin du 0,7 % de la fin décembre 2018. Cette remontée des taux sur le marché des dettes souveraines n’a pas empêché l’Etat français de placer pour plusieurs d’euros des OAT à 10 ans à -0,2 %.
Crédits à l’habitat, la crainte d’une bulle !
Au mois de septembre, la croissance des crédits à l’habitat aux particuliers a été de 6,6 % (contre 6,5 % en août), tandis que celle des prêts à la consommation s’est élevée à 6,2 %, après 5,6 %.
À 21,7 milliards d’euros, la production mensuelle de crédits à l’habitat est au-dessus de sa moyenne des 12 derniers mois (19,0 Mds). La part des renégociations dans les crédits nouveaux se maintient à 23,6 % en septembre (après 24,6 % en août et 17,5 % en septembre 2018). Fin septembre, l’encours des crédits à l’habitat a atteint 1 060 milliards d’euros sur un total de 1 280 milliards d’euros.
Les taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux ont encore baissé pour atteindre 1,27 % en ce qui concerne les prêts à l’habitat à long terme à taux fixe en septembre, après 1,31 % en août et pour les crédits à la consommation (3,55 %, après 3,83 %).
Les pouvoirs publics réfléchissent sur l’adoption de mesures afin d’éviter un surendettement des emprunteurs et protéger la rentabilité des banques.
Parmi les pistes à l’étude, figure celle consistant à limiter le taux d’effort qui correspondant à la part des revenus consacrés au remboursement de l’emprunt et aux charges qui y sont liées. « Une pratique habituelle de marché consiste à le limiter à 33 %, mais ce n’est pas juridiquement contraignant », indique le Haut Comité de la Stabilité Financière (HCSF). Si ce taux se situe à 30 % en moyenne, il atteint 35 % pour 25 % des nouveaux crédits, Sa limitation pèserait sur les primo-accédants et sur les jeunes ménages.
Le HCSF réfléchit également à la limitation des renégociations de crédits qui favorise la baisse des taux. Pour cela, il pourrait agir sur le montant du rachat de crédit qui est aujourd’hui limité à 3 % du capital restant dû, plafonné à 6 mois d’intérêt.
Le taux d’usure pourrait être relevé pour permettre aux banques de proposer des taux plus élevés. Jusqu’au 31 décembre, il est fixé à 2,77 % pour un emprunt à taux fixe d’une durée d’au moins 20 ans (2,67 % en dessous de 20 ans).
Une autre solution consisterait à instituer un taux plancher. Les banques ne pourraient pas descendre trop bas. Le risque serait que ce taux devienne celui du marché et supprime toute concurrence.
L’endettement des entreprises poursuit sa hausse
Au mois de septembre, selon la Banque de France, le taux de croissance de l’endettement des sociétés non financières a été de 6,1 % sur un an. Le taux de croissance du financement bancaire s’est élevé à 6,4 % en rythme annuel, après 7,2 % le mois précédent. Le taux de croissance annuel du financement de marché s’établit à 5,7 %, après 5,8 % en août.
Après plusieurs mois consécutifs de baisse, le coût moyen à 5 ans du financement de marché croît de 16 points de base en septembre et atteint 0,62 %.
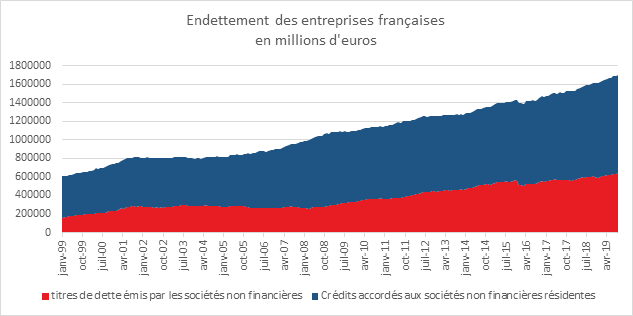
Les entreprises françaises toujours en mode endettement
Au mois de septembre, selon la Banque de France, le taux de croissance de l’endettement des sociétés non financières a été de 6,1 % sur un an. Le taux de croissance du financement bancaire s’est élevé à 6,4 % en rythme annuel, après 7,2 % le mois précédent. Le taux de croissance annuel du financement de marché s’établit à 5,7 %, après 5,8 % en août.
Après plusieurs mois consécutifs de baisse, le coût moyen à 5 ans du financement de marché croît de 16 points de base en septembre et atteint 0,62 %.
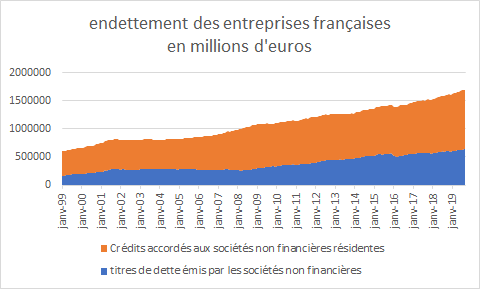
L’action Française des Jeux fera-t-elle des heureuses et des heureux ?
Le Gouvernement a décidé de privatiser la Française des Jeux qui est le deuxième opérateur de jeux en Europe et le quatrième au niveau mondial. La Française des Jeux peut compter sur 25 millions de joueurs. Les mises de jeu ont atteint 15,8 milliards d’euros en 2018. 10,7 milliards d’euros ont été redistribués aux joueurs. L’entreprise a contribué sous formes de taxes à hauteur de 3,3 milliards d’euros au budget de l’État. Ses bénéfices ont atteint en 2018 170 millions d’euros. 138 millions ont été versés sous forme de dividendes dont 100 millions à l’État. La Française bénéficie d’un champ d’activité à priori protégé et réglementé. Elle a reçu une licence pour exercer sa mission.
La privatisation de la Française des Jeux est un symbole. Société de services aux bénéfices récurrents, cette dernière a la possibilité d’attirer un grand nombre d’actionnaires. Elle intervient au moment où les taux bas obèrent le rendement des fonds euros et des livrets d’épargne.
Une entreprise atypique
La Française des Jeux est dans la série de privatisation qu’a connue la France depuis 1986 très atypique. Son activité est très réglementée et bénéficie d’un monopole.
La Française des Jeux partage avec le PMU le monopole des jeux d’argent en France. Sa première activité est constituée par les jeux de loterie, la seconde étant les paris sportifs dont les mises ont atteint en 2018 3,04 milliards d’euros, en hausse de 21 % par rapport à 2017 grâce à la Coupe du Monde. Les jeux de loterie ont engendré 12,8 milliards d’euros de mise. Les jeux n’échappent pas au processus de digitalisation. Les mises collectées en ligne ont représenté, en 2018, 2,4 milliards d’euros, soit 15 % des mises. Les paris sportifs connaissent la plus forte progression en particulier pour les mises en ligne avec une augmentation de 60 % en 2018. L’effet « coupe du monde » explique ce bond. La Française des jeux peut s’appuyer sur un réseau de 30 000 détaillants qui sont présents sur l’ensemble du territoire.
Une longue histoire
La Française des Jeux a succédé, en 1976, à la Loterie nationale française, créée par décret de l’article 136 de la loi de finances du 22 juillet 1933 afin de venir en aide aux invalides de guerre, aux anciens combattants et aux victimes de calamités agricoles. Cette dernière est l’héritière de la Loterie royale de France gérée par l’Administration générale des loteries.
Lors d’une campagne en Italie, François 1er découvre la loterie comme moyen de financement de l’État. Il décide d’instituer cette pratique en France. La première loterie autorisée par le Roi date de 1539. La loterie se nomme alors « blanque », de l’italien « blanca » (blanche) d’après la couleur des billets où seuls ceux en noir, parmi les billets blancs distribués, sont gagnants. La blanque connaît peu de succès. Elle est interdite durant deux siècles ou simplement tolérées dans le meilleur des cas. Son retour intervient à la fin du XVIIe siècle avec la Loterie de l’Hôtel de Ville à Paris, qui permettait de payer les rentes des emprunts contractés par la ville, lorsqu’elle était à court d’argent. Le régime royal autorise dans certaines limites les loteries religieuses pour permettre à certaines congrégations en difficulté de trouver des revenus complémentaires. À Paris, l’église Saint-Sulpice, l’église Sainte-Geneviève, et le futur Panthéon de Paris ont été financés en ayant recours aux loteries. Les loteries de l’Hôtel de ville à Paris servent également à financer la restauration des monuments. La Loterie du Patrimoine de Stéphane Bern s’inscrit dans ce lointain lignage.
Face au développement des loteries et des sommes de plus en plus importantes qu’elles mobilisent, au cours du XVIIe siècle le pouvoir royal décide d’en prendre le contrôle. Il renforce également son arsenal juridique contre les tricheurs et les faussaires. La gradation des peines est révélatrice des relations difficiles que l’État a avec l’ordre religieux et avec les collectivités locales. Ainsi, les sanctions sont modérées dans le cas d’une tricherie à une loterie religieuse, sévère dans le cas d’une loterie semi-publique comme celle de l’Hôtel de ville, allant jusqu’aux galères dans le cas des loteries d’État.
La prédominance de l’État central intervient au milieu du XVIIIe siècle, avec la création en 1757 de la loterie de l’École Militaire. Cette loterie a vocation à faciliter la construction de l’École militaire, à la gloire de Louis XV sans peser sur les caisses de l’État. En 1776, cette loterie est transformée en Loterie Royale de France qui peut s’appuyer sur Administration générale des loteries. L’État s’attribue de la sorte un monopole qui, à la veille de la Révolution française, lui procure entre 5 et 7 % de ses revenus.
Les philosophes des lumières sont plutôt opposés aux jeux de hasard et à la loterie. Ces derniers sont accusés de favoriser le vice, la cupidité, le crime et la pauvreté. Talleyrand est à l’origine d’un pamphlet (Des loteries, 1789) d’une virulence extrême contre les loteries. La loterie est supprimée en 1792 par les députés révolutionnaires, mais réapparaît dès 1799, à l’initiative de Bonaparte pour financer ses campagnes militaires.
Les loteries connaissent un nouvel essor après la crise de 1929. Les problèmes de financement des États incitent à y recourir. C’est ainsi qu’intervient le premier tirage de la Loterie Nationale au Trocadéro à Paris le 7 novembre 1933. Le premier gagnant, Paul Bonhoure, reçoit la somme de 5 000 000 de francs (correspondant à 3,5 millions d’euros d’aujourd’hui). Les associations d’anciens combattants et les Gueules cassées sont associés dès 1935 en tant qu’émetteurs des jeux. Lors de la création de la Française des Jeux, ils en deviendront actionnaires.
La Loterie est une activité qui demeure à autorisation annuelle. Elle est ainsi reconduite chaque année par les lois de finances. En 1938, une tentative de suppression est sur le point d’aboutir mais les associations d’anciens combattants parviennent à sauver la loterie nationale. Malgré les pénuries de papier, l’irrégularité des trains, les défaillances postales ou les tracasseries des autorités allemandes pendant la seconde Guerre mondiale, les tirages de la loterie nationale se poursuivent salle Pleyel à Paris.
Avec le lancement du tiercé, en 1954, par le PMU, les jeux de loterie périclitent obligeant les émetteurs à se regrouper en 1974 au sein d’un Groupement d’intérêt économique pour lancer deux ans plus tard un nouveau jeu, le Loto. La Loterie Nationale prend alors la forme d’une société d’économie mixte, la Française des Jeux. Sous le contrôle du Ministre chargé du budget, elle dispose du monopole des jeux de loterie et de paris sportifs sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Principauté de Monaco.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ses activités de pari en ligne sont ouvertes à la concurrence.
Un groupe présent dans plusieurs secteurs et à l’international
La Française des Jeux est en fait un groupe qui comprend une dizaine de filiales spécialisées dans la gestion des jeux.
Le groupe est à l’origine de plusieurs entreprises à vocation technologique. En novembre 2016, avait été créée la marque commerciale B2B FDJ Gaming Solutions, qui rassemble les offres de services et de technologie en matière de Loterie, de Paris Sportifs et de contenus digitaux de ses deux filiales LotSys et LVS.
LotSys a pour objet le développement, la fabrication, la commercialisation et la fourniture de matériels, de logiciels et de services, en relation avec les jeux de hasard et notamment les terminaux de prises de jeux. À ce titre, elle commercialise des terminaux de jeux et des services liés aux jeux de loterie en partenariat avec Idemia (anciennement dénommée Safran Identity & Security et Morpho).
Basée à Londres, LVS (Laverock Von Schoultz) est une filiale spécialisée dans la création et la distribution de logiciels pour les jeux et paris sportifs en ligne, acquise en 2010 par FDJ. La société fournit notamment les loteries française, israélienne et portugaise.
FDJ est actionnaire en Chine, au travers de la filiales Internationale des Jeux, la Beijing Zhongcaï Printing Co (BZP) spécialisée dans l’impression de tickets de loterie.
Afin de développer le réseau de distribution en métropole et dans les DOM TOM, des filiales spécifiques ont été créées FDP, FDJD et « La Pacifique des Jeux ».
FDP est la filiale de distribution de jeux de loterie et de paris en métropole. Créée en 2013 de la fusion de 14 sociétés de distribution, elle a repris plus de 60 secteurs anciennement exploités par les courtiers-mandataires
FDJ Développement et La Pacifique des Jeux sont en charge de la commercialisation Outre-Mer. FDJ Développement assure l’animation et le pilotage commercial du réseau dans les départements des Antilles/Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane). La Pacifique des Jeux assure l’exploitation des jeux de hasard en Polynésie française,
Le Groupe comprend plusieurs filiales en charge de la communication. FDJ STUDIOS, est en charge de la gestion des émissions TV. Les décors, les supports utilisés par le réseau, les opérations marketing et le suivi des gagnants relèvent de FDJ ÉVÈNEMENTS.
La Française des Jeux est présente à l’international avec la création avec la loterie d’État portugaise, de la National Lotteries Common Services (NLCS) dont la mission est de rassembler les loteries qui mettent en commun leurs compétences et leurs moyens en matière de paris sportifs. La Française des Jeux a pris une participation dans la société Services aux Loteries en Europe qui prend en charge les opérations communes du jeu Euro millions
Le passage au privé de l’entreprise
Avant la procédure de privatisation, le capital de la Française des Jeux se répartit de la manière suivante :
- 72 % à l’État ;
- 9,2 % à l’Union des Blessés de la Face et de la Tête ;
- 5 % au Fond Commun de placement des salariés de la Française des Jeux ;
- 13,8 % autres dont actionnaires individuels.
Pour pouvoir justifier de son monopole dans les jeux de loterie, la Française des Jeux doit acquitter une licence de 380 millions d’euros. Le coût de cette licence ne devrait pas obérer le résultat de l’entreprise et le versement des dividendes.
La Française des Jeux constitue une bonne valeur de fond de performance. Elle devrait être déconnectée des mouvements erratiques en raison de la solidité de son chiffre d’affaires. Ses bénéfices ne sont pas prolifiques mais récurrents ce qui constitue un gage de sécurité pour les actionnaires. La remise en cause du monopole sur les jeux de loteries nationales (le loto) est un des rares risques auquel pourrait être confrontée la Française des Jeux. En l’état actuel, l’action de cette entreprise ne devrait pas connaître le même sort que celle d’EDF. C’est pour cette raison que le Gouvernement entend utiliser cette privatisation pour relancer l’idée de l’actionnariat populaire au sein du pays.
La valorisation de l’entreprise devrait se situer entre 2 et 3 milliards d’euros. Les actions seront émises entre 16,5 et 19,90. Une décote de 2 % est prévu pour les particuliers et une action gratuite pour 10 actions achetées sous réserve de les conserver 18 mois. L’opération de privatisation est censée durer jusu’au 20 novembre.
Face à la croissance rapide du crédit à l’habitat, le Gouvernement veut agir
Au mois de septembre, la croissance des crédits à l’habitat aux particuliers a été de à 6,6 % (contre 6,5 % en août), tandis que celle des prêts à la consommation s’est élevé à 6,2 %, après 5,6 %.
A 21,7 milliards d’euros, la production mensuelle de crédits à l’habitat est au-dessus de sa moyenne des 12 derniers mois (19,0 Mds). La part des renégociations dans les crédits nouveaux se maintient à 23,6 % en septembre (après 24,6 % en août et 17,5 % en septembre 2018). L’encours des crédits à l’habitat a atteint à fin septembre 1060 milliards d’euros sur un total de 1280 milliards d’euros.
Les taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux a encore baissé pour atteindre en ce qui concerne les prêts à l’habitat à long terme à taux fixe 1,27 % en septembre, après 1,31 % en août et pour les crédits à la consommation (3,55 %, après 3,83 %).
Les pouvoirs publics réfléchissent sur l’adoption de mesures afin d’éviter un surendettement des emprunteurs et protéger la rentabilité des banques.
Parmi les pistes à l’étude, figure de limiter le taux d’effort qui correspond à la part des revenus consacrés au remboursement de l’emprunt et aux charges qui y sont liées. « Une pratique habituelle de marché consiste à le limiter à 33 %, mais ce n’est pas juridiquement contraignant », indique le Haut Comité de la Stabilité Financière (HCSF). Si en moyenne, il se situe à 30 %; pour 25 % des nouveaux crédits, il est de 35 %. Sa limitation pèserait sur les primo-accédants et sur les jeunes ménages.«
Le HCSF réfléchit également à la limitation des renégociations de crédits qui favorise la baisse des taux. Pour cela, il pourrait agir sur le montant du rachat de crédit qui est aujourd’hui limité à 3 % du capital restant dû plafonné à 6 mois d’intérêt.
Le taux d’usure pourrait être remonté pour permettre aux banques de proposer des taux plus élevés. Jusqu’au 31 décembre, il est fixé à 2,77 % pour un emprunt à taux fixe d’une durée d’au moins 20 ans (2,67% en dessous de 20 ans)«
Une autre solution consisterait à instituer un taux plancher. Les banques ne pourraient pas descendre trop bas. le risque serait que ce taux devienne celui du marché et supprime toute concurrence.
Les marchés « actions » au plus haut
Avec les bons résultats de l’emploi aux Etats-Unis publiés vendredi 1er novembre, la baisse des taux décidés par la FED le 30 octobre , les indices « actions » restent bien orientés à l’exception du Footsie londonien.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 1er novembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 761,89 | +0,69 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 27 347,36 | +1,44 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 386,40 | +1,74 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 12 961,05 | +0,52 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 302,42 | -0,30 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 623,74 | -0,03 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 22 850,77 | +0,22 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 958,20 | +0,11 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,069 % | +0,003 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,383 % | -0,013 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,733 % | -0,072 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1164 | +0,76 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 508,148 | +0,26 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 61,740 | -0,36 % | 52,973 |
Quand octobre ne déplaît pas aux actionnaires
Pas d’octobre noir pour les marchés en 2019. À l’exception de Londres, les principaux indices « actions » ont progressé durant le mois dernier mois leur permettant d’atteindre des niveaux record sur l’année. La détente constatée sur plusieurs fronts de tension au mois d’octobre a fait le bonheur des actionnaires. Les craintes d’une récession généralisée et, en particulier, aux États-Unis se sont estompées tout comme la menace d’un hard-Brexit. En revanche, il reste difficile de se faire une idée précise sur l’évolution des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les autorités chinoises ont durci le ton en fin de semaine en n’entendant pas céder aux exigences de Washington en matière de réformes structurelles (subventions aux entreprises exportatrices, transferts forcés de technologies). Elles jugent la personnalité de Donald Trump « trop impulsive » ce qui constitue à leurs yeux un frein à la signature d’un accord complet. Elles pourraient attendre l’évolution de la procédure d’impeachment ou les élections. Elles estiment que le Président américain aura besoin d’un accord avant de se présenter devant les électeurs. Par ailleurs, le Gouvernement chinois a une notion du temps différente de celle des occidentaux. La temporisation fait partie des règles du jeu. Du côté américain, mercredi 30 octobre, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a déclaré que les États-Unis devaient s’opposer au Parti communiste chinois en raison de sa volonté de dominer le monde. Le dossier est donc loin d’être clos.
Consulter les résultats des indices
boursiers du mois d’octobre
sur le site du Cercle de l’Epargne
Sortie de tunnel en vue pour le Brexit ?
Les 27 pays de l’Union européenne ont donné leur feu vert lundi 28 octobre pour accorder un report de la date de sortie du Royaume-Uni jusqu’au 31 janvier 2020. Les représentants français ont endossé la position des faucons quand ceux d’Europe du Nord se montraient plus conciliants. Une position médiane a été retenue. « Les 27 se sont accordés pour accepter la demande du Royaume-Uni pour un report flexible du Brexit jusqu’au 31 janvier 2020 », a indiqué le Président de la Commission de Bruxelles. Le Royaume-Uni a la possibilité de quitter l’Union au 30 novembre ou au 31 décembre en cas de ratification de l’accord de sortie avant ces échéances. Cependant, la décision de procéder à des élections législatives anticipées le 12 décembre prochain rend improbable une sortie avant la fin de l’année.
La FED, une baisse de taux pour solde de tout compte ?
Mercredi 30 octobre, la FED, la banque centrale américaine a abaissé une troisième fois ses taux depuis le mois de juillet 2019. Son principal taux directeur évoluera désormais dans une fourchette de 1,50 à 1,75 %. Cette baisse avait été anticipée par les investisseurs des marchés financiers. Selon les déclarations du Président de la FED, Jerome Powell, la politique monétaire est « au bon niveau ». Compte tenu des taux d’inflation et de croissance ou de celui de l’emploi, la situation de l’économie américaine ne semble pas justifier une décrue massive des taux. Le taux d’inflation sous-jacent (hors prix des produits énergétiques et alimentaires) a été de 2,4 % en septembre. Le taux d’inflation globale est de 1,7 point. Le taux annuel de la croissance américaine est certes au troisième trimestre en retrait mais ne témoigne pas de l’arrivée prochaine d’une récession. Il s’est élevé à 1,9 %. Au sein du Conseil de politique monétaire, plusieurs membres étaient hostiles à une nouvelle baisse des taux. Parmi ceux-ci, le Président de la Réserve fédérale de Boston, Eric Rosengren qui craint que des taux bas incitent les ménages et les entreprises à s’endetter davantage.
La baisse des taux par la FED est un peu un solde de tout compte avant l’ouverture de la période électorale en 2020. Son Président qui depuis des mois doit faire face aux propos peu amènes de Donald Trump a certainement voulu adresser un message conciliant. Le Président américain estime de son côté que la FED doit réduire ses taux afin de s’aligner sur le comportement des autres grandes banques centrales, celles de la zone euro, du Canada, d’Australie, du Japon ou de Chine. Actuellement empêtré par la procédure d’impeachment, Donald Trump pourrait moins s’immiscer dans les dossiers de politique monétaire qu’auparavant ce qui ne l’empêchera pas néanmoins de faire pression à l’occasion de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la FED prévue les 10 et 11 décembre 2019.
Pression à la baisse pour le rendement des livrets d’épargne
Sur l’ensemble de l’année, le taux d’inflation devrait être proche de 1 % conduisant en cas de respect de la nouvelle formule, à abaisser le taux du Livret A à 0,5 % à compter du 1er février 2020, contre 0,75 % actuellement. Le 1er février 2020 marque la fin de la période de gel décidé en 2017 par le Gouvernement après sa décision de réduire de 5 euros les Allocations personnalisées au logement (APL) et l’application pour la première fois de la nouvelle formule de calcul du taux du Livret A. En vertu de celle-ci, le taux est désormais égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à trois mois, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %.
La rémunération du Livret A est, dans un contexte de taux négatifs, anormale même si les épargnants ne l’estiment pas ainsi. En effet, l’écart avec le rendement des livrets ordinaires atteint 0,5 point sachant que ces derniers sont tirés vers le haut par les taux des livrets réglementés. Le Livret A est un produit coûteux pour les établissements financiers qui le gèrent. Son coût est égal au taux de rendement 0,75 % auquel il faut ajouter les frais de collecte et de gestion qui atteignent 0,3 point, soit au total plus d’un point. Les ressources permettant de rémunérer le Livret A sont de leur côté en baisse. Elles proviennent de deux canaux. Le premier est constitué des intérêts des prêts accordés aux organismes gérant le logement social et de ceux réalisés au profit des collectivités ainsi qu’au profit de l’économie sociale et solidaire. Le deuxième canal de financement correspond aux intérêts des placements financiers, essentiellement constitués de titres du Trésor (bons du Trésor et obligations). Or, les intérêts des prêts immobiliers sont orientés à la baisse quand ceux des titres financiers sont en-dessous de zéro. La Caisse des Dépôts et Consignation qui gère la partie centralisée du Livret, 60 % de l’encours, bénéficie certes des placements du passé qui étaient mieux rémunérés que ceux d’aujourd’hui, mais au fil des années, cette situation s’altère irrémédiablement. Si la raison conduit donc à la baisse des taux de rendement de l’épargne réglementée, la logique politique pourrait amener au statu quo. En effet, l’éventuelle diminution du taux pourrait buter sur l’obstacle des élections municipales prévues au mois de mars 2020.
Si la fixation des taux de l’épargne réglementée est une question éminemment politique, elle est moins sujette à polémique pour les livrets règlementés. Il y a encore quelques années, les banques et en particulier celles en ligne faisaient montre de surenchère en proposant des livrets à taux dopés. Aujourd’hui, la raison est à la décrue. Selon la Banque de France, le taux de rémunération moyen des livrets ordinaires était, en septembre, de 0,22 %. Dans les prochains mois, ce taux devrait fortement diminuer. Plusieurs banques se sont lancées dans des révisions en forte baisse. Depuis le 1er novembre 2019, le Livret d’Epargne Orange de ING est de 0,03 %. Néanmoins, un taux de 1 % est appliqué sur les deux premiers mois dans la limite de 50 000 euros dépôt pour toute ouverture d’un compte courant. Le Livret Orange Bank est désormais rémunéré à 0,3 % contre 0,5 % auparavant. Le taux était de 1 % au début de l’année 2019. À compter du 1er novembre 2019, le taux de rémunération annuel du Livret d’épargne Hello+ est de 0,10 % pour la tranche de 0 à 49 999 euros, de 0,15 % pour la tranche de 50 000 à 99 999 euros et de 0,20 % pour la tranche supérieure ou égale à 100 000 euros. Seul le livret Distingo de PSA banque offre encore un taux élevé sous certaines conditions. Ainsi un taux de 3 % pour deux mois était proposé jusqu’au 15 novembre sous réserve d’un solde minimum de 20 000 euros maintenu entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020 sur le livret. Au-delà de deux mois, le taux est abaissé à 0,8 %. Le Livret Zesto de RCI Bank (Renault) est, de son côté, rémunéré à 0,9 % contre 1 % en début d’année. Les filiales financières des constructeurs automobiles continuent à proposer des rémunérations au-dessus de la moyenne du marché afin de disposer de ressources pour réaliser des prêts aux acheteurs de voitures. En qui concerne les rémunérations des livrets ordinaires, les taux indiqués au-dessus sont brut de fiscalité. Après application du prélèvement forfaitaire unique, le rendement est inférieur à celui de l’épargne réglementée.
Pas de catastrophe en octobre, c’est déjà une bonne nouvelle pour les marchés !
Octobre a toujours une résonance particulière pour les investisseurs « actions » qui ont en mémoire la crise de 1929 ou celle de 1987. Le dixième mois de l’année est souvent propice à des corrections. Tel ne fut pas le cas en 2019. A l’exception de l’indice londonien, tous les grands indices sont en hausse. La bourse britannique est évidemment soumise aux incertitudes entourant le Brexit qui était censé prendre forme le 31 octobre. La situation s’est n »anmoins éclaircie avec la possible ratification de l’accord modifié avec au mois de décembre des élections législatives. Les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis demeurent mais le fil de la négociation n’est pas rompue. Sur le plan de la conjoncture, le ralentissement économique est confirmé mais le scénario catastrophe avec une récession à la clef est pour le moment abandonné.

La baisse de l’inflation et le futur taux du Livret A
Le taux d’inflation est, selon les premières données d’octobre de l’INSEE, désormais nettement inférieur à 1 % en France. En effet, sur un an, les prix à la consommation n’auraient augmenté que +0,7 % en octobre, après +0,9 % le mois précédent. Cette baisse de l’inflation résulterait d’un repli des prix de l’énergie et d’un ralentissement de ceux de l’alimentation. Les prix des produits manufacturés baisseraient moins qu’en septembre et l’inflation dans les services serait inchangée.
Sur un mois, les prix à la consommation reculeraient de 0,1 %, après une baisse de 0,3 % en septembre. Les prix de l’énergie seraient stables, la hausse des prix des produits pétroliers étant compensée par une baisse accentuée du prix du gaz. Ceux des services baisseraient à peine, après une nette contraction en septembre. Enfin, les prix de l’alimentation reculeraient au même rythme que le mois précédent et ceux des produits manufacturés ralentiraient.
Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait à +0,9 %, après +1,1 % en septembre. Sur un mois, il baisserait de 0,1 %, après −0,4 % le mois précédent.
Avec un tel d’inflation, le taux d’inflation devrait être proche de 1 % sur l’ensemble de l’année ce qui devrait provoquer le passage à 0,5 % du taux du Livret A au 1er février 2020, en application de la nouvelle formule après la période de deux ans de gel du taux qui avait été décidé par le Gouvernement en 2017.
La rémunération des livrets d’épargne au plus bas
Selon la Banque de France, le taux de rémunération des livrets ordinaires était de 0,22 % en septembre. En ce qui concerne le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires, il est resté inchangé en septembre 2019 à 0,59 %, en baisse de 6 points de base sur un an (après 0,65 % en septembre 2018). C’est principalement l’évolution de la rémunération des comptes à terme à plus de deux ans qui détermine, jusqu’à présent, l’érosion modérée de la rémunération globale des dépôts depuis un an: – 5 points de base pour les ménages, -6 points pour les sociétés non financières.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| sept- 2019 | juil- 2019 | août-2019 (e) | sept- 2019 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
| Ménages | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,84 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,74 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,35 | 1,40 | 1,38 | 1,35 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| – plan d’épargne-logement | 2,66 | 2,66 | 2,65 | 2,66 |
| SNF | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,18 | 1,21 | 1,19 | 1,18 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,42 | -0,37 | -0,41 | -0,42 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,31 | -0,54 | -0,70 | -0,63 |
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.
La croissance française sur un plateau depuis trois trimestres
Le taux de croissance a été de 0,3 % au 3e trimestre en France comme lors des deux trimestres précédents. La croissance du mois de juillet à septembre a bénéficié d’une légère reprise de la consommation qui a compensé la moindre progression de l’investissement. Le commerce extérieur du fait d’une forte augmentation des importations a contribué de manière négative à la croissance du PIB.
Le taux de croissance annuel devrait se situer entre 1,2 et 1,4 % en 2019. Elle sera inférieure à celle de l’année 2017. Dans un contexte compliqué, la France s’en sort mieux que nombre de ses partenaires. Elle est moins touchée que l’Allemagne par le ralentissement du commerce international et la fin du cycle industriel du fait du caractère plus tertiaire de son économie. La résilience de cette dernière repose également sur le niveau élevé des dépenses publiques.
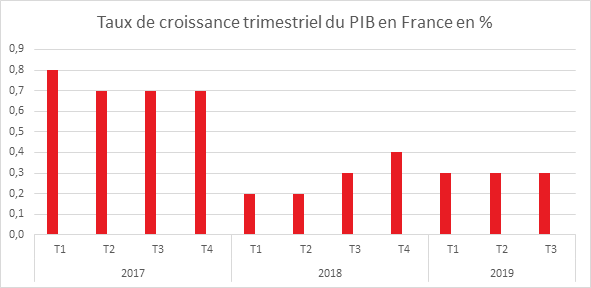
Faut-il verser en 2019 sur son produit d’épargne retraite individuel ?
Avec l’instauration du prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019, un dispositif spécifique de déduction s’applique cette année pour versements sur les produits d’épargne retraite individuels comme le PERP, le Prefon ou le COREM. Pour les épargnants ayant versé moins en 2018 qu’en 2017 sur leurs produits d’épargne retraite, la déduction sera calculée sur la moyenne des versements de 2018 et 2019. Si un titulaire de PERP a versé 10 000 euros en 2017 puis 5000 euros en 2018 et enfin 10 000 euros en 2019. La déduction fiscale sera calculée sur la base d’un versement de 7500 euros pour cette année. En revanche, ceux qui n’auront rien versé en 2017 ne seront pas pénalisés. Il en est de même pour les épargnants qui ont décidé de souscrire un produit d’épargne retraite cette année. Dans ces deux cas toutes les sommes versées, d’ici le 31 décembre, seront déductibles en totalité de leurs revenus imposables, dans la limite de leur enveloppe de déduction de 2019 mais également de celle de 2017, voire de celle de 2018, s’ils ne l’ont pas utilisée ou seulement en partie. Les titulaires de produits d’épargne retraite individuels qui ont maintenus constants leurs versements durant ces deux dernières années ne seront pas touchées.
Pour ceux ont diminué leurs versements en 2018, si seul le critère fiscal compte, ils pourraient avoir intérêt à ne pas effectuer des versements cette année et à ne reprendre leurs versements qu’en 2020. Ils pourront alors utiliser leurs enveloppes de déduction de 2018 et de 2019 puisqu’ils ne les ont pas utilisés ainsi que celle de 2020. Si dans un couple, seul un membre a un plan d’épargne retraite, l’autre peut en souscrire afin d’échapper à la règle instituée dans le cadre de l’année blanche. L’autre option est d’ouvrir un nouveau PER Individuel avant la fin de l’année. La mesure anti-optimisation ne s’applique pas aux versements effectués sur ce nouveau support, commercialisé depuis le 1er octobre dernier.
Les ménages craignent ne plus pouvoir épargner autant qu’ils ne le souhaiteraient
Au mois d’octobre, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique est stable, après neuf mois de hausse. À 104, l’indicateur qui la synthétise demeure au-dessus de sa moyenne de longue période (100). La confiance des ménages au regard de son évolution lors de ces dix dernières années se situe à un niveau relativement élevé. Les gains de pouvoir d’achat jouent sans nul doute favorablement tout comme la baisse du chômage.
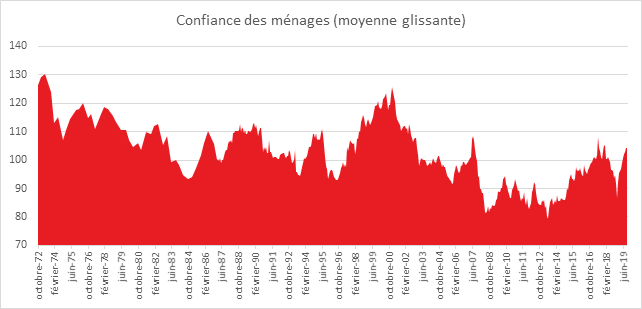
Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée est stable, mais celui relatif à leur situation financière future perd deux points. Ces deux soldes restent au-dessus de leur moyenne de longue période.
Les ménages semblent selon l’enquête de l’INSEE plus enclin à réaliser des achats importants. L’indicateur augmente légèrement par rapport au mois dernier. Le solde correspondant augmente d’un point et reste nettement au-dessus de sa moyenne. De l’intention au passage à l’acte, un écart s’est créé car les dépenses de consommation n’augmentent que faiblement sur moyenne période.
En octobre, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future se détériore nettement. Le solde correspondant baisse de cinq points. Il demeure néanmoins au-dessus de sa moyenne de long terme. Depuis de nombreux mois, les ménages français augmentent leur effort d’épargne. En considérant que leur capacité d’épargne devrait baisser, les ménages peuvent tout à la fois exprimer une angoisse sur l’évolution de la conjoncture ou une volonté de dépenser plus, en particulier à l’occasion des fêtes de fin d’année. La première appréciation semble l’emporter sur la seconde car la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente légèrement. Assez étrangement, ce solde tout en gagnant un point demeure inférieur à sa moyenne de longue période.
Les ménages ont bien conscience que leur pouvoir d’achat s’est amélioré depuis le début de l’année. Ainsi, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie passé en France s’est accru au cours des douze derniers mois augmente de nouveau. Le solde correspondant gagne deux points et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. Cette situation n’est pas amenée à perdurer car ils sont, au mois d’octobre, plus nombreux à considérer que leur niveau de vie futur baissera. Ce jugement explique leur pessimisme sur leurs capacités d’épargne pour l’avenir. Les Français pensent que l’inflation pourrait augmenter dans les prochains mois ce qui nuira à leur pouvoir d’achat.
Ce pessimisme se traduit par un regain d’inquiétude en matière d’emploi. Ainsi, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage augmentent légèrement en octobre. Le solde correspondant regagne un point, après en avoir perdu cinq en septembre comme en août. Il demeure cependant bien au-dessous de sa moyenne de longue période.
Le Coin de l’Epargne du 26 octobre 2019
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 25 octobre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 5 722,15 | +1,52 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 26 958,06 | +0,70 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 8 243,12 | +1,90 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 12 894,51 | +2,07 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 324,47 | +2,43 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 624,68 | +1,26 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 22 799,81 | +1,37 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 2 955,86 | +0,09 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,072 % | +0,015 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,370 % | +0,018 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,805 % | +0,076 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1074 | -0,86 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 503,300 | +0,89 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 61,500 | +3,78 % | 52,973 |
Brexit, en attendant Godot
Le Brexit est reporté à une date à déterminer. Après l’adoption de l’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sous réserve d’examen par les députés britanniques, la possible convocation prochaine des électeurs et la décision des 27 Etats membres de reporter le Brexit, la question du calendrier du départ du Royaume-Uni reste en suspens. Néanmoins, les probabilités d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne a augmenté, ce qui ne peut que satisfaire les investisseurs.
En cette fin de mois d’octobre, la Bourse de Paris a dépassé la barre des 5700 points pour atteindre un de ses plus hauts de l’année, qui sont aussi ses meilleurs niveaux enregistrés depuis décembre 2007, juste avant la grande crise financière. Le Cac 40 a fini la semaine à 5.722,15 points, dans de faibles volumes. L’indice a été notamment porté par les bons résultats du secteur du luxe et par Michelin qui dans un marché difficile, réussit à compenser les baisses des ventes en volume par des hausses de prix. Tous les indices actions ont terminé la semaine en hausse, la palme revenant sans surprise au Footsie londonien.
Aux Etats-Unis, le ralentissement économique se manifeste à travers d’une contraction des bénéfices ce qui est une première depuis plus de trois ans se confirme. Cette baisse est constatée dans les données agrégées des entreprises qui ont publié leurs résultats trimestriels. En prenant en compte les programmes de rachats d’actions, les bénéfices par action ressortent en légère hausse (+3% environ).
Etats-Unis ou la tentation de la facilité budgétaire
Le déficit public au sein de la zone euro est nettement inférieur à 1 % du PIB et tend à se réduire d’année en année quand dans le même temps, le Président Donald Trump met en œuvre une politique de laxisme budgétaire. Ainsi, pour l’exercice qui s’est terminé fin septembre, le déficit a atteint 984 milliards de dollars, selon les données publiées par le département du Trésor. Ce déficit équivaut à 4,6 % du PIB. En un an, il a augmenté de 26 %. Il reste néanmoins inférieur à son record de 2012 (1 100 milliards de dollars). Il y a sept ans, le gouvernement américain gérait encore la sortie de crise à travers des mesures de soutien à l’économie sans précédent. La situation est tout autre en 2019 après dix ans de croissance et avec un taux de chômage historiquement bas.
Si les recettes ont progressé de 4 % grâce notamment aux majorations des droits de douane, les dépenses ont connu une hausse encore plus vive de 8 %. Les pensions de retraites et les frais d’assurance santé pour les plus pauvres (Medicaid) et les plus âgés (Medicare) ont fortement progressé, notamment pour des raisons démographiques. Le déficit budgétaire s’est également accru par une augmentation du service de la dette, à hauteur de 51 milliards de dollars (+10 %) ainsi que par une hausse des dépenses militaires (+9 %) et de l’aide aux agriculteurs qui souffraient de l’escalade des tarifs douaniers entre la Chine et les Etats-Unis.
Les Français plébiscitent le liquide et le garanti
Septembre 2019 a dérogé à la règle selon laquelle le neuvième mois de l’année est peu porteur pour l’épargne financière. Traditionnellement, les dépenses de rentrée scolaire, l’impôt sur le revenu et les impôts locaux à acquitter pèsent sur le niveau de la collecte. Cette année, avec la retenue à la source, la suppression pour 80 % de la population de la taxe d’habitation et les gains de pouvoir d’achat non consommés, le Livret A comme l’assurance vie ont connu un début d’automne florissant.
L’assurance vie maintient toujours le cap
Au mois de septembre 2019, l’assurance vie a poursuivi sur sa lancée avec une collecte nette positive de 2,9 milliards d’euros. Elle est supérieure à celle du mois d’août dernier (2,1 milliards d’euros) et à celle de septembre 2018 (700 millions d’euros). Ce bon résultat de septembre a été porté par la collecte brute (12 milliards d’euros) et par la relative modération des prestations (9,1 milliards d’euros), prouvant ainsi que les Français sont toujours en mode « épargne ». Sur les neuf premiers mois de l’année 2019, la collecte nette atteint 22,3 milliards d’euros contre 17,2 milliards d’euros sur la même période en 2018. L’encours de l’assurance vie atteint un niveau record à 1776 milliards d’euros.
Le Livret A près de la barre des 300 milliards d’euros d’encours
Le Livret A, après six années consécutives de décollecte en septembre, a renoué, cette année, avec une collecte positive à hauteur de 1,06 milliard d’euros. Elle avait été négative de 410 millions en septembre 2018. Il faut remonter à 2012, année de relèvement du plafond et en pleine crise des dette souveraines, pour retrouver en septembre, une collecte positive (+190 millions euros en 2012).
Depuis le mois de janvier 2019, la collecte nette atteint, pour le Livret A, 15,77 milliards d’euros contre 10,93 milliards d’euros sur la même période de 2018. Cette collecte permet au Livret A d’espérer enregistrer son meilleur résultat depuis 2012, année qui avait été marquée par le relèvement du plafond. L’encours à fin septembre frôle la barre historique des 300 milliards d’euros au mois de septembre (299,6 milliards d’euros).
Le Livret de Développement Durable et Solidaire a, de son côté, enregistré une décollecte de 40 millions d’euros au mois de septembre. Ce livret qui est depuis son origine, en 1983, distribué par tous les réseaux quand le Livret A ne le fut qu’à partir de 2009. De ce fait, le LDDS est associé aux comptes courants des ménages. Il fluctue de manière plus fine que le Livret A en fonction de l’évolution des dépenses de ces derniers. Le Livret A est considéré comme un produit d’épargne quand le LDDS est utilisé comme une annexe des comptes courants. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du LDDS reste positive de 3,57 milliards d’euros. L’encours de ce produit est de 111,2 milliards d’euros.
Les produits de taux, inoxydables malgré leur faible rendement
Les livrets réglementés et les fonds euros de l’assurance vie représentent plus de 60 % du patrimoine financier des ménages. Les collectes de septembre confirment la préférence des ménages pour la liquidité et la sécurité. Certes, la part des unités de compte dans la collecte de l’assurance vie a été de 30 % en septembre mais depuis le 1er janvier, elle n’atteint que 24 %.
Progression de l’épargne sur fond de méfiance voire de défiance
Depuis le milieu de l’année dernière, les Français augmentent leur effort d’épargne. Ce phénomène est également constaté à l’étranger. Les signes positifs comme l’amélioration du marché de l’emploi et les gains de pouvoir d’achat n’amènent pas un surcroît de consommation. Cette dernière demeure étale. L’accumulation des menaces (croissance en berne, tensions commerciales sino-américaines, Brexit, dérèglement climatique) semble conduire les ménages à opter pour un comportement de fourmis que de cigales.
Entre effet de précaution et effet d’encaisse
Avec l’augmentation des prix de l’immobilier, les ménages voulant acquérir un logement sont contraints de disposer d’apports personnels plus importants et donc d’épargner en amont davantage. Les taux bas provoquent de manière contre-intuitive une augmentation du taux d’épargne.
L’effet vieillissement
Du fait du vieillissement de la population, une part croissante des ménages est amenée à préparer financièrement sa retraite. Cette motivation est d’autant plus prégnante que le débat sur la future réforme des retraites s’est engagé. 75 % des non-retraités estiment selon l’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa que leurs futures pensions ne leur permettront pas de vivre correctement quand ils seront à la retraite.
Quand trop d’assurance vie en fonds euros devient un problème
Même si la proportion des unités de compte a augmenté en septembre, elle reste très largement minoritaire (24 % sur les 9 premiers mois de l’année). Avec des taux négatifs devenus la règle, la garantie en fonds euros devient un supplice pour les assureurs. Du fait des règles prudentielles en vigueur, cette garantie coûte de plus en plus chère en fonds propres. Elle expose à terme les assureurs à un risque de solvabilité.
Les annonces de plusieurs compagnies d’assurance vie de restreindre l’accès aux fonds euros et d’en limiter le rendement sont intervenues au mois d’octobre. Il conviendra d’analyser les effets de ces déclarations sur les résultats des prochains mois. Naturellement, les épargnants demeurent averses à la prise de risque. Ils sont toujours très sensibles aux variations des marchés financiers.
La réorientation de l’épargne, un chantier toujours en cours
Lors de son intervention au cours de la 11e édition de la Conférence Internationale de la Fédération Française de l’Assurance, vendredi 25 octobre, le Ministre de l’Économie Bruno Le Maire, a insisté sur la solidité du secteur de l’assurance français qui gère près de 2 800 milliards d’euros d’actifs financiers. Il a tenu à rappeler la pertinence des fonds euros et cela malgré la baisse des taux. Il a simplement souligné que ces fonds ne pourront plus être rémunérés à l’avenir aussi bien qu’ils l’ont été dans le passé. Il a demandé aux assureurs d’être clairs sur le sujet et de « faire preuve de pédagogie envers les épargnants pour les orienter sur des placements correspondant à leurs besoins et leur mentionner que l’époque où l’on pouvait cumuler garantie, liquidité et rendement, s’éloigne progressivement ».
Le Ministre de l’Économie a mis en avant lors de son discours la loi PACTE qui a réformé de fond en comble la législation sur les suppléments d’épargne par capitalisation et qui entend donner un nouveau souffle au fonds eurocroissance. Il a jugé que « le nouvel Eurocroissance prévu par la loi PACTE sera plus simple, flexible, plus lisible pour les assurés ».
Afin de réorienter l’épargne vers les entreprises et notamment vers les entreprises de taille intermédiaire, le Ministre souhaite instamment le développement de l’Union des marchés de capitaux au niveau européen. Il se donne trois ans pour bâtir cette union. À cette fin, la directive Solvency II devra être révisée avec à la clef le renforcement de la supervision des activités transfrontalières et l’allègement de la charge prudentielle liée à la détention des actions par les assureurs.
Depuis René Monory et ses SICAV, en 1978, tous les Ministres de l’Économie ou presque ont tenté de favoriser les placements à long terme sans pour autant remettre en cause les avantages dont bénéficient les produits d’épargne de court terme. En 1983, le Ministre de l’Économie et des Finances, Jacques Delors créa le Compte d’Épargne en Actions (CEA). Durant la première cohabitation de 1986, le CEA laisse la place au Plan d’Épargne Retraite, première mouture avant celui prévu par la loi PACTE de 2019. Ce produit PER est supprimé le 31 décembre 1989 au profit du Plan d’Épargne Populaire qui n’a pas vocation à être investi obligatoirement en actions. Il fut supprimé en 2003 par la loi Fillon sur les retraites qui a institué le PERP et le PERCO. En 1992, le Gouvernement de Pierre Bérégovoy décide la création du Plan d’Épargne en Actions (PEA) qui est un compte titre bénéficiant d’avantages fiscaux. Initialement réservé aux actions françaises, il a été élargi, en 2003, aux actions européennes. En 2014, le PEA-PME fut créé. Toujours dans le rayon des produits visant à inciter les Français à placer leur argent sur les marchés financiers, il faut citer le Contrat d’assurance vie DSK, du nom du Ministre de l’Économie et des Finances de l’époque. Il s’agit d’un contrat de capitalisation ou un contrat d’assurance vie dans lequel l’épargne est investie à au moins 50 % dans des actions françaises ou européennes dont une part d’au moins 5 % est affectée à des actifs dits risqués. La commercialisation fut arrêtée le 1er janvier 2005 du fait du remplacement de ces contrats par les contrats dits NSK. Les contrats NSK obéissent aux mêmes règles que les DSK néanmoins les seuils d’actions à détenir sont différents. Pour bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur le revenu après 8 ans, les sommes investies doivent être placées à au moins 10 % dans des actions d’entreprises dites à risque (actions directes, parts d’OPC à risques, de FCPI ou FIP) et au moins 5 % d’actions non cotées. Ce type de contrat n’est plus ouvert à la souscription depuis le 1er janvier 2014. Pourraient être ajoutés à cette longue liste les Fonds de Commun Placement dans l’Innovation et les Fonds de Placement de Proximité. En 2019, la France compte 4 millions de PEA et trois millions d’
Brexit : en attendant Godot
Le Brexit est reporté à une date à déterminer. Après l’adoption de l’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sous réserve d’examen par les députés britanniques, la possible convocation prochaine des électeurs et la décision des 27 Etats membres de reporter le Brexit, la question du calendrier du départ du Royaume-Uni reste en suspens. Néanmoins, les probabilités d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne a augmenté, ce qui ne peut que satisfaire les investisseurs.
En cette fin de mois d’octobre, la Bourse de Paris a dépassé la barre des 5700 points pour atteindre un de ses plus hauts de l’année, qui sont aussi ses meilleurs niveaux enregistrés depuis décembre 2007, juste avant la grande crise financière. Le Cac 40 a fini la semaine à 5.722,15 points, dans de faibles volumes. L’indice a été notamment porté par les bons résultats du secteur du luxe et par Michelin qui, dans un marché difficile, réussit à compenser les baisses des ventes en volume par des hausses de prix. Tous les indices actions ont terminé la semaine en hausse, la palme revenant sans surprise au Footsie londonien.
Aux Etats-Unis, le ralentissement économique se confirme à travers une contraction des bénéfices, ce qui est une première depuis plus de trois ans. Cette baisse est constatée dans les données agrégées des entreprises qui ont publié leurs résultats trimestriels. En prenant en compte les programmes de rachats d’actions, les bénéfices par action ressortent en légère hausse (+3% environ).
Etats-Unis ou la tentation de la facilité budgétaire
Le déficit public au sein de la zone euro est nettement inférieur à 1 % du PIB et tend à se réduire d’année en année quand, dans le même temps, le Président Donald Trump met en œuvre une politique de laxisme budgétaire. Ainsi, pour l’exercice qui s’est terminé fin septembre, le déficit a atteint 984 milliards de dollars, selon les données publiées par le département du Trésor. Ce déficit équivaut à 4,6 % du PIB. En un an, il a augmenté de 26 %. Il reste néanmoins inférieur à son record de 2012 (1 100 milliards de dollars). Il y a sept ans, le gouvernement américain gérait encore la sortie de crise à travers des mesures de soutien à l’économie sans précédent. La situation est tout autre en 2019 après dix ans de croissance et avec un taux de chômage historiquement bas.
Si les recettes ont progressé de 4 % grâce notamment aux majorations des droits de douane, les dépenses ont connu une hausse encore plus vive de 8 %. Les pensions de retraites et les frais d’assurance santé pour les plus pauvres (Medicaid) et les plus âgés (Medicare) ont fortement progressé, notamment pour des raisons démographiques. Le déficit budgétaire s’est également accru par une augmentation du service de la dette, à hauteur de 51 milliards de dollars (+10 %) ainsi que par une hausse des dépenses militaires (+9 %) et de l’aide aux agriculteurs qui souffraient de l’escalade des tarifs douaniers entre la Chine et les Etats-Unis.
Les Français plébiscitent le liquide et le garanti
Septembre 2019 a dérogé à la règle selon laquelle le neuvième mois de l’année est peu porteur pour l’épargne financière. Traditionnellement, les dépenses de rentrée scolaire, l’impôt sur le revenu et les impôts locaux à acquitter pèsent sur le niveau de la collecte. Cette année, avec la retenue à la source, la suppression pour 80 % de la population de la taxe d’habitation et les gains de pouvoir d’achat non consommés, le Livret A comme l’assurance vie ont connu un début d’automne florissant.
L’assurance vie maintient toujours le cap
Au mois de septembre 2019, l’assurance vie a poursuivi sur sa lancée avec une collecte nette positive de 2,9 milliards d’euros. Elle est supérieure à celle du mois d’août dernier (2,1 milliards d’euros) et à celle de septembre 2018 (700 millions d’euros). Ce bon résultat de septembre a été porté par la collecte brute (12 milliards d’euros) et par la relative modération des prestations (9,1 milliards d’euros), prouvant ainsi que les Français sont toujours en mode « épargne ». Sur les neuf premiers mois de l’année 2019, la collecte nette atteint 22,3 milliards d’euros contre 17,2 milliards d’euros sur la même période en 2018. L’encours de l’assurance vie atteint un niveau record à 1776 milliards d’euros.
Le Livret A près de la barre des 300 milliards d’euros d’encours
Après six années consécutives de décollecte en septembre, le Livret A a renoué avec une collecte positive à hauteur de 1,06 milliard d’euros en 2019. Elle avait été négative de 410 millions en septembre 2018. Il faut remonter à 2012, année de relèvement du plafond et en pleine crise des dette souveraines, pour retrouver, une collecte positive à pareille époque (+190 millions euros en 2012).
Depuis le mois de janvier 2019, la collecte nette pour le Livret A atteint 15,77 milliards d’euros contre 10,93 milliards d’euros sur la même période de 2018. Cette collecte permet au Livret A d’espérer enregistrer son meilleur résultat depuis 2012, année qui avait été marquée par le relèvement du plafond. L’encours à fin septembre frôle la barre historique des 300 milliards d’euros au mois de septembre (299,6 milliards d’euros).
De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LLDS) a enregistré une décollecte de 40 millions d’euros au mois de septembre. Depuis son origine en 1983, ce livret est distribué par tous les réseaux quand le Livret A ne le fut qu’à partir de 2009. De ce fait, le LDDS est associé aux comptes courants des ménages. Il fluctue de manière plus fine que le Livret A en fonction de l’évolution des dépenses de ces derniers. Le Livret A est considéré comme un produit d’épargne quand le LDDS est utilisé comme une annexe des comptes courants. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du LDDS reste positive de 3,57 milliards d’euros. L’encours de ce produit est de 111,2 milliards d’euros.
Les produits de taux, inoxydables malgré leur faible rendement
Les livrets réglementés et les fonds euros de l’assurance vie représentent plus de 60 % du patrimoine financier des ménages. Les collectes de septembre confirment la préférence des ménages pour la liquidité et la sécurité. Certes, la part des unités de compte dans la collecte de l’assurance vie a été de 30 % en septembre mais depuis le 1er janvier, elle n’atteint que 24 %.
Progression de l’épargne sur fond de méfiance voire de défiance
Depuis le milieu de l’année dernière, les Français augmentent leur effort d’épargne. Ce phénomène est également constaté à l’étranger. Les signes positifs comme l’amélioration du marché de l’emploi et les gains de pouvoir d’achat n’amènent pas un surcroît de consommation. Cette dernière demeure étale. L’accumulation des menaces (croissance en berne, tensions commerciales sino-américaines, Brexit, dérèglement climatique) semble conduire les ménages à opter pour un comportement de fourmis plutôt que de cigales.
Entre effet de précaution et effet d’encaisse
Avec l’augmentation des prix de l’immobilier, les ménages voulant acquérir un logement sont contraints de disposer d’apports personnels plus importants et donc d’épargner davantage en amont. Les taux bas provoquent de manière contre-intuitive une augmentation du taux d’épargne.
L’effet vieillissement
Du fait du vieillissement de la population, une part croissante des ménages est amenée à préparer financièrement sa retraite. Cette motivation est d’autant plus prégnante que le débat sur la future réforme des retraites s’est engagé. Selon l’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa, 75 % des non-retraités estiment que leurs futures pensions ne leur permettront pas de vivre correctement quand ils seront à la retraite.
Quand trop d’assurance vie en fonds euros devient un problème
Même si la proportion des unités de compte a augmenté en septembre, elle reste très largement minoritaire (24 % sur les 9 premiers mois de l’année). Avec des taux négatifs devenus la règle, la garantie en fonds euros devient un supplice pour les assureurs. Du fait des règles prudentielles en vigueur, cette garantie coûte de plus en plus chère en fonds propres. Elle expose à terme les assureurs à un risque de solvabilité.
Les annonces de plusieurs compagnies d’assurance vie de restreindre l’accès aux fonds euros et d’en limiter le rendement sont intervenues au mois d’octobre. Il conviendra d’analyser les effets de ces déclarations sur les résultats des prochains mois. Naturellement, les épargnants demeurent averses à la prise de risque. Ils sont toujours très sensibles aux variations des marchés financiers.
La réorientation de l’épargne, un chantier toujours en cours
Lors de son intervention au cours de la 11e édition de la Conférence Internationale de la Fédération Française de l’Assurance, vendredi 25 octobre, le Ministre de l’Économie Bruno Le Maire a insisté sur la solidité du secteur de l’assurance français qui gère près de 2 800 milliards d’euros d’actifs financiers. Il a tenu à rappeler la pertinence des fonds euros et cela malgré la baisse des taux. Il a simplement souligné que ces fonds ne pourront plus être rémunérés à l’avenir aussi bien qu’ils l’ont été dans le passé. Il a demandé aux assureurs d’être clairs sur le sujet et de « faire preuve de pédagogie envers les épargnants pour les orienter sur des placements correspondant à leurs besoins et leur mentionner que l’époque où l’on pouvait cumuler garantie, liquidité et rendement, s’éloigne progressivement ».
Lors de son discours, le Ministre de l’Économie a mis en avant la loi PACTE qui a réformé de fond en comble la législation sur les suppléments d’épargne par capitalisation et qui entend donner un nouveau souffle au fonds eurocroissance. Il a jugé que « le nouvel Eurocroissance prévu par la loi PACTE sera plus simple, flexible, plus lisible pour les assurés ».
Afin de réorienter l’épargne vers les entreprises et notamment vers les entreprises de taille intermédiaire, le Ministre souhaite instamment le développement de l’Union des marchés de capitaux au niveau européen. Il se donne trois ans pour bâtir cette union. À cette fin, la directive Solvency II devra être révisée avec à la clef le renforcement de la supervision des activités transfrontalières et l’allègement de la charge prudentielle liée à la détention des actions par les assureurs.
Depuis René Monory et ses SICAV, en 1978, tous les Ministres de l’Économie ou presque ont tenté de favoriser les placements à long terme sans pour autant remettre en cause les avantages dont bénéficient les produits d’épargne de court terme. En 1983, le Ministre de l’Économie et des Finances, Jacques Delors, créa le Compte d’Épargne en Actions (CEA). Durant la première cohabitation de 1986, le CEA laissa la place au Plan d’Épargne Retraite, première mouture avant celui prévu par la loi PACTE de 2019. Ce produit PER fut supprimé le 31 décembre 1989 au profit du Plan d’Épargne Populaire qui n’avait pas vocation à être investi obligatoirement en actions. Il fut supprimé en 2003 par la loi Fillon sur les retraites qui institua le PERP et le PERCO. En 1992, le Gouvernement de Pierre Bérégovoy décida la création du Plan d’Épargne en Actions (PEA) qui est un compte titre bénéficiant d’avantages fiscaux. Initialement réservé aux actions françaises, il fut élargi aux actions européennes en 2003. En 2014, le PEA-PME fut créé. Toujours dans le rayon des produits visant à inciter les Français à placer leur argent sur les marchés financiers, il faut citer le Contrat d’assurance vie DSK, du nom du Ministre de l’Économie et des Finances de l’époque. Il s’agit d’un contrat de capitalisation ou un contrat d’assurance vie dans lequel l’épargne est investie à au moins 50 % dans des actions françaises ou européennes dont une part d’au moins 5 % est affectée à des actifs dits risqués. La commercialisation fut arrêtée le 1er janvier 2005 du fait du remplacement de ces contrats par les contrats dits NSK. Les contrats NSK obéissent aux mêmes règles que les DSK néanmoins les seuils d’actions à détenir sont différents. Pour bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur le revenu après 8 ans, les sommes investies doivent être placées à au moins 10 % dans des actions d’entreprises dites à risque (actions directes, parts d’OPC à risques, de FCPI ou FIP) et au moins 5 % d’actions non cotées. Ce type de contrat n’est plus ouvert à la souscription depuis le 1er janvier 2014. Pourraient être ajoutés à cette longue liste les Fonds de Commun Placement dans l’Innovation et les Fonds de Placement de Proximité. En 2019, la France compte 4 millions de PEA et trois millions d’actionnaires directs. Le recours aux unités de compte et de parts d’OPC est dominant.
Chômage : des inscrits en baisse et une durée en hausse
Malgré le ralentissement de la croissance, le nombre de demandeurs poursuit sa lente baisse. En France (y compris départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 3 616 700 pour la catégorie A. Il diminue de 0,4 % sur le trimestre (-2,4 % sur un an). Pour les catégories A, B, C, ce nombre s’établit à 5 835 800 en diminution de 0,9 % ce trimestre et de 2,0 % sur un an.
Pour la seule France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle en catégorie A s’élève à 3 364 500. Ce nombre a baissé de 0,4 % au cours du troisième trimestre et de 2,4 % sur un an. Pour l’ensemble des catégories, le nombre de demandeurs d’emploi est de 6 196 800.
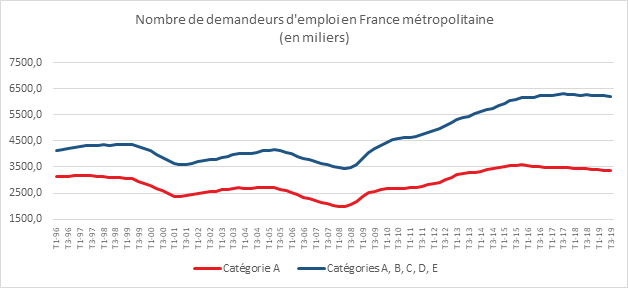
En France métropolitaine, le chômage des moins de 25 ans a augmenté au cours du troisième trimestre de 0,7 % quand il a baissé de 0,6 % pour les 25 / 49 ans et de 0,3 % pour les plus de 50 ans. La diminution des emplois aidés et l’arrivée ou le retour sur le marché du travail après la période estivale peuvent expliquer ce surcroît de chômage chez les jeunes. Sur un an, ces trois catégories d’âge enregistrent une décrue du nombre de demandeurs d’emploi (–0,9 % sur un an pour les moins de 25 ans, -3,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans et -1,3 % pour ceux de plus de 50 ans.
Si la décrue du chômage semble s’inscrire dans la durée, en revanche, l’ancienneté moyenne des demandeurs d’emploi est toujours orientée à la hausse. Elle a atteint e 635 jours au troisième trimestre 2019 (+4 jours par rapport au trimestre précédent). L’obtention d’un emploi est difficile en particulier pour les seniors. 48 % des demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle Emploi depuis plus d’un an. Cette proportion atteint 65 % chez les plus de 50 ans.
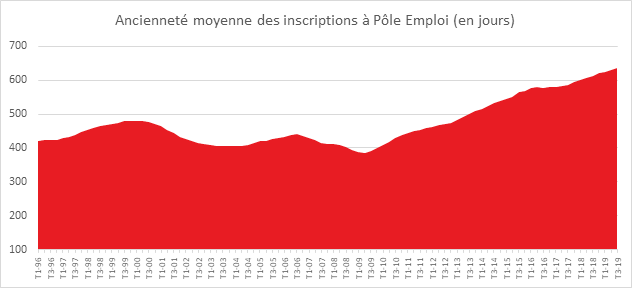
L’économie française croît à une petite vitesse mais de manière stable ce qui est plutôt favorable aux créations d’emploi. Par ailleurs, le nombre de départs à la retraite tend à s’amplifier, environ 800 000 pour l’année. Ces deux facteurs combinés ne peuvent que favoriser la décrue du chômage. La demande d’emploi reste forte dans plusieurs secteurs, services de proximité, tourisme, informatique, digital.
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


