Le Livret A franchit en beauté la barre des 300 milliards d’euros d’encours
Le Livret A prouve au mois de janvier son caractère inoxydable. L’annonce de la baisse du taux du Livret A intervenue au mois de janvier n’a eu aucun effet sur la collecte qui a atteint 4,13 milliards d’euros, soit le même montant que l’année dernière (4,00 milliards d’euros). Comme les années précédentes, le Livret A démarre l’année sur les chapeaux de roues. Pour la première fois de son histoire, l’encours du Livret A dépasse les 300 milliards d’euros (302,7 milliards en janvier contre 298,6 milliards d’euros en décembre). En dix ans, l’encours a progressé de 54 %.
Le mois de janvier se caractérise, en règle générale, par une forte collecte en raison du versement des primes et des étrennes de fin d’année. Lors de ces dix dernières années, deux décollectes sont seulement à signaler, en 2015 (-0,85 milliards d’euros) et en 2016 (-0,81 milliards d’euros). Ces deux dernières s’expliquaient en grande partie par la baisse du rendement du Livret A intervenue au mois d’août de l’année précédente (août 2014 passage de 1,25 à 1 %, août 2015 passage de 1 à 0,75 %). Le passage de 2,25 à 1,75 % annoncé au mois de janvier 2013 n’avait pas eu tout comme en 2020 d’effet négatif sur la collecte qui avait atteint alors 8,21 milliards d’euros. Ce résultat était lié au relèvement du plafond du Livret A qui était passé le 1er janvier 2012 de 19 125 à 22 950 euros
Les ménages, en plus des primes et des étrennes de fin d’année, ont pu épargner sur leur Livret A tout ou partie de l’avance des crédits d’impôt versé par l’administration fiscale le 15 janvier à 9 millions de ménages. Au total, l’Etat a reversé 5,5 milliards d’euros représentant 60 % du montant des crédits d’impôt de l’année 2020.
Les ménages français sont depuis deux ans enclins à maintenir un fort volant d’épargne de précaution en raison des incertitudes sociales et économiques. Les grèves du mois de décembre et de janvier concernant la réforme des retraites ne les ont pas incités à relâcher leur effort. Ils privilégient toujours la sécurité et la liquidité en faisant fi du rendement. Le vieillissement de la population contribue également à l’amplification de l’effort d’épargne. Pour le moment, les ménages ne répondent qu’avec modération aux stimuli des pouvoirs publics en faveur de la réorientation l’épargne vers des placements plus risqués.
La collecte du Livret A obéit à une saisonnalité. Le premier semestre se caractérise par de fortes collectes mensuelles quand le second semestre est marqué quelques mois de décollecte. Le mois de février sera peut être marqué par une baisse de la collecte en raison de l’entrée en vigueur du taux de 0,5 %. Le contexte anxiogène pourrait conduire les ménages français à ne pas relâcher leur effort. Le Livret A en période tourmentée joue le rôle de paratonnerre, de valeur sûre.
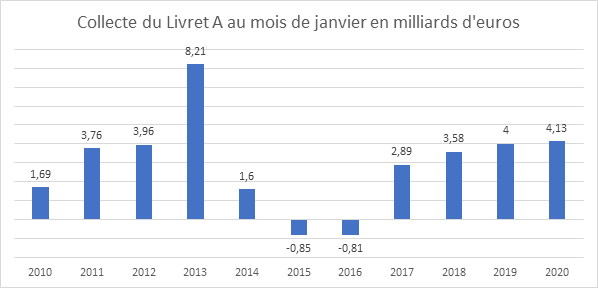
L’Assurance vie, une petite collecte nette sur fond de changement de paradigme
L’assurance vie commence moderato l’année 2020 avec une collecte nette de 500 millions d’euros au mois de janvier. Cette collecte relativement faible au regard des résultats passés est riche d’enseignements.
Un petit trou d’air
Pour trouver une collecte nette plus faible, il faut remonter au mois de décembre 2018 (-700 millions d’euros). Lors de ces dix dernières années, l’assurance vie n’a connu qu’une décollecte au mois de janvier, en 2012, l’année horribilis pour le premier produit d’épargne français. Janvier est traditionnellement un mois correct pour l’assurance vie avec des collectes nettes pouvant atteindre 2,4 milliards d’euros comme en janvier 2018 ou 3,2 milliards d’euros en janvier 2017. Ce petit trou d’air est avant tout imputable à la bonne tenue des rachats.
Pas de réelle défiance à l’encontre du premier produit d’épargne des Français
Avec une collecte brute de 11,8 milliards d’euros, l’assurance vie attire toujours les épargnants. Certes, ce résultat est en léger retrait par rapport au mois de janvier 2019 (12,7 milliards d’euros) et au mois de janvier 2018 (13,4 milliards d’euros) mais il est identique à celui du dernier mois de l’année 2019. Elle est dans la moyenne de ces douze derniers mois. Les Français continuent à placer une part non négligeable de leur épargne sur l’assurance vie et cela malgré les annonces de baisse de rendement intervenues entre le mois de décembre et janvier.
Plus du tiers de la collecte en unités de compte
La proportion d’unités de compte en s’élevant à 34 % symbolise bien la volonté des compagnies d’assurance de limiter le poids des fonds euros et d’inciter les épargnants à porter le risque. La bonne tenue de la bourse facilite la montée en puissance des unités de compte. Certes, il y a un retrait par rapport à décembre, mois durant lequel la proportion d’UC avait atteint 41 %. Ce taux s’expliquait, sans nul doute, par le fait que des compagnies avaient décidé de restreindre l’accès à leurs fonds euros.
Des rachats en hausse
Le montant des rachats et des prestations, 11,3 milliards d’euros au mois de janvier, est en hausse. Il s’élevait à 11 milliards d’euros en décembre 2019 et à 10,6 milliards d’euros au mois de janvier 2019. Le montant des prestations tend à augmenter avec la maturité croissante du produit. Le vieillissement des titulaires de contrats aboutit automatiquement à un accroissement des versements intervenant au moment des décès. Par ailleurs, les ménages effectuent des arbitrages avec l’immobilier qui bat des recors en matière de transactions, plus d’un million en 2019.
En route vers 1800 milliards d’euros d’encours
L’assurance vie devrait atteindre la barrière des 1800 milliards d’euros dans les prochains mois renforçant sa position de numéro un des placements français. Au mois de janvier, l’encours a atteint 1789 milliards d’euros. La résilience du produit n’est plus à prouver. Il semble pouvoir s’adapter à la nouvelle donne imposée par les taux d’intérêt négatifs. Il profite de la forte appétence des Français pour l’épargne. L’assurance vie offre l’accès à une combinaison sécurité, liquidité avec les fonds euros et prise de risques avec les unités de compte. Cette association n’existe dans un aucun autre type de placement.
Le Coin des Epargnants du 21 février 2020 : les taux d’intérêt toujours en baisse
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 21 février 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 6 029,72 | -0,65 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 992,41 | -1,38 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 9 576,59 | -1,59 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 579,33 | -1,20 % | 13 249,01 |
| Footsie | 7 403,92 | -0,07 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 800,38 | -1,06 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 386,74 | -1,27 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 039,67 | +4,21 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,205 % | -0,045 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,494 % | -0,090 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,475 % | -0,103 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1.0856 | +0,23 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 641,230 | +3,57 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 58,240 | +1,66 % | 66,300 |
.
Coup d’arrêt pour les marchés financiers
Les marchés financiers ont réagi de manière négative à la publication de l’indice PMI composite (synthèse entre l’industrie et les services) établi par IHS Markit qui est ainsi tombé sous le seuil critique des 50 points à 49,6, son plus niveau depuis plus de six ans. Le passage en-dessous de 50 est synonyme de contraction de l’activité. L’indice manufacturier américain se maintient au-dessus des 50 mais est en recul de 1,1 point à 50,8, affecté par des retards d’approvisionnements liés à l’apparition du coronavirus. A l’exception du « shutdown » du gouvernement de 2013, le passage en-dessous de 50 de l’indice composite est une première depuis 2009. La détérioration conjoncturelle est en grande partie imputable à l’épidémie de coronavirus, qui se manifeste par un affaiblissement de la demande dans différents secteurs comme les voyages et le tourisme, ainsi que par la baisse des exportations et les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Aux Etats-Unis, les incertitudes liées à la future élection américaine conduisent également les investisseurs à opter pour la prudence. L’indice Dow Jones a reculé cette semaine de près de 1,4 % quand le Nasdaq se contractait de près de 1,6 %. L’or continue à jouer son rôle de valeur refuge avec une hausse en une semaine de 3,6 % portant l’once à 1641 dollars. Les taux d’intérêt continuent leur baisse. Les investisseurs anticipent de plus en plus de nouvelles diminutions de la part des banques centrales de leurs taux directeurs. Le taux d’intérêt de l’Obligation du Trésor français est descendu en-dessous de -0,2 % vendredi 21 février.
Dans la zone euro, l’activité manufacturière a, en revanche, connu une amélioration surprise au mois de février, l’indice préliminaire PMI manufacturier IHS Markit ayant progressé de 0,4 point à 48,4 tout en restant en-dessous de 50. L’indice composite, synthèse entre l’industrie et les services, est en effet ressorti en croissance à 51,6 points dans l’ensemble de la région, un plus haut de six mois.
La vitesse de propagation du coronavirus inquiète de plus en plus la communauté financière. L’épidémie de Covid-19. Plus de 200 nouveaux cas ont été recensés en Corée du Sud. Singapour et le Japon en ont enregistré plus de 85, sans oublier les quelque 600 cas signalés sur le Diamond Princess dans le port de Yokohama.
Plus de 140 milliards d’euros épargnés sur un an
Les ménages français ont, au cours de l’année 2019, accru leur effort d’épargne malgré ou à cause de la baisse des taux d’intérêt. À la fin du troisième trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux.
Le patrimoine financier des ménages est passé du deuxième au troisième trimestre de 5276 à 5367 milliards d’euros. Les produits de taux représentent, avec un encours de 3 477 milliards d’euros, les deux tiers du patrimoine financier des ménages.
Le numéraire et les dépôts à vue ont dépassé, pour la première fois, la barre des 600 milliards d’euros (603,8 milliards d’euros) au troisième trimestre 2019.
Les marchés financiers ont réagi de manière négative à la publication de l’indice PMI composite (synthèse entre l’industrie et les services) établi par IHS Markit tombé sous le seuil critique des 50 points à 49,6, son plus bas niveau depuis plus de six ans, synonyme de contraction de l’activité. L’indice manufacturier américain affecté par des retards d’approvisionnements liés à l’apparition du coronavirus se maintient au-dessus des 50 mais est en recul de 1,1 point à 50,8. A l’exception du « shutdown » du gouvernement fédéral de 2013 sous l’administration Obama, le passage en-dessous de 50 de l’indice composite est une première depuis 2009. La détérioration conjoncturelle est en grande partie imputable à l’épidémie de coronavirus qui se manifeste par un affaiblissement de la demande dans différents secteurs comme les voyages et le tourisme, ainsi que par la baisse des exportations et les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Aux Etats-Unis, les incertitudes liées à la future élection américaine conduisent également les investisseurs à opter pour la prudence. L’indice Dow Jones a reculé cette semaine de près de 1,4 % quand le Nasdaq se contractait de près de 1,6 %. L’or continue à jouer son rôle de valeur refuge avec une hausse en une semaine de 3,6 % portant l’once à 1641 dollars. Les taux d’intérêt continuent leur baisse. Les investisseurs anticipent de plus en plus de nouvelles diminutions de la part des banques centrales de leurs taux directeurs. Le taux d’intérêt de l’Obligation du Trésor français est descendu en-dessous de -0,2 % vendredi 21 février.
Dans la zone euro, l’activité manufacturière a, en revanche, connu une amélioration surprise au mois de février, l’indice préliminaire PMI manufacturier IHS Markit ayant progressé de 0,4 point à 48,4 tout en restant en-dessous de 50. L’indice composite, synthèse entre l’industrie et les services, est en effet ressorti en croissance à 51,6 points dans l’ensemble de la région, un plus haut de six mois.
La vitesse de propagation du coronavirus inquiète de plus en plus la communauté financière. L’épidémie de Covid-19 gagne du terrain. Plus de 200 nouveaux cas ont été recensés en Corée du Sud. Singapour et le Japon en ont enregistré plus de 85, sans oublier les quelques 600 cas signalés sur le Diamond Princess dans le port de Yokohama.
Plus de 140 milliards d’euros épargnés sur un an
Au cours de l’année 2019, les ménages français ont accru leur effort d’épargne malgré ou à cause de la baisse des taux d’intérêt. À la fin du troisième trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux.
Le patrimoine financier des ménages est passé du deuxième au troisième trimestre de 5276 à 5367 milliards d’euros. Les produits de taux représentent, avec un encours de 3 477 milliards d’euros, les deux tiers du patrimoine financier des ménages.
Le numéraire et les dépôts à vue ont dépassé, pour la première fois, la barre des 600 milliards d’euros (603,8 milliards d’euros) au troisième trimestre 2019. Le flux correspondant a été positif au quatrième trimestre (+ 5,8 milliards d’euros), mais en retrait par rapport aux 12,4 milliards d’euros au troisième.
Le flux correspondant a été positif au quatrième trimestre (+ 5,8 milliards d’euros), mais en retrait par rapport aux 12,4 milliards d’euros au troisième.
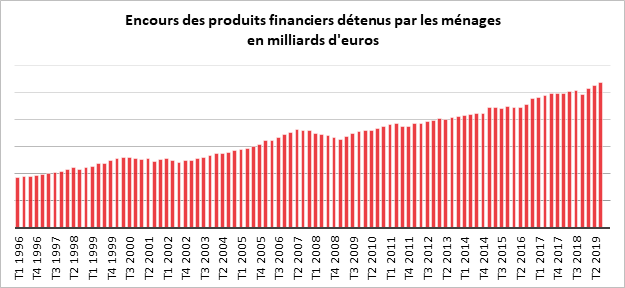
Cercle de l’Épargne – données Banque de France
L’épargne réglementée s’est élevée à 768 milliards d’euros au troisième trimestre contre 764 milliards d’euros au deuxième. Les flux de l’épargne réglementée sont en retrait en fin d’année. Ils sont passés de 5 milliards d’euros au troisième trimestre à 400 millions d’euros au quatrième.
L’assurance vie et l’épargne retraite en fonds euros ont fortement progressé durant le troisième trimestre. Leur encours a atteint 1 722 milliards d’euros contre 1 664,8 milliards d’euros le trimestre précédent.
Les produits de fonds propre ont bénéficié du bon résultat des marchés et ont vu ainsi leur encours progressé. Il est passé de 1 763 à 1 795 milliards d’euros du deuxième au troisième trimestre. En revanche, une décollecte de 2 milliards d’euros est constatée pour les actions, faisant suite à un flux également négatif au deuxième trimestre de 0,5 milliard d’euros. L’encours des actions cotées s’élevait, à la fin du troisième trimestre, à 292 milliards d’euros. Les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite sont en progrès avec un flux positif de 800 millions d’euros. Compte tenu des premières données fournies par la Banque de France, le flux serait positif de 2,1 milliards d’euros au quatrième trimestre. L’encours atteint 378,1 milliards d’euros à fin septembre 2019. Les Français détiennent pour 117,8 milliards d’euros d’action de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC). Les flux en actions via les OPC ont atteint 700 millions d’euros au troisième trimestre 2019.
L’Assemblée nationale et la politique de l’épargne
À l’Assemblée nationale, une mission d’information présidée par Gilles Carrez a été constituée le mercredi 19 février 2020 afin de proposer des solutions pour moderniser la politique de l’épargne dans un contexte de taux bas.
La mission doit, en effet, évaluer les répercussions sur l’épargne de la baisse prolongée des taux des produits d’épargne et de leur maintien à un niveau quasi nul. Pour le moment, malgré ou à cause de la baisse des taux les Français ont tendance à épargner davantage. Pour atteindre leur objectif implicite ou explicite d’épargne, les ménages doivent mettre plus d’argent de côté car celui-ci rapporte moins. À côté de cet effet d’encaisse, l’effet de précaution joue aussi. Les faibles taux, par leur caractère anormal, incitent les ménages à renforcer l’épargne de précaution. Par ailleurs, les bas taux conduisent à un endettement accru en particulier en matière d’immobilier dont les prix augmentent. Il en résulte des remboursements de capital plus importants ce qui alimente l’effort d’épargne. Les Français privilégient les produits sans risque et à forte liquidité. La succession de crises a renforcé leur aversion aux risques. Le vieillissement de la population des épargnants renforce cette tendance.
Les faibles taux d’intérêt touchent les épargnants mais également les compagnies d’assurances dont la solvabilité est mise à mal avec des fonds euros offrant une garantie en capital.
Les pouvoirs publics avec la création des fonds Eurocroissance, le PEA-PME ou le Plan d’Épargne Retraite (PER), tentent depuis de nombreuses années de réorienter l’épargne vers des placements plus « actions ».
La fiscalité de l’épargne est jugée par certains incohérente à travers des incitations réalisées en faveur des produits sans risque et de court terme comme le Livret A d’un côté et des mesures destinées à promouvoir les produits de long terme comme le Plan d’Épargne en Actions ou le Plan d’Épargne en Retraite. Toutes les gammes de produits sont aidés ce qui peut poser un problème de cohérence.
Quand plus personne ne croit à la fin des taux bas
Les marchés financiers pensent que la BCE va conserver très longtemps des taux d’intérêt très bas. Les anticipations sont, en la matière, très nettes. Ainsi, les contrats « futures » (contrats à terme) sur les Euribor à 3 mois à l’échéance 2022 offrent, en février 2020, des taux à -0,4 %. Le taux d’intérêt des obligations de l’État allemand à 10 ans dans 3 ans est de -0,1 % en février 2020.
Au mieux, les marchés financiers pensent que les taux d’intérêt à court terme ne monteront que de 20 points de base en 3 ans et que les taux d’intérêt à long terme ne progresseront que de 35 points de base en 3 ans. Le simple ralentissement de l’économie européenne a amené à une baisse du taux de dépôt de la BCE et à un réenclenchement des opérations de rachats d’actifs. La politique monétaire des grandes zones économiques se japonise, rendant de moins en moins facile la sortie de la nasse des taux bas.
Cette situation est-elle tenable compte tenu des risques des déséquilibres financiers insupportables ?
Les taux bas amèneront une baisse importante des portefeuilles obligataires dans les prochaines années. Compte tenu de la duration moyenne des portefeuilles obligataires des compagnies d’assurance, autour de 7 ans, leur rendement devrait diminuer assez rapidement d’ici 2025. Il devrait être de 0,8 % en moyenne en 2023. Pour les assureurs allemands, la diminution sera encore plus nette (rendement de 0,3 %). Logiquement, les investisseurs devraient se détourner des obligations et les épargnants des fonds euros. Cette désaffection devrait par ricochet aboutir à une remontée des taux sauf en cas d’action contraire de la banque centrale (rachats d’obligations par exemple).
Si les taux d’intérêt à long terme restent très bas, très inférieurs à la croissance (écart de trois points entre le taux de croissance en valeur et les taux), les prix des actifs continueront à augmenter. Le Per (price earning ratio, soit le cours de bourse sur le bénéfice net par action) de l’indice Eurostoxx est passé de 15 à 18 de 2017 à 2020. Hors banques, ces dernières étant pénalisées par les taux bas, le PER atteint désormais 20. Depuis 2010, le prix des logements au sein de la zone euro a augmenté de plus de 20 % quand celui des bureaux et des commerces s’est apprécié de plus de 35 %.
L’augmentation du prix des actifs est susceptible de créer une bulle spéculative. Elle est déconnectée de leur rentabilité et de la croissance économique. Plus l’écart augmente, plus le risque d’éclatement de la bulle s’accroît. Par ailleurs, la valorisation des actifs, de l’immobilier en particulier, contribue à l’appauvrissement des jeunes qui doivent les acquérir à des prix surévalués. Cela provoque un détournement de l’épargne vers des emplois non productifs et de nature spéculative.
Plus les taux d’intérêt à long terme resteront durablement bas, plus les taux d’intérêt moyens sur les dettes continueront à baisser, et se rapprocheront des taux d’intérêt présents. La solvabilité des emprunteurs est conditionnée par le maintien de taux bas et cela d’autant plus que leur niveau d’endettement augmente. La dette des entreprises de la zone euro est passée de 100 à 108 du PIB de 2010 à 2019. Sur la même période, le paiement des intérêts est passé de 2,6 à 1,5 % du PIB. La dette publique a atteint, toujours pour la zone euro, plus de 85 % du PIB en 2019 contre 80 % en 2010. Le service de la dette est passé de 2 7 à 1,4 % du PIB. Les ménages européens sont endettés à hauteur de 58 % du PIB et acquittent des intérêts représentant 0,8 % du PIB en 2019 contre 1,5 % en 2010. Avec un niveau plus élevé d’endettement, tout relèvement de taux est susceptible de provoquer des problèmes de solvabilité en chaîne en mettant, sous tension, les banques.
La remontée des taux qui aurait dû commencer au mois de septembre dernier ouvrait une porte pour retrouver le chemin normal de taux. En la refermant, la BCE s’est compliqué la tâche. La sortie des taux bas sera de plus en plus délicate à organiser compte tenu de l’endettement croissant des acteurs. Au Japon, les taux sont bas depuis 30 ans. La dette publique de plus de 250 % du PIB rend évidemment très difficile toute remontée des taux, surtout si cette dernière ne s’accompagnait pas d’une progression de l’inflation.
Des origines de l’augmentation de la capitalisation boursière
De 1995 à aujourd’hui, la capitalisation boursière des pays de l’OCDE est passée de 43 % à 110 % du PIB. Elle est revenue à son niveau le plus élevé qui avait été auparavant atteint en 1999, avant l’éclatement de la bulle Internet. Après la crise de 2009, cette capitalisation était redescendue à 55 % du PIB.
Cette forte augmentation de la capitalisation boursière ne s’explique pas par la progression du nombre d’entreprises cotées. 14 000 entreprises sont cotées au sein de l’OCDE, en 2019 contre 17 000 en 2003. Compte tenu des contraintes financières et administratives liées à la cotation, des entreprises, en Europe comme aux États-Unis, y renoncent. Par ailleurs, le nombre d’entreprises cotées tend à décliner avec les opérations de concentration.
La valorisation des entreprises résulte de déformation du partage des revenus. Au sein de l’OCDE, les profits après taxes, intérêts et avant dividendes sont passés de 11 à 15 % du PIB de 1995 à 2019. Quand le salaire réel a progressé sur cette même période de 20 %, la productivité par tête a augmenté de près de 40 %. Le changement dans le partage de la valeur ajoutée est à l’origine de de la hausse 33 % de la profitabilité des entreprises, rapportée au PIB.
Le rapport entre le cours de bourse et le bénéfice net par action, ou entre la capitalisation boursière et le bénéfice net (Per) exprime le nombre d’années de bénéfices que l’investisseur est prêt à payer lorsqu’il achète une action. Le Per sur bénéfices futurs est passé de 12 à 18 de 2011 à 2019. Son niveau reste très inférieur à celui qui l’avait atteint en 1999 en pleine bulle Internet. À 19, il se situe dans la moyenne haute de ses vingt dernières années. En tant que tel, ce score ne semble pas signaler l’existence d’une véritable bulle « actions ». L’amélioration des résultats des entreprises justifie, en partie, la valorisation du cours des actions.
Le facteur déterminant pour comprendre l’appréciation du cours des actions est la baisse des taux d’intérêt à long terme surtout au regard du taux de croissance. L’écart est supérieur, en moyenne, à deux points depuis quatre ans. Les actions, en revanche, pâtissent d’une prime de risque relativement élevée. Elle est passée de 1 à 4 de 1995 à 2019. Elle avait atteint un sommet à 10 en 2009 au moment de la crise financière.
Selon l’économiste en c
L’épargne réglementée s’est élevée à 768 milliards d’euros au troisième trimestre contre 764 milliards d’euros au deuxième. Les flux de l’épargne réglementée sont en retrait en fin d’année. Ils sont passés de 5 milliards d’euros au troisième trimestre à 400 millions d’euros au quatrième.
L’assurance vie et l’épargne retraite en fonds euros ont fortement progressé durant le troisième trimestre. Leur encours a atteint 1 722 milliards d’euros contre 1 664,8 milliards d’euros le trimestre précédent.
Les produits de fonds propre ont bénéficié du bon résultat des marchés et ont vu ainsi leur encours progressé. Il est passé de 1 763 à 1 795 milliards d’euros du deuxième au troisième trimestre. En revanche, une décollecte de 2 milliards d’euros est constatée pour les actions, faisant suite à un flux également négatif au deuxième trimestre de 0,5 milliard d’euros. A la fin du troisième trimestre, l’encours des actions cotées s’élevait à 292 milliards d’euros. Les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite sont en progrès avec un flux positif de 800 millions d’euros. Compte tenu des premières données fournies par la Banque de France, le flux serait positif de 2,1 milliards d’euros au quatrième trimestre. L’encours atteint 378,1 milliards d’euros à fin septembre 2019. Les Français détiennent pour 117,8 milliards d’euros d’action de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC). Les flux en actions via les OPC ont atteint 700 millions d’euros au troisième trimestre 2019.
L’Assemblée nationale et la politique de l’épargne
À l’Assemblée nationale, une mission d’information présidée par Gilles Carrez a été constituée le mercredi 19 février 2020 afin de proposer des solutions pour moderniser la politique de l’épargne dans un contexte de taux bas.
Cette mission doit évaluer les répercussions sur l’épargne de la baisse prolongée des taux des produits d’épargne et de leur maintien à un niveau quasi nul. Pour le moment, malgré ou à cause de la baisse des taux, les Français ont tendance à épargner davantage. Pour atteindre leur objectif implicite ou explicite d’épargne, les ménages doivent mettre plus d’argent de côté car celui-ci rapporte moins. À côté de cet effet d’encaisse, l’effet de précaution joue aussi. Les faibles taux, par leur caractère anormal, incitent les ménages à renforcer l’épargne de précaution. Par ailleurs, les bas taux conduisent à un endettement accru en particulier en matière d’immobilier dont les prix augmentent. Il en résulte des remboursements de capital plus importants ce qui alimente l’effort d’épargne. Les Français privilégient les produits sans risque et à forte liquidité. La succession de crises a renforcé leur aversion aux risques. Le vieillissement de la population des épargnants renforce cette tendance.
Les faibles taux d’intérêt touchent les épargnants mais également les compagnies d’assurances dont la solvabilité est mise à mal avec des fonds euros offrant une garantie en capital.
Les pouvoirs publics avec la création des fonds Eurocroissance, le PEA-PME ou le Plan d’Épargne Retraite (PER), tentent depuis de nombreuses années de réorienter l’épargne vers des placements plus « actions ».
La fiscalité de l’épargne est jugée par certains incohérente à travers des incitations réalisées en faveur des produits sans risque et de court terme comme le Livret A, d’un côté, et des mesures destinées à promouvoir les produits de long terme comme le Plan d’Épargne en Actions ou le Plan d’Épargne en Retraite, de l’autre. Toutes les gammes de produits sont aidées, ce qui peut poser un problème de cohérence.
Quand plus personne ne croit à la fin des taux bas
Les marchés financiers pensent que la BCE va conserver très longtemps des taux d’intérêt très bas. Les anticipations en la matière sont très nettes. Ainsi, les contrats « futures » (contrats à terme) sur les Euribor à 3 mois à l’échéance 2022 offrent, en février 2020, des taux à -0,4 %. Le taux d’intérêt des obligations de l’État allemand à 10 ans dans 3 ans est de -0,1 % en février 2020.
Au mieux, les marchés financiers pensent que les taux d’intérêt à court terme ne monteront que de 20 points de base en 3 ans et que les taux d’intérêt à long terme ne progresseront que de 35 points de base en 3 ans. Le simple ralentissement de l’économie européenne a amené à une baisse du taux de dépôt de la BCE et à un réenclenchement des opérations de rachats d’actifs. La politique monétaire des grandes zones économiques se japonise, rendant de moins en moins facile la sortie de la nasse des taux bas.
Cette situation est-elle tenable compte tenu des risques des déséquilibres financiers insupportables ?
Les taux bas amèneront une baisse importante des portefeuilles obligataires dans les prochaines années. Compte tenu de la duration moyenne des portefeuilles obligataires des compagnies d’assurance (autour de 7 ans), leur rendement devrait diminuer assez rapidement d’ici 2025. Il devrait être de 0,8 % en moyenne en 2023. Pour les assureurs allemands, la diminution sera encore plus nette (rendement de 0,3 %). Logiquement, les investisseurs devraient se détourner des obligations et les épargnants des fonds euros. Cette désaffection devrait par ricochet aboutir à une remontée des taux sauf en cas d’action contraire de la banque centrale (rachats d’obligations par exemple).
Si les taux d’intérêt à long terme restent très bas et très inférieurs à la croissance (écart de trois points entre le taux de croissance en valeur et les taux), les prix des actifs continueront à augmenter. Le PER de l’indice Eurostoxx (price earning ratio, soit le cours de bourse sur le bénéfice net par action) est passé de 15 à 18 de 2017 à 2020. Hors banques, ces dernières étant pénalisées par les taux bas, le PER atteint désormais 20. Depuis 2010, le prix des logements au sein de la zone euro a augmenté de plus de 20 % quand celui des bureaux et des commerces s’est apprécié de plus de 35 %.
L’augmentation du prix des actifs est susceptible de créer une bulle spéculative. Elle est déconnectée de leur rentabilité et de la croissance économique. Plus l’écart augmente, plus le risque d’éclatement de la bulle s’accroît. Par ailleurs, la valorisation des actifs, de l’immobilier en particulier, contribue à l’appauvrissement des jeunes qui doivent les acquérir à des prix surévalués. Cela provoque un détournement de l’épargne vers des emplois non productifs et de nature spéculative.
Plus les taux d’intérêt à long terme resteront durablement bas, plus les taux d’intérêt moyens sur les dettes continueront à baisser, et se rapprocheront des taux d’intérêt présents. La solvabilité des emprunteurs est conditionnée par le maintien de taux bas et cela d’autant plus que leur niveau d’endettement augmente. La dette des entreprises de la zone euro est passée de 100 à 108 du PIB de 2010 à 2019. Sur la même période, le paiement des intérêts est passé de 2,6 à 1,5 % du PIB. Toujours pour la zone euro, la dette publique a atteint plus de 85 % du PIB en 2019 contre 80 % en 2010. Le service de la dette est passé de 2 7 à 1,4 % du PIB. Les ménages européens sont endettés à hauteur de 58 % du PIB et acquittent des intérêts représentant 0,8 % du PIB en 2019 contre 1,5 % en 2010. Avec un niveau plus élevé d’endettement, tout relèvement de taux est susceptible de provoquer des problèmes de solvabilité en chaîne en mettant, sous tension, les banques.
Les taux directeurs de la BCE étaient censés remontrer au mois de septembre 2019. En reportant ce processus, la banque centrale s’est compliqué la tâche. Plus longue sera la phase de taux bas, plus difficile leur abandon compte tenu notamment de l’endettement croissant des acteurs. Au Japon, les taux sont bas depuis 30 ans. La dette publique de plus de 250 % du PIB rend évidemment très difficile toute remontée des taux, surtout si cette dernière ne s’accompagnait pas d’une progression de l’inflation.
Des origines de l’augmentation de la capitalisation boursière
De 1995 à aujourd’hui, la capitalisation boursière des pays de l’OCDE est passée de 43 % à 110 % du PIB. Elle est revenue à son niveau le plus élevé qui avait été auparavant atteint en 1999, avant l’éclatement de la bulle Internet. Après la crise de 2009, cette capitalisation était redescendue à 55 % du PIB.
Cette forte augmentation de la capitalisation boursière ne s’explique pas par la progression du nombre d’entreprises cotées. 14 000 entreprises sont cotées au sein de l’OCDE en 2019 contre 17 000 en 2003. Compte tenu des contraintes financières et administratives liées à la cotation, des entreprises, en Europe comme aux États-Unis, y renoncent. Par ailleurs, le nombre d’entreprises cotées tend à décliner avec les opérations de concentration.
La valorisation des entreprises résulte de déformation du partage des revenus. Au sein de l’OCDE, les profits après taxes, intérêts et avant dividendes sont passés de 11 à 15 % du PIB de 1995 à 2019. Quand le salaire réel a progressé sur cette même période de 20 %, la productivité par tête a augmenté de près de 40 %. Le changement dans le partage de la valeur ajoutée est à l’origine de la hausse de 33 % de la profitabilité des entreprises rapportée au PIB.
Le rapport entre le cours de bourse et le bénéfice net par action, ou entre la capitalisation boursière et le bénéfice net (Per) exprime le nombre d’années de bénéfices que l’investisseur est prêt à payer lorsqu’il achète une action. Le Per sur bénéfices futurs est passé de 12 à 18 de 2011 à 2019. Son niveau reste très inférieur à celui qu’il avait atteint en 1999 en pleine bulle Internet. À 19, il se situe dans la moyenne haute de ses vingt dernières années. En tant que tel, ce score ne semble pas signaler l’existence d’une véritable bulle « actions ». L’amélioration des résultats des entreprises justifie, en partie, la valorisation du cours des actions.
Le facteur déterminant pour comprendre l’appréciation du cours des actions est la baisse des taux d’intérêt à long terme surtout au regard du taux de croissance. L’écart est supérieur, en moyenne, à deux points depuis quatre ans. Les actions, en revanche, pâtissent d’une prime de risque relativement élevée. Cette prime est passée de 1 à 4 de 1995 à 2019. Elle avait atteint un sommet à 10 en 2009 au moment de la crise financière.
Selon l’économiste en chef de Natixis, Patrick Artus, la
hausse de la capitalisation boursière de 67 points de PIB s’explique à hauteur
de 73 points par l’écart de taux d’intérêt avec le taux de croissance, à 15
points par la progression de la profitabilité, ces deux ratios étant minorés à
hauteur de 21 points par l’augmentation de la prime de risque
« actions ».
hef de Natixis, Patrick Artus, la hausse de la capitalisation boursière de 67 points de PIB s’explique à hauteur de 73 points par l’écart de taux d’intérêt avec le taux de croissance, à 15 points par la progression de la profitabilité, ces deux ratios étant minorés à hauteur de 21 points par l’augmentation de la prime de risque « actions ».
Les députés, les épargnants et les taux bas
A l’Assemblée nationale, une mission d’information présidée par Gilles Carrez a été constituée le mercredi 19 février 2020 afin de proposer des solutions pour moderniser la politique de l’épargne dans un contexte de taux bas
La mission doit, en effet, évaluer les répercussions sur l’épargne de la baisse prolongée des taux des produits d’épargne et de leur maintien à un niveau quasi nul. Pour le moment, malgré ou à cause de la baisse des taux les Français ont tendance à épargner davantage. Pour atteindre leur objectif implicite ou explicite d’épargne, les ménages doivent mettre plus d’argent de côté car celui rapporte moins. A côté de cet effet d’encaisse, l’effet de précaution joue aussi. Les faibles taux par leur caractère anormal incitent les ménages à renforcer l’épargne de précaution. Par ailleurs, les bas taux conduisent à un endettement accru en particulier en matière d’immobilier dont les prix augmentent. Il en résulte des remboursements de capital plus important ce qui alimente l’effort d’épargne. Les Français privilégient les produits sans risque et à forte liquidité. La succession de crises a renforcé leur aversion aux risques. Le vieillissement de la population des épargnants renforce cette tendance.
Les faibles taux d’intérêt touchent les épargnants mais également les compagnies d’assurances dont la solvabilité est mise à mal avec des fonds euros offrant une garantie en capital.
Les pouvoirs publics avec la création des fonds Eurocroissance, le PEA-PME ou avec le PER tentent depuis de nombreuses années de réorienter l’épargne vers des placements plus « actions ».
La fiscalité de l’épargne est jugée par certains incohérente, incitant tout à la fois les produits sans risque, de court terme comme le Livret A et les produits de long terme comme le Plan d’Epargne en Actions ou le Plan d’Epargne en Retraite. Toutes les gammes de produits sont aidés ce qui peut poser un problème de cohérence.
Le patrimoine financier des ménages : 5367 milliards d’euros au 3e trimestre 2019
Les ménages français ont, au cours de l’année 2019, accru leur effort d’épargne. A la fin du 3e trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux. Leur patrimoine financier est passé du 2e au 3e trimestre de de 5276 à 5367 milliards d’euros
Les ménages français ont, au cours de l’année 2019, accru leur effort d’épargne. A la fin du 3e trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux. Leur patrimoine financier est passé du 2e au 3e trimestre de 5276 à 5367 milliards d’euros. Les produits de taux représentent, avec un encours de 3 477 milliards d’euros, les deux tiers du patrimoine financier des ménages. Le numéraire et les dépôts à vue ont dépassé, pour la première fois, la barre des 600 milliards d’euros (603,8 milliards d’euros) au troisième trimestre 2019. Le flux a été positif au 3e trimestre de 5,8 miliiards d’euros au quatrième trimestre en retrait par rapport aux 12,4 milliards d’euros au troisième.
L’épargne réglementée s’est élevée à 768 milliards d’euros au troisième trimestre contre 764 milliards d’euros au deuxième. Les flux sont en retrait en fin d’année. Ils sont passés de 5 milliards d’euros au troisième trimestre à 400 millions d’euros au quatrième.
L’assurance vie et épargne retraite en fonds euros a fortement progressé durant le troisième trimestre. Son encours a atteint 1722 milliards d’euros contre 1664,8 milliards d’euros le trimestre précédent.
Les produits de fonds propre ont bénéficié du bon résultat des marchés et ont vu ainsi leur encours progressé. Il est passé de 1763 à 1795 milliards d’euros du deuxième au troisième trimestre. En revanche, une décollecte est constatée pour les actions, -2 milliards d’euros faisant suite à un flux également négatif au deuxième trimestre de 0,5 milliard d’euros. L’encours des actions cotées s’élevait à la fin du troisième trimestre à 292 milliards d’euros. Les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite sont en progrès avec un flux positif de 800 millions d’euros. Compte tenu des premières données fournies par la Banque de France, le flux serrait positif de 2,1 milliards d’euros au quatrième trimestre. L’encours atteint 378,1 milliards d’euros à fin septembre 2019. Les Français détiennent pour 117,8 milliards d’euros d’action de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC). Les flux en actions via les OPC ont atteint 700 millions d’euros au troisième trimestre 2019
Retraite, une réforme sur fond de déficits
Entre 2018 et 2030, le« déficit cumulé » du système de retraite français pourrait atteindre 113 milliards d’euros, selon le document envoyé aux partenaires sociaux par le Gouvernement pour la réunion de la « conférence sur l’équilibre et le financement »du mardi 18 février.
La conférence, a pour objectif d’ici la fin du mois d’avril de trouver des solutions afin d’équilibrer les comptes d’ici 2027. L’équation à résoudre est complexe car les partenaires sociaux ne peuvent ni toucher à l’âge légal, ni au montant des cotisations et ni à celui des pensions.
Le document communiqué aux partenaires sociaux montre souligne que les pertes seraient concentrées à la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, qui couvre les salariés du privé, avec un déficit d’un peu plus de 10 milliards d’euros en 2030, et à la CNRACL, la caisse nationale qui prend en charge les fonctionnaires employés par les collectivités locales et les hôpitaux publics (– 6,5 milliards d’euros).Même si le chiffrage demeure encore un peu flou, le passage au régime par points aurait peu d’incidences financières d’ici 2030 (son entrée en vigueur est très progressive et ne commence qu’en 2025 pour les actifs nés après 1975).Le surcroît de dépenses est de 300 millions d’euros à l’horizon 2030, du fait de l’amélioration du minimum de pension. le passage à 28,12 % pour le taux de cotisation devrait générer une augmentation des recettes (+ 900 millions d’euros d’ici à 2030).«
Discussion à haute tension de la réforme des retraites
Plus de 41 000 amendements, la discussion du projet de loi visant à instituer un régime universel par points donne lieu à une bataille parlementaire hors du commun. Les logiciels informatiques permettent aux groupes parlementaires de produire de l’amendements en masse. Les deux prochaines semaines ne permettront pas d’écluser l’ensemble des amendements. Un examen scrupuleux nécessiterait plus de six mois. Pour le moment l’examen est prévu sur deux semaines, une troisième semaine étant possible. L’objectif du Gouvernement est d’obtenir une adoption en première lecture à l’Assemblée nationale avant les élections municipales du 15 et 22 mars prochains. L’adoption définitive a été, de son côté, prévue d’ici la fin juin sachant que l’Assemblée nationale est en travaux durant l’été. La discussion du texte qui a commencé le 17 janvier risque de s’enliser sous le poids des amendements. La majorité peut espérer qu’au fil des jours le nombre de combattants diminue permettant une accélération de l’examen du texte. Il pourra également recourir à la procédure du vote bloqué sur les articles et les amendements pour gagner du temps. Le Premier Ministre pourrait décider d’utiliser l’article 49-3 de la Constitution permettant d’interrompre la discussion et d’obtenir l’adoption du texte sauf en cas de vote d’une motion de censure. Sans nul doute que le Gouvernement n’optera pour cet article qu’après deux ou trois semaines et après souligné l’incapacité technique de poursuivre la discussion. L’hostilité de la CFDT au recours au 49-3 ne facilite pas la tâche de l’exécutif. Le dessaisissement du Parlement devra être préparé d’autant plus que le projet de loi renvoie à de nombreuses ordonnances.
Avant la discussion, le gouvernement a entériné plusieurs modifications. Ainsi, les droits à pension acquis avant le basculement de 2025 seront garantis à 100 % aux personnes nées à partir de 1975. Le montant de la pension correspondant au système actuel qui s’ajoutera à celui du régime par points sera calculé au moment du départ à la retraite et proratisé en fonction du nombre d’années cotisées dans le système actuel. pour les fonctionnaires, le montant de la pension d’ancien régime sera calculée à partir des six derniers mois de rémunération en fin de carrière et non sur les six derniers mois de 2024.
Le Gouvernement a aussi acté l’amélioration du régime de la retraite progressive qui permet à un salarié de réduire son temps de travail sans subir une réduction proportionnelle de son revenu. Ce système qui n’a pour le moment rencontré le succès escompté, pourra continuer d’être ouvert à compter de 60 ans quand dans le projet de loi initial l’âge avait été fixé à 62 ans. Par ailleurs, les salariés soumis aux forfaits jours et les fonctionnaires pourront avoir accès à ce dispositif. Les employeurs devront motiver leur refus en cas de demande d’un de ses salariés.
L’exécutif a également décidé de revoir sa copie pour la réversion en l’accord aux ex-conjoints sous certaines conditions. La réversion sera ainsi dotée de deux dispositifs. Pour le conjoint survivant, les revenus seront garantis à hauteur de 70 %. Pour les ex-conjoints, la réversion se montera à 55 % de la pension du divorcé au prorata de la durée du mariage rapportée à la durée totale d’activité de la personne décédée.
Des aménagements ont été retenus pour les droits familiaux. Les femmes qui élèvent seules leur enfant et qui bénéficient de l’allocation de soutien familial auront accès à des points supplémentaires. Concernant la majoration de 5 % par enfant, le Gouvernement a confirmé que la moitié sera réservée à la mère au titre de la maternité, les 2,5 % seront par défaut attribués à la mère mais ils pourront être partagés avec le père.
Le gouvernement souhaite favoriser le développement du mécénat de compétences par lequel une entreprise met à la disposition d’une association un salarié sur son temps de travail par la « levée des freins juridiques ». Un travail sera aussi engagé sur les « voies et moyens de prévenir la désinsertion professionnelle ».
La prise en compte de la pénibilité est au coeur des négociations entre l’Etat et les partenaires sociaux. Ce sujet comprend la prévention, la reconversion, la réparation. En matière de prévention, l’effort financier devrait passer de 100 à 200 millions d’euros, sachant qu’il est prévu de puiser sur les excédents de la branche accidents du travail et maladie professionnelle pour financer des actions sectorielles. Les branches professionnelles les plus exposées devront négocier des dispositifs. La création d’un congé de reconversion de 6 mois avec maintien du salaire et une enveloppe de 12.500 euros pour la formation est confirmée. Mais le financement de cette enveloppe devra être discuté avec les partenaires sociaux.
Le Coin des Epargnants du 14 février 2020
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 14 février 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 6 071,81 | +0,70 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 29 398,08 | +1,02 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 9 731,18 ( | +2,21 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 744,21 | +1,70 % | 13 249,01 |
| Footsie | 7 409,13 | -0,76 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 840,97 | +1,12 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 687,59 | -0,59 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 917,01 | +1,43 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,160 % | -0,025 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,404 % | -0,020 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,578 % | -0,017 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0844 | -0,92 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 583,837 | +0,88 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 56,820 | +4,37 % | 66,300 |
.
L’économie, les marchés et les virus
Malgré des annonces contrastées sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus et les résultats médiocres de l’économie allemande, les cours des actions ont repris leur marche en avant. Les investisseurs ont retenu avant tout les bons résultats des entreprises, gages d’une distribution importante de dividendes. L’indice Stoxx 600 des grandes valeurs européennes a atteint de nouveaux records vendredi 14 février tout comme le Dax de la Bourse de Francfort, qui se calcule dividendes réinvestis (le Cac 40 dividendes réinvestis n’est qu’à quelques points de ses sommets du 17 janvier). Les indices américains sont également à leur plus haut niveau.
L’Europe joue la prudence
Selon les prévisions économiques de l’hiver 2020 publiées par la Commission de Bruxelles le 13 février dernier, l’économie européenne devrait se maintenir sur une trajectoire régulière de croissance modérée. La zone euro connaît ainsi sa plus longue période de croissance soutenue depuis la création de l’euro en 1999. En 2020 et en 2021, sa croissance devrait être de 1,2 % identique à celle de 2019. Pour l’ensemble de l’UE, un léger recul de la croissance serait constaté à 1,4 % en 2020 et 2021, contre 1,5 % en 2019.
Les prévisions du taux d’inflation (indice des prix à la consommation harmonisé) de la zone euro ont été relevées à 1,3 % pour 2020 et à 1,4 % pour 2021, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage pour chaque année par rapport aux prévisions économiques de l’automne 2019. Cette révision à la hausse est liée à l’apparition de signes semblant indiquer que les hausses de salaires commencent à se répercuter sur les prix à la consommation, et à un léger relèvement des hypothèses de prix du pétrole. En raison de l’épidémie de coronavirus, celui-ci est néanmoins pour le moment en forte baisse. La prévision du taux d’inflation de l’ensemble de l’Union pour 2020 a également été relevée de 0,1 point de pourcentage, à 1,5 %. La prévision pour 2021 reste inchangée, à 1,6 %.
La Commission considère que l’économie européenne pourrait bénéficier de politiques budgétaires plus expansionnistes et propices à la croissance, ainsi que des retombées positives de conditions de financement plus favorables dans certains États membres de la zone euro.
Les autorités européennes ont listé les principales menaces qui pourraient remettre en cause leurs prévisions. Figurent parmi ces menaces l’évolution des relations commerciales américano-chinoises, les problèmes au Moyen Orient, le Brexit et le coronavirus.
La Commission de Bruxelles estime que l’accord commercial de « phase 1 » entre les États-Unis et la Chine contribue à réduire dans une certaine mesure les aléas baissiers, mais le degré élevé d’incertitude qui entoure la politique commerciale des États-Unis empêche toujours une amélioration plus généralisée du climat des affaires. Elle souligne qu’en Amérique latine, les troubles sociaux risquent de peser sur la croissance.
En ce qui concerne les relations commerciales entre l’Union et le Royaume-Uni, si le hard Brexit n’est plus à l’ordre du jour, l’élaboration d’un accord avant la fin de l’année ne sera pas simple.
L’épidémie de coronavirus « Covid-19 » constitue un nouvel aléa baissier, compte tenu de ses conséquences pour la santé publique, l’activité économique et le commerce, en particulier en Chine. L’hypothèse retenue dans le scénario de référence est que le pic de l’épidémie sera atteint au premier trimestre, et que la propagation à l’échelle mondiale sera relativement limitée.
L’Allemagne toujours à l’arrêt
La croissance allemande a été presque nulle au cours du quatrième trimestre 2019, avec une progression du PIB de 0,0279 % par rapport au trimestre précédent, selon l’Office fédéral des statistiques. Sur l’ensemble de l’année, la croissance aura été de 0,6 %. Le gouvernement allemand comptait, il y a quelques semaines, sur une reprise de vitesse et une croissance de 1,1 % en 2020 et de 1,3 % en 2021. Le ralentissement de l’économie chinoise et les incertitudes liées au Brexit ont mis un terme, du moins pour le moment, à ses espoirs.
Au mois de décembre, les exportations n’ont augmenté que de 0,1 %, après une baisse de 2,2 % en novembre. La production a reculé, de son côté, de 3,5 % en décembre, soit la plus forte baisse depuis la crise financière en 2009.
Selon Stefan Schneider, économiste à la Deutsche Bank, l’épidémie pourrait coûter 0,2 point de croissance à l’économie allemande au premier trimestre 2020, a-t-il indiqué à Die Welt.
L’Allemagne est par ailleurs confrontée à une fin de mandat difficile pour Angela Merkel qui doit gérer la crise survenue au sein de la CDU après les élections en Thuringe, crise qui a abouti à la démission annoncée de sa présidente, Annegret Kramp Karrenbauer.
Le difficile chiffrage de l’impact économique de l’épidémie
L’épidémie en cours en Chine a et aura des conséquences sur l’économie mondiale. L’appréciation de son impact reste délicate d’autant plus que nul ne prédire pour le moment de sa durée. Les répercussions sont de plusieurs natures, l’impact sur la demande en Chine, sur les exportations, les importations, la rupture des chaînes d’approvisionnement. Il faut également prendre en compte les facteurs psychologiques. La demande peut être entamée par l’absence de confiance, par les peurs générées par cette crise.
Pour le moment, l’épidémie a peu de conséquences sur les marchés financiers qui après avoir encaissé le choc sont repartis à la hausse. Wall Street et le S&P500 ont atteint de nouveaux plus hauts historiques. Les indices européens enregistrent de bons résultats. En revanche et assez logiquement, l’indice de Shanghai est toujours aussi déprimé par rapport à son niveau antérieur à la crise. La baisse des cours des matières premières (pétrole, cuivre) traduit l’anticipation d’un repli de la demande, essentiellement chinoise.
Le produit régional brut de la province de Hubei, l’épicentre de l’épidémie, représente 4,2 % du produit national. Une forte contraction de la production au sein de cette province devrait se faire ressentir sur l’ensemble du pays. Une possible diminution d’un point de la croissance est envisagée si la crise perdurait jusqu’en avril/mai. Selon une étude du FMI, une baisse de la croissance chinoise de 1 % entraine une contraction de 0,2 point de la croissance pour l’Union européenne à moyen terme. Pour les Etats-Unis, le déficit de croissance serait de 0,3 point et pour l’Asie de 0,7 point. La direction des études économiques de BNP Paribas évalue l’impact maximum sur la croissance à -0,3 % pour l’Europe en prenant en compte les effets indirects sur le commerce international.
2019, un bon cru pour les SCPI
En 2019, la collecte des SCPI Immobilier d’entreprise a atteint, 8,9 milliards d’euros selon l’ASPIM. Leur rendement a été de 4,4% (contre 4,34% en 2018)
La collecte après la baisse de 19 % en 2018 est reparti à la hausse avec une croissance de 68 % par rapport à 2018 et de 36 % par rapport à celle de 2017. Les SCPI ont réalisé pour 9,2 milliards d’éuros d’acquisitions en 2019 (+48%), 63% des acquisitions ont concerné les locaux commerciaux, 12% des établissements de santé, 10 % les EPHAD et résidences de service pour seniors, 4 % l’hôtellerie et 6 % la logistique et locaux d’activité. Les autres catégories (dont le résidentiel, les crèches/écoles, les locaux mixtes) complètent les investissements à hauteur de 5%.
Le taux de chômage en forte baisse en France
L’économie française a connu, en 2019, une faible croissance de 1,2 % qui s’est néanmoins accompagnée d’un nombre important de créations d’emploi, + 260 000. Ces dernières ont permis une forte diminution du taux de chômage. Il a baissé de 0,7 point en 2019 pour s’établir à 8,1 % de la population active. Pour la seule France métropolitaine, il est même repassé sous la barre des 8 % (7,9 %), ce qui n’était pas arrivé depuis la crise de 2008.
Pour le quatrième trimestre 2019, le nombre de chômeurs diminue selon la définition du Bureau International du Travail de 85 000 sur le trimestre, à 2,4 millions de personnes permettant une décrue du taux de chômage de 8,5 à 8,1 %.
Sur un an, le taux de chômage a diminué de 0,8 point pour les personnes de 25 à 49 ans et de 0,6 point pour celles de 50 ans ou plus. Le taux de chômage augmente, en revanche, pour les jeunes de 0,7 point. Pour les jeunes hommes de 15 à 24 ans, le taux de chômage a progressé de 1,3 % quand pour les jeunes femmes, il est en baisse de 0,2 point. Les résultats du chômage traduisent un problème croissant d’employabilité des jeunes hommes en lien avec la diminution de leur niveau scolaire. Ce phénomène marqué en France est constaté également dans de nombreux pays de l’OCDE. L’école n’est plus perçue comme un vecteur d’ascension sociale ou de réussite.
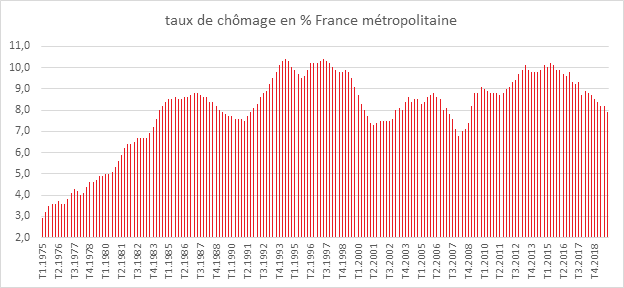
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Le chômage de longue durée en baisse
Parmi les chômeurs, 1,0 million déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée s’établit à 3,2 % de la population active au quatrième trimestre 2019, en baisse de 0,4 point sur un an.
Le halo autour du chômage augmente de nouveau au quatrième trimestre
Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,7 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage. Elles constituent le halo autour du chômage. Leur nombre augmente de 0,2 point sur un an, à 4,0 %, son plus haut niveau depuis 2003.
Le taux d’emploi rebondit au quatrième trimestre 2019
Au quatrième trimestre 2019, le taux d’emploi des 15-64 ans augmente de 0,7 point après avoir reculé le trimestre précédent (–0,3 point). Il s’élève désormais à 65,9 %, en progression de 0,4 point sur un an.
Le taux d’emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) des 15-64 ans atteint 49,3 % au quatrième trimestre 2019. Stable sur un an, il augmente de 0,2 point sur le trimestre. Le taux d’emploi en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim est également en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent et retrouve son niveau de fin 2018. À 7,7 %, il se situe 0,4 point au-dessous de son plus haut niveau, atteint fin 2017.
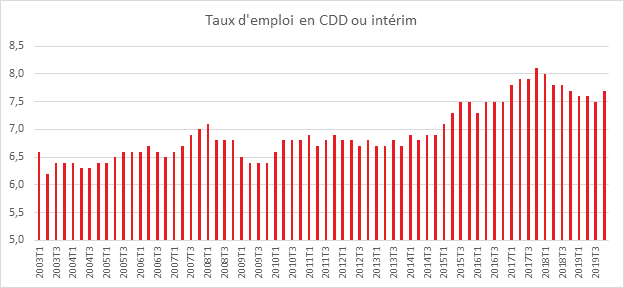
Cercle de l’Epargne – données INSEE
La baisse du taux de chômage est facilitée par l’évolution de la démographie. La population active ne s’accroit que de 100 000 personnes par contre 200 000 il y a encore dix ans. Les départs à la retraite qui avoisinent 800 000 par an contribuent fortement à cette faible progression. Ce phénomène devrait se poursuivre dans les prochaines années. La capacité de l’économie à créer des emplois malgré une faible croissance est plus étonnante et traduit un réel changement. Dans les années 90, il était admis qu’il fallait un taux de croissance de 2 % pour créer des emplois. Aujourd’hui, avec un taux près de deux fois moindre, l’économie crée 260 000 emplois. La tertiarisation de l’activité avec l’essor des services domestiques et des services de logistique (transports, entrepôts, etc.) génère de nombreux emplois. Les services ont connu ) croître ces dernières années malgré le ralentissement de l’industrie. Ce processus est amené à se poursuivre en 2020 avec peut être une moindre force. L’essor du commerce en ligne et des plateformes de services n’est pas sans limite.
La retraite à 70 ans au Japon
Au nom de l’équilibre des régimes des retraites, le gouvernement nippon a adopté des projets de loi visant à porter l’âge de la retraite à 70 ans. Ces projets qui doivent être adoptés par le Parlement sont censés entrer en vigueur en 2021.
Deux projets ont pour but d’encourager les entreprises, en échange de mesures fiscales incitatives, à confier certaines tâches ou des projets philanthropiques à des retraités.
Selon un récente sondage, deux Japonais sur trois de plus de 60 ans souhaitaient pouvoir travailler après 65 ans. 8 millions de Japonais de plus de 65 ans occupent encore un emploi.
Le Coin des Epargnants du 7 février 2020
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 7 février 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 6 029,75 | +3,85 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 29 102,51 | +3,00 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 9 520,51 | +4,04 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 513,81 | +4,10 % | 13 249,01 |
| Footsie | 7 466,70 | +2,48 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 798,49 | +4,33 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 827,98 | +2,68 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 875,96 | -3,38 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,135 % | +0,046 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,384 % | +0,056 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,595 % | +0,066 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0947 | -1,54 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 566,870 | -1,38 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 54,740 | -3,32 % | 66,300 |
Les marchés ne croient pas au pire
Avec les bons résultats de l’emploi et la mobilisation internationale pour lutter contre le coronavirus, les investisseurs ont décidé de revenir sur le marché « actions ». Paris a ainsi signé sa plus forte hausse depuis un an.
L’emploi américain au beau fixe
Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), les Etats-Unis ont créé 225 000 emplois dans le secteur non agricole au mois de janvier, soit plus que les 165 000 anticipés par le consensus Bloomberg. Des conditions climatiques particulièrement clémentes pour la saison ont favorisé l’emploi dans les secteurs de la construction, des loisirs et de l’accueil. Le solde des deux mois précédents a été révisé en hausse de 7 000. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,6% de la population active alors que le marché prédisait sur une stabilisation à 3,5 %. Cela est plutôt une bonne nouvelle. En effet, cela signifie que des personnes qui n’étaient pas sur le marché du travail y viennent reviennent. Le salaire horaire moyen a, de son côté, augmenté de 0,2 % sur un mois et de 3,1% sur un an, contre respectivement +0,3 % et +3 % attendus.
La virulence du coronavirus et la croissance
Le nombre de décès s’élevait vendredi 7 février à 638 (636 en Chine, 1 à Hong Kong et 1 à Singapour). Le nombre de personnes contaminées était toujours vendredi de 31 432 dans le monde (31 161 en Chine). Le taux de mortalité coronavirus est de 2 %. Il reste inférieur à celui du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) qui avait provoqué la mort de 774 personnes dans le monde en 2002-2003.
L’épidémie impacte l’économie de la deuxième puissance mondiale sur trois niveaux, l’offre, la demande et la confiance. Du fait de la fermeture des usines, la production est en baisse. Les revenus des Chinois risquent de baisser en raison de la diminution du nombre d’heures de travail, de l’absence de touristes, etc. Les projets d’investissement sont reportés ce qui aura des conséquences sur la croissance. Les consommateurs étant appelés à ne pas bouger de chez eux, la demande est en berne. Les Chinois diffèrent leurs voyages tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières. De nombreuses compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers la Chine. La confiance qui est essentiel dans les rouages de l’économie est atteinte. La population chinoise voire mondiale doute des capacités des pouvoirs publics à endiguer l’épidémie. La mort du Docteur Li à Wuhan, docteur qui avait été contraint au silence après avoir révélé les dangers du coronavirus a amené à des réactions vives au sein des réseaux sociaux dans un pays où l’expression publique est très régulée. Les autorités chinoises ont décidé la mise en place de soutien à l’économie. Lors de l’épidémie de SRAS, en 2003, son impact avait été évalué sur le PIB chinois à un point pour l’ensemble de l’année. Du fait de l’essor de l’économie chinoise, le manque à gagner sera certainement plus élevé. De même, les effets sur l’ensemble de l’économie mondiale seront plus importants en raison de l’intégration de la Chine dans les chaînes de valeur mondiales. Néanmoins, une épidémie est logiquement un phénomène temporaire qui logiquement s’accompagne d’un rebond (courbe en « V »). Si dans les prochaines semaines, l’augmentation du nombre de victimes se ralentissait, a confiance pourrait commencer à se restaurer. Après un mauvais mois de janvier et de février, l’économie repartirait à partir du mois de mars. Si la décrue du nombre de nouveaux cas tardait, l’économie chinoise voire mondiale connaîtrait une courbe en « U » avec plusieurs mois de mauvais résultats précédant un rebond.
Les investisseurs ont opté cette semaine pour une courbe en « V » avec une reprise assez rapide. Le CAC 40 est ainsi repassé au-dessus de 6000 points. Indice Eurostoxx a gagné en une semaine de plus de 4,3 %. Le Dow Jones a progressé de 3 % et le Nasdaq d’un peu plus de 4 %.
Le pétrole subit de plein les fouets les menaces de ralentissement de la croissance de l’économie mondiale et en premier lieu de la Chine qui est à l’origine d’un tiers des importations. Le baril de Brent est passé en-dessous de 55 dollars cette semaine. En un mois, il a perdu un cinquième de sa valeur.
L’euro, la croissance en berne et l’Allemagne
L’euro est en baisse constante vis-à-vis du dollar depuis plusieurs jours en raison du décalage de croissance de la zone et tout particulièrement de l’Allemagne avec les Etats-Unis. Sur le plan politique, l’imbroglio lié aux élections régionales de Thuringe qui a abouti à l’élection du Président grâce aux voix du parti d’extrême droite, l’Afd, a invité les investisseurs à la prudence vis-à-vis de l’Europe. La Chancelière Angela Merkel a condamné cette alliance conduisant le nouvel élu à démissionner. Cette démission devrait permettre de nouvelles élections régionales dans ce Land du centre de l’Allemagne. L’écho de cette élection est d’autant plus important que le parti Nazi, dans les années 30, avait entamé sa conquête du pouvoir à partir du Thuringe sa conquête du pouvoir.
Les taux des livrets au plus bas
Le taux des livrets bancaires fiscalisés était de 0,16 % au mois de décembre contre 0,17 % au mois de novembre et 0,28 % au mois de décembre 2018. La baisse des taux d’intérêts enregistrés sur les marchés s’est répercutée sur les livrets. Ce mouvement devrait se confirmer en janvier avec l’annonce du passage au 1er février 2020 du taux du Livret A à 0,75 %.
Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires était 0,58 % au cours du dernier trimestre 2019.
Sur un an, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires enregistre une baisse de 5 points de base (0,63 % en décembre 2018).
taux de rémunération en %
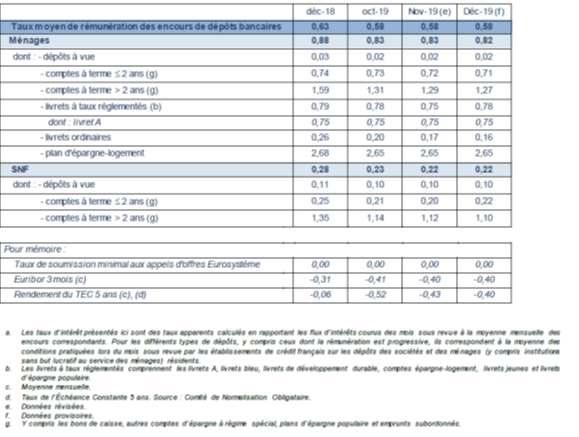
Source : Banque de France
Les ménages ont continué durant l’année 2019 à s’endetter profitant de la nouvelle baisse des taux d’intérêt. La croissance des crédits aux particuliers a été de 6,6 %. Celle des seuls crédits à l’habitat a été de 6,8 %. La production de nouveaux crédits à l’habitat s’établit à 258 milliards d’euros, après 214 milliards d’euros en 2018. Cette hausse s’explique en partie par une reprise des flux de rachats et renégociations (53 milliards d’euros en 2019, après 35 milliards d’euros en 2018). L’endettement des ménages a atteint, à la fin de l’année 2019, 1 302 milliards d’euros dont 1078 milliards d’euros au titre de l’immobilier. Dix ans auparavant, l’endettement global des ménages était de 841 milliards d’euros.
2019, une nouvelle année historique pour les crédits aux particuliers
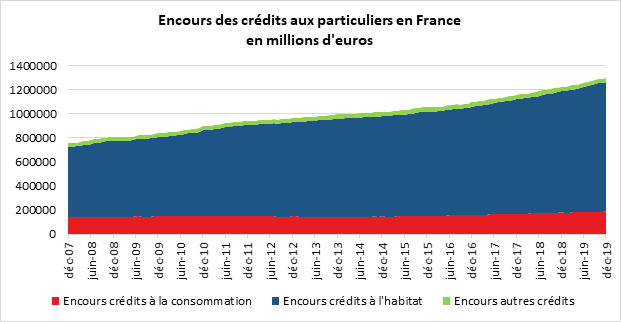
Cercle de l’Épargne – données Banque de France
En 2019, les particuliers ont bénéficié de la nouvelle baisse des taux des crédits à l’habitat qui a dépassé 30 points de base. Pour les emprunts à 10 ans, le taux moyen était de 0,8 % à fin décembre. Le taux d’intérêt moyen de tous les crédits nouveaux à l’habitat s’élevait en décembre à 1,17 %, en recul de 32 points de base sur une année.
En raison de cette nouvelle contraction des taux, les renégociations de prêts sont reparties à la hausse. Fin décembre, ces renégociations représentaient le quart de la production des crédits à l’habitat (après 28,7 % en novembre). En janvier 2017, ce taux avait atteint plus de 60 %.
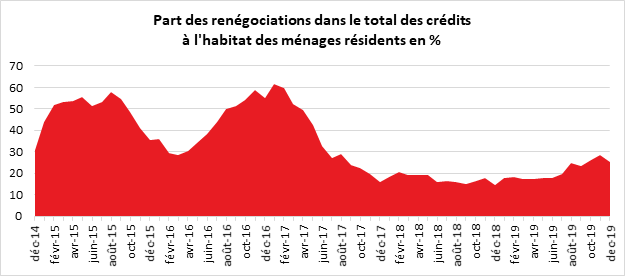
Cercle de l’Épargne – données Banque de France
Face à la progression rapide des crédits à l’habitat, les
pouvoirs publics ont, en fin d’année, demandé aux établissements financiers et
de faire preuve de modération. Il a été rappelé que le ratio 30 % du
revenu pour le remboursement des emprunts devait être respecté. Une
surveillance sur les crédits à très long terme a été également organisée.
Bonne nouvelle pour le financement des retraites, l’emploi se porte bien
Sur l’ensemble de l’année 2019, l’emploi salarié privé a augmenté de 1,1 % (soit +210 000). Ce résultat est meilleur que celui de 2018 obtenu malgré une croissance plus forte (+163 000). Il est, en revanche, inférieur à celui de 2017 (+329 800). Hors intérim, l’emploi salarié privé a augmenté de 1,2 % sur un an (+216 300).
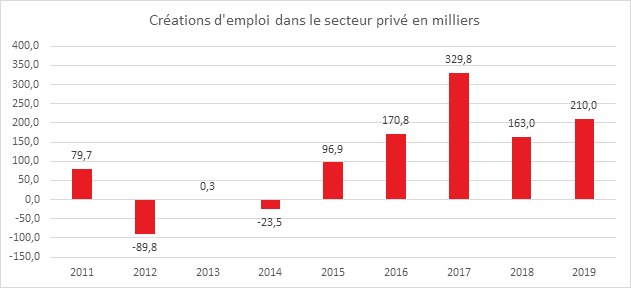
Au quatrième trimestre 2019, l’emploi salarié du secteur privé a, en France, augmenté de 0,2 %. Cette progression intervenue au moment où le PIB se contractait de 0,1 % est réconfortante pour l’économie française Cette hausse est comparable à celle du trimestre précédent. 40 700 créations nettes d’emploi ont été ainsi enregistrés après33 200 au troisième trimestre.
L’emploi salarié privé progresse de nouveau solidement dans la construction : +0,6 % au quatrième trimestre 2019, comme au trimestre précédent (soit +8 100 après +8 900). L’emploi industriel est quasi stable : –0,1 % (soit –1 700), après 0,0 %. Sur un an, l’emploi salarié privé s’accroît de 42 200 dans la construction et de 7 900 dans l’industrie.
Dans les services marchands, l’emploi privé augmente de 0,3 % (soit +31 800), après +0,2 % (soit +22 500) le trimestre précédent, portant à +1,3 % sa hausse sur un an (soit +155 000). Hors intérim, sa progression sur le trimestre est similaire (+0,3 %) et à peine plus dynamique sur l’année (+1,4 %). L’emploi privé dans les services non marchands est quasi stable ce trimestre (+0,1 %) et stable sur l’année (0,0 %). La baisse de l’emploi intérimaire se poursuit : –0,9 % après –0,4 % le trimestre précédent (soit –7 400 après –3 500). Sur un an, il baisse de 0,8 % (soit –6 300).
La bataille parlementaire des retraites a commencé
La Commission spéciale en charge de l’examen du projet de loi sur la réforme des retraites devra étudier plus de 22 000 amendements ont été déposés vendredi, dont 19 000 issus du Groupe parlementaires des Insoumis et 298 par celui de LREM.
La Commission est composée de 71 députés désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires, auxquels s’ajoute un député non inscrit.
Le dépôt d’un aussi grand nombre d’amendements devrait ralentir l’examen du texte. Cette pratique pourrait provoquer l’usage des outils du parlementarisme rationalisé, vote bloqué voir au cours de la discussion, l’article 49-3 de la Constitution. L’usage du 49-3 est compliqué car il aboutit à interrompre la discussion et est assimilé à un coup de force.
Quel que soit la suite du débat, l’ombre porté de la Conférence du financement planera. En effet, logiquement d’ici avril, cette conférence est censée apporter la solution pour assurer l’équilibre des régimes de retraite d’ici 2027.
2019, nouvelle année historique pour le crédit aux particuliers
Les ménages ont continué durant l’année 2019 à s’endetter profitant de la nouvelle baisse des taux d’intérêt. La croissance des crédits aux particuliers a été de 6,6 %. Celle des seuls crédits à l’habitat a été de 6,8 %. La production de nouveaux crédits à l’habitat s’établit à 258 milliards d’euros, après 214 milliards d’euros en 2018. Cette hausse s’explique en partie par une reprise des flux de rachats et renégociations (53 milliards d’euros en 2019, après 35 milliards d’euros en 2018). L’endettement des ménages a atteint à la fin du mois de l’année 2019 1302 milliards d’euros dont 1078 milliards d’euros au titre de l’immobilier. Dix ans auparavant, l’endettement global des ménages était de 841 milliards d’euros.
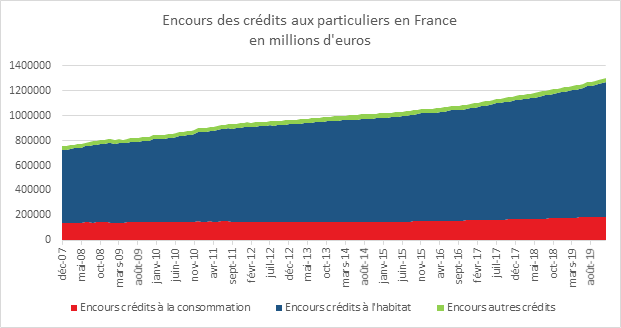
En 2019, les particuliers ont bénéficié de la nouvelle baisse des taux des crédits à l’habitat qui a dépassé 30 points de base. Pour les emprunts à 10 ans, le taux moyen était de 0,8 % à fin décembre. Le taux d’intérêt moyen de tous les crédits nouveaux à l’habitat s’élevait en décembre à 1,17 %, en recul de 32 points de base sur une année.
En raison de cette nouvelle contraction des taux, les renégociations de prêts sont reparties à la hausse. Fin décembre, ces renégociations représentaient le quart de la production des crédits à l’habitat (après 28,7 % en novembre). En janvier 2017, ce taux avait atteint plus de 60 %.
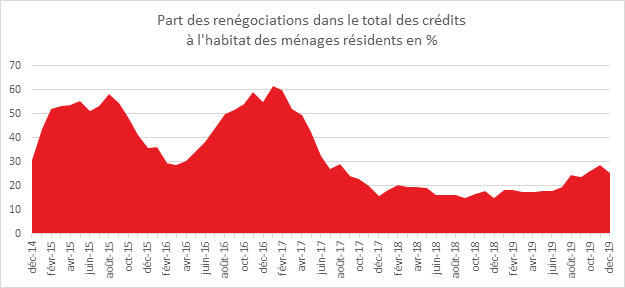
Cercle de l’Epargne – Banque de France
Le taux des livrets bancaires toujours plus bas
Le taux des livrets bancaires fiscalisés était au mois de décembre de 0,16 % contre 0,16 % au mois de novembre et 0,28 % au mois de décembre 2018. La baisse des taux d’intérêts enregistrés sur les marchés s’est répercutée sur les livrets. Ce mouvement devrait se confirmer en janvier avec l’annonce du passage au 1er février 2020 du taux du Livret A à 0,75 %.
Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires était 0,58 % au cours du dernier trimestre 2019. P
Sur un an, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires enregistre une baisse de 5 points de base (0,63 % en décembre 2018).
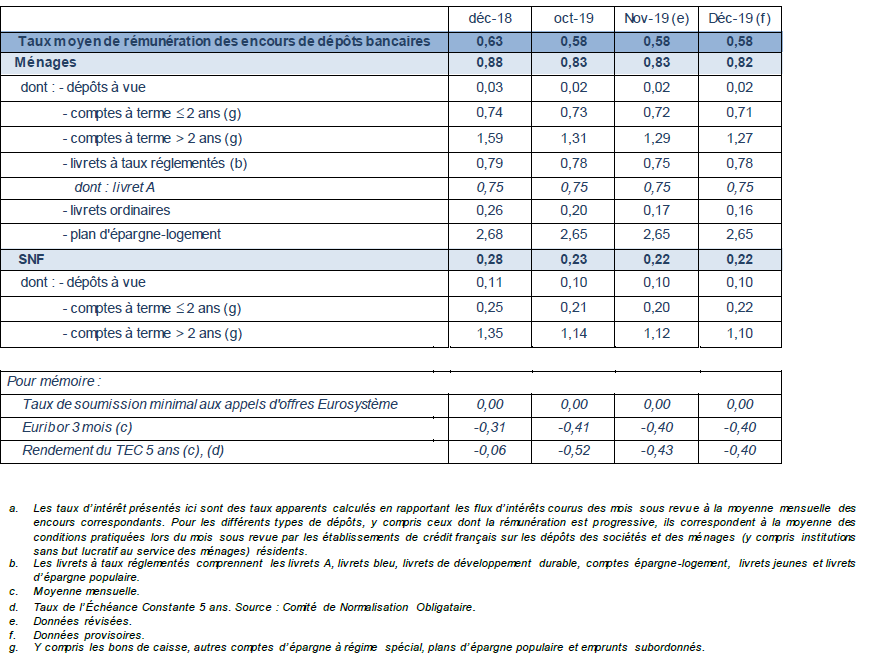
source : Banque de France
Le Coin des Epargnants : coup de froid pour les marchés !
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 31 janvier 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 806,34 | -3,62 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 256,03 | -2,53 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 9 150,94 | -1,76 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 12 981,97 | -4,38 % | 13 249,01 |
| Footsie | 7 286,01 | -3,95 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 640,91 | -3,66 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 205,18 | -2,61 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 976,53 | 0,00 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,181 % | -0,099 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,440 % | -0,112 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,529 % | -0,162 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1079 | +0,48 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 585,740 | +0,95 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 56,080 | -7,69 % | 66,300 |
.
Coup de froid pour les marchés
La décision de l’organisation Mondiale de la Santé de proclamer l’état d’urgence internationale au sujet du coronavirus était assez logique compte tenu de sa diffusion rapide. Au nom du principe de précaution, les compagnies aériennes suspendent les liaisons aériennes avec la Chine. Si le scénario ressemble à celui du SRAS en 2003, il en diffère sur deux points. Premièrement, les autorités chinoises ont été plus transparentes sur l’évolution de la maladie, deuxièmement, la place de la Chine au sein de l’économie mondiale n’est pas celle de 2003. Elle est aujourd’hui la première puissance commerciale et le premier pays du monde.
L’épidémie de SRAS en 2003 avait concerné 7 761 personnes avec 623 décès notifiés au sein de 28 pays. 5 209 cas et 282 décès avaient été enregistrés en Chine. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait également lancé une alerte mondiale encourageant très largement l’isolement et la mise en quarantaine des personnes touchées pour enrayer l’épidémie. L’épidémie de coronavirus en cours a déjà occasionné la mort d’au moins 200 personnes.
Dans ce contexte, les investisseurs ont délaissé les placements actions et ont opté pour les obligations d’Etat sûrs. Les taux d’intérêt sont, de ce fait, à nouveau orientés à la baisse. Le CAC 40 a perdu 3,62 % sur la semaine et 2,87 % sur le mois. Les secteurs de l’automobile, du tourisme et des produits de luxe sont les plus touchés par la baisse des cours étant fortement dépendants du marché chinois. Face à la propagation du virus, 14 provinces et villes chinoises, représentant, selon les calculs de Bloomberg, près de 69 % du PIB national, ont annoncé une prolongation de plus d’une semaine du Nouvel An Lunaire. Cette prolongation a pour conséquence de maintenir à l’arrêt de nombreuses entreprises. Les réouvertures sont désormais prévues, au mieux, pour la deuxième semaine du mois de février au moins. Le constructeur automobile Peugeot a indiqué que les usines PSA de Wuhan resteront fermées jusqu’au 14 février, Valeo et Seb ont prolongé la fermeture de leurs sites dans la ville, tandis qu’Air France a suspendu, leurs vols au départ et à destination de la Chine jusqu’au 9 février. Si la crise épidémiologique perdure, la croissance chinoise pourrait fondre assez rapidement. Certains économistes prévoient même une croissance inférieure à 3 % pour 2020. A la peur du coronavirus s’est ajoutée des mauvaises nouvelles sur le front au sein de la zone euro. Le PIB s’est contracté en France et en Italie (-0,3 %, la plus mauvaise performance trimestrielle depuis 2013).
Dans un contexte économique peu porteur, le baril du pétrole est en forte baisse depuis le début du mois. En un mois, le baril de pétrole Brent a perdu près de 16 % de sa valeur. L’or, valeur refuge par excellence, continue son mouvement haussier. En un mois, l’once d’or a gagné près de 5 %. En un an, la progression dépasse désormais 20 %.

La croissance française cale au 4e trimestre 2019
La croissance française a calé au mois de décembre, victime des grèves et du ralentissement du commerce international. Ainsi, contrairement aux prévisions, au quatrième trimestre 2019, le produit intérieur brut (PIB) en volume a baissé de 0,1 %, contre un gain de +0,3 % au troisième trimestre. En moyenne sur l’année, le taux a été en 2019 de +1,2 % après +1,7 % en 2018.
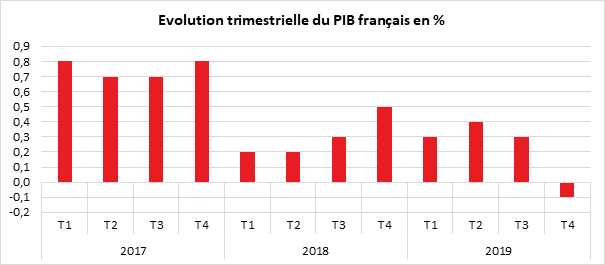
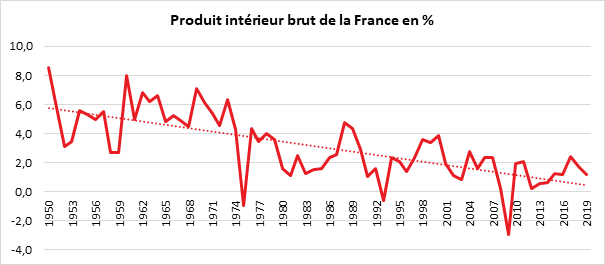
Toutes les composantes de la croissance ont pesé sur son cours. Les dépenses de consommation des ménages n’ont progressé que de 0,2 % au quatrième trimestre contre un gain de 0,4 % au troisième.
La consommation bute sur les grèves de fin d’année
La consommation en biens a été de +0,4 % (après +0,5 %) et celle des services de +0,2 % (après +0,4 %). Elle a souffert des grèves du mois de décembre. Les dépenses de consommation des ménages en biens se sont, en effet, contractés durant le dernier mois de l’année, -0,3 % après +0,7 % en novembre.
Pour le quatrième trimestre, la consommation de biens fabriqués ralentit (+1,2 % après +1,6 %) tandis que les dépenses en énergie baissent (-1,2 % après -0,1 %) en raison notamment de températures clémentes. En revanche, les dépenses alimentaires rebondissent (+0,4 % après -0,7 %).
Sur le dernier trimestre, la consommation de services de transport a fortement reculé (-2,0 %) en relation avec les mouvements sociaux d’octobre et décembre.
En moyenne sur l’année, la consommation des ménages a néanmoins progressé de +1,2 % après +0,9 %. Au regard de l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages, la plus forte enregistrée depuis 2007, cette hausse de la consommation est faible. Cette dernière a augmenté deux fois moins vite que le pouvoir d’achat. Les ménages ont, en grande partie, épargné les gains de pouvoir d’achat générés par les mesures prises après la crise des « gilets jaunes ».
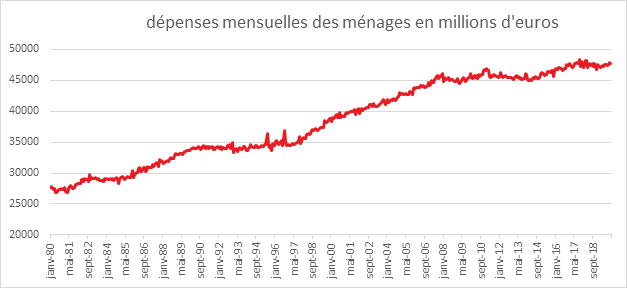
La production industrielle en retrait
La production de biens et services a pâti des grèves. Elle s’est repliée au cours du quatrième trimestre (-0,2 % après +0,3 %). La baisse est forte au niveau des biens (-1,5 % après -0,6 %). En raison des problèmes d’approvisionnement et d’expédition, les industriels ont ralenti leur production. La production manufacturière diminue nettement (-1,6 % après -0,6 %), notamment dans la cokéfaction-raffinage en raison de la maintenance d’une raffinerie et de grèves. La construction est également en recul (-0,3 % après +0,7 %). L’impact des grèves a au niveau des services touché les services.
Sur l’année, la production totale est moins dynamique qu’en 2018 (+1,6 % après +2,0 %). La production manufacturière est en retrait avec une baisse de 0,2 % en 2019, contre une hausse de 0,6 % en 2018 tandis que la production de services ralentit légèrement (+2,2 % après +2,5 %). Au-delà des grèves, l’industrie française a été pénalisée par le ralentissement marqué du commerce international.
L’investissement accélère sur l’année mas freine en fin d’année
Au quatrième trimestre 2019, la FBCF totale ralentit nettement (+0,3 % après +1,3 %). L’investissement des entreprises décélère par rapport au trimestre précédent (+0,3 % après +1,6 %), notamment dans la construction (-0,2 % après +0,9 %), les biens d’équipement et les matériels de transport. L’investissement des ménages ne progresse que de 0,5 %, contre +0,9 % en 2018. Malgré tout, sur fond de taux d’intérêt historiquement bas, l’investissement s’accroît de 3,6 % en 2019 après une hausse de 2,8 % en 2018.
Le commerce extérieur atone
Au quatrième trimestre 2019, les importations ont diminué de 0,2 % comme les exportations. Le repli des livraisons de produits énergétiques et pharmaceutiques est en partie contrebalancé par un rebond des exportations de matériels de transport, avec notamment la livraison d’un paquebot. La contribution des échanges extérieurs à la croissance du PIB est nulle ce trimestre quand elle était négative de 0,3 point au 3e trimestre. Sur l’ensemble de l’année, la contribution du commerce extérieur a été négative de 0,2 point quand en 2018, il avait joué positivement sur la croissance (+0,7 point).
Les variations de stock en phase avec les grèves
Les entreprises ont déstocké en fin d’année en raison des problèmes de transports et du manque de visibilité sur la suite du conflit social.
Au quatrième trimestre 2019, les variations de stocks ont ainsi contribué négativement à la croissance du PIB (-0,4 point après -0,1 point) en particulier dans les matériels de transport et les biens d’équipement.
La croissance française a ralenti en 2019, certes de manière moins forte que celle de l’Allemagne. Elle a été néanmoins handicapée par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les grèves ont entraîné une perte de 0,2 point de croissance, ce qui est un peu plus que prévu. Les entreprises ont réduit fortement la voilure au niveau de la production au mois de décembre. De leur côté, les ménages ont privilégié l’épargne. Un phénomène de rattrapage devrait intervenir au cours du premier trimestre 2020. La croissance française semble se caler autour d’un rythme médiocre. Elle devrait être proche en 2020 de son niveau de 2019. Les effets de l’épidémie en cours en Chine sont encore difficilement évaluables. Un ralentissement du tourisme est à craindre, ce qui toucherait la France plus que l’Allemagne.
Réformes des retraites : conférence de financement, à la recherche du cocktail magique
La Conférence de financement qui commence à compter du 30 janvier 2020 a pour objectif de trouver des solutions autres que les mesures d’âge pour assurer l’équilibre du régime des retraites en 2027, le besoin de financement étant évalué à 12 milliards d’euros.
Les partenaires sociaux et le Gouvernement doivent établir les pistes possibles de financement sachant que les points de divergences entre les parties prenantes sont importants. L’équation à résoudre est difficile car plusieurs paramètres sont, dès le départ, bloqués. Ainsi, cette conférence est censée se conclure sur une augmentation des cotisations ou sur une baisse des pensions. La tentation sera grande de jouer au bonneteau et de déporter le problème du financement.
LES PISTES POSSIBLES
Le report de la date du retour à l’équilibre
Les syndicats sont assez hostiles à lier réforme des retraites et retour de l’équilibre. Ils estiment que le déséquilibre diagnostiqué par le Conseil d’Orientation des Retraites est avant tout la conséquence de la politique de recrutement de l’État. La CFDT juge par ailleurs que l’équilibre ne devrait pas être évalué en 2027 mais en 2032, 10 ans après l’entrée en vigueur de la réforme.
L’affectation des ressources de la CADES à l’équilibre du régime
La Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES), afin de financer le remboursement de la dette accumulée des régimes sociaux, bénéficie comme ressources de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (créée en 1996), d’un pourcentage de la CSG et de versements provenant du Fonds de Réserve des retraite (depuis 2010).
Logiquement, la CADES devait disparaître, comme la CRDS, en 2009. En 1997, la durée de la CADES a été prorogée jusqu’en 2014. En 2004, le Gouvernement décide que la CADES ne disparaîtra qu’au moment de la disparition de la dette sociale. Le Gouvernement d’Édouard Philippe a estimé que l’extinction de la dette pourrait intervenir en 2024. Néanmoins, une partie de la dette de la Sécurité sociale n’a pas été transférée à la CADES et se trouve dans les comptes de l’ACOSS. Par ailleurs, le retour de la Sécurité Sociale à l’équilibre reste hypothétique. Enfin, la CRDS a déjà été préemptée pour financer la montée en puissance des dépenses de dépendance.
En
2018, les apports de la CRDS et de la CSG à la CADES ont porté sur 15 milliards
d’euros et ceux du Fonds de Réserve des Retraite sur 2,1 milliards d’euros.
Le mercato des cotisations, taxes et impôts est ouvert
La France championne des prélèvements obligatoires peut compter sur une longue liste de cotisations, taxes et impôts en tout genre. En jouant sur leur affectation, il est certainement imaginable de dégager 12 milliards d’euros pour le régime vieillesse. La première piste serait de transférer la contribution des entreprises au Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui s’élève à 2,6 milliards d’euros en 2020. Le FNAL finance les allocations logement. Il faudrait, certainement via l’impôt ou une nouvelle taxe, trouver de nouvelles recettes.
L’augmentation de la cotisation de solidarité de 2,81 %
Dans le cadre du futur système de retraite, la cotisation de 28,12 % se décompose en une cotisation de 25,31 % contributrice de droits et une cotisation de solidarité de 2,81 %. La première s’applique jusqu’à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, la seconde s’applique sans plafond. Certains syndicats souhaitent augmenter cette cotisation pour les actifs gagnant au-delà de trois fois le plafond annuel (120 000 euros par an).
La carte de l’amélioration du marché de l’emploi
L’amélioration de la situation de l’emploi est une bonne nouvelle. L’augmentation du nombre d’emplois est une source de cotisations. Par ailleurs, une baisse du chômage pourrait permettre d’affecter une partie des ressources du régime d’indemnisation chômage (essentiellement de la CSG) au régime de retraite. Cette piste avait déjà été évoquée sous François Hollande mais n’avait pas eu de suite en raison de la progression du chômage. Cette solution qui a l’avantage d’être indolore demeure fragile et soumise à l’aléa de la conjoncture.
Le retour de la durée de cotisation
Pour retarder l’âge de départ à la retraite, sans en revenir à l’âge pivot, les négociateurs pourraient réinstituer une durée de cotisation pour une période transitoire. Cette durée qui est actuellement de 41 ans et trois trimestres (générations 1958 à 1960) est censée passer à 43 ans pour les générations nées après 1972. Une accélération de l’allongement de la durée de cotisation pourrait être imaginée d’ici 2027 avec, par exemple, une application des 43 ans pour les générations nées après 1964.
Le versement d’une soulte par l’État
Pour afficher un équilibre dès 2022, l’État pourrait être contraint de verser une soulte. Le taux de cotisation fictif de l’État (taux reconstitué par le Conseil d’Orientation des Retraites qui permet l’équilibre de la retraite des fonctionnaires) est de 74 %. Dans le nouveau système, le taux sera de 28,12 %. Même, en prenant les cotisations sur les primes et les compensations à certaines catégories, l’État devrait être, à terme, gagnant. Afin d’amortir le coût du transfert des retraités des fonctions publiques dans le système du régime universel, une soulte pourrait être prévue.
La tentation des réserves
Pour aboutir à l’équilibre, le Gouvernement pourrait être tenté de demander aux différentes caisses de retraite d’affecter à un fonds d’équilibre une partie de leurs réserves. Pourraient également y figurer le montant des actifs du Fonds de Réserve des Retraites (FRR) qui s’élevait à 32,7 milliards mi-2019. Ce dernier devrait diminuer du fait du versement annuel de 2,1 milliards d’euros à la CADES, et des 4,9 milliards d’euros à rendre à terme au régime des industries électriques et gazières, moins de 17 milliards d’euros sont mobilisables. Selon le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites du mois de novembre 2019, la situation patrimoniale nette du système de retraite était de 127,4 milliards d’euros. Ce fonds pourrait apporter d’ici 2027 au minimum 5 milliards d’euros de revenus annuels sans toucher au capital. Évidemment, cela supposerait que les caisses acceptent de s’en délester, ce qui est peu probable.
La voie difficile des économies
Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics pourraient dégager des économies sur des prestations accessoires aux pensions. La réversion, les majorations pour enfants…, sont des pistes dont certaines sont très sensibles.
L’option du compte notionnel
Cette piste ne devrait pas être abordée. Elle viserait à lier le montant des pensions à un coefficient d’espérance de vie comme cela est le cas en Italie ou en Suède. Il serait possible de lier ce coefficient avec la pénibilité afin de personnaliser en fonction des carrières professionnelles le montant des pensions. Les salariés ayant occupé des emplois pénibles se verraient appliquer un coefficient majorant leur pension. Le principe serait l’application d’un paramètre actuariel dans le système de retraite actuel. Une telle intégration offrirait l’avantage de permettre une réelle retraite à la carte et de s’affranchir des questions d’âge.
**
*
La résolution de l’équation du retour à l’équilibre à paramètres fermés devrait aboutir à l’adoption d’un cocktail associant plusieurs solutions permettant aux parties prenantes de ne pas perdre totalement la face. Le concept d’âge d’équilibre, au cœur du projet de loi du Gouvernement, sera sans doute traduit sous une nouvelle forme pour être présent tout en étant moins visible. Par ailleurs, il est envisageable que le patronat accepte in fine une légère augmentation des cotisations dans le cadre du cocktail précité.
Amélioration du moral des Français
Au mois de janvier 2020, la confiance des ménages dans la situation économique est en nette hausse. L’indicateur de l’INSEE qui le mesure a gagné trois points en un mois et a atteint 104 et reste ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période (100). La baisse du mois de décembre pouvait être mis sur le compte des conflits sociaux dans les transports qui ont pesé sur les achats et les déplacements de fin d’année. Au cours du mois de janvier, les effets des grèves se sont progressivement estompés.
En janvier, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future gagne quatre points après en avoir perdu cinq en décembre. Il repasse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde relatif à leur situation financière passée gagne quant à lui trois points après en avoir perdu deux le mois dernier. Il se maintient au-dessus de sa moyenne. La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement par rapport au mois précédent. L’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle est quant à elle stable pour le quatrième mois consécutif. En janvier, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future augmente de deux points et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période.
Avec l’amélioration du niveau de confiance, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner baisse. L’indicateur correspondant perd deux points et demeure inférieur à sa moyenne. Pour autant, le taux d’épargne demeure élevé. Entre l’intention et sa concrétisation, un écart important subsiste.
Malgré l’augmentation du pouvoir d’achat en 2019, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois est stable. Le solde correspondant se situe néanmoins au-dessus de sa moyenne. Les Français restent pessimistes sur l’évolution à venir de leur niveau de vie. L’indicateur qui le mesure perd un point et demeure en dessous de sa moyenne de longue période.
La baisse du nombre de demandeurs d’emploi et du taux de chômage n’entraînent pas un regain de confiance des ménages en la matière. Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage sont stables en janvier, après avoir augmenté en décembre (+6 points). Le solde d’opinion demeure néanmoins en dessous de sa moyenne de longue période.
En janvier, le solde d’opinion des ménages relatif aux prix passés est stable et demeure inférieur à sa moyenne de longue période. Les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont un peu moins nombreux que le mois précédent. Le solde correspondant perd un point mais demeure quant à lui au-dessus de sa moyenne.
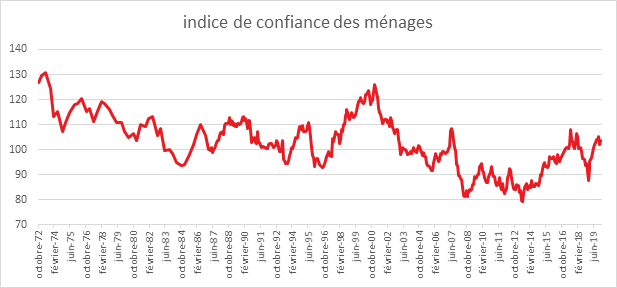
Les marchés financiers touchés par le coronavirus
Le CAC 40 a connu sa plus forte baisse depuis début octobre, baisse provoquée par la propagation du coronavirus dans plus d’une dizaine de pays. La décision de la Chine de prolonger de trois jours les congés du nouvel an lunaire (jusqu’au 2 février inclus) a pour conséquences de mettre en arrêt de nombreuses entreprises du pays. La situation ressemble à ce qui c’était passé en 2003 avec le SRAS qui avait provoqué 800 morts. Le
Les valeurs sensibles aux variations de conjoncture sont touchées. Cela concerne en premier lieu le secteur des matières premières sachant que la Chine est l’un des premiers importateurs mondiaux. Les entreprises de l’industrie lourde ont été également impactées. Avec les mises en quarantaine et la suppression des liaisons aériennes, les secteurs du tourisme et du luxe sont sous pression, Pékin a interdisant la vente de voyages organisés. Accor, Air France-KLM, Lufthansa, IAG (maison mère de British Airways), Hermès, Kering, LVMH, l’Oréal sont exposés.
Les entreprises ayant des établissements à Wuhan ou qui avaient l’intention d’investir dans cette région ont vu leur action chuté.
Cette épidémie intervient après une année décevante pour la Chine qui comptait rebondir à l’occasion du Nouvel An et après la signature de l’accord sino-américain. Première puissance commerciale, première puissance industrielle, la Chine dépend des échanges. Wuhan est une agglomération de 12 millions d’habitants spécialisée dans la sidérurgie, la construction automobile avec notamment des usines PSA et Nissan. Des entreprises d’électroménager dont SEB sont présentes à Wuhan qui est la première ville d’accueil des investissements français en Chine.
Poursuite de la baisse du nombre d’inscrits à Pôle Emploi
Le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi , en catégorie A ; a baissé, en France métropolitaine de 3,1 % en 2019 ; sur le dernier trimestre, la diminution a été de 1,7 % (-55 700). La France métropolitaine comptait par ailleurs à fin décembre dernier, 5 442 900 personnes sans emploi et tenues à en chercher un (catégories A, B et C). Sur un an, la baisse pour ces trois catégories a été de 2,9 %. Elle a été de 1,6 % sur le dernier trimestre 2019.
En France (y compris départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 3 553 700 pour la catégorie A. Il a diminué de 3,3 % sur un an et de 1,7 % sur le dernier trimestre 2019. Pour les catégories A, B, C, ce nombre s’établit à 5 740 200. Il diminue de 3,0 % sur un an et de 1,6 % sur le dernier trimestre.
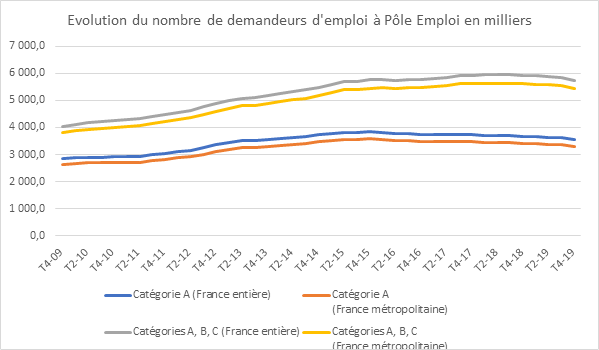
La baisse de nombre de demandeurs d’emploi se poursuit malgré une croissance faible. Cette diminution est la conséquence du maintien d’un bon niveau de créations d’emploi (autour de 260 000 en 2019) et du ralentissement de l’accroissement de la population active.
L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi par âge
Le nombre d’inscrits à Pôle Emploi a diminué pour toutes les catégories d’âge en 2019. La baisse a été de 1,4 % pour les moins de 25 ans, de 4,1 % pour les 25/49 ans et de 2,1 % pour les plus de 50 ans. Si les années précédentes, la diminution était plus forte chez les jeunes, 2019 marque un changement avec une diminution centrée sur les actifs confirmés et non séniors. La baisse est identique pour les hommes et les femmes.
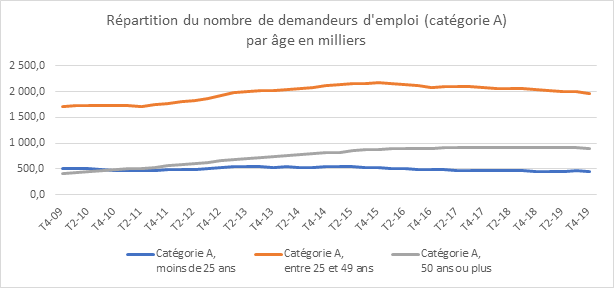
La lente décrue du chômage de longue durée
En France métropolitaine, 2,583 millions de personnes (catégories A, B et C) sont à la recherche d’un emploi depuis plus d’un. Ils représentent 48 % du total des inscrits. Cet enracinement du chômage au sein d’une partie de la population s’est accru avec la crise de 2008. En un an, leur nombre a diminué de 2,5 %.
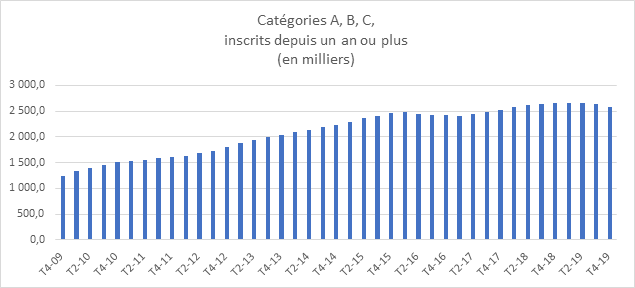
L’ancienneté moyenne des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 641 jours au quatrième trimestre 2019. La durée moyenne d’inscription en catégories A, B, C des demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C au quatrième trimestre 2019 est de 323 jours (+2 jours par rapport au trimestre précédent).
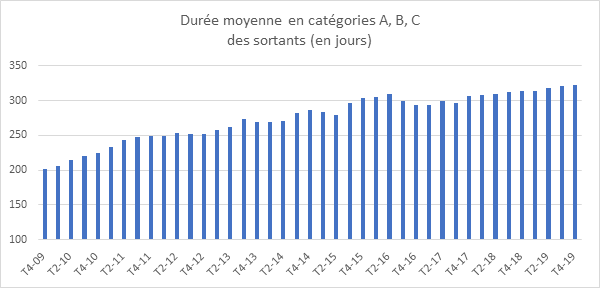
Ce processus de diminution lente mais régulière du chômage devrait se poursuivre en 2020 dans un contexte de départs importants à la retraite, environ 800 000 départs par an dans les prochaines années.
Le Coin des Epargnants du 25 janvier 2020
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 24 janvier 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 6 024,26 | -1,25 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 989,73 | -1,22 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 9 314,91 | -0,79 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 576,68 | +0,37 % | 13 249,01 |
| Footsie | 7 585,98 | -1,15 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 779,16 | -0,76 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 827,18 | -0,89 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 976,53 | -3,22 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | -0,081 % | -0,121 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,328 % | -0,126 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 1,691 % | -0,0138 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,1027 | -0,57 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 571,937 | +0,97 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 60,800 | -6,55 % | 66,300 |
Les marchés et le coronavirus
Cette semaine, les marchés asiatiques ont pâti du début d’épidémie de coronavirus. Les décisions des autorités chinoises de mettre en quarantaine l’agglomération de Wuhan et d’annuler les fêtes du nouvel an chinois à Pékin pourraient fragiliser la croissance du pays. Si les investisseurs avaient été rassurés par l’annonce de l’Organisation Mondiale de la Santé de ne pas déclarer par l’urgence médicale mondiale, ils ont reconsidéré leur position avec la détection de plusieurs cas en France et aux Etats-Unis a, en fin de journée de vendredi. Les autorités suivent de près l’évolution de l’épidémie tout en indiquant qu’en l’état actuel il n’est pas possible de réduire la circulation humaine et donc du virus. Le Ministère des Solidarités et de la Santé dispose depuis les années 2000 de protocoles détaillés pour faire face à une épidémie, plans qui peuvent aller jusqu’à des mises en quarantaine. Les hôpitaux ont reçu les consignes à suivre face à des patients atteints par le coronavirus. Le Ministère s’attend à la détection de nouveaux cas dans les prochains jours.
Au-delà des polémiques, une bonne année pour l’assurance vie
En 2019, l’assurance vie aurait pu souffrir de la baisse des rendements, des polémiques sur l’avenir du fonds euros, or, tel n’a pas été le cas. Bien au contraire, les résultats témoignent de la force de ce produit qui est le premier support d’épargne en France.
Les versements se sont élevés à 144,6 milliards d’euros contre 139,7 milliards d’euros en 2018. En termes de collecte brute, c’est le meilleur de ses vingt dernières années.
De janvier à décembre, la proportion de la collecte en UC est passée de 23 à 41 %. En moyenne, elle a été de 27 % soit le même taux qu’en 2018. La collecte en UC avait été faible en début d’année en raison de la baisse des cours des actions à la fin de l’année 2018. A contrario, la forte progression de la collecte en UC de la fin de l’année s’inscrit dans un contexte financier porteur pour les valeurs actions.
Les prestations ont été, sur l’ensemble de l’année, stables par rapport à 2018 (118,7 milliards d’euros contre 118,2 milliards d’euros). Depuis le début des années 2010, elles ont tendance à augmenter du fait de la maturité croissante du produit et du vieillissement de la population. Les sorties des contrats sont à relier avec le dynamisme du marché immobilier.
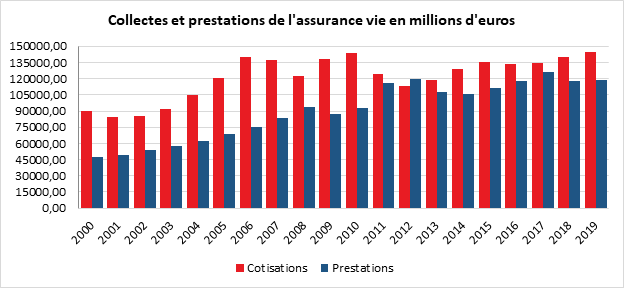
Cercle de l’Épargne – source : FFA
La collecte nette a atteint 25,9 milliards d’euros, le meilleur résultat enregistré depuis 2010 (51 milliards d’euros). En 2018, elle s’était élevée à 21,5 milliards d’euros. Avec ce résultat, l’assurance vie témoigne de sa résilience. En permettant un arbitrage entre la sécurité, la liquidité et le rendement, ce produit répond aux exigences des épargnants. La hausse de la collecte est à relier à celle du taux d’épargne des ménages qui ont choisi de ne pas consommer l’ensemble de leurs gains de pouvoir d’achat.
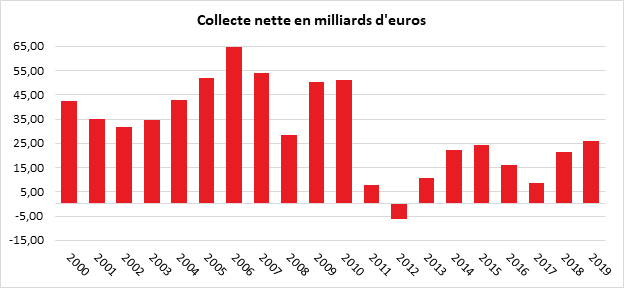
Cercle de l’Épargne – données FFA
L’assurance vie, un produit en évolution permanente
L’assurance vie a connu un essor important dans les années 90 et 2000 grâce au succès du fonds euros qui apportait tout à la fois sécurité, liquidité et rendement. Il a bénéficié alors des taux d’intérêt élevés dans un contexte de désinflation. Le retournement intervenu depuis la grande récession de 2008/2009, avec la mise en œuvre de politique monétaire accommodante, change la donne pour les assureurs comme pour les assurés. L’installation des taux bas voire négatifs sur longue période impose une reformulation de l’assurance vie. La garantie du capital qui est un service, a un coût, un prix qui se matérialise par une diminution des taux de rendement des fonds euros. La recherche de gains supérieurs passe désormais, par une prise de risque accrue, ce qui n’est pas illogique en soi.
Les nouvelles équations de l’assurance vie
Depuis cinq ans, les compagnies d’assurances évoluent dans un environnement de très faibles taux qui remet en cause les fondamentaux de leur principal produit, l’assurance vie. La baisse des taux joue sur le rendement proposé aux assurés mais aussi sur les besoins en capitaux des compagnies qui sont la contrepartie de la garantie offerte dans le cadre des fonds euros. Le coût de cette garantie apparaît au grand jour en période de taux négatifs. L’assurance vie ne peut pas se résumer à un simple produit d’épargne, c’est, aussi, voire avant tout, une prestation de services. La compagnie reçoit l’argent de ses assurés en leur promettant à tout moment, dans le cadre des fonds euros classiques, de leur en restituer l’intégralité.
Les sommes collectées à travers les fonds euros sont affectés entre différentes classes d’actifs selon des règles prudentielles précises. En moyenne, en France, l’actif du fonds en euros de l’assurance-vie en France est principalement composé d’obligations à taux fixe (à 67 %). Le reste est constitué à 7,5 % d’obligations à taux variable, à 7,5 % d’actions set de fonds structurés en actions, à 2,6 % d’obligations indexées sur l’inflation, à 5,9 % d’immobilier, à 1 % en liquidités et à 0,5 % en autres types de placements.
La baisse des taux d’intérêt des obligations de l’État pèse fortement sur le rendement des fonds euros. Ainsi, le taux des Obligations Assimilables du Trésor à 10 ans est passé de 4 % en 2003 à 0 % au cours du second semestre 2019. Les prévisions à dix ans des investisseurs ne dépassent guère le 1 % ce qui traduit le fait que le marché ne croît pas, pour le moment à la remontée des taux d’intérêt.
Selon Patrick Artus, chef économiste de Natixis, le rendement annuel attendu du fonds euros dans sa structure actuelle, ne peut pas dépasser 1 %. Pour obtenir ce résultat, il a retenu un rendement nul pour les obligations d’État, 2 % pour les obligations d’entreprise, 4 % pour l’immobilier et 8 % pour les actions. Ces dernières évaluations de taux sont certainement un peu optimistes.
Compte tenu des règles prudentielles en vigueur, les marges des assureurs pour améliorer le rendement des fonds euros sont faibles. Les régulateurs afin de garantir la sécurité de l’épargne, imposent un coussin de capital de grande taille. La diversification du portefeuille est la réaction normale mais elle a un coût élevé. Pour obtenir du rendement, les assureurs peuvent être tentés d’accroître leurs placements dans l’immobilier commercial qui rapporte autour de 4 %, dans le private equity et dont le rendement est voisin de 8 % ou dans les fonds d’infrastructures (rendement de 5,6 % en 2018).
Cette diversification qui signifie une ouverture accrue aux risques est très consommatrice de fonds propres pour les assureurs. Ainsi, pour les actions cotées des pays occidentaux, le besoin en capital en fonction de l’année d’acquisition varie de 22 à 39 %. Pour des actions cotées d’entreprises issues de pays non-membres de l’OCDE ou non cotées, ce taux est de 49 %. Si les actions sont détenues en face d’engagement retraite, en revanche, le besoin en capital est de 22 %. Pour l’immobilier, ce besoin est de 25 % quand pour les obligations d’État, il varie de 0 à 20 %. Les fonds propres des compagnies d’assurance, depuis l’entrée en vigueur de la directive Solvency II, sont passés, de 2012 à 2019 de 55 à près de 80 milliards d’euros (source Fédération Française de l’Assurance). Pour ne pas peser sur la rentabilité des assureurs, les rendements des fonds propres doivent être élevés, ce qui ne va pas de soi dans le contexte économique actuel.
L’environnement de taux bas impose une clarification en matière d’assurance vie. La garantie en capital a un prix que l’épargnant doit prendre en compte. Il ne peut plus comme dans le passé transférer la totalité du risque sur l’assureur en étant certain d’avoir un rendement relativement correct. Les fonds euros demeurent un outil incontournable pour sécuriser un capital en vue d’un réemploi ou dans le cadre d’une préparation d’une succession. La possibilité de déroger à l’ordre successoral et le maintien d’avantages fiscaux constituent deux atouts non négligeables. Par ailleurs, au-delà de la succession, les gains issus des contrats d’assurance vie de plus de huit ans bénéficient toujours d’un traitement fiscal avantageux avec notamment l’existence de l’abattement de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple.
La bonne année du Livret A
Une très belle année 2019
Malgré la décollecte de 1,6 milliards d’euros de décembre, le Livret A a enregistré un bon niveau de collecte sur l’ensemble de l’année, +12,64 milliards d’euros, la meilleure collecte depuis 2012, année qui avait bénéficié du relèvement du plafond à 22 950 euros. Pour le LDDS la collecte annuelle s’établit à 3,91 milliards d’euros contre 2,62 milliards un an plus tôt.
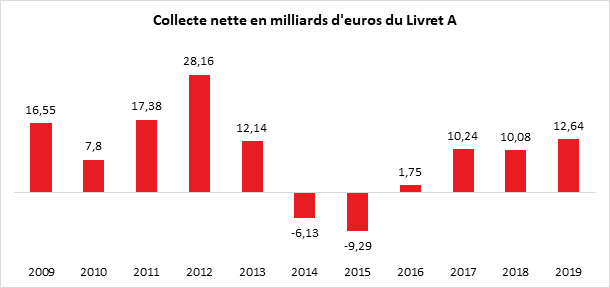
Cercle de l’Epargne – données : Caisse des Dépôts et Consignation
L’encours de ces deux produits a atteint 410,9 milliards d’euros, fin 2019, un niveau record à (avec respectivement 298,6 milliards d’euros pour le Livret A et 112,4 milliards pour le LDDS). Ce résultat traduit l’attachement des Français à la sécurité et la liquidité. En 2019, ménages ont affecté une part non négligeable de leur gain de pouvoir d’achat sur le Livret A. Comme les années précédentes, la collecte du Livret A est marquée par une certaine saisonnalité, avec un premier semestre très fourmi et un second plutôt cigale.
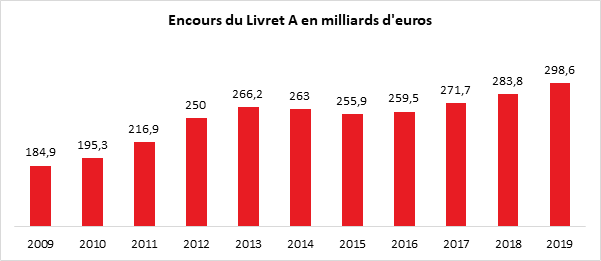
Cercle de l’Epargne – données : Caisse des Dépôts et Consignation
2020, sur fond de baisse des taux
Pour l’année 2020, avec l’annonce de la baisse du taux à 0,5 % devrait occasionner plusieurs mois difficiles pour le Livret A, comme ce fut le cas en 2015. Le passage à 0,75 % du taux de Livret A avait alors donné lieu à 11 mois successifs de décollecte. Il est cependant possible que mouvement soit moins fort en raison de la forte propension des ménages à l’épargne. La multiplication des formes atypiques d’emploi oblige un nombre croissant d’actifs à se constituer une épargne de précaution. L’amélioration de la situation sur le front de l’emploi ne se traduit pas pour le moment par une augmentation de la consommation. La crainte d’un retournement conjoncturel, la succession de conflits sociaux incitent les ménages à conserver d’importantes liquidités. L’augmentation du coût de l’immobilier contraint également à un effort d’épargne supplémentaire. Cet effort est enfin nourri par le vieillissement de la population.
L’assurance vie et le droit successoral : un élément de souplesse bien utile
Un rapport technique sur la réserve héréditaire remis au garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le 13 décembre 2019 préconise de mettre l’assurance vie dans l’actif successoral des défunts. « Sans préjudice des dispositions fiscales propres à l’assurance […], cette étude propose de […] de soumettre l’assurance vie au droit commun des successions et des libéralités ». Actuellement, l’assurance vie est « hors succession » au patrimoine du défunt. Il échappe ainsi au calcul de la part réservataire même si la jurisprudence a fixé des limites au cessions à des tiers non réservataires du patrimoine du défunt via l’assurance vie. L’étude revient donc sur une des souplesses clef des contrats d’assurance vie. Avec l’allongement de l’espérance de vie, avec la diminution du nombre de mariages avec la multiplication des divorces, il n’est pas inutile de pouvoir échapper aux règles successorales classiques. Les familles recomposées ainsi que les liens pouvant se tisser en-dehors des cadres familiaux stricts doivent pouvoir amener des solutions au cas pas cas que l’assurance vie offre. Par ailleurs, à plusieurs reprises, la justice a tranché de manière claire en cas d’abus visant à déshériter totalement les membres de la famille en ayant recours à l’assurance vie. L’étude mentionne, par ailleurs, qu’il n’est pas prévu de revenir sur les avantages fiscaux attachés aux successions dans le cadre des contrats d’assurance vie. Malgré tout, l’idée de la banalisation pourrait aller à terme jusqu’à remettre en cause le régime fiscal de la succession de l’assurance vie.
La problématique de la suppression des cotisations retraite créatrices de droits au-delà de 120 000 euros
Le projet de réforme des retraites prévoit que les rémunérations au-delà de trois fois le plafond de la sécurité sociale (supérieur à 120 000 euros) ne seront plus assujettis à des cotisations retraite créatrices de droit. Elles ne seront soumises qu’à la cotisation de solidarité de de 2,81 % à compter du 1er janvier 2025 si la réforme est adoptée. Actuellement, les revenus jusqu’à huit fois le plafond donnent lieu à des cotisations créatrices de droit au titre de la retraite complémentaire AGIRC -ARRCO.
La suppression des cotisations entre trois et huit fois le plafond (de 120 000 à 329 000 euros) de la sécurité sociale donnera lieu, selon une étude de lAGIRC / ARRCO, à une dépense de retraite non couverte de 3,7 milliards d’euros durant 15 ans. En effet, les salariés ayant cotisé dans cette tranche de revenus se sont vus accorder des droits à retraite qu’il conviendra d’honorer. .
Ce changement de mode de cotisation concerne 240.000 cadres supérieurs du privé affiliés à l’Agirc-Arrco. La masse salariale correspondante atteindrait 14,7 milliards d’euros en 2018 ; le montant des cotisations perçu serait de 3,6 milliards la même année.
Le système de cotisation à huit plafonds a été introduit en 1989 en grande partie pour augmenter le volume des cotisations. Compte tenu de l’augmentation du nombre de cadres supérieurs se situant au-dessus de trois plafonds, ce système joue positivement sur les comptes de l’AGIRC – ARRCO.
Pour éviter un manque à gagner préjudiciable à l’équilibre du futur régime de retraite, le Gouvernement étudie la possibilité d’instauration d’une réduction progressive du plafond de cotisation. Le passage de 8 fois à 3 fois le plafond de la sécurité sociale serait étalé dans le temps.
L’année des paradoxes pour l’assurance vie
Un mois de décembre très classique pour l’assurance vie
La collecte nette de l’assurance vie a été, selon les résultats de la Fédération Française de l’Assurance publiés le 24 janvier, positive de 800 millions d’euros. Cette collecte avait été négative de 700 millions d’euros en 2018. En règle générale, le mois de décembre est un petit mois pour l’assurance vie. Quatre décollectes lors de ces dix dernières années ont été enregistrées en décembre. Les fêtes de fin d’année, les vacances sont autant d’éléments qui pèsent sur la collecte. Cette année s’ajoutent les grèves des transports qui ont pu entrainer le report de rendez-vous avec les conseillers en charge de la gestion des contrats d’assurance.
Avec 11,8 milliards d’euros, les versements bruts sont en phase avec les résultats de l’année. Ils n’ont pas souffert des annonces de plusieurs compagnies concernant la baisse du rendement des fonds euros et la limitation de leur accès. En lien avec ces deux facteurs, la collecte en unités de compte a continué d’augmenter. Avec 4,8 milliards d’euros en décembre, la collecte en unités de compte représente 41 % de la collecte totale, soit le taux le plus élevé constaté depuis le mois d’août 2000 (45 %).
Les prestations d’assurance vie ont atteint 11 milliards d’euros au mois de décembre. Elles ont été un peu plus élevées que les mois précédents (10,3 milliards d’euros en octobre et 10 milliards d’euros en novembre).
2019, une bonne année avec un retour en force des unités de compte
En 2019, l’assurance vie aurait pu souffrir de la baisse des rendements, des polémiques sur l’avenir du fonds euros, or, tel n’a pas été le cas ; bien au contraire, les résultats témoignent de la force de ce produit qui est le premier support d’épargne en France.
Les versements se sont élevés à 144,6 milliards d’euros contre 139,7 milliards d’euros en 2018. En termes de collecte brute, c’est le meilleur de ses vingt dernières années.
De janvier à décembre, la proportion de la collecte en UC est passée de 23 à 41 %. En moyenne, elle a été de 27 % soit le même taux qu’en 2018. La collecte en UC avait été faible en début d’année en raison de la baisse des cours des actions à la fin de l’année 2018. A contrario, la forte progression de la collecte en UC de la fin de l’année s’inscrit dans un contexte financier porteur pour les valeurs actions.
Les prestations ont été, sur l’ensemble de l’année, stable par rapport à 2018 (118,7 milliards d’euros contre 118,2 milliards d’euros). Depuis le début des années 2010, elles ont tendance à augmenter du fait de la maturité croissante du produit et du vieillissement de la population. Les sorties des contrats sont à relier avec le dynamisme du marché immobilier.
La collecte nette a atteint 25,9 milliards d’euros, le meilleur résultat enregistré depuis 2010 (51 milliards d’euros). En 2018, elle s’était élevée à 21,5 milliards d’euros. Avec ce résultat, l’assurance vie témoigne de sa résilience. En permettant un arbitrage entre la sécurité, la liquidité et le rendement, ce produit répond aux exigences des épargnants. La hausse de la collecte est à relier à celle du taux d’épargne des ménages qui ont choisi de ne pas consommer l’ensemble de leurs gains de pouvoir d’achat.
L’assurance vie, un produit en évolution permanente
L’assurance vie a connu un essor important dans les années 90 et 2000 grâce au succès du fonds euros qui apportait tout à la fois sécurité, liquidité et rendement. Il a bénéficié alors des taux d’intérêt élevés dans un contexte de désinflation. Le retournement intervenu depuis la grande récession de 2008/2009 avec la mise en œuvre de politique monétaire accommodante change la donne pour les assureurs comme pour les assurés. L’installation des taux bas voire négatifs sur longue période impose une reformulation de l’assurance vie. La garantie du capital qui est un service a un coût, un prix qui se matérialise par une diminution des taux de rendement des fonds euros. La recherche de gains supérieurs passe désormais, par une prise de risque accrue, ce qui n’est pas illogique en soi.
L’assurance vie conserve des atouts indéniables pour les ménages en permettant des arbitrages au sein d’une même enveloppe entre différents types de placement. Elle réunit en un produit le triptyque sécurité, liberté avec la liquidité et le rendement. Pour reproduire ce triangle magique en dehors de l’assurance vie, il faut associer par exemple, des livrets bancaires ou réglementés, un Plan d’Epargne en Actions ou un compte titre. En revanche, cette association n’offre pas de solutions pour les successions à la différence de l’assurance vie.
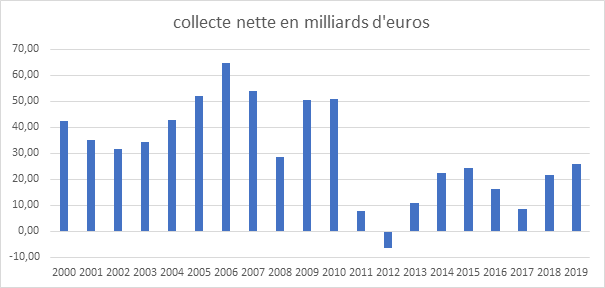
Les Français épargnent pour leur retraite
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié les résultats de son étude annuelle sur les attitudes et opinions des épargnants à l‘égard des placements. Cette enquête a été menée en septembre-octobre 2019 par l’institut Audirep auprès d’un échantillon de 1.200 personnes représentatif de la population française, montre que la préparation de la retraite est une des premières motivations des épargnants.
Selon cette étude,71 % des Français interrogés placent parmi leurs priorités d’épargne l’objectif de « disposer d’un capital en vue de la retraite, pour avoir suffisamment d’argent tout au long de votre retraite » et 38 % la qualifient de « préoccupation forte ». La première préoccupation reste l’épargne de précaution afin de « faire face à d’éventuelles dépenses imprévues ».
La moitié des actifs pensent que leur épargne ne sera pas suffisante pour la retraite, tandis que 23 % considèrent qu’elle sera « suffisante », une proportion en hausse (19% en 2018). Cependant, près d’un actif sur deux (48 %) reconnaît n’avoir « aucune idée du montant d’épargne nécessaire » pour constituer un complément de revenus suffisant pour sa retraite.
53 % des actifs déclarent mettre de l’argent de côté en vue de la retraite. Ils étaient 48 % en 2017. Seulement un actif sur cinq (21 %) le fait régulièrement (dont 86 % tous les mois). 70 % des Français ne mettent jamais ou quasiment jamais d’argent de côté pour la retraite faute de moyens financiers. Seuls 26 % le font par choix personnel.
Le montant moyen épargné par les Français en préparation de leur retraite s’élève à 2.300 euros par an (100 euros de plus que l’année précédente).
Pour préparer financièrement leur retraite les Français placent en premier l’immobilier, puis l’épargne salariale et l’assurance vie en fonds euros. Les placements investis en Bourse (actions, obligations, fonds…) recueillent une bonne note (entre 7 et 10 sur 10) auprès de 29 % des personnes sondées.
La confiance dans les placements en actions a baissé en 2019, à 21 % contre 27 % en 2018. La proportion des Français envisageant un investissement en actions dans les 12 prochains mois reste limitée à une personne sur cinq (19 % en 2019).
Près de 240 milliards d’euros d’encours pour l’épargne retraite en France
L’encours des produits d’épargne représentait à fin 2018 237 milliards d’euros contre 229 milliards d’euros en 2017. Cette augmentation est la conséquence des cotisations versées d’une année sur l’autre, l’appréciation des valeurs de marché n’a pas contribué réellement à l’augmentation du fait de la baisse des valeurs actions en 2018.
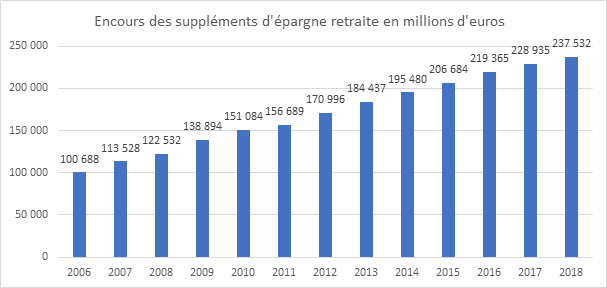
Les cotisations se sont élevées à près de 13 milliards d’euros et les prestations à 7,6 milliards d’euros. Les prestations issues des suppléments d’épargne retraite ont représenté 2,4 % de toutes les pensions touchées par des retraités français. Plus de 13 millions d’actifs sont couverts par un contrat d’épargne retraite individuel ou collectif.
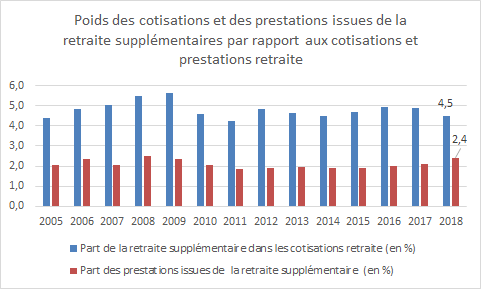
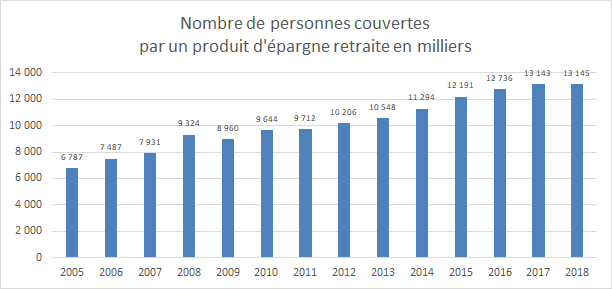
Près de 2,5 millions de retraités français touchent une rente d’un produit d’épargne retraite.
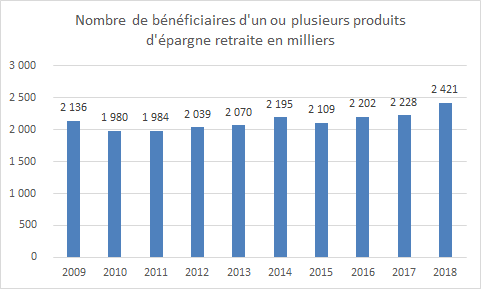
Le Livret A signe une belle année en 2019
Le Livret A a fini l’année sur une mauvaise note avec une décollecte de 1,6 milliard d’euros contre +540 millions en décembre 2018. Il s’agit de la seconde décollecte de l’année pour le Livret A (après -2,13 milliards en octobre). Le résultat de décembre contraste avec les collectes constatées les années précédentes. Si traditionnellement le Livret A affiche une petite collecte en décembre en raison des dépenses engagées par les ménages pour les fêtes (cadeaux, vacances, réveillon), seules deux décollectes avaient été constatées au cours des dix dernières années (en 2017, avec –360 millions d’euros et en 2014, -290 millions d’euros).
Un relâchement en fin d’année
Le résultat de décembre 2019, par son ampleur, surprend. La collecte a pu être influencée par le débat sur la baisse du taux du Livret A, plusieurs annonces en provenance du Ministère de l’Economie et de la Banque de France étant intervenues courant décembre. Par ailleurs, après avoir fortement épargnant durant les neuf premiers mois de l’année, les Français ont relâché leur effort sur la fin de l’année. Il convient de souligner que le Livret de Développement Durable et Solidaire n’a pas connu la même évolution que son grand frère. En effet, la collecte a été positive pour le LDDS de 770 millions d’euros. Largement diffusé au sein des réseaux bancaires, le LDDS est l’antichambre du compte courant. Avec l’utilisation des applications digitales, les ménages gèrent au fil de l’eau leurs liquidités.
Une très belle année 2019
Malgré la décollecte de décembre, l’année 2019 a été une très bonne année pour le Livret A qui a collecté 12,64 milliards d’euros, la meilleure collecte depuis 2012, année qui avait bénéficié du relèvement du plafond à 22 950 euros. Pour le LDDS la collecte annuelle s’établit à 3,91 milliards d’euros contre 2,62 milliards un an plus tôt.
L’encours de ces deux produits a atteint 410,9 milliards d’euros, fin 2019, un niveau record à (avec respectivement 298,6 milliards d’euros pour le Livret A et 112,4 milliards pour le LDDS). Ce résultat traduit l’attachement des Français à la sécurité et la liquidité. En 2019, ménages ont affecté une part non négligeable de leur gain de pouvoir d’achat sur le Livret A. Comme les années précédentes, la collecte du Livret A est marquée par une certaine saisonnalité, avec un premier semestre très fourmi et un second plutôt cigale.
2020, sur fond de baisse des taux
Pour l’année 2020, avec l’annonce de la baisse du taux à 0,5 % devrait occasionner plusieurs mois difficiles pour le Livret A comme en 2015. Le passage à 0,75 % du taux de Livret A avait donné lieu à 11 mois successifs de décollecte. Il est cependant possible que mouvement soit moins fort en raison de la forte propension des ménages à l’épargne. La multiplication des formes atypiques d’emploi oblige un nombre croissant d’actifs à se constituer une épargne de précaution. L’amélioration de la situation sur le front de l’emploi ne se traduit pas pour le moment par une augmentation de la consommation. La crainte d’un retournement conjoncturel, la succession de conflits sociaux incitent les ménages à conserver d’importantes liquidités. L’augmentation du coût de l’immobilier contraint également à un effort d’épargne supplémentaire. Cet effort est enfin nourri par le vieillissement de la population.
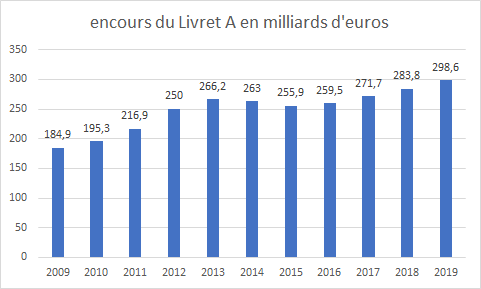
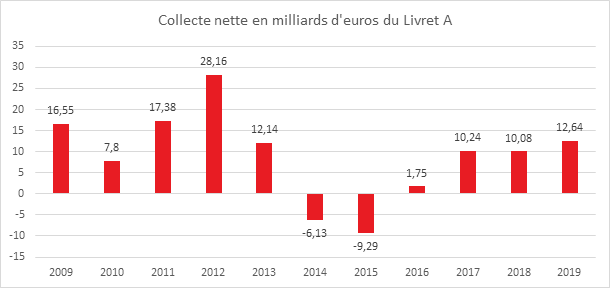
La baisse du taux du Livret A : un changement d’époque
La baisse du taux du Livret A à 0,5 % : un changement de paradigme
Le Gouvernement a décidé d’abaisser le taux du Livret A de 0,75 à 0,5 % ce qui constitue un nouveau plus bas historique. Cette diminution, intervenant après deux années de gel, est la conséquence de l’application de la nouvelle formule instituée en 2018. Elle s’inscrit dans une volonté de normalisation du Livret A et dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. En 2019, l’Etat a emprunté à -0,4 %. La Banque Centrale Européenne a abaissé son taux de dépôt à -0,5 % le 12 septembre 2019. Le Gouvernement entend également favoriser la réallocation de l’épargne des ménages vers le long terme et les entreprises.
La première application de la nouvelle formule
Le Gouvernement a décidé de respecter pour sa première application de résultat de la nouvelle formule. En vertu de celle-ci, le taux du Livret A est égal à la moyenne du taux d’inflation (indice des prix hors tabac) et des taux des marchés monétaires de ces six derniers (EONIA) avec un plancher à 0,5 point. Compte tenu de l’inflation 0,85 %) et des taux des marchés monétaires (-0,42 %), le taux moyen est de 0,22 %. C’est donc la valeur plancher qui s’applique.
Une non-application de la formule nouvelle mouture aurait constitué un fâcheux précédent pour le Gouvernement.
Le pouvoir d’achat du Livret A n’est plus garanti
La nouvelle formule ne vise plus à garantir automatiquement le pouvoir d’achat du Livret A comme cela était le cas depuis 2003, année de la mise en œuvre de la première formule du taux du Livret A. Le Gouvernement était déjà confronté à la problématique de la fixation du taux du Livret A et avait alors souhaité s’abriter derrière une formule technique. Depuis dix sept ans, les gouvernements ont eu à chaque fois des difficultés d’application de la formule de fixation au point de la modifier à plus de trois reprises.
Le Gouvernement entend favoriser la consommation et la réallocation de l’épargne des ménages vers des placements longs. Depuis la crise financière, l’encours de l’épargne réglementée a fortement augmenté (764 milliards d’euros au 2e trimestres 2019) ainsi que celui des dépôts à vue et du numéraire (594 milliards d’euros).
Quelles conséquences pour les épargnants
Une baisse de revenus
Rémunéré à 0,75 %, le Livret A rapportait à l’ensemble des épargnants épargnants sur un an 2,235 milliards d’euros. Rémunéré à 0,5 %, le gain ne sera plus que de 1,49 milliard d’euros, soit une perte de 745 millions d’euros.
Pour un épargnant ayant un Livret A de 10 000 euros, la perte est de 25 euros sur un an (50 euros au lieu de 75 euros). Pour un épargnant, au plafond de 22 950 euros, la perte est de 57,375 euros (114,75 au lieu de 172,125 euros).
Un rendement réel négatif
Depuis 2016, le rendement réel du Livret A est redevenu négatif clôturant une période de 30 ans de rendement positif. Avec une inflation qui sur ces derniers mois était voisine d’un point, le rendement réel est négatif de 0,5 point. L’inflation a tendance à s’accélérer depuis quelques mois. Elle a atteint 1,5 % en décembre mettant le rendement réel à -1 point.
Le rendement du Livret A reste supérieur à celui des livrets bancaires (0,17 % en moyenne en novembre 2019 source Banque de France).
Quelles réactions auront les épargnants ?
Lors des précédentes baisses du taux, les ménages ont, durant plusieurs mois, boudé le Livret A avec des décollectes. En 2015, onze mois consécutifs de décollecte avaient été constatés. Le retour à des collectes positives significatives s’est produit en 2017. La baisse du taux prévue le 1er février 2020 intervient dans un contexte de fort taux d’épargne des ménages. Sur les onze premiers mois de l’année 2019, la collecte du Livret A a dépassé 14 milliards d’euros.
Le pari de relance de la consommation n’est pas gagné d’avancecompte tenu du contexte économique et social rempli d’incertitudes. Les ménages risquent dans un premier temps de laisser plus d’argent sur leurs comptes courants. Une partie pourrait être réorientée vers l’assurance vie même si le rendement des fonds euros s’inscrit également en baisse (1,4 % pour 2019). La réorientation vers l’épargne longue n’est pas automatique car le Livret A est avant tout un outil d’épargne de précaution.
Quelles conséquences pour le logement social
Une partie de la collecte du Livret A sert à financer le logement social en servant de base à des emprunts à long terme aux bailleurs sociaux. En réduisant le coût de la ressource, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, les charges financières des bailleurs sociaux seraient réduites de 317 millions ‘euros, la somme correspondrait à la construction de 17.000 logements supplémentaires.
Par ailleurs, pour la Caisse des Dépôts, la rentabilité du Livret A est amélioré. En effet, l’écart entre le rendement des actifs du fonds d’épargne et le rendement du Livret A pesait de plus en plus sur les comptes de la Caisse. des dépôts.
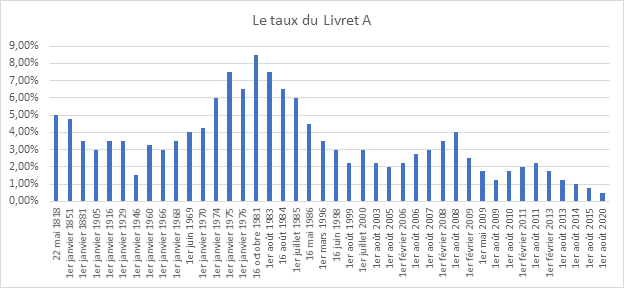
| Taux du Livret A | |
| 22 mai 1818 | 5,00% |
| 1er janvier 1851 | 4,75% |
| 1er janvier 1881 | 3,50% |
| 1er janvier 1905 | 3,00% |
| 1er janvier 1916 | 3,50% |
| 1er janvier 1929 | 3,50% |
| 1er janvier 1946 | 1,50% |
| 1er janvier 1960 | 3,25% |
| 1er janvier 1966 | 3,00% |
| 1er janvier 1968 | 3,50% |
| 1er juin 1969 | 4,00% |
| 1er janvier 1970 | 4,25% |
| 1er janvier 1974 | 6,00% |
| 1er janvier 1975 | 7,50% |
| 1er janvier 1976 | 6,50% |
| 16 octobre 1981 | 8,50% |
| 1er août 1983 | 7,50% |
| 16 août 1984 | 6,50% |
| 1er juillet 1985 | 6,00% |
| 16 mai 1986 | 4,50% |
| 1er mars 1996 | 3,50% |
| 16 juin 1998 | 3,00% |
| 1er août 1999 | 2,25% |
| 1er juillet 2000 | 3,00% |
| 1er août 2003 | 2,25% |
| 1er août 2005 | 2,00% |
| 1er février 2006 | 2,25% |
| 1er août 2006 | 2,75% |
| 1er août 2007 | 3,00% |
| 1er février 2008 | 3,50% |
| 1er août 2008 | 4,00% |
| 1er février 2009 | 2,50% |
| 1er mai 2009 | 1,75% |
| 1er août 2009 | 1,25% |
| 1er août 2010 | 1,75% |
| 1er février 2011 | 2,00% |
| 1er août 2011 | 2,25% |
| 1er février 2013 | 1,75% |
| 1er août 2013 | 1,25% |
| 1er août 2014 | 1,00% |
| 1er août 2015 | 0,75% |
| 1er août 2020 | 0,50% |
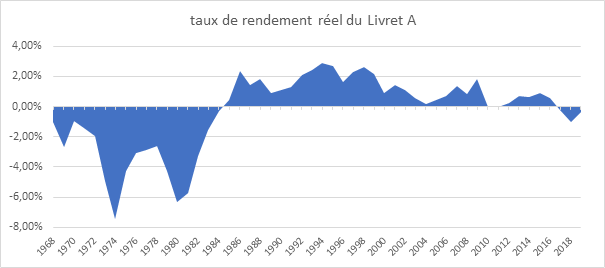
Petit regain d’inflation en décembre, qu’en sera-t-il pour le taux du Livret A
Au mois de décembre, selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de +0,4 % sur un mois, après +0,1 % en novembre 2019. Cette hausse résulte d’un renchérissement des prix de l’énergie (+0,8 % après +0,3 %) et de l’alimentation (+0,6 % après +0,1 %) et d’un rebond des prix des services (+0,5 % après −0,2 %) et des produits manufacturés (+0,2 % après −0,1 %). Les prix du tabac sont stables après une hausse de 6,0 % le mois précédent.
Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % en décembre, après +0,2 % en novembre.
Sur un an, les prix à la consommation accélèrent pour le deuxième mois consécutif. La hausse atteint désormais +1,5 % après +1,0 % en novembre et +0,8 % en octobre. Cette hausse de l’inflation s’explique par le rebond des prix de l’énergie, d’une légère accélération de ceux des services et d’un moindre recul des prix des produits manufacturés. Les prix de l’alimentation et du tabac augmentent au même rythme que le mois précédent.
L’inflation sous-jacente augmente légèrement en décembre : +1,1 % sur un an, après +1,0 % le mois précédent.
L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,5 % sur un mois, après +0,1 % en novembre ; sur un an, il accélère à +1,6 %, après +1,2 % le mois précédent.
Si en retenant la nouvelle formule, le taux du Livret A devrait être abaissé de 0,75 à 0,5 point, le Gouvernement pourrait en différer l’application en arguant que la reprise de l’inflation entraînerait une réelle perte de pouvoir d’achat de l’épargne placée sur le Livret A. Si le taux d’inflation demeurait sur l’année autour de 1,5 %, le rendement réel du Livret A serait négatif de 1 point.
La France vieillit mais reste un des pays les plus jeunes de l’Union européenne
Au 1er janvier 2020, la France, selon les dernières statistiques publiées par l’INSEE comptait 67 064 000 habitants. 64 898 000 vivaient en métropole et 2 166 000 dans les cinq départements d’outre-mer. Comme depuis 2017, la population a augmenté, l’année dernière, de 0,3 %. Ce rythme est inférieur à celui qui était constaté avant 2017. La progression était de + 0,4 % par an entre 2014 et 2016 et de + 0,5 % par an entre 2008 et 2013.
En 2019, le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, s’établit à + 141 000, soit plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale comme c’est le cas depuis 2016. Cette baisse est la conséquence d’une augmentation des décès et du recul des naissances. Le solde migratoire est estimé à + 46 000 personnes en 2019. Il se situe également dans un étiage bas.
L’augmentation de la population française est donc, comme par le passé, davantage tirée par le solde naturel que par le solde migratoire. Au 1er janvier 2019, la France est le deuxième pays le plus peuplé de l’Union européenne (UE) derrière l’Allemagne (83,0 millions d’habitants).
En 2019, 753 000 naissances ont été enregistrées en France, soit 6 000 naissances de moins qu’en 2018 (– 0,7 %) Le nombre de naissances baisse chaque année depuis cinq ans.
Le nombre de naissances dépend à la fois du nombre de femmes en âge de procréer et de leur fécondité. La population des femmes de 20 à 40 ans, âges où elles sont les plus fécondes, diminue depuis le milieu des années 1990 expliquant en partie la baisse des naissances.
En 2019, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) s’établit à 1,87 enfant par femme, après 1,88 en 2018. Ce taux était proche de 2,0 enfants par femme entre 2006 et 2014.
L’âge moyen à la maternité dépasse 30 ans en 2019, (30,7 ans en 2019, contre 29,3 ans vingt ans plus tôt).
Jusqu’en 2015, l’Irlande et la France étaient chaque année les pays les plus féconds de l’UE. Depuis 2016, la Suède devance l’Irlande. Son ICF est de 1,78 en 2017, contre 1,77 pour l’Irlande. Les cinq pays de l’UE les moins féconds sont Malte (ICF de 1,26), l’Espagne (1,31), l’Italie (1,32), Chypre (1,32) et la Grèce (1,35). L’Allemagne, qui faisait partie il y a dix ans des pays les moins féconds de l’Union, figure désormais dans la moyenne (ICF de 1,57 contre 1,59 pour l’ensemble de l’Union).
En 2019, 612 000 personnes sont décédées en France ; c’est 2 000 de plus qu’en 2018, soit une hausse de 0,4 %. Du fait de l’arrivée des générations nombreuses du baby boom à des âges de forte mortalité, le nombre de décès augmente depuis 10 ans. L’épidémie de grippe hivernale 2018-2019, dont le pic a été atteint début février, a été de durée limitée (8 semaines) mais avec une mortalité élevée, inférieure cependant à l’épidémie de l’hiver précédent. Les canicules de l’été 2019 ont eu un impact sur les plus de 75 ans en terme de mortalité.
En 2019, l’espérance de vie à la naissance est de 85,6 ans pour les femmes et de 79,7 ans pour les hommes. Les hommes continuent à rattraper les femmes. En dix ans, les hommes ont gagné 2,0 ans d’espérance de vie et les femmes 1,2 an. Ces cinq dernières années, ils ont gagné 0,5 an d’espérance de vie et les femmes 0,2 an. L
En moyenne dans l’UE en 2017, l’espérance de vie des femmes est de 83,5 ans et celle des hommes de 78,3 ans. L’espérance de vie des femmes en France est l’une des plus élevées de l’Union : seule l’Espagne (86,1 ans) devance la France (85,3 ans). Pour les hommes, la France (79,4 ans) se situe un peu au-dessus de la moyenne de l’UE ; neuf pays, en particulier l’Italie et la Suède (80,8 ans) ont une espérance de vie supérieure à la France pour les hommes.
En France, l’écart d’espérance de vie entre femmes et hommes est de 5,9 ans en 2019. Il était plus élevé en 2009 à 6,7 ans, et est stable autour de 6 ans depuis 2015. En 2017, cet écart est plus élevé en France (5,9 ans) que dans tous les pays de l’ouest de l’Europe, à l’exception du Portugal (6,2 ans). L’écart moyen dans les pays de l’Union est de 5,2 ans. Il varie de 3,2 ans aux Pays-Bas à 9,9 ans en Lettonie.
Même si la natalité est en baisse, la France se classe parmi les pays les plus jeunes de l’Union européenne. Fortes du dynamisme de leur fécondité depuis une quinzaine d’années, l’Irlande et la France ont la proportion de jeunes de moins de 15 ans la plus élevée de l’UE en 2018 (respectivement 20,8 % et 18,1 %), devant le Royaume-Uni et la Suède. Cette part est inférieure à 14 % dans quatre pays (Allemagne, Italie, Malte, Portugal) et elle est de 15,6 % pour l’ensemble de l’UE.
Au 1er janvier 2020, plus d’une personne sur cinq en France a 65 ans ou plus (figure 6). Cette part augmente depuis plus de 30 ans et le vieillissement de la population s’accélère depuis le milieu des années 2010, avec l’arrivée à ces âges des premières générations nombreuses nées après-guerre. Comme en France, la part des personnes âgées de 65 ans ou plus a augmenté dans tous les pays de l’UE ces quinze dernières années. Ainsi, en 2018, elles représentent 19,7 % de la population de l’UE, contre 16,2 % en 2003. Leur part varie désormais de 13,8 % en Irlande à 22,6 % en Italie
Livret A et Livret d’Epargne Populaire, quel taux le 1er février 2020
Avant le 1er février 2020, le Gouvernement devra communiquer le taux du Livret A et du Livret d’Epargne Populaire. Après un gel de deux ans décidé en 2017, c’est le retour des psychodrames autour de la fixation du taux de ces produits d’épargne.
La question de la fixation du taux du Livret A reste une question éminemment politique même si les gouvernements tentent depuis 2003 de s’abriter derrière une formule technique pour le faire fluctuer en fonction des prix et de la situation des taux d’intérêt. Pour des raisons de cohérence de taux avec les autres placements, du coût du financement du logement social et de ceux supportés par les organismes financiers collecteurs, la baisse de son taux d’impose. Néanmoins, il faut prendre en compte des considérations d’ordre politiques et sociales. La proximité des élections municipales, le débat houleux sur la réforme des retraites et l’impact de la crise des gilets jaunes pourraient amener un report de l’application de la nouvelle formule du Livret A. Pour justifier ce report, le Gouvernement pourrait mettre en avant que l’inflation accélère un peu en ce début d’année. Elle devrait s’établir autour de 1,4 % d’ici le mois d’avril. De ce fait, si en vertu de la formule, le Gouvernement pourrait abaisser à 0,5 %, le taux, cela aboutirait à un rendement réel négatif de près d’un point.
Une nouvelle formule a été élaborée en 2018 en vertu de laquelle le taux du Livret A devrait être désormais égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EURIBOR/EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche, au lieu de l’arrondi au quart de point pratiqué actuellement. Un plancher à 0,5 % a été institué.
La composante « inflation » qui entre dans le calcul du taux du Livret A correspond à la moyenne arithmétique, sur 6 mois, des glissements annuels de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT).
Le taux d’inflation hors tabac est de 0,9 %. Le taux d’intérêt du marché monétaire est de -0,417 % aboutissant à une moyenne inférieure à 0,5 %; ce dernier taux est donc retenu.
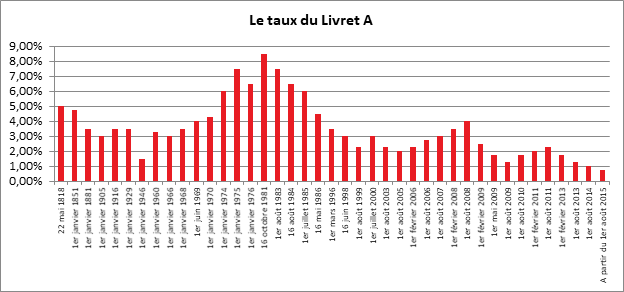
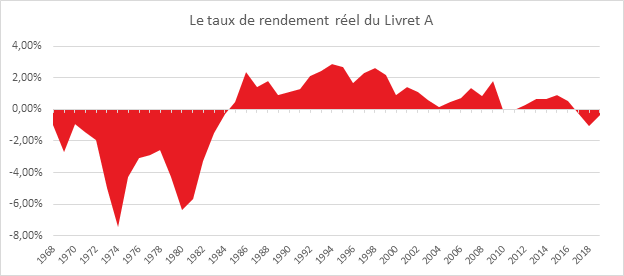
Quelles pertes pour les épargnants ?
Rémunéré à 0,75 %, le Livret A rapporte aux épargnants sur un an 2,235 milliards d’euros.
Rémunéré à 0,5 %, le gain n’est plus que de 1,49 milliard d’euros, soit une perte de 745 millions d’euros.
Pour un épargnant ayant un Livret A de 10 000 euros, la perte est de 25 euros sur un an (50 euros au lieu de 75 euros).
Pour un épargnant, au plafond de 22 950 euros, la perte est de 57,375 euros (114,75 au lieu de 172,125 euros).
Le Livret d’Epargne Populaire, un nouveau taux aussi
Les règles de fixation du taux du Livret d’Epargne Populaire ont été également modifiées.
A partir du 1er février 2020, le taux du LEP est égal au chiffre le plus élevé entre le taux des livrets A majoré de un demi-point et le taux d’ inflation. Le taux du LEP qui est aujoud’hui de LEP de 1,5 %, le taux du Livret + 0,5 point. Il pourrait donc diminuer à 1 point en cas de baisse du taux du Livret A à 0,5 point.
Le Coin des Epargnants du 11 janvier 2020
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 10 janvier 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 6 037,11 | -0,12 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 823,77 | +0,66 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 9 178,86 | +1,75 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 483,31 | +2,00 % | 13 249,01 |
| Footsie | 7 587,85 | -0,45 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 789,52 | +0,43 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 850,57 | +0,82 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 092,29 | +0,28 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,044 % | +0,004 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,238 % | -0,045 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,820 % | +0,011 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1122 | -0,37 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 560,315 | +0,27 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 65,000 | -5,28% | 66,300 |
Evènements majeurs, conséquences mineures …
Bien que d’une extrême gravité, les derniers évènements internationaux ont eu, pour le moment, peu d’incidences sur les marchés financiers. Le face à face entre les Etats-Unis, première puissance économique et militaire mondiale, et l’Iran, puissance majeure du Moyen Orient, qui était essentiellement verbal, a donné lieu en quelques jours à des actions physiques sans précédent. La réaction du marché a été très modérée ; les cours n’ont pas chuté et l’augmentation du cours du pétrole a été raisonnable. L’or s’est apprécié de manière classique mais dans des proportions mesurées compte tenu de l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran.
Ces réactions limitées sont-elles le résultat d’une sous-appréciation des risques ou d’une conviction partagée d’une menace régulée ? La montée aux extrêmes n’est pas le scénario retenu par les experts et les investisseurs. Les mesures de rétorsion annoncées à l’avance par l’Iran sont apparues symboliques. L’implication a priori accidentelle de la défense antimissile iranienne concernant le Boeing 737 ukrainien ne semble pas pour le moment remettre en cause la volonté des parties de calmer le jeu qui s’inscrit ainsi dans un cadre très byzantin.
En ce début d’année, les investisseurs veulent croire aux signaux positifs que sont l’éventuelle signature de l’accord commerciale sino-américain, le vote du Parlement britannique de l’accord de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le maintien de faibles taux d’intérêt, et l’arrêt de la chute de la production industrielle.
Le pétrole après avoir franchi la barre des 70 dollars a rapidement retrouvé son cours d’équilibre autour de 65 dollars. Les indices « actions » sont restés globalement stables sur la semaine.
L’emploi américain décevant mais pas catastrophique
L’emploi américain au mois de décembre s’est révélé moins dynamique qu’espéré sans être pour autant catastrophique. 145 000 créations d’emplois nettes ont été enregistrées en décembre, soit moins que les 160 000 attendues. Pour les analystes, cette moindre création est imputable à l’effet saisonnier lié à la fête de Thanksgiving. Le taux de chômage s’est maintenu au plus bas depuis 50 ans à 3,5 %. Compte tenu des éléments déjà publiés, les économistes américains s’attendent à une croissance pour 2019 autour de 2,25 %.
La difficile fixation du taux du Livret A
Dans les prochains jours, le Gouvernement annoncera le futur taux du Livret A qui devrait s’appliquer à compter du 1er février. En vertu de la nouvelle formule décidée en 2017, le taux devrait être abaissé à 0,5 %. Le Gouverneur de la Banque de France et le Ministre de l’Economie ont pris fait et cause pour cet ajustement. Le taux du Livret A reste un taux éminemment politique. Un peu plus d’un an après la crise des gilets jaunes, en pleine réforme des retraites et à quelques semaines des élections municipales, le Gouvernement osera-t-il diminuer le taux du produit d’épargne le plus populaire en France ?
Les formules de fixation des taux en permanente reformulation
Avant la banalisation du Livret A en 2008 permettant aux banques de le distribuer, ces dernières se plaignaient que son taux trop élevé pénalisait leurs produits d’épargne. Par ailleurs, les organismes du logement social ont, à maintes reprises, contesté le taux du Livret A. Trop haut, il a pour conséquence de renchérir la ressource à la base des emprunts qu’ils souscrivent ; trop faible, il pèse sur la collecte, ce qui peut également nuire à la production de prêts. De leur côté, les épargnants mettent en avant que le taux du Livret A est bien souvent peu rémunérateur et qu’il peut être inférieur à l’inflation. Ce fut le cas en particulier à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 80. Le rendement réel du Livret A a alors été négatif durant plusieurs années. Face à cette situation, l’établissement d’une formule garantissant le pouvoir d’achat des épargnants a été au cœur des débats à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ces débats ont abouti à l’instauration d’une règle de fixation par le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2004. Le choix d’une formule visait à dépolitiser la fixation du taux du Livret A. La formule est censée protéger tout à la fois les épargnants et le Gouvernement. Or, cette fixation demeure un pouvoir discrétionnaire de l’exécutif. Il en résulte que le résultat de la formule ne fut pas retenu et que cette dernière a été modifiée à plusieurs reprises.
La première formule a été en vigueur de juillet 2004 à janvier 2008. Elle prévoyait que le taux du livret A était révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. Le taux était égal au meilleur taux choisi entre :
- le taux Euribor 3 mois mensuel moyen du mois m-1 (respectivement décembre et juin), exprimé avec deux décimales ;
- le taux d’inflation hors tabac du mois m-1.
Le résultat était majoré de 0,25 % afin de garantir le pouvoir d’achat des épargnants et arrondi aux 0,25 % les plus proches.
Cette formule a été modifiée en 2007. La nouvelle version prévoyait que le taux du Livret A devait être le chiffre le plus élevé entre :
- la moyenne arithmétique entre, d’une part, la moitié de la somme de la moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois et de la moyenne mensuelle de l’Eonia (exprimées avec deux décimales) et, d’autre part, l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac (exprimé avec une décimale) ;
- l’inflation majorée d’un quart de point.
Le taux est arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur
Cette formule s’est appliquée durant huit ans de 2008 à 2016. Avec la baisse des tax d’intérêt, elle a été contestée tant par les banques, par les organismes de logements sociaux que par la BCE qui estiment que le Livret A est trop bien rémunéré au regard de la situation qui prévaut sur les marchés monétaires.
En 2016, une nouvelle révision de la formule est intervenue. L’objectif poursuivi était alors de réduire l’écart entre le taux du Livret A et les taux du marché monétaire. Il y avait également la volonté d’éviter des changements fréquents de taux en retenant non plus le dernier taux d’inflation connu mais en prenant en compte la moyenne des 6 derniers mois. Par ailleurs la majoration de 0,25 point de pourcentage par rapport à l’inflation est suspendue quand l’écart entre l’inflation et les taux monétaires est supérieur ou égal à 0,25 point de pourcentage. Prévue pour entrer en vigueur le 1er août 2017, cette formule n’a jamais été appliquée.
Après son élection, le Président de la République, Emmanuel Macron, a décidé, de différer son application puis de l’annuler avec l’annonce, au mois de septembre, du gel du taux pour deux ans, ce qui est le cas actuellement. Le Gouvernement d’Edouard Philippe a souhaité refondre la formule afin de rapprocher le taux du Livret A des taux des produits d’épargne à court terme. Cette intention s’inscrit dans le cadre de la réorientation de l’épargne des ménages vers les placements longs.
Une nouvelle formule a été élaborée en 2018 en vertu de laquelle le taux du Livret A devrait être désormais égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EURIBOR/EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche, au lieu de l’arrondi au quart de point pratiqué actuellement. Un plancher à 0,5 % a été institué.
La composante « inflation » qui entre dans le calcul du taux du Livret A correspond à la moyenne arithmétique, sur 6 mois, des glissements annuels de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT).
Une formule contestée et peu respectée
Depuis 2004 mais surtout depuis la crise financière de 2008, les Gouvernements ont, à plusieurs reprises, décidé de ne pas appliquer les règles de fixation du Livret A. de même, ils n’ont pas toujours suivi les recommandations en la matière du Gouverneur de la Banque de France.
Ainsi, lors de la révision du 1er février 2012, la formule n’a pas été respectée. En effet, le taux d’inflation du mois décembre 2011 était alors de 2,4 % (en base annuelle), ce qui aurait dû conduire à relever le taux du livret A à 2,75 %. Mais le gouvernement de l’époque a décidé de le maintenir à 2,25 %. Pour la révision de février 2013, l’inflation annuelle s’élevait à 1,2 %, ce qui aurait dû conduire à un taux du Livret A de 1,50 %. Le Gouvernement décida de n’abaisser le taux que d’un demi-point, à 1,75 %. Six mois plus tard, alors que l’inflation annuelle aurait dû conduire à un taux de 1 % à partir du 1er août 2013 dans le cas de l’application de la formule, la baisse ne fut, à nouveau, que d’un demi-point, à 1,25 %. De la même façon, au 1er février 2014, le gouverneur de la Banque de France a préconisé d’abaisser le taux à 1 %, mais le ministre opta pour le statu quo à 1,25 %. La stricte application de la formule aurait dû conduire alors à un taux du Livret A à 0,75 %. En 2015 et 2016, le taux du Livret A a été fixé à 0,75 % mais compte tenu d’une inflation nulle, il aurait pu être abaissé au minimum à 0,5 %. A contrario, pour la révision du 1er août 2017, le taux aurait dû être relevé de 0,75 à 1 % étant donné que l’indice des prix sur les 6 derniers mois était de 1 %. Le Gouvernement, pour ne pas respecter le résultat de la formule, a pu s’appuyer sur la recommandation du Gouverneur de la Banque de France.
Au mois de septembre 2017, le Gouvernement d’Edouard Philippe a annoncé la suspension de la formule pour deux ans. Le taux du Livret A est ainsi gelé à 0,75 % jusqu’en 2019. Cette décision est la conséquence de la réduction des Allocations Personnelles de Logement de 5 euros. En effet, le Gouvernement a demandé aux organismes d’HLM de diminuer le montant des loyers de cette somme moyennant en contrepartie la possibilité de souscrire des emprunts à des taux plus faibles auprès de la Caisse des Dépôts grâce au gel du Livret A.
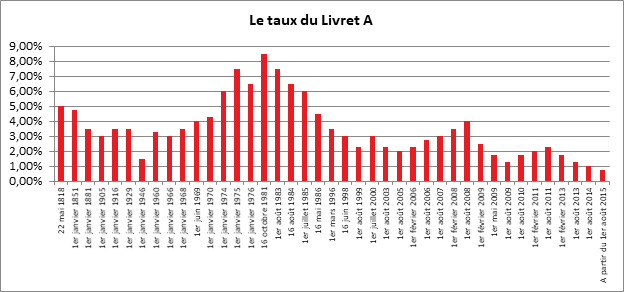
Depuis 2016, le rendement réel du Livret A est redevenu négatif mettant un terme à un période de rendement positif qui avait débuté au moment de la mise en œuvre de la politique de désinflation compétitive en 1983/1984.
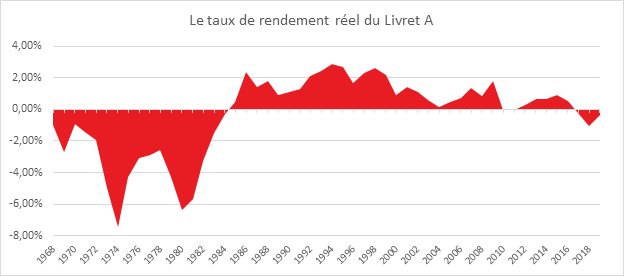
Quand le moral des Français est grevé par les grèves
En décembre 2019, la confiance des ménages dans la situation économique baisse pour la première fois depuis décembre 2018. L’indicateur de l’INSEE qui la mesure perd trois points en un mois, ce qui est important au regard des évolutions passées. À 102, il reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette baisse est sans nul doute imputable aux mouvements sociaux liés à la réforme des retraites. Le long conflit social en cours a contraint les ménages à revoir leurs déplacements et a pu les gêner pour les achats de fin d’année.
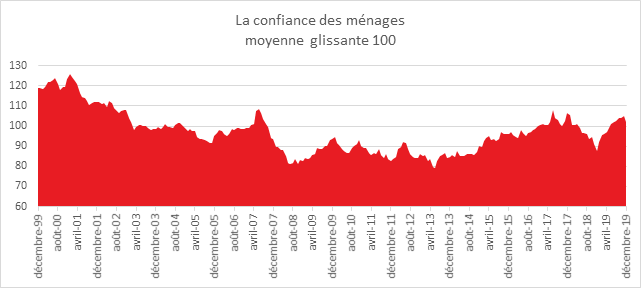
En décembre, selon l’INSEE, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future perd quatre points et rejoint sa moyenne de longue période. Le solde relatif à leur situation financière passée perd quant à lui un point et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminue par rapport au mois précédent, le solde correspondant perd deux points, mais il demeure bien au-dessus de sa moyenne.
En décembre, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future se dégrade. le solde correspondant baisse de quatre points. En revanche, le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle augmente d’un point. Les deux soldes demeurent au-dessus de leur moyenne de longue période. La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est stable, le solde correspondant demeure ainsi inférieur à sa moyenne. Malgré tout, les Français continuent à épargner comme en témoignent les derniers résultats du Livret A et de l’assurance vie.
Au mois de décembre, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois baisse fortement. Le solde correspondant a perdu quatre points mais se situe toujours au-dessus de sa moyenne de longue période. Le ressenti des mesures prises par le Gouvernement après la crise des gilets jaunes s’estompe. La baisse de la taxe d’habitation ne semble pas avoir été pris en compte par les ménages au mois de décembre. Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France baisse quant à lui de manière un peu plus marquée. Il se contracte de six points et passe en-dessous de sa moyenne.
Une proportion croissante de ménages français anticipe une dégradation de la situation de l’emploi. En revanche, les Français estiment majoritairement que l’inflation est en baisse.
L’enquête du mois de décembre sur l’opinion des ménages est marquée par le conflit social sur la réforme des retraites. Au-delà des problèmes de transport, ce conflit concerne la retraite qui est sujet hautement anxiogène pour les Français. Selon l’enquête « les Français, l’Epargne et la Retraite de 2019 », 70 % d’entre eux considèrent que leurs pensions ne leur permettront pas de vivre correctement à la retraite. Ils sont également majoritairement opposés à tout recul de l’âge de départ à la retraite. De ce fait, les débats actuels sur l’âge d’équilibre et sur le niveau à venir des pensions sont des sources d’inquiétude qui ne peuvent que peser sur leur moral.
Le taux des livrets bancaires continue sa baisse
Selon la Banque de France, le taux des livrets bancaires fiscalisés est passé de 0,19 à 0,17 % d’octobre à novembre 2019. Au mois de novembre 2018, le taux était de 0,26 %. Sinon, de manière plus globale, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est quasi inchangé en novembre 2019 à 0,58 %. Un effet d’arrondi masque en effet une légère baisse portée par les comptes à terme et les livrets ordinaires. Ce taux moyen enregistre une baisse de 6 points de base en un an (0,64 % en novembre 2018).
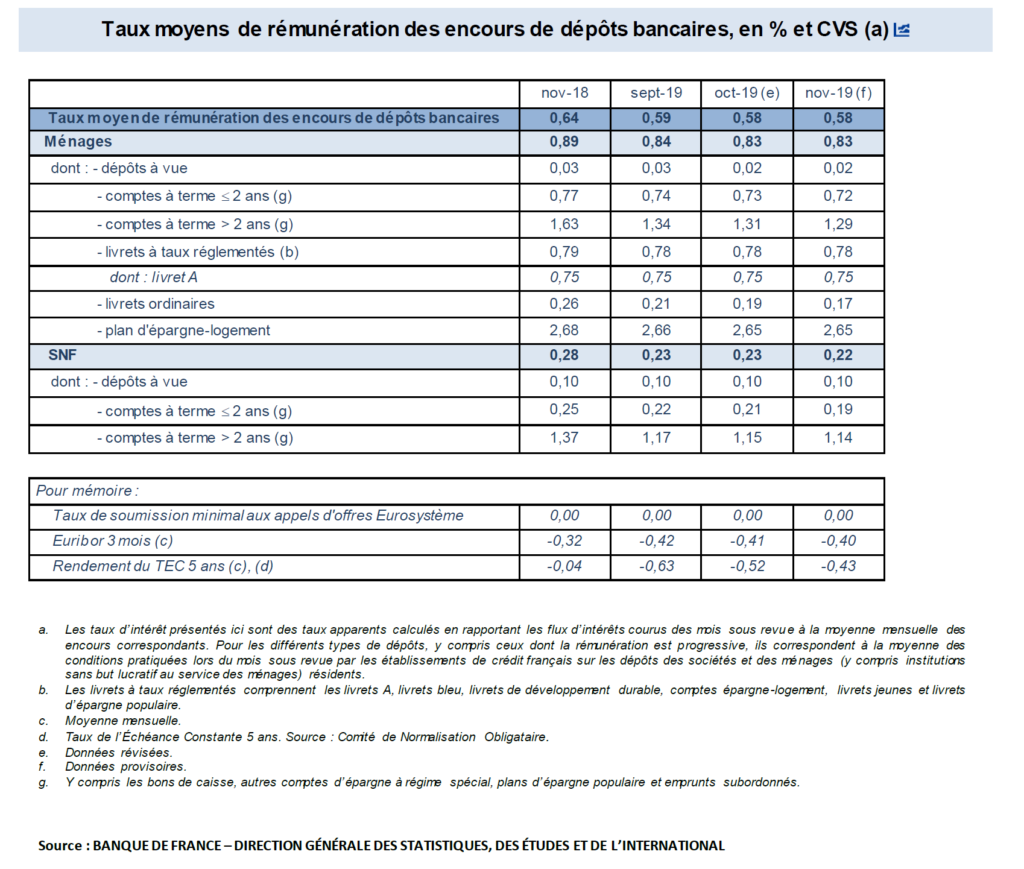
Le Coin de l’épargne du 4 janvier 2020 : quand la mort d’un général refroidit les marchés
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 3 janvier 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 6 044,16 | +0,11 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 28 634,88 | -0,04 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 9 020,77 | +0,16 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 219,14 | -0,88 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 622,40 | -0,29 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3 773,37 | -0,24 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 656,62 | -0,76 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 3 083,79 | +2,62 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,04 % | -0,024 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,283 % | -0,029 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,809 % | -0,066 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1171 | -0,04 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 548,708 | +2,51 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 68,340 | +0,31% | 52,973 |
Les marchés surpris par la mort du général iranien Qassem Soleimani
L’élimination du général iranien Qassem Soleimani ordonnée par Donald Trump lui-même, a provoqué une onde de choc sur les places financières avec la clef une augmentation du prix du pétrole et de l’or. A Paris, le Cac 40 est parvenu à contenir ses pertes grâce à la hausse de Total. L’indice finit la séance à l’équilibre à 6 044,16 points en hausse de 0,11 point sur la semaine.
Les investisseurs devraient opter pour la prudence dans l’attente des éventuelles réactions de l’Iran. La situation entre ce pays et les Etats-Unis s’est tendue après l’attaque de leur ambassade à Bagdad par des forces pro-iraniennes. La décision de Donald Trump intervient au début d’une année qui se conclura par l’élection présidentielle. L’Iran, depuis 1979 et la prise d’otage de l’ambassade américaine à Téhéran est un sujet de tension et cela d’autant que ce pays a accru sa sphère d’influence au sein du Moyen Orient. Présent au Liban, en Irak, en Cisjordanie, au Yémen, l’Iran menace deux alliés des Etats-Unis, Israël et l’Arabie Saoudite. Même si les Etats-Unis sont redevenus auto-suffisants pour le pétrole, les liens avec l’Arabie Saoudite sont importants. Ce dernier pays joue un rôle majeur dans la régulation du prix du pétrole. Le Président américain a besoin que les producteurs américains soient suffisamment bien rémunérés. Par ailleurs, l’Arabie Saoudite joue un rôle croissant dans le financement des Etats-Unis qui en contrepartie assure sa sécurité. L’Iran a peut-être interprété que le départ des Etats-Unis de Syrie annonçait leur départ général du Moyen Orient et qu’il pouvait étendre leur influence. A priori, le Président Donald Trump a tenu à rappeler que son pays restait le maître du jeu au Moyen Orient.
Les marchés « actions » terminent la décennie en beauté
En 2019, le CAC 40 a enregistré sa plus forte progression de ces vingt dernières années (après un recul de 10,95 % en 2018). Le gain a été de 26,37 %. L’indice parisien a néanmoins terminé en-dessous des 6000 points qui avaient été atteints au cours du mois de décembre. Les valeurs du luxe et celles la haute technologie ont contribué à ce bon résultat.
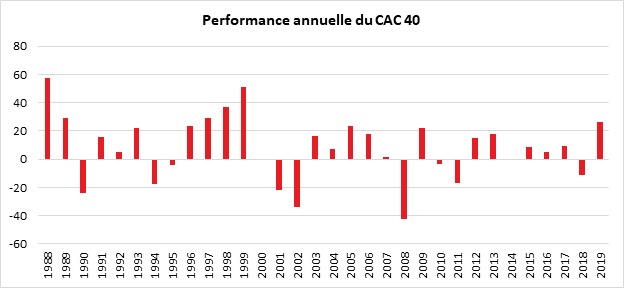
Paris n’est pas la seule place à avoir connu une forte croissance. Ainsi, le Footsie londonien a signé sa meilleure performance annuelle depuis le référendum de 2016 sur le Brexit avec un gain de 12,10 %. Le Dax de la Bourse de Francfort s’est adjugé 25,48 % sur l’année, le FTSE MIB milanais 28,28 % L’indice espagnole (le Madrid, l’IBEX 35) a gagné 12 %, son meilleur résultat depuis 2013. De son côté, l’indice européen Stoxx 600 progresse de 23,09 %, sa plus forte hausse depuis 2009.
*
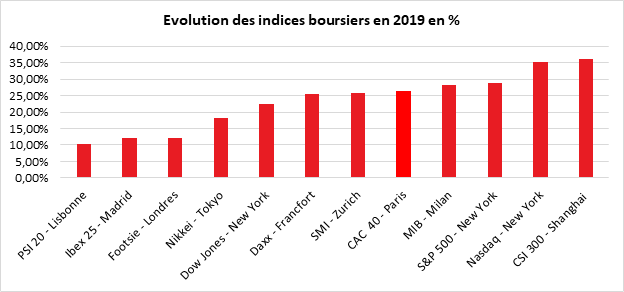
Cette forte progression peut surprendre au regard des prévisions pessimistes qui avaient cours en début d’année. La crainte d’un violent ralentissement voire la survenue d’une récession étaient avancées. Les tensions commerciales donnaient crédits aux sombres projections réalisées par les différents instituts économiques. La politique des banques centrales a plus que compensé les effets négatifs de ces prévisions sur les cours boursiers. L’arrêt du programme de hausse des taux directeurs de la part de la banque centrale américaine puis leur baisse à trois reprises ainsi que la décision de la BCE de diminuer son taux de dépôt à -0,5 % le 18 septembre 2019, ont contribué à doper le marché « actions », les investisseurs ayant décidé de réorienter une partie de leurs actifs vers ce type de placements. En fin d’année, les prémices d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que la victoire de Boris Johnson ont également porté le cours des actions.
Assurance vie : renforcement des fonds propres tout en préservant les intérêts des assurés
Le Gouvernement a publié au Journal officiel du 28 décembre l’arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie permettant aux compagnies d’assurances de reprendre, sous condition, la provision pour participation aux bénéfices (PPB). L’arrêté précise que « dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation » du régulateur, l’ACPR. Cette reprise ne pourra concerner que les assureurs ayant engrangé une perte annuelle. Elle est par ailleurs limitée dans le temps. L’affectation de la PPB aux fonds propres est temporaire. Elle est soumise à autorisation de l’ACPR qui supervisera en outre le retour à la normale. Les assureurs devront ainsi remettre au régulateur un plan prévoyant notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. L’organisme d’assurance ne pourra pas verser de dividendes tant que ces montants repris n’ont pas été restitués.
L’arrêté permet une dérogation au droit existant. Logiquement, les compagnies d’assurance ont l’obligation de reverser à leurs clients au moins 85 % des bénéfices qu’elles réalisent en plaçant leur épargne. Toutefois, elles ont le droit de mettre de côté une partie minoritaire de ces bénéfices pendant plusieurs années, afin de lisser le rendement des fonds euros. Le reversement doit s’effectuer sur huit ans.
Le montant du minimum vieillesse franchit la barre des 900 euros
Depuis le 1er janvier 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), encore appelée minimum vieillesse, sont les suivants :
- Personne seule sans ressources : 903,20 € par mois, soit 10 838,40 € par an ;
- Deux personnes sans ressources : 1402,22 € par mois, soit 16 826,64 € par an.
Cette revalorisation est la conséquence de l’engagement pris par le Président de la République lors de la campagne électorale en 2017.
En France, 568 000 personnes étaient, à la fin de l’année 2018, attributaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’ex-minimum vieillesse dont le coût est évalué à 2,7 milliards d’euros, soit moins de 1 % du total des pensions distribuées. En moyenne, les bénéficiaires du minimum vieillesse touchent 401 euros par mois.
Une année record pour les actions
Le CAC 40, après un recul de 10,95 % en 2018, a enregistré, en 2019, sa plus forte progression de ces vingt dernières années. Le gain a été, en effet de 26,37 %. L’indice parisien a néanmoins terminé en-dessous des 6000 points qui avaient été atteints au cours du mois de décembre. Les valeurs du luxe et celles la haute technologie ont contribué à ce bon résultat.
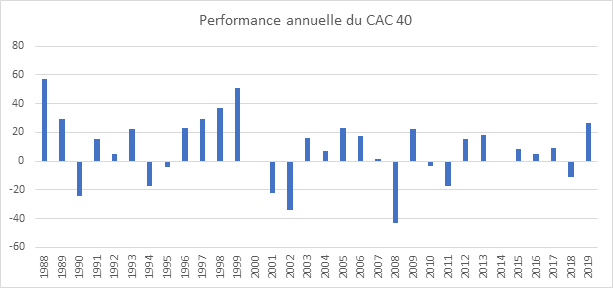
Paris n’est pas la seule place à avoir connu une forte croissance. Ainsi, le Footsie londonien a signé sa meilleure performance annuelle depuis le référendum de 2016 sur le Brexit avec un gain de 12,10%. Le Dax de la Bourse de Francfort s’est adjugé 25,48 % sur l’année, le FTSE MIB milanais 28,28 % L’indice espagnole (le Madrid, l’IBEX 35) a gagné 12 %, son meilleur résultat depuis 2013. De son côté, l’indice européen Stoxx 600 progresse de 23,09 %, sa plus forte hausse depuis 2009. New York a battu une série de records. historiques. Le Nasdaq a progressé de 35,23 % et le Dow Jones de 22,34 %.
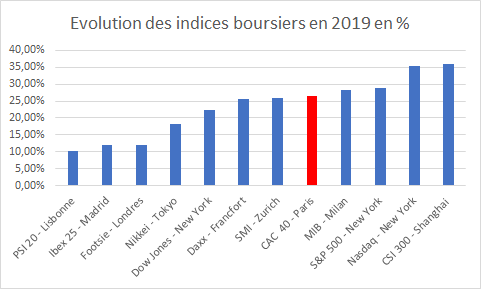
Cette forte progression peut surprendre au regard des prévisions pessimistes qui avaient cours en début d’année. La crainte d’un violent ralentissement voire la survenue d’une récession étaient avancées. Les tensions commerciales donnaient crédits aux sombres projections réalisées par les différents instituts économiques. La politique des banques centrales a plus que compensé les effets négatifs de ces prévisions sur les cours boursiers. L’arrêt du programme de hausse des taux directeurs de la part de la banque centrale américaine puis leur baisse à trois reprises ainsi que la décision de la BCE de diminuer son taux de dépôt à -0,5 % le 18 septembre 2019 ont contribué à doper le marché « actions », les investisseurs ayant décidé de réorienter vers ce type de placements une partie de leurs actifs. En fin d’année, les prémices d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que la victoire de Boris Johnson ont également porté le cours des actions.
| Place | Indice | % 2019 |
| EUROPE | ||
| Paris | Cac 40 | +26,37% |
| Londres | FTSE 100 | +12,1% |
| Francfort | Dax | +25,48% |
| Zurich | SMI | +25,95% |
| Milan | MIB | +28,28% |
| Madrid | Ibex 35 | +11,98% |
| Lisbonne | PSI 20 | +10,2% |
| ETATS-UNIS | ||
| New York | Dow Jones 30 | +22,34% |
| S&P 500 | +28,88% | |
| Nasdaq Composite | +35,23% | |
| ASIE | ||
| Tokyo | Nikkei 225 | +18,2% |
| Chine | CSI 300 | +36,07 |
Baisse de l’impôt sur le revenu et application de la retenue à la source aux employés à domicile
En 2020, l’impôt sur le revenu diminue de 5 milliards d’euros. Cette diminution concernera 12,2 millions de contribuables actuellement situés dans la tranche à 14 % (soit des revenus de 9.965 euros à 27.519 euros par part). Ils bénéficieront d’un gain moyen de 350 euros par an. Les 4,7 millions de foyers situés dans la tranche à 30 % (soit des revenus de 27.520 euros à 73.779 euros par part) auront également le droit à une baisse de leur impôt diminuer de 125 euros par an en moyenne. Pour les autres contribuables, l’impôt restera identique. Pour la première fois, la baisse d’impôt sera appliquée dès janvier, via l’actualisation des taux de prélèvement à la source.
Simplification fiscale
Les ménages ne bénéficiant de revenus déclarés que par des tiers, ne seront plus contraints de remplir la déclaration annuelle sur les revenus. Les contribuables concernés en seront informés par l’administration fiscale. Ils seraient près de 12 millions, d’après l’évaluation du projet de loi de finances.
L’impôt à la source s’applique aux particuliers employeurs
Décalé d’un an à cause de retards informatiques, le prélèvement à la source entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020 aux particuliers employeurs. Les employeurs devront effectuer une déclaration « tout en un » auprès des Urssaf ou déduire eux-mêmes l’impôt de la rémunération versée à leur salarié.
Baisse de la taxe d’habitation
La dernière étape de baisse de la taxe d’habitation pour les classes moyennes, votée dans la loi de finances 2018, intervient en 2020. Après avoir baissé de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019, la taxe d’habitation disparaîtra pour 4 ménages sur 5. Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 27.000 euros pour un célibataire ou 43.000 euros pour un couple. Pour les 20 % de ménages restants, il faudra attendre 2021 pour voir la taxe d’habitation commencer à baisser. Pour compenser la suppression progressive de la taxe d’habitation, les communes récupèrent la part de taxe foncière actuellement perçue par les départements qui se voient attribuer une fraction de TVA aujourd’hui affectée à l’Etat.
La revalorisation différentielle des pensions validée
Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif d’indexation des pensions de base prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Les pensions supérieures à 2000 euros seront revalorisées à hauteur de 0,3 % quand celles inférieures le seront à 1,0 %. Par ailleurs, un mécanisme de lissage a été institué pour éviter un effet de seuil. à
Les membres du Conseil ont néanmoins le critiqué le dispositif. Ainsi, ils ont écrit que « cette revalorisation différentielle, dont l’effet se répercute d’années en années, modifie durablement les niveaux relatifs des prestations versées à chaque assuré, au profit des trois quarts des retraités et bénéficiaires de pensions d’invalidité et au détriment du quart restant cequi affecte, selon eux, « le caractère contributif des régimes d’assurance-vieillesse et invalidité ».Le Conseil a accepté le mécanisme d’indexation en raison de son « caractère exceptionnel et limité » .
Les plafonds de l’épargne retraite pour 2020
Les plafonds de déductibilité des cotisations en vigueur pour l’épargne retraite dépendent du Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ne retraite. Ces plafonds concernent le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER), les PERP ou les Contrats Madelin.
De 2019 à 2020, le PASS augmente de 1,5 % et passe ainsi de 40 524 à 41 136 euros. Il en résulte une actualisation pour les différents produits d’épargne retraite
- Contrats Madelin
- Premier plafond (10 %) : les versements effectués en 2020 par des travailleurs non-salariés (TNS) sont déductibles dans la limite de 10 % de la fraction du bénéfice imposable. Cette limite de 10 % est plafonnée à un montant de 32 908,80 euros (10 % de huit fois le PASS 2020 ou 80 % du PASS 2020) ;
- Second plafond (15 %) : au-delà du premier plafond, les versements sur un Madelin peuvent être déduits dans la limite de 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS. Cette limite aboutit à un montant d’un maximum de 43 192,80 euros en 2020
- Les versements sur un Contrat Madelin sont donc déductibles dans la limite d’un montant maximum de 76 101,60 euros.
- Le plafond global minimum est pour 2020 égal à 10 % du PASS 2020, soit 4 114 euros.
- PERP
- Les plafonds du PERP varient sur la base du PASS de l’année antérieure aux versements. Ainsi pour les versements 2020, c’est le PASS 2019 qui est utilisé.
- Plafond maximum : les détenteurs d’un PERP peuvent déduire leurs versements dans la limite de 10 % des revenus professionnels de l’année précédente. Ces derniers sont plafonnés à un maximum de huit fois le PASS de l’année précédente. En 2020, le plafond maximum est fixé à 32 419,20 euros.
- Plafond minimum : le minimum de versements déductibles correspond à 10 % du PASS de l’année n-1. Soit 4 052 euros en 2020.
- PER
- Les plafonds du PER sont les mêmes que ceux retenus pour les contrats Madelin (pour les TNS) et le PERP (pour les salariés) ;
- Plafonds du PER en 2020 pour un salarié : 32 419,20 euros maximum et 4 052 euros minimum ;
- Plafonds du PER en 2020 pour un TNS : 76 101,60 euros maximum et 41 136 euros minimum.
Le plafond annuel d’épargne retraite peut être augmenté en prenant en compte le disponible non utilisé des trois dernières années. Il est doublé pour les couples mariés ou PACSES.
Assurance vie : encadrement strict de l’affectation de la provision pour participation aux bénéfices aux fonds propres
Le Gouvernement a publié au Journal officiel du 28 décembre l’arrêté permettant aux compagnies d’assurances de reprendre sous condition la provision pour participation aux bénéfices (PPB) applicable à l’assurance vie. L’arrêté précise que « dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation » du régulateur, l’ACPR. Cette reprise ne pourra concerner que les assureurs ayant engrangé une perte annuelle. Elle est limitée dans le temps. L’affectation de la PPB aux fonds propres est temporaire. Elle est soumise à autorisation de l’ACPR qui supervisera en outre le retour à la normale. Les assureurs devront ainsi remettre au régulateur un plan prévoyant notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. L’organisme d’assurance ne pourra pas verser de dividendes tant que ces montants repris n’ont pas été restitués.
L’arrêté permet une dérogation au droit existant. Logiquement, les compagnies d’assurance doivent reverser à leurs clients au moins 85 %des bénéfices qu’elles réalisent en plaçant leur épargne. Toutefois, elles ont le droit de mettre de côté une partie minoritaire de ces bénéfices pendant plusieurs années, afin de lisser le rendement des fonds euros. Le reversement doit s’effectuer sur huit ans.
Arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie
Le Coin de l’Epargne du 27 décembre 2019 – les marchés sur leur 31 tout comme le Livret A et l’assurance vie
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 27 décembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |
| CAC 40 | 6 037,39 | +0,26 % | 4 678,74 |
| Dow Jones | 28 645,26 | +0,67 % | 23 097,67 |
| Nasdaq | 9 006,62 | +0,91 % | 6 583,49 |
| Dax Allemand | 13 337,11 | +0,14 % | 10 558,96 |
| Footsie | 7 644,90 | +0,82 % | 6 733,97 |
| Euro Stoxx 50 | 3,782.27 | +0,15 % | 2 986,53 |
| Nikkei 225 | 23 837,72 | +0,09 % | 20 014,77 |
| Shanghai Composite | 3 005,04 | -0,40 % | 2493,89 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (20 heures) | +0,048 % | -0,003 pt | 0,708 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (20 heures) | -0,254 % | -0,002 pt | 0,238 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (20 heures) | 1,875 % | -0,042 pt | 2,741 % |
| Cours de l’euro / dollar (20 heures) | 1,1182 | +0,96 % | 1,1447 |
| Cours de l’once d’or en dollars (20 heures) | 1 513,217 | +2,40 % | 1 279,100 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (20 heures) | 68,040 | +3,09 % | 52,973 |
Les marchés toujours dans le beau fixe (pas achevé en l’attente de NY°
Le pétrole s’est rapproché de la barre des 70 dollars pour le baril de Brent en gagnant sur la semaine plus de 3 %. Cette hausse s’explique la forte baisse des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis et par la perspective d’un accord entre la Chine et les Etats-Unis, synonyme de reprise économique et donc de la demande de pétrole.
Dans cette période de trêve, les marchés ont conforté les positions acquises avant Noël. L’année 2019 devrait être pour le CAC 40 un des meilleurs crus depuis 1999. A quelques jours de la clôture annuelle, l’indice s’est apprécié de près de 28 %, soit davantage que les progressions de 22,3 % et de 23,4 % respectivement enregistrées en 2009 et 2005. Cela reste inférieur néanmoins à la progression de 51 % constatée en 1999.
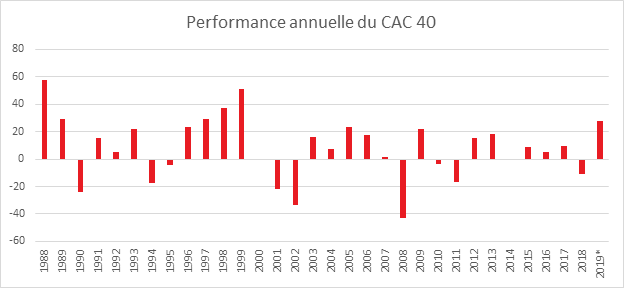
* : au 27 décembre
Source : Cercle de l’Epargne
A New York, le Nasdaq Composite a dépassé pour la première fois les 9 000 points. Depuis le début de l’année, il a augmenté de 36 %, bien aidé par quelques Gafam (+83% pour Apple, +58% pour Facebook et +56% pour Microsoft).
La bonne tenue des marchés en décembre est toujours liée aux avancées sur le terrain des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Vendredi 27 décembre, le ministère chinois du Commerce a confirmé, à l’occasion d’un point presse hebdomadaire, que la Chine était en contact étroit avec les États-Unis pour la signature d’un accord de « phase 1 ». Donald Trump avait déclaré mardi que l’accord est en train de se réaliser, ajoutant qu’une cérémonie serait organisée avec le président chinois Xi Jinping pour sa signature de cet accord qui serait en voie de traduction.
L’assurance vie, les unités de compte en plein boom
En pleine polémique sur le devenir des fonds euros, la collecte nette de l’assurance vie a fléchi au mois de novembre tout en restant positive. Elle a été ainsi de 1,2 milliard d’euros contre 1,7 milliard en octobre et 2,9 milliards d’euros en septembre. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à 25,2 milliards d’euros contre 22,2 milliards d’euros sur la même période en 2018.
Le mois de novembre est traditionnellement positif pour l’assurance vie sans être exceptionnel. Si le cru de 2019 n’échappe pas à la règle, il est néanmoins inférieur à celui de 2018 (+2,5 milliards d’euros). Sur ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées en novembre.
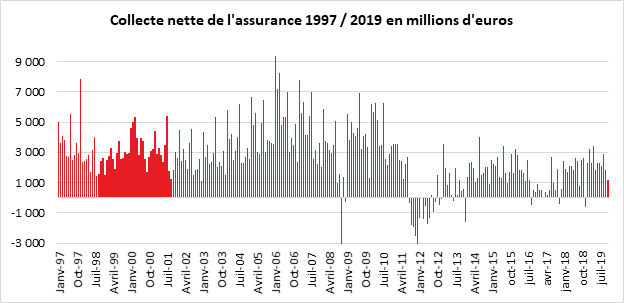
Plus du tiers de la collecte en unités de compte en novembre
Le montant des cotisations brutes d’assurance vie a baissé au mois de novembre à 11,1 milliards d’euros contre 12,1 milliards en octobre. La baisse de la collecte brute s’explique par le refus de certains assurés de prendre des unités de compte. Ils préfèrent alors renoncer à leurs versements ce qui pèse sur la collecte. Néanmoins, sur les onze premiers mois, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance est de 132,8 milliards d’euros contre 129,2 milliards d’euros sur la même période en 2018.
Les unités de compte ont, en revanche, fortement progressé et ont ainsi représenté 37 % de la collecte contre 32 % en octobre. Sur les onze premiers mois de l’année, la part des unités de compte dans la collecte est de 26 %. Cette augmentation est non seulement imputable aux bons résultats de la bourse mais aussi aux recommandations des compagnies d’assurance vie.
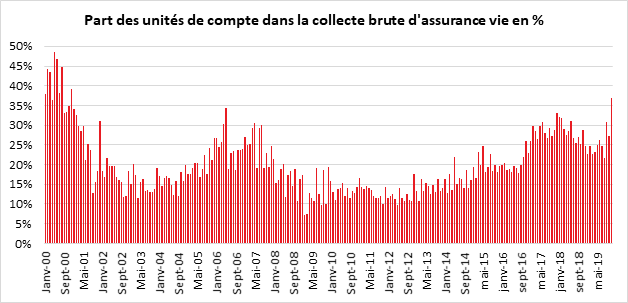
Des prestations en baisse
Les prestations se sont élevées à 9,9 milliards d’euros en novembre contre 10,3 milliards d’euros. Elles se situent dans la moyenne de ces derniers mois. De janvier à novembre, elles ont atteint 107,6 milliards d’euros contre 107,1 milliards d’euros sur la même période en 2018. Les épargnants n’ont pas effectué de retraits massifs après les annonces sur les fonds euros.
L’assurance vie conforte sa place de numéro 1
L’encours des contrats d’assurance-vie était de 1 785 milliards d’euros à fin novembre 2019, en progression de 5 % sur un an, ce qui constitue un record.
L’assurance vie à la croisée des chemins
En 2019, les ménages français ont accru leur effort d’épargne malgré la baisse des rendements des produits de taux. Ils ont souhaité renforcer la poche d’épargne de précaution dans un contexte d’incertitude élevée. Par ailleurs, compte tenu des faibles rendements, pour obtenir le niveau souhaité d’épargne, il faut mettre davantage d’argent de côté. En outre, l’augmentation des prix de l’immobilier entraîne celle des apports personnels. Par ailleurs, comme les Français s’endettent fortement pour acquérir leur logement, cela se traduit par une progression du taux d’épargne.
L’assurance vie a connu, des années 90 à maintenant, une ascension provoquée par l’engouement envers les fonds euros. Les annonces des compagnies d’assurance de baisser fortement, pour 2019, les taux de leurs fonds euros et d’en restreindre éventuellement l’accès constituent un changement de cap qui devrait se matérialiser l’année prochaine. Avec des marchés financiers en forte hausse, plus de 25 % pour le CAC 40 depuis le mois de janvier, cette réorientation est plus facile à faire passer auprès des assurés. Ce contexte porteur encourage à une prise accrue de risques. Cependant, compte tenu du poids des fonds euros (environ 80 % de l’encours), le rééquilibrage en faveur des unités de compte mettra du temps et nécessite un effort de pédagogie évident.
Le Livret A, un placement inoxydable ou presque ?
Après la décollecte de 2,13 milliards d’euros du mois d’octobre dernier, le Livret A a renoué, en novembre, avec des résultats positifs, +610 millions d’euros, soit une collecte équivalente à celle de 2018 (670 millions d’euros).
Pour le Livret A, novembre ressemble, en règle générale, à octobre en n’étant pas très porteur. Les impôts locaux à acquitter, la proximité des dépenses de fin d’année et l’absence de versement de primes freinent logiquement les ardeurs des épargnants. Lors de ces dix dernières années, le Livret A a, ainsi, enregistré cinq décollectes au mois de novembre.
L’année 2019 se démarque avec un résultat positif. Le contexte incertain sur le plan économique et social pousse les ménages à épargner. Les gains de pouvoir d’achat engrangés en 2019, les plus importants constatés depuis 2007, ont été, en grande partie, mis de côté amenant le taux d’épargne à 15 % du revenu disponible brut. Ce constat est confirmé par la faible progression, depuis un an, de la consommation. Les Français estiment que l’amélioration économique qui se traduit notamment par une baisse du chômage demeure fragile. Le caractère plus précaire des emplois avec l’essor des CDD, du temps partiel ou de l’intérim, peut expliquer l’excès actuel de prudence. Le rendement faible du Livret A et sa baisse possible le 1er février prochain n’influent en rien sur le comportement des ménages. Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte nette du produit a atteint 14,24 milliards d’euros contre 9,54 milliards d’euros l’année dernière sur la même période. Le Livret A est en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2012 (28,16 milliards d’euros), année qui avait été marquée par le relèvement de plafond et par la crise des dettes souveraines (le taux du Livret A était alors de 2,25 %).
Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a enregistré de son côté une collecte nette nulle après deux mois de décollecte. Antichambre des comptes courants des ménages, le LDDS suit plus finement que le Livret A les évolutions de leurs dépenses d’où des résultats différents de ceux du Livret A qui est davantage un outil d’épargne.
Le 1er février prochain, baisse ou pas baisse du taux, les paris sont ouverts ?
Compte tenu du taux d’inflation constaté depuis un an et des taux d’intérêt à trois mois des marchés interbancaires, le rendement du Livet A pourrait, en application de la nouvelle formule, passer au taux plancher de 0,5 % au 1er février prochain (le taux est logiquement égal à la moyenne des taux monétaires à trois mois et du taux de l’inflation sur 12 mois avec un plancher fixé à 0,5 point). Le Gouverneur de la Banque de France a plaidé en ce sens. Le taux actuel de 0,75 % est nettement supérieur aux taux pratiqués pour des produits de même nature. Le taux de rémunération des livrets bancaires avoisine 0,20 %. Le Livret A coûte cher à la Caisse des dépôts et aux réseaux bancaires au regard du rendement des placements et des prêts issus du Livret A. Le taux de 0,75 % rend peu attractif les emprunts financés à partir des ressources collectées. Cette situation pénalise les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les PME, les structures de l’économie sociale et solidaire qui peuvent se financer via le Livret A. S’il décidait de ne pas baisser le taux, le Gouvernement porterait un coup à la nouvelle formule.
La proximité des élections municipales ainsi que les débats complexes sur la réforme des retraites pourraient dissuader le Gouvernement de baisser le taux du Livret A. le taux de 0,5 % serait le plus faible jamais appliqué aux épargnants. Symbole de l’épargne populaire, le Livret A rapporterait 0,5 à 0,7 point de moins que l’inflation. Au début des années 2000, les gouvernements avaient instauré une formule de fixation du taux visant à garantir le pouvoir d’achat des épargnants, mais ce principe ne tient plus avec les taux d’intérêt négatifs.
Le Coin de l’agenda du 30 décembre au 19 janvier
Lundi 30 décembre
En Allemagne, il faudra regarder les ventes au détail de novembre.
Aux États-Unis, les promesses de vente immobilières de novembre seront rendues publiques.
Mardi 31 décembre
Marchés fermés au Japon, en Allemagne.
Clôture anticipée à la bourse de Londres et pour Euronext
En Chine, seront publiés les indices PMI officiels de décembre.
Mercredi 1er janvier
Marchés fermés au Japon, en Europe et aux Etats-Unis.
En France, seront connues les immatriculations automobiles de décembre et de l’année 2019.
Jeudi 2 janvier
Marchés fermés au Japon et en Suisse
Il faudra suivre l’indice PMI manufacturier du mois de décembre pour la Chine, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro.
Vendredi 3 janvier
Marchés fermés au Japon
En France, il faudra regarder l’indice des prix à la consommation de décembre (estimation provisoire).
En Allemagne, il faudra regarder le nombre de demandeurs d’emploi et le taux de chômage de décembre.
Pour la zone euro, la première estimation de l’inflation de décembre sera connue. Les résultats de la masse monétaire M3, du crédit au secteur privé de novembre seront publiés.
Aux Etats-Unis, il faudra suivre l’indice ISM manufacturier de décembre, les dépenses de construction de novembre et le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 10/11 décembre.
Lundi 6 janvier
L’indice PMI IHS Markit manufacturier de décembre sera connu pour l’Allemagne, la France, la zone euro et le Royaume-Uni.
Pour l’Allemagne, seront publiées les ventes au détail de novembre.
Pour la zone euro, l’indice « Sentix » de janvier sera publié.
Mardi 7 janvier
L’indice PMI IHS Markit des services de décembre seront publiés pour le Japon, le Royaume-Uni, la France et la zone euro.
Le taux d’inflation de la zone euro (1e estimation) de décembre sera publié. Seront rendues publiques les ventes au détail et la balance commerciale de novembre.
Mercredi 8 janvier
Les résultats des commandes à l’industrie de novembre pour la zone euro seront publiés. Seront également connus les indices du climat des affaires et du sentiment économique du mois de décembre.
L’enquête ADP sur l’emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de décembre sera publiée.
En France, il faudra regarder les résultats du commerce extérieur de novembre, l’enquête de conjoncture auprès des ménages de décembre.
Jeudi 9 janvier
En France, sera attendu l’indicateur conjoncture de la Banque de France (3e projection du taux de croissance du PIB pour le 4e trimestre).
Pour l’Allemagne, la production industrielle de novembre sera publiée.
Pour la zone euro, seront communiqués la balance commerciale et le taux de chômage.
Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine au 4 janvier.
Vendredi 10 janvier
Au Japon, la consommation des ménages de novembre sera publiée.
Aux Etats-Unis, les créations d’emploi, le taux de chômage et les salaires de décembre seront publiés.
En France, l’indice de la production industrielle de novembre sera publié.
Lundi 13 janvier
Marchés fermés au Japon
Mardi 14 janvier
Aux Etats-Unis, il faudra suivre les prix à la consommation de décembre.
Mercredi 15 janvier
Pour la zone euro, il faut regarder la balance commerciale et la production industrielle de novembre.
Aux Etats-Unis, sera connu l’indice manufacturier « Empire State » de janvier.
En France, l’indice des prix à la consommation de décembre (définitif) sera connu.
Jeudi 16 janvier
En Allemagne, le taux d’inflation de décembre sera publié.
Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine au 11 janvier seront communiquées tout comme l’indice d’activité « Philly Fed » de janvier. Les ventes au détail de décembre seront connues ainsi que l’indice NAHB du marché immobilier de janvier.
Vendredi 17 janvier
Pour la zone euro, le taux d’inflation de décembre sera publié.
Aux Etats-Unis, les mises en chantier, le permis de construire de décembre seront publiés tout comme la production industrielle et l’indice de confiance du Michigan (1e estimation).
Vendredi 5 janvier
Pour la zone euro, seront connus le taux d’inflation de décembre et les prix de production de novembre.
Aux Etats-Unis, il faudra suivre les créations d’emploi et le taux de chômage de décembre, la balance commerciale de novembre et l’indice ISM des services de décembre. Seront également publiées les commandes à l’industrie de novembre.
Dimanche 7 janvier
En Chine, seront rendues publiques les réserves de changes de décembre.
Le salon de l’électronique grand public, CES, se tiendra à Las Vegas, jusqu’au 8 janvier.
Lundi 8 janvier
Marchés fermés au Japon
En Allemagne, seront rendues publiques les commandes à l’industrie de novembre.
Pour la zone euro, seront publiées les ventes au détail de novembre.
Mardi 9 janvier
En Allemagne, le résultat de la balance commerciale et celui de la production industrielle de novembre seront connus.
Pour la zone euro, le taux de chômage de novembre sera publié.
Mercredi 10 janvier
Au Royaume-Uni, il faudra suivre les résultats de la production industrielle et de la balance commerciale de novembre.
Aux Etats-Unis, seront connus les stocks et ventes des grossistes de novembre.
Jeudi 11 janvier
Sera connue, pour la zone euro, la production industrielle de novembre.
Pour les Etats-Unis, il faudra regarder l’indice « Philly Fed » de janvier, les inscriptions au chômage de semaine au 6 janvier, le résultat du budget fédéral de décembre.
Vendredi 12 janvier
Aux Etats-Unis, seront connus le taux d’inflation et les ventes au détail de décembre ainsi que les stocks des entreprises de novembre.
Lundi 15 janvier
Marchés fermés aux Etats-Unis (Martin Luther King, Jr. Day)
Pour la zone euro, il faudra suivre le résultat de la balance commerciale de novembre.
Mardi 16 janvier
En Allemagne, le taux d’inflation de décembre sera publié.
Au Royaume-Uni, il faudra regarder le taux d’inflation de décembre.
Aux Etats-Unis, il faudra suivre l’indice manufacturier « Empire State » de janvier et les stocks des entreprises de novembre.
Mercredi 17 janvier
Pour l’ensemble de l’Union européenne seront publiées les immatriculations automobiles de décembre et pour l’année 2019. Le taux d’inflation de la zone euro sera connue.
Aux Etats-Unis, la production industrielle de décembre et l’indice immobilier NAHB de janvier.
Jeudi 18 janvier
Aux Etats-Unis, il faudra regarder les mises en chantier, les permis de construire de décembre, les inscriptions au chômage de la semaine au 13 janvier et l’indice d’activité « Philly Fed » de janvier.
Vendredi 19 janvier
En Allemagne, les prix à la production de décembre seront rendus publics.
Au Royaume-Uni, il faudra suivre les ventes au détail de décembre.
Aux Etats-Unis, l’indice de confiance du Michigan (1e estimation) de janvier sera connu.
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


