Chute logique du climat des affaires en mars
Dans la droite ligne de la dernière étude de conjoncture de l’INSEE, l’indice sur le climat des affaires du même institut est en avril en forte baisse. Avec 62 points, il a perdu en un mois plus de 30 points, en lien avec le confinement d’une grande partie de la population. Cette baisse est la plus importante jamais enregistrée par cet indice depuis sa création en 1980. Le précédent niveau plancher datait de mars 2009 avec 69 points. Avec la moitié de l’économie à l’arrêt, cette baisse est logique.
Le climat de l’emploi a, de son côté, perdu 25 points, après en avoir perdu 11 en mars. À 70, il se situe à son plus bas niveau depuis le début de la série (1991) ; le précédent niveau plancher était à 71 et avait été atteint en mars et mai 2009
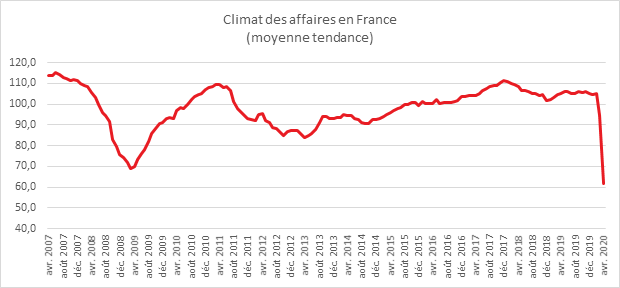
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Le Coin des Epargnants : volatilité, attentisme et précaution
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 17 avril 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 499,01 | -0,17 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 24 242,49 | +2,21 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 8 650,14 | +6,09 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 10 625,78 | +0,58 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 786,96 | -0,95 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 2 888,30 | -0,16 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 19 897,26 | +2,05 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 838,49 | +0,40 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,026 %% | -0,075 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,474 % | -0,132 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +0,610 % | -0,119 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0882 | -0,49 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 690,100 | -0,28 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 28,380 | -11,03 % | 66,300 |
Marchés toujours en mode douche écossaise
Au gré des nouvelles, les investisseurs changent d’humeur. Vendredi 17 avril, les marchés ont enregistré de fortes hausses avec les annonces de reprise de l’activité aux Etats-Unis par Donald Trump, même si ce dernier n’a pas donné de réel calendrier. Les Etats du Montana, le Wyoming ou le Dakota du Nord, relativement épargnés par le Covid-19, pourraient décider la réouverture avant le 1er mai de certains commerces et activités. Le déconfinement pourrait commencer par les restaurants et les salles de sport sous certaines conditions, mais pas les écoles ni les bars. Le port du masque serait vivement conseillé pour l’ensemble de la population. Les investisseurs ont réagi positivement aux informations sur un médicament de Gilead Sciences, le « remdesivir », l’un des premiers médicaments identifiés comme candidat au traitement du virus. Il avait été développé après l’épidémie de Sras. Pour certains analystes, l’engouement est exagéré et pourrait vite retomber. La hausse des cours à New York a été également portée par l’annonce de la reprise de l’activité de Boeing la semaine prochaine. Au niveau des pays occidentaux, le point bas de la production industrielle semble avoir été atteint. En France, les capacités de production utilisées remontent progressivement de 40 à 70 % selon les secteurs. Les entreprises s’adaptent en équipant leur personnel de masques et en isolant les postes de travail.
Ces bonnes nouvelles ont compensé en partie les mauvaises du début de la semaine sur la chute de l’activité au premier trimestre pour les grands pays avancés. Si à New-York, le Dow Jones et le Nasdaq ont été fortes hausses, les indices européens sont restés stables.
Recul record du PIB en Chine au 1er trimestre
Sans surprise, le PIB chinois s’est contracté au 1er trimestre. Son ampleur, -6,8 % en rythme annuel, est légèrement supérieure à la prévision du consensus (- 6,5 %). Il s’agit d’une première en Chine depuis 1992, année de l’introduction d’outils statistiques sur la croissance trimestrielle dans le pays. Par rapport au dernier trimestre 2019, la chute est sévère. Encore touchée par l’épidémie, en mars, les ventes au détail ont chuté de 15,8 % et la production a diminué de 1,1 %.
Le PIB a décliné de 9,8 % sur la période janvier-mars, contre une croissance de 1,5 % au trimestre précédent, selon les données communiquées par le Bureau national de la statistique (BNS).
Des analystes s’attendent à ce que la crise sanitaire provoque cette année une perte de plus de 30 millions d’emplois en Chine. Face au risque de tensions sociales, les autorités chinoises ont promis l’augmentation des dépenses budgétaires.
Marchés pétroliers, un accord pour sauver le prix du baril
Le 12 avril dernier, l’OPEP et ses partenaires ont décidé de réduire de près de 10 millions de barils par jour (bpj) la production de pétrole avec une entrée en vigueur le 1er mai, pour une période de deux mois. Cette diminution correspond à une contraction du PIB de 10 % de la production mondiale.
La Russie a également annoncé, par la voix de son Ministre de l’Énergie Alexander Novak, que l’accord avait l’appui des États-Unis. « Les Américains soutiennent eux-mêmes l’accord et disent qu’ils sont prêts à contribuer à la baisse de la production : on a entendu des chiffres allant de 2 à 3 milliards de barils par jour », a-t-il déclaré auprès de l’agence TASS, avant la réunion de ce dimanche.
L’accord n’a pas conduit pour le moment à un relèvement du prix du baril qui vendredi 17 avril restait inférieur à 30 dollars (Brent). Depuis le 1er janvier, le pétrole a baissé de plus de 57 %.
Livret A, la valeur refuge des temps difficiles
Face à une crise sanitaire et économique sans précédent, le Livret A joue son rôle traditionnel de valeur refuge de l’épargne française. En mars la collecte du Livret A, seule, s’élève à 2,71 milliards d’euros contre 1,97 milliard un an plus tôt. La collecte nette s’établit par conséquent à 8 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année 2020, portant ainsi l’encours du Livret A à un niveau inégalé de 306,6 milliards d’euros.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) enregistre également une collecte importante de 1,12 milliard d’euros après 370 millions d’euros en février dernier et 540 millions d’euros en mars 2019. Son encours a atteint ainsi, fin mars, 114,3 milliards d’euros.
La baisse du taux de rendement de 0,75 à 0,5 % intervenue le 1er février a eu peu d’effets sur la collecte à la différence du précédent ajustement qui avait conduit à plusieurs mois de décollecte. Ce phénomène de forte collecte en période de crise est classique. Lors des précédentes crises entre 2008 et 2009, ainsi qu’entre 2011 et 2013, le Livret A avait connu de fortes collectes (aidées en cela par le relèvement de son plafond en 2012). Avant même la survenue de la crise du COVID-19, les Français avaient tendance à accroître leur effort d’épargne de précaution. Les « gilets jaunes » comme le projet de réforme des retraites et les grèves qu’il avait provoquées, avaient conduit à une hausse du taux d’épargne et de la collecte du Livret A.
Pour le mois de mars 2020, le Livret A et le LDDS bénéficient du contexte fortement anxiogène. La crainte de la maladie et de la perte de revenus incite les ménages à se constituer un volant de sécurité. En fonction de l’évolution de la situation économique et des modalités du déconfinement, certains seront contraints de puiser dans leurs réserves d’épargne, en particulier les commerçants, les artisans et les professions libérales qui sont plus exposés à court terme à la perte de revenus.
La collecte du mois de mars aurait pu être plus élevée compte tenu de l’ampleur du choc subi par la population. Avec la fermeture des commerces non-alimentaires, des cafés et des restaurants, les dépenses des ménages se sont contractées d’au moins 30 % selon l’INSEE et ont augmenté d’autant leurs capacités d’épargne. Le taux d’épargne des ménages a certainement dépassé 50 % en mars. Pour certains, le pouvoir d’achat a pu, certes, être érodé par la diminution des salaires avec la mise en place du chômage partiel. Même si de plus en plus de Français recourent à Internet pour effectuer leurs versements sur leur Livret A ou sur leur LDDS, une partie d’entre eux a pu en être dissuadée en raison de l’accès difficile aux agences bancaires. Les Français ont sans nul doute laissé une grande partie de leurs liquidités sur leurs comptes courants. À fin février, les dépôts à vue des ménages avaient déjà atteint un sommet historique à 411 milliards d’euros.
L’appel du Ministre de l’Économie et des Finances en faveur de l’investissement et des placements productifs ne pourra être entendu qu’après le déconfinement et sous réserve de réelles avancées en matière d’endiguement de l’épidémie. Le retour de la confiance est un préalable à tout placement sur le long terme. Les ménages éprouvent les pires difficultés à se projeter, ce qui ne les incite pas à prendre des risques en matière d’épargne. L’évolution du chômage, l’ampleur du rebond économique, la capacité à gérer financièrement la sortie de crise ainsi que la bonne tenue des placements financiers sont autant de facteurs qui seront pris en compte par les épargnants dans les prochains mois.
Le Livret A, un phare au milieu de la tempête
Le Livret A, la valeur refuge des temps difficiles
Selon le Ministre de l’Économie, la collecte du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré, au mois de mars, une progression de 50 % par rapport à celle du même mois en 2019. La caisse des dépôts précise ces résultats et évoque une collecte globale de 3,82 milliards d’euros en mars 2020 pour ces deux placements.
Face à une crise sanitaire et économique sans précédent, le Livret A joue son rôle traditionnel de valeur refuge de l’épargne française. En mars la collecte du Livret A, seul, s’élève à 2,71 milliards d’euros contre 1,97 milliard un an plus tôt. La collecte nette s’établit par conséquent à 8 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année 2020 portant ainsi l’encours du Livret A à un niveau inégalé de 306,6 milliards d’euros.
Le LDDS enregistre également une collecte record de 1,12 milliard d’euros après 370 millions d’euros en février dernier et 540 millions d’euros en mars 2019. Son encours s’établit à présent à 114,3 milliards d’euros.
La baisse du taux de rendement de 0,75 à 0,5 % intervenue le 1er février a eu peu d’effets sur la collecte à la différence du précédent ajustement qui avait conduit à plusieurs mois de décollecte. Ce phénomène de forte collecte en période de crise est classique. Entre 2008 et 2009 ainsi qu’entre 2011 et 2013, lors des précédentes crises, le Livret A avait connu de fortes collectes (aidées en cela par le relèvement de son plafond en 2012). Avant même la survenue de la crise du COVID-19, les Français avaient tendance à accroître leur effort d’épargne de précaution. Les « gilets jaunes » comme la réforme des retraites et les grèves qu’elle avait provoquées, avaient conduit à une hausse du taux d’épargne et de la collecte du Livret A.
Pour le mois de mars 2020, le Livret A et le LDDS bénéficient du contexte fortement anxiogène. La crainte de la maladie et de la perte de revenus incite les ménages à se constituer un volant de sécurité. En fonction de l’évolution de la situation économique et des modalités du déconfinement, certains seront contraints de puiser dans leurs réserves d’épargne, en particulier les commerçants, les artisans et les professions libérales qui sont plus exposés à court terme à la perte de revenus.
La collecte du mois de mars aurait pu être plus élevée compte tenu de l’ampleur du choc subi par la population. Avec la fermeture des commerces non-alimentaires, des cafés et des restaurants, les dépenses des ménages se sont contractées d’au moins 30 % selon l’INSEE et ont augmenté d’autant leurs capacités d’épargne. Certes, le pouvoir d’achat a pu être érodé par la diminution des salaires avec la mise en place du chômage partiel. Même si de plus en plus de Français recourent à Internet pour effectuer leurs versements sur leur Livret A ou sur leur LDDS, une partie d’entre eux a pu en être dissuadée en raison de l’accès difficile aux agences bancaires. Les Français ont sans nul doute laissé une grande partie de leurs liquidités sur leurs comptes courants. À fin février, les dépôts à vue des ménages avaient déjà atteint un sommet historique à 411 milliards d’euros.
L’appel du Ministre de l’Économie en faveur de l’investissement et des placements productifs ne pourra être entendu qu’après le déconfinement et sous réserve de réelles avancées en matière d’endiguement de l’épidémie. Le retour de la confiance est un préalable à tout placement sur le long terme. Les ménages éprouvent les pires difficultés à se projeter ce qui ne les incite pas à prendre des risques en matière d’épargne. L’évolution du chômage, l’ampleur du rebond économique, la capacité à gérer financièrement la sortie de crise ainsi que la bonne tenue des placements financiers sont autant de facteurs qui seront pris en compte par les épargnants dans les prochains mois.
Les assureurs se mobilisent face à la crise
Face aux difficultés que rencontrent les Français avec la crise du covid-19, les assureurs sont mobilisés. La Fédération Française de l’Assurance , mercredi 15 avril, annoncé que les assureurs ont pis une série de mesures extra-contractuelles à destination des populations et des entreprises les plus exposées, mesures s’élevant à 1,75 milliard d’euros.La moitié de cet effort est dédié aux TPE, PME, artisans et commerçants. La participation des assureurs au fonds de solidarité mis en place par l’Etat a été doublée, la portant ainsi à 400 millions d’euros. Le maintien en garantie est confirmé jusqu’à la fin des interdictions correspondantes, même en cas de non-paiement des primes. Des mesures spécifique sont été prises en faveur de métiers très touchés par la crises (bâtiment, commerces non alimentaires, réparations automobile…) soit collectivement par l’ensemble de la profession, soit par les assureurs les plus concernés. AG2R LA MONDIALE, actionnaire du Cercle de l’Epargne, a ainsi décidé de reporter ou de rééchelonner le paiement de cotisations ou de loyers d’entreprises ou de travailleurs indépendants, de maintenir des prestations, de déployer des services d’action sociale, de mobiliser toutes ses équipes et d’allouer 200 millions d’euros supplémentaire pour ses assurés les plus touchés.
La Fédération Française de l’Assurance a indiqué que l’autre moitié des efforts de la profession est dédiée notamment aux assurances du personnel médical, aux personnes particulièrement exposées au virus du fait de leur état de santé ainsi qu’à l’aménagement des contrats pour l’ensemble des assurés en situation de confinement.
Les assureurs ont décidé de mettre en place un programme d’investissements global d’au moins 1,5 milliard d’euros, majoritairement en fonds propres, en particulier en faveur des ETI et des PME et du secteur de la santé. La FFA travaille avec le Ministère de l’Economie pour l’élaboration d’un régime d’assurance contre les risques sanitaires majeurs de type Covid-19 permettant une meilleure protection en cas de nouvelle catastrophe sanitaire.
Le Coin des Epargnants : les marchés en mode résilient !
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 10 avril 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 506,85 | +1,55 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 23 719,37 | +4,58 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 8 153,58 | +3,04 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 10 564,74 | +2,01 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 842,66 | +2,42 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 2,892.79 | +1,23 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 19 498,50 | +9,42 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 796,63 | +2,24 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (13 heures) | +0,101 % | +0,026 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (13 heures) | -0,342 % | -0,097 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (13 heures) | +0,729 % | +0,150 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (13 heures) | 1,0939 | +1,19 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (13 heures) | 1 675,000 | +3,76 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (13 heures) | 31.900 | -8,25 % | 66,300 |
Une semaine courte et positive !
La semaine boursière a été écourtée pour cause de Vendredi-Saint. L’ensemble des indices bousiers ont progressé en lien avec les multiples annonces de plan de soutien. La CAC a gagné en une semaine 1,55 % et le Dow Jones près de 4,6 %. Ce dernier indice a profité de l’annonce de la Réserve fédérale, avant l’ouverture de Wall Street, les détails de son plan MSLP (Main Street Lending Program) qui prévoit l’injection possible de près de 2 300 milliards de dollars supplémentaires de d’aides à l’économie afin de fournir des crédits aux petites entreprises et aux municipalités.
Le choix de la monétisation directe par la Banque d’Angleterre
La Banque d’Angleterre a décidé d’aider l’Etat en augmentant temporairement la facilité de caisse qu’elle accorde au gouvernement britannique. Londres va pouvoir financer ses mesures exceptionnelles sans forcément émettre de dette sur les marchés. Cette solution avait déjà été utilisée lors de la crise de 2008. Elle s’assimile à de la création monétaire directe. Cette décision a surpris car Andrew Bailey, le nouveau gouverneur de la Banque d’Angleterre, s’était prononcé contre toute initiative de la sorte dans une tribune publiée par le Financial Times. Le financement direct d’un Etat auprès de sa banque centrale est jugé peu orthodoxe car porteur de risques d’inflation et de déficits sans limite. Cette pratique a amené dans le passé des banqueroutes. Le dispositif utilisé outre-Manche sera néanmoins encadré. La banque centrale britannique augmentera la taille du compte du gouvernement, baptisé « Ways and Means ». Cette facilité de caisse permet aux pouvoirs publics de faire face à des besoins exceptionnels de trésorerie, ou à des problèmes sur les marchés financiers. La taille de ce compte tourne en temps normal, autour de 400 millions de livres sterling. Le montant du nouveau plafond n’a pas été communiqué. En 2008, il avait brièvement dépassé 20 milliards de livres. Ce dispositif sera « temporaire et de court terme », a précisé le Trésor Britannique. Les montants empruntés seront remboursés le plus tôt possible, et au plus tard à la fin de l’année.
Le pétrole, un accord à confirmer
La réunion des pays producteurs de pétrole (OPEP) réunis jeudi 9 avril a abouti à un accord de réduction de la production de 10 millions de barils/jour. Sa mise en œuvre reste conditionnée à la signature du Mexique. Dans un deuxième temps, de juillet à décembre, la réduction sera de 8 millions de barils par jour.Cet accord doit permettre une remontée des cours après la guerre des prix engagée entre la Russie et l’Arabie saoudite et la baisse de la demande mondiale de pétrole qui se situe entre 25 % et 35 %.
Ces derniers jours, le Président russe, Vladimir Poutine, et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avaient laissé entendre qu’ils étaient prêts à réduire leur production sous réserve que les Etats-Unis, premier producteur mondial, acceptent de faire de même. Jamais, les Eatts-Unis n’ont dans le passé accepté un accord de régulation de production multinational. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid en soutenant le principe d’un accord de réduction mais sans faire aucune promesse. Le Président américain ne peut pas se désintéresser de la situation des producteurs américains en pleine crise sanitaire et à quelques mois de l’élection pérsidentielle.
Dans le cadre de l’accord du 9 avril 2020, l’Arabie saoudite et la Russie ont pris l’engagement de réduire de plus de 2,5 millions de barils/jour leur production respective. L’OPEP et la Russie souhaitent que les pays non signataires de l’accord – en particulier les Etats-Unis et le Canada – diminuent leur production de 5 millions de barils par jour. Une réunion des ministres de l’énergie des pays du G20, vendredi, pourrait entériner une telle orientation.
L’ampleur de la réduction est jugée insuffisante compte tenu de la situation économique. La forte réduction des transports ainsi que l’arrêt de nombreuses usines pèsent sur la demande de pétrole. Les pays producteurs cherchent à gérer l’augmentation de leurs stocks et d’éviter les fermetures de gisement, fermetures qui sont coûteuses à réaliser.
En fin de semaine, les marchés étaient peu convaincus par l’accord. Le baril de Brent s’échangeait à 31 dollars en baisse sur une semaine de 8,25 %. Depuis le début de l’année, le cours a diminué de plus de 50 %.
L’économie française débraye
Les Français ont appliqué de manière plus scrupuleuse que leurs voisins le confinement. Ainsi, le trafic routier a baissé avec l’instauration du confinement de 62 % en France contre 53 % en Italie, 33 % en Espagne et 31% en Allemagne. Le trafic aérien est en chute de 94 % en France contre une contraction de 78 % en Allemagne et de 20 % en Italie. La consommation d’électricité a diminué de 12,3 % en France, de 24,1 % en Italie et de 7,2 % en Allemagne. Les déplacements dans les commerces non alimentaires est en réduction de 88 % en France, contre -77 % en Allemagne et -26 % aux Etats-Unis. La fréquentation des bureaux et lieux de travail a baissé de 56 % en France, de 39 % en Allemagne, de 63 % en Italie et de 9 % aux Etats-Unis. La France pays tertiarisé et disposant d’un taux élevé de ménages connectés pratique le télétravail de manière plus importante que les pays plus industrialisés. Dans la grande majorité des pays de l’OCDE, la diminution de l’activité est évaluée entre 35 et 55 %.
Pour la France, selon la dernière étude de conjoncture de l’INSEE, au 9 avril 2020, l’activité économique française aurait diminué de l’ordre de 36 %. Ce taux atteint 42 % pour le secteur marchand. Les seuls services marchands sont responsables de plus de la moitié à cette baisse (–22 points). Le commerce, les services de transports et l’hébergement-restauration contribueraient à eux seuls au tiers de la perte d’activité.
La baisse d’activité atteindrait 44 % dans l’industrie. Elle est provoquée par la diminution de la demande interne et externe, de l’incapacité à disposer de l’ensemble des salariés et de la rupture des chaines d’approvisionnement. L’industrie agroalimentaire serait la moins affectée des branches de l’industrie. Le secteur du bâtiment serait presque à l’arrêt.
Pour un mois complet de confinement, la perte d’activité économique équivaut comptablement à une perte d’environ 3 points de croissance du PIB annuel. Selon l’INSEE, l’effet du confinement en termes d’activité n’est sans doute pas linéaire dans le temps.
L’INSEE estime que les semaines ou les mois qui suivront le déconfinement seront affectés par la crise sanitaire du fait de la persistance d’un risque de deuxième vague. L’institut statistique considère que la reprise de l’activité sera progressive en raison de l’existence de contraintes en matière de déplacement La baisse des revenus des ménages pèsera sur la demande tout comme le maintien d’un climat d’incertitudes.
Au 9 avril 2020 selon l’INSEE, la consommation finale des ménages aurait diminué de 35 % par rapport à une situation « normale ». La demande des ménages en biens manufacturés explique 17 points de cette baisse. Les dépenses de textile, d’habillement et de carburant) sont en forte diminution. Elles sont inexistantes pour les ventes de voiture. D’autres se maintiennent (énergie) voire augmentent, telles les dépenses en produits agroalimentaires (comportements de report de consommation du fait de l’arrêt de la restauration traditionnelle et collective). La consommation de services principalement marchands serait en baisse de 33 %, soit une contribution de 15 points à la baisse. L’hébergement, la restauration et les services de transport sont en forte diminution quand d’autres seraient peu affectés (télécommunication, services financiers et d’assurance ou services immobiliers, principalement constitués des loyers…). Les services principalement non marchands enregistreraient une diminution de 39 % (enseignement et formation, soins de santé en ville). La demande des ménages pour les dépenses de construction diminuerait de 90 % avec la suspension de la plupart des travaux de rénovation. En revanche, la consommation en produits agricoles augmenterait de 10 %, parallèlement aux dépenses de produits agroalimentaires.
L’OCDE évalue à –32 % l’impact des mesures de confinement sur la consommation finale des ménages en France, soit une estimation proche de celle de l’INSEE. de la nôtre. Pour l’OFCE, la perte s’élèverait à 18 %. Une partie de l’écart s’explique par une
différence de champ, l’OFCE s’intéressant à la consommation finale effective des ménages, c’est-à-dire intégrant les biens et services produits par les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages.
France, une récession logique mais qui ne présage en rien de l’avenir
Après un recul au dernier trimestre 2019 de 0,1 point du PIB français, celui-ci se serait contracté, selon la Banque de France, de 6 points au 1er trimestre. Avec deux trimestres de recul du PIB, la France est entrée en récession. Une telle situation ne s’était pas produite depuis 2009.
Chaque quinzaine de confinement entrainerait une perte de PIB annuel proche de -1,5 point. La perte d’activité subit durant la période de confinement de 15 jours au mois de mars est de 32 %. Les montants des paiements effectués par cartes bancaires ont baissé de 50 % pendant la semaine du 23 au 29 mars. La consommation des ménages se serait contactée de 30 % durant cette période.
L’économie française n’a pas connu de nombreux évènements durant son histoire contemporaine de tels évènements. Parmi les précédents figurent les évènements de mai 1968 qui avaient provoqué un recul au 2e trimestre de 5,3 % du PIB, recul qui avait été compensé par une hausse de 8 points au 3e trimestre 1968. Par rapport à la crise financière de 2008 qui s’était soldé par un recul du PIB de 2,9 % en 2009, la chute de l’activité est en 2020 1,5 fois supérieur pour l’industrie et 4 fois supérieur pour les services.
Cette récession est évidemment logique en raison de la fermeture de nombreuses entreprises et du confinement qui freine tant la production que la consommation. Le choix du gouvernement a été de maintenir autant que possible en état les capacités de production afin de permettre un rebond rapide l’économie. Le choix du chômage partiel et du soutien aux entreprises s’inscrit dans cette logique. Certains secteurs et certaines régions nécessiteront des dispositifs de soutien spécifiques après la fin du confinement. La Corse dont le tourisme avec le secteur de la construction plus de 30 % du PIB est fortement touchée par la crise du coronavirus tout comme les principales zones touristiques du pays. En sortie de crise, les pouvoirs publics devront veiller à éviter une multiplication de faillites de PME qui pourraient accroître la désertification économique au sein de certains territoires.
La capacité de rebond de l’économie française dépend de la mobilisation de tous les acteurs. La mise en place de plans coordonnées au niveau européen facilitera le redémarrage et surtout sa pérennisation.
Le Coin des Epargnants : montagnes russes en vue
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 10 avril 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 154,58 | -4,53 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 21.052,53 | -2,70 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 7 373,08 | -1,72 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 9 525,77 | -1,11 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 415,50 | -1,72 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 2 662,99 | -2,41 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 17 820,19 | -8,09 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 763,99 | -0,30 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,074 % | +0,144 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,439 % | +0,040 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +0,579 % | -0,187 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0784 | -3,19 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 615,678 | -0,64 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 33,100 | +32,24 % | 66,300 |
La sortie du tunnel pas encore entrevue
Les marchés sont repartis à la baisse cette semaine sur fond de dégradation de l’emploi aux Etats-Unis et d’indices PMI déprimants aux Etats-Unis et en zone euro.
Entre février et mars, l’indice PMI composite de l’institut IHS Markit, qui fait la synthèse entre l’industrie et les services, a chuté aux de 51,6 à 29,7 points Etats-Unis, du jamais-vu depuis la création de la statistique en 1998. Selon Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, ce résultat suggère une compression annuelle du PIB de 10 %. En Europe, les indices PMI sont toujours en baisse. Celui du secteur des services italien est tombé à 17,4 en mars. Tant que les résultats tangibles des confinements se feront sentir, le pessimisme sera de mise. La lueur viendra quand les dispositifs de déconfinement entreront en vigueur.
Dans ce contexte, l’indice CAC 40 a perdu 4,5 % en une semaine. Le Daxx allemand a mieux résisté en ne cédant que 1,11 %. Le Dow Jones a cédé de son côté 2,7 %.
L’écart de taux entre la France et l’Allemagne s’est accru et dépasse désormais 0,5 point. Le taux de l’obligation d’Etat italien est également en hausse de 0,3 point en une semaine à 1,54 %.
Le pétrole en mode montagne russe
Après avoir atteint un point bas à 20 dollars le baril, le pétrole a gagné en quelques jours plus de 30 % et a terminé la semaine à 32,24 dollars. Cette augmentation est la conséquence des appels de l’OPEP et de ses alliés à une baisse de la production mondiale pour enrayer la chute des cours. Une réduction de 10 millions de barils par jour serait l’objectif. Une réunion d’urgence par téléconférence des pays de l’OPEP avec la Russie est prévue le lundi 6 avril.
La Banque chinoise à la manœuvre
La banque centrale chinoise (PBoC) a réduit de 20 points de base, à 2,2 %, son taux de référence (« reverse repo ») à 7 jours. Une telle baisse n’avait pas été pratiquée depuis l’été 2015 au moment où les autorités chinoises cherchaient à contrer une grave crise boursière. Cette décision vise à aligner la politique monétaire chinoise sur celles des autres grandes banques centrales. La Chine qui, depuis trois mois, est confrontée à une crise interne doit, désormais, faire face à une chute de ses exportations en raison de la mise en cape de l’économie occidentale.
La banque centrale chinoise a décidé de renouer avec les injections de liquidité à hauteur de 6,4 milliards d’euros. Son objectif est d’éviter une crise financière en raison de l’accumulation de créances douteuses. Des retards de paiement pour des prêts à la consommation commencent à être enregistrés dans plusieurs régions chinoises. Pour venir en aide aux collectivités locales et pour soutenir l’activité, Pékin a également prévu d’émettre une série d’obligations souveraines libellées « coronavirus », et d’autoriser les gouvernements locaux à placer davantage d’obligations pour financer des projets d’infrastructures.
Les taux d’usure pour le deuxième trimestre 2020
La Banque de France a publié le 1er avril 2020 les taux d’usure applicables au cours du 2e trimestre ainsi que les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement lors du premier trimestre.
| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 1er trimestre 2020 | Taux d’usure applicable au 1er avril 2020 |
| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,98 | 21,31 |
| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 8,40 | 11,20 |
| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,26 | 5,68 |
| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,81 | 2,41 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,80 | 2,40 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 1,88 | 2,51 |
| Prêts à taux variable | 1,70 | 2,27 |
| Prêts relais | 2,24 | 2,99 |
| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,40 | 1,87 |
| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,21 | 1,61 |
| Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 2,35 | 3,13 |
| Découverts en compte | 10,88 | 14,51 |
| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,21 | 1,61 |
| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Découverts en compte | 10,88 | 14,51 |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.
La rémunération des livrets bancaires encore en baisse
En février, selon la Banque de France, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires s’élevait à 0,52 %, contre 0,58 % janvier. La rémunération des livrets bancaires atteint le niveau historique de 0,14 % contre 0,16 % en janvier.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| févr- 2019 | déc- 2019 | janv- 2020 (e) | févr- 2020 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,63 | 0,58 | 0,58 | 0,52 |
| Ménages | 0,88 | 0,82 | 0,83 | 0,73 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,78 | 0,71 | 0,68 | 0,65 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,55 | 1,25 | 1,21 | 1,18 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| – plan d’épargne-logement | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,59 |
| SNF | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,31 | 1,09 | 1,07 | 1,05 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,31 | -0,40 | -0,39 | -0,41 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,14 | -0,40 | -0,41 | -0,52 |
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
h. La date de prise d’effet de la baisse du taux du livret A à 0,50% est le 1er février 2020.
Les marchés en baisse mais pas en enfer !
En un mois, le CAC 40 a perdu 17,21 %. Pour le premier trimestre, la perte atteint 26,46 %, ce qui est le recul le plus important constaté depuis la création en 1987 du CAC 40. Pour le Daxx allemand, la chute est de 25,01 % pour les trois premiers mois de l’année. Elle est de 23,20 % pour le Dow Jones et de 14,18 % pour le Nasdaq. Il est à souligner que sur un an, ce dernier indice ne baisse que de 0,38 %.
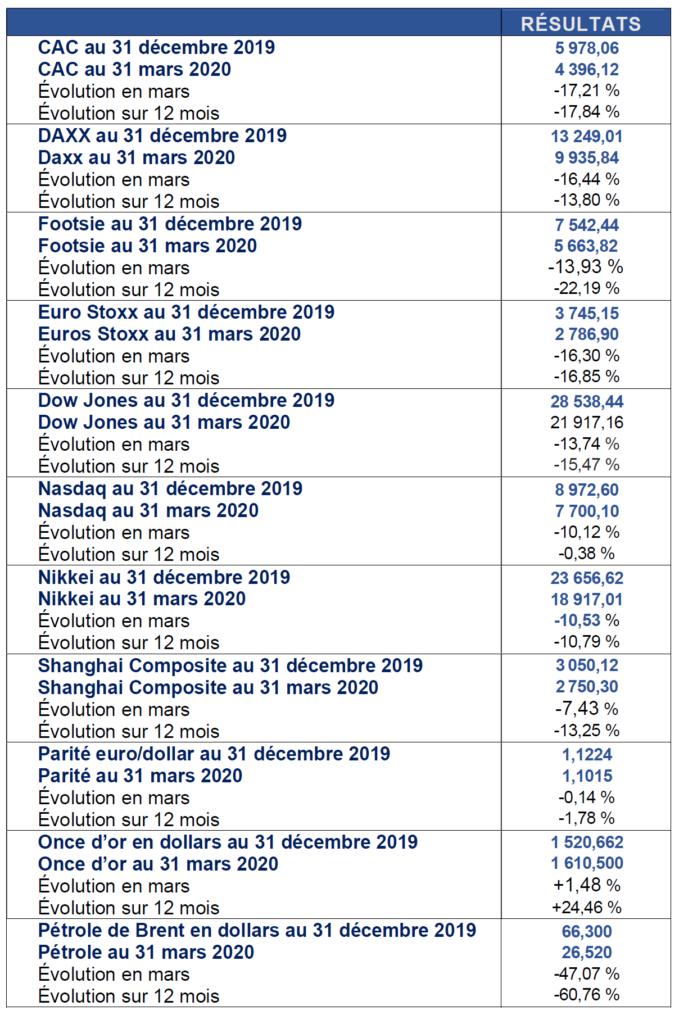
La crise du coronavirus provoquant le confinement de la moitié de la population mondiale a provoqué par voie de retour un choc économique sans précédent, avec une forte contraction de l’offre et de la demande, avec la quasi disparition des liaisons aériennes. Au regard de l’ampleur de la mise en cape de l’économie mondiale, le recul des marchés « actions » peut apparaître assez limité. Les autorités de marché se sont refusées à juste titre à arrêter les cotations. Une telle décision aurait amené plus d’anxiété que de calme. Elle aurait pu provoquer un effet de panique. Malgré la succession de mauvaises nouvelles, l’offre et la demande ont été au rendez-vous.
Les investisseurs se sont protégés mais sans exagération. L’intervention massive des Etats qui aboutira à un nouveau gonflement de l’endettement public les a convaincus de ne pas tout miser sur les obligations.
Les taux d’intérêt sous contrôle des banques centrales
Les taux d’intérêt des obligations d’Etat européennes ont été orientés à la hausse jusqu’à l’intervention massive des banques centrales. Tout en étant supérieurs à leur niveau de la fin février, ils sont nettement en-dessous de leur niveau de la fin d’année dernière. Aux Etats-Unis, la très forte baisse des taux directeurs de la Banque centrale a entraîné la baisse des taux qui sont fin mars 1,3 point au-dessous de leur niveau de la fin décembre 2019.
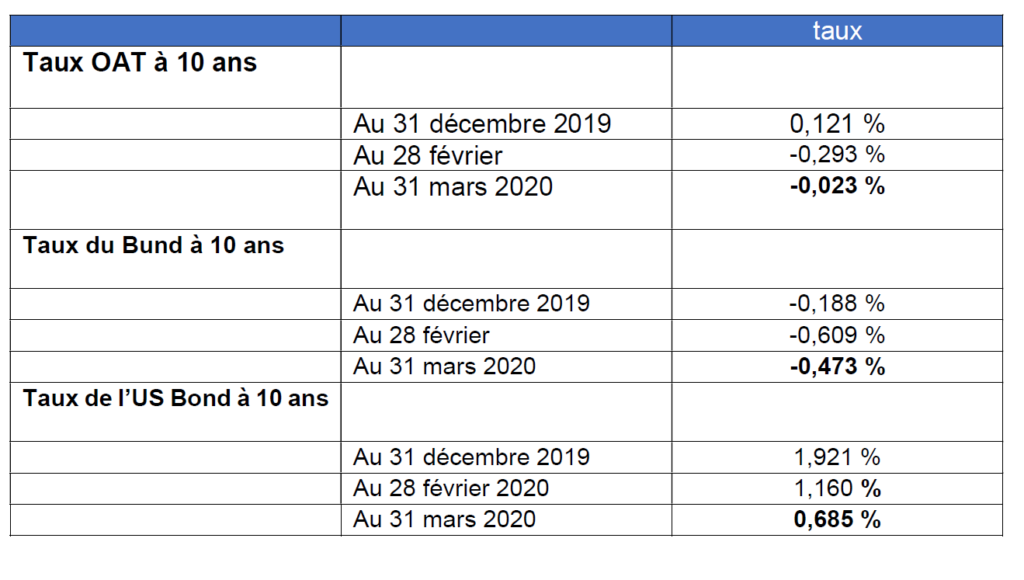
Le pétrole en chute libre
Le premier trimestre est également par la chute des prix du pétrole. En un trimestre, le baril de Brent a perdu 60 % de sa valeur. Sur le seul mois de mars, la baisse a atteint 47 %. Cette forte baisse a amené le cours du baril au cours du mois de mars au bord du seuil des 20 dollars, soit moins qu’en 2016. Cette chute est le produit de l’affaissement de la demande en lien avec la crise du coronavirus et de la guerre des prix que l’Arabie saoudite et la Russie. L’OPEP était censé reconduire l’accord de régulation de l’offre datant de 2016 et qui avait été jusqu’alors accepté par la Russie. Cette dernière a refusé de restreindre plus fortement que prévu sa production, ce qui amené l’Arabie saoudite à se délier de l’accord. L’objectif est de contraindre les Russes accepter les réductions de quotas de production.
L’once d’or a augmenté au cours du premier trimestre de 5,52 % et de seulement 0,96 % en mars. Cette relative progression s’explique par le fait que les investisseurs ont avant tout privilégié la liquidité les amenant à vendre de l’or.
Le Coin des Epargnants du 27 mars 2020
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 27 mars 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 351,49 | +7,48 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 21 636,78 | +12,84 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 7 502,38 | +9,05 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 9 632,52 | +7,88 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 510,33 | +6,16 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 2 586,02 | -19,99 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 19 389,43 | +17,14 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 772,20 | +0,97 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,070 % | -0,084pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,479% | -0,136 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,735 % | -0,187 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1066 | +3,49 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 625,140 | +8,44% | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 24,590 | -10,39 % | 66,300 |
Une semaine de hauts et de bas
Le CAC 40 a repris quelques couleurs cette semaine avec un gain de plus de 7 % tout en perdant plus de 4 % vendredi. Le Dow Jones a également perdu plus de 4 points vendredi tout en gagnant près de 13 % sur la semaine. Les marchés « actions » sont restés très volatils évoluant au gré des annonces des pouvoirs publics concernant tant le nombre de victimes que les engagements pris pour soutenir les économies. La progression de l’épidémie aux Etats-Unis est devenue un sujet majeur pour les investisseurs. La mise à l’arrêt de la première économie mondiale aurait des effets en chaine importants. L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en une semaine, plus de trois millions a été durement ressenti.
Cette semaine aura été marquée par la présentation du plan de soutien allemand à son économie et l’adoption du plan américain. Le premier porte sur 1200 milliards d’euros et le second sur 2000 milliards de dollars (1846 milliards d’euros).
L’Allemagne prévoit la création d’un fonds de secours pour les grandes entreprises, doté de jusqu’à 600 milliards d’euros, dont 400 milliards d’euros de garanties pour les dettes des entreprises, 100 milliards pour les prêts ou les prises de participation dans les entreprises et 100 milliards pour soutenir la banque d’investissement publique KfW. Cette dernière pourra jusqu’à 822 milliards d’euros de prêts
Le plan américain représente un effort de 10 % du PIB. En vertu de ce plan, l’Etat américain a prévu de verser aux Américains directement 500 milliards de dollars sous la forme d’un chèque de 1 200 dollars par personne, à condition de gagner moins de 75 000 dollars par an pour une personne, et 150 000 pour un couple. Chaque enfant donnera droit à une majoration de 500 dollars. La mesure, dégressive au-delà, vise à maintenir le pouvoir d’achat des Américains dont certains sont privés d’emploi. 250 milliards de dollars ont été affectés à l’indemnisation fédérale du chômage pendant quatre mois. Le Congrès a également voté des prêts destinés aux PME, pour près de 370 milliards de dollars. Ces sommes ne seront pas remboursables si elles servent à payer les salaires, les loyers ou les intérêts d’emprunt immobilier, et les abonnements à l’eau et à l’électricité. 500 milliards de dollars de prêts sont également prévus en faveur des grandes entreprises. 17 milliards de dollars seront alloués à des entreprises jugées stratégiques pour le pays, dont Boeing et General Electric. Les compagnies aériennes, seront aussi secourues à hauteur de 25 milliards de dollars, les aéroports de 10 milliards, le fret et les prestataires de services aériens de 8 milliards. Le programme prévoit d’interdire les rachats d’actions et les bonus des dirigeants. 100 milliards de dollars seront affectés aux hôpitaux et aux entreprises de soins, tandis que 16 milliards permettront l’achat et la production de matériels de première nécessité, comme les masques.
Les Etats fédérés, en première ligne, devront bénéficier de quelque 150 milliards de dollars. Cette somme apparaît faible face aux problèmes financiers que rencontrent les villes et les services publics locaux. Le Gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, s’attend à des pertes de revenus de 9 à 15 milliards de dollars » dans le budget de l’Etat. Le réseau de métro et de bus de New York aurait un besoin immédiat de 3,8 milliards de dollars pour payer les salariés et faire face aux remboursements d’emprunt.
Le pétrole a continué de baisser sur l’ensemble de la semaine dans l’attente d’un accord entre l’Arabie saoudite et la Russie que les Etats-Unis appellent de leurs vœux. Avec les interventions des banques centrales, les taux d’intérêt des obligations souveraines sont en repli cette semaine.
Les principales mesures économiques et sociales des ordonnances prises dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire
Promulguée le 23 mars 2020, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 instaure un état d’urgence sanitaire pour une durée provisoire de deux mois et habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour prendre les mesures d’adaptation et de soutien qu’imposent cette crise sans précédent. Objectif : donner au gouvernement la capacité d’agir pour garantir la santé publique et limiter au mieux les conséquences économiques et sociales de l’épidémie, quitte à restreindre les libertés d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre, pour un temps donné et sous le contrôle du Parlement et du Conseil d’État. L’articulation de ces mesures avec le droit européen fait l’objet d’un « cadre temporaire » adopté le 19 mars 2020 par la Commission européenne et visant à soutenir l’économie dans le contexte de crise sanitaire.
Le soutien aux entreprises
Le Fonds de solidarité
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises au ralenti voire à l’arrêt en raison du confinement, une ordonnance crée un Fonds de solidarité doté d’1 milliard d’euros, (dont 250 millions d’euros en provenance des régions) pour une durée de trois mois prolongeables par décret jusqu’à six mois. Ce fonds de solidarité concerne les très petites entreprises, les micro-entrepreneurs, les indépendants, et les professions libérales les plus touchés par l’épidémie. Pour en bénéficier, il faut un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60000 euros, avoir fait l’objet d’une fermeture administrative et subi une perte de 70% de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. A compter de début avril, une aide de 1500 euros sera versée par l’État. Une aide complémentaire de 2000 euros pourra être attribuée, au cas par cas, par les régions, uniquement aux TPE.
Le maintien de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau
Afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des très petites entreprises éligibles au Fonds de solidarité, une ordonnance interdit la suspension, l’interruption et la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, et prévoit la possibilité d’un paiement échelonné sans pénalité. En cas de défaut de paiement de loyers ou de charges locatives, les pénalités financières, dommages et intérêts, clauses résolutoires ou pénales, de même que les garanties ou cautions ne pourront pas être appliquées pendant cette période d’état d’urgence sanitaire.
L’adaptation des contrats de voyage et de séjours touristiques
Fortement touché par la pandémie, le secteur du tourisme fait l’objet d’une ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages et de séjours en période d’épidémie, et permet pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement des prestations annulées sous forme de reports ou de bons d’achats.
La simplification des règles
Trois autres ordonnances ont pour objectifs de simplifier et de sécuriser le fonctionnement des entreprises durant cette période :
- en prorogeant les délais pour l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les entreprises doivent déposer ou publier annuellement ;
- en adaptant les règles et en prorogeant les délais pour la passation, le paiement, l’exécution et la résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Le Ministre de l’économie et des finances, Bruno le Maire, a indiqué qu’il n’y aura plus de limite au paiement des avances, dont le plafond est habituellement fixé à 60% ;
- en aménageant les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des entreprises, afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement. Ces instances pourront être reportées au mois de septembre.
L’accès facilité aux services et réseaux de communication
Une ordonnance raccourcit les délais et simplifie les procédures préalables à l’implantation ou à la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques très sollicités dans cette période de confinement.
L’assouplissement temporaire du droit du travail
La fixation des congés payés, des RTT et des jours de repos
Une ordonnance précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant désormais un délai d’un jour franc seulement à l’avance (au lieu de quatre semaines). Les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, pourront être imposées ou différées unilatéralement par l’employeur sans qu’il y ait un accord collectif.
Travailler plus sur la base du volontariat
Cette ordonnance prévoit d’élargir les possibilités de dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises des secteurs essentiels qui ont un surcroît d’activité, de déroger aux règles actuellement en vigueur et de fonctionner jusqu’à 7 jours sur 7 sur une période limitée au 31 décembre 2020. Sont notamment concernés l’énergie, les télécoms, la logistique, les transports, les activités agricoles ou encore la filière agroalimentaire. Concrètement, le seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives au-delà duquel on ne peut travailler, pourra être porté à 46 heures (plafond fixé au niveau européen). Fixée à 48 heures, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 60 heures. A partir de la 36ème heure de travail, la majoration pour heure supplémentaire de 25 % s’appliquera, avec un minimum de 10 %, ainsi que les repos compensateurs dans les conditions de droit commun. Le repos compensateur minimal entre deux journées de travail pourra être réduit de 11 heures à 9 heures. Le travail dominical pourra être élargies sur la base du volontariat des salariés. En cas d’application occasionnelle, le volontariat ne sera pas nécessaire.
Protection sociale, prime et intéressement
Une ordonnance adapte temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’allocation complémentaire à l’indemnité journalière perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel (notamment d’épidémie), et élargit le champ des salariés éligibles. Avec le nouveau dispositif, le délai de carence de 3 jours est supprimé, de même que la condition d’ancienneté demandée dans certaines entreprises pour verser l’allocation complémentaire. Le versement aux salariés des sommes au titre d’un régime d’intéressement ou de participation qui leur sont dues au titre de l’exercice 2019 est reporté au 31 décembre 2020. Cela concerne également la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime Macron reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et dont le versement était conditionné à la signature d’un accord d’intéressement avant le 30 juin. Cette condition préalable a été levée et la prime de 1000 euros défiscalisée peut être versée aux salariés mobilisés pendant la crise sanitaire.
Le chômage partiel pour tous les salariés
S’inspirant de l’expérience allemande lors de la crise financière de 2008, une ordonnance permet d’étendre le chômage partiel à tous les salariés, y compris les assistantes maternelles, les employés à domicile, les intérimaires (dont la mission est en cours ou interrompue), les VRP, et les employés d’entreprises étrangères payant leurs cotisations en France. L’État assurera la prise en charge totale des indemnisations versées aux salariés par les entreprises en cas d’activité partielle, jusqu’à hauteur de 4,5 SMIC. Un délai de 30 jours sera accordé aux entreprises pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a précisé qu’en cas de non-réponse à l’entreprise au bout de 48h, son dossier est accepté et elle est remboursée dix jours plus tard. Au 25 mars, le ministère du travail annonçait 730.000 personnes en chômage partiel, soit presque le double en six jours.
L’offre de modes de garde élargie
Afin de faciliter l’accueil des enfants dont les parents travaillent dans les secteurs d’activités essentiels, en particulier les personnels soignants, une ordonnance autorise les assistants maternels à accueillir simultanément jusqu’à six enfants (contre quatre dans le droit commun). Un service unique d’information des familles permettra de connaître en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles.
Mesures sociales
Le maintien des revenus de remplacement
Une ordonnance prolonge le bénéfice de l’allocation chômage, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leur droit à compter du 12 mars 2020. Ces droits sont prolongés jusqu’au mois d’avril et tant que durera la période de confinement.
L’emploi et les ressources des personnes en situation de handicap
Une ordonnance assure le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap (l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ainsi que la continuité des droits des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Dans la même logique, une ordonnance relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux permet le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d’aide par le travail, en cas de réduction de l’activité ou de fermeture de l’établissement.
La prolongation de la trêve hivernale
Une ordonnance prolonge la trêve hivernale du 31 mars au 31 mai et sursoit aux mesures d’expulsion et d’interruption de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité durant cette période.
Début mars, les Français pressentaient l’arrivée des problèmes !
L’INSEE a réalisé son enquête mensuelle sur le niveau de confiance des ménages du 26 février au 17 mars. Les résultats reflètent l’état d’esprit des Français juste avant le confinement.
A mi-mars, la confiance des ménages dans la situation économique était en baisse tout en restant au-dessus de sa moyenne de longue période. L’inquiétude dans l’avenir était néanmoins en augmentation. Ainsi, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminuait fortement par rapport au mois précédent. Le solde correspondant a perdu sept points et bascule en dessous de sa moyenne de longue période.
Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future a diminué de deux points et est repassé en dessous de sa moyenne de longue période. Malgré tout, solde relatif à leur situation financière passée avait gagné deux points et se maintenait au-dessus de sa moyenne de longue période.
Début mars, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future était en augmentation et restait au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle avait gagné un point et demeurait également au-dessus de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant qu’il était opportun d’épargner était en progression.
Concernant l’évolution du niveau de vie, les Français étaient plus pessimistes au début du mois de mars qu’en février. En revanche, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois était en augmentation. Avant même l’annonce du confinement, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage était en très forte augmentation, + 22 points. Enfin, début mars, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont nettement plus nombreux que le mois précédent.
L’enquête du mois d’avril prendra en compte la période du confinement qui s’est traduit par le développement du chômage partiel, plus de 1,6 million de personnes concernées (26 mars). Les jugements des Français devraient être tout autres que ce soit sur l’évolution du niveau de vie et de l’épargne.
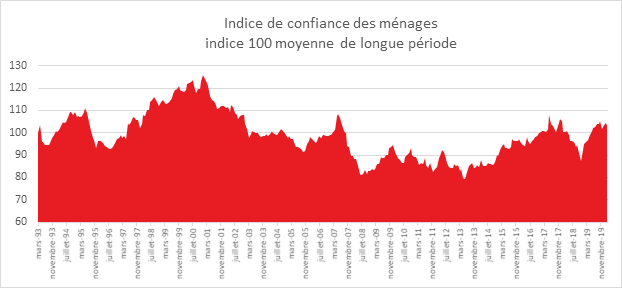
Questions et réponses pour des épargnants perdus face à la crise du coronavirus
- Avec la crise du coronavirus, les marchés « actions » sont en forte baisse. Quelle sont les conséquences pour les épargnants français ?
Le patrimoine des ménages est, en France, peu sensible aux variations des marchés « actions ». Pour plus de 60 % il est composé d’actifs immobiliers dont les évolutions sont plus lentes que celles des marchés boursiers. Les actifs financiers s’élevaient à 5300 milliards d’euros en 2019. Trois quarts de ce montant sont investis en produits de taux qui ne sont pas touchés par la chute des cours des actions. Les seuls dépôts bancaires des ménages dépassent 1 500 milliards d’euros. En leur sein figurent les produits d’épargne réglementée (Livret A, LDDS, Livret d’Epargne Populaire, Livret Jeune…). Les fonds euros bénéficiant d’une garantie en capital représentent 81 % de l’encours qui s’élèvent à plus de 2000 milliards d’euros (avec les produits assurantiels d’épargne retraite). Les valeurs pouvant être touchées par la chute des bourses sont les actions détenues en direct, les unités de compte investies en actions et les parts d’Organismes de Placement collectif également investis en actions. ’encours des Les actions cotées détenues par les ménages s’élevait à la fin du troisième trimestre 2019 à 292 milliards d’euros. L’encours total des unités de compte 378,1 milliards d’euros toujours à fin septembre 2019. Par ailleurs, les Français détenaient pour 117,8 milliards d’euros d’actions de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC).
- Les épargnants qui ont acheté des actions ou des unités de compte juste avant la crise, ont-ils fait une très mauvaise opération ?
Les « actions » sont par nature des placements de long terme dont la valorisation s’apprécie sur le long terme. La crise du Covid-19 est brutale mais, en l’état, elle ne remet pas en cause les capacités de rebond des économies. Avant la crise, les résultats des entreprises étaient corrects, ce qui leur donnent les moyens de retrouver rapidement le chemin de la croissance. La levée des incertitudes sanitaires et économiques constitue, un préalable à la remontée des cours, ce qui peut exiger entre quelques semaines et quelques mois.
- Avec la crise, les banques et les compagnies d’assurances peuvent-elles faire faillites ?
Depuis la dernière crise financière de 2008, les banques et les compagnies d’assurances, en France, ont renforcé leurs fonds propres. Elles ont réussi les stress tests de la Banque centrale européenne qui assure un rôle de surveillance et de contrôle. En cas de banqueroute d’un établissement, les mécanismes de garanties joueraient. Les dépôts bancaires sont garantis par client et par établissement à hauteur de 100 000 euros. Les comptes titres (actions, obligations, etc.) et les contrats d’assurance vie sont garantis à hauteur de 70 000 euros par client et par établissement.
- Le Gouvernement a annoncé d’éventuelles nationalisations. Quelles conséquences pour les épargnants ?
Le Premier Ministre comme le Ministre de l’Économie ont indiqué que si des entreprises stratégiques étaient en difficulté, des prises de participation pourraient être réalisées par l’État. Cela pourrait concerner le secteur aérien et celui de l’automobile. L’intervention de l’État prendrait la forme d’une entrée en capital, ce qui permettrait de sauver les entreprises de la faillite. C’est donc une bonne nouvelle pour les actionnaires. En revanche, une augmentation du capital engendrerait, dans un premier temps, une baisse de la valeur des actions.
- Avec les interventions massives des banques centrales et des gouvernements, l’inflation ne risque-t-elle pas, dans les prochains mois, d’augmenter très fortement?
La tendance de court terme est plutôt déflationniste avec une baisse des prix de l’énergie et des matières premières. L’offre et la demande se contractant en parallèle, il n’y a pas de déséquilibres pouvant amener de l’inflation. À la fin de la crise sanitaire la demande pourrait rebondir plus vite que l’offre dont le retour à la normale passe par le rétablissement des lignes d’approvisionnement. Dans ces conditions, un risque d’inflation existe. Il sera limité car a priori les gouvernements opteront pour des dispositifs de sortie progressive des confinements. À la lumière de la crise précédente, les injections de liquidités ont peu d’effets sur l’inflation au grand dam des banques centrales.
- Avec la crise du coronavirus, l’immobilier est-il une valeur refuge ou les prix peuvent-ils baisser ?
L’immobilier n’est pas un actif bénéficiant d’une garantie en capital. Les prix des logements avaient fortement baissé entre 1992 et 1995 en raison de la hausse des taux d’intérêt. Lors de la crise de 2008 et de celle de 2012, une baisse avait été constatée en France. Avec le confinement, le marché a été gelé, la demande étant inexistante. Avec la récession et la diminution de revenus pour un certain nombre de ménages, avec la moindre présence des investisseurs internationaux, les prix devraient s’orienter à la baisse dans les prochains mois. La stabilisation du marché dépendra de l’ampleur du rebond économique.
- L’endettement massif des États n’est-il pas un vecteur de crise financière pour les prochaines années ?
Les États s’étaient fortement endettés après la crise de 2008. À l’exception de l’Allemagne, le poids de leurs dettes ne s’était pas réduit ces dernières années. Afin de limiter les conséquences de la crise du Covid-19 sur les ménages et les entreprises, les États ont décidé d’engager de vastes plans de soutien. Ces derniers devraient aboutir à un accroissement des dettes. Au niveau européen, la zone euro, malgré ses imperfections, joue un éminent rôle de mutualisation des risques.
- Les taux d’intérêt peuvent-ils connaître une forte hausse avec l’augmentation de l’endettement ?
D’un côté les banques centrales ont renforcé leur politique monétaire accommodante, de l’autre côté, les investisseurs s’inquiètent de l’endettement croissant et exigent des primes de risque plus élevées à l’encontre des États les moins bien notés. Pour contrer la crise, la FED a abaissé ses taux directeurs à 0/0,25 % et ceux de la Banque centrale européenne sont en territoire négatif à -0,5 %. Les banques centrales ont, par ailleurs, pris l’engagement de racheter des obligations d’État et d’entreprise pour des montants de plusieurs centaines de milliards d’euros. Une remontée des taux d’intérêt supposerait une situation de défiance à l’encontre d’un ou plusieurs pays. À l’heure actuelle, l’économie mondiale ne peut guère se payer le luxe d’ajouter à ses problèmes une crise financière. Dans ces conditions, les taux d’intérêt devraient rester faibles dans les prochains mois.
- Les gouvernements augmenteront-ils les prélèvements obligatoires pour financer le surcroît de dépenses ?
Les déficits publics devraient augmenter assez fortement en 2020. Celui de la France devrait dépasser 3,9 % du PIB. Lors de la crise de 2008, il avait atteint 7,2 % du PIB. Les gouvernements souhaitent avant tout un fort rebond de l’économie qui sera générateur de recettes fiscales. Compte tenu du choc économique subi, il faudra plusieurs années pour assainir la situation. Il n’est pas exclu que les pouvoirs publics soient contraints d’augmenter les impôts et taxes. Cela ne devrait intervenir qu’après la phase de consolidation.
- Quelles est la situation conjoncturelle en Chine qui a été le premier pays touché par le coronavirus ?
Après trois mois de crise, un redémarrage de l’économie serait en cours. La consommation quotidienne de charbon pour la production électrique serait en hausse tout comme le nombre de kilomètres d’embouteillage dans les grandes villes. Les ventes des surfaces commerciales sont en légère progression. Les porte-conteneurs recommencent à partir des ports. Transposés à l’Occident, ces résultats signifieraient un début de normalisation de la situation économique vers la fin mai, début juin.
L’économie française touchée mais pas coulée
L’INSEE a publié son enquête de conjoncture du mois de mars qui a été réalisée du 26 février au 23 mars et inclue donc en partie la phase de confinement du pays. L’institut statistique a précisé qu’à partir du 14 mars, les réponses « papier » n’ont pas été gérées.
Selon les données recueillies, le climat des affaires a perdu 10 points, à 95. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle de l’indicateur depuis le début de la série (1980). En octobre 2008, après la faillite de Lehman Brothers, l’indicateur avait chuté de 9 points. L’indicateur de climat de l’emploi connaît également sa plus forte chute depuis le début de la série (1991). Il perd 9 points et atteint 96.
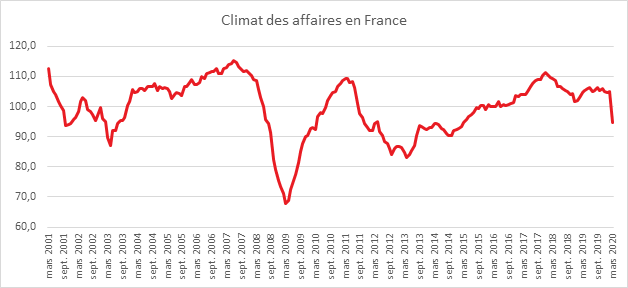
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Au niveau sectoriel, les indicateurs de climat des affaires se dégradent considérablement dans les services (-14 points) et dans le commerce de détail (-13 points). Ils se détériorent également dans le commerce de gros (-5 points) et dans l’industrie (-3 points).
Sans surprise, les perspectives générales d’activité dans chaque secteur sont en forte baisse, -15 points dans les services, -25 points dans le commerce de détail, -33 points dans l’industrie et dans le commerce de gros.
Pour l’INSEE, les indicateurs concernent le climat des affaires dans l’industrie du bâtiment qui ressortent stables, reflètent la situation au début du mois de mars.
En fonction des données en sa possession fin mars, l’INSEE estime que la perte d’activité économique atteint 35 % par rapport à une situation normale.
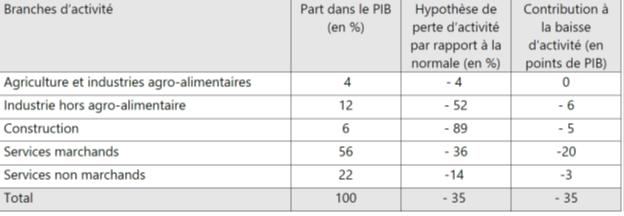
La France se distingue par le poids très important du secteur tertiaire et par celui des dépenses publiques. Si au niveau des services, le confinement a entraîné l’arrêt des activités liées au tourisme, aux transports et aux loisirs, il a un effet moindre sur les secteurs des télécommunications ou de la finance. L’industrie française ne fonctionnerait, fin mars qu’à 50 %. Les entreprises de l’automobile sont, en particulier, à l’arrêt (PSA, Renault, Michelin). En revanche, l’industrie agro-alimentaire maintient, pour le moment, ses niveaux de production. La production agricole n’a pas connu une forte variation mais ce résultat n’est pas significatif étant donné que nous sortons de l’hiver. Le secteur de la construction est très touchée à la fois par l’absence de personnel mais aussi par les ruptures de stock.
Les dépenses publiques, et en particulier sociales, devraient jouer, comme en 2008, en France comme en 2008, un rôle d’amortisseur important. La réduction de certaines activités non-marchandes comme les crèches, les garderies, les bibliothèques, les centres sportifs, ponctionnera le PIB.
La consommation des ménages serait également inférieure de 35 % à sa « normale ». Les chutes les plus importantes concernent les dépenses en biens industriels. Les achats de textile auraient baissé de 90 à 100 %. Il en est de même pour les voitures.
La consommation de services marchands s’est contractée de 33 %, contribuant à la baisse totale de la consommation à hauteur de 15 points. Avec la fermeture des cafés et restaurants, la consommation en la matière a quasiment disparu. La consommation de services non marchands baisserait de 34 %, contribuant à hauteur de 2 points à la baisse d’ensemble. Du fait de la suspension des travaux de rénovation, la consommation des ménages dans la branche de la construction baisserait de 90 %, contribuant à une baisse de 1 point de la consommation totale des ménages.
Les secteurs enregistrant des hausses sont ceux de l’eau et de l’industrie pharmaceutique. La consommation des ménages en produits agricoles et agro-alimentaires augmenterait de 6 %. Les ménages, en raison du confinement, s’alimentent à domicile.
Les services immobiliers se maintiendraient en raison du caractère récurrent du versement des loyers.
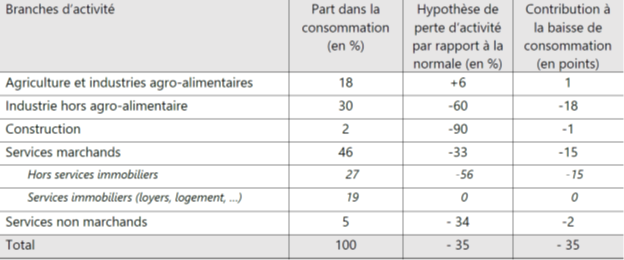
L’INSEE évalue la perte de PIB d’un mois de confinement à 12 points en rythme trimestriel entraînant une perte de 3 points sur l’année sous réserve d’un rebond rapide. Les modalités de sortie de la crise sanitaire, la nature des plans de soutien et le niveau de confiance de la population sont autant de facteurs cruciaux pour l’évolution de la croissance dans les prochains mois.
| Durée de confinement | Effet sur le PIB trimestriel | Effet sur le PIB annuel |
| Un mois | -12 | -3 |
| Deux mois | -24 | -6 |
Source : INSEE
Report des versements des primes d’épargne salariale
La loi d’urgence adoptée ce dimanche 22 mars par le Parlement permet au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnances. Mercredi 25 mars, en Conseil des ministres, une ordonnance a été présentée afin de prévoir un report de la date limite de versement des primes d’intéressement et de participation aux salariés. logiquement, en temps normal, ces primes doivent être versées par l’entreprise au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice financier. Cette dernière ayant le plus souvent lieu le 31 décembre, le versement de ces primes est à réaliser a ant le 31 mai de l’année suivante, au plus tard. Certaines entreprises clôturant en mars peuvent verser jusqu’en août.
Avec l’ordonnance, les primes des salariés ne sont pas supprimées mais leur versement est décalé. Il s’agit d’un avantage de trésorerie accordé aux entreprises.
En 2018, la collecte avait atteint 15,2 milliards d’euros. selon l’Association Française de Gestion. 10,6 millions de salariés avaient profit du versement d’une prime d’épargne salariale.
Au 31 décembre 2018, les fonds d’actionnariat salarié représentent 37 % des encours contre 63% pour les fonds diversifiés (monétaires, obligataires, mixtes et actions). Au total la part de l’épargne salariale investie en actions représente plus de 55% des encours dont 37% via l’actionnariat salarié, 11% via les fonds actions et le solde via les fonds mixtes. Cette part « actions » a connu une forte valorisation en 2019 avant de connaître une baisse sensible à partir du mois de mars. En l’état actuel, les moins-values potentielles sont assez proches des gains obtenus l’année dernière, sachant que les FCPE sont un peu plus résilients que le CAC 40 aux chocs.
Finances publiques, petit état des lieux avant la crise
La France n’avait pas réussi à réduire de manière drastique son déficit public avant la survenue de la crise sanitaire. Le déficit français était, en 2019, 2,5 points de PIB supérieur à la moyenne de la zone euro. Il s’est élevé à 72,8 milliards d’euros, soit 3,0 % du produit intérieur brut (PIB), après 2,3 % en 2018. Hors impact de la transformation du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) en baisse de cotisations le déficit s’établit à 2,1 %. Même en sortant l’effet du CICE, l’écart avec nos partenaires reste conséquent.
En part de PIB, les recettes passent de 53,4 % à 52,6 % tandis que le poids des dépenses dans le PIB est quasiment stable (55,7 % en 2018 et 55,6 % en 2019). Hors changement de périmètre des administrations publiques lié à la création de France Compétences (établissement public en charge de la formation professionnelle), les dépenses représentent 55,3 % du PIB. Le taux de prélèvements obligatoires baisse de 0,7 point et s’établit à 44,1 % du PIB (43,8 % hors France Compétences).
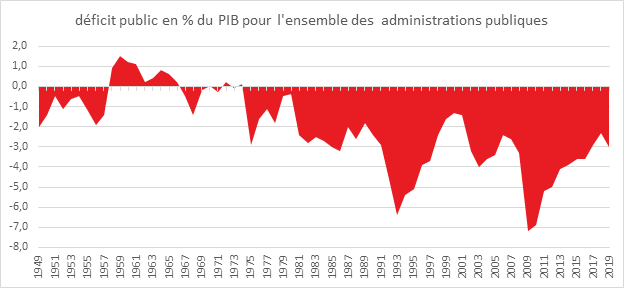
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Des dépenses publiques en nette augmentation
L’ensemble des dépenses publiques ont augmenté, 2019, de 2,6 % (+2,0 % hors changement de périmètre lié à la création de France Compétences) en euros courants après +1,3 % en 2018. Hors crédit d’impôts, elles augmentent de 2,8 % en 2019 après +0,7 % en 2018.
Les dépenses de fonctionnement restent dynamiques avec une hausse de +1,7 % en 2019, après +1,3 % en 2018. Les dépenses de rémunération augmente de +1,2 % après +1,0 %. En revanche, grâce à la baisse des taux, la charge d’intérêts de la dette diminue fortement (−12,2 %)
Les prestations sociales se sont accrues de +2,7 %, après +1,8 % en 2018. Les prestations en espèces progressent de 2,9 % après +2,1 % en 2018, portées notamment par l’élargissement et la revalorisation de la prime d’activité. Les transferts sociaux en nature de biens et services marchands accélèrent à +1,9 % après +1,0 % en 2018, en premier lieu du fait d’une moindre baisse des aides au logement, mais aussi en raison d’une légère accélération des transferts sociaux de santé marchande (en nature).
Les dépenses d’investissement des administrations publiques locales ont fortement augmenté l’année dernière en raison de la proximité des élections municipales (+6,9 milliards d’euros, soit une progression de 15,1 %) L’investissement de l’État en revanche est en diminution (−0,4 milliard d’euros).
Des recettes en faible augmentation
L’ensemble des recettes n’a augmenté que de 1,2 % (+0,6 % hors effet de périmètre lié à la création de France Compétences), après +2,5 % en 2018 en euros courants. Les impôts sur le revenu et le patrimoine ralentissent (+1,8 % après +6,2 %). Le rendement de la CSG a été affectée par la mesure prise en faveur des retraites modestes (−1,7 milliard d’euros.
L’impôt sur le revenu des personnes physiques s’est accru de 1,7 milliard d’euros. Le rendement de l’impôt sur les sociétés s’est amélioré de 4,2 milliards d’euros en raison de la baisse des cotisations sociales provoquée par la transformation du CICE ; ce qui a conduit à une augmentation du bénéfice taxable des entreprises.
Les autres impôts courants ont diminué de 3,1 milliards d’euros notamment du fait de la deuxième étape de dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (abattement de 65 % en 2019 après un abattement de 30 % en 2018, soit une baisse de −3,6 milliards d’euros.
Les impôts sur les produits et la production ont connu, de leur côté, une progression plus vive avec un gain de 5,2 %, après +4,0 % en 2018. Les recettes de TVA sont en hausse de 6,7 milliards d’euros.
Les cotisations sociales perçues diminuent de 4,4 % (après −1,7 % en 2018) sous l’effet de la transformation du CICE en baisse de cotisations, ainsi que de l’extension en année pleine de la bascule de cotisations sociales à la charge des salariés vers la CSG. Les cotisations employeurs diminuent ainsi de 6,4 % (après +2,5 %) quand les cotisations des ménages sont stables (+0,4 % après −10,1 %), la baisse des cotisations des salariés étant compensée par l’augmentation des cotisations des non-salariés.
Une année 2020 d’une tout autre nature
Avec une augmentation sans précédent des dépenses et une raréfaction des recettes, le déficit public de l’année 2020 sera sans commune mesure avec celui des années précédentes. Dans le cadre de la loi de finances rectificative, adoptée vendredi 20 mars, le Gouvernement a prévu un déficit de 3,9 % du PIB. Compte tenu des effets du confinement sur l’activité, ce dernier pourrait dépasser aisément 5 % du PIB et se rapprocher du niveau qu’il avait atteint en 2009 (-7,2 %). Depuis 1973, de crise en crise, le montant du déficit est de plus en plus élevé (à l’exception de la période 2001/2003 après l’éclatement de la bulle Internet qui avait peu touché économiquement la France). La période de rétablissement des comptes s’allonge également de crise en crise et le niveau in fine du déficit est plus élevé que lors de la crise précédente.
Résultats de l’assurance vie en février : à l’époque, le ciel était dégagé ou presque
L’assurance vie a enregistré, selon la Fédération Française de l’Assurance, au mois de février, une collecte positive de 1,4 milliard d’euros soit deux fois plus qu’en janvier (0,7 milliard d’euros). Cette collecte nette est, en revanche, en retrait par rapport à celle de l’année dernière (3,1 milliards d’euros). Le mois de février est en règle générale un mois correct pour l’assurance vie. Aucune décollecte n’a été enregistré lors de ces dix dernières années.
L’assurance vie a enregistré, selon la Fédération Française de l’Assurance, au mois de février, une collecte positive de 1,4 milliard d’euros soit deux fois plus qu’en janvier (0,7 milliard d’euros). Cette collecte nette est, en revanche, en retrait par rapport à celle de l’année dernière (3,1 milliards d’euros). Le mois de février est en règle générale un mois correct pour l’assurance vie. Aucune décollecte n’a été enregistrée lors de ces dix dernières années.
En février, les cotisations se sont élevées à 11,1 milliards d’euros contre 12,1 milliards d’euros le mois précédent. C’est également en retrait par rapport à février 2019 (12,4 milliards d’euros). La proportion des unités de compte dans la collecte brute a été de 39,6 % en février contre 33 % le mois précédent. Les ménages ont fortement plébiscité les unités de compte avant la chute des cours provoquée par la crise du coronavirus.
Les prestations versées par les sociétés d’assurance se sont élevées à 9,7 milliards d’euros en février contre 11,3 milliards d’euros en janvier. Ce montant est le plus faible constaté depuis le mois de septembre dernier (9,1 milliards d’euros).
L’encours des contrats d’assurance vie a atteint 1 776 milliards d’euros à fin février 2020, en progression de 3 % sur un an.
En ce début d’année, les ménages continuaient de placer leur épargne sur l’assurance vie, à un rythme modéré. La baisse du taux de rendement des fonds d’euros a eu peu d’incidence sur leur comportement. La relative modestie de la collecte peut s’expliquer par la nécessité de souscrire une certaine proportion d’unités de compte. Cette pression pouvait dissuader certains ménages. Malgré tout, avant la diffusion de l’épidémie en Europe, les épargnants semblaient accepter le jeu de la prise de risque avec une proportion plus élevée que dans le passé d’unités de compte. Sur les deux premiers mois de l’année, les unités de compte représentaient 36 % de la collecte totale contre une moyenne de 27 % en 2019. Cette récente montée en puissance des unités de compte, à un moment où les marchés étaient au plus haut, est susceptible de provoquer des désillusions avec l’accumulation des baisses enregistrées depuis le début du mois de mars. Les épargnants devront intégrer le fait que les unités de compte sont des placements de long terme.
La crise sanitaire devrait avoir de fortes conséquences sur la collecte de l’assurance vie. Avec le confinement, les épargnants ne peuvent pas accéder à leurs assureurs, à leurs conseillers en gestion de patrimoine, à leurs banquiers ou à leurs courtiers. Même si Internet permet de réaliser certaines transactions, cette situation devrait peser fortement sur la collecte de mars. Les rachats devraient être limités pour la même raison même si certains ont pu vouloir disposer rapidement de liquidités pour faire face à des échéances incontournables. Le krach financier devrait provoquer un fort repli de la collecte en unités de compte même si les épargnants auraient tout, au contraire, intérêt à les privilégier. La petite remontée des taux sur les obligations d’État constatée depuis le début de la crise est une mauvaise nouvelle pour les finances de l’État. En revanche, elle est positive pour les fonds euros si elle perdurait quelque temps.
L’évolution de l’assurance vie dans les prochains mois est, comme pour l’économie, difficile à prévoir compte tenu du nombre élevé des incertitudes. L’ampleur et la durée de la crise ainsi que l’évolution des prix et celle des différents actifs sont autant de facteurs qu’il faudra prendre en compte.
En février, les cotisations se sont élevées à 11,1 milliards d’euros contre 12,1 milliards d’euros le mois précédent. C’est également en retrait par rapport à février 2019 (12,4 milliards d’euros). La proportion des unités de compte dans la collecte brute a été de 39,6 % en février contre 33 % le mois précédent. Les ménages ont fortement plébiscité les unités de compte avant la chute des cours provoquée par la crise du coronavirus.
Les prestations versées par les sociétés d’assurance se sont élevées à 9,7 milliards d’euros en février contre 11,3 milliards d’euros en janvier. Ce montant est le plus faible constaté depuis le mois de septembre dernier (9,1 milliards d’euros).
L’encours des contrats d’assurance-vie a atteint 1 776 milliards d’euros à fin février 2020, en progression de 3 % sur un an.
En ce début d’année, les ménages continuaient de placer leur épargne sur l’assurance vie, à un rythme modéré. La baisse du taux de rendement des fonds d’euros a eu peu d’incidence sur leur comportement. La relative modestie de la collecte peut s’expliquer par la nécessité de souscrire une certaine proportion d’unités de compte. Cette pression pouvait dissuader certains ménages. Malgré tout, avant la diffusion de l’épidémie en Europe, les épargnants semblaient accepter le jeu de la prise de risque avec une proportion plus élevée que dans le passé d’unités de compte. Sur les deux premiers mois de l’année, les unités de compte représentaient 36 % de la collecte totale contre une moyenne de 27 % en 2019. Cette récente montée en puissance des unités de compte, à un moment où les marchés étaient au plus haut, est susceptible de provoquer des désillusions avec l’accumulation des baisses depuis le début du mois de mars. Les épargnants devront intégrer le fait que les unités de compte sont des placements de long terme.
La crise sanitaire devrait avoir de fortes conséquences sur la collecte de l’assurance vie. Avec le confinement, les épargnants ne peuvent pas accéder à leurs assureurs, à leur conseiller en gestion de patrimoine, à leurs banquiers ou à leurs courtiers. Même si Internet permet de réaliser certaines transactions, cette situation devrait peser fortement sur la collecte de mars. Les rachats devraient être limités pour la même raison même si certains ont pu vouloir disposer rapidement de liquidités pour faire face à des échéances incontournables. Le krach financier devrait provoquer un fort repli de la collecte en unités de compte même si les épargnants auraient tout intérêt à les privilégier. La petite remontée des taux sur les obligations d’Etat constatée depuis le début de la crise est une mauvaise nouvelle pour les finances de l’Etat mais est positive pour les fonds euros si elle perdurait quelque temps. L’évolution de l’assurance vie dans les prochains mois est comme pour l’économie difficile à prévoit compte tenu du nombre élevé des incertitudes. L’ampleur et la durée de la crise ainsi que l’évolution des prix ainsi que celle des différents actifs sont autant de facteurs qu’il faudra prendre en compte
Bourse, de quoi sera fait demain ? Trois questions à Philippe Crevel
Trois questions à Philippe Crevel
La crise du coronavirus est à l’origine d’une chute brutale des indices boursiers. Comment expliquez-vous une telle réaction ?
Nous vivons une crise sanitaire mondiale. C’est une première depuis l’épidémie de grippe espagnole de 1918/1920. Au-delà du problème majeur de santé publique, cette crise provoque la mise en cape de toutes les grandes zones économiques. L’offre comme la demande sont à l’arrêt ou en quasi-arrêt. Les échanges commerciaux sont freinés et les investissements remis à plus tard. Dans un tel contexte, les indices actions ne pouvaient que plonger d’autant plus que les incertitudes l’emportent nettement sur les certitudes. Les investisseurs tentent de protéger leur capital en arbitrant en faveur des obligations des États les mieux notés. En l’état actuel, l’ampleur et la durée de la crise sont mal appréhendées conduisant les détenteurs d’actions à s’en délester. La valeur d’une action dépend non seulement des résultats actuels mais aussi des résultats projetés d’une entreprise. La baisse du cours des actions est liée à la crainte d’une diminution des bénéfices. Avec l’arrêt de l’économie mondiale, avec la réduction des échanges, les actions cotées des grands groupes se déprécient.
Les détenteurs d’actions sont nombreux à vendre afin d’obtenir des liquidités pour faire face à certaines échéances au moment où leurs recettes traditionnelles s’amenuisent, voire ont disparu. Cette recherche de liquidités explique la baisse du cours de l’or. La chute du cours des actions s a été aggravée par la forte baisse du prix du pétrole. En plus de la diminution de la demande avec l’arrêt de nombreuses usines à travers le monde, les pays producteurs n’ont pas réussi à s’entendre la mise en place d’un nouvel accord de régulation de la production, quand le précédent arrivera à échéance fin mars. L’Arabie Saoudite souhaite une réduction plus forte de la production quand la Russie s’y oppose. Face au blocage de la négociation, l’Arabie saoudite a décidé de ne plus contingenter sa production entraînant la baisse des cours, en espérant que les Russes reviendraient sur leurs positions. Cette chute des cours pénalise les pays producteurs et les entreprises du secteur pétrolier.
Un rebond du cours des actions à la fin des confinements est-il envisageable ?
Le phénomène baissier des indices accompagné d’une forte volatilité devrait se poursuivre tant que les incertitudes sur le terme de la crise sanitaire ne seront pas levées. La menace planant sur l’économie américaine devrait provoquer quelques soubresauts au niveau des marchés. Un rebond économique devrait intervenir dans les semaines suivant la fin des confinements. Il faudra quelques semaines pour retrouver les rythmes de production d’avant crise. Le retour à la normale, sous réserve d’une résorption réelle de l’épidémie, interviendrait au cours du troisième trimestre. Une gestion coordonnée de la crise économique par les États est un facteur clef pour la réappréciation des cours. Les marchés pourraient dans ces conditions dès le retour d’une certaine visibilité espérée pour le mois de mai. En cas de persistance de la menace épidémiologique avec la mise en place de confinement temporaire à répétition, les investisseurs devraient rester sur leur défensive, ce qui limitera autant la remontée des actions.
Inflation ou déflation au rendez-vous des prochains mois ?
Avec une demande aux abonnées absentes, la tendance est à la baisse des prix. La baisse du cours du pétrole et des principales matières premières en est un signe. Les agents économiques, au nom de l’aversion aux risques devraient encore accroitre leur épargne de précaution, avec une prédilection pour les placements liquides et sures. Une résurgence de l’inflation est imaginable en raison de l’augmentation des liquidités disponibles avec les politiques monétaires et budgétaires mises en œuvre depuis le début de la crise. Par ailleurs, au moment de la sortie des confinements, la demande pourrait augmenter plus rapidement que l’offre. La montée en puissance de la production nécessitera plusieurs semaines. La remise en route des usines fermées, leur alimentation en matières premières et en biens intermédiaires exigent un peu de temps. Cette inadéquation entre offre et demande est propice à une augmentation des prix d’autant plus que les agents économiques pourraient être tentés de compenser le manque à gagner accumulé durant les mois de mars et avril. Ce risque inflationniste est néanmoins assez limité. Entre 2008 et 2012, l’augmentation des bilans des banques centrales n’a pas eu d’incidence sur l’inflation au grand dam des pouvoirs publics. Par ailleurs, la sortie du confinement pourrait être progressive. En Chine, plus de trois mois après le début de l’épidémie, les centres commerciaux qui ont pu ouvrir n’ont pas été pris d’assaut. Les goulets d’étranglement au niveau de l’offre pourraient être limité avec le retour progressif à la normale de la Chine qui est le premier producteur industriel mondial. La spirale déflationniste est en l’état actuel la menace la plus importante. Elle pourrait être alimentée par la tentation du repli sur soi que cette crise alimente.
La lutte contre la récession est engagée aux Etats-Unis
Les Etats-Unis sont de plus en plus touchés par l’épidémie. Face à la menace de récession, les pouvoirs publics réagissent à l’américaine, c’est à dire de manière massive et directe.
La Réserve fédérale a annoncé lundi matin 23 mars une série de nouvelles mesures pour assurer la liquidité des marchés. Selon la FED, « il est devenu évident que notre économie sera confrontée à de graves perturbations. Des efforts énergiques doivent être déployés dans les secteurs public et privé pour limiter les pertes d’emplois et de revenus, et pour favoriser une reprise rapide une fois les perturbations atténuées »,
La Réserve fédérale a prévu d’acheter des titres du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires « dans les quantités nécessaires » pour assurer le bon fonctionnement du marché. Cette intervention se fera sans limite de montant ni de temps. Cela va au-delà des annonces du comité de politique monétaire de la banque centrale qui avait mentionné l’achat d’ au moins 500 milliards de dollars de titres du Trésor et d’au moins 200 milliards de titres adossés à des créances hypothécaires.
La banque centrale américaine a également prévu des mesures en faveur des entreprises et de consommateurs qui porteront sur 300 milliards de dollars de nouveaux financements. La Fed achétera sur le marché secondaire des obligations émises par des grandes entreprises, au moins jusqu’à fin septembre.
La Fed a aussi annoncé une modification des règles applicables au secteur bancaire pour faciliter l’utilisation des coussins en capital mis en place à la suite de la crise financière de 2008, afin de « promouvoir l’activité de prêt aux ménages et aux entreprises ».
La Banque centrale a prévu des mesures en faveur des étudiants endettés et des ménages devant rembourser des crédits à la consommation. Des dispositifs en faveur des collectivités territoriales, municipalités et Etats sont également prévus car ces dernières sont en première ligne en matière sociale.
En revanche, le Sénat freine pour le moment le plan de soutien à l’économie de 2000 milliards de dollars, soit 10 % du PIB que l’exécutif souhaite faire adopter au plus vite.
Le Livret A : la sécurité et la liquidité avant tout
La collecte du mois de février du Livret A a été positive de 1,17 milliard d’euros. Les Français n’ont pas boudé le Livret A malgré la baisse de son taux de 0,75 à 0,5 % intervenue le 1er février. Cette collecte est certes inférieure à celle de l’année dernière (1,93 milliards d’euros) mais elle reste dans la moyenne de ces derniers mois. Depuis le début de l’année, la collecte a été de 5,3 milliards d’euros. L’encours du Livret A a, par ailleurs, battu un nouveau record à 303,9 milliards d’euros.
Le LDDS enregistre de son côté une collecte de 0,37 milliard d’euros contre 0,41 milliard d’euros en janvier. Son encours s’élève désormais à 113,1 milliards d’euros.
Février, un mois résilient pour le Livret A ?
Lors de ces dix dernières années, seules trois décollectes ont été constatées en février, en 2014, 2015 et 2016. Ces trois années avaient été marquées par des baisses de taux du Livret A intervenant au mois d’août. La dernière baisse de taux effectuée en février avait été réalisé en 2013 et s’était traduite par une collecte de 9,71 milliards d’euros, collecte record en lien avec le relèvement du plafond du Livret A de 19 125 à 22 950 euros effective depuis le 1er janvier 2013. Le relèvement du plafond avait totalement compensé celui du passage du taux de 2,25 à 1,75 %.
L’effet précaution avant l’effet taux
En février, les Français se sont moqués de la baisse des taux pour privilégier la sécurité et la liquidité, l’effet précaution avant l’effet taux. Même si la question de l’épidémie était évidemment moins prégnante que maintenant, elle commençait à occuper le devant de la scène. Depuis plus d’un an, les Français accroissent leur effort d’épargne. La succession de crise, gilets jaune, retraite et maintenant sanitaire, ne font que conforter cette tendance. Cette collecte a pu également être alimentée par le versement mi-janvier de 60 % des crédits d’impôts de l’année 2019.
A la recherche de la sécurité en période de crise
Les prochains mois seront atypiques avec l’arrêt partiel de l’activité au sein de nombreux secteurs et avec le confinement de la population. Les dépenses des ménages devraient se réduire fortement entraînant une augmentation de l’épargne. A défaut de pouvoir se déplacer, les titulaires du Livret A et du LDDS pourraient faire leurs arbitrages sur Internet. Les récessions conduisent, en règle générale, les ménages à privilégier la sécurité et la liquidité. Le Livret A avait connu une collecte nette de plus de 33 milliards d’euros de juillet 2008 à juillet 2009. La nature de la crise était alors financière quand celle que nous connaissons à l’heure actuelle est plurielle. L’offre, la demande et la sphère financière sont touchées. En l’état actuel, compte tenu de l’importance des incertitudes, l’appréciation de la crise économique et de ses conséquences en matière d’épargne reste délicate. A court terme, le gonflement des liquidités est, en revanche, plus que probable. L’évolution de la collecte dépendra des modalités de la sortie de crise. Si l’épidémie est rapidement endiguée, un rebond assez fort devrait intervenir avec la volonté des ménages d’oublier ce douloureux épisode. Si au contraire, la sortie de crise aboutissait à une forte augmentation du chômage et un cycle de dépression économique, les ménages se positionneront de plus en plus sur des placements liquides.
Crise du coronavirus : la mobilisation des assureurs
La Fédération Française de l’Assurance a pris en coordination avec le Ministère de l’Economie plusieurs engagements. Ainsi les assureurs s’engagent à :
- contribuer à hauteur de 200 millions d’euros au fonds de solidarité qui a été créé par le Gouvernement pour soutenir les entreprises confrontées à une baisse significative de leur activité ;
- différer le paiement des loyers pour les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue en application de l’arrêté du 15 mars 2020 ;
- maintenir les garanties d’assurance des TPE qui connaîtraient des difficultés ou des retards de paiement pendant toute la durée de la période de suspension de l’activité ;
- travailler à la conception d’un produit d’assurance en cas de catastrophe sanitaire majeure pour améliorer l’offre de couverture assurantielle à destination des entreprises pour l’avenir.
Le Coin des Epargnants – demain est un autre jour
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 20 mars 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 048,80 | -1,69 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 19 173,98 | -17,30 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 6 879,52 | -12,64 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 8 928,95 | -3,28 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 190,78 | -,3,27 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 2 586,02 | -19,99 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 16 552,83 | -5,04 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 745,62 | -4,91 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | +0,094 % | +0,089 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,343 % | +0,202 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 0,922 % | -0,061 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,0678 | -3,82 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 481,300 | -3,16 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 28,623 | -17,54 % | 66,300 |
Quand les blindés sont de sortie
La chute des cours des actions en Europe et du prix de pétrole a été enrayée vendredi 20 mars grâce à l’action coordonnée des banques centrales et des dernières annonces du Président Donald Trump. Le déblocage de 750 milliards d’euros de la Banque centrale européenne pour soutenir les Etats et les entreprises face aux conséquences du coronavirus a permis à la bourse de Paris de sauver la barre des 4000 points après deux séances de hausse consécutive, ce qui n’était plus arrivé depuis deux semaines et demie. Vendredi 20 mars, le CAC 40 s’est offert un gain de plus de 5 points. En revanche, les indices américains sont en forte baisse. Le Dow Jones a perdu 4,55 % vendredi et 17,30 % en une semaine. Le décalage entre les Etats-Unis et l’Europe au niveau boursier est en lien avec celui de la diffusion de l’épidémie. Aux Etats-Unis, les mesures de confinement et les fermetures des entreprises sont devenues d’actualité cette semaine.
L’autre nouvelle de la fin de semaine provient de la hausse du prix du pétrole. Le baril de pétrole Brent a enregistré, vendredi sur un gain quasi historique de 14,4 % tandis que le baril WTI a repris 27 % Ce rebond marque la fin d’une chute de 60 % qui avait placé le baril en-dessous de 26 dollars Il a été provoqué par la décision de la Réserve fédérale d’étendre ses lignes de swap à neuf banques centrales étrangères, ce qui a relâché la pression sur les actifs en dollars. Par ailleurs, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé qu’il envisageait « au moment opportun » de faire pression sur l’Arabie saoudite et la Russie pour qu’ils réduisent leur production.
Au niveau des taux d’intérêt, l’engagement de la BCE a permis une légère détente pour la France et l’Italie. Après être montés à près de 0,5 point le 18 mars, ils sont revenus à +0,1 point en fin de semaine. Le taux italien est de son côté passé de 2,4 à 1,63 %.
L’or est-il encore une valeur refuge ?
Vendredi 20 mars, l’once d’or ne valait 1 482,840 euros en baisse de 8 % sur un mois. Depuis son pic à 1700 dollars le 9 mars dernier, le métal précieux se déprécie. L’or ne jouerait-il plus son rôle de valeur refuge ? En période de taux bas, de ralentissement rapide de l’économie, en règle générale, certains investisseurs arbitrent en faveur du métal jaune. Avec la forte chute des bourses, -36 % pour le CAC 40 en un mois, les investisseurs ont besoin d’argent pour couvrir des pertes ou obtenir des liquidités dans l’urgence pour faire face à leurs engagements et réaliser des appels de marge, c’est-à-dire apporter des liquidités pour revaloriser les titres placés en garantie. En période de crise grave, ce qui compte, c’est la liquidité. L’or ne l’est pas complètement car son détenteur doit trouver une personne qui souhaite en acquérir. Le cours de l’or avait également baissé en 2008 pour les mêmes raisons. En un an, la hausse avait dépassé 20 %. Autre facteur de baisse, la demande en or industriel diminue du fait de l’arrêt de nombreuses entreprises d’électronique. L’ensemble des prix des matières premières enregistrent des baisses depuis quelques jours.
Fallait-il fermer les marchés ?
En un mois, le CAC 40 a perdu près de 40 %, le Dow Jones, plus de 30 %. Face à ces chutes sans précédent, certains experts ont avancée l’idée de fermer les marchés. Les autorités en charge de leur régulation s’y sont refusés. Leur décision est fondée sur le fait qu’une fermeture serait un aveu de non-fonctionnement normal des cotations. Or, pour le moment, offre et demande s’ajustent certes à la baisse mais il y a toujours des preneurs pour les actions. Si tel n’était pas le cas, les autorités prendraient sans nul doute des mesures énergiques. Les régulateurs tentent pour le moment de réduire autant que possible les comportements qui pourraient déstabiliser les marchés. Ainsi, pour éviter des opérations spéculatives, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mardi l’interdiction pour un mois des positions nettes vendeuses sur les titres négociés sur une plate-forme boursière établie en France.
Une fermeture des marchés aurait un inconvénient majeur. Il faut les rouvrir après. La chute peut être encore plus sévère après un blocage. Les investisseurs pour se prémunir d’une nouvelle fermeture vendraient alors leurs titres.
La fermeture des marchés est donc une arme à utiliser avec discernement. En France, depuis la création du CAC 40, en 1988, les marchés n’ont jamais été fermés. Pour trouver une fermeture de la bourse de Paris, il faut remonter à mai 1968. A l’étranger, la bourse de New York a été fermé le 11 septembre 2001. L’attaque du Word Trade Center à quelques encablures de la bourse rendait difficilement possible le maintien de la cotation. Lors de la crise de 2008/2009, la question d’une fermeture des marchés a été posée mais elle n’a pas été mise en œuvre.
La fermeture ne pourrait donc s’imposer que si les marchés n’étaient que vendeurs et que si une spirale dépressive entraînait les cours à des niveaux réellement irrationnels.
Une sanction d’un assureur pour non-respect du droit des associations d’épargnants
L’autorité de contrôle de l’assurance, l’ACPR, a sanctionné, selon l’Argus de l’Assurance, une compagnie d’assurances, pour ne pas avoir en matière de produit d’épargne retraite respecter le droit des associations souscriptrices de contrats de groupe. Les PERP sont des produits souscrits par des associations auprès d’un assureur. En cas de modifications du contrat, ces dernières doivent être validées par l’Assemblée générale des adhérents. L’assureur visé par l’ACPR avait omis de faire valider certaines modifications. D’autres griefs lui ont été également signifiés. L’assureur n’a pas été au moment du contrôle de l’ACPR, « été en mesure de fournir les pièces d’origine . Les paramètres techniques (table de mortalité utilisée et taux technique appliqué) » d’un contrat n’ont pas été convenablement appliqués. Les frais d’acquisition ont été précomptés, bien que leur mode de calcul n’ait pas été précisé dans ce contrat. Des écritures comptables de régularisation ont été passées qui ont, dans certains cas, conduit à affecter les écarts positifs à ses fonds propres. Lors d’opérations de transfert interne de contrats, le recueil des exigences et besoins des clients et l’expression de la motivation du conseil fourni ont été effectués sans que soient totalement respectées les obligations applicables dans ce domaine. Le montant de la sanction a été fixé à 10 millions d’euros. L’assureur a assumé toutes ses responsabilités sur ce dossier et a régularisé la situation. La décision sera publiée au registre de l’ACPR pendant cinq ans sous une forme nominative, puis sous une forme anonyme.
La BCE sort l’armement lourd
L’arrêt de toutes les économies occidentales est un phénomène sans précédent même en période de guerre. L’absence de visibilité sur le moment de la reprise perturbe fortement les marchés. Le non paiement d’impôts et des cotisations ainsi que la multiplication des dépenses de soutien à l’économie mettent les Etats déjà très endettés en situation très délicate. Les banques doivent de leur côté faire face à des reports de remboursements des créances. Dans ce contexte exceptionnel, les banques centrales sont amenées à jouer leur rôle de banquier en dernier ressort. Déjà très impliquées dans la sortie de crise de 2008 et de 2012, elles sont, aujourd’hui, au cœur des combats.
La Banque centrale européenne dont l’action avait été jusqu’à alors jugée timide, a décidé dans la nuit du mercredi 19 mars de s’engager plus fortement. Christine Lagarde a indiqué clairement « qu’il n’y a pas de limites à notre engagement envers l’euro ». Cette volonté se traduit par une décision de lancer un programme de 750 milliards d’euros de rachat de dettes publiques portant son programme à 1000 milliards d’euros. Cette annonce a permis de casser le processus d’augmentation des taux d’intérêt en France et en Italie. En quelques jours, le taux de l’obligation d’Etat à 10 ans était passé de -0,4 à + 0,5 %. En Italie, il était passé de 1 à 2,4 %. Ils sont respectivement revenus à 0,1 % et à 1,6 %.
La BCE a agi en coordination avec les autres banques centrales. Ainsi, toujours dans la nuit de mercredi, la Réserve fédérale américaine a annoncé un troisième programme d’urgence en deux jours, visant à protéger les fonds de placement sur le marché monétaire d’éventuels mouvements de retraits massifs de la part d’investisseurs désireux de récupérer des liquidités. Les banques centrales d’Australie et du Brésil ont également annoncé une baisse de taux, et le lancement, pour la première fois en ce qui concerne l’Australie, d’un programme de rachats d’actifs.
Pourquoi les marchés n’ont pas été fermés ?
En un mois, le CAC 40 a perdu près de 40 %. le Dow Jones, plus de 30 %. Face à ces chutes sans précédent, certains experts ont avancée l’idée de fermer les marchés. Les autorités en charge de leur régulation s’y sont interdits. Leur décision est fondé sur le fait qu’une fermeture serait un aveu de non-fonctionnement normal des cotations. Or, pour le moment, offre et demande s’ajuste certes à la baisse mais il y a toujours des preneurs pour les actions. Si tel n’était pas le cas, les autorités prendraient sans nul doute des mesures énergiques. Les régulateurs tentent pour le moment de réduire autant que possible les comportements qui pourraient déstabiliser les marchés. Ainsi, pour éviter des opérations spéculatives, l »Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mardi l’interdiction pour un mois des positions nettes vendeuses sur les titres négociés sur une plate-forme boursière établie en France.
Une fermeture des marchés a un inconvénient majeur. Il faut les ouvrir après. La chute peut être encore plus sévère après un blocage. Les investisseurs pour se prémunir d’une nouvelle fermeture vendront alors leurs titres.
La fermeture des marchés est donc une arme à utiliser avec parcimonie. En France, depuis la création du CAC 40, en 1988, les marchés n’ont jamais été fermés. Pour trouver une fermeture de la bourse de Paris, il faut remonter à mai 1968. A l’étranger, la bourse de New York a été fermé le 11 septembre 2001. L’attaque du Word Trade Center à quelques encablures de la bourse rendait difficilement le maintien de la cotation. Lors de la crise de 2008/2009, l’idée d’une fermeture des marchés a été posée mais elle n’a pas été mise en oeuvre.
La fermeture ne pourrait donc s’imposer que si les marchés n’étaient que vendeurs et que si une spirale dépressive entraînait les cours à des niveaux réellement irrationnels.
Suspension de la réforme des retraites
Le Président de la République a, lors de son intervention du lundi 16 mars, annoncé la suspension de la réforme des retraites. Cette décision, prise au nom de l’unité nationale, s’est imposée du fait du caractère conflictuelle de la réforme. En outre, la Conférence de financement était censée remettre ses propositions d’ici la fin du mois d’avril afin de résoudre le déficit de 17 milliards d’euros en 2025. Compte tenu de l’évolution prévisible du solde public dans les prochains mois, la question du résorption du déficit du régime de retraite n’est plus la première des priorités.
Pourquoi l’or ne joue-t-il plus son rôle de valeur refuge ?
Lundi 16 mars, l’once d’or ne valait 1500 euros en baisse de 11 % en une semaine après avoir atteint un pic 1700 dollars le 9 mars dernier. L’or ne jouerait-il plus son rôle de valeur refuge ? En période de taux bas, en période de ralentissement rapide de l’économie, certains investisseurs, en règle générale, arbitre en faveur du métal jaune. Avec la forte chute des bourses, -36 % pour le CAC 40 en un mois, les investisseurs ont besoin d’argent pour couvrir des pertes ou de lever du cash dans l’urgence pour faire face à ses engagements et réaliser des appels de marge, c’est-à-dire apporter des liquidités pour revaloriser les titres placés en garantie. Le cours de l’or avait baissé en 2008 pour les mêmes raisons. Des détenteurs d’or ont pu également vendre en raison du niveau élevé des cours. En un an, la hausse avait dépassé 20 %. Par ailleurs, la demande en or industriel diminue du fait de l’arrêt de nombreuses entreprises d’électronique. L’ensemble des prix des matières premières enregistrent des baisses depuis quelques jours.
Le Cercle reste ouvert mais à distance
Conformément aux demandes des autorités, le Cercle de l’Epargne reste ouvert mais a demandé à ses collaborateurs de limiter leurs déplacements afin de ne pas contribuer à la diffusion du coronavirus. Le Cercle continuera néanmoins à publier ses études et ses analyses. Prenez-soin de vous et respectez les consignes !
Mise en cape de l’économie mondiale et mobilisation des Etats
Face à l’épidémie, la nécessité de casser les chaines de transmission impose à tous les Etats de mettre en cape leur économie. Cet exercice sans précédent déroute
Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale l’économie mondiale a été confrontée à une telle situation, un ralentissement généralisé provoqué par une épidémie. Ce ralentissement est la conséquence des confinements imposés pour enrayer la diffusion du virus au sein des populations. Après avoir été cantonné durant trois ou quatre mois, en Chine, sa prolifération à l’échelle mondiale créée un grave problème de santé publique qui s’accompagne d’une déstabilisation des circuits économiques et financiers. Les conséquences de cette crise sans précédent seront importantes. Elles seront néanmoins moindres en cas de coordination internationale et en cas. Depuis quelques jours, après l’effet de stupeur, une mobilisation internationale se dessine.
Les Etats-Unis contrattaque
La banque centrale américaine est très active depuis le début de l’épidémie mondiale. Après avoir baissé de 0,5 point ses taux directeurs le 9 mars et annoncé le 12 mars dernier, l’injection d’un total de 1 500 milliards de dollars en trois tranches pour éviter des perturbations inhabituelles sur le marché, elle a récidivé dimanche 15 mars. Face à cette situation sans précédent, la banque centrale américaine, la FED, a décidé, à nouveau, de baisser d’un point ses taux directeurs, qui seront désormais compris entre 0 % et 0,25 %. Depuis le mois de décembre 2018, la FED a baissé ses taux de deux points. Elle n’envisage pas pour le moment l’adoption de taux négatifs. Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné, en conférence de presse, que cet outil n’était pas souhaitable pour les Etats-Unis. Il estime que les taux négatifs est une source de difficultés financières pour les banques et les assurances. A demi mot, ils critique la BCE qui ne dispose pas de marges de manœuvre du fait de l’application de taux négatifs depuis de longues années.
La FED a également annoncé un programme de rachats de dettes bancaire, d’entreprise et immobilière, pour un montant d’au moins 700 milliards de dollars (626 milliards d’euros).
Elle s’est engagée à mener une opération coordonnée avec cinq autres banques centrales – Zone euro, Canada, Japon, Royaume-Uni, Suisse –, afin de garantir la liquidité avec une mise à disposition de dollars,
Par cette décision, la FED reprend ses achats de titres, connues sous le nom barbare de « quantitative leasing » (QE), qu’elle avait menées après la crise de 2008. Ces opérations, destinées à assurer la liquidité du marché et à contrôler les taux d’intérêt à moyen et long terme, avaient conduit à augmenter le bilan de la banque qui était passé de 900 milliards de dollars à plus de 4 500 milliards. Ce bilan était redescendu à 3 750 milliards de dollars en 2018 avant de remonter à 4300 milliards de dollars en 2019.
Le Président de la FED a indiqué que la situation économique et financière n’est en rien comparable à 2008. Avant la survenue de l’épidémie, l’économie américaine était saine avec un taux de chômage au plus bas. Le système financier est beaucoup plus résistant qu’il y a douze ans. Les banques disposent de fonds propre plus importants et ont réussi à plusieurs reprises les « stress tests ».
Les décisions de la FED complète les annonces du Président des Etats-Unis du Vendredi 13 mars. Ce dernier a décrété l’état d’urgence nationale. Cette décision permet de débloquer près de 50 milliards de dollars en faveur des Etats pour faire face à l’épidémie. L’action sera ainsi coordonnée par la Federal Emergency Management Agency (Fema), qui a l’habitude de venir en aide aux victimes d’ouragans et d’inondations. L’agence pourra assister les autorités locales. L’état d’urgence permet aussi aux hôpitaux de contourner certaines restrictions pour faire face à la situation.
L’Europe met entre parenthèse la règle des 3 %
En Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a garanti vendredi une « flexibilité maximale » dans l’application des règles communautaires sur les déficits et sur les aides d’Etat. Elle a porté à 37 milliards d’euros le montant du fonds européen de soutien aux entreprises.
La BCE entre temporisation et volontarisme
La réunion de la Banque centrale européenne du jeudi 12 mars était attendue après celle de la FED de la semaine dernière qui avait abouti à une diminution des taux de 0,5 point. Il y a quelques jours, Christine Lagarde avait affirmé face aux chefs d’Etat et de gouvernement européens que la Banque centrale européenne était prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour limiter, autant que possible, les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus. Contrairement aux attentes de nombreux investisseurs, la BCE a décidé de maintenir inchangé ses taux. Le taux de dépôt reste ainsi fixé à -0,5 %, ce qui constitue un niveau bas historique. Elle a, en revanche, annoncé des mesures en faveur du système bancaire et des Etats souverains. Ainsi, la BCE offrira aux banques commerciales de nouveaux prêts et des taux encore plus favorables sur les liquidités mises à leur disposition, et elle envisage d’ajouter une enveloppe supplémentaire pour ses achats d’actifs sur les marchés de 120 milliards d’euros d’ici la fin de l’année, ce qui devrait faciliter le financement des Etats. En injectant ces liquidités, la banque centrale devrait maintenir à des niveaux très bas les coûts d’emprunt des Etats et des entreprises. Cette augmentation n’est pas sans poser des problèmes. En effet, elle ne peut pas acheter plus d’un tiers d’une ligne d’obligation émise par un Etat. Comme la dette de l’Allemagne s’est réduite ces dernières années, la BCE risque d’atteindre assez rapidement ce plafond sachant que la répartition des rachats est proportionnelle aux poids des Etats de la zone euro. Les décisions de la BCE ont été mal comprises par les investisseurs qui souhaitaient une baisse des taux. Or, actuellement, la crise du coronavirus fait peser plutôt un risque de solvabilité tant pour les administrations publiques que le secteur privé. Les taux sont déjà à un niveau extrêmement bas. Les entreprises ne se lanceront pas dans des investissements importants tant que l’épidémie ne sera pas jugulée. L’important est de passer le cap de la crise sans tensions financières importantes. Dans ce contexte, la BCE a fait preuve de sagesse et de courage. La décision de la FED de baisser ses taux n’a eu qu’un effet passager et n’a pas empêché la forte baisse des marchés constatée depuis lundi 9 mars. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre du conseil de la BCE, a déclaré vendredi 13 mars sur Radio Classique que « s’il y a des risques de fragmentation dans la zone euro nous utiliserons toutes les flexibilités possibles. Nous l’avons déjà fait dans le passé et le ferons à l’avenir chaque fois que cela est nécessaire ». Par ce discours, il confirme le rôle de banquier en dernier ressort de la BCE.
Les autres grandes banques centrales en mouvement
La banque centrale norvégienne a annoncé également vendredi une baisse surprise de 50 points de base de son principal taux directeur à 1%. Pour enrayer la chute des marchés, vendredi 13 mars, la Banque du Japon a injecté des liquidités sur le marché bancaire et offert de racheter 1,9 milliard de dollars d’obligations. Elle a par ailleurs annoncé l’achat de plus de 101 milliards de yens (10,4 milliards de dollars) d’ETF (trackers qui répliquent les indices boursiers).
L’Allemagne sort du bois
Les ministres allemands de l’Economie et des Finances, Peter Altmaier et Olaf Scholz, ont déclaré que « toutes les armes sont sur la table » et que « nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les entreprises et les emplois ». Ils ont prévenu que les mesures coûteront « des dizaines de milliards d’euros ». La possibilité de recourir à l’endettement n’est plus un tabou. Comme en France, l’objectif est d’assurer les acteurs économiques du soutien déterminé du gouvernement pour qu’ils maintiennent leur activité. Le dispositif de chômage partiel qui avait bien fonctionné en 2008, est réamorcé. Un bouclier en faveur des entreprises a été adopté. Il prévoit des facilités fiscales, notamment des reports d’impôts à hauteur de plusieurs milliards d’euros, mais aussi et surtout un programme illimité de crédits pour assurer la liquidité des entreprises. Une enveloppe de 500 milliards d’euros de crédits sera dégagée. L’idée de nationaliser des entreprises en difficulté est également prévu pour éviter un effet domino au sein des secteur stratégiques.
La France, la santé publique, les entreprises et l’emploi
En France, le Président de la République a annoncé, lors de son intervention jeudi 12 mars, que la priorité était la santé publique. Le Premier Ministre, le 14 mars a placé la France en phase 3 avec la fermeture des commerces (hors pharmacien, alimentation et tabacs) Il a également souligné que le Gouvernement veillerait à soutenir l’économie pour éviter une paralysie du pays et pour faciliter la reprise. Plusieurs mesures économiques exceptionnelles sont prises afin d’atténuer les effets de la crise pour les entreprises et les salariés. Ainsi, les entreprises qui le souhaitent pourront également « reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars ». L’Etat met en place un dispositif de soutien du chômage partiel qui couvrira les salariés jusqu’à hauteur de 4,5 fois le SMIC. Les licenciements ne seraient plus autorisés.
Le Coin des Epargnants du 14 mars 2020 – le temps de la mobilisation
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 13 mars 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 118,36 | -19,86 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 23 185,62 | -10,36 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 7 874,88 | -8,17 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 9 232,08 | -20,01 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 366,11 | -16,97 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 2 586,02 | -19,99 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 21 142,96 | -9,59 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 034,51 | +5,35 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | +0,003 % | +0,342 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,545 % | +0,169 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 0,983 % | +0,225 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,1103 | -1,67 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 529,708 | -8,62 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 34,710 | -23,75 % | 66,300 |
Les marchés saisis de vertige
Le krach financier tant redouté a eu lieu sous forme de deux lames. La première s’est produite le lundi 9 mars sur fond de guerre du prix de pétrole ; la seconde, le jeudi 12 après les annonces de Donald Trump de fermer le territoire des Etats-Unis aux transporteurs de passagers avec les Etats de l’Union européenne, et la déception occasionnée par les décisions de la BCE. Vendredi, les cours étaient à la hausse. Les investisseurs se sont délestés de leurs actions par crainte d’une récession forte avec un risque de montée du protectionnisme. La difficile mise en œuvre d’une coordination internationale a aussi contribué à ce vent de panique.
Le CAC 40 a connu le plus fort recul de son histoire avec un recul de 12,25 %. En un mois, il a perdu un tiers de sa valeur. Il a effacé tous les gains enregistrés depuis l’année 2016 qui avait été marquée par la forte baisse du cours du pétrole. En fonction de l’évolution de l’épidémie et des annonces gouvernementales, les marchés peuvent connaître encore plusieurs coups de tabacs et rester très volatils.
Vendredi 13 mars, les marchés européens n’ont connu pas connu le rebond espéré. Ils ont avant tout stabilisé leurs positions, aidés en cela par les annonces de la Commission de Bruxelles indiquant clairement que les Etats européens ne seraient pas tenus de respecter les 3 % de PIB de déficit en 2020. La Commission s’est également engagée à soutenir l’économie des Etats membres. Le CAC 40 n’a repris vendredi que 1,83 %. En revanche, le rebond à New York, les indices « actions » après la déclaration de l’état d’urgence par Donald Trump ont fortement progressé, +9,36 % pour le Dow Jones et +9,34 % pour le Nasdaq.
Dette publique, la France attaquée
La semaine a été marquée également par un changement sur les dettes souveraines avec l’augmentation de l’écart de taux entre la France et l’Allemagne. Le taux de l’OAT à 10 ans français est redevenu positif et est supérieur de 540 points de base à celui de l’Allemagne. La France suit dorénavant les taux italiens, certes à distance. Le taux de l’obligation à 10 ans italien a atteint vendredi 13 mars s’élevait à 1,8 % contre 0,8 % avant le début de l’épidémie. Les investisseurs craignent le dérapage des finances publiques dans les prochains mois pour des pays qui sont déjà fortement endettés.
Le pétrole sur tous les fronts
Le baril de pétrole a perdu 25 % dans la semaine. Compte tenu du ralentissement de l’économie mondiale, la demande en pétrole actuelle et à venir est orientée à la baisse. Pour éviter une baisse trop importante des cours, les pays de l’OPEP avaient souhaité renégocier l’accord de régulation de la production en vigueur depuis la fin de l’année 2016, accord auquel la Russie était jusqu’à maintenant partie prenante. Cette dernière a refusé le durcissement des quotas de production. Elle souhaitait le simple maintien de la réduction de 2,1 millions de barils jour. Si aucune solution n’est trouvée, l’accord de régulation deviendra caduc d’ici la fin du mois de mars, ni l’OPEP ni les non-membres n’étant alors soumis à des restrictions de production. À partir du mois d’avril, l’Arabie saoudite pourrait ainsi augmenter sa production d’un million de barils jours à 11 millions de barils jour. Le Royaume saoudien s’engagerait dans une guerre des tarifs comme en 2014. À l’époque, le prix du baril était tombé à 26 dollars. La chute pourrait être encore plus brutale en raison des risques de récession que le coronavirus fait peser sur l’économie mondiale. Par sa décision, l’Arabie saoudite tente de faire pression sur la Russie qui a besoin d’un baril de pétrole à 60 dollars pour son économie et ses finances publiques. Depuis le 31 décembre, la baisse atteint près de 50 %.
Mobilisation internationale face à la crise totale
Cantonnée du mois de novembre à février à la Chine, voire à une région de Chine, la diffusion rapide du coronavirus semble avoir pétrifié dans un premier temps les pouvoirs publics. L’absence de précédent et les interrogations sur sa dangerosité expliquent le retard pris au début de la crise. Dans un premier temps, la crainte d’apeurer la population et d’affoler les marchés a certainement joué. L’accumulation de mauvaises nouvelles en provenance d’Italie et la multiplication des décès ont changé la donne en ce milieu de mois de mars. La crise est devenue totale sanitaire, économique (offre, demande) et financière.
Les dirigeants des différents pays sont tenaillés entre la mise en œuvre de politique à tendance nationaliste et la nécessité de jouer sur la coordination et la coopération internationale. Face aux défis de santé publique, le chacun pour soi a d’abord été de mise. En fin de semaine, plusieurs initiatives ont été prises par de nombreux Etats et organismes internationaux afin de limiter l’impact économique et social de cette crise sans précédent.
L’Etat d’urgence aux Etats-Unis
Vendredi 13 mars, le Président américain Donald Trump a décrété l’état d’urgence nationale. Cette décision permet de débloquer près de 50 milliards de dollars en faveur des Etats pour faire face à l’épidémie. L’action sera ainsi coordonnée par la Federal Emergency Management Agency (Fema), qui a l’habitude de venir en aide aux victimes d’ouragans et d’inondations. L’agence pourra assister les autorités locales. L’état d’urgence permet aussi aux hôpitaux de contourner certaines restrictions pour faire face à la situation.
L’Allemagne sort du bois
Les ministres allemands de l’Economie et des Finances, Peter Altmaier et Olaf Scholz, ont déclaré que « toutes les armes sont sur la table » et que « nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les entreprises et les emplois ». Ils ont prévenu que les mesures coûteront « des dizaines de milliards d’euros ». La possibilité de recourir à l’endettement n’est plus un tabou. Comme en France, l’objectif est d’assurer les acteurs économiques du soutien déterminé du gouvernement pour qu’ils maintiennent leur activité. Le dispositif de chômage partiel qui avait bien fonctionné en 2008, est réamorcé. Un bouclier en faveur des entreprises a été adopté. Il prévoit des facilités fiscales, notamment des reports d’impôts à hauteur de plusieurs milliards d’euros, mais aussi et surtout un programme illimité de crédits pour assurer la liquidité des entreprises. Une enveloppe de 500 milliards d’euros de crédits sera dégagée. L’idée de nationaliser des entreprises en difficulté est également prévu pour éviter un effet domino au sein des secteur stratégiques.
La France, la santé publique, les entreprises et l’emploi
En France, le Président de la République a annoncé, lors de son intervention jeudi 12 mars, que la priorité était la santé publique. Il a également souligné que le Gouvernement veillerait à soutenir l’économie pour éviter une paralysie du pays et pour faciliter la reprise. Plusieurs mesures économiques exceptionnelles sont prises afin d’atténuer les effets de la crise pour les entreprises et les salariés. Ainsi, les entreprises qui le souhaitent pourront également « reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars ». Le chômage partiel sera facilité avec une prise en charge possible de l’Etat. 5 117 entreprises ont déjà demandé à bénéficier du chômage partiel pour un total de 80 000 salariés et un coût de 242 millions d’euros selon le Ministre de l’Economie. Ces nombres devraient augmenter fortement dans les prochains jours. Jusqu’à présent, le chômage partiel était indemnisé pour le salarié à hauteur de 70 % du salaire brut et 84 % du salaire net. La prise en charge par l’Etat n’était effectuée qu’à hauteur du Smic. Le Président de la République a indiqué le dispositif serait déplafonné. Emmanuel Macron a également promis la mise en place d’un plan de relance national et européen et a indiqué que la dégradation des comptes publics était inévitable. En l’état de la situation financière, il est difficile d’apprécier le coût de la crise. Ce dernier sera fonction de la durée de l’épidémie et de son ampleur.
La suspension de la règle des 3 %
En Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a garanti vendredi une « flexibilité maximale » dans l’application des règles communautaires sur les déficits et sur les aides d’Etat. Elle a porté à 37 milliards d’euros le montant du fonds européen de soutien aux entreprises.
Les banques centrales à la manœuvre
Les banques centrales ne peuvent pas tout mais elles sont des acteurs clefs dans cette crise. En tant que banquiers en dernier ressort, elles doivent calculer au mieux leurs décisions en fonction des besoins des économies sachant qu’elles ont notamment comme missions d’assurer la liquidité ainsi que la pérennité de la sphère financière. Leurs décisions sont décortiquées en temps réel par les investisseurs au point de surréagir.
Après avoir baissé de 0,5 point ses taux directeurs la semaine dernière, la Fed a annoncé jeudi 12 mars qu’elle injecterait un total de 1 500 milliards de dollars en trois tranches pour éviter des perturbations inhabituelles sur le marché. Les investisseurs anticipent, par ailleurs, une nouvelle baisse des taux directeurs américains mercredi prochain.
La réunion de la Banque centrale européenne du jeudi 12 mars était attendue après celle de la FED de la semaine dernière qui avait abouti à une diminution des taux de 0,5 point. Il y a quelques jours, Christine Lagarde avait affirmé face aux chefs d’Etat et de gouvernement européens que la Banque centrale européenne était prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour limiter, autant que possible, les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus. Contrairement aux attentes de nombreux investisseurs, la BCE a décidé de maintenir inchangé ses taux. Le taux de dépôt reste ainsi fixé à -0,5 %, ce qui constitue un niveau bas historique. Elle a, en revanche, annoncé des mesures en faveur du système bancaire et des Etats souverains. Ainsi, la BCE offrira aux banques commerciales de nouveaux prêts et des taux encore plus favorables sur les liquidités mises à leur disposition, et elle envisage d’ajouter une enveloppe supplémentaire pour ses achats d’actifs sur les marchés de 120 milliards d’euros d’ici la fin de l’année, ce qui devrait faciliter le financement des Etats. En injectant ces liquidités, la banque centrale devrait maintenir à des niveaux très bas les coûts d’emprunt des Etats et des entreprises. Cette augmentation n’est pas sans poser des problèmes. En effet, elle ne peut pas acheter plus d’un tiers d’une ligne d’obligation émise par un Etat. Comme la dette de l’Allemagne s’est réduite ces dernières années, la BCE risque d’atteindre assez rapidement ce plafond sachant que la répartition des rachats est proportionnelle aux poids des Etats de la zone euro. Les décisions de la BCE ont été mal comprises par les investisseurs qui souhaitaient une baisse des taux. Or, actuellement, la crise du coronavirus fait peser plutôt un risque de solvabilité tant pour les administrations publiques que le secteur privé. Les taux sont déjà à un niveau extrêmement bas. Les entreprises ne se lanceront pas dans des investissements importants tant que l’épidémie ne sera pas jugulée. L’important est de passer le cap de la crise sans tensions financières importantes. Dans ce contexte, la BCE a fait preuve de sagesse et de courage. La décision de la FED de baisser ses taux n’a eu qu’un effet passager et n’a pas empêché la forte baisse des marchés constatée depuis lundi 9 mars. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre du conseil de la BCE, a déclaré vendredi 13 mars sur Radio Classique que « s’il y a des risques de fragmentation dans la zone euro nous utiliserons toutes les flexibilités possibles. Nous l’avons déjà fait dans le passé et le ferons à l’avenir chaque fois que cela est nécessaire ». Par ce discours, il confirme le rôle de banquier en dernier ressort de la BCE.
La banque centrale norvégienne a annoncé également vendredi une baisse surprise de 50 points de base de son principal taux directeur à 1%. Pour enrayer la chute des marchés, vendredi 13 mars, la Banque du Japon a injecté des liquidités sur le marché bancaire et offert de racheter 1,9 milliard de dollars d’obligations. Elle a par ailleurs annoncé l’achat de plus de 101 milliards de yens (10,4 milliards de dollars) d’ETF (trackers qui répliquent les indices boursiers).
La bourse saisie de vertige
L’annonce surprise de Donald Trump d’interdire les vols en provenance et en relation des Etats d’Europe continentale dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne a créé un choc de grande ampleur sur les différentes places financières. Le CAC 40 a en une journée perdu 12,28 %, ce qui constitue un record historique. L’écart de taux entre la France et l’Allemagne s’est accru notamment dans l’attente des mesures que le Président de la République annoncera à 20 heures jeudi 12 mars.
Les marchés sont toujours sous le choc de la crise sanitaire en raison de l’absence de visibilité et de la faiblesse de la coordination internationale.
La BCE réfute le catastrophisme en privilégiant la modération
La réunion de la Banque centrale européenne du jeudi 12 mars était attendue après celle de la FED de la semaine dernière qui avait abouti à une diminution des taux de 0,5 point. Il y a quelques jours, Christine Lagarde avait affirmé face aux chefs d’Etat et de gouvernement européens que la Banque centrale européenne était prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour limiter, autant que possible, les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus.
Contrairement aux attentes de nombreux investisseurs, la BCE a décidé de maintenir inchangé ses taux. Le taux de dépôt reste ainsi fixé à -0,5 %, ce qui constitue un niveau bas historique. Elle a, en revanche, annoncé des mesures en faveur du système bancaire et des Etats souverains. Ainsi, la BCE offrira aux banques commerciales de nouveaux prêts et des taux encore plus favorables sur les liquidités mises à leur disposition, et elle envisage d’ajouter une enveloppe supplémentaire pour ses achats d’actifs sur les marchés de 120 milliards d’euros d’ici la fin de l’année, ce qui devrait faciliter le financement des Etats. En injectant ces liquidités, la banque centrale devrait maintenir à des niveaux très bas les coûts d’emprunt des Etats et des entreprises. Cette augmentation n’est pas sans poser des problèmes. En effet, elle ne peut pas acheter plus d’un tiers d’une ligne d’obligation émise par un Etat. Comme la dette de l’Allemagne s’est réduite ces dernières années, la BCE risque d’atteindre assez rapidement ce plafond sachant que la répartition des rachats est proportionnelle aux poids des Etats de la zone euro.
Les décisions de la BCE ont été mal comprises par les investisseurs qui souhaitaient une baisse des taux. Or, actuellement, la crise du coronavirus fait peser plutôt un risque de solvabilité tant pour les administrations publiques que le secteur privé. Les taux sont déjà à un niveau extrêmement bas. Les entreprises ne se lanceront pas dans des investissements importants tant que l’épidémie ne sera pas jugulée. L’important est de passer le cap de la crise sans tensions financières importantes. Dans ce contexte, la BCE a fait preuve de sagesse et de courage. La décision de la FED de baisser ses taux n’a eu qu’un effet passager et n’a pas empêché la forte baisse des marchés constatée depuis lundi 9 mars.
Aversion totale aux risques quand la raison n’est plus de mise
Lundi 9 mars, le taux de l’obligation de l’Etat allemand à 10 ans était de -0,845 %, soit moins que le taux de dépôt pratiqué par la BCE (-0,5 %). Les investisseurs anticipent une baisse des taux directeurs de la part de la banque centrale et des mesures de rachats d’obligations. C’est également la conséquence d’une aversion aux risques poussée à l’extrême. Face à la crise virale, les investisseurs se délestent des actions et acquièrent des obligations d’Etat jugées plus solides. Cette frénésie alimente la spirale déflationniste en cours et contribue au processus de dépréciation des valeurs boursières.
Ne pas tomber dans le piège de la panique !
Les marchés financiers sont, avec la mondialisation de l’épidémie de coronavirus, entrés dans un processus de baisse forte avec un risque d’auto-réalisation. Cette baisse se nourrit des incertitudes concernant l’évolution de l’épidémie et de ses effets sur l’offre ainsi que sur la demande. La réaction des investisseurs a été d’autant plus vive que la diffusion du virus est mondiale et rapide. La baisse est accentuée par l’échec des négociations entre la Russie et l’OPEP pour stabiliser les prix du pétrole.
Une crise virale non assimilable à celle de 2008/2009
Nous sommes confrontés à une crise sanitaire violente mais sans comparaison avec celle de 2008/2009 qui était d’ordre financière et bancaire sur fond de titrisation des emprunts immobiliers. La défiance générale sur le marché interbancaire avait bloqué toute l’économie faisant même craindre une implosion de l’ensemble du système financier.
La crise du coronavirus pèse sur l’offre et l’endettement. Elle n’a pas de fondement financier même si les banques et les assurances peuvent être concernées avec la multiplication des faillites et le processus de baisse des taux.
Le marché « actions » est, par nature, très volatil d’autant plus que le nombre d’acteurs est limité. Par aversion aux risques, ils vendent des titres pour acquérir des obligations d’État solides ce qui fait baisser les taux d’intérêt.
Une crise ponctuelle !
La crise de coronavirus devrait durer entre deux et trois mois. L’application des mesures de confinement sont pour le moment les seules à permettre l’isolement des foyers épidémiques et le ralentissement de la circulation du virus. L’objectif est de réduire la contagion. Cette solution permet à la Chine de faire repartir son économie et de réexporter. Compte tenu du rôle de la Chine dans la production industrielle, ce redémarrage est important pour le reste de l’économie.
Dans les pays nouvellement affectés,
la production devrait connaître plusieurs semaines de baisse avant de retrouver
son rythme de croisière. La demande sera entravée par les confinements et par
la crainte qu’inspire le virus.
La coordination mondiale en marche
Les ministres des finances du G7 ont déclaré « être prêts à prendre les mesures nécessaires, y compris budgétaires ».
La Réserve fédérale américaine a annoncé, mardi 3 mars, une baisse de ses taux d’intérêt de 0,5 point les amenant à 1/1,25 %. Cette mesure d’urgence constitue une réponse pour contrer le caractère récessif pour l’économie de la diffusion du coronavirus. Cette décision intervient entre deux réunions de politique, ce qui n’était pas arrivé depuis la crise de 2008/2009. Jerome Powell, son Président, a indiqué que la FED agirait de manière appropriée et se tenait prête à utiliser tous les outils à sa disposition. Il a souligné que les responsables des grandes banques centrales se coordonnaient pour faire face à la crise et que d’autres mesures d’assouplissement pourraient être prochainement annoncées.
La BCE, même si elle dispose de moins de marges de manœuvre que la FED pour ajuster ses taux, pourrait néanmoins accroître sa politique de rachats. La Commission européenne a indiqué qu’elle était prête à prendre ses responsabilités pour contribuer à limiter l’impact de la crise.
La Banque Centrale d’Australie a également baissé ses taux et la banque centrale du Japon a augmenté ses achats sur les marchés. Le Ministre de l’Économie a indiqué qu’en l’état actuel la croissance pourrait être amputée de 0,1 point en 2020 et que le Gouvernement était prêt à prendre des mesures afin de soutenir les entreprises.
Cette crise sanitaire permettra de mesurer la résilience des nations et des économies. Après l’effet de panique, les autorités, les entreprises, la population devraient s’organiser.
Un accompagnement prévisible des autorités en France
Le Ministre de l’Économie français, Bruno Le Maire tout en reconnaissant que la crise sanitaire devrait aboutir à un net ralentissement de la croissance PIB estime nécessaire de ne pas surréagir afin de ne pas accentuer les tendances récessionnistes. Des mesures de soutien en faveur des entreprises et en particulier des PME sont attendues avec certainement des dégrèvements d’impôts et des reports de charges sociales.
La guerre des prix pétroliers
Compte tenu du ralentissement de l’économie mondiale, la demande en pétrole actuelle et à venir est orientée à la baisse. Pour éviter une baisse trop importante des cours, les pays de l’OPEP avaient souhaité renégocier l’accord de régulation de la production en vigueur depuis la fin de l’année 2016, accord auquel la Russie était jusqu’à maintenant partie prenante. Cette dernière a refusé le durcissement des quotas de production. Elle souhaitait le simple maintien de la réduction de 2,1 millions de barils jour. Si aucune solution n’est trouvée, l’accord de régulation deviendra caduc d’ici la fin du mois de mars. À partir du mois d’avril, puisque ni l’OPEP ni les non-membres seront soumis à des restrictions de production, l’Arabie saoudite pourrait augmenter sa production d’un million de barils jours à 11 millions de barils jour. Le Royaume saoudien s’engagerait dans une guerre des tarifs comme en 2014. À l’époque, le prix du baril était tombé à 26 dollars. La chute pourrait être encore plus brutale en raison des risques de récession que le coronavirus fait peser sur l’économie mondiale. L’Arabie saoudite, à travers sa décision, tente de faire pression sur la Russie qui a besoin d’un baril de pétrole à 60 dollars pour son économie et ses finances publiques. Lundi 9 mars, à 11 H 30, le baril de Brent avait perdu 21 % de sa valeur depuis le début de la journée. La chute était de 45 % par rapport au cours du 1er janvier. Le baril pourrait rapidement évoluer à 20 dollars en cas de poursuite de la guerre des prix compte tenu du marché. Un baril bon marché aurait un effet positif sur la conjoncture et favoriser le redémarrage de l’économie. En revanche, il fragile les pays producteurs et le secteur pétrolier ainsi que le secteur bancaire. L’ensemble de la communauté internationale est donc preneur d’un accord.
Un probable scénario en « U »
En l’état actuel, le scénario en « U » est retenu par de nombreux experts qui ont, en revanche, abandonné celui en « V » reposant sur l’idée d’une reprise rapide. La diffusion du virus aboutit à déstabiliser l’ensemble des pôles de croissance. Le scénario en « L » n’est pas, pour le moment, évoqué. Il supposerait une incapacité à juguler la crise sanitaire d’ici le mois de juin avec une très forte désorganisation de l’offre et des circuits d’échange. Le scénario du « pire » supposerait une aggravation sensible du bilan sanitaire provoqué par exemple par une ou des mutations dangereuses du virus. Ce scénario est jugé, en l’état, peu probable.
Les marchés européens toujours en état de choc
| Résultats 6 mars 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 139,11 | -3,22 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 25 865,12 | +1,79 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 8 575,62 | +0,22 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 11 541,87 | -2,93 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 462,55 | -1,79 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 232,07 | -2,93 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 21 142,96 | -9,59 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 034,51 | +5,35 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | -0,339 % | -0,046 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,714 % | -0,105 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 0,758 % | -0,402 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,1303 | +2,47 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 671,410 | +5,40 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 45,440 | -9,30 % | 66,300 |
.
Les marchés toujours en état de choc
Les marchés financiers continuent leur chute libre en raison de la progression inexorable du coronavirus. Le Cac 40 a clôturé la séance de vendredi en forte baisse de 4,13 %, à 5.139,11 points, dans un volume une nouvelle fois élevé, de 7,56 milliards d’euros. Sur la semaine, l’indice parisien a cédé 3,22 %, après une chute hebdomadaire spectaculaire de 11,94% le vendredi précédent. En un mois, le CAC 40 a perdu 14 %. Le Dow Jones a, en revanche, un petit peu la pente avec un gain sur une semaine de 1,79 %.
Les investisseurs n’ont pas souhaité prendre en compte les bons résultats de l’emploi américain. Selon le Bureau of labour statistics (BLS), 273 000 postes ont été créés dans le secteur non agricole aux Etats-Unis le mois dernier, contre 175 000 anticipés par le marché, tandis que le solde des deux mois précédents a été révisé en hausse de 85 000. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 3,5 %. Ces résultats ont été recensés avec la diffusion hors de Chine du virus.
Du fait de l’absence d’accord à Vienne entre les membres de l’OPEP et à la Russie, le pétrole de Brent se traitait vendredi à 45,64 dollars, au plus bas depuis juillet 2017.
Les investisseurs recherchent avant tout à privilégier les actifs dits refuge comme l’or, certaines devises, dont le yen, et les emprunts d’Etat. Le rendement de l’emprunt chinois à 10 ans a touché un plus bas de 18 ans ce matin. Celui des bons du Trésor américain de même échéance est tombé à 0,6611 %, un nouveau plus bas historique, tandis que celui de l’échéance à 30 ans est passé sous le seuil de 1,5 %. Les investisseurs anticipent une nouvelle détente de la part de la Fed après la baisse d’urgence de 50 points de base du taux des Fed funds annoncée mardi 3 mars dernier. Le taux de l’obligation d’Etat allemand à 10 ans s’est abaissé à -0,714 %. L’euro s’apprécie par rapport au dollar en raison de la baisse des taux décidés de la Banque centrale américaine.
Le taux de rémunération de l’épargne de court terme, stabilité près de zéro
Au mois de janvier, le taux de rendement des livrets bancaires fiscalisés a, selon la Banque de France, été de 0,16 %, le même taux qu’en décembre. Le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est inchangé sur deux mois (0,58 % depuis novembre 2019). La rémunération moyenne des dépôts des ménages augmente légèrement (0,83 %, après 0,82 % en décembre 2019), malgré une baisse de la rémunération des comptes à terme. En février, la baisse du taux du Livret a sera pris en compte.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires
| janv- 2019 | nov- 2019 | déc- 2019 (e) | jan- 2020 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,63 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Ménages | 0,89 | 0,83 | 0,82 | 0,83 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,77 | 0,72 | 0,71 | 0,69 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,58 | 1,28 | 1,25 | 1,22 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| – plan d’épargne-logement | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| SNF | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,22 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,33 | 1,12 | 1,10 | 1,08 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,31 | -0,40 | -0,40 | -0,39 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,10 | -0,43 | -0,40 | -0,41 |
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
h. La date de prise d’effet de la baisse du taux du livret A à 0,50% est le 1er février 2020.
La Banque centrale américaine baisse de 0,5 point ses taux directeurs
La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi 3 mars une baisse de ses taux d’intérêt de 0,5 point les amenant à 1 /1,25 %. Cette mesure d’urgence constitue une réponse pour contrer le caractère récessif pour l’économie de la diffusion du coronavirus. Cette décision intervient entre deux réunions de politique, ce qui n’était pas arrivé depuis la crise de 2008/2009. Cette baisse avait été anticipée par la place financière de New York qui a enregistré une hausse lundi. Par ailleurs, le dollar s’était déprécié par rapport à l’euro. L’o a progressé de 3% à 1.633 dollars l’once.
Jerome Powell a indiqué que la FED agirait de manière appropriée et se tenait prête à utiliser tous les outils à sa disposition.Il a souligné que les responsables des grandes banques centrales se coordonnaient pour faire face à la crise et que d’autres mesures d’assouplissement pourraient être prochainement annoncées.
La BCE dispose de moins de marges de manoeuvre que la FED pour ajuster ses taux. Elle pourrait néanmoins accroître sa politique de rachats. La Commission européenne a indiqué qu’elle était prête à prendre ses responsabilités pour contribuer à limiter l’impact de la crise.
Au fil des jours, une coordination se met en place à l’échelle internationale pour apporter une réponse à cette crise d’un nouveau type.
Le Coin des Epargnants : la première crise financière virale ?
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 28 février 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 299,26 | -12,11 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 25 409,36 | -12,36 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 8 567,37 | -10,54 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 11 890,35 | -12,44 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 565,80 | -11,32 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 329,49 | -12,39 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 21 142,96 | -9,59 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 2 880,30 | -5,24 % | 3050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,293 % | -0,088 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,609 % | -0,115 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,160 % | -0,315 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1005 | +1,45 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 588,521 | -3,55 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 49,740 | -14,78 % | 66,300 |
Depuis la première révolution industrielle, l’économie mondiale avait été confrontée à des chocs de nature diverse, spéculation immobilière, bulle financière, crise agricole, crise énergétique, etc. La diffusion du coronavirus à l’échelle planétaire suivie en direct par les médias traditionnels et numérique constitue une première entraînant une chute brutale du cours des actions. Même si pour le moment, le terme de krach n’est pas encore d’actualité car pour être qualifiée en tant que tel, la baisse des cours doit être brutale et avoisiner les 20 %. En cinq jours, l’indice japonais a perdu près de 10 %, le CAC 40 français, plus de 12 % tout comme le Nasdaq américain. La contraction des indices « actions » enregistrée cette semaine est la plus forte enregistrée depuis la crise financière de 2008. La correction en cours intervient après plusieurs mois de fortes hausses qui rendent la correction d’autant plus violente Juste avant l’annonce par les autorités chinoises d’un problème sanitaire à Wuhan, il y a deux mois, nul n’avait imaginé un tel scénario même si nombreux étaient ceux qu’un ajustement était probable.
Cette baisse des valeurs « actions » repose tout autant sur les effets économiques palpables de la crise épidémique que sur les interrogations liées à son ampleur et à sa durée. La peur générée par cette épidémie a été le catalyseur de la baisse de ces derniers jours. Le monde occidental vit tout à la fois sa première grande épidémie depuis la grippe espagnole et la première épidémie suivie en temps réel par les médias et les réseaux sociaux. Les pouvoirs publics sont amenés à communiquer quotidiennement pour éviter l’amplification de la panique et la circulation de fausses informations. La forte défiance des opinions ne facilite pas leur tâche en la matière d’autant plus que la situation est très évolutive. Depuis 2004, la France est dotée de plans de réactions en cas d’épidémies de grande ampleur. Ces plans prévoient plusieurs échelons et dispositifs de prise en charge en fonction de la gravité de la situation. Compte tenu de la forte ouverture de l’économie européenne, les pouvoirs publics ne peuvent opter pour les limitations de circulation qu’avec prudence. La priorité a été pour le moment de mettre en alerte le système de santé afin qu’il puisse répondre à une demande de soins en augmentation rapide. Les demandes de confinement demeurent très ciblées et ne concernent que les personnes qui ont été potentiellement en contact avec le virus.
Une baisse de la production et des ruptures de stocks
La crise sanitaire par son caractère global et mondial touche l’ensemble des composantes de l’économie. Le premier effet de l’épidémie a été de réduire les capacités de production de la première puissance industrielle et du premier exportateur mondial qu’est devenue la Chine. Compte tenu de la diffusion de la maladie, plusieurs autres pays asiatiques comme la Corée du Sud sont concernés. Du fait de l’éclatement des chaînes de production, les entreprises, à l’échelle mondiale, sont éventuellement confrontées à des risques de rupture de stock.
La diffusion du virus en Italie du Nord, cœur industriel de ce pays, a créé une onde de choc. Jusqu’à maintenant, le problème semblait être cantonné à une région en Chine. En quelques jours, la crise sanitaire est apparue mondiale pour les investisseurs et les actionnaires.
Pétrole et taux à la baisse
La crainte d’une récession mondiale a provoqué une forte baisse du cours du pétrole qui est passé en-dessous des 50 dollars le baril vendredi 28 février. Sur un an, il a perdu un quart de sa valeur. Les obligations d’Etat les mieux notés sont particulièrement recherchés entraînant une nouvelle baisse des taux. Le taux de l’obligation de l’Etat allemand à 10 ans est tombé à -0,609 % et celui de l’obligation de l’Etat américain à 1,160 % vendredi 28 février. Les investisseurs s’attendent à des annonces de la part des banques centrales pour soutenir l’activité économique. Les Etats-Unis disposant de marges de manœuvre supérieures en la matière, leurs taux baissent plus fortement qu’en Europe. Ces marges plus élevées outre-Atlantique expliquent pourquoi le dollar se déprécie par rapport à l’euro, le marché anticipant des décisions accommodantes de la banque centrale américaine.
Le secteur du tourisme en première ligne
L’épidémie a un effet tangible sur l’activité touristique. Les prévisions aériennes pour les trois prochains mois tablent sur une baisse de 60 % de la fréquentation chinoise en France. Air France chiffre le manque à gagner à plus de 200 millions d’euros. En moyenne, sur 90 millions de touristes étrangers, 2,7 millions de Chinois visitent la France chaque année. Il est à noter que le nombre de touristes chinois avait tendance à diminuer avant même l’épidémie de COVID-19. Plus l’épidémie se répandra, plus l’impact sur le transport aérien et le secteur touristique sera important. La France, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis en tant que premiers pays d’accueil pour les touristes sont tout à la fois susceptibles d’être ainsi touchés par la contamination et d’être impactés au niveau du tourisme. L’hôtellerie, la restauration mais aussi toutes les activités de loisirs (spectacles, musées, parc de loisirs) entraînant une concentration de personnes sont potentiellement concernées.
Une baisse de l’investissement ?
Les investisseurs sont incités à retarder leurs investissements du fait des incertitudes économiques générées par l’épidémie. Par ailleurs, des projets devant être engagés en Chine ont été retardés du fait du cantonnement de la population.
Un ralentissement des échanges internationaux
L’épidémie touche à plusieurs niveaux les échanges internationaux. En raison des réductions de production constatées en Chine, les exportations se tarissent. Par voie de conséquence, les importations font de même. Cette situation entraîne une baisse des cours du pétrole et des matières premières, réduisant d’autant les ressources des pays producteurs.
Une baisse de la demande des ménages
Les mesures prises pour ralentir la diffusion du virus entraînent, à travers le confinement des villes touchées, une baisse de la consommation. L’Europe étant le premier centre de consommation mondiale, avec plus de 500 millions d’habitants, la diffusion du COVID-19 peut avoir des effets importants sur la consommation en raison de la limitation des échanges. Le caractère anxiogène de l’épidémie peut conduire à des reports d’achats. Avec la réduction du nombre de touristes, le secteur du luxe est en première ligne.
Quel effet sur la croissance ?
Les effets de l’épidémie sur la croissance de l’économie mondiale, et notamment de l’économie française, dépendront de sa durée et de son importance. Ils sont aussi liés à la levée ou non des incertitudes qui sont nombreuses. La dangerosité de la maladie, les modalités de contagion, la capacité des pouvoirs publics à la juguler, sont autant d’interrogations qui génèrent l’inquiétude des investisseurs. L’indice de contagiosité est estimé entre 1,5 et 3,5 contre 2,2 pour la grippe espagnole de 1919. Pour le rhume, le taux est de 2 et celui de la grippe saisonnière de 1. Des chiffres très éloignés de la varicelle (8,5), de la rougeole (9) ou du choléra (9,5). Le taux de létalité est de 2,3 % pour le COVID-19 contre 0,1 % pour la grippe saisonnière. Il est en revanche plus faible que celui constaté lors de l’épidémie de SRAS (9,6 %). Mais cette dernière n’avait touché que 8 000 personnes lorsqu’elle s’était propagée en 2003. Le taux de létalité augmente à partir de 50 ans pour atteindre son plus haut niveau au-delà de 70 ans. Le taux de mortalité est de 15 % au-delà de 80 ans. À l’inverse, pour les personnes âgées de moins de 39 ans, ce taux serait de 0,2 % selon une étude chinoise. De manière pour le moment peu expliqué, le taux de contamination et de létalité est très faible chez les enfants.
Le scénario le plus rationnel est une évolution en « U » de l’économie avec une chute d’activité suivie d’une période étale plus ou moins longue débouchant sur un rebond assez fort pour compenser les retards pris durant l’épidémie. Ce scénario repose sur l’atteinte d’un pic épidémique intervenant d’ici quelques semaines et sur une coordination à l’échelle internationale des moyens sanitaires voire des réponses économiques nécessaires pour empêcher une récession. L’autre scénario dit en « L » se matérialiserait par une entrée en récession relativement longue le temps de vaincre l’épidémie. Pour le moment, le Ministère de l’Économie estime que le virus COVID-19 ne provoquera qu’un manque de croissance de l’ordre de 0,1 point en France. Au niveau mondial, le PIB devrait être amputé de 0,2 point en 2020. Si l’épidémie se muait en pandémie et si le mouvement de panique prenait racine, le risque de récession mondiale ne serait pas à écarter. La multiplication des mesures protectionnistes, la fermeture des frontières aurait évidemment un fort effet sur la croissance. Les autorités mondiales s’inquiètent des conséquences de l’épidémie sur des pays ne disposant pas de système de santé performant (particulièrement en Afrique).
Avant la crise du COVID-19, la Banque de France était optimiste
Après le trou d’air de la fin 2019, la Banque de France pensait, en début de semaine que le retour à normal était possible pour la France au cours du 1er trimestre 2020 avec une progression du PIB de 0,3 % pour le premier trimestre (contre un recul de 0,1 point au dernier trimestre 2019). Les économistes de la banque centrale estimaient que l’industrie devrait retrouver son rythme de croisière en février, tandis que l’activité dans les services et le bâtiment sont bien orientés depuis le début d’année.
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, pariait sur un taux moyen de croissance par trimestre de 0,3 %, soit le résultat constaté depuis deux ans. L’INSEE est un peu plus pessimiste et prévoit une croissance de 0,2 % au premier trimestre, puis de 0,3 % au deuxième.
Pour l’ensemble de 2020, la Banque de France prévoit une croissance de 1,1 %, selon ses prévisions dévoilées en décembre dernier, soit le rythme le plus bas depuis 2016, lorsqu’elle avait atteint 1 %. Le Gouvernement table pour sa part sur une progression du PIB de 1,3 %.
Sécurité et liquidité
En 2019, le taux d’épargne des ménages a atteint 14,7 % du revenu disponible brut contre 14,2 % en 2018. Le taux d’épargne financière est passé sur cette période de 4 à 4,3 %.
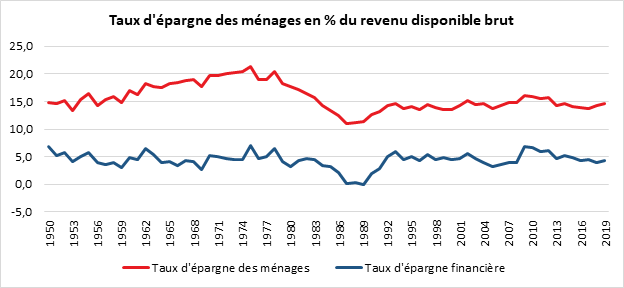
Les premiers résultats du mois de janvier en ce qui concerne l’épargne confirment la tendance de l’année 2019. Ils traduisent, chez les ménages, un certain conservatisme teinté d’une prise de conscience que la donne a changé. Le Livret A démarre ainsi sur les chapeaux de roues quand l’assurance vie connaît un début d’année en demi-teinte sur fond de remise en cause de son modèle qui a fait son succès ces vingt dernières années.
L’inoxydable Livret A
L’annonce de la baisse du taux du Livret A intervenue au mois de janvier n’a eu aucun effet sur la collecte qui a atteint 4,13 milliards d’euros, soit le même montant que l’année dernière (4,00 milliards d’euros). Pour la première fois de son histoire, l’encours du Livret A dépasse les 300 milliards d’euros (302,7 milliards en janvier contre 298,6 milliards d’euros en décembre). En dix ans, l’encours a progressé de 54 %.
Le mois de janvier se caractérise, en règle générale, par une forte collecte en raison du versement des primes et des étrennes de fin d’année. Lors de ces dix dernières années, deux décollectes seulement sont à signaler, en 2015 (-0,85 milliards d’euros) et en 2016 (-0,81 milliards d’euros). Ces deux dernières s’expliquaient en grande partie par la baisse du rendement du Livret A intervenue au mois d’août de l’année précédente (août 2014 passage de 1,25 à 1 %, août 2015 passage de 1 à 0,75 %). Comme en 2020, le passage de 2,25 à 1,75 % annoncé au mois de janvier 2013 n’avait pas eu tout d’effet négatif sur la collecte qui avait alors atteint alors 8,21 milliards d’euros. Ce résultat était lié au relèvement du plafond du Livret A qui était passé le 1er janvier 2012 de 19 125 à 22 950 euros.
Outre les primes et des étrennes de fin d’année, les ménages ont pu épargner sur leur Livret A tout ou partie de l’avance des crédits d’impôt versé par l’administration fiscale le 15 janvier à 9 millions de ménages. Au total, l’État a reversé 5,5 milliards d’euros représentant 60 % du montant des crédits d’impôt de l’année 2020.
La collecte du Livret A obéit à une saisonnalité. Le premier semestre se caractérise par de fortes collectes mensuelles quand le second est marqué par quelques mois de décollecte. Février 2020 sera peut-être marqué par une baisse de la collecte en raison de l’entrée en vigueur du taux de 0,5 %. Cependant le contexte anxiogène pourrait conduire les ménages français à ne pas relâcher leur effort. Le Livret A en période tourmentée joue le rôle de paratonnerre, de valeur sûre.

L’assurance vie à la croisée des chemins
L’assurance vie commence moderato l’année 2020 avec une collecte nette de 500 millions d’euros au mois de janvier. Cette collecte relativement faible au regard des résultats passés est riche d’enseignements.
Pour trouver une collecte nette plus faible, il faut remonter au mois de décembre 2018 (-700 millions d’euros). Lors de ces dix dernières années, l’assurance vie n’a connu qu’une décollecte au mois de janvier, en 2012, l’annus horribilis, pour le premier produit d’épargne français. Janvier est traditionnellement un mois correct pour l’assurance vie avec des collectes nettes pouvant atteindre 2,4 milliards d’euros comme en janvier 2018 ou 3,2 milliards d’euros en janvier 2017. Ce petit trou d’air est avant tout imputable à la bonne tenue des rachats.
Avec une collecte brute de 11,8 milliards d’euros, l’assurance vie attire toujours les épargnants. Certes, ce résultat est en léger retrait par rapport au mois de janvier 2019 (12,7 milliards d’euros) et au mois de janvier 2018 (13,4 milliards d’euros) mais il est identique à celui du dernier mois de l’année 2019. Elle est dans la moyenne de ces douze derniers mois. Les Français continuent à placer une part non négligeable de leur épargne sur l’assurance vie, malgré les annonces de baisse de rendement intervenues entre le mois de décembre et janvier.
La proportion d’unités de compte (UC) en s’élevant à 34 % symbolise bien la volonté des compagnies d’assurance de limiter le poids des fonds euros et d’inciter les épargnants à porter le risque. La bonne tenue de la bourse facilite la montée en puissance des unités de compte. Certes, il y a un retrait par rapport à décembre, mois durant lequel la proportion d’UC avait atteint 41 %. Ce taux s’expliquait, sans nul doute, par le fait que des compagnies avaient décidé de restreindre l’accès à leurs fonds euros.
Le montant des rachats et des prestations qui s’établit à 11,3 milliards d’euros au mois de janvier, est en hausse. Il s’élevait à 11 milliards d’euros en décembre 2019 et à 10,6 milliards d’euros au mois de janvier 2019. Le montant des prestations tend à augmenter avec la maturité croissante du produit. Le vieillissement des titulaires de contrats aboutit automatiquement à un accroissement des versements intervenant au moment des décès. Par ailleurs, les ménages effectuent des arbitrages avec l’immobilier qui bat des recours en matière de transactions (plus d’un million en 2019).
L’assurance vie devrait atteindre la barre des 1800 milliards d’euros dans les prochains mois, renforçant sa position de numéro un des placements français. Au mois de janvier, l’encours a atteint 1789 milliards d’euros. La résilience du produit n’est plus à prouver. Il semble pouvoir s’adapter à la nouvelle donne imposée par les taux d’intérêt négatifs. Il profite de la forte appétence des Français pour l’épargne. L’assurance vie offre l’accès à une combinaison sécurité, liquidité avec les fonds euros et prise de risques avec les unités de compte. Cette association n’existe dans un aucun autre type de placement.
Les ménages français sont depuis deux ans enclins à maintenir un fort volant d’épargne de précaution en raison des incertitudes sociales et économiques. Les grèves du mois de décembre et de janvier concernant la réforme des retraites ne les ont pas incités à relâcher leur effort. Ils privilégient toujours la sécurité et la liquidité en faisant fi du rendement. Le vieillissement de la population contribue également à l’amplification de cet effort d’épargne. Pour le moment, les ménages ne répondent qu’avec modération aux stimuli des pouvoirs publics en faveur de la réorientation l’épargne vers des placements plus risqués.
La consommation française en panne en janvier
L’année 2020 débute avec un recul marqué de la consommation, -1,1 % faisant suite à une contraction de 0,3 % en décembre. Les grèves des transports ont certainement joué un rôle dans cette contreperformance. Le recul des achats a concerné en premier lieu les biens fabriqués (–2,7 %). En janvier, les dépenses en biens durables chutent (–5,1 %) après trois mois de hausse. La consommation de matériels de transport (en particulier l’achat de voitures) a diminué de 7,1 %. Cette baisse est notamment due au contrecoup de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de nouvelles modalités encadrant le malus écologique, qui avaient été anticipées au mois de décembre. Les dépenses en habillement-textile se replient de nouveau nettement (–1,2 % après –1,3 %).
En revanche, les achats alimentaires ont légèrement augmenté (+0,2 % après –0,4 %) tout comme les dépenses en énergie (+0,1 %).
Ce mauvais résultat de la consommation constitue une mauvaise nouvelle pour la croissance du premier trimestre d’autant plus qu’avec la diffusion du COVID-19, les prochaines semaines pourraient s’avérer délicates.
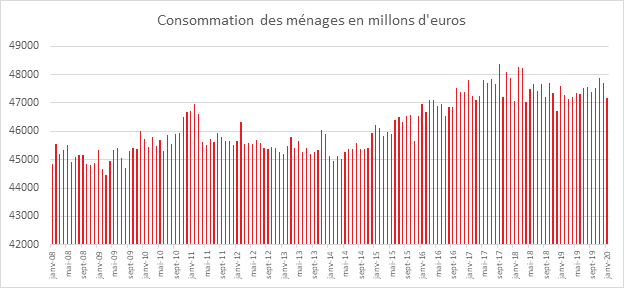
Hausse du taux d’épargne en 2019 sur fond de gains de pouvoir d’achat et de hausse de l’endettement des ménages
En 2019, le taux d’épargne des ménages a atteint 14,7 % du revenu disponible brut contre 14,2 % en 2018. Le taux d’épargne financière est passé sur cette période de 4 à 4,3 %.
Le taux d’épargne des ménages comprend deux composantes, le remboursement du capital des emprunts et l’épargne financière. Cette dernière a progressé de 0,3 point en 2019 quand la première a augmenté de 0,2 point. L’endettement croissant des ménages en particulier pour acquérir un bien immobilier a pour conséquence une progression des remboursements. Par ailleurs, les ménages ont affecté une part non négligeable de leurs gains de pouvoir d’achat dans l’épargne financière. Par unité de consommation, le pouvoir d’achat a progressé, en 2019 de 1,4 %. La consommation a augmenté moins vite, de 1,2 % permettant une hausse du taux d’épargne.
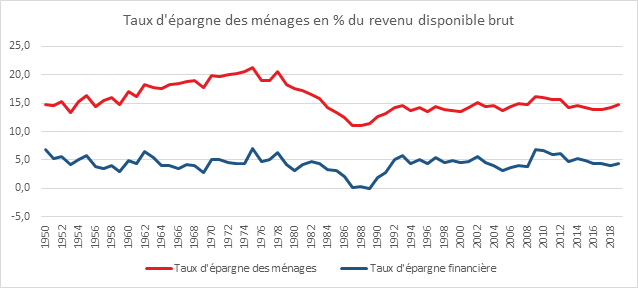
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Les Français restent zen mais les épargnants ne savent plus sur quel pied danser
Au mois de février, la confiance des ménages dans la situation économique est stable. L’indicateur qui la synthétise se maintient à 104, au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Pour le moment, l’épidémie de COVID-19 n’a pas altéré le moral des ménages mais l’enquête a été réalisée avant la diffusion du virus en Italie et a chute des cours de bourse.
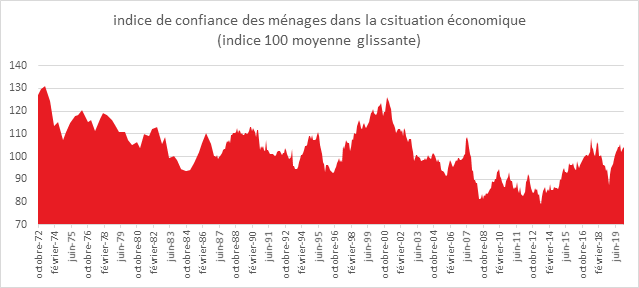
Quelques craintes pour la consommation
En ce qui concerne leur situation financière future, les ménages sont un peu plus pessimistes en février qu’en janvier. L’indice perd deux points mais demeure légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde relatif à leur situation financière passée gagne quant à lui un point et se maintient ainsi au-dessus de la moyenne. La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminue légèrement par rapport au mois précédent ; le solde correspondant perd un point mais demeure au-dessus de sa moyenne.
Niveau de vie globale en hausse
Si sur leur situation personnelle, les Français sont un peu plus inquiets en février, ils estiment néanmoins que le niveau de vie en France devrait s’améliorer au cours des douze prochains mois ; le solde correspondant gagne quatre points, rejoignant ainsi sa moyenne. Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France augmente quant à lui légèrement (+1 point) et demeure supérieur à sa moyenne de longue période.
Emploi, la confiance est de mise
L’annonce des bons résultats sur le front de l’emploi en début d’année a été prise par les Français. Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage diminuent nettement en février ; le solde correspondant, au plus bas depuis juillet 2007, perd douze points.
Un peu plus de Français pensent que les prix augmentent
En février, les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont légèrement plus nombreux que le mois précédent ; le solde correspondant gagne un point mais demeure cependant bien en dessous de sa moyenne. Le solde d’opinion des ménages sur les prix futurs est quant à lui inchangé.
Epargne, les Français ne savent plus sur quel pied danser
Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle gagne également un point, après quatre mois de stabilité. Le solde correspondant reste au-dessus de sa moyenne. En février, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future augmente d’un point et reste nettement au-dessus de sa moyenne de longue période.
En revanche, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner continue de baisser en février (–1 point). Le solde correspondant demeure donc inférieur à sa moyenne de longue période.
Dans ce contexte un peu chahuté et avec des perceptions de la situation un peu contradictoire, les Français indiquent tout à la fois que leur capacité d’épargne augmente mais, en même temps, qu’il n’est pas opportun de le faire. La baisse des taux pourrait expliquer cette appréciation. Dans les faits, les ménages épargnent fortement en produits de taux ou en laissant leur argent sur leurs comptes courants ce qui est en phase avec l’étude de l’INSEE.
Le virus, les bourses et la croissance
Les marchés « actions » occidentaux ont perdu, lundi 24 février, entre 3 et 4 %. Cette baisse brutale est la conséquence de la diffusion de l’épidémie de coronavirus au sein de plusieurs pays, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, essentiellement en Italie.
Les investisseurs face à la menace de ralentissement économique ont réagi en se délestant de leurs actions et en arbitrant en faveur des obligations d’État ce qui a amené, par voie de conséquence, une nouvelle baisse des taux d’intérêt.
Quelles sont les conséquences économiques de l’épidémie en cours ?
Une baisse de la production et des ruptures de stocks
Le premier effet est de réduire les capacités de production de la première puissance industrielle et du premier exportateur mondial qu’est devenue la Chine. Compte tenu de la diffusion de la maladie, plusieurs autres pays asiatiques comme la Corée du Sud pourraient enregistrer des baisses de production. Par ailleurs, du fait de l’éclatement des chaînes de production, les entreprises, à l’échelle mondiale, pourraient avoir des problèmes pour se fournir en biens intermédiaires auprès de leurs sous-traitants situés majoritairement en Asie.
La diffusion du virus en Italie du Nord, cœur industriel de ce pays a créé une onde de choc. Jusqu’à maintenant, le problème semblait cantonner à une région en Chine. En quelques jours, la crise sanitaire est apparue mondiale pour les investisseurs et les actionnaires.
Un retard dans les investissements
Les investisseurs sont incités à retarder leurs investissements du fait des incertitudes économiques générées par l’épidémie. Par ailleurs, des projets devant être engagés en Chine ont été retardés du fait du cantonnement de la population.
Un ralentissement des échanges internationaux
L’épidémie touche à plusieurs niveaux les échanges internationaux. En raison des réductions de production constatées en Chine, les exportations se tarissent. Par voie de conséquence, les importations font de même. Cette situation entraîne une baisse des cours du pétrole et des matières premières, réduisant d’autant les ressources des pays producteurs.
L’épidémie a un effet tangible sur l’activité touristique. Les prévisions aériennes pour les trois prochains mois tablent sur une baisse de 60 % de la fréquentation chinoise en France. En moyenne, sur 90 millions de touristes étrangers, 2,7 millions de Chinois visitent la France chaque année. Il est à noter que le nombre de touristes chinois avait tendance à diminuer avant même l’épidémie de COVID-19. Plus l’épidémie se répandra, plus l’impact sur le transport aérien et le secteur touristique sera important.
Une baisse de la demande des ménages
Les mesures prises pour ralentir la diffusion du virus entraîne, à travers le confinement des villes touchées, une baisse de la consommation. L’Europe étant le premier centre de consommation mondiale, avec plus de 500 millions d’habitants, la diffusion du COVID-19 aurait de fortes répercussions.
Quel effet sur la croissance ?
Les effets de l’épidémie sur l’économie mondiale et française dépendent de sa durée et de son importance. Ils sont aussi liés à la levée ou non des incertitudes qui sont nombreuses. La dangerosité de la maladie, les modalités de contagion, la capacité des pouvoirs publics à la juguler, sont autant de questions qui pour le moment n’ont pas reçu des réponses fiables. Le COVID-19 apparaît doté d’un pouvoir contagieux élevé, cependant il n’est pas, à preuve du contraire, extrêmement dangereux. L’indice de contagiosité est estimé entre 1,5 et 3,5 contre 2,2 pour la grippe espagnole de 1919. pour le rhume, le taux est de 2 et celui de la grippe saisonnière de 1. Des chiffres très éloignés de la varicelle (8,5), de la rougeole (9) ou du choléra (9,5). Le taux de létalité est de 2,3 % pour le COVID-19 contre 0,1 % pour la grippe saisonnière. Il est en revanche plus faible que celui constaté lors de l’épidémie de SRAS (9,6 %). Mais cette dernière n’avait touché que 8 000 personnes lorsqu’elle s’était propagée en 2003. Le taux de létalité augmente aussi avec l’âge et les plus de 80 ans sont les plus à risque, avec une mortalité de 14,8 %. À l’inverse, pour les personnes âgées de moins de 39 ans, ce taux serait de 0,2 % selon une étude chinoise.
Quel effet pour la croissance ?
Le scénario le plus probable est une évolution en « U » de l’économie avec une chute d’activité suivie d’une période étale plus ou moins longue débouchant sur un rebond assez fort pour compenser les retards pris durant l’épidémie. Ce scénario repose sur l’atteinte d’un pic épidémique assez rapide et sur une coordination à l’échelle internationale des moyens sanitaires voire des réponses économiques nécessaires pour empêcher une récession. L’autre scénario dit en « L » se matérialiserait par une entrée en récession relativement longue le temps de vaincre l’épidémie. Pour le moment, le Ministère de l’Économie estime que le virus COVID-19 ne provoquera qu’un manque de croissance de l’ordre de 0,1 point.
Le Climat des affaires en mode résilient
Au mois de février, malgré l’amoncellement des menaces avec la diffusion de l’épidémie de coronavirus, le climat des affaires est resté, en France, stable. À 105, l’indicateur, calculé par l’INSEE, à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, demeure au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Comparé à janvier, le climat des affaires gagne un point dans le commerce de détail et les services. Il est stable dans le bâtiment et l’industrie. Dans tous les secteurs, le climat des affaires se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.
En février 2020, le climat de l’emploi reste porteur. À 105, il est au-dessus de sa moyenne de longue période.
L’indicateur de retournement qui mesure l’évolution à venir de la conjoncture pour l’ensemble de l’économie reste dans la zone indiquant un climat favorable.
Cette enquête a été réalisée avant la chute des marchés financiers et avant la multiplication des cas de coronavirus en Italie.
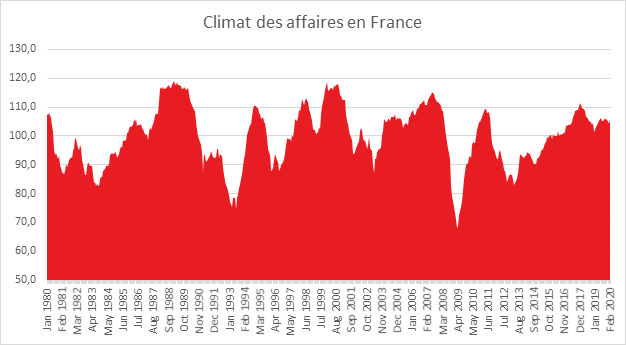
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


