Vers une baisse du taux du Livret A le 1er août 2025
Le taux du Livret A, comme celui du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), devrait être révisé à la baisse au 1er août prochain, compte tenu de l’inflation et de l’évolution du taux Ester au cours du premier semestre 2025.
Le taux du Livret A est, selon la formule en vigueur depuis 2021, égal à la moyenne de l’inflation hors tabac et du taux Ester sur les six derniers mois. La moyenne de l’inflation hors tabac s’est établie à 0,8 %, et celle du taux Ester à 2,44 %. Le taux du Livret A devrait donc passer de 2,4 % à 1,6 % ou 1,7 %. Le taux du LDDS étant identique à celui du Livret A, il suivrait la même évolution.
De son côté, le taux du Livret d’Épargne Populaire est fixé au niveau le plus élevé entre le taux d’inflation et le taux du Livret A majoré de 0,5 point. Compte tenu du faible niveau de l’inflation, c’est cette seconde formule qui s’appliquera. Le taux du LEP pourrait ainsi être de 2,1 % ou 2,2 %, contre 3,5 % actuellement. Toutefois, comme lors des précédentes révisions, le gouvernement pourrait ne pas suivre strictement la formule et fixer un taux arrondi à 2,5 %.
Une baisse des taux de l’épargne réglementée pour relancer la consommation ?
Pour le Livret A, le gouvernement devrait suivre la recommandation du gouverneur de la Banque de France en abaissant le taux à 1,6 % ou 1,7 %. En effet, afin de soutenir les recettes de TVA, l’exécutif souhaite encourager une reprise de la consommation, qui demeure atone depuis de nombreux mois.
La précédente baisse du taux du Livret A, intervenue le 1er février, n’avait pas produit l’effet escompté. Si les ménages ont réduit leurs versements sur ce produit, ils ont maintenu un effort d’épargne élevé, en se tournant notamment vers l’assurance vie. Dans un contexte d’incertitudes politiques et économiques persistantes, les Français continuent de privilégier l’épargne. Au premier trimestre 2025, le taux d’épargne des ménages a ainsi atteint 18,8 % du revenu disponible brut.
Une baisse favorable au logement social et aux banques
La diminution du taux du Livret A permettra une baisse du taux des crédits accordés aux bailleurs sociaux. En effet, les ressources collectées sur le Livret A servent en partie à financer les prêts aux organismes HLM. Or, le taux de ces prêts est directement lié au coût de la ressource, c’est-à-dire au taux du Livret A. Sa diminution se traduit donc mécaniquement par des taux de crédits plus faibles.
Les banques, qui conservent en moyenne 40 % de la collecte du Livret A et du LDDS pour financer des crédits aux collectivités locales et aux entreprises, pourront également réduire les taux appliqués à ces prêts.
Un rendement réel positif pour le Livret A et le LEP
Le rendement réel du Livret A restera positif, l’inflation étant restée faible ces derniers mois. Il devrait s’élever à environ un point, ce qui constitue un niveau relativement élevé par rapport à la moyenne des dix dernières années. Pour le LEP, le rendement réel pourrait avoisiner deux points.
Mais une baisse des revenus pour les épargnants
Malgré ce rendement réel positif, en valeur absolue, la baisse du taux du Livret A signifie une diminution des intérêts perçus.
- Sur un an, pour un Livret A d’un montant moyen de 7 100 euros, le manque à gagner lié au passage du taux de 2,4 % à 1,7 % serait de 49,70 euros.
- Pour un Livret A au plafond (22 950 euros), la perte annuelle atteindrait 160,65 euros.
- Pour un LEP avec un encours moyen de 6 580 euros, la baisse du taux de 3,5 % à 2,5 % se traduirait par une perte annuelle de 65,80 euros.
- Enfin, pour un LEP au plafond (10 000 euros), le manque à gagner s’élèverait à 100 euros par an.
La probable baisse du taux du Livret A au 1er août 2025, de 2,4 % à 1,6 % ou 1,7 %, s’inscrit dans un contexte de faible inflation et de normalisation monétaire. Si le rendement réel reste positif, les épargnants constateront une baisse de leurs revenus d’intérêts. Le gouvernement espèrera favoriser une reprise de la consommation et ainsi contribuer à l’augmentation des recettes fiscales. Il attend également un rebond de l’investissement dans l’immobilier social. Le LEP devrait rester attractif avec un taux supérieur à 2 %
Dans un climat d’instabilité politique et géopolitique, le comportement des ménages pourrait rester dominé par la prudence, au détriment de la relance de la consommation.
Le Coin de l’épargne du 4 juillet 2025 : les Etats-Unis à l’honneur
Trump, toujours Trump
Les investisseurs sont nerveux dans l’attente d’éventuelles négociations commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires économiques. Le 9 juillet prochain est la date limite fixée par Donald Trump pour conclure des accords bilatéraux avec des dizaines de partenaires commerciaux. Passé ce délai, Washington appliquera, faute d’accord, les hausses de droits de douane annoncées le 2 avril dernier. Les nouveaux tarifs, en fonction des pays, pourraient atteindre 20 %, 30 %, voire 70 %.
Jusqu’à présent, l’administration américaine a noué des accords avec le Royaume-Uni et le Vietnam, et a accepté une trêve avec la Chine. L’accord entre Washington et Hanoï prévoit des surtaxes de 20 % sur les produits vietnamiens et de 40 % pour les produits transitant par le Vietnam mais fabriqués ailleurs. Cet accord laisse présager que Washington ne compte pas se satisfaire du taux de 10 % actuellement en vigueur. Les nouveaux droits devraient avoir un effet inflationniste aux États-Unis, à moins que les entreprises ne choisissent de réduire leurs marges. Mais au vu des taux qui pourraient être appliqués, cela ne sera pas tenable très longtemps.
Les tensions commerciales ont provoqué un recul, en fin de semaine, des places asiatiques et européennes. Aux États-Unis, cette semaine, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux records, après la publication d’un rapport sur l’emploi meilleur que prévu. Les indices de Wall Street ont été portés par les bons chiffres de l’emploi américain. Malgré les craintes liées aux politiques commerciales et migratoires de Donald Trump, l’économie américaine a créé plus d’emplois que prévu et le taux de chômage s’est légèrement replié. La première économie mondiale a, en effet, créé 147 000 postes en juin, soit 41 000 de plus qu’anticipé par les économistes interrogés par Bloomberg. Le chiffre du mois précédent a, par ailleurs, été révisé à la hausse de 5 000. Le taux de chômage s’est réduit à 4,1 % de la population active, alors qu’il était attendu à 4,3 %. La hausse du salaire horaire moyen s’est ralentie plus que prévu, à 0,2 % sur un mois et à 3,7 % sur un an.
Donald Trump peut, en outre, se réjouir de l’adoption par le Congrès de la loi budgétaire XXL. Celle-ci a été promulguée à l’occasion de la fête nationale. Cette loi comprend des mesures de prolongation de crédits d’impôt, la diminution des aides sociales, l’augmentation des dépenses militaires et le financement d’une campagne d’expulsion de migrants. Avec cette loi budgétaire, la dette publique américaine devrait dépasser les 40 000 milliards de dollars dans les années à venir, un niveau susceptible d’inquiéter les investisseurs internationaux. Les taux des titres publics américains sont en hausse sur la semaine. Le taux à 10 ans a atteint, en fin de semaine, 4,3 %.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 4 juillet 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 696,27 | +0,40 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 44 828,53 | +3,04 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 6 279,35 | +2,09 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 20 601,10 | +1,90 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 798,12 | -1,02 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 822,91 | +0,27 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 288,81 | -0,92 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 39 810,88 | -1,82 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 472,32 | +1,43 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,281 % | +0,020 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,569 % | -0,018 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,331 % | +0,070 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1781 | +1,45 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 334,32 | +0,26 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 68,17 | +1,04 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 107 433,10 | +0,44 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
La France face à la menace d’un emballement de sa dette publique
Le rapport 2025 sur la situation et les perspectives des finances publiques de la Cour des comptes souligne une fois de plus que la trajectoire des comptes publics est préoccupante et que des mesures de correction doivent être rapidement prises pour éviter un emballement de la dette publique. Les magistrats de la rue Cambon estiment que les prévisions de croissance sont optimistes, ce qui pourrait compliquer le respect de la trajectoire budgétaire décidée par le gouvernement. Ils pointent également des évaluations peu réalistes des dépenses et des recettes.
Malgré l’absence de choc économique majeur, le déficit public a augmenté en France, alors qu’il baissait chez ses partenaires européens. La France est le seul pays dans cette situation, incapable de maîtriser sa dette publique. Le besoin de financement de l’ensemble des administrations publiques s’est élevé à 169,6 milliards d’euros en 2024, soit 5,8 points de PIB, contre 5,4 en 2023 et 4,7 en 2022. Parmi les cinq autres principales économies de la zone euro, seule la Belgique affiche un déficit encore éloigné de l’objectif de 3 % du PIB, celui-ci restant toutefois inférieur de 1,3 point à celui de la France.
La dérive du déficit public en 2024 est imputable aux collectivités locales et aux régimes sociaux. L’an dernier, le besoin de financement des collectivités territoriales a atteint 11,4 milliards d’euros, soit 0,4 % du PIB. Selon la loi de programmation budgétaire, les collectivités locales étaient censées contribuer au redressement.
La dépense publique, hors charge de la dette et hors mesures exceptionnelles, a augmenté en 2024 de 2,7 % en volume, soit deux fois plus vite que la croissance économique. Elle a contribué à hauteur de 0,8 point de PIB à l’augmentation du déficit. Les dépenses des administrations locales ont progressé de 2,7 % en volume, et celles des administrations de sécurité sociale de 3,3 %. Les seules prestations sociales ont augmenté de 4 %, en raison notamment de la revalorisation différée des pensions de retraite.
La charge de la dette a également augmenté, sous l’effet du déficit 2023 et du refinancement progressif de l’encours à des taux plus élevés, contribuant à creuser le déficit de 0,2 point de PIB. Ce service de la dette devrait passer de 60 à 100 milliards d’euros d’ici la fin de la décennie.
Les prélèvements obligatoires sont peu dynamiques depuis plusieurs années. Ils progressent moins vite que le PIB, en raison notamment de la baisse des droits de mutation liée au recul des transactions immobilières et de l’atonie de la consommation. Le manque à gagner par rapport aux prévisions initiales a entraîné une majoration du déficit public de 0,4 point de PIB. Pour compenser la stagnation des recettes, le gouvernement a été contraint d’augmenter les impôts. Certaines hausses prévues pour 2025 sont censées être temporaires, mais la Cour des comptes doute de la capacité des pouvoirs publics à les remettre en cause.
Le retour du déficit public sous les 3 points de PIB en 2029, tel que la France s’y est engagée, ne suffira pas à garantir la soutenabilité de la dette. La Cour des comptes souligne que les pouvoirs publics devront dégager un solde primaire (c’est-à-dire avant paiement des intérêts de la dette) positif de 1,1 point de PIB de manière durable, alors qu’il est aujourd’hui négatif de 3,7 points. En cas de persistance d’un déficit primaire, la dette publique continuera de dériver, pouvant à terme poser un problème de soutenabilité. Cette dette pourrait dépasser 120 % du PIB en 2029, contre 113 % fin 2024.
La trajectoire pluriannuelle publiée en avril 2025 suppose un effort de 105 milliards d’euros à l’horizon 2029 pour ramener le déficit sous le seuil des 3 % du PIB, alors même que certaines dépenses (santé, retraites, défense) sont appelées à augmenter. La Cour des comptes s’inquiète des retards pris dans cet ajustement et de la timidité des mesures annoncées. Elle suggère l’instauration d’un mécanisme contraignant à l’encontre des collectivités locales.
Le rapport 2025 s’inscrit dans la continuité des précédents, mais adopte un ton plus alarmiste. Le président de la Cour, Pierre Moscovici, appelle à l’adoption de mesures courageuses. Ce rapport ignore toutefois les effets négatifs qu’un ajustement budgétaire pourrait avoir sur la croissance. Il ne retient pas l’idée qu’un surcroît d’activité économique est nécessaire pour améliorer durablement les finances publiques. Le Portugal, l’Espagne et la Grèce ont réussi à redresser leurs comptes notamment grâce au retour de la croissance. Une stratégie d’attrition budgétaire, reposant sur des hausses d’impôts et des économies, risque de s’avérer malthusienne.
Rémunération des dépôts : toujours en baisse
En mai 2025, la rémunération moyenne des encours de dépôts bancaires des ménages et des sociétés non financières (SNF) a enregistré, selon la Banque de France, une baisse de 2 points de base (pb) par rapport à avril 2025 et s’établit à 1,53 %.
Les taux de rémunération sur les contrats nouveaux poursuivent leur repli pour les ménages comme pour les SNF, les baisses étant plus marquées pour les dépôts à terme à moins de deux ans (-10 pb entre avril et mai pour les ménages et pour les SNF).
Taux moyens de rémunération des dépôts bancaires, en % et CVS
| Encours (Md€) | Taux de rémunération des encours de dépôts | Contrats nouveaux (Mds€) | Taux de rémunération sur contrats nouveaux | |||||
| mai- 2025 (p) | mai- 2024 | avr- 2025 (r) | mai- 2025 (p) | mai- 2025 (p) | mai- 2024 | avr- 2025 (r) | mai- 2025 (p) | |
| Dépôts bancaires des Ménages et SNF | 2 588 | 1,89 | 1,55 | 1,53 | ||||
| dont Ménages | 1 878 | 1,90 | 1,61 | 1,60 | ||||
| dont : – dépôts à vue (b) | 547 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||||
| – livrets à taux réglementés (b,c) | 718 | 3,17 | 2,48 | 2,48 | ||||
| dont : livret A (b) | 404 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | ||||
| – livrets ordinaires (b) | 221 | 0,92 | 0,84 | 0,83 | ||||
| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 80 | 3,67 | 2,79 | 2,76 | 12 | 3,54 | 2,24 | 2,14 |
| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 102 | 2,23 | 2,34 | 2,35 | 2 | 3,36 | 2,55 | 2,52 |
| – plan d’épargne-logement | 210 | 2,62 | 2,63 | 2,63 | 0 | 2,22 | 1,74 | 1,74 |
| dont SNF | 710 | 1,86 | 1,39 | 1,35 | ||||
| dont : – dépôts à vue (b) | 488 | 0,79 | 0,56 | 0,54 | ||||
| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 144 | 4,10 | 3,06 | 2,95 | 35 | 3,85 | 2,37 | 2,27 |
| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 77 | 3,93 | 3,44 | 3,43 | 2 | 3,86 | 2,81 | 2,79 |
| Pour mémoire : | ||||||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 4,50 | 2,40 | 2,40 | |||||
| Euribor 3 mois (e) | 3,81 | 2,25 | 2,09 | |||||
| Rendement du TEC 2 ans (e), (f) | 3,08 | 1,98 | 1,98 | |||||
| Rendement du TEC 5 ans (e), (f) | 2,86 | 2,55 | 2,54 | |||||
Notes :
– En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Pour les dépôts à vue et les livrets, le taux sur les contrats nouveaux est supposé égal à celui sur les encours.
c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
d. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
e. Moyenne mensuelle.
f. Taux de l’Échéance Constante 2 ans et 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
r. Données révisées.
p. Données provisoires.
Le Coin des Epargnants du 27 juin 2025 – soulagements sur les marchés
Donald Trump ou l’art du « deal » permanent
Jeudi 26 juin, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé sur son compte X qu’il avait demandé au Congrès de retirer la « mesure de protection Section 899 » du budget, plus connue sous le nom de « revenge tax » (taxe vengeresse) contre les intérêts étrangers aux États-Unis, actuellement en discussion au Sénat. Cette annonce est la conséquence de la décision des pays du G7 d’exempter les États-Unis de l’impôt minimum mondial. Cette exemption était instamment demandée par Donald Trump.
La « revenge tax » permettait aux États-Unis de retenir à la source jusqu’à 20 % des revenus de capitaux réalisés par des individus et des groupes étrangers, dès lors qu’ils provenaient de pays dont la fiscalité est jugée préjudiciable aux intérêts américains. La France était doublement visée, puisqu’elle a mis en œuvre l’impôt minimum mondial de 15 % sur les multinationales (le « deuxième pilier » de l’accord OCDE) ainsi qu’une taxe sur les services numériques.
Avec la décision intervenue au sein du G7, les multinationales américaines pourront continuer à optimiser leur fiscalité entre plusieurs pays sans s’exposer à une surtaxe extraterritoriale. « Les taxes OCDE du deuxième pilier ne s’appliqueront pas aux entreprises américaines, et nous travaillerons coopérativement pour mettre en œuvre cet accord dans le cadre de l’accord OCDE-G20 au cours des prochaines semaines et des prochains mois », a déclaré Scott Bessent. Cette décision remet en cause l’accord OCDE sur la taxation minimale des bénéfices. Pour l’instant, la conclusion d’un accord entre l’Europe et les États-Unis tarde. En revanche, le président américain a laissé entrevoir un « deal » avec l’Inde.
Le Sénat espère désormais adopter le budget des États-Unis ce week-end au plus tard. Il devra ensuite repasser à la Chambre. Le président Trump souhaite promulguer la loi à l’occasion de la fête nationale, le 4 juillet.
Soulagement sur les marchés actions
Après deux semaines de baisse consécutives, la Bourse de Paris a clôturé la semaine, vendredi 27 juin, sur une progression hebdomadaire de près de 1 %, à 7 691,55 points. L’indice allemand DAX a gagné de son côté près de 3 % sur la semaine, atteignant des niveaux records. Depuis le début de l’année, il a progressé de plus de 20 %. Les décisions des États membres européens de l’OTAN d’accroître leurs dépenses militaires soutiennent les valeurs allemandes de l’armement, comme Rheinmetall. L’amélioration du climat des affaires outre-Rhin contribue également à la hausse du cours des actions. Aux États-Unis, les indices ont également enregistré de bons résultats sur la semaine.
Parmi les bonnes nouvelles figure la publication de l’indice PCE des dépenses de consommation aux États-Unis, qui a augmenté comme prévu de 2,3 % sur un an après 2,2 % en avril. Hors alimentation et énergie, l’inflation « core », considérée comme la plus pertinente par la Réserve fédérale, marque une accélération d’un dixième de point, à 2,7 % sur un an. Les effets de la politique commerciale de Donald Trump ne se sont pas encore répercutés sur le niveau des prix, ce qui permettrait à la Fed de reprendre ses baisses de taux d’intérêt au second semestre. Les dépenses des ménages américains ont en revanche connu leur plus forte baisse de l’année (-0,3 %). « Associée au ralentissement des revenus et des dépenses des ménages, l’inflation PCE de mai est restée suffisamment proche du taux cible de 2 % pour maintenir l’espoir d’une baisse rapide des taux », a commenté Gary Schlossberg, du Wells Fargo Investment Institute.
À Wall Street, le S&P 500 a battu un nouveau record au-delà des 6 180 points, porté par la désescalade commerciale avec Pékin et l’accord avec le G7 mettant un terme à la « revenge tax ». La spéculation sur une future baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale soutient également la hausse des cours. La Chine a confirmé la conclusion d’un accord-cadre avec les États-Unis, précisant qu’elle pourrait valider l’exportation de davantage d’articles soumis à contrôle. Pourraient être concernées les terres rares. La Maison-Blanche envisage par ailleurs un report de la date butoir du 9 juillet pour l’entrée en vigueur des surtaxes réciproques. Ce report renforce l’idée que les menaces de Donald Trump visent avant tout à obtenir des concessions de ses partenaires économiques.
Pétrole : le retour à la normale
Avec le cessez-le-feu, le cours du baril a presque retrouvé cette semaine son niveau d’avant-guerre entre Israël et l’Iran. Il a perdu près de 13 % de sa valeur, le baril de Brent s’échangeant à 68 dollars vendredi 27 juin. La baisse du cours du pétrole est également imputable à l’augmentation de la production, avec la fin de l’accord de régulation de l’OPEP+ et la montée en puissance de la production américaine.
L’once d’or, avec l’atténuation des tensions, s’est repliée, perdant près de 4 % sur la semaine. Le bitcoin a, en revanche, gagné plus de 3 % et s’est rapproché de son record (111 900 dollars atteint le 22 mai dernier). La cryptoactif est toujours porté par les achats d’ETF.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 27 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 691,55 | +0,89 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 43 819,27 | +3,31 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 6 173,07 | +2,80 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 20 273,46 | +3,66 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 24 000,27 | +2,71 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 798,91 | +0,11 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 325,64 | +1,65 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 40 150,79 | +3,98 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 424,23 | +1,09 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,261 % | +0,015 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,587 % | +0,067 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,261 % | -0,114 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1703 | +1,90 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 275,88 | -3,39 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 68,40 | -11,92 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 107 131,81 | +3,21 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
L’assurance vie en plein boom
Cette année, en mai, les Français sont restés en mode épargne en privilégiant l’assurance vie qui bat une nouvelle fois un record d’encours. Depuis le début de l’année, il y a indéniablement un moment « assurance vie ».
Un mois de mai exceptionnel
Le mois de mai est traditionnellement peu porteur pour l’assurance vie. Les jours fériés et les longs week-ends qui en résultent n’incitent pas aux versements. En moyenne, sur ces dix dernières années (2015 – 2024), la collecte nette du mois de mai est de 580 millions d’euros. Néanmoins, les décollectes y sont assez rares. Depuis 1997, trois décollectes ont été enregistrées en mai :
- 2023 : -1,839 milliard d’euros ;
- 2020 : -2,047 milliards en plein covid ;
- 2012 : -1,711 milliard en pleine crise des dettes souveraines.
En 2025, l’assurance vie rompt avec cette tradition en enregistrant une collecte record de 3,8 milliards d’euros, son meilleur résultat depuis 16 ans. Pour le 4e mois consécutif, la collecte nette des supports en euros demeure positive.
Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à +22,4 milliards d’euros, supérieure de +8,9 milliards d’euros à celle de 2024 sur la même période. La collecte nette est de 20,0 milliards d’euros pour les supports en unités de comptes (UC) et de 2,4 milliards d’euros pour les supports en euros.
Des cotisations brutes au plus haut
Au mois de mai, les cotisations d’assurance vie se sont élevées à 13,9 milliards d’euros, en hausse de +10 % par rapport à mai 2024.
Les fonds euros poursuivent leur remontée en puissance avec une augmentation de leur collecte de 13 % sur un an. Malgré la volatilité des marchés actions, la collecte des UC est en progrès de 4 %.
Depuis le début de l’année, les cotisations atteignent 80,2 milliards d’euros, en hausse de +3,2 milliards d’euros par rapport à la même période de l’année précédente. La collecte en supports en UC augmente de 8 % et celle en fonds euros progresse plus de +2 %. La part des UC dans les cotisations s’établit à 35 % sur le mois et à 38 % depuis le début de l’année.
Des prestations en baisse
Les ménages réalisent peu de sorties de l’assurance vie. Les prestations sont en effet en baisse en s’établissant à 10,2 milliards d’euros au mois de mai en recul de 9 % par rapport à mai 2024. Elles continuent de reculer ce mois-ci sur les supports en UC (-15 %) et sur ceux en euros (-7 %).
Depuis le début de l’année, les prestations s’établissent à 57,8 milliards d’euros, en baisse de -9 %. Ce recul concerne aussi bien les supports en euros (-4,3 milliards d’euros, soit −8 %) que les supports en UC (-1,4 milliard d’euros, soit -12 %).
Un encours record
L’encours de l’assurance s’élevait fin mai à 2049 milliards d’euros contre 2028 milliards d’euros fin avril en hausse de près de 5 % sur un an.
L’assurance vie : « the place to be »
L’assurance vie porte bien son nom de placement préféré des Français. Il profite pleinement du taux d’épargne élevé, 18,8 % du revenu disponible brut au premier trimestre 2025. Le taux d’épargne financière approche désormais 10 %, contre moins de 5 % au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire. Il bénéficie du moindre attrait de l’épargne réglementée et des dépôts à terme, pénalisés par la baisse de leur rendement. L’attractivité des fonds euros est en hausse avec des rendements moyens autour de 2,6 % avant impôt. L’assurance vie devrait continuer sur sa lancée dans les prochains mois. Les incertitudes sur les retraites et les inquiétudes liées aux déficits publics devraient conduire au maintien d’un fort volant de cotisations en faveur de l’assurance vie.
Les PER assurantiels : au-dessus de 100 milliards d’euros d’encours
Dans un contexte anxiogène en ce qui concerne l’avenir des régimes de retraite par répartition, sur les douze derniers mois, plus d’un million d’assurés ont souscrit un nouveau PER. Près d’un milliard d’euros de cotisations a été enregistré en mai. La collecte nette s’est élevé toujours en mai à 581 millions d’euros, en hausse de +6 %, soit +30 millions d’euros par rapport à mai 2024.
À fin mai, les PER assurantiels comptabilisaient 7,3 millions d’assurés pour un encours de 100,0 milliards d’euros, dont 44 % correspondent à des UC.
Dette publique française : 114% du PIB
Au premier trimestre 2025, la dette publique a progressé de 40,5 milliards d’euros pour atteindre 114,0 % du PIB contre 113,2 % au quatrième trimestre 2024.
Au premier trimestre 2025, la contribution de l’État à la dette publique augmente de 36,7 milliards d’euros, après une baisse de 3,7 milliards d’euros au trimestre précédent. La contribution des organismes divers d’administration centrale (Odac) à la dette diminue légèrement (-0,1 milliard d’euros après +1,1 milliard d’euros au trimestre précédent). La contribution des administrations de sécurité sociale (Asso) à la dette publique augmente (+3,3 milliards d’euros, après -5,5 milliards d’euros au trimestre précédent).
Au premier trimestre 2025, la dette publique des administrations publiques locales augmente de 0,6 milliard d’euros, après +11,9 milliards d’euros au trimestre précédent. Les régions s’endettent (+2,0 milliards d’euros), de même que les organismes divers d’administration locale (+0,8 milliard d’euros dont +1,0 milliard d’euros pour Île-de-France Mobilités). À l’inverse, la dette des communes diminue (-1,6 milliard d’euros), comme celle des départements (-0,6 milliard d’euros).
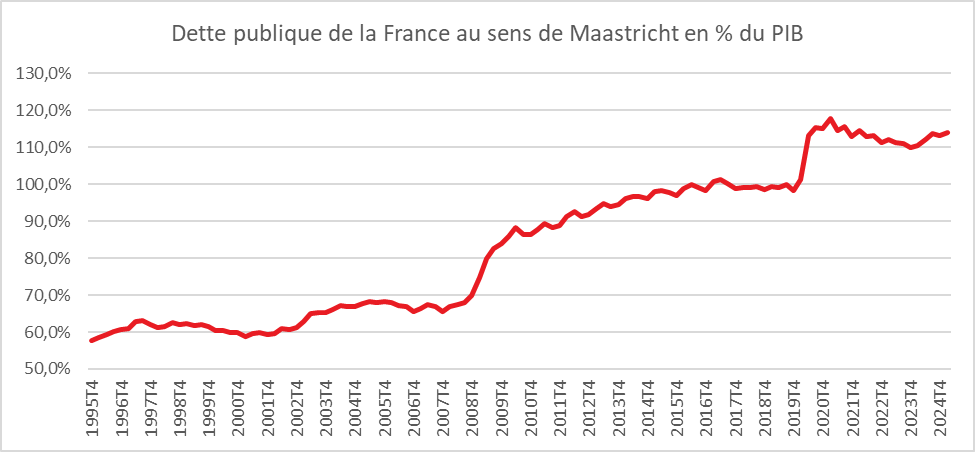
INSEE
Livret A : le retour d’une collecte positive en mai – Le LDDS toujours dans le rouge
« Fais ce qu’il te plait en mai ». Les Français ont épargné avec modération durant le printemps sur leurs produits réglementés. Si le Livret A a renoué avec une collecte positive, tel n’est pas le cas pour le Livret d’Epargne Populaire. Sur fond de forte épargne, les produits réglementés digèrent toujours la baisse de son rendement du 1er février dernier, rendement qui pourrait, à nouveau, baisser le 1er août prochain.
Livret A : le retour d’une collecte positive
Après une décollecte de 200 millions d’euros au mois d’avril, le Livret A renoué avec une collecte positive au mois de mai avec +1,22 milliard d’euros. Celle-ci demeure néanmoins inférieure à celle de 2024 (1,26 milliard d’euros) et à la moyenne de ces dix dernières années (1,4 milliard d’euros). Depuis 2009, le premier produit d’épargne des ménages a connu quatre décollectes en mai (2015 : -0,44 milliard d’euros ; 2014 : – 0,09 milliards d’euros ; 2010 : -0,31 milliard d’euros et 2009 : -1 milliard d’euros). La plus forte collecte en mai a été celle de 2020, 3,98 milliards d’euros, à la fin du premier confinement.
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, la collecte atteint seulement 2,76 milliards d’euros contre 8,91 milliard d’euros sur la même période de 2024. La normalisation du Livret A se poursuit après des années de collectes fastes. Mai est un mois charnière avec ses week-ends prolongés et l’arrivée des vacances. Il sépare la période d’épargne du début d’année de celle de la fin d’année marquée par un surcroit de dépenses. Le Livret A continue d’être affecté par l’effet taux. Les ménages redéployent une partie de leur épargne de précaution vers des produits de long terme comme l’assurance vie, qui connaît un net rebond depuis le début de l’année.
Cette normalisation n’est pas synonyme de crise de l’épargne réglementée, l’encours du Livret A battant un nouveau record à 445,3 milliards d’euros.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)t
Le mois de mai réussit rarement au LDDS qui a accumulé, depuis 2009, neuf décollectes. La collecte moyenne y est faible, 387 millions d’euros entre 2015 et 2024. En 2025, pas de décollecte mais une collecte de 660 millions d’euros, deux fois supérieur à la moyenne décennale. Cette collecte est identique à celle de 2024.
Sur les cinq premiers mois de l’année, la collecte pour le LDDS se monte à 2,78 milliards d’euros contre 4,28 milliards d’euros en 2024 sur la même période. A noter, le LDDS collecte plus que le Livret A en 2025. Le LDDS épouse plus finement que le Livret A l’évolution du budget des ménages. Cette corrélation s’explique par le fait que le LDDS est plus souvent associé au compte courant des ménages que le Livret A. Les Français mettent leurs gains de pouvoir d’achat plus facilement sur un LDDS, gains qui pourront être utilisés durant les vacances. Le Livret A est un produit plus « épargne ».
L’encours du LDDS atteint en mai 2025, 163,3 milliards d’euros, un nouveau record.
Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) : toujours en recul forte décollecte sur fond de régularisation
Le LEP enregistre, en mai, sa deuxième décollecte successive avec –1,19 milliard d’euros. En avril, la décollecte avait atteint un niveau important, -1,96 milliard d’euros. Déjà en 2024, le LEP avait connu un résultat négatif de -0,04 milliard d’euros.
Les ménages à revenus modestes ont puisé dans leur épargne pour faire face à leurs dépenses, sachant que par ailleurs le mois de mai a pu enregistrer la fin des régularisations au titre du contrôle du plafond de revenus.
La collecte cumulée sur les cinq premiers mois de l’année est négative de -2,55 d’euros, contre une collecte positive de 3,99 milliards sur la même période en 2024.
L’encours du LEP s’établit ainsi, fin mai, 79,6 milliards d’euros, 80,8 milliards d’euros fin avril
Le taux du Livret A : 1,6 à 1,7 le 1er août 2025
Compte tenu du taux ester et du taux d’inflation, le taux du Livret A pourrait passer de 2,4 à 1,6/1,7 % le 1er août prochain. Le taux d’inflation des 6 derniers mois devrait, en effet, être proche de 1 % et le taux ester est passé 2,922 à 1,924 % sur le semestre. Le taux moyen du taux ester est du 1er janvier au 15 juin de 2,44 %.
Dans une optique de baisse des taux du crédit et de relance de la consommation, il est fort probable que le Ministre de l’Economie suive la recommandation du Gouverneur de la Banque de France, ce dernier se rangeant derrière l’application de la formule. Avec un taux de 1,6/1,7 %, le gouvernement pourra indiquer que le rendement réel est positif d’un point ce qui est élevé par rapport aux années précédentes.
Le taux du LEP pourrait passer de son côté, en appliquant la formule de 3 à 2,2 % (taux du Livret A +0,5 point) mais depuis deux ans, le gouvernement ne respecte pas totalement cette dernière. Un taux à 2,5% est assez probable.
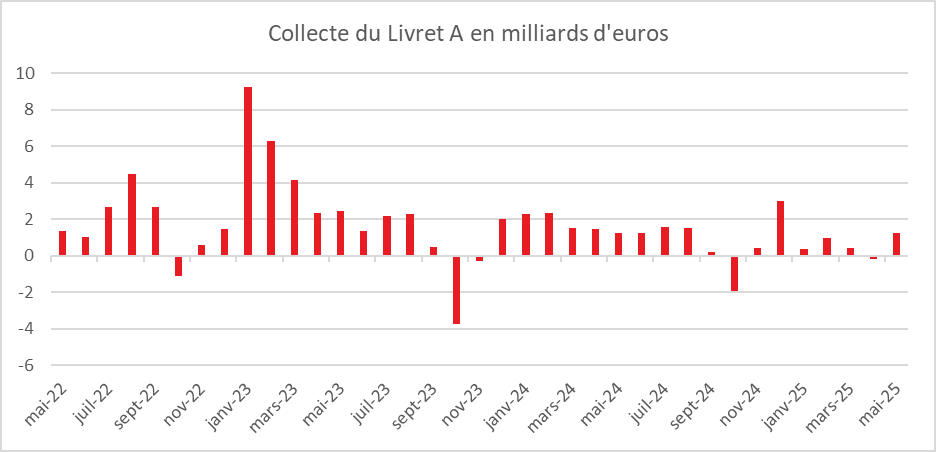
CDC
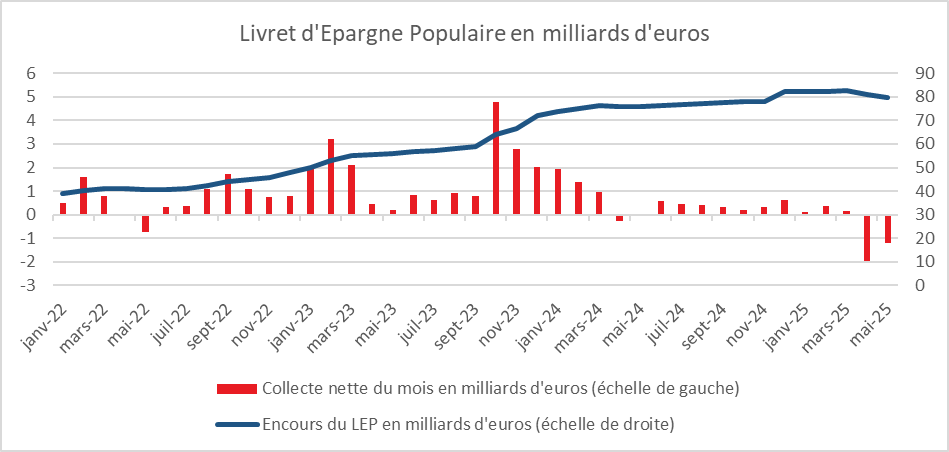
CDC
Le Coin des Epargnants du 20 juin 2025 : en attendant Donald Trump….
Les marchés suspendus à la décision de Donald Trump
Les investisseurs tentent de croire à une sortie négociée du conflit en Iran. La décision de Donald Trump de ne pas trancher a été perçue comme une volonté de laisser du temps à la diplomatie. Après avoir accusé le coup avec l’intervention israélienne, les investisseurs cherchent à se rassurer. Le début du mois de juillet devrait être tendu avec l’arrivée à échéance des ultimatums en matière de négociations commerciales et concernant l’Iran.
Le CAC 40 a une nouvelle fois perdu du terrain cette semaine, en cédant plus de 1 % et en repassant sous les 7 600 points. L’indice parisien reste pénalisé par le recul des valeurs du luxe. Tous les grands indices ont enregistré un repli. Le S&P 500 a perdu près de 1,5 % sur la semaine et le Nasdaq près de 1,3 %.
Dans un environnement de tensions internationales, les obligations souveraines jouent leur rôle de valeur refuge, provoquant une baisse des taux d’intérêt. L’or est en hausse, sans pour autant battre son record.
Sur le front du pétrole, la volatilité a également été de mise cette semaine. Avec le retour de l’espoir d’une négociation, le prix du baril de Brent, qui sert de référence mondiale, s’est détendu en fin de semaine à 76,4 dollars, tout en restant supérieur de plus de 20 % à son niveau de début juin. Le prix du baril pourrait s’envoler en cas de blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transite 20 % du pétrole mondial.
La Fed en mode attentiste
Guerre commerciale, guerre en Iran : la Réserve fédérale américaine avait toutes les raisons de ne pas modifier ses taux directeurs. Lors de sa réunion du 18 juin, elle a, sans surprise, maintenu le statu quo, laissant ses taux entre 4,25 % et 4,50 % pour la quatrième fois consécutive. Certes, au cours des quatre derniers mois, l’inflation a progressé moins vite que prévu et s’est établie à 2,8 % au mois de mai. L’indice PCE, qui mesure les prix des dépenses de consommation personnelle — indice clé pour la Fed — se rapproche de plus en plus de la cible de 2 % que s’est fixée la banque centrale.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné lors de la conférence de presse qui s’est tenue après la réunion du comité de politique monétaire que « les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump, d’au moins 10 % sur l’ensemble des produits entrant dans le pays, vont pousser les prix à la hausse et peser sur l’activité économique ». La Fed estime pour l’instant que la hausse des prix devrait atteindre 3 % en 2025, contre 2,87 % dans ses prévisions de mars. Le président de la Fed a mentionné que « l’inflation des biens a légèrement augmenté. Nous nous attendons à ce que cela se poursuive au cours de l’été ». Pour le moment, Jerome Powell refuse d’obéir aux injonctions présidentielles. Donald Trump a demandé, au début du mois de juin, une baisse d’un point des taux directeurs. « Tant que le marché du travail reste en l’état et que l’inflation diminue, la bonne chose à faire est de maintenir les taux inchangés », considère le président de la Réserve fédérale. Ce dernier opte pour la prudence. Il attend de constater les résultats économiques de la politique de Donald Trump pour infléchir la sienne.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 20 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 589,66 | -1,07 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 42 206,82 | -1,81 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 967,84 | -1,43 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 19 447,41 | -1,26 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 326,60 | -0,73 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 774,65 | -0,86 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 233,58 | -1,18 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 38 403,23 | +0,50 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 359,90 | -0,75 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,246 % | -0,010 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,513 % | -0,021 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,375 % | -0,047 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1533 | +0,71 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 369,65 | +1,38 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,67 | +2,53 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 104 220,50 | -1,40 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Le coin des épargnants du 14 juin 2025 : bruits de bottes
La semaine financière a été dominée par le choc géopolitique au Moyen-Orient, avec l’attaque israélienne contre l’Iran. À la clef : tensions sur le pétrole, aversion au risque sur les marchés actions, et un retour de l’incertitude stratégique dans les prévisions économiques.
L’attaque israélienne contre l’Iran, vendredi 13 juin, a créé une onde de choc sur l’ensemble des places financières. Les États-Unis avaient été avertis de l’imminence de cette attaque, Donald Trump ayant annoncé jeudi 12 la réduction du personnel diplomatique dans la région. Tsahal a lancé son opération « Nations de lions », en frappant Téhéran et des cibles liées au programme nucléaire dans différentes régions de l’Iran. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé que l’opération militaire visait à repousser « la menace iranienne pour la survie même d’Israël ». Cette opération devrait, selon les autorités israéliennes, durer autant de jours qu’il sera nécessaire pour éliminer cette menace. Par ailleurs, Tsahal a tué le commandant des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami ; des scientifiques nucléaires auraient également été tués. L’Iran a promis de répondre à cette attaque, faisant craindre l’ouverture d’un conflit de grande envergure au Moyen-Orient. L’Iran a répliqué vendredi soir en utilisant notamment des missiles balistiques. Malgré le Dôme de fer, plusieurs bâtiments ont été touchés.
La grande majorité des États, dont la France et l’Allemagne, ont appelé à la retenue après le déclenchement des frappes par Israël. De l’ONU à Londres, en passant par Paris, tous redoutent une escalade pouvant mener à l’ouverture d’un conflit majeur. Néanmoins, Donald Trump ne joue pas la carte de l’apaisement. Dans un post sur son réseau Truth Social, le président américain a rappelé avoir « donné à l’Iran un ultimatum de 60 jours il y a deux mois pour conclure un accord. Ils auraient dû le faire ! Aujourd’hui, c’est le jour 61. » Le gouvernement de Netanyahou entend poursuivre les opérations militaires jusqu’à l’éradication des capacités nucléaires de l’Iran, voire jusqu’à la chute du régime.
Avec le déclenchement de l’attaque israélienne, les indices actions des grandes places financières ont connu une baisse immédiate vendredi 13 juin, et le prix du pétrole a gagné plus de 10 %. Les valeurs des compagnies aériennes, comme Air France, ont fortement reculé (–4,74 % vendredi 13 pour la compagnie franco-néerlandaise et –10 % sur la semaine). Le CAC 40 a reculé de 1,65 % sur la semaine, et le DAX allemand de près de 3,5 %. Le S&P 500 américain a diminué de près de 0,4 % sur la semaine. Le cours de l’or, sans surprise, est en hausse.
La semaine prochaine sera marquée par la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les taux directeurs devraient rester inchangés dans la fourchette actuelle de 4,25–4,5 % à l’issue de la réunion des 17 et 18 juin. À cette occasion, le comité présentera ses projections économiques et d’inflation.
Pétrole sous tension
Sur la semaine, le cours du baril de pétrole Brent a augmenté de 10 %, avec une hausse de plus de 6 % vendredi. Le baril s’échangeait vendredi soir contre 73 dollars. Le marché était, jusqu’à l’intervention militaire israélienne, déflationniste, avec l’engagement d’une guerre des prix au sein du cartel. La prime de risque sur le pétrole est supérieure à celles observées en avril et octobre 2024, lors des précédents incidents entre Israël et l’Iran, les investisseurs estimant que le risque d’embrasement est plus important que par le passé. Le baril de Brent n’avait plus atteint ce niveau depuis mars, avant le déclenchement de la guerre commerciale de Donald Trump. Avec la décision des pays exportateurs de pétrole, regroupés dans l’OPEP+, d’augmenter progressivement leur production, le baril était descendu aux alentours de 60 dollars, avant de se stabiliser ces dernières semaines entre 63 et 65 dollars. La baisse du cours du baril avait récemment conforté la désinflation.
Les investisseurs craignent que la poursuite des frappes israéliennes ne mette à mal la production iranienne, le pays étant le septième producteur mondial. Les autorités de Téhéran ont indiqué vendredi qu’aucune installation pétrolière n’avait été touchée. Les recettes pétrolières sont, pour l’Iran, indispensables. Elles ont atteint 67 milliards de dollars l’an dernier. Priver Téhéran de ces ressources est sans nul doute une tentation pour Israël afin d’affaiblir le régime. En moyenne, le pays a produit l’an dernier 3,26 millions de barils de brut, une production en augmentation de 13 % par rapport à 2023. La moitié de cette production est exportée, essentiellement vers la Chine. Les pays de l’OPEP ont la capacité de compenser l’arrêt de la production iranienne (soit 3 % de la production mondiale), avec néanmoins, à la clé, une hausse des cours.
Au-delà de la production pétrolière iranienne, les investisseurs sont attentifs à l’accès au détroit d’Ormuz, en partie contrôlé par l’Iran. Ce détroit est un passage stratégique pour les cargaisons de pétrole et de gaz du Moyen-Orient vers l’Asie et l’Europe. Téhéran a, par le passé, menacé de bloquer le trafic dans cette zone, même si le gouvernement n’a jamais mis ces menaces à exécution, sachant qu’il en serait la première victime. Plus de 20 % du pétrole mondial et du GNL transitent par ces routes. Le détroit d’Ormuz est notamment stratégique pour le Qatar, qui expédie son GNL vers les pays asiatiques. JP Morgan évalue que le blocage de cette voie d’accès au golfe Persique porterait le prix du pétrole brut à 130 dollars le baril. Le prix du gaz a fortement augmenté vendredi, en lien avec la crainte d’un tel blocage. Le TTF, principal indice européen, a augmenté de plus de 5 % ce vendredi, atteignant 38 euros le MWh.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 13 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 684,68 | -1,65 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 42 197,79 | -1,46 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 976,97 | -0,37 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 19 406,83 | -0,63 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 499,40 | -3,42 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 850,63 | +0,11 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 290,47 | -2,76 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 834,25 | +1,03 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 377,00 | +0,40 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,256 % | +0,013 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,534 % | -0,038 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,422 % | -0,061 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1558 | +1,49 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 421,65 | +2,270 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 73,32 | +11,49 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 105 697,60 | +0,57 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Le Coin des Epargnants du 6 juin 2025 – bataille d’ego
L’emploi américain résiste aux foucades présidentielles
L’économie des États-Unis a, en effet, créé 139 000 emplois au mois de mai. Certes, ce chiffre est inférieur à celui d’avril (147 000), mais il dépasse le consensus établi par Bloomberg, qui tablait sur 126 000 créations de postes. Le taux de chômage est resté stable à 4,2 % de la population active, comme prévu, tandis que le salaire horaire moyen a progressé de 3,9 % sur un an, soit le même rythme qu’en avril et 0,2 point au-dessus des attentes.
La semaine a été marquée par la forte chute de l’action Tesla, victime d’une dispute sans précédent entre Donald Trump et Elon Musk. Le titre a perdu 14,3 % le 5 juin avant de regagner du terrain le vendredi suivant, Wall Street voulant croire à une accalmie entre ces deux egos surdimensionnés. La querelle est née des critiques formulées par Elon Musk à l’encontre du projet de budget, qui risquerait de remettre en cause ses ambitions spatiales. En réaction, la Maison-Blanche a indiqué qu’elle était prête à annuler tous les contrats dont bénéficient les entreprises de Musk. Cette guerre d’egos n’a toutefois pas eu d’incidence sur le cours du bitcoin, qui demeure au-dessus de 100 000 dollars.
L’économie chinoise souffre, quant à elle, de la hausse des droits de douane imposés par Donald Trump. L’indice PMI manufacturier, calculé par le cabinet S&P Global et le média économique chinois Caixin, est tombé à son plus bas niveau depuis l’automne 2022. Il est repassé sous le seuil des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et expansion de l’activité – une première depuis octobre 2024. Cette baisse s’explique en partie par des achats anticipés réalisés par les importateurs américains en février et mars.
Sur le front diplomatique, la tentative de décrispation entre Pékin et Washington ne convainc guère. La conversation d’hier entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping, censée relancer les négociations commerciales, s’apparente davantage à un exercice de communication. Les marchés attendent encore des preuves tangibles. Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre les discussions en vue de résoudre les différends sur les droits de douane et l’accès aux terres rares chinoises. L’entretien a entraîné une légère hausse des cours du pétrole, les investisseurs espérant un regain d’activité en Chine en cas d’accord commercial. Les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, en revanche, restent dans l’impasse : Moscou exige, plus ou moins explicitement, la reddition de Kiev.
Dans ce contexte troublé, les indices actions sont restés relativement stables cette semaine, avec des progressions tournant autour de 1 %, à l’exception du Nasdaq, qui a gagné plus de 2 %. Les investisseurs demeurent relativement – voire étonnamment – confiants, estimant que la situation économique pourrait s’améliorer à moyen terme.
Une huitième baisse des taux pour la BCE
Jeudi 5 mai, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé, pour la huitième fois consécutive, de réduire ses taux directeurs d’un quart de point. À compter du 11 juin, le taux de dépôt sera abaissé à 2 %, celui de la facilité de refinancement à 2,25 %, et celui de la facilité de prêt marginal à 2,4 %. Christine Lagarde a néanmoins précisé que cet allègement serait parmi les derniers envisagés. Elle a souligné que « au niveau actuel des taux d’intérêt, nous arrivons à la fin d’un cycle de politique monétaire qui répondait à des chocs cumulés, dont la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ».
L’inflation dans la zone euro se situe désormais dans la cible des 2 %. En mai, elle s’est établie à 1,9 % sur un an. Les économistes de la BCE anticipent une inflation de 2 % en 2025, de 1,6 % en 2026, et de 2 % en 2027. La hausse des droits de douane annoncée par l’administration Trump à l’encontre de l’Europe – bien que sa mise en œuvre soit suspendue – pèse déjà sur les perspectives de croissance, ce qui limite les pressions inflationnistes. Par ailleurs, l’appréciation de l’euro face au dollar réduit le coût des importations.
La baisse des taux directeurs devrait permettre une légère diminution des taux de crédit, favorisant ainsi l’investissement et le secteur de la construction. En contrepartie, la rémunération des dépôts à terme et des livrets d’épargne devrait continuer à baisser. Cette semaine, les taux souverains à 10 ans ont cependant légèrement progressé.
Procédure pour déficit excessif de la France en suspens
Le 4 juin, la Commission européenne a répondu à la France au sujet du plan présenté pour réduire les déficits publics dans le cadre de la procédure pour déficit excessif. Dans son avis, la Commission estime qu’au vu des éléments transmis, aucune mesure contraignante supplémentaire n’est actuellement justifiée. La procédure est ainsi mise « en suspens », sans pour autant être formellement « suspendue » à long terme. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la décision de l’agence de notation S&P, qui a maintenu la note souveraine de la France. Le prochain rendez-vous budgétaire décisif sera l’adoption des projets de loi de finances pour 2026.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 6 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 804,87 | +0,87 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 42 762,62 | +1,17 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 6 000,35 | +1,49 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 19 529,95 | +2,34 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 24 304,46 | +1,56 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 837,91 | +0,73 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 430,17 | +1,39 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 741,61 | +0,05 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 385,36 | +1,34 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,243 % | +0,082 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,572 % | +0,072 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,483 % | +0,080 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1387 | +0,64 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 329,69 | +1,00 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 66,23 | +3,33 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 105 048,83 | +0,23 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Un label européen pour l’épargne
Jeudi 5 juin, sept États membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Luxembourg et Estonie) ont signé un accord en vue de la création du label Finance Europe, destiné aux produits d’épargne investis dans les entreprises européennes. D’autres pays sont susceptibles de rejoindre ce premier groupe.
Dans le cadre du processus d’unification des marchés de capitaux, les États signataires souhaitent orienter l’épargne des particuliers vers des produits finançant directement les entreprises, plutôt que de la laisser sur des comptes de dépôt ou des livrets. Le deuxième objectif est de réduire la part de l’épargne investie en dehors de l’Union européenne, en particulier aux États-Unis.
Le contexte est actuellement favorable aux placements en actions européennes. Les indices américains sont en recul depuis les annonces de Donald Trump sur les droits de douane, tandis que ceux du Vieux Continent progressent. Du 1er janvier au 5 juin, l’Eurostoxx 50 a gagné plus de 10 %, contre seulement 1,5 % pour le S&P 500.
L’obtention du label européen pour des produits financiers sera conditionnée au respect de plusieurs critères : un minimum de 70 % de l’actif investi en actions ou obligations d’entreprises européennes, cotées ou non cotées, ainsi qu’une durée minimale de détention de cinq ans. Ces produits sont censés bénéficier de l’enveloppe fiscale la plus avantageuse et la plus simple possible dans chaque pays où ils seront distribués.
Les États membres ont renoncé à créer un produit d’épargne commun, en raison de la complexité et de la longueur du processus, liées aux réglementations différentes d’un pays à l’autre. L’échec du Plan d’Épargne Retraite paneuropéen a sans doute conduit les gouvernements à privilégier l’option du label.
Le rapport Prodi avait déjà souligné la nécessité de réorienter l’épargne des ménages en Europe, où seulement un tiers des encours est placé en actions, contre près de la moitié aux États-Unis. À l’inverse, la moitié des placements européens sont liquides et garantis, contre 14 % outre-Atlantique. Une meilleure allocation de l’épargne serait un atout majeur pour l’économie européenne, d’autant que celle-ci est abondante : le taux d’épargne dépasse 13 % du revenu disponible brut, contre moins de 8 % aux États-Unis. Le stock d’épargne croît chaque année de plus de 1 000 milliards d’euros en Europe et atteignait, en 2024, plus de 35 000 milliards. Or, 20 % de cette épargne est investie à l’étranger. La popularité croissante des fonds indiciels, les ETF, majoritairement composés d’actifs américains, contribue à cette fuite de capitaux.
Rémunération de l’épargne de court terme orientée à la baisse
En avril 2025, la rémunération moyenne des encours de dépôts bancaires des ménages et des sociétés non financières (SNF) est son la Banque de France , en baisse de 2 points de base (pb) par rapport à mars 2025 et s’établit à 1,55 %. Le taux des livrets ordinaires était, en avril, de 0,84 %.
Les taux de rémunération sur les contrats nouveaux poursuivent par ailleurs leur repli pour les ménages comme pour les SNF, les baisses étant les plus marquées pour les dépôts à terme à moins de deux ans (-13 pb entre mars et avril pour les ménages et -18 pb pour les SNF).
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS
| Encours (Md€) | Taux de rémunération des dépôts | Contrats nouveaux (Mds€) | Taux de rémunération sur contrats nouveaux | |||||
| avr- 2025 (p) | avr- 2024 | mars- 2025 (r) | avr- 2025 (p) | avr- 2025 (p) | avr- 2024 | mars- 2025 (r) | avr- 2025 (p) | |
| Dépôts bancaires des Ménages et SNF | 2 588 | 1,88 | 1,57 | 1,55 | ||||
| dont Ménages | 1 874 | 1,89 | 1,62 | 1,61 | ||||
| dont : – dépôts à vue (b) | 544 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||||
| – livrets à taux réglementés (b,c) | 718 | 3,18 | 2,49 | 2,48 | ||||
| dont : livret A (b) | 403 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | ||||
| – livrets ordinaires (b) | 218 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | ||||
| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 81 | 3,65 | 2,86 | 2,79 | 13 | 3,65 | 2,35 | 2,22 |
| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 101 | 2,19 | 2,35 | 2,33 | 2 | 3,34 | 2,55 | 2,55 |
| – plan d’épargne-logement | 212 | 2,61 | 2,63 | 2,63 | 0 | 2,23 | 1,74 | 1,74 |
| dont SNF | 714 | 1,85 | 1,44 | 1,39 | ||||
| dont : – dépôts à vue (b) | 490 | 0,79 | 0,58 | 0,56 | ||||
| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 148 | 4,15 | 3,16 | 3,10 | 42 | 3,87 | 2,55 | 2,37 |
| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 76 | 3,57 | 3,47 | 3,44 | 3 | 3,66 | 2,94 | 2,81 |
| Pour mémoire : | ||||||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 4,50 | 2,65 | 2,40 | |||||
| Euribor 3 mois (e) | 3,89 | 2,44 | 2,25 | |||||
| Rendement du TEC 2 ans (e), (f) | 3,00 | 2,29 | 1,98 | |||||
| Rendement du TEC 5 ans (e), (f) | 2,80 | 2,80 | 2,55 | |||||
Données Banque de France
Notes :
– En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
d. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
e. Moyenne mensuelle.
f. Taux de l’Échéance Constante 2 ans et 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
r. Données révisées.
p. Données provisoires.
Le Coin des Epargnants du 30 mai 2025 : les marchés en mode résilience
Après avoir encaissé, en avril, la tempête des droits de douane américains, les marchés se sont ressaisis au cours du mois de mai. La hausse des indices actions a été obtenue malgré les sautes d’humeur, plus ou moins calculées, du locataire de la Maison-Blanche. Ordres et contre-ordres se sont multipliés, visant tour à tour différentes cibles. L’Europe et la Chine ont été alternativement dans le viseur du président Donald Trump. Pour compliquer encore la donne et accroître les incertitudes, la justice américaine s’est immiscée dans le débat en contestant le droit du président à modifier les tarifs douaniers par décret.
Le CAC 40 reste à la traîne des autres grands indices. Il a progressé de 2 % en mai, contre une hausse de près de 7 % pour le DAX allemand. L’EuroStoxx 50 a, de son côté, enregistré une hausse de 4 %. Sur le même mois, le Nasdaq a bondi de plus de 8 %, et le S&P 500 de près de 6 %.
Le bitcoin, après un mois d’avril difficile, a enregistré une hausse de plus de 10 %, lui permettant de battre de nouveaux records. Il a terminé le mois autour de 105 000 dollars.
Sur le front de la guerre commerciale, Donald Trump a accusé Pékin d’avoir « totalement violé » les termes de leur accord commercial, sans en préciser les motifs. Le secrétaire au Trésor a, le jeudi 29 mai, souligné que les négociations entre les deux puissances mondiales étaient « un peu dans l’impasse », suggérant que les deux chefs d’État pourraient reprendre la main.
Imbroglio juridico-commercial
Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur l’intérêt, pour les partenaires commerciaux des États-Unis, de s’engager dans des négociations, étant donné que la justice américaine arbitre la légalité des décisions présidentielles en matière de droits de douane. En quelques heures, la situation s’est complexifiée. Un jour seulement après que des juges ont bloqué la majorité des barrières douanières décidées par Washington, la cour d’appel a accordé à l’administration un sursis dans l’attente d’un jugement sur le fond. Donald Trump ne se considère pas battu. Peter Navarro, son conseiller commercial, a ainsi souligné que « même si nous perdons, nous procéderons autrement ». La Maison-Blanche espère obtenir gain de cause devant la Cour suprême. Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, l’équipe présidentielle prépare un nouveau texte, fondé sur le Trade Act de 1974, visant à imposer des surtaxes allant jusqu’à 15 % sur une large gamme de produits importés, et cela pour une durée de 150 jours. D’autres dispositifs législatifs susceptibles d’autoriser une action présidentielle en matière commerciale pourraient également être mobilisés.
Malgré la menace des droits de douane, l’inflation ralentit aux États-Unis. L’indice des prix PCE, baromètre d’inflation préféré de la Réserve fédérale, n’a augmenté que de +0,1 % en avril pour sa composante « core » (hors alimentation et énergie), soit une hausse annuelle de 2,5 %, la plus faible depuis plus de quatre ans (contre 2,7 % en mars). Ce ralentissement de l’inflation est attribuable au coup de frein de la consommation, pourtant moteur essentiel de la croissance américaine. Les dépenses de consommation réelle n’ont progressé que de 0,1 % en avril, contre +0,7 % en mars. Cette prudence accrue des ménages s’est traduite par une augmentation du taux d’épargne, passé de 4,3 % à 4,9 % en un mois, atteignant son plus haut niveau depuis près d’un an. Dans le même temps, les importations américaines de marchandises ont chuté de 19,8 % entre mars et avril, les importateurs ayant anticipé leurs achats en début d’année pour contourner les hausses de droits de douane.
Après les droits de douane, les impôts
Après les surtaxes commerciales, les États-Unis ont décidé d’activer le levier fiscal pour obtenir des concessions de leurs partenaires, en premier lieu de l’Europe. Les élus républicains du Congrès ont introduit, dans le projet de loi de finances, un mécanisme de rétorsion contre les pays aux pratiques fiscales jugées « injustes ».
L’Union européenne est directement visée, tout comme le Royaume-Uni, le Canada ou encore l’Australie. Sont notamment en cause la taxe sur les services numériques et les mesures instaurant une imposition minimale des multinationales. La France est en première ligne, accusée d’avoir mis en œuvre à la fois une taxe GAFAM sur les grandes plateformes numériques et l’impôt minimum effectif négocié dans le cadre de l’OCDE, transposé via une directive européenne.
Les États-Unis ont ainsi décidé d’appliquer, dès l’an prochain, une taxe supplémentaire sur les revenus américains perçus par des entités françaises, britanniques ou australiennes. Cette surtaxe démarrera à 5 %, augmentant de cinq points par an jusqu’à un plafond de 20 %. Son assiette est large : du simple actionnaire d’Apple aux gouvernements étrangers eux-mêmes, en passant par les filiales de multinationales. Elle s’ajoutera aux impôts déjà en vigueur — qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des taxes sur les dividendes ou sur les redevances. Jusqu’à 80 % des investissements étrangers aux États-Unis pourraient être concernés.
Cette mesure risque de réduire l’attractivité du marché américain pour les investisseurs européens, alors même que les États-Unis ont besoin de capitaux étrangers pour financer leurs investissements. Elle pourrait également peser sur les cours des actions américaines. Enfin, elle entre en contradiction directe avec la volonté affichée de Donald Trump de faire revenir les capitaux étrangers pour réindustrialiser le pays. La taxation de ces flux pourrait dissuader de nombreuses entreprises d’investir outre-Atlantique.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 30 mai 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 751,89 | +0,23 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 42 270,07 | +1,66 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 911,69 | +1,54 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 19 113,77 | +1,83 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 997,48 | +1,60 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 772,38 | +0,62 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 366,59 | +0,76 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 965,10 | +1,91 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 347,49 | -1,01 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,161 % | -0,102 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,500 % | -0,071 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,403 % | -0,096 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1364 | +0,19 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 291,06 | -0,89 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 63,92 | -1,66 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 104 088,62 | -2,42 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
L’épargne financière au sommet au 1er trimestre 2025
Le taux d’épargne des ménages s’est élevé, selon l’INSEE, en France au premier trimestre 2025 à 18,8 % du revenu disponible brut (RDB), en hausse de 0,3 point par rapport au dernier trimestre 2024. Hors période Covid, il faut remonter au troisième trimestre 1981 pour constater un taux d’épargne plus élevé.
Le taux d’épargne des ménages n’a, en France, pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %). La succession de chocs — Covid, guerre en Ukraine, vague inflationniste, crise politique (dissolution), retour de Donald Trump — explique en partie cette propension à l’épargne. Le faible niveau de confiance des ménages ne les incite pas à consommer. Le montant élevé du déficit public conduit, par ailleurs, les ménages à épargner par crainte d’une augmentation des prélèvements (effet Ricardo-Barro ou équivalence ricardienne).
La désinflation n’a pas modifié le comportement des Français, pas plus que la hausse de leurs revenus. Au premier trimestre 2025, leur pouvoir d’achat a augmenté de 0,3 % (+0,1 % par unité de consommation). Dans le même temps, les ménages ont réduit leur consommation de 0,2 %, entraînant une hausse du taux d’épargne. C’est l’épargne financière qui bénéficie de cette progression, passant de 9,3 % à 9,8 % du revenu disponible brut entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Il faut remonter à 1950 pour retrouver (hors période Covid) un taux d’épargne financière plus élevé (10,7 % au deuxième trimestre 1950).
Cette hausse spectaculaire de l’épargne financière s’explique également par les craintes des Français concernant leur pouvoir d’achat à la retraite. Ils sont de plus en plus nombreux à épargner pour se constituer un complément de revenus ou de capital. Le vieillissement démographique joue en faveur de l’épargne. Ce phénomène est également observé en Allemagne, au Japon ou en Chine.
Une décrue significative du taux d’épargne ne pourra advenir qu’avec le retour de la confiance et d’une dynamique économique crédible. Mais le niveau de 2019 appartient, sans doute, déjà à l’histoire ancienne.

Cercle de l’Épargne – données INSEE
6 356 milliards d’euros : le patrimoine financier des ménages en France fin 2024
L’encours de l’épargne financière des ménages s’élevait au quatrième trimestre 2024 à 6 356 milliards d’euros dont 3 856 milliards au titre des produits de taux et 2 420,1 milliards d’euros au titre des produits de fonds propres. Le numéraire et les dépôts à vue représentent 742,7 milliards d’euros, l’épargne réglementée 955,7 milliards d’euros, les livrets ordinaires et les comptes à terme 409,7 milliards d’euros et les fonds euros d’assurance vie – PER 1 551,6 milliards d’euros. L’encours des actions cotées est de 310,4 milliards d’euros, celui unités de compte des contrats d’assurance vie 6 PER est de 538 milliards d’euros.
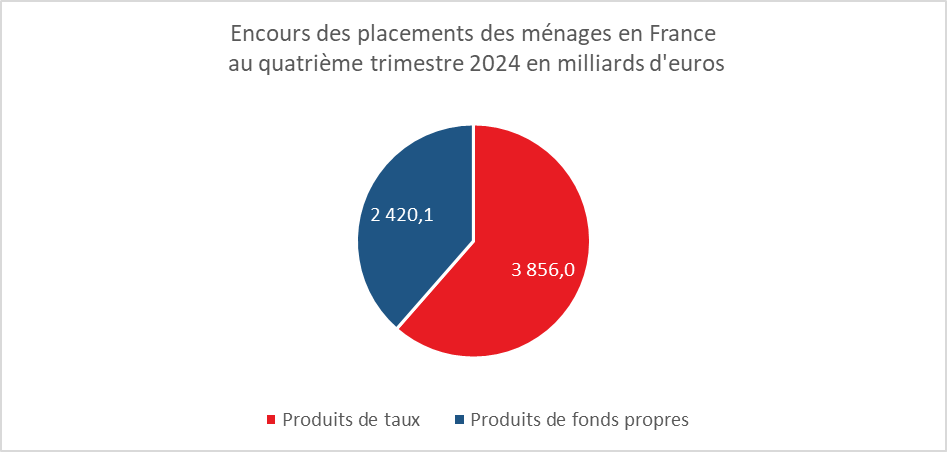
Cercle de l’Épargne – données Banque de France
En 2024, l’épargne brute, c’est-à-dire la part de leurs revenus qui reste aux ménages après leurs dépenses de consommation, a atteint 343,4 milliards d’euros en 2024, contre 205,4 milliards d’euros. Les principaux placements financiers restent élevés comparés aux années passées.
En 2024, le flux net de placements des ménages s’établit, selon la Banque de France, à 112,8 milliards d’euros, après 112,3 milliards en 2023. Cette stabilité s’accompagne néanmoins d’un rééquilibrage de l’allocation entre les types de placement de taux qui profite à l’assurance vie en euros.
Les flux financiers trimestriels ont atteint, en moyenne 28,2 milliards d’euros en 2024, contre une moyenne de 26,2 milliards d’euros entre 2014 et 2024.
Les flux au profit des produits de taux ont atteint, en 2024, 73,1 milliards d’euros contre 66,2 milliards d’euros en 2023. Ils ont représenté, en 2024, 64,8 % des flux contre 59 % en 2023. Les produits de fonds propres ont bénéficié de flux de 36,5 milliards d’euros en 2024 et de 45,5 milliards d’euros en 2023.
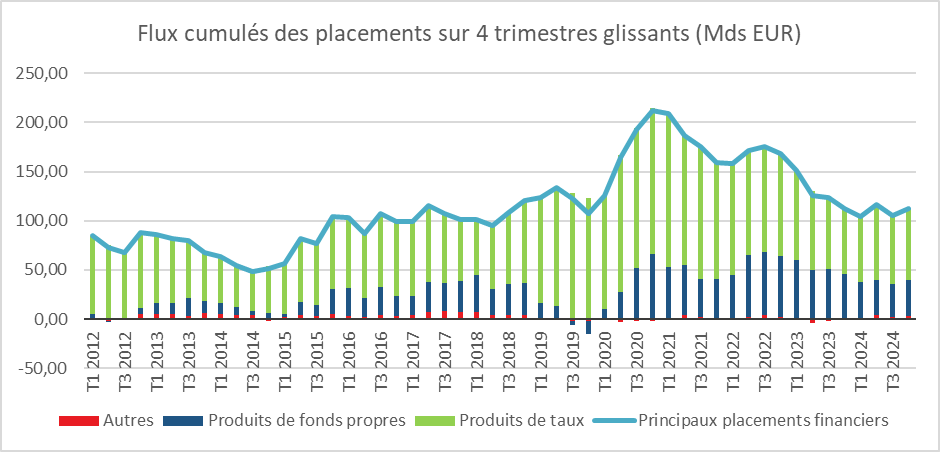
Cercle de l’Épargne – données Banque de France
Les données préliminaires (encore partielles) relatives aux principaux flux de placements financiers des ménages pour le premier trimestre 2025 indiquent une reprise de la collecte sur les dépôts à vue (+6,2 milliards d’euros après -0,7 milliard au quatrième trimestre), une décollecte sur les livrets d’épargne en lien avec la diminution des taux de rémunération, ainsi qu’une baisse des flux vers l’assurance vie et les droits à pension en euros. À l’inverse, les supports en unités de compte connaissent une réelle augmentation.
L’assurance vie au sommet en avril 2025
Résultats de l’assurance vie en avril
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne
L’embellie de l’assurance vie se poursuit avec une collecte nette de 4,4 milliards d’euros au mois d’avril, après 3,9 milliards d’euros en mars et 5,7 milliards d’euros en février. Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint, selon France Assureurs, 18,7 milliards d’euros. Le résultat du mois d’avril confirme la vigueur du rebond de l’assurance vie depuis janvier, et ce, malgré la baisse des cours boursiers consécutive aux déclarations de Donald Trump sur les droits de douane.
Un mois d’avril haut en couleur pour la collecte nette
Le cru 2025 est plus de deux fois supérieur à la moyenne des dix dernières années (1,6 milliard d’euros). Il dépasse également le résultat du mois d’avril 2024 (+3,2 milliards d’euros). En règle générale, le mois d’avril réussit assez bien à l’assurance vie. Deux seules décollectes ont été enregistrées depuis 1996 pour ce mois : en 2012, annus horribilis de l’assurance vie (−548 millions d’euros), et en 2020, année du Covid (−1,948 milliard d’euros).
La collecte nette sur le premier quart de l’année atteint 18,7 milliards d’euros, dont +17,0 milliards pour les supports en unités de compte (UC) et +1,7 milliard pour les supports en euros. La collecte nette des supports en euros est ainsi positive pour le troisième mois consécutif, traduisant une rupture par rapport aux tendances récentes.
Des cotisations brutes à un niveau élevé
Les cotisations d’assurance vie ont atteint 16,5 milliards d’euros en avril, établissant un nouveau record. Depuis le début de l’année, les Français affichent une forte propension à l’épargne, avec une nette préférence pour les placements de long terme. La baisse des taux de rémunération des livrets réglementés et des dépôts à terme explique sans doute en partie le succès de l’assurance vie en 2025.
Ainsi, les cotisations s’élèvent à 66,3 milliards d’euros depuis janvier, en hausse de 3 % sur un an. Les cotisations des supports en UC progressent de 9 %, tandis que celles des supports en euros sont quasi stables. La part des UC dans les cotisations atteint 34 % sur le mois et 39 % depuis le début de l’année (contre 38 % pour l’ensemble de 2024).
Les soubresauts des marchés financiers, le 2 avril, après les annonces de Donald Trump, n’ont pas eu d’effet notable sur la collecte.
Des prestations en fort recul
À 12,1 milliards d’euros, les prestations ont diminué de 9 % en avril 2025 par rapport à avril 2024. Elles reculent de 13 % sur les supports en UC et de 8 % sur les supports en euros.
Depuis le début de l’année, les prestations se limitent à 47,6 milliards d’euros, en baisse de 9 %. Ce repli concerne à la fois les supports en euros (−9 %) et les supports en UC (−11 %).
La baisse des prestations est à mettre en lien avec le moindre attrait des contrats à terme, dans un contexte de recul des taux d’intérêt à court terme. En 2023 et 2024, les ménages avaient partiellement réorienté leur épargne depuis les fonds en euros vers ces contrats. Aujourd’hui, le mouvement s’inverse. La faiblesse du marché immobilier réduit par ailleurs les besoins de désinvestissement en assurance vie pour financer l’achat d’un bien.
Un encours de 2 028 milliards d’euros
L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 028 milliards d’euros à fin avril 2025, en hausse de 4,2 % sur un an, mais en léger repli par rapport au record atteint en février dernier (2 037 milliards d’euros), en raison de la baisse des marchés actions.
L’assurance vie : le placement du moment
Les Français ne relâchent pas leur effort d’épargne, bien au contraire. Le taux d’épargne a atteint 18,8 % du revenu disponible brut au premier trimestre 2025. Le taux d’épargne financière approche désormais 10 %, contre moins de 5 % au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.
De 2020 à 2024, les livrets réglementés ont été les principaux bénéficiaires de la forte propension des ménages à épargner. Mais depuis début 2025, c’est l’assurance vie qui reprend la main. Les ménages réallouent une partie de leur épargne liquide, particulièrement abondante, vers l’assurance vie dont la rentabilité relative s’est renforcée. Cette réallocation devrait se poursuivre dans les mois à venir. La faible confiance dans l’avenir, les incertitudes sur les retraites et les inquiétudes liées aux déficits publics concourent à maintenir l’épargne à un niveau élevé.
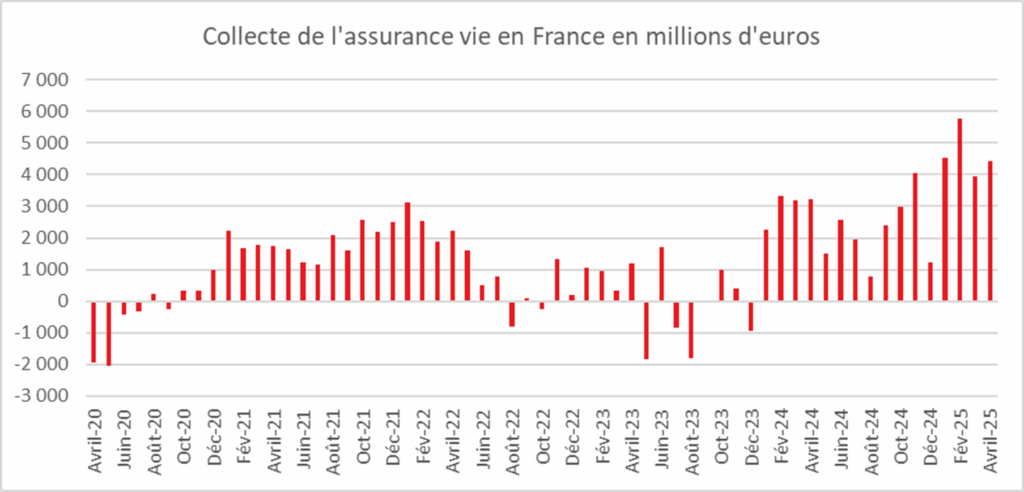
Cercle de l’Épargne – données France assureurs
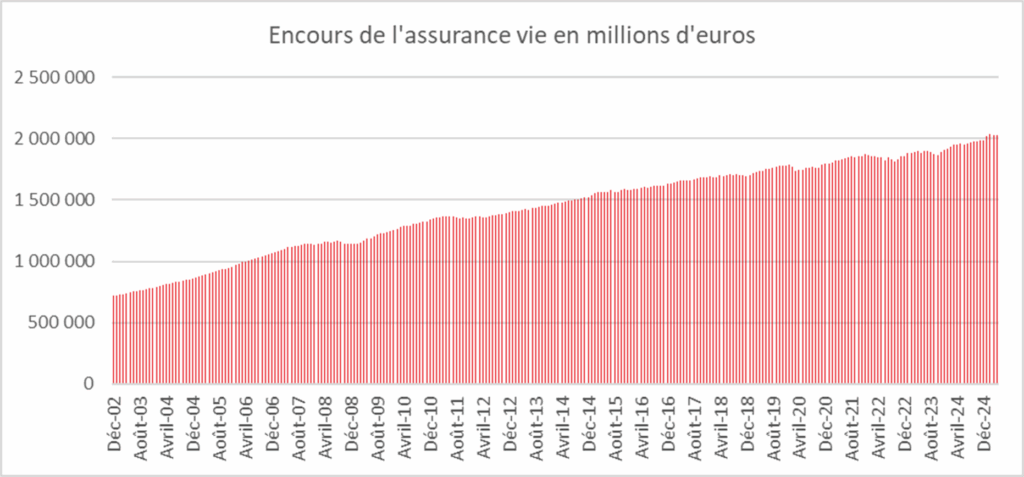
Cercle de l’Épargne – données France Assureurs
Contact presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Assurance vie : l’embellie confirmée
L’embellie de l’assurance vie se poursuit avec une collecte nette de 4,4 milliards d’euros au mois d’avril, après 3,9 milliards d’euros en mars et 5,7 milliards d’euros en février. Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint, selon France Assureurs, 18,7 milliards d’euros. Le résultat du mois d’avril confirme la vigueur du rebond de l’assurance vie depuis janvier, et ce, malgré la baisse des cours boursiers consécutive aux déclarations de Donald Trump sur les droits de douane.
Un mois d’avril haut en couleur pour la collecte nette
Le cru 2025 est plus de deux fois supérieur à la moyenne des dix dernières années (1,6 milliard d’euros). Il dépasse également le résultat du mois d’avril 2024 (+3,2 milliards d’euros). En règle générale, le mois d’avril réussit assez bien à l’assurance vie. Deux seules décollectes ont été enregistrées depuis 1996 pour ce mois : en 2012, annus horribilis de l’assurance vie (−548 millions d’euros), et en 2020, année du Covid (−1,948 milliard d’euros).
La collecte nette sur le premier quart de l’année atteint 18,7 milliards d’euros, dont +17,0 milliards pour les supports en unités de compte (UC) et +1,7 milliard pour les supports en euros. La collecte nette des supports en euros est ainsi positive pour le troisième mois consécutif, traduisant une rupture par rapport aux tendances récentes.
Des cotisations brutes à un niveau élevé
Les cotisations d’assurance vie ont atteint 16,5 milliards d’euros en avril, établissant un nouveau record. Depuis le début de l’année, les Français affichent une forte propension à l’épargne, avec une nette préférence pour les placements de long terme. La baisse des taux de rémunération des livrets réglementés et des dépôts à terme explique sans doute en partie le succès de l’assurance vie en 2025.
Ainsi, les cotisations s’élèvent à 66,3 milliards d’euros depuis janvier, en hausse de 3 % sur un an. Les cotisations des supports en UC progressent de 9 %, tandis que celles des supports en euros sont quasi stables. La part des UC dans les cotisations atteint 34 % sur le mois et 39 % depuis le début de l’année (contre 38 % pour l’ensemble de 2024).
Les soubresauts des marchés financiers, le 2 avril, après les annonces de Donald Trump, n’ont pas eu d’effet notable sur la collecte.
Des prestations en fort recul
À 12,1 milliards d’euros, les prestations ont diminué de 9 % en avril 2025 par rapport à avril 2024. Elles reculent de 13 % sur les supports en UC et de 8 % sur les supports en euros.
Depuis le début de l’année, les prestations se limitent à 47,6 milliards d’euros, en baisse de 9 %. Ce repli concerne à la fois les supports en euros (−9 %) et les supports en UC (−11 %).
La baisse des prestations est à mettre en lien avec le moindre attrait des contrats à terme, dans un contexte de recul des taux d’intérêt à court terme. En 2023 et 2024, les ménages avaient partiellement réorienté leur épargne depuis les fonds en euros vers ces contrats. Aujourd’hui, le mouvement s’inverse. La faiblesse du marché immobilier réduit par ailleurs les besoins de désinvestissement en assurance vie pour financer l’achat d’un bien.
Un encours de 2 028 milliards d’euros
L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 028 milliards d’euros à fin avril 2025, en hausse de 4,2 % sur un an, mais en léger repli par rapport au record atteint en février dernier (2 037 milliards d’euros), en raison de la baisse des marchés actions.
L’assurance vie : le placement du moment
Les Français ne relâchent pas leur effort d’épargne, bien au contraire. Le taux d’épargne a atteint 18,8 % du revenu disponible brut au premier trimestre 2025. Le taux d’épargne financière approche désormais 10 %, contre moins de 5 % au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.
De 2020 à 2024, les livrets réglementés ont été les principaux bénéficiaires de la forte propension des ménages à épargner. Mais depuis début 2025, c’est l’assurance vie qui reprend la main. Les ménages réallouent une partie de leur épargne liquide, particulièrement abondante, vers l’assurance vie dont la rentabilité relative s’est renforcée. Cette réallocation devrait se poursuivre dans les mois à venir. La faible confiance dans l’avenir, les incertitudes sur les retraites et les inquiétudes liées aux déficits publics concourent à maintenir l’épargne à un niveau élevé.
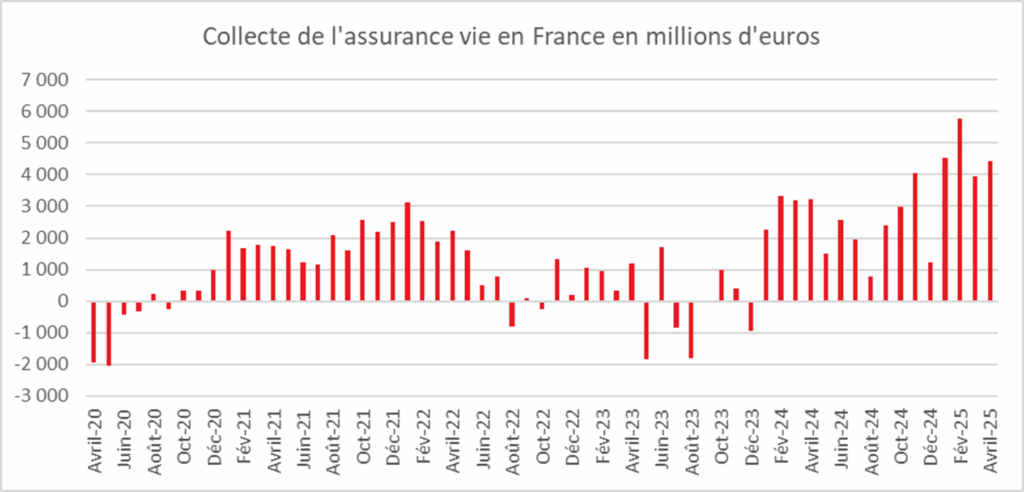
Cercle de l’Épargne – données France assureurs
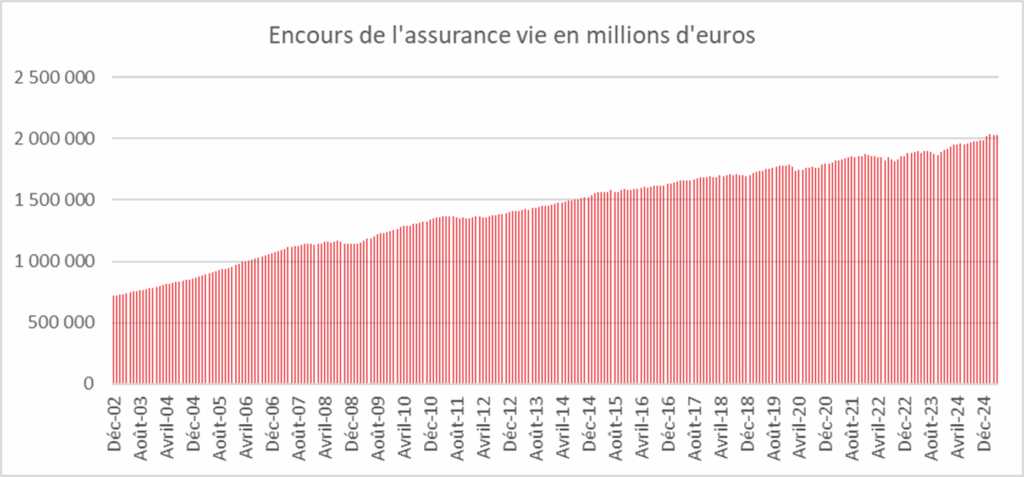
Cercle de l’Épargne – données France Assureurs
Niveau record du taux d’épargne en France au premier trimestre 2025
Le taux d’épargne des ménages s’est élevé, selon l’INSEE, en France au premier trimestre 2025 à 18,8 % du revenu disponible brut, en hausse de 0,3 point par rapport au dernier trimestre 2024. Hors période Covid, il faut remonter au troisième trimestre 1981 pour constater un taux d’épargne plus élevé.
Le taux d’épargne des ménages n’a, en France, pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %). La succession de chocs — Covid, guerre en Ukraine, vague inflationniste, crise politique, retour de Donald Trump — explique en partie cette propension à l’épargne. Le faible niveau de confiance des ménages ne les incite pas à consommer. Le montant élevé du déficit public conduit, par ailleurs, les ménages à épargner par crainte d’une augmentation des prélèvements (effet Ricardo-Barro ou équivalence ricardienne).
La désinflation n’a pas modifié le comportement des Français, pas plus que la hausse de leurs revenus. Au premier trimestre 2025, leur pouvoir d’achat a augmenté de 0,3 % (+0,1 % par unité de consommation). Dans le même temps, les ménages ont réduit leur consommation de 0,2 %, entraînant une hausse du taux d’épargne. C’est l’épargne financière qui bénéficie de cette progression, passant de 9,3 % à 9,8 % du revenu disponible brut entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Il faut remonter à 1950 pour retrouver (hors période Covid) un taux d’épargne financière plus élevé (10,7 % au deuxième trimestre 1950).
Cette hausse spectaculaire de l’épargne financière s’explique également par les craintes des Français concernant leur pouvoir d’achat à la retraite. Ils sont de plus en plus nombreux à épargner pour se constituer un complément de revenus ou de capital. Le vieillissement démographique joue en faveur de l’épargne. Ce phénomène est également observé en Allemagne, au Japon ou en Chine.
Une décrue significative du taux d’épargne ne pourra advenir qu’avec le retour de la confiance et d’une dynamique économique crédible. Mais le niveau de 2019 appartient sans doute déjà à l’histoire.
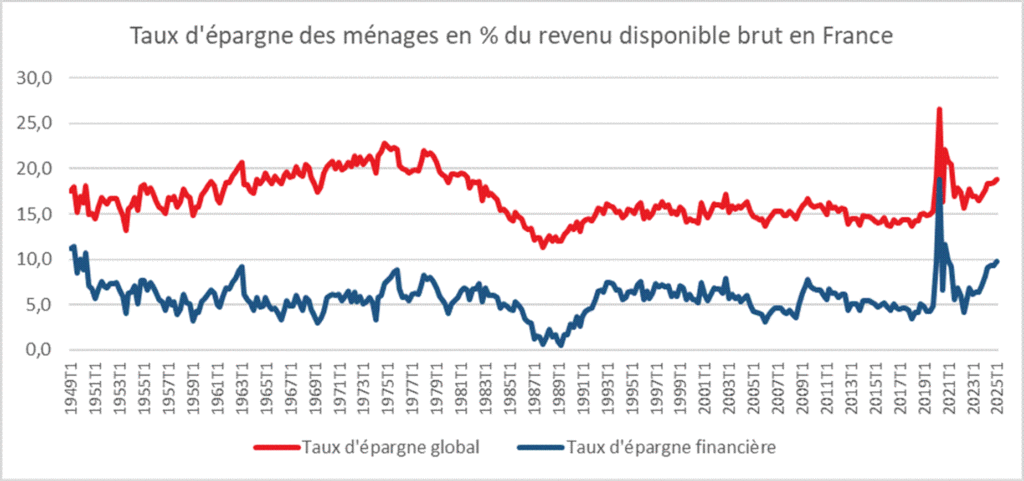
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Contacts presse
Niveau record de l’épargne en France au 1er trimestre 2025
L’épargne financière au sommet au 1er trimestre 2025
Le taux d’épargne des ménages s’est élevé, selon l’INSEE, en France au premier trimestre 2025 à 18,8 % du revenu disponible brut, en hausse de 0,3 point par rapport au dernier trimestre 2024. Hors période covid, il faut remonter au troisième trimestre de 1981 pour constater un taux d’épargne plus élevé.
Le taux d’épargne des ménages n’a en France, pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %). La succession de chocs, covid, guerre en Ukraine, vague inflationniste, crise politique, retour de Donald Trump, explique en partie cette propension à l’épargne. Le faible niveau de confiance des ménages, ces derniers, ne les incite pas à consommer. Le montant important du déficit public conduit, par ailleurs, les ménages à épargner par crainte d’une augmentation des prélèvements (effet Ricardo-Barro ou équivalence ricardienne).
La désinflation n’a pas modifié le comportements des Français ni même la hausse de leurs revenus. Au premier trimestre 2025, leur pouvoir d’achat a augmenté de 0,3 % (+0,1 % par unité de consommation). Dans le même temps, les ménages ont réduit leur consommation de 0,2 % entrainant la hausse du taux d’épargne. C’est l’épargne financière qui bénéficie de cette progression, passant de 9,3 à 9,8 % du revenu disponible brut du dernier trimestre 2024 au premier trimestre 2025. Il faut remonter à 1950 pour retrouver (hors période covid) un taux d’épargne financière plus élevé (10,7 % au deuxième trimestre 1950).
Cette hausse spectaculaire de l’épargne financière s’explique également par les craintes des Français en ce qui concerne leur pouvoir d’achat à la retraite. Ils sont de plus en plus nombreux à épargner pour se constituer un complément de revenus ou de capital à la retraite. Le vieillissement démographique joue en faveur de l’épargne. Ce phénomène est également constaté en Allemagne, au Japon ou en Chine.
Une baisse du taux d’épargne en France passe par une amélioration de la confiance et des perspectives de croissance. En revanche, il est peu probable qu’il ne retrouve son niveau de 2019.
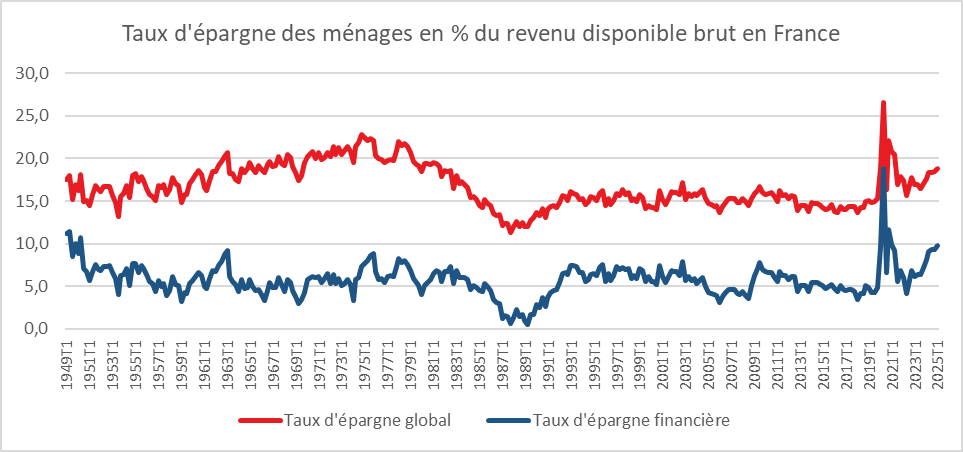
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Le Coin des Epargnants du 23 mai 2025 : Donald Trump a encore frappé !
Le retour de la guerre commerciale
Les investisseurs pensaient bénéficier d’une période de répit jusqu’au 9 juillet, date fatidique pour les négociations commerciales avec les États-Unis, avant que ces derniers n’appliquent des droits dits « réciproques », synonymes de droits majorés. Or, avec Donald Trump, rien n’est jamais acquis, et l’imprévisible est la règle.
L’Union européenne jugée coupable par Donald Trump
Vendredi 23 mai, le président américain a menacé l’Union européenne d’instaurer des droits de douane à hauteur de 50 %. Très remonté, le locataire de la Maison-Blanche a exprimé sur son réseau Truth Social son impatience à l’égard des négociations commerciales avec Bruxelles. Il a ainsi déclaré que ces négociations « ne mènent nulle part […] Il est très difficile de traiter avec l’UE, créée en premier lieu pour profiter des États-Unis d’un point de vue commercial. Je recommande d’imposer 50 % de droits de douane sur l’Union à compter du 1er juin ». Le républicain a également dénoncé les « barrières commerciales, la TVA, les sanctions injustifiées contre les entreprises américaines, les barrières non douanières, les manipulations monétaires, qui ont conduit à un déficit commercial de plus de 250 milliards de dollars par an, ce qui est totalement inacceptable ». Cette déclaration a provoqué une forte baisse des indices européens. Le CAC 40 a touché un plus bas à 7 620,40 points, en retrait de 3,1 %, avant de limiter ses pertes à 1,65 % en clôture, terminant la semaine à 7 734,40 points. Aucun secteur n’a été épargné : ni le luxe, ni l’automobile, ni la banque, ni la tech. L’indice allemand a également reculé, mais dans une moindre mesure. Les indices américains ont reculé de plus de 2 % effaçant une partie des gains de la semaine précédente.
Les menaces du Président américain ont eu pour effet d’effacer la hausse des taux des obligations souveraines, hausse enregistrée en début de semaine en raison des craintes de dérive budgétaire aux États-Unis, liées à l’adoption du budget fédéral.
L’euro résiste relativement bien, s’échangeant à 1,14 dollar, preuve que les investisseurs misent sur un accord, à terme, avec les Américains. Néanmoins, avec ces nouvelles tensions commerciales, l’or est reparti à la hausse.
Apple dans le viseur du Président américain
Donald Trump s’en est également pris, ce même 23 mai, à Apple, menaçant d’appliquer une surtaxe de 25 % si les iPhone ne sont pas fabriqués aux États-Unis. « Cela fait longtemps que j’ai informé Tim Cook d’Apple que je m’attendais à ce que les iPhone vendus aux États-Unis soient fabriqués aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si ce n’est pas le cas, Apple devra payer des droits de douane d’au moins 25 % aux États-Unis », a déclaré le président républicain.
De nouveaux records pour le bitcoin
Le bitcoin a battu dans la semaine un nouveau record. Il a fêté dignement les quinze ans de sa première transaction commerciale. Le 22 mai 2010, un programmeur floridien, Laszlo Hanyecz, réalisait, en effet, la première transaction commerciale connue en bitcoin, en échangeant 10.000 BTC contre deux pizzas. Jeudi 22 mai 2025, lors de cette date anniversaire désormais célébrée comme le « Bitcoin Pizza Day », l’actif numérique s’est échangé contre plus de 111 000 dollars. La commande de pizza vaudrait aujourd’hui plus de 1,1 milliard de dollars, contre les 41 dollars échangés en 2010.
Le bitcoin a connu ces dernières semaines une évolution en montage russe passant de 109 000 dollars, lors de l’investiture de Donald Trump à 80 000 dollars après les annonces de ce dernier sur les droits de douane au début du mois d’avril. Il est depuis porté le rétropédalage relatif du président américain et surtout par les apports réalisés par les institutionnels dans le cadre des fonds indiciels (ETF). Pour le seul mois de mai, plus de 4,2 milliards de dollars ont été injectés dans les fonds négociés en bourse aux Etats-Unis. La première des cryptoactifs profite du mouvement de dérégulation lancé par le Président américain. Le Genius Act, en cours d’examen au Sénat américain, propose un encadrement strict des stablecoins (cryptomonnaies adossées à des actifs traditionnels comme le dollar) : réserves obligatoires, supervision renforcée et cadre pour l’émission bancaire. Selon Standard Chartered, cette loi pourrait faire passer le marché des stablecoins de 240 milliards à 2 000 milliards de dollars d’ici à 2028. La banque JPMorgan Chase, longtemps prudente à l’égard des cryptoactifs, a annoncé début mai qu’elle autorisait désormais sa clientèle à acheter directement du bitcoin via sa plateforme.
Sur le front de la conjoncture : léger mieux en Allemagne, moral en berne en France
Sur le plan de la conjoncture, en Allemagne, l’indice Ifo du climat des affaires pour le mois de mai s’améliore. L’indicateur progresse à 87,5 points, contre 86,9 en avril (87,4 points étaient attendus selon le consensus). En revanche, le climat des affaires en France se dégrade, tout comme le moral des consommateurs.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 23 mai 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 886,69 | -1,93 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 41 603,07 | -2,31 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 802,82 | -2,37 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 18 737,21 | -2,47 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 629,58 | -0,58 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 717,97 | +0,38 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 326,31 | -1,85 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 118,39 | -2,66 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 354,71 | +0,09 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,263 % | +0,001 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,571 % | -0,008 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,499 % | +0,070 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1359 | +1,52 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 364,82 | +3,34 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 64,95 | -1,04 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 109 608,36 | +5,87 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Placements verts : « je t’aime moi non plus » !
Si selon une étude de l’Autorité des Marchés Financiers de 2023, deux tiers des Français jugent nécessaire que leur épargne soit en phase avec les objectifs du développement durable, le passage à l’acte est plus difficile. Plus récemment, selon l’enquête de Toluna Harris Interactive réalisée pour le label ISR (pour investissement socialement responsable), publiée le 20 mai dernier, seulement 12 % des Français auraient déjà investi dans un produit d’épargne dit « responsable ». Une des raisons de ce faible score est la méconnaissance des produits « verts » par les Français. Seul « un Français sur cinq aurait déjà entendu parler de l’épargne responsable ». 73 % des sondés reconnaissent être « mal informés » sur ce type de produits. Les Français privilégient les placements connus et sans risque. 81 % du panel interrogé par l’institut Toluna Harris indique détenir un livret d’épargne réglementé, comme un Livret A, un Livret d’épargne populaire (LEP) ou un Livret de développement durable et solidaire (LDDS).
Plus de la moitié des salariés couverts par un produit d’épargne salariale en France
En 2023, 52,2 % des salariés du secteur privé non agricole sont, selon la Dares, le service statistique du ministère du Travail, couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne entreprise – PEE –, plan d’épargne retraite collectif – Perco). Ce taux est en baisse de 0,7 point par rapport à 2022. Ainsi, 10,2 millions de salariés sont couverts par au moins un de ces quatre dispositifs. Le PEE reste le plus répandu, avec 44,3 % des salariés couverts en 2023, une part quasiment stable sur un an. La participation aux résultats de l’entreprise concerne 38,1 % des salariés, en recul de 1,0 point. L’intéressement couvre 34,6 % des salariés (part stable), tandis que la diffusion du Perco, en légère hausse, atteint 26,7 % des salariés (+0,4 point).
Une couverture liée à la taille de l’entreprise
En 2023, dans les entreprises de moins de 50 salariés, moins d’un salarié sur cinq est couvert par au moins un dispositif (18,1 %), contre 46,6 % dans celles de 50 à 99 salariés et 89,4 % dans celles de 1 000 salariés ou plus. Dans les très grandes entreprises, 95,6 % des salariés sont couverts. Le taux de couverture a diminué dans les plus petites structures (-1,8 point dans celles de moins de 50 salariés). Cette baisse peut s’expliquer par la forte croissance des créations d’entreprises ces dernières années. Les TPE, notamment au cours de leurs premières années, sont peu enclines à mettre en place des dispositifs d’épargne salariale.
Plus les entreprises versent des salaires élevés, plus la couverture en dispositifs d’épargne salariale est élevée. Elle atteint 68,4 % dans les entreprises où le salaire moyen est supérieur au 7e décile (soit 32 316 euros bruts). Dans les entreprises où le salaire moyen est inférieur au 3e décile (19 663 euros bruts), elle est de 23,6 %.
Près de 9 millions de bénéficiaires en 2023
En 2023, plus de 8,9 millions de salariés ont perçu une prime de participation ou d’intéressement au titre de l’exercice ou ont bénéficié d’un abondement sur leur PEE ou leur Perco. Ainsi, 45,2 % des salariés du secteur privé ont reçu une prime liée à l’épargne salariale, en recul de 1,1 point sur un an. Parmi les salariés couverts par au moins un dispositif, 86,7 % ont été concernés.
Le montant total des primes s’élève à 26,7 milliards d’euros bruts (y compris CSG et CRDS), en hausse de 0,4 milliard d’euros dans un contexte d’inflation persistante. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, environ 350 000 personnes ont bénéficié d’une prime en 2023, soit 9,4 % des effectifs. Le montant total de ces primes atteint 0,8 milliard d’euros bruts. Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, 8,5 millions de salariés ont bénéficié d’une prime ou d’un abondement en 2023, contre 8,4 millions en 2022. Le montant global atteint 25,9 milliards d’euros bruts, un nouveau record.
L’intéressement et l’abondement en hausse
En 2023, 5,6 millions de salariés d’entreprises de 10 salariés ou plus ont perçu une prime d’intéressement. Le nombre de bénéficiaires augmente légèrement par rapport à 2022 (+0,7 %, après +3,4 % en 2022). Les sommes versées au titre de l’intéressement atteignent 11,6 milliards d’euros bruts, en hausse de 1,8 %, et représentent 4,8 % de la masse salariale des bénéficiaires. Les entreprises ont également versé 2,0 milliards d’euros bruts d’abondement sur les PEE et 0,8 milliard sur les Perco. En 2023, 2,5 millions de salariés ont bénéficié d’un abondement sur leur PEE et 1,2 million sur leur Perco, représentant respectivement 1,7 % et 1,2 % de la masse salariale. Le complément de rémunération issu de ces dispositifs atteint en moyenne 3 039 euros bruts par bénéficiaire, après 2 920 euros en 2022.
Des sommes majoritairement placées
Les salariés peuvent choisir de percevoir immédiatement les sommes issues de la participation et de l’intéressement, ou de les placer sur un plan d’épargne ou un compte courant bloqué (pour la participation). En 2023, dans les entreprises de 10 salariés ou plus, les sommes perçues immédiatement atteignent 4,1 milliards d’euros nets pour la participation comme pour l’intéressement. Les sommes placées atteignent respectivement 6,2 et 6,4 milliards d’euros nets.
Les versements cumulés des salariés et des entreprises représentent 13,4 milliards d’euros nets (après CSG et CRDS), en forte progression pour la deuxième année consécutive (+10,4 %, après +17,0 % en 2022). Ces montants proviennent à 72,4 % des primes versées au titre de l’exercice 2022.
En 2023, 1,6 million de salariés ont épargné sur un Perco, pour un montant total de 2,9 milliards d’euros nets (+9,0 % sur un an). Les primes issues de l’exercice 2022 représentent 47,3 % des versements sur les Perco. La part des versements volontaires des salariés s’élève à 18,1 %.
L’épargne salariale confirme, en 2023, son rôle structurant dans la rémunération différée des salariés du secteur privé, avec des montants distribués en progression et une diffusion encore très liée à la taille et à la richesse des entreprises. Si la baisse du taux de couverture dans les petites structures témoigne des difficultés persistantes à démocratiser ces dispositifs, la stabilité, voire la hausse, des montants versés souligne leur ancrage dans les pratiques des entreprises établies. L’essor des plans d’épargne retraite collectifs, traduit un intérêt croissant des salariés pour une gestion de long terme de leur épargne, en lien avec les enjeux de pouvoir d’achat à la retraite. Reste que les inégalités d’accès, sociales comme sectorielles, appellent à des mesures d’incitation ciblées pour favoriser l’extension de ces outils aux publics les plus éloignés de la culture d’épargne en entreprise.
Livret A : une décollecte printanière
Livret A : touché mais pas coulé
Le Livret A, avec une décollecte de 200 millions d’euros, enregistre sa première sortie nette de fonds depuis le mois d’octobre dernier. Cette décollecte s’inscrit dans le processus d’atterrissage amorcé depuis l’annonce de la baisse de son taux de rémunération. La collecte avait été de 400 millions d’euros en mars et de 940 millions d’euros en février. Sur les quatre premiers mois de l’année 2025, la collecte atteint seulement 1,53 milliard d’euros, contre 7,64 milliards d’euros sur la même période de 2024.
Le résultat d’avril 2025 peut néanmoins surprendre : le quatrième mois de l’année est généralement favorable au Livret A. La collecte moyenne d’avril sur les dix dernières années s’élève à 1,929 milliard d’euros. En avril 2024, elle avait atteint 1,48 milliard d’euros. Depuis 2009, une seule décollecte avait été enregistrée au mois d’avril, en 2015, avec -170 millions d’euros. La collecte la plus élevée pour un mois d’avril reste celle de 2020, en plein confinement, avec 5,47 milliards d’euros.
Le Livret A continue d’être affecté par l’effet taux. Les ménages redéploient une partie de leur épargne de précaution vers des produits de long terme comme l’assurance vie, qui connaît un net rebond depuis le début de l’année. Cet ajustement est logique après plusieurs années de versements massifs sur le Livret A, dont l’encours est passé de 298 à 444 milliards d’euros.
L’encours du Livret A s’établit, après cette décollecte, à 444 milliards d’euros.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) fait bande à part
Contrairement au Livret A, le LDDS affiche une collecte positive en avril, avec +310 millions d’euros. Cela s’explique par sa fonction d’antichambre des comptes courants : les ménages y gèrent leur trésorerie en temps réel, tandis que le Livret A reste davantage perçu comme un produit d’épargne à moyen ou long terme.
La collecte du LDDS en avril 2025 s’élève à 310 millions d’euros, contre 400 millions en mars et 760 millions en avril 2024. Elle reste néanmoins inférieure à la moyenne des dix dernières années (586 millions d’euros). Sur les quatre premiers mois de l’année 2025, la collecte cumulée atteint 2,11 milliards d’euros, contre 3,68 milliards sur la même période en 2024.
L’encours du LDDS atteint un nouveau record en avril 2025, à 162,7 milliards d’euros.
Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) : forte décollecte sur fond de régularisation
Le Livret d’Épargne Populaire connaît une décollecte marquée, à hauteur de 1,96 milliard d’euros. En avril 2024, il avait déjà enregistré une décollecte de 270 millions d’euros. Ces sorties s’expliquent par les vérifications annuelles des conditions d’éligibilité effectuées par les banques : elles doivent clôturer les LEP des épargnants dont le revenu fiscal de référence dépasse le plafond autorisé. Les revenus pris en compte pour 2025 sont ceux de 2023, année marquée par de fortes revalorisations salariales, notamment du SMIC.
La collecte cumulée sur les quatre premiers mois de l’année est négative de 1,37 milliard d’euros, contre une collecte positive de 3,99 milliards sur la même période en 2024.
Les ménages modestes réagissent rapidement aux variations de taux, passé de 4 % à 3,5 % le 1er février dernier.
L’encours du LEP s’établit ainsi, fin avril, à 80,8 milliards d’euros, contre 82,8 milliards fin mars.
Vers une baisse du taux du Livret A et du LEP en août prochain
Les deux composantes entrant dans le calcul du taux du Livret A — le taux €STR et l’inflation — sont orientées à la baisse. Sur la base des données disponibles pour les quatre premiers mois de 2025, le taux du Livret A pourrait être ramené de 2,4 % à 1,5 %.
Le taux du LEP pourrait, quant à lui, passer de 3,4 % à 2 %. Toutefois, ces dernières années, le gouvernement n’a pas toujours appliqué strictement la formule, préférant maintenir un avantage pour l’épargne populaire. Un taux de 2,5 % paraît ainsi plus probable.
Le Coin des Epargnants : les marchés toujours dans le tempo de Donald Trump
A ne plus savoir sur quel pied danser
Les investisseurs oscillent entre espoirs et désillusions… D’un côté, ils ont accueilli favorablement la désescalade des droits de douane entre la Chine et les États-Unis, ainsi que l’amorce d’un dialogue entre Russes et Ukrainiens en Turquie. De l’autre, ils restent circonspects quant aux résultats des négociations, tant commerciales que militaires, actuellement en cours.
Sur le front de la guerre commerciale, la proposition américaine d’un relèvement à 30 % des droits sur les importations chinoises a été perçue comme un levier de négociation. L’accord trouvé entre Washington et Pékin a temporairement réduit les craintes d’une récession mondiale et a contribué à la forte progression des indices actions américains. Néanmoins, les investisseurs prennent conscience que Donald Trump, avec ses mesures protectionnistes, a profondément modifié les règles du commerce international. La taxe moyenne sur les importations aux États-Unis atteint son plus haut niveau depuis 1934, en dépit d’une trêve de 90 jours. Par ailleurs, beaucoup redoutent que les accords commerciaux nécessaires ne puissent être finalisés avant la date butoir du 9 juillet. Les États-Unis doivent en effet renégocier avec plus de 150 pays. Pour accélérer ce processus, Donald Trump n’hésite pas à souffler le chaud et le froid, en laissant entendre qu’il pourrait de nouveau relever les tarifs douaniers.
Le début des discussions entre Russes et Ukrainiens, sous l’œil attentif des Américains, en Turquie, constitue une première étape. Il souligne toutefois l’ampleur du chemin restant à parcourir avant un éventuel accord.
Dans ce contexte, les marchés actions ont progressé. Le CAC 40 a gagné plus de 1,5 % sur la semaine, tandis que la hausse a été plus marquée encore aux États-Unis. Le S&P 500 a progressé de plus de 5 % et le Nasdaq de près de 7 %. Le bitcoin, bénéficiant de la hausse des valeurs technologiques, dépasse désormais les 104 000 dollars.
La confiance des ménages américains au plus bas depuis juin 2022
Après trois années de montagnes russes tarifaires, le moral des consommateurs américains est en forte baisse. L’indice préliminaire de confiance, établi par l’université du Michigan, est tombé en mai à 50,8 points – son deuxième niveau le plus bas jamais enregistré, après celui de juin 2022 – contre 52,2 en avril. Le consensus anticipait pourtant une légère amélioration. Près de trois quarts des personnes interrogées mentionnent spontanément la question des droits de douane, y compris dans les rangs républicains. L’enquête a été menée essentiellement avant l’accord conclu avec la Chine. Les consommateurs anticipent une inflation moyenne de 4,6 % au cours des cinq à dix prochaines années, un niveau record depuis 1991.
Le Royaume-Uni, champion de la croissance au sein du G7
Depuis le Brexit, jamais le Royaume-Uni n’avait retrouvé la première place des économies du G7 en matière de croissance. Au premier trimestre 2025, il met un terme à cette disette avec une croissance de 0,7 % sur trois mois, contre 0,1 % au trimestre précédent, selon l’Office national des statistiques (ONS).
Cette performance s’explique « en grande partie par les services, bien que la production de biens ait également rebondi de manière significative après une période de ralentissement ». Les investissements des entreprises repartent à la hausse, et le commerce extérieur contribue positivement à la croissance.
Le deuxième trimestre devrait être moins dynamique, en raison des tensions commerciales mondiales, malgré l’accord signé avec les États-Unis. Sur l’ensemble de l’année 2025, le Royaume-Uni pourrait afficher une croissance autour de 1 %.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 16 mai 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 886,69 | +1,67 % % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 42 654,74 | +3,33 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 958,38 | +5,14 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 19 211,10 | +6,96 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 749,21 | +0,89 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 684,56 | +1,48 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 309,74 | +0,47 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 777,65 | +2,48 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 364,92 | +1,50 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,262 % | -0,003 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,580 % | +0,030 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,429 % | +0,071 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1133 | -2,07 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 184,22 | -7,31 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 65,39 | +2,17 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 104 026,84 | +1,00 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Investissements internationaux : la France malgré tout attractive
En 2024, malgré la crise politique survenue au mois de juin, la France est restée, selon le baromètre du cabinet EY, le pays européen le plus attractif en matière d’investissements internationaux.
L’an passé, le nombre de projets internationaux sur le sol européen a reculé, en raison notamment de la concurrence accrue des États-Unis. Ces derniers attirent les entreprises étrangères grâce au programme d’incitations fiscales connu sous le nom d’Inflation Reduction Act (IRA) mis en place par Joe Biden. Si la France a enregistré une baisse notable des investissements étrangers, elle est néanmoins parvenue à conserver la première place en Europe. En 2024, les décisions d’investissements internationaux sur son sol ont diminué de 14 %, avec 1 025 projets recensés. L’Allemagne a connu un recul de 17 % (607 projets), et le Royaume-Uni de 13 % (853 projets).
Les projets allemands en France ont chuté de 34 %. Les États-Unis, premier investisseur dans l’Hexagone, ont réduit leurs investissements de 12 %, tout comme la Chine (-11 %). L’image de la France, malgré les tensions politiques et les déséquilibres budgétaires, demeure globalement positive. À trois ans, 70 % des investisseurs interrogés considèrent que l’attractivité du pays s’améliorera ; un chiffre en baisse de 5 points sur un an.
La France conserve plusieurs atouts majeurs : sa position géographique centrale, son énergie décarbonée, et la qualité de ses infrastructures. Elle bénéficie également d’une bonne image dans des secteurs d’avenir comme la défense, le quantique et l’intelligence artificielle. Lors du sommet sur l’IA, un programme d’investissement de 109 milliards d’euros a été annoncé en février.
Concernant l’implantation d’usines, un quart des investissements internationaux en Europe en 2024 ont été réalisés en France (415 projets, dont 74 dans l’énergie). Toutefois, les investissements industriels portés par des capitaux étrangers ont reculé de 22 % par rapport à 2023, en raison notamment des difficultés rencontrées dans des secteurs comme la chimie et l’automobile.
Dans les faits, les projets menés par des investisseurs étrangers sont majoritairement des extensions ou des réaménagements d’installations existantes. Seuls 15 % des projets relèvent de créations ex nihilo. De plus, ces investissements génèrent peu d’emplois : 29 000 créations annoncées pour 2024, soit une baisse de 27 % par rapport à 2023. En moyenne, chaque projet d’investissement en France crée 30 emplois, contre 48 au Royaume-Uni et en Allemagne, et 125 en Espagne. Ce faible contenu en emplois s’explique notamment par le coût du travail et la complexité des règles sociales.
D’après Rexecode, en 2024, le coût horaire du travail en France dans l’industrie et les services s’élevait à 44,11 euros, contre 43,97 euros en Allemagne, 25,79 euros en Espagne et 16,70 euros en Pologne. Ces deux derniers pays ont enregistré une progression significative des projets d’investissements internationaux (+15 % pour l’Espagne, +13 % pour la Pologne).
La France reste en tête en Europe pour l’accueil de centres de R&D, même si le nombre de projets y a baissé de 15 %. En revanche, pour l’implantation des sièges sociaux, elle reste nettement devancée par le Royaume-Uni. Malgré le Brexit et les efforts des autorités françaises, la place financière de Paris ne parvient pas à concurrencer celle de Londres.
Si la France conserve sa première place en Europe en matière d’attractivité pour les investissements étrangers, ce leadership est désormais plus fragile. La baisse du nombre de projets, leur moindre intensité en emploi et la faible part des créations ex nihilo traduisent un essoufflement structurel. Plusieurs freins pèsent encore sur l’attractivité française : l’accès au foncier, le coût de l’énergie, le niveau de qualification moyen des actifs, et la faible robotisation des sites industriels. L’atonie de la croissance économique et de la consommation intérieure constitue également un sujet d’inquiétude. À l’heure où la compétition mondiale s’intensifie, notamment sous l’effet des stratégies offensives des États-Unis et des pays d’Europe centrale, la France doit impérativement lever les freins persistants : complexité administrative, coût du travail, faible productivité industrielle. Le pari d’une montée en gamme dans les secteurs d’avenir, comme l’intelligence artificielle, la défense ou l’aéronautique, ne pourra être gagné sans un effort en matière de formation, d’innovation et d’efficacité de l’action publique.
Le Coin des Epargnants du 10 mai 2025 : les marchés, les yeux rivés sur les négociations commerciales
Donald Trump, avec le pacte commercial signé avec le Royaume-Uni, a suscité un petit vent d’optimisme sur les marchés financiers.
Ce premier accord témoigne de la volonté de Washington de sortir de la spirale des droits de douane, même si, dans les faits, les tarifs appliqués aux États-Unis resteront à des niveaux supérieurs à ceux en vigueur avant le retour de Donald Trump au pouvoir. Ce dernier s’est félicité que le Royaume-Uni s’ouvre davantage aux produits américains, pour plusieurs milliards de dollars. De son côté, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a évoqué un accord « extrêmement important », notamment pour l’industrie automobile. Les constructeurs britanniques sont en effet autorisés à exporter 100 000 voitures vers les États-Unis avec une taxe réduite à 10 %, contre un taux de 27,5 % auparavant. La taxe plancher de 10 % annoncée le 2 avril sur l’ensemble des marchandises reste toutefois en vigueur.
Le Royaume-Uni, l’un des rares pays à afficher une balance commerciale équilibrée avec les États-Unis, demeure un cas particulier en raison des liens historiques unissant les deux nations. Donald Trump entend par ailleurs éviter un rapprochement entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, dont il reste un adversaire résolu. Il est, en effet, un fervent soutien du Brexit.
Autre signe encourageant : une réunion officielle entre représentants américains et chinois est prévue le samedi 10 mai. Il s’agit de la première rencontre depuis l’escalade tarifaire entre les deux pays. Donald Trump viserait à ramener les droits de douane de 145 % à 80 %. Plusieurs séances de travail seront nécessaires pour rapprocher les positions des deux premières puissances économiques mondiales.
La situation commerciale, en cette fin de printemps, reste contrastée. Les exportations totales chinoises ont augmenté de 8,1 % en avril sur un an, bien au-delà des prévisions des économistes. En revanche, celles à destination des États-Unis ont chuté de 21 % sur un an. Les entreprises chinoises ont redirigé leurs flux commerciaux vers d’autres marchés. Les exportations vers l’Inde et les dix pays de l’ASEAN ont progressé de plus de 20 %, tandis que celles vers l’Union européenne ont augmenté de 8 %. Les importations de biens américains en Chine, quant à elles, ont diminué de près de 14 %. Faute de produits de substitution, les importateurs américains continuent à acheter chinois, tout en s’acquittant des droits de douane.
En clôture, vendredi 9 mai, le CAC 40 a terminé à 7 743,75 points. Sur la semaine, il cède 0,34 %. À Francfort, le DAX a inscrit un nouveau record, avec un gain de près de 2 %. Les investisseurs anticipent par ailleurs une nouvelle baisse des taux directeurs de la part de la Banque centrale européenne. Les grands indices américains sont restés stables cette semaine. Les marchés demeurent prudents, dans l’attente de précisions sur le contenu des négociations américano-chinoises.
Le bitcoin a franchi, cette semaine, à nouveau la barre des 100 000 dollars. Son cours a été porté par l’accord commercial entre Washington et Londres, qui rassure les investisseurs sur les actifs risqués, comme les cryptomonnaies. Le bitcoin avait atteint son record historique à 109 000 dollars le 20 janvier, jour de l’investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. La chute des valeurs technologiques et des prises de bénéfice a provoqué un repli du bitcoin de près de 20 % en quelques semaines.
Le cours du pétrole a légèrement augmenté avec la signature de l’accord américano-britannique. En cas de multiplication d’accords commerciaux, le ralentissement de la croissance serait plus faible ce qui serait favorable à la demande de pétrole.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 9 mai 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 743,75 | -0,34 % % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 41 249,38 | -0,15 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 659,91 | -0,28 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 17 928,92 | -0,23 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 499,32 | +1,73 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 554,80 | -0,51 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 309,74 | +0,47 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 503,33 | +4,64 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 342,00 | +1,38 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,265 % | +0,018 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,550 % | +0,020 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,358 % | +0,042 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1265 | -0,99 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 339,85 | +0,58 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 63,58 | +3,45 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 102 779,95 | +6,52 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Taux de rémunération des dépôts bancaires : toujours en baisse
En mars 2025, la rémunération moyenne des encours de dépôts bancaires des ménages et des sociétés non financières (SNF) a, selon la Banque de France, diminué de 3 points de base (pb) par rapport à février 2025 et s’établit à 1,56 %.
Si la rémunération des dépôts des ménages reste stable (-1 pb entre février et mars à 1,62 %) elle diminue de -7 pb pour les SNF à 1,42% sous l’effet notamment de la baisse du taux des dépôts à terme à moins de deux ans de -15 pb. Le taux de rémunération des livrets ordinaires des ménages était de 0,84 % en mars pour les particuliers.
Les taux de rémunération sur les contrats nouveaux poursuivent par ailleurs leur repli pour les ménages comme pour les SNF, les baisses étant là aussi les plus marquées pour les dépôts à terme à moins de deux ans (-15 pb entre février et mars pour les ménages et -16 pb pour les SNF).
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération des dépôts | Contrats nouveaux (Mds€) | Taux de rémunération sur contrats nouveaux | |||||
| mars- 2025 (p) | mars- 2024 | févr- 2025 (r) | mars- 2025 (p) | mars- 2025 (p) | mars- 2024 | févr- 2025 (r) | mars- 2025 (p) | |
| Dépôts bancaires des Ménages et SNF | 2 586 | 1,87 | 1,59 | 1,56 | ||||
| dont Ménages | 1 875 | 1,88 | 1,63 | 1,62 | ||||
| dont : – dépôts à vue (b) | 542 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ||||
| – livrets à taux réglementés (b,c) | 719 | 3,18 | 2,49 | 2,49 | ||||
| dont : livret A | 403 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | ||||
| – livrets ordinaires | 216 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | ||||
| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 84 | 3,57 | 2,92 | 2,86 | 14 | 3,69 | 2,51 | 2,36 |
| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 101 | 2,14 | 2,37 | 2,35 | 2 | 3,46 | 2,67 | 2,55 |
| – plan d’épargne-logement | 214 | 2,61 | 2,63 | 2,63 | 1 | 2,22 | 1,75 | 1,74 |
| dont SNF | 710 | 1,82 | 1,49 | 1,42 | ||||
| dont : – dépôts à vue (b) | 482 | 0,79 | 0,61 | 0,57 | ||||
| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 153 | 4,01 | 3,26 | 3,11 | 38 | 3,81 | 2,71 | 2,55 |
| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 75 | 3,53 | 3,40 | 3,42 | 2 | 3,88 | 3,05 | 2,94 |
| Pour mémoire : | ||||||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 4,50 | 2,90 | 2,65 | |||||
| Euribor 3 mois (e) | 3,92 | 2,53 | 2,44 | |||||
| Rendement du TEC 2 ans (e), (f) | 2,93 | 2,25 | 2,29 | |||||
| Rendement du TEC 5 ans (e), (f) | 2,67 | 2,64 | 2,80 | |||||
Banque de France
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
d. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
e. Moyenne mensuelle.
f. Taux de l’Échéance Constante 2 ans et 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
r. Données révisées.
p. Données provisoires.
Le Coin des Epargnants du 2 mai 2025 : petit mieux sur les marchés
Les investisseurs ont choisi d’être optimistes en ce début de mois de mai. La publication des chiffres de l’emploi aux États-Unis les a rassurés. Le marché du travail ralentit outre-Atlantique, mais moins fortement que prévu.
Les créations d’emplois non agricoles pour le mois se sont établies à 177 000, en baisse par rapport au chiffre révisé de 185 000 en mars, selon les données du Bureau des statistiques du travail du Département du Travail publiées vendredi. Ce chiffre est supérieur aux attentes, les économistes anticipant seulement 138 000 créations d’emplois. En avril, le taux de chômage est resté stable à 4,2 % de la population active par rapport à mars. La croissance du salaire horaire moyen a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle, en dessous des 0,3 % enregistrés en mars. Les résultats de l’emploi devraient conforter la Réserve fédérale dans sa stratégie d’attentisme.
Les indices PMI d’activité en zone euro pour le mois d’avril avaient également rassuré les investisseurs vendredi 2 mai. La production manufacturière a augmenté au rythme le plus rapide en un peu plus de trois ans, tout en restant en zone de contraction, l’indicateur passant de 48,6 à 49 points. Les nouvelles commandes ont continué de diminuer, mais à un rythme moins soutenu qu’auparavant, la composante ressortant à 49,5 points, soit tout près de la stabilisation.
Le CAC 40 a gagné cette semaine près de 3 %, portant le gain depuis le 1er janvier à 4,7 %. L’indice allemand continue de progresser plus vite que son homologue français, avec une hausse de près de 4,5 % sur la semaine, portant sa progression à plus de 15 % depuis le début de l’année.
Sur le marché américain, les bons résultats trimestriels de Microsoft et Meta ont été positivement accueillis par les investisseurs. Ces derniers nourrissent des espoirs d’une éventuelle désescalade sur le front commercial. Le ministère chinois du Commerce a en effet déclaré être en train d’évaluer une offre de Washington en vue de négociations concernant les droits de douane imposés par Donald Trump. Les autorités chinoises ont néanmoins réaffirmé que Washington devrait supprimer tous les tarifs unilatéraux, affirmant que « si les États-Unis veulent discuter, ils doivent montrer leur sincérité et être prêts à corriger leurs mauvaises pratiques et à annuler ces surtaxes ».
Les investisseurs n’ont pas surinterprété le recul du PIB américain au premier trimestre, imputable à une forte croissance des importations, réalisées en anticipation du relèvement des tarifs douaniers. Les grands indices américains ont connu une semaine honorable, avec une progression autour de 3 %.
Les cours du pétrole ont baissé cette semaine. Le baril de Brent a perdu près de 8 % en cinq jours et s’échangeait, vendredi 2 mai, contre 61 dollars. Les prévisions de croissance de la production de l’Opep+ à compter du mois de juin ont pesé sur les cours. L’Arabie saoudite, membre le plus influent de l’Opep+, est passée d’un objectif de « stabilité du marché » à une véritable offensive sur les parts de marché, au moment où la demande pourrait être moins dynamique en raison du ralentissement de l’économie mondiale.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 2 mai 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 770,48 | +2,98 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 41 317,43 | +2,93 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 686,67 | +3,07 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 17 977,73 | +3,37 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 057,34 | +4,48 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 596,35 | +2,15 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 285,19 | +2,22 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 36 807,78 | +7,65 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 279,03 | -0,63 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,247 % | +0,060 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,530 % | +0,061 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,316 % | +0,049 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1322 | -0,07 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 235,30 | -3,51 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 61,35 | -7,95 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 97 357,93 | +3,40 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Assurance vie : un premier trimestre de haute tenue
L’assurance vie réussit la passe de trois au premier trimestre 2025
L’assurance vie a réalisé la passe de trois au cours du premier trimestre 2025, avec des collectes nettes supérieures à 4 milliards d’euros chaque mois. Les ménages plébiscitent ce placement qui, grâce à l’amélioration du rendement des fonds en euros, a retrouvé des couleurs. Ils réallouent une partie de l’épargne accumulée ces dernières années sur des produits de court terme, devenus moins rémunérateurs avec la baisse des taux.
Un mois de mars de haute tenue
La collecte nette a atteint 4,0 milliards d’euros en mars, après 5,8 milliards en février et 4,5 milliards en janvier. À titre de comparaison, elle s’élevait à 3,2 milliards d’euros en mars 2024. Il faut remonter à mars 2010 pour retrouver un niveau plus élevé sur ce mois, avec une collecte nette de 6,284 milliards d’euros — un record sur quinze ans.
Depuis 1997, seules trois décollectes nettes ont été enregistrées en mars : en 2020 (−1,842 milliard d’euros, en lien avec la crise du Covid), en 2017 (−9 millions d’euros) et en 2012 (−1,378 milliard d’euros, en lien avec la crise des dettes souveraines). Sur les dix dernières années, la collecte moyenne du mois de mars s’établit à environ 1 milliard d’euros. Celle de 2025 est donc quatre fois supérieure à cette moyenne décennale.
La collecte nette a été positive à hauteur de +3,4 milliards d’euros pour les supports en unités de compte (UC), et de +0,6 milliard pour les supports en euros. Ces derniers enregistrent ainsi deux collectes nettes consécutives, traduisant un retour en territoire positif.
Des cotisations dynamiques
Depuis plusieurs mois, l’assurance vie bénéficie de cotisations soutenues. Les ménages réaffectent une partie de leur épargne de court terme vers ce placement. En 2023 et 2024, ils avaient privilégié les dépôts à vue et les livrets réglementés, qui offraient des rendements attractifs. L’encours des dépôts à vue est passé de 406 milliards à plus de 500 milliards d’euros entre 2019 et 2023.
Avec la décrue des taux directeurs, ces placements deviennent mois après mois moins intéressants. La baisse du rendement du Livret A incite désormais les ménages à privilégier les placements de long terme, au premier rang desquels figure l’assurance vie.
En mars, le montant des cotisations brutes a atteint 15,5 milliards d’euros, un niveau record. En mars 2024, il avait déjà atteint un sommet comparable à 15,504 milliards d’euros.
Des prestations plutôt stables
Les prestations versées en mars 2025 se sont élevées à 11,5 milliards d’euros, contre 12,321 milliards en mars 2024. Elles demeurent relativement stables d’un mois sur l’autre. Le redémarrage encore lent du marché immobilier ne conduit pas les ménages à effectuer des retraits sur leurs contrats d’assurance vie pour financer l’achat d’un logement.
Un premier trimestre prometteur
Le contexte du premier trimestre 2025 a été porteur pour l’assurance vie. Avec un Livret A en perte d’attractivité, l’assurance vie s’impose comme le placement gagnant du premier trimestre. Sur les trois premiers mois, la collecte nette atteint 14,4 milliards d’euros, soit +5,6 milliards d’euros par rapport à la même période en 2024. Elle s’élève à +13,3 milliards pour les supports en UC, et à +1,1 milliard pour les supports en euros.
Depuis le début de l’année, les cotisations brutes s’élèvent à 49,8 milliards d’euros, en hausse de +1,9 milliard par rapport à la même période en 2024. Les prestations, quant à elles, atteignent 35,4 milliards d’euros, en baisse de −9 %, soit −3,7 milliards d’euros.
.
Un encours au-dessus des 2 000 milliards d’euros
L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 025 milliards d’euros à fin mars 2025, en hausse de +3,7 % sur un an.
L’assurance vie face à l’effet Trump
L’année 2025 a débuté sur les chapeaux de roue pour l’assurance vie, portée par le recul des rendements de l’épargne de court terme et la bonne tenue des marchés financiers. Mais les annonces du 2 mars dernier par Donald Trump concernant un relèvement des droits de douane rebattent en partie les cartes. Les marchés actions enregistrent de fortes variations au gré des déclarations du président américain, avec une tendance baissière. En revanche, les taux d’intérêt à long terme restent élevés, notamment en raison des besoins de financement croissants des États européens, en particulier dans le domaine de la défense.
Le climat économique et géopolitique anxiogène pourrait conduire certains ménages à se tourner à nouveau vers des placements de court terme, comme le Livret A. Toutefois, le taux de ce dernier devrait être abaissé à environ 1,7 % au 1er août prochain, ce qui pourrait limiter cet attrait.
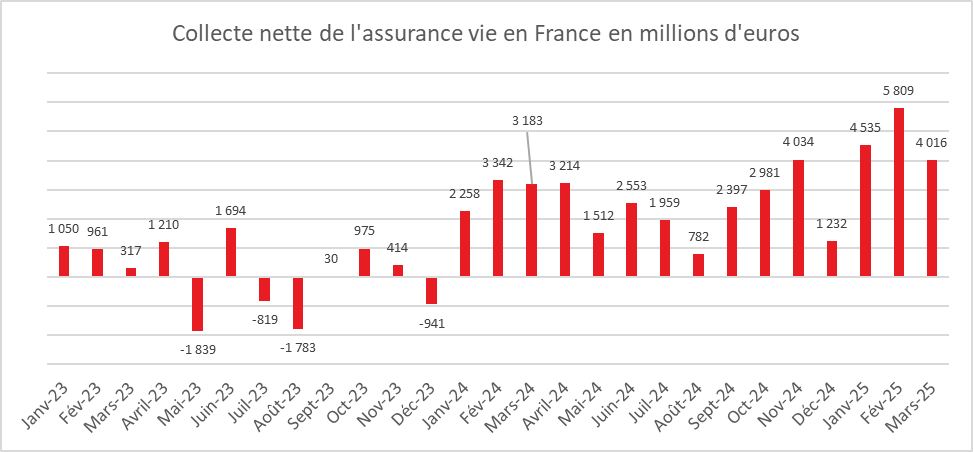
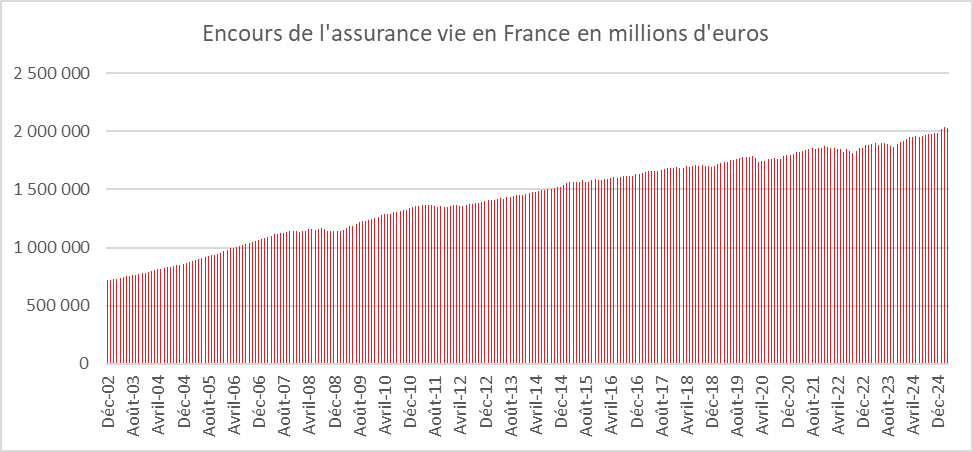
Données France Assureurs
Légère reprise du PIB, mais une croissance toujours fragile
Selon l’INSEE, le produit intérieur brut (PIB) en volume a progressé de 0,1 % au premier trimestre 2025, après un recul de 0,1 % au quatrième trimestre 2024. La croissance de l’économie française demeure fragile, plusieurs composantes étant en territoire négatif, comme l’investissement ou le commerce extérieur. La consommation reste atone, avec un fort repli des achats de biens en mars.
La demande intérieure finale (hors variations de stocks) a stagné au premier trimestre, après une hausse de 0,2 % au quatrième trimestre 2024. La consommation des ménages est restée stable sur les trois premiers mois de l’année, contre une hausse de 0,2 % fin 2024. La formation brute de capital fixe (FBCF) est à nouveau en baisse : -0,2 % après -0,1 %. Le commerce extérieur continue de peser sur la croissance, avec une contribution négative de -0,4 point, après -0,1 point. Les exportations ont diminué de 0,7 % (après +0,2 %), tandis que les importations ont progressé de 0,4 % (après +0,5 %). En revanche, les variations de stocks ont soutenu la croissance, contribuant pour +0,5 point (après -0,2 point).
Une production portée par l’industrie
La production totale (biens et services) a augmenté de 0,2 % au premier trimestre, après +0,1 % au trimestre précédent. Dans l’industrie manufacturière, la hausse atteint 0,4 %, après +0,1 %. Les industries agroalimentaires ont enregistré une forte progression (+1,6 % après +0,9 %), tirée par la fabrication de boissons. La production de matériels de transport est également en nette hausse (+1,4 % après +0,1 %), bien qu’elle reste inférieure de 5 % à son niveau de fin 2023. En revanche, la production recule dans les biens d’équipement (-0,8 % après +0,5 %), notamment dans la fabrication d’équipements électriques, ainsi que dans le raffinage (-3,2 % après +6,8 %). La production d’électricité est également en baisse ce trimestre.
La production de services marchands a progressé de 0,4 % après +0,1 %. Les services aux ménages enregistrent une hausse de 0,5 % (après -2,5 %), conséquence du contrecoup des Jeux olympiques et paralympiques. Les services aux entreprises progressent également (+0,6 % après +0,2 %), en lien avec l’amélioration de l’activité industrielle. À l’inverse, la construction poursuit son recul (-0,5 % après -0,7 %).
Une consommation des ménages étale
La consommation des ménages est restée stable au premier trimestre 2025, après une hausse de 0,2 %. Les achats de biens ont diminué de 0,6 % (après +0,1 %), pénalisés par la chute de la consommation de matériels de transport (-4,4 % après +2,6 %), impactée par la réduction du bonus écologique et le durcissement du malus.
La consommation alimentaire (y compris tabac) a reculé de 0,8 % (après +0,1 %), en partie à cause de la baisse des achats de tabac consécutive à la hausse des prix en janvier. Hors tabac, la consommation diminue également (-0,2 % après stabilité).
En revanche, les dépenses de services sont en hausse (+0,5 % après -0,1 %). Les services aux ménages progressent de 0,3 %, après un fort recul de 6,1 % au quatrième trimestre. Les services de transport augmentent de 1,0 % (après +0,4 %). À l’inverse, la consommation dans l’hébergement-restauration est moins dynamique (+0,2 % après +0,5 %), de même que dans l’information-communication (+0,5 % après +0,9 %).
Recul de l’investissement
La formation brute de capital fixe a reculé de 0,2 % au premier trimestre 2025, après -0,1 % fin 2024. L’investissement en construction poursuit sa baisse (-0,8 % après -0,9 %), tandis que celui en produits manufacturés repart à la baisse (-0,5 % après stabilité).
La FBCF en biens d’équipement chute de 1,6 % (après -0,3 %), tout comme celle en autres produits manufacturés (-1,1 % après -1,2 %). En revanche, l’investissement en matériels de transport reste dynamique (+1,3 % après +1,4 %).
Perspectives moroses pour 2025
L’objectif de croissance de 0,7 % pour 2025 fixé par le gouvernement apparaît difficile à atteindre. La tendance est au ralentissement, dans un contexte de commerce mondial perturbé par les mesures douanières initiées par Donald Trump. En France, les ménages restent prudents, freinés par les craintes d’une hausse du chômage, ce qui limite les dépenses importantes.
L’OFCE anticipe pour sa part une croissance de 0,5 % en 2025. La baisse récente des taux directeurs décidée par la Banque centrale pourrait soutenir une reprise progressive de l’investissement, sous réserve d’un allègement des incertitudes économiques et géopolitiques.
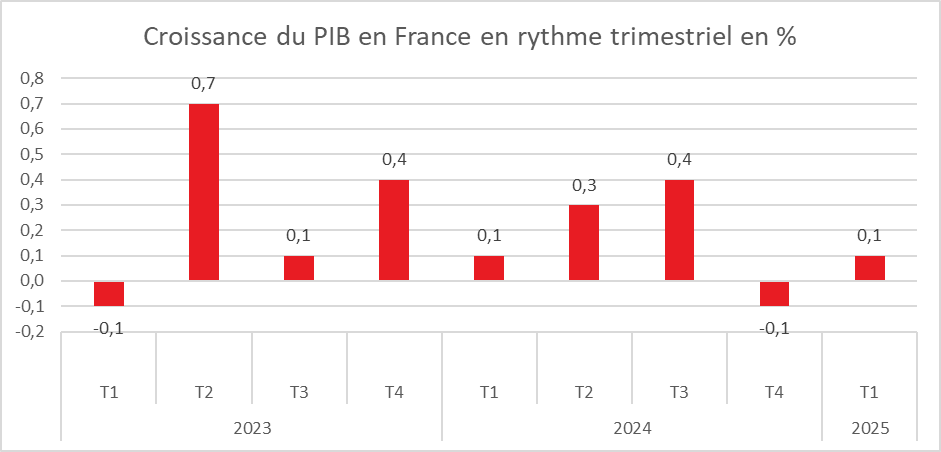
INSEE
Le Coin des Epargnants du 26 avril 2025 : Volatilité présidentielle à tous les étages
Accalmie sur le front de la guerre commerciale
Désescalade est le mot de la semaine. Après avoir menacé le président de la Réserve fédérale, Donald Trump a finalement déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le limoger. Après une escalade des droits de douane entre la Chine et les États-Unis, si la détente n’est pas encore pleinement d’actualité, l’heure semble être aux petits pas. Le gouvernement chinois envisagerait de suspendre ses droits de douane de 125 % sur certaines importations américaines, selon Bloomberg. Il pourrait notamment supprimer les prélèvements additionnels sur les équipements médicaux et certains produits chimiques industriels, comme l’éthane. La Chine réfute cependant, pour l’instant, mener toute négociation avec les États-Unis.
Par ailleurs, les États-Unis et la Corée du Sud pourraient parvenir à un protocole d’entente dès la semaine prochaine. La Corée du Sud, allié clé de Washington, pourrait être soumise à des droits de douane de 25 % sur certaines importations, temporairement ramenés à 10 % pendant la « pause » de 90 jours décrétée par Donald Trump. S’y ajouteraient des taxes de 25 % sur les livraisons de voitures, d’acier et d’aluminium. Des progrès significatifs auraient également été réalisés avec l’Inde, pays où Apple prévoit de transférer l’assemblage de l’ensemble de ses iPhone d’ici 2026.
La Bourse de Paris a enchaîné quatre séances consécutives de hausse cette semaine, terminant à 7 536,26 points. Le CAC 40 affiche désormais une progression d’environ 2 % depuis le 1er janvier. Surtout, depuis son point bas du 7 avril, atteint quelques jours après l’annonce des nouveaux droits « réciproques » par Donald Trump, l’indice a repris près de 9 %. D’autres indices européens font encore mieux : le DAX allemand a progressé de plus de 4 % cette semaine, portant sa hausse depuis le début de l’année à plus de 11 %.
Aux États-Unis, les indices ont pleinement profité des inflexions du président américain sur les droits de douane et de ses déclarations sur l’indépendance de la banque centrale. Le Nasdaq a gagné plus de 7 % sur la semaine et le S&P 500 plus de 6 %.
Sur le plan de la politique monétaire, des membres de la Réserve fédérale commencent à infléchir leur position, préoccupés par l’impact potentiel des tensions commerciales sur l’emploi. Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a estimé qu’une baisse des taux pourrait être envisagée dès le mois de juin, sous réserve de données économiques allant dans ce sens. L’activité sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux indique désormais une probabilité d’environ 60 % d’une détente monétaire dans deux mois. Une éventuelle baisse des taux qui réjouirait Donald Trump, qui la réclame avec insistance depuis plusieurs semaines.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 25 avril 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 536,26 | +2,93 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 40 113,50 | +2,25 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 525,21 | +7,12 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 17 382,94 | +6,64 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 22 242,45 | +4,43 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 415,25 | +1,04 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 154,12 | +3,87 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 35 705,74 | +5,17 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 295,06 | +0,71 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,187 % | -0,052 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,469 % | +0,002 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,267 % | -0,062 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1371 | -0,18 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 283,10 | -1,69 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 66,81 | -1,08 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 95 531,7 | +9,25 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Petit mois de mars pour le Livret A
Le Livret A est touché par l’effet taux mais conserve néanmoins une collecte positive en mars. Les ménages se détournent de ce placement depuis l’annonce du passage de son taux de rémunération de 3 % à 2,4 %. Compte tenu du niveau de l’inflation (0,8 % en février et en mars), ainsi que de la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne, une nouvelle diminution de son taux de rémunération est probable au 1er août prochain.
Une collecte modeste mais positive
Le Livret A, avec une collecte de 400 millions d’euros, enregistre en mars 2025 son plus mauvais mois de mars depuis 2016 (310 millions d’euros). Ce résultat tranche avec ceux des années précédentes : en mars 2024, le Livret A avait bénéficié d’une collecte de 1,53 milliard d’euros, et en 2023 de 4,17 milliards d’euros. La collecte de mars 2025 s’inscrit dans le processus de décélération constaté depuis le début de l’année. En février, la collecte s’élevait à 940 millions d’euros, et en janvier à 350 millions d’euros.
Sur le premier trimestre 2025, la collecte atteint 1,73 milliard d’euros, contre 8,91 milliards d’euros sur la même période en 2024.
La collecte de mars 2025 pour le Livret A est nettement inférieure à sa moyenne des dix dernières années (2 milliards d’euros).
En mars, le Livret A bat néanmoins un nouveau record d’encours avec 444,2 milliards d’euros.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) mieux que le Livret A
Le LDDS fait mieux que le Livret A en mars, avec une collecte de 610 millions d’euros, soit un montant proche de celui de février (640 millions d’euros). Ce résultat reste néanmoins inférieur à celui de mars 2024 (910 millions d’euros). Sur les trois premiers mois de l’année, le LDDS enregistre une collecte de 1,81 milliard d’euros, contre 2,92 milliards d’euros sur la même période en 2023. La collecte de mars 2025 est assez proche de la moyenne de ses dix dernières années (700 millions d’euros). Aucune décollecte n’a été enregistrée au mois de mars pour le LDDS.
L’encours du LDDS atteint, avec 162,4 milliards d’euros, un nouveau record.
Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) : une érosion de la collecte
Comme le Livret A et le LDDS, le Livret d’Épargne Populaire est en repli en mars, avec une collecte de 140 millions d’euros, contre 350 millions d’euros en février. Cette collecte est en net retrait par rapport à celle de mars 2024 (950 millions d’euros).
Avec un encours de 82,8 milliards d’euros, le LEP atteint néanmoins un plus haut historique.
Une indéniable normalisation de l’épargne réglementée
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la baisse de la collecte du Livret A en ce début d’année. La diminution du taux de rémunération conduit les ménages à réorienter leur épargne vers d’autres placements, notamment l’assurance vie, qui connaît un excellent début d’année. Par ailleurs, certaines rumeurs évoquant une mobilisation de l’épargne pour financer la défense, perçue comme une forme de prélèvement, ont pu jouer en sa défaveur. Enfin, le nombre de Livrets A plafonnés a fortement augmenté ces dernières années (environ 13 %), ce qui pousse les épargnants disposant de liquidités à se tourner vers d’autres produits.
La baisse de la collecte du Livret A ne semble pas, en revanche, traduire un arbitrage en faveur de la consommation.
Une baisse des taux de rémunération attendue le 1er août 2025
Les deux composantes utilisées pour calculer le taux du Livret A — le taux ester et le taux d’inflation — sont orientées à la baisse. Compte tenu des données des trois premiers mois de l’année, le taux du Livret A pourrait passer de 2,4 % à 1,7 %.
Le taux du Livret d’Épargne Populaire pourrait quant à lui baisser de 3,4 % à 2,3 %. Pour ce dernier, le gouvernement n’a pas appliqué strictement la formule ces dernières années, préférant donner un avantage à l’épargne populaire.
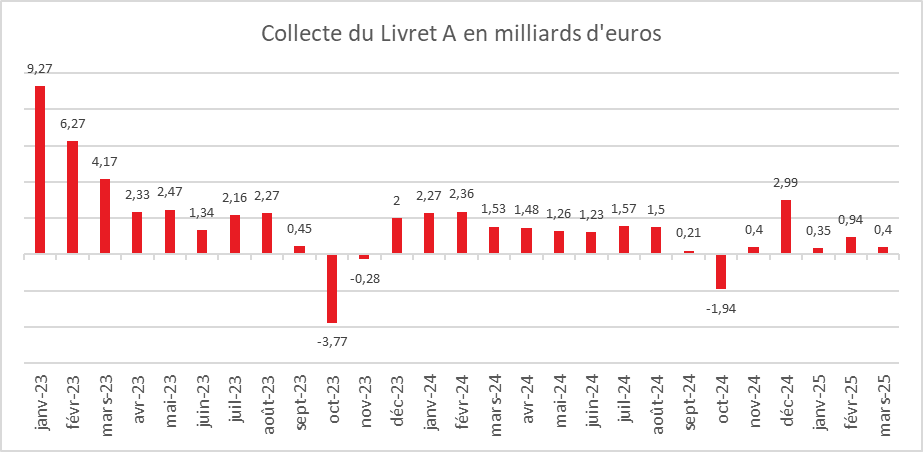
CDC
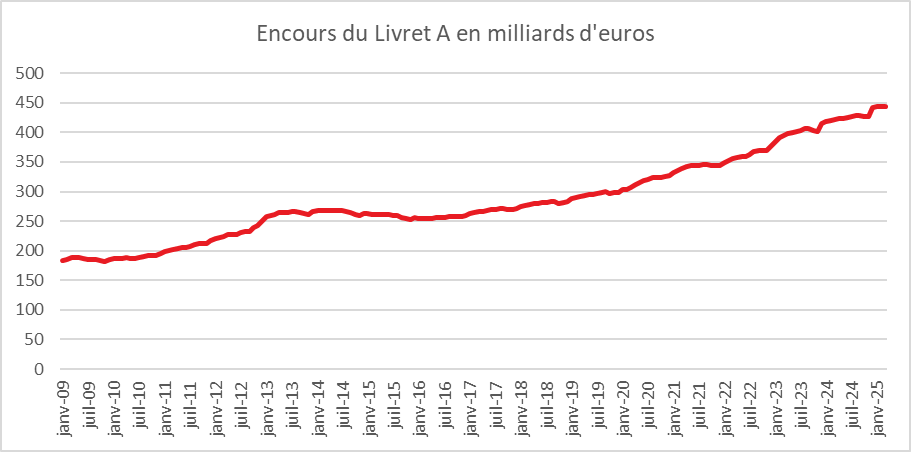
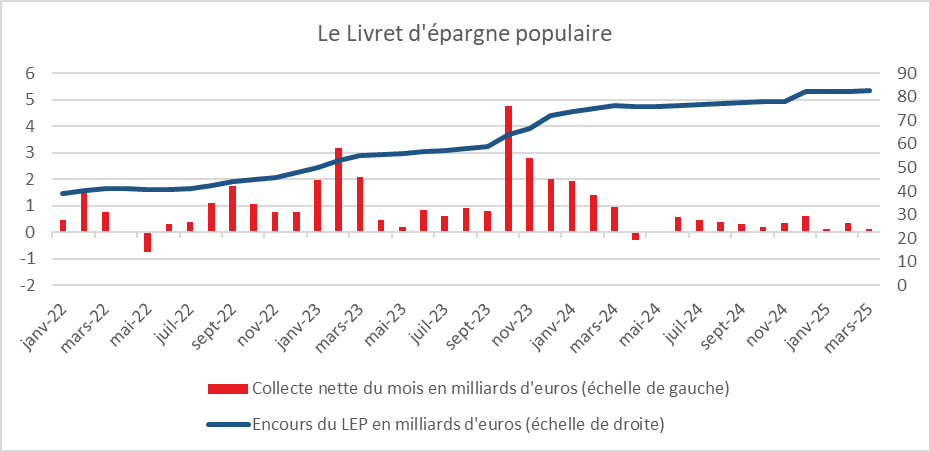
CDC
Livret A – mars 2025 – A petit trot
Le Livret A est touché par l’effet taux mais conserve néanmoins une collecte positive en mars. Les ménages se détournent de ce placement depuis l’annonce du passage de son taux de rémunération de 3 % à 2,4 %. Compte tenu du niveau de l’inflation (0,8 % en février et en mars), ainsi que de la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne, une nouvelle diminution de son taux de rémunération est probable au 1er août prochain.
Une collecte modeste mais positive
Le Livret A, avec une collecte de 400 millions d’euros, enregistre en mars 2025 son plus mauvais mois de mars depuis 2016 (310 millions d’euros). Ce résultat tranche avec ceux des années précédentes : en mars 2024, le Livret A avait bénéficié d’une collecte de 1,53 milliard d’euros, et en 2023 de 4,17 milliards d’euros. La collecte de mars 2025 s’inscrit dans le processus de décélération constaté depuis le début de l’année. En février, la collecte s’élevait à 940 millions d’euros, et en janvier à 350 millions d’euros.
Sur le premier trimestre 2025, la collecte atteint 1,73 milliard d’euros, contre 8,91 milliards d’euros sur la même période en 2024.
La collecte de mars 2025 pour le Livret A est nettement inférieure à sa moyenne des dix dernières années (2 milliards d’euros).
En mars, le Livret A bat néanmoins un nouveau record d’encours avec 444,2 milliards d’euros.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) mieux que le Livret A
Le LDDS fait mieux que le Livret A en mars, avec une collecte de 610 millions d’euros, soit un montant proche de celui de février (640 millions d’euros). Ce résultat reste néanmoins inférieur à celui de mars 2024 (910 millions d’euros). Sur les trois premiers mois de l’année, le LDDS enregistre une collecte de 1,81 milliard d’euros, contre 2,92 milliards d’euros sur la même période en 2023. La collecte de mars 2025 est assez proche de la moyenne de ses dix dernières années (700 millions d’euros). Aucune décollecte n’a été enregistrée au mois de mars pour le LDDS.
L’encours du LDDS atteint, avec 162,4 milliards d’euros, un nouveau record.
Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) : une érosion de la collecte
Comme le Livret A et le LDDS, le Livret d’Épargne Populaire est en repli en mars, avec une collecte de 140 millions d’euros, contre 350 millions d’euros en février. Cette collecte est en net retrait par rapport à celle de mars 2024 (950 millions d’euros).
Avec un encours de 82,8 milliards d’euros, le LEP atteint néanmoins un plus haut historique.
Une indéniable normalisation de l’épargne réglementée
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la baisse de la collecte du Livret A en ce début d’année. La diminution du taux de rémunération conduit les ménages à réorienter leur épargne vers d’autres placements, notamment l’assurance vie, qui connaît un excellent début d’année. Par ailleurs, certaines rumeurs évoquant une mobilisation de l’épargne pour financer la défense, perçue comme une forme de prélèvement, ont pu jouer en sa défaveur. Enfin, le nombre de Livrets A plafonnés a fortement augmenté ces dernières années (environ 13 %), ce qui pousse les épargnants disposant de liquidités à se tourner vers d’autres produits.
La baisse de la collecte du Livret A ne semble pas, en revanche, traduire un arbitrage en faveur de la consommation.
Une baisse des taux de rémunération attendue le 1er août 2025
Les deux composantes utilisées pour calculer le taux du Livret A — le taux ester et le taux d’inflation — sont orientées à la baisse. Compte tenu des données des trois premiers mois de l’année, le taux du Livret A pourrait passer de 2,4 % à 1,7 %.
Le taux du Livret d’Épargne Populaire pourrait quant à lui baisser de 3,4 % à 2,3 %. Pour ce dernier, le gouvernement n’a pas appliqué strictement la formule ces dernières années, préférant donner un avantage à l’épargne populaire.
France info : baisse des taux de la BCE – une bonne nouvelle pour les emprunts immobiliers, moins pour l’épargne
Face à l’incertitude économique, la Banque centrale européenne choisit une nouvelle fois de baisser ses taux. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, décrypte l’impact sur les emprunts immobiliers et l’épargne des Français.
La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé une nouvelle fois ses taux d’intérêt directeurs afin de soutenir la fragile croissance économique de la zone euro désormais confrontée aux incertitudes sur l’impact des droits de douane américains. Le taux de la facilité de dépôt a été abaissé de 25 points de base, à 2,25%.
Il s’agit de la septième baisse du coût du crédit en un an de la part de l’institut de Francfort qui avait porté en septembre 2023 le taux de dépôt à un record de 4% pour juguler une inflation galopante après la pandémie de COVID-19 et le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Ecouter l’interview
Immobilier : les stratégies pour investir et épargner avec Philippe Crevel
Entre les compléments de revenus, la constitution d’un patrimoine pour la retraite, l’immobilier offre des solutions. Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l’épargne et Benjamin Lefébure, cofondateur des secrets de l’Immo, partagent leurs idées dans l’émission Figaro Immo, animée par Olivier Marin.
Le Coin des Epargnants du 19 avril 2025 : des marchés à la recherche d’un cap
Trêve Pascale sur les marchés
En raison du Vendredi saint, cette semaine, les Bourses européennes et américaines n’ont été ouvertes que quatre jours. Les espoirs d’un accord entre l’Europe et les États-Unis sur les droits de douane ont conduit à une progression des indices « actions » sur le Vieux Continent. Sur la semaine, le CAC 40 a progressé de 2,55 % et le DAX allemand de plus de 4 %.
Si les craintes de ralentissement de l’économie mondiale sont justifiées, elles ne devraient pas déboucher sur une récession, selon le FMI. D’après sa directrice générale, Kristalina Georgieva, « les tensions commerciales sont comme une marmite qui bouillonne depuis longtemps et qui maintenant déborde ». À quelques jours de l’ouverture des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI), elle a porté un jugement sans concession sur les raisons de la guerre commerciale actuelle. Elle a ainsi souligné que « dans une large mesure, ce que nous constatons aujourd’hui est le résultat d’une érosion de la confiance dans le système international et entre les pays ». Elle a admis que, si « la mondialisation a permis de sortir de la pauvreté des millions de personnes, tout le monde n’en a pas bénéficié ». Elle a ajouté que « nombreux sont ceux qui imputent au système économique international la responsabilité de l’injustice perçue dans leurs vies ».
Elle a condamné le recours aux barrières tarifaires (droits de douane) et non tarifaires (réglementation sanitaire, environnementale…) qui vident de sa substance le système multilatéral, lequel n’a pas réussi à offrir des conditions de concurrence équitables. Elle estime que la non-correction des déséquilibres commerciaux a conduit à une impasse. Logiquement, les excédents commerciaux auraient dû provoquer l’appréciation des monnaies des pays concernés et une augmentation de leur demande interne. Or, cela n’a pas été le cas.
Pour le FMI, la Chine doit stimuler sa consommation privée, limiter l’essor excessif de son industrie et favoriser une baisse de l’épargne de précaution des ménages. L’Union européenne, quant à elle, doit améliorer sa compétitivité et approfondir le marché unique. « L’Europe a besoin d’une union bancaire, d’une union des marchés de capitaux et de moins de restrictions au commerce intérieur des services. » Pour le FMI, les États-Unis doivent réduire considérablement le déficit budgétaire fédéral par des réformes du côté des dépenses. Le déficit de la balance courante serait alors moins élevé.
L’once d’or toujours plus haut
L’once d’or a encore battu des records cette semaine et a dépassé 3300 dollars. Depuis le 1er janvier, le cours a gagné plus de 25 %.et sur un an la hausse atteint près de 40 %. Les prévisions sur l’évolution des cours sont de plus en plus difficiles à réaliser. Certains experts estiment possible un cours à plus de 3600 dollars dans les prochains semaines, voire 4000 dollars. D’autres estiment que la conclusion d’accords pour les droits de douane mettrait un terme à l’envolée du métal précieux. De même, un cessez le feu en Ukraine pourrait provoquer une baisse de l’once d’or.
Septième baisse consécutive des taux directeurs par la Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne a réalisé, jeudi 17 avril, sa septième baisse de taux directeurs depuis le début de son cycle d’assouplissement monétaire au mois de juin dernier. Le taux de dépôt a été ainsi ramené de 2,5 % à 2,25 %. Cette décision était anticipée après l’annonce par Donald Trump, le 2 avril, de relever les droits de douane américains. Malgré le revirement du président américain sur les surtaxes « réciproques », diminuées à un seuil plancher de 10 % pour tous les pays sauf la Chine (le taux y est de 145 % pour la majeure partie des importations en provenance de ce pays.
La poursuite de la baisse des taux directeurs constitue une réponse face à la menace de nouveau ralentissement de croissance qui menace la zone euro avec la mise en œuvre de politiques protectionnistes par le Président américain. Le communiqué de la BCE souligne que « les perspectives de croissance se sont détériorées du fait de l’intensification des tensions commerciales. L’incertitude accrue devrait affaiblir la confiance des ménages et des entreprises, tandis que les réactions négatives et volatiles des marchés aux tensions commerciales devraient entraîner un durcissement des conditions de financement. Ces facteurs pourraient par ailleurs peser sur les perspectives économiques de la zone euro ». Christine Lagarde, la Présidente de la BCE, a souligné que les perturbations croissantes du commerce mondial ont accru l’incertitude concernant l’inflation. Des facteurs jouent à la baisse -ralentissement de l’économie mondiale, baisse des prix des importations chinoises pour gagner des parts de marché, appréciation de l’euro – mais d’autres jouent à la hausse – fragmentation des chaînes d’approvisionnement, augmentation des dépenses publiques en matière de défense et d’infrastructures.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 17/18 avril 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 285,86 | +2,55 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 39 142,23 | -2,66 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 282,70 | -1,50 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 16 286,45 | -2,62 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 21 205,86 | +4,11 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 275,66 | +3,91 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 4 935,34 | +3,09 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 34 730,28 | +4,13 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 280,34 | +4,29 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,239 % | -0,111 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,467 % | -0,100 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,329 % | -0,223 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1371 | +3,75 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 324,89 | +11,52 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 67,89 | +4,96 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 85 064,63 | +1,63 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Le Coin des épargnants du 11 avril 2025 : les marchés pris en otage par les droits de douane
La semaine folle des marchés
Suspension des droits de douane majorés pendant une période de 90 jours réservée à la négociation : les nerfs des investisseurs sont mis à rude épreuve depuis le 2 avril dernier. Si la suspension des majorations a été appréciée, la poursuite de la guerre commerciale avec la Chine et le haut niveau d’incertitude pour la suite pèsent évidemment sur les valeurs « actions ». Le passage des droits à 10 % pour toutes les importations américaines, qui ne devrait pas être remis en cause, reste une mauvaise nouvelle pour les échanges.
La Bourse de Paris a connu le repli le plus important en Europe cette semaine. L’indice CAC 40 a, en effet, reculé de près de 4 %, quand le DAX allemand n’a perdu que 1,5 %. Les valeurs du luxe, de la finance et de l’automobile ont été les plus touchées. Aux États-Unis, le moratoire du président américain a été suivi d’un rebond impressionnant des indices actions. Le Nasdaq a progressé de plus de 7 % sur la semaine et le S&P 500 de près de 6 %. Le président américain, ayant invité à acheter des actions avant sa déclaration du 9 avril relative aux droits de douane, est suspecté d’être à l’origine d’un délit d’initié. Les démocrates au Congrès ont demandé, sur ce sujet, la création d’une commission d’enquête.
La spirale protectionniste s’emballe entre les Etats-Unis et la Chine
La spirale protectionniste bat son plein avec un bras de fer inédit entre les États-Unis et la Chine. Vendredi 11 avril, la Chine a décidé d’appliquer des droits de douane de 125 % sur les importations américaines, en réaction aux droits de 145 % institués par Donald Trump. Ces taux sont synonymes d’un quasi-embargo mutuel. Les Chinois n’entendent pas négocier sous la pression et la menace américaines. Ils estiment que l’économie américaine ne peut pas se passer de leurs importations. Celle-ci peut compter sur des stocks constitués en janvier et février, mais ceux-ci ne couvrent pas les besoins des entreprises au-delà du mois de mai.
Les autorités chinoises envisagent de réduire leurs exportations de métaux rares vers les États-Unis. Cette limitation risquerait néanmoins de peser sur les recettes d’exportation et d’inciter les Américains à se tourner vers d’autres fournisseurs. Vendredi 11 avril, le ministère du Commerce chinois a indiqué que les taux des droits de douane ne devraient plus évoluer : « étant donné qu’il n’y a plus aucune possibilité d’acceptation du marché pour les produits américains exportés vers la Chine aux niveaux tarifaires actuels, si la partie américaine continue par la suite à imposer des droits de douane sur les produits chinois exportés vers les États-Unis, la partie chinoise n’y prêtera aucune attention ». Les États-Unis pourraient eux aussi décider d’en rester là, pensent certains experts, leur surtaxe de 145 % sur les biens chinois étant supérieure à celle imposée par Pékin.
Le moral des consommateurs en berne aux États-Unis
Sur le plan économique, aux États-Unis, la dernière enquête de l’Université du Michigan sur le moral des consommateurs, réalisée entre le 25 mars et le 8 avril, c’est-à-dire avant le revirement de Donald Trump sur les droits de douane, a confirmé que les ménages restent préoccupés par la guerre tarifaire engagée par leur président. Leur moral est tombé à son plus bas niveau depuis juin 2022, à 50,8 points — trois points de moins qu’anticipé —, tandis que les attentes en matière d’inflation à court et à long terme ont atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs décennies. Les ménages s’attendent à ce que les prix augmentent à un rythme annuel de 6,7 % sur les douze prochains mois (contre 5 % auparavant), soit le niveau le plus élevé enregistré depuis novembre 1981. À l’horizon de 5 à 10 ans, les anticipations montent à 4,4 %.
La « remontada » de l’euro
En fin de semaine, le dollar s’échangeait contre 1,13 euro. La devise européenne est à son plus haut niveau depuis février 2022, c’est-à-dire depuis le début de la guerre en Ukraine. Sur une semaine, elle a gagné 5 % face au dollar. Depuis le début de l’année, l’euro a repris 10 % par rapport à la monnaie américaine.Cette semaine, l’euro a été porté par plusieurs facteurs. La conclusion d’un accord de coalition en Allemagne, mercredi 9 avril, met fin à une incertitude politique européenne. Ce pacte augure des mesures de relance pour l’économie allemande, en perte de vitesse depuis de nombreuses années. La hausse de l’euro est avant tout la conséquence de la dépréciation du dollar qui a reculé de 8,5 % vis-à-vis des principales monnaies depuis le début de l’année. Le billet vert est affecté par la guerre commerciale et notamment par la montée aux extrêmes avec la Chine. La hausse des taux d’intérêt sur les obligations d’État américaines — le dix ans atteignant 4,5 % en fin de semaine — n’a pas suffi à enrayer la glissade du dollar.
Logiquement, quand les taux obligataires d’un pays augmentent, la devise de ce même pays s’apprécie : la rémunération augmente, ce qui incite normalement les investisseurs à placer leur argent et donc à « acheter » la devise. Mais ces derniers, compte tenu du contexte économique et politique des États-Unis, se détournent des actifs financiers américains. Ils privilégient les placements dans d’autres devises : le franc suisse, le yen et l’euro. Le dollar perd ainsi de son attrait, avec une érosion de son statut de « valeur refuge ». Les investisseurs perçoivent des risques de récession et d’inflation aux États-Unis. Ils vendent en conséquence des actifs américains pour redéployer leurs fonds vers des titres d’autres pays. Les États-Unis ont néanmoins un réel besoin de capitaux étrangers pour financer leurs imposants déficits publics et extérieurs. Cette dépendance peut peser sur les choix de Donald Trump. L’appréciation de l’euro renchérit le prix des exportations et diminue celui des importations. Pour la France, c’est plutôt une bonne nouvelle.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 11 avril 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 104,80 | -3,86 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 40 212,71 | +5,08 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 363,36 | +5 ;75 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 16 724,46 | +7,15 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 20 368,53 | -1,48 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 964,18 | -0,79 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 20 368,53 | -1,46 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 33 585,58 | -5,76 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 238,23 | -3,29 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,350 % | +0,018 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,567 % | +0,004 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,501 % | +0,552 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,1286 | +5,05 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 234,15 | +3,86 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 64,03 | -3,72 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 82 263,80 | -2,46 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Le PER face à l’épreuve de la volatilité des marchés
Le Plan d’Épargne Retraite à l’épreuve de la volatilité
Depuis les annonces fracassantes de Donald Trump, début avril, sur les droits de douane, les marchés financiers évoluent en dents de scie. La nervosité gagne les investisseurs, pris de court par l’ampleur des relèvements tarifaires et inquiets d’un possible ralentissement économique mondial. Résultat : les actifs risqués, comme les actions, sont délaissés au profit d’actifs jugés plus sûrs, à commencer par les obligations. L’avenir des marchés dépendra de l’issue des négociations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires. En attendant, l’incertitude domine.
Quelles conséquences pour les Plans d’Épargne Retraite (PER), ces placements de long terme de plus en plus prisés par les Français ? Faut-il s’inquiéter des secousses boursières ?
Un placement de long terme, par définition exposé
Le PER repose sur une logique d’épargne longue, souvent sur plusieurs décennies. Les versements sont investis dans différents supports, dont une part en actions, plus volatiles. Il est donc normal d’observer des variations, parfois marquées, à la hausse comme à la baisse. Mais c’est précisément parce qu’il s’inscrit dans la durée que le PER peut traverser ces épisodes sans dommage structurel. En 2020, la chute brutale des marchés lors des confinements avait été effacée en quelques mois. L’histoire financière montre que les crises finissent presque toujours par être surmontées.
La gestion pilotée : un bouclier contre la panique
La plupart des PER sont sous gestion pilotée : l’épargne est automatiquement répartie entre actifs dynamiques (actions) et sécurisés (fonds en euros, obligations), selon l’âge du titulaire. Plus on approche de la retraite, plus l’exposition aux marchés actions est réduite. En cas de krach, les jeunes actifs, plus exposés, ont le temps de voir les marchés remonter. Quant aux épargnants proches de la retraite, leur épargne est en grande partie protégée, ce qui limite les pertes.
Chaque titulaire peut par ailleurs choisir un profil de risque – prudent, équilibré ou dynamique – en fonction de sa sensibilité aux fluctuations. Cette flexibilité est l’un des atouts majeurs du PER.
Le bon réflexe : investir régulièrement, surtout quand ça baisse
Pour amortir les variations de marché, la régularité des versements est essentielle. En investissant chaque mois, on profite des périodes de baisse pour acheter à meilleur prix. Cela permet, sur le long terme, de lisser le coût moyen d’acquisition des parts et de renforcer les perspectives de plus-values.
À retenir
✅ Le PER est un produit d’épargne long terme : inutile de paniquer à la moindre turbulence.
✅ La gestion pilotée protège naturellement les épargnants à l’approche de la retraite.
✅ Investir régulièrement, surtout quand les marchés baissent, est souvent la meilleure stratégie.
Le Coin des épargnants du 4 avril 2025 : les marchés touchés par la guerre commerciale
Et les Chinois ont remis une pièce dans le jukebox du protectionnisme
La spirale maléfique du protectionnisme semble bel et bien enclenchée.
Jusqu’au dernier moment, les investisseurs pensaient que Donald Trump bluffait, et que ses menaces de relèvement des droits de douane visaient avant tout à obtenir des concessions de la part de ses partenaires. Or, ils ont découvert un tout autre scénario. Lors de sa conférence de presse du 2 avril dernier, Donald Trump a renvoyé ad patres quatre-vingts ans de libéralisation des échanges commerciaux. Les investisseurs ont été surpris par l’ampleur des droits de douane imposés au reste du monde.
En outre, la réponse de la Chine, avec des mesures de rétorsion de grande ampleur, semble indiquer qu’une spirale protectionniste est bel et bien en train de se mettre en place, synonyme de baisse des échanges mondiaux et, par conséquent, de ralentissement de la croissance. Les investisseurs jugent désormais plausible une récession mondiale, ou du moins une récession aux États-Unis.
Les autorités chinoises ont déclaré vendredi 4 avril qu’elles imposeraient, à compter du 10 avril, des droits de douane de 34 % sur les produits américains, en réaction à ceux que les États-Unis appliqueront aux produits chinois dès le 9 avril. Compte tenu de l’accumulation des taxes, les produits chinois pourraient être taxés à hauteur de 54 % aux États-Unis. Les produits en provenance de l’Union européenne s’en sortent pour l’instant mieux, avec un taux moyen de 20 %, même si certains articles sont frappés d’un droit de 25 %. Par ailleurs, la Chine a annoncé qu’elle saisirait l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et a déclaré mettre en place des contrôles à l’exportation sur sept éléments de terres rares, tels que le gadolinium — utilisé notamment en imagerie par résonance magnétique — et l’yttrium, présent dans l’électronique grand public.
L’Union européenne a de son côté averti qu’une réponse forte serait apportée, avec à la clé des mesures ciblant les entreprises technologiques américaines et une possible limitation des investissements en direction des États-Unis. Le Canada a également réagi en imposant des droits de 25 % sur les véhicules fabriqués aux États-Unis.
Le CAC 40 a chuté de 4 % le vendredi 4 avril, portant son recul hebdomadaire à 7,40 %. Il a terminé à 7 274 points. Ce sont les valeurs bancaires qui ont le plus souffert : Société Générale a perdu plus de 10 %. Des industriels comme ArcelorMittal, Saint-Gobain ou Stellantis ont également enregistré des baisses significatives, en raison de l’importance de leurs exportations vers les États-Unis. Le DAX allemand a lui aussi connu une semaine difficile, avec un recul supérieur à 8 %.
Outre-Atlantique, la correction est encore plus sévère. Les valeurs technologiques, particulièrement exposées en raison de leur dépendance aux importations asiatiques, sont sous pression. Elles sont également susceptibles de faire l’objet de mesures de rétorsion, notamment de la part de l’Europe. Le Nasdaq a reculé de près de 9 % sur la semaine, et de plus de 18 % depuis le 1er janvier. Le S&P 500 a perdu 8,66 % sur la semaine, et le Dow Jones 7,13 %. La capitalisation du S&P 500 a fondu de 5 400 milliards de dollars au cours des séances des 3 et 4 avril. Les trois grands indices de la Bourse de New York ont ainsi enregistré, jeudi et vendredi, leur plus forte baisse en deux jours depuis la pandémie de Covid-19.
Dans ce contexte, les bons chiffres de l’emploi sont passés inaperçus, éclipsés par la tempête provoquée par le relèvement des droits de douane. En mars, l’économie américaine a créé 228 000 emplois, selon les données publiées vendredi par le ministère du Travail. Les analystes tablaient sur environ 140 000 créations. Donald Trump s’est attribué ce résultat, estimant qu’il est la conséquence directe de sa politique économique.
Face aux tensions mondiales, les taux des obligations souveraines — valeurs refuge traditionnelles — sont en baisse. Le taux de l’obligation d’État américaine à 10 ans est repassé sous la barre des 4 %. L’or, autre valeur refuge, a battu de nouveaux records au cours de la semaine, atteignant jusqu’à 3 168 dollars l’once.
Avec des perspectives de ralentissement de la croissance mondiale, le prix du pétrole est également en forte baisse : le baril de Brent a reculé de 10 % sur la semaine, descendant sous la barre des 65 dollars.
Premier trimestre 2025 : fin de la fête pour les marchés
Sur les trois premiers mois de l’année, le CAC 40 a gagné plus de 5 %. Le gain avait atteint, au cours du mois de février, plus de 8 %. Depuis, l’accélération de la guerre commerciale a conduit à une érosion de l’indice parisien comme ceux des grandes places européennes. En mars, le CAC 40 a perdu près de 5 %. Le Daxx allemand a néanmoins progressé plus vite sur le premier trimestre que le CAC, près de 11 % malgré un recul de 4,61 % en mars. L’Eurostoxx 50 fait également mieux que le CAC 40 avec un gain de 7,82 % sur trois mois. Il s’est déprécié de 5,24 % en mars. Les indices américains sont en nette baisse sur l’ensemble du premier trimestre. Le Nasdaq a ainsi diminué sur trois mois de plus de 10 %, le S&P 500 de 4,5 % et le Dow Jones de 0,92 %. Les valeurs technologiques sont contestées après avoir connu une forte croissance à la fin de l’année 2024.
Les indices américains ont fortement reculé du fait de la montée des incertitudes commerciales. Après avoir battu des records dans la foulée du retour au pouvoir de Donald Trump, les indices subissent une correction qui, si elle continue, pourrait porter atteinte au moral des ménages.
Dans un contexte économique et géopolitique d’une rare complexité, l’or se négocie à des niveaux sans précédent. L’once d’or s’échangeait le 31 mars contre plus de 3 100 dollars. Il a gagné en trois mois près de 20 %. Sur un an, la hausse atteint plus de 40 %. L’or valeur refuge par excellence profite des craintes inflationnistes, des menaces de ralentissement de l’économie américaines, des tensions commerciales et des incertitudes internationales en Ukraine comme au Proche-Orient.
Les taux des obligations souveraines européennes ont fortement augmenté au cours du premier trimestre en lien avec les annonces d’augmentation de l’effort de défense. La suppression du frein budgétaire allemand a été compris comme un signal d’augmentation de la dette publique en Europe. La hausse des taux européens s’est accompagnée d’une appréciation logique de l’euro.
Le cours du pétrole est resté sur le premier trimestre stable mais a enregistré une augmentation de près de 5 % au cours d mois de mars en lien avec les menaces de nouvelles sanctions à l’encontre de l’Iran prononcées par Donald Trump.
Le bitcoin après avoir atteint plus de 100 000 dollars dans les jours qui ont suivi la nomination de Donald Trump à la présidence est en recul de plus de 10 % sur le trimestre. Porté en janvier par les annonces de déréglementation des cryptoactifs, il est depuis pénalisé par le recul des valeurs technologiques et pas des prises de bénéfices.
Vers de nouvelles baisses de taux directeurs par la BCE
Confiante dans le reflux de l’inflation, la BCE a baissé ses taux à six reprises depuis juin 2024, après les avoir relevés drastiquement pendant deux ans pour combattre l’envolée des prix. Mercredi, elle scrutera avec attention l’annonce concernant les droits de douane américains. Ces tensions commerciales font en effet planer une grande incertitude sur la poursuite de l’assouplissement monétaire de la BCE.
La banque centrale a évalué à 0,3 point de PIB l’impact récessif sur la zone euro des hausses potentielles de droits de douane américains, un taux qui monterait à 0,5 point en cas de riposte de l’Union eurpéene Dans ce contexte économique devenu complexe et instable, la BCE pourrait décider lors de sa prochaine réunion de réduire pour la septième fois depuis le mois de juin 2024, ses taux directeurs. Un tel scénario serait conforté par les statistiques rassurantes sur l’inflation.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 4 avril 2025 | Évolution ur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 274,95 | -7,80 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 38 314,86 | -7,13 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 074,08 | -8,66 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 15 587,79 | -8,99 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 20 641,72 | -8,08 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 054,98 | -6,97 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 4 878,31 | -8,20 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 33 780,58 | -10,59 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 342,01 | -0,83 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,332 % | -0,102 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,563 % | -0,206 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +3,951 % | -0,576 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,093 | +1,95 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 022,98 | +0,16 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 65,40 | -10,44 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 83 338,65 | -1,56 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
La finance responsable en forte hausse en 2024
En 2024, les encours gérés, en France, selon les principes de l’investissement responsable ont atteint 2 701 milliards d’euros. Ils ont enregistré une croissance de +15,2 % à périmètre constant, contre +5,8 % en 2023 et +6,9 % en 2022.
Ces encours relèvent des classifications Article 8 ou Article 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Le règlement SFDR agit comme le socle normatif de cette évolution. Il distingue deux catégories : les produits Article 8, qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et les produits Article 9, plus exigeants, dont l’objectif principal est l’investissement durable.
Les encours Article 8 représentent 2 603 milliards d’euros (+15,9 %) et les Article 9 atteignent 98 milliards d’euros (+7,4 %). Cette répartition souligne la montée en puissance des produits à visée de durabilité, même si la catégorie Article 9 reste plus restreinte, en partie en raison des contraintes réglementaires accrues et du recentrage de nombreux fonds vers le statut Article 8.
Les encours « investissement responsable » des fonds domiciliés en France représentent 1 283 milliards d’euros d’encours. Ils ont progressé de +14,1 % en 2024, soit bien plus que l’ensemble des fonds de droit français (+9,8 %). Désormais, 61 % de ces fonds sont classés Article 8 ou 9. La pénétration est particulièrement élevée pour les OPCVM (81 %), tandis que les FIA (fonds d’investissement alternatifs) restent en retrait (44 %).
L’investissement responsable demeure aujourd’hui majoritairement une affaire d’institutionnels, qui détiennent 73 % des encours. Ces derniers, par leur horizon long et leur besoin de gestion des risques systémiques, sont naturellement enclins à intégrer des critères de durabilité. La part des particuliers (soit 27 %) n’est néanmoins pas négligeable notamment grâce à l’essor de l’épargne salariale, de l’épargne retraite, et à la diffusion des labels qui facilitent la lisibilité des produits. Pour les seuls fonds IR domiciliés en France, 43 % des encours sont détenus par des investisseurs particuliers.
Avec 5 000 milliards d’euros d’encours gérés (tous types confondus), la France demeure le premier pays de l’Union européenne en matière de gestion d’actifs. Elle s’impose également comme un leader européen de l’investissement responsable, tant par la taille de son marché IR que par la structuration de son écosystème (labels, régulation, engagement des acteurs).
L’assurance vie confirme et signe
L’assurance vie avec un encours de 2038 milliards d’euros assume parfaitement son rôle de leader de l’épargne française en accumulant en ce début d’année d’excellents résultats en lien avec l’amélioration du rendement des fonds euros et la baisse des taux de rémunérations des placements bancaires dont le Livret A. Les ménages ont, en février, poursuivi ainsi la réorientation de leur épargne en faveur des placements de long terme plus rémunérateurs. La guerre commerciale engagée de Donald Trump peut -elle en revanche rebattre les cartes dans les prochains mois ?
Un mois de février « canon »
La collecte nette de l’assurance vie a atteint, en février, 5,8 milliards d’euros. Il faut remonter à février 2006 pour enregistrer un résultat supérieur (7,2 milliards d’euros). En janvier 2025, la la collecte nette avait été déjà importante (4,5 milliards d’euros). En deux mois, l’assurance vie a bénéficié d’une collecte nette de près de plus de 10 milliards d’euros, soit un niveau deux fois plus élevé qu’en 2024. En février 2024, la collecte nette avait été de 3,3 milliards d’euros.
Février est traditionnellement un mois favorable pour l’assurance ; depuis 1996, aucune décollecte n’y a été constatée. Sur ces dix dernières années, la collecte moyenne, en février, atteint deux milliards d’euros. En 2025, la collecte nette a néanmoins été près de trois fois supérieur à la moyenne décennale.
L’assurance vie profite à plein de la baisse du taux de rémunération du Livret A et de la préférence des ménages pour l’épargne de long terme.
Les cotisations à un haut niveau
En février 2025, les cotisations d’assurance vie sont en légère hausse de +2 % par rapport à février 2024, soit +0,4 milliard d’euros, et se sont élevées à 17,0 milliards d’euros, leur plus haut niveau historique pour un mois de février. Elles augmentent pour les supports en unités de compte (UC, +14 %) et diminuent pour ceux en euros (−5 %).
Depuis le début de l’année, les cotisations ont progressé de 6 % pour atteindre 34,2 milliards d’euros. La hausse est de 10 % pour les unités de compte et de 3 % pour les fonds euros. La part des UC dans les cotisations a été, en février, de 41 % contre 43 % en janvier.
Les ménages français ne relâchent pas leur effort d’épargne dans un contexte qui demeure anxiogène.
Des prestations en nette baisse
Les ménages ont moins retiré d’argent en février 2025 qu’un an auparavant. Les prestations se sont élevées à 11,1 milliards d’euros au cours du deuxième mois de l’année en baisse de 16 % par rapport à février 2024. Elles diminuent à la fois pour les supports en euros (−1,7 milliard d’euros, soit −16 %) et ceux en unités de compte (−0,4 milliard d’euros, soit −14 %). Sur les deux premiers mois de l’année, les prestations sont en recul de 11 % à 23,9 milliards d’euros.
Les moindres rachats témoignent d’une attractivité plus forte de l’assurance vie et du faible niveau de l’investissement immobilier.
Le retour des fonds euros dans le vert
Au mois de février, la collecte nette des fonds a été positive de 1,3 milliard d’euros quand elle était négative en décembre et janvier derniers. Celle des unités de compte dépasse de son côté 4 milliards d’euros.
L’assurance vie : the place to be ?
Le premier placement des ménages profite du rendement des fonds euros, redevenu plus compétitif avec la baisse des rémunérations des livrets bancaires et des dépôts à terme ainsi qu’avec la hausse des taux obligataires. Ces derniers influent directement sur le rendement des fonds euros. Celui-ci pourrait se rapprocher de 3 % cette année, creusant l’écart avec celui du Livret A. en effet, ce dernier devrait à nouveau baisser le 1er août. Il devrait passer en-dessous des 2 % compte tenu de l’évolution de l’inflation et des taux directeurs de la Banque centrale européenne.
L’assurance vie pourrait être en revanche pénalisée par la guerre commerciale lancée le 2 avril dernier par Donald Trump. Le caractère anxiogène de la situation économique et géopolitique pourrait amener les ménages à se tourner une fois de plus vers les placements de court terme comme le Livret A.
La forte baisse des valeurs boursières peut-elle occasionner un reflux des unités de compte ?. Lors des dernières périodes de baisse, épidémie covid, guerre en Ukraine ou crise politique en France, les assurés avaient été relativement stoïques voire opportunistes. La baisse des cours constituent une opportunité pour acheter des valeurs. Cela suppose que la crise soit courte ce qui n’est pas en l’état actuel une garantie. Une réponse commune des Européens avec la réaffirmation de l’Union à travers le lancement de plans de relance et de soutien à l’activité pourrait y aider.
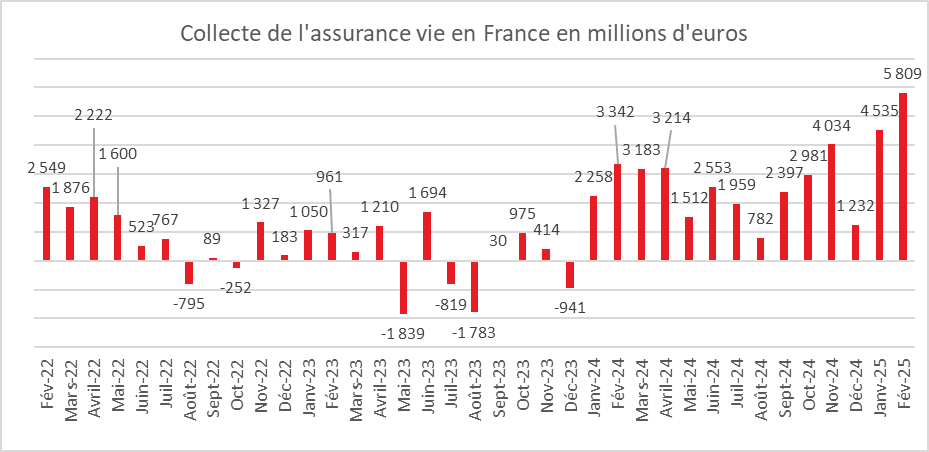
France Assureurs
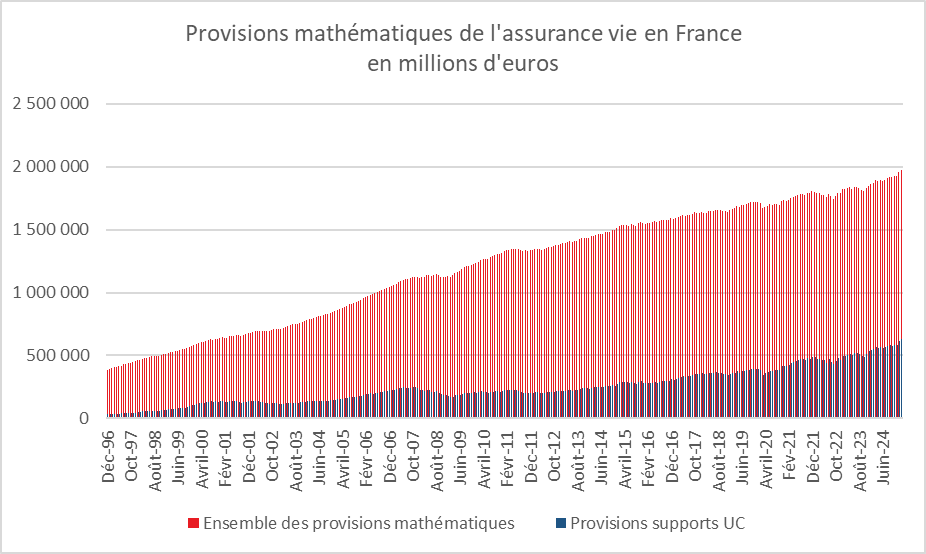
France Assureurs
Baisse des rémunérations des dépôts bancaires en février 2025
En février 2025, la rémunération globale des dépôts bancaires a, selon la Banque de France, diminué de 16 points de base (pb) et s’établit à 1,62% (après 1,78 % en janvier). Le repli de la rémunération des dépôts est particulièrement marqué pour les ménages (-17 pb à 1,63 %), compte tenu notamment de la baisse du taux du Livret A (-60 pb). Il est plus limité pour les sociétés non financières (SNF ; -7 pb), qui enregistrent en particulier une diminution de la rémunération des comptes à terme à moins de deux ans de 12 pb. Le taux de rémunération des livrets ordinaires est passé de 0,9 à 0,85 % de janvier à février.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| févr- 2025 (p) | févr- 2024 | déc- 2024 | janv- 2025 (r) | févr- 2025 (p) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 110 | 1,87 | 1,78 | 1,78 | 1,62 |
| dont Ménages | 1 883 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,63 |
| dont : – dépôts à vue | 539 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| – comptes à terme <= 2 ans (c) | 86 | 3,51 | 3,08 | 2,98 | 2,93 |
| – comptes à terme > 2 ans (c) | 99 | 2,05 | 2,35 | 2,35 | 2,33 |
| – livrets à taux réglementés (d) | 723 | 3,17 | 3,07 | 3,07 | 2,49 |
| dont : livret A | 407 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,40 |
| – livrets ordinaires | 220 | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,85 |
| – plan d’épargne-logement | 217 | 2,55 | 2,63 | 2,64 | 2,63 |
| dont SNF | 850 | 1,98 | 1,69 | 1,73 | 1,66 |
| dont : – dépôts à vue | 516 | 0,82 | 0,67 | 0,68 | 0,65 |
| – comptes à terme <= 2 ans (c) | 260 | 3,83 | 3,26 | 3,33 | 3,21 |
| – comptes à terme > 2 ans (c) | 73 | 3,39 | 3,44 | 3,41 | 3,35 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 4,50 | 3,15 | 3,15 | 2,90 | |
| Euribor 3 mois (e) | 3,92 | 2,82 | 2,70 | 2,53 | |
| Rendement du TEC 2 ans (e), (f) | 2,86 | 2,21 | 2,42 | 2,25 | |
| Rendement du TEC 5 ans (e), (f) | 2,66 | 2,55 | 2,82 | 2,64 | |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
d. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
e. Moyenne mensuelle.
f. Taux de l’Échéance Constante 2 ans et 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
r. Données révisées.
p. Données provisoires.
Premier trimestre boursier : les incertitudes ont pris le dessus
Sur les trois premiers mois de l’année, le CAC 40 a gagné plus de 5 %. Le gain a atteint au cours du mois de février plus de 8 %. L’accélération de la guerre commerciale a conduit à une érosion de l’indice parisien comme ceux des grandes places européennes. En mars, le CAC 40 a perdu près de 5 %
Le Daxx allemand a néanmoins progressé plus vite sur le premier trimestre que le CAC, près de 11 % malgré un recul de 4,61 % en mars. L’Eurostoxx 50 fait également mieux que le CAC 40 avec un gain de 7,82 % sur trois mois. Il s’est déprécié de 5,24 % en mars. Les indices américains sont en nette baisse sur l’ensemble du premier trimestre. Le Nasdaq a ainsi diminué sur trois mois de plus de 10 %, le S&P 500 de 4,5 % et le Dow Jones de 0,92 %. Les valeurs technologiques sont contestées après avoir connu une forte croissance à la fin de l’année 2024.
Les indices américains ont fortement reculé du fait de la montée des incertitudes commerciales. Après avoir battu des records dans la foulée de le retour au pouvoir de Donald Trump, les indices subissent une correction qui si elle continue pourrait porter atteinte au moral des ménages.
Dans un contexte économique et géopolitique d’une rare complexité, l’or se négocie à des niveaux sans précédent. L’once d’or s’échangeait le 31 mars contre plus de 3100 dollars. Il a gagné en trois mois près de 20 %. Sur un an, la hausse atteint plus de 40 %. L’or valeur refuge par excellence profite des craintes inflationnistes, des menaces de ralentissement de l’économie américaines, des tensions commerciales et des incertitudes internationales en Ukraine comme au Proche Orient.
Les taux des obligations souveraines européennes ont fortement augmenté au cours du premier trimestre en lien avec les annonces d’augmentation de l’effort de défense. La suppression du frein budgétaire allemand a été compris comme un signal d’augmentation de la dette publique en Europe. La hausse des taux européens s’est accompagnée d’une appréciation logique de l’euro.
Le cours du pétrole est resté sur le premier trimestre stable mais avec une augmentation de près de 5 % au cours d mois de mars en lien avec les menaces de nouvelles sanctions à l’encontre de l’Iran prononcées par Donald Trump.
Le bitcoin après avoir atteint plus de 100 000 dollars dans les jours qui ont suivi la nomination de Donald Trump à la présidence est en recul de plus de 10 sur le trimestre. Il a été porté en janvier par les annonces de déréglementation des cryptoactifs. Il est depuis pénalisé par le recul des valeurs technologiques et pas des prises de bénéfices.
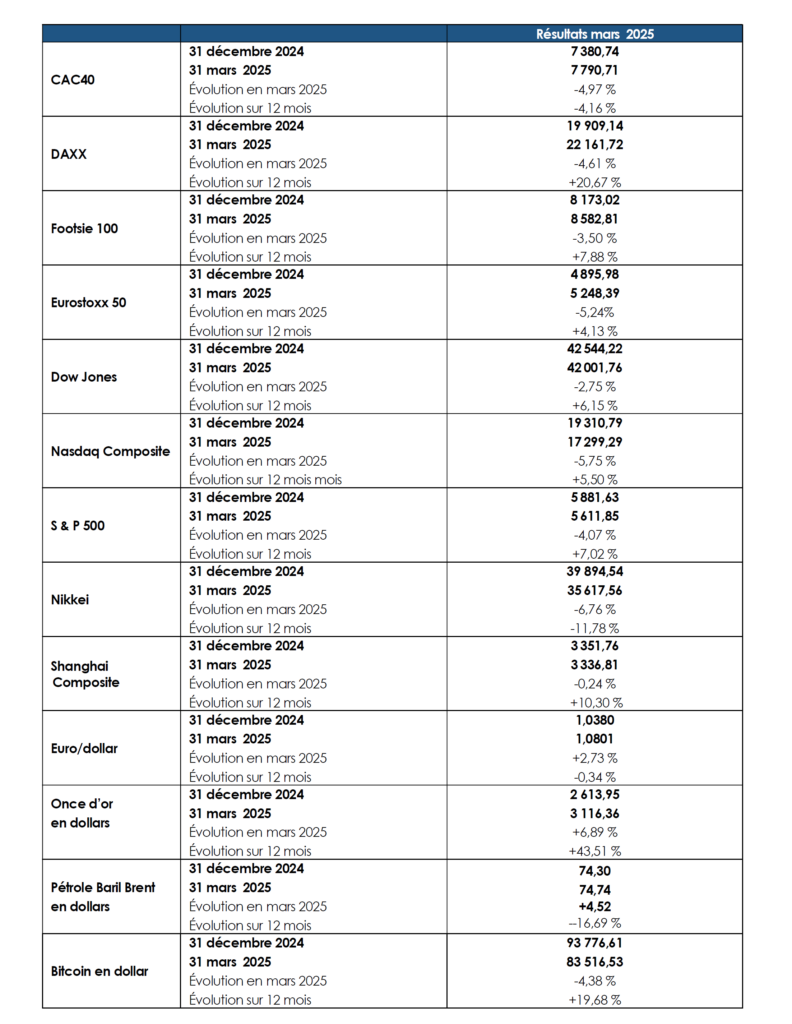
Le Coin des épargnants : les marchés face à la danse des droits de douane
Les annonces de Donald Trump sur les droits de douane concernant les exportations automobiles (droits de 25 %) ont, cette semaine, touché de plein fouet les Bourses mondiales. En Europe comme en Asie, les principales places ont connu des accès de faiblesse, avec le recul des valeurs des constructeurs automobiles. Les titres des entreprises d’électronique ont également été affectés, les véhicules comportant en effet un grand nombre de composants technologiques, comme les microprocesseurs. Les sociétés japonaises et sud-coréennes, deux pays qui représentent respectivement 16 % et 15 % du total des importations automobiles des États-Unis, sont fortement exposées. En 2024, l’automobile représentait 28 % des exportations nippones vers les États-Unis, soit 1,35 million de véhicules pour un montant de 40 milliards de dollars. Les États-Unis demeurent un marché crucial pour les constructeurs japonais. Toyota, numéro un mondial, y a écoulé l’an dernier 2,33 millions de véhicules, soit 23 % de ses ventes mondiales.
Le prochain rendez-vous est fixé au 2 avril, dit « jour de Libération » (Libération Day). Dans l’esprit du locataire de la Maison-Blanche, à compter de cette date, l’équité dans les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde sera assurée par l’application de droits réciproques. Compte tenu des déclarations du président américain — il est vrai fluctuantes — sur le sujet tarifaire, le plan des droits de douane réciproques ne constitue pas un substitut aux mesures déjà annoncées, qu’elles soient en vigueur (Chine, acier, aluminium) ou à venir (automobile, Canada, Mexique, droits de douane secondaires en lien avec les importations de pétrole vénézuélien, etc.) : il s’ajoute aux autres mesures. En aucun cas, la règle de la réciprocité ne sera garantie.
Les investisseurs ont donc poursuivi leur allègement sur les marchés actions tout au long de la semaine. Le CAC 40 a perdu 1,58 % et repasse sous la barre des 8 000 points. Sur le trimestre, il ne reste plus qu’une séance — celle du 31 mars —, et le baromètre gagne néanmoins 7,25 %, soit bien plus que le S&P 500, dont la perte atteint près de 5 %. L’indice phare allemand DAX a également reculé, de près de 1,7 % sur la semaine. L’indice américain S&P 500 a perdu plus de 1,5 % en cinq jours, et le Nasdaq 2,63 %. Depuis le début de l’année, ce dernier a reculé de plus de 10 %. En raison d’un redéploiement vers les obligations souveraines, leurs taux se sont orientés à la baisse ces derniers jours. Le cours de l’or reste dynamique dans ce contexte anxiogène. L’once s’est rapprochée des 3 100 dollars, gagnant 1,5 % sur la semaine.
Les derniers indicateurs macroéconomiques n’ont pas permis d’amortir la baisse des valeurs boursières. La statistique relative aux revenus et dépenses des ménages américains en février, qui inclut l’indice des prix PCE, montre que la consommation se tasse, tandis que les tensions sur les prix persistent. Le taux de l’indice PCE s’est établi à 2,5 % sur un an. En données « core » (hors alimentation et énergie), cette mesure de l’inflation privilégiée par la Réserve fédérale a progressé de 2,8 %. Le baromètre de l’Université du Michigan sur le moral des consommateurs s’est à nouveau dégradé en mars, tout comme les anticipations d’inflation à court et à long terme. Les consommateurs prévoient une hausse annuelle des prix de 4,1 % au cours des cinq à dix prochaines années — un record depuis février 1993 et supérieur aux 3,9 % de l’estimation préliminaire —, et une inflation de 5 % au cours des 12 prochains mois, soit le taux le plus élevé depuis 2022. Le taux d’inflation PCE n’est pas exceptionnellement élevé, mais il n’incite pas la Fed à accélérer son calendrier d’assouplissement de ses taux d’intérêt.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 28 mars 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 7 916,08 | -1,58 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 41 583,90 | -1,00 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 580,94 | -1,59 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 17 322,99 | -2,63 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 22 455,90 | -1,69 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 658,85 | +0,16 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 331,40 | -1,94 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 120,33 | -1,92 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 351,31 | -2,29 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,434 % | -0,031 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,729 % | -0,035 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,257 % | +0,003 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0818 | -1,05 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 085,64 | +1,48 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 73,62 | +2,12 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 83 694,63 | +0,32 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Le Livret A plie mais ne rompt pas en février
Le Livret A poursuit sur la lancée du mois de janvier avec une collecte modeste mais positive en février. La baisse du taux de rémunération le 1er février ne s’est pas accompagnée d’une sanction de la part des épargnants. La collecte se normalise, les ménages semblant préférer l’assurance vie au potentiel de rendement supérieur.
Livret A : une collecte de 940 millions d’euros en février
Le Livret A a fait mieux en février qu’en janvier avec une collecte de 940 millions d’euros, contre 350 millions d’euros. Ce résultat est néanmoins inférieur à la moyenne de ces dix dernières années, qui était de 1,8 milliard d’euros. En février 2024, elle avait atteint 2,3 milliards d’euros, et en février 2023, le niveau astronomique de 6,27 milliards d’euros. À l’époque, le Livret A était porté par son rendement de 3 % et par le caractère anxiogène de la guerre en Ukraine.
Ces dix dernières années, le Livret A n’a connu en février que deux décollectes, en 2016 (-0,51 milliard d’euros) et en 2015 (-0,97 milliard d’euros), années marquées par la baisse du taux de rendement.
Avec la collecte du mois de février, l’encours du Livret A bat un nouveau record à 442,5 milliards d’euros.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) : une collecte de 640 millions d’euros en février
Le LDDS affiche également une collecte plus élevée en février, à 640 millions d’euros, contre 460 millions d’euros en janvier. Ce résultat est néanmoins inférieur à celui de février 2024 (1,04 milliard d’euros).
La collecte de février 2025 est légèrement supérieure à la moyenne de ces dix dernières années (500 millions d’euros). Deux décollectes ont été enregistrées sur cette période, en 2016 (-120 millions d’euros) et en 2015 (-230 millions d’euros).
L’encours du LDDS atteint, avec 161,7 milliards d’euros, un nouveau sommet.
Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) : un léger mieux en février
Comme le Livret A et le LDDS, le Livret d’Épargne Populaire améliore sa collecte en février par rapport à janvier, avec 350 millions d’euros contre 110 millions. Ce chiffre est cependant loin du résultat de février 2024 (+1,39 milliard d’euros). Avec un encours de 82,7 milliards d’euros, le LEP est à son plus haut historique.
Normalisation sur fond de baisse du rendement
La collecte du Livret A, comme celle du LDDS et du LEP, se banalise. Elle n’a pas été excessivement affectée par la diminution des taux de rémunération. Les ménages semblent accepter cette baisse, mais ils sont désormais plus enclins à regarder ailleurs si l’herbe est plus verte. L’assurance vie a ainsi commencé l’année sur les chapeaux de roue.
Les prochains mois pourraient réserver quelques évolutions, voire des surprises. La multiplication des fausses informations concernant l’utilisation par l’État de l’argent des ménages pour financer la défense va-t-elle provoquer une défiance des épargnants ? À l’inverse, l’augmentation des tensions internationales en Europe pourrait-elle conduire à une nouvelle hausse de l’épargne de précaution ? Il faudra attendre le mois de mars pour disposer de premiers éléments de réponse.
Le contexte ne pousse pas à un réel relâchement de l’effort d’épargne. Avec la baisse de l’inflation et la diminution du rendement de l’épargne réglementée, les ménages pourraient laisser à nouveau plus d’argent sur leurs comptes courants. La bonne tenue du rendement des fonds euros de l’assurance vie pourrait continuer à doper la collecte de ce produit, qui reste en volume le premier placement financier des ménages.
La collecte du Livret A comme du LDDS en février traduit donc une certaine normalisation après plusieurs années exceptionnelles.
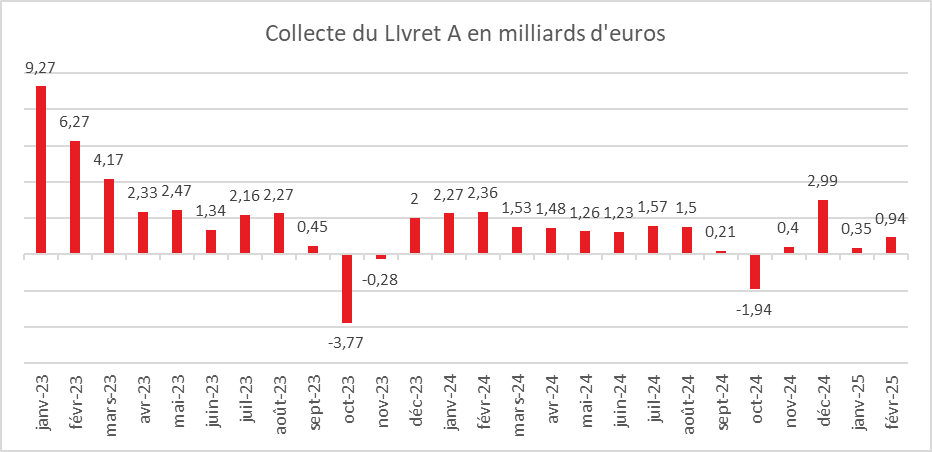
Cercle de l’Epargne – CdC
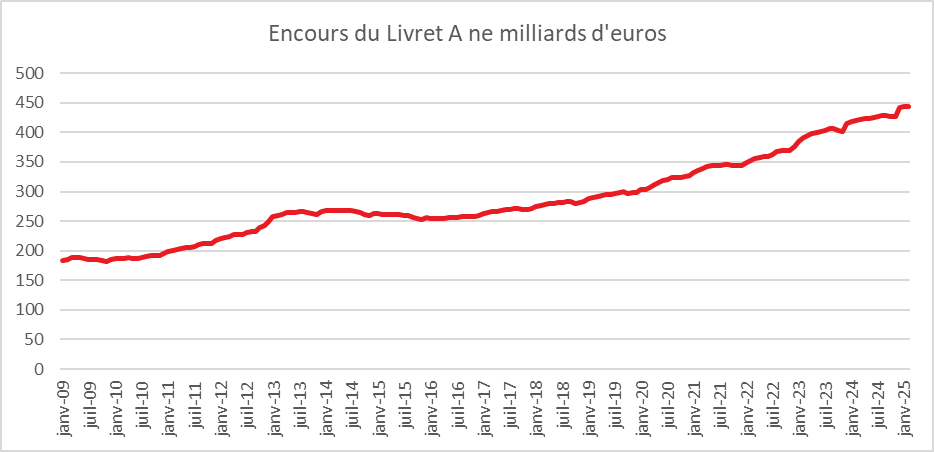
Cercle de l’Epargne – CdC
Le Coin des Epargnants du 21 mars 2025 : des marchés encalminés
Les indices actions européens sont restés atones cette semaine. Le CAC 40 est parvenu à progresser modestement de 0,18 % sur cinq séances. Ce résultat a été obtenu dans un contexte marqué par un volume élevé de transactions lié aux « Quatre sorcières », phénomène technique correspondant à l’arrivée à échéance simultanée de contrats à terme et d’options sur indices et actions. De leur côté, les indices américains ont légèrement progressé cette semaine, mais les pertes depuis le début de l’année restent significatives : près de 8 % pour le Nasdaq et plus de 3,5 % pour le S&P 500.
Les investisseurs demeurent prudents dans l’attente de nouveaux développements concernant la guerre commerciale. Donald Trump s’apprête à instaurer, dès le 2 avril, des droits de douane dits « réciproques », accompagnés de surtaxes ciblant spécifiquement certains secteurs économiques. Les politiques protectionnistes du président américain génèrent ainsi une vague d’incertitude inédite depuis plusieurs années.
Dans ce contexte troublé, l’or apparaît comme le grand gagnant avec une hausse hebdomadaire de 3,4 %. L’once d’or s’échange désormais au-dessus de 3 000 dollars, enregistrant depuis le 1er janvier une progression de près de 15 %. À l’inverse, le bitcoin poursuit son recul, suivant la tendance négative observée sur l’indice américain des valeurs technologiques.
Les cours du pétrole ont connu une tendance haussière cette semaine, influencés par l’annonce de nouvelles sanctions américaines visant à réduire les exportations de pétrole iranien. Le gouvernement américain a notamment sanctionné, jeudi 20 mars, une raffinerie indépendante chinoise accusée de traiter illégalement du brut iranien, réaffirmant ainsi sa volonté de « réduire à zéro » les exportations pétrolières de Téhéran. Ces nouvelles mesures visent à contraindre l’Iran à négocier un nouvel accord sur son programme nucléaire. Toutefois, la hausse du prix du baril devrait rester limitée en raison de l’augmentation constante de la production américaine.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 21 mars 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 8 042,95 | +0,18 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 41 985,35 | +0,83 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 667,56 | +0,51 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 17 784,05 | +0,17 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 22 891,38 | -0,45 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 646,79 | +0,16 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 423,83 | +0,45 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 677,06 | +2,40 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 364,83 | -0,44 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,465 % | -0,101 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,764 % | -0,109 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,254 % | -0,052 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0826 | -0,84 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 3 015,75 | +3,41 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 72,22 | +2,12 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 83 998,79 | -0,88% | 38 252,54 | 93 776,61 |
Des fonds « verts kakis » pour les épargnants
Le Ministère de l’Économie a opté pour la mobilisation de l’épargne en faveur de la défense à travers la mise en place de fonds d’investissement. La Banque Publique d’Investissement créera un fonds accessible au grand public qui pourra acquérir des parts ou des unités de compte pour une valeur d’émission de 500 euros. Ces titres seront logeables dans des contrats d’assurance vie (unités de compte) ou dans des comptes titres (parts).
Ce fonds dont le capital pourrait atteindre 450 millions d’euros aura la faculté de prendre des participations ou de prêter de l’argent aux entreprises du secteur de la défense. Il aura à ce titre vocation à faciliter le financement des investissements rendus nécessaires par l’augmentation des commandes publiques de matériels de défense au sein de l’Union européenne. Le Ministre de l’Économie a évoqué un besoin de 5 milliards d’euros pour l’industrie de la défense.
D’autres fonds mis en œuvre par des acteurs de la place financière française et européenne devraient être également accessibles
En collectant autour de 600 millions d’euros par effet de levier, les fonds pourraient prêter 5 milliards d’euros. Il est fort probable que les fonds n’interviendront pas exclusivement sous la forme de prêts ou d’émission pour le compte de tiers d’obligations, ils prendront des participations (actions).
Un choix logique
Le choix des fonds d’investissement est la réponse la plus rapide pour mobiliser de manière volontaire l’épargne des ménages. En pouvant loger ces fonds dans l’assurance vie, l’industrie de la défense accède ainsi au premier placement des ménages dont l’encours a dépassé 2000 milliards d’euros en janvier 2025. Les assurés sont de plus en plus prompts à investir en unités de compte, ces dernières années. Ces unités de compte ont représenté 40 % de la collecte de l’assurance vie en 2024, les 60 % restant étant dévolus aux fonds en euros.
Un placement volontaire de la part des épargnants
Pas de ponction, de prélèvement, d’orientation obligatoire de l’épargne des ménages ne sont prévus. Le gouvernement n’a pas opté pour un grand emprunt national qui n’aurait ajouté que de la dette publique à la dette publique. Un tel emprunt aurait été en outre compliqué à mettre en œuvre tout comme la création d’un nouveau Livret d’épargne. Le Livret A n’est pas un outil adapté pour financer sur le long cours des entreprises qui interviennent sur le secteur concurrentiel de l’industrie de la défense. Le Livret A ne permet pas des prises de participation dans des entreprises non cotées. Produit liquide par nature, il n’est pas armé pour des investissements de long terme dans des entreprises.
Les épargnants pourront donc opter pour les unités de compte ou les parts des fonds défense. De manière indirecte, dans le cadre de la diversification, les assureurs pourraient insérer dans leurs fonds euros des parts des fonds « défense ».
Un placement par nature de long terme et potentiellement attractif
La montée en puissance de l’industrie de la défense européenne nécessitera du temps. Il est de ce fait logique que le retour sur investissement ne soit pas immédiat. Le Ministre de l’Économie a prévu une période de blocage de 5 ans, le temps nécessaire pour la réalisation des investissements. Cela signifie que les acheteurs ne pourraient pas céder leurs parts durant ce délai. Un tel blocage existe par exemple pour des produits comme le FCPI, des fonds qui financent des entreprises à forte croissance, en particulier dans le secteur technologique. En revanche, à la différence des FCPI, le gouvernement n’a pas associé d’avantage fiscal pour l’achat de parts de son fonds vert kaki.
Compte tenu de la progression de la demande en équipements militaires, le rendement de ce fonds pourrait être attractif et se situer au-dessus de la moyenne sur longue période.
La longue marche vers le marché unique de l’épargne
La Commission européenne a adopté, mercredi 19 mars, sa stratégie pour l’union de l’épargne et des investissements (UEI), une initiative visant à améliorer la manière dont le système financier de l’Union européenne (UE) oriente l’épargne vers des investissements productifs. Cette stratégie s’inscrit dans le prolongement des rapports Draghi et Letta ainsi que des prises de positions de l’ancien ministre de l’Économie, Bruno Lemaire.
La stratégie de l’Union vise à offrir aux citoyens de l’UE un accès plus large aux marchés des capitaux et de meilleures possibilités de financement pour les entreprises afin d’améliorer la compétitivité de l’économie européenne. Les ménages auront des possibilités plus nombreuses et plus sûres d’investir sur les marchés des capitaux et d’accroître la valeur de leur épargne. Dans le même temps, les entreprises pourront se financer plus facilement et à moindres coûts.
Le rapport Draghi estimait entre 750 et 800 milliards d’euros supplémentaires par an d’ici à 2030, les besoins d’investissement sans prendre en compte l’effort en faveur de la défense. Ces besoins concernent, en priorité, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises innovantes, qui ne peuvent pas compter uniquement sur le financement bancaire. En développant des marchés des capitaux intégrés, parallèlement à un système bancaire intégré, l’UEI peut relier efficacement l’épargne aux besoins d’investissement.
L’épargne financière des ménages européens est abondante. Elle peut s’appuyer sur 10 000 milliards d’euros en dépôts bancaires. Les dépôts bancaires sont sûrs et faciles d’accès, mais ils rapportent généralement moins d’argent que les investissements sur les marchés des capitaux. Un des objectifs de l’UEI est d’orienter vers des placements longs et plus rémunérateurs cette épargne actuellement liquide.
La mise en œuvre de l’UEI relève de la responsabilité partagée des institutions de l’UE, des États membres et de toutes les principales parties prenantes. Quatre axes de travail ont été retenus :
- Citoyens et épargne : l’objectif est de permettre aux épargnants d’accéder plus facilement aux instruments des marchés des capitaux offrant un meilleur rendement, notamment dans la perspective de leur retraite ;
- Investissement et financement : afin de stimuler les investissements, en particulier dans les secteurs critiques, la Commission lancera des initiatives visant à améliorer la disponibilité des capitaux et l’accès à ces derniers pour toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises ;
- Intégration et échelle : la réduction des inefficacités dues à la fragmentation suppose la levée des obstacle réglementaires ou prudentiels aux activités transfrontières des infrastructures de marché, à la gestion des actifs et à la répartition des fonds ;
- Surveillance efficace au sein du marché unique : la Commission entend proposer des mesures afin que tous les acteurs des marchés financiers puissent bénéficier d’un même traitement, quel que soit leur lieu d’implantation dans l’UE.
L’UEI vise également à renforcer l’intégration et la compétitivité du secteur bancaire en avançant sur le terrain de l’union bancaire. La Commission évaluera également la situation globale du système bancaire dans le marché unique, y compris sa compétitivité.
La mise en œuvre de l’UEI reposera sur des mesures tant législatives que non législatives, ainsi que sur des mesures qu’il conviendra aux États membres d’élaborer. Au deuxième trimestre de 2027, la Commission publiera un examen à mi-parcours des progrès globaux accomplis dans la réalisation de l’union de l’épargne et des investissements.
Pertes historiques de la Banque de France en 2024
La Banque de France a enregistré, en 2024, selon les résultats publiés mercredi 19 mars dernier, une perte nette historique de 7,7 milliards d’euros. « C’est un chiffre qui n’a pas existé dans l’histoire de la Banque de France », a souligné le gouverneur de la banque, François Villeroy de Galhau, lors d’une conférence de presse, « et qui n’existera plus non plus dans l’avenir prévisible ».
L’année dernière, a Banque de France a réalisé une perte opérationnelle de 17,9 milliards d’euros compensée à hauteur de 10,1 milliards d’euros par des réserves constituées par le passé. En 2023, elle avait déjà connu un perte opérationnelle qui avait atteint 12,4 milliards d’euros, mais celle-ci avait intégralement compensée permettant les résultats d’être à l’équilibre.
La perte nette, privant l’État d’impôts et de dividendes, est la conséquence de collision de deux cycles de taux atypiques. La Banque de France a géré successivement une crise déflationniste ayant atteint son paroxysme avec l’épidémie de Covid et une vague inflationniste après le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022. La Banque de France a été contrainte, dans le cadre de la politique monétaire non conventionnelle de la BCE d’acquérir des obligations à faibles taux, en moyenne 0,7 % entre 2019 et 2022. À compter du milieu de l’année 2022, la Banque de France a été contrainte de mieux rémunérer les dépôts des banques en raison du relèvement des taux directeurs de la BCE qui ont atteint plus de 4 %. L’écart ces deux taux a conduit à une perte importante pour la Banque de France. Le gouverneur a prévenu que la perte pour 2025 serait moindre et a écarté tout besoin de recapitalisation de la part de l’État actionnaire. La Banque de France n’est pas la seule, en zone euro, à être confrontée à ce problème. Les comptes de la banque centrale allemande a enregistré également une perte historique de 19,2 milliards d’euros en 2024, sa première depuis 1979.
Le Coin des Epargnants du 14 mai 2025 : les marchés face à la tempête Trump
Un lundi noir pour la tech
25 ans après l’explosion de la bulle du « Dot.com » en 2000, le Nasdaq a connu un lundi noir, le 10 mars dernier. Les Sept Magnifiques – Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Google et Tesla – ont enregistré un recul important de leur cours en Bourse. Tesla a perdu 15 % en une séance, soit sa plus forte baisse journalière depuis 2020. Apple a cédé 4,85 %, Nvidia 5 %, Alphabet (Google) 4,5 %, Meta 4,4 %, Microsoft 3,3 % et Amazon 2,3 %. Le Nasdaq 100, qui regroupe les principales valeurs technologiques, a clôturé en baisse de 3,8 %, une contraction inédite depuis 2022. Les gains boursiers enregistrés juste après l’investiture de Trump, le 20 janvier dernier, ont été effacés.
Malgré les promesses de dérégulation dont pourrait bénéficier le secteur, les craintes liées à la conduite d’une politique commerciale agressive par le locataire de la Maison-Blanche ont changé la donne. La mise en place de barrières douanières inquiète les milieux économiques. Cette politique pourrait peser sur la croissance et favoriser le retour de l’inflation. Depuis le 21 janvier, l’ensemble des « Sept Magnifiques », à l’exception d’Apple, a basculé en territoire négatif, avec une baisse notable de près de 50 % pour Tesla, 22 % pour Nvidia et entre 10 % et 15 % pour Amazon, Microsoft et Google.
Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk souffre d’un effondrement des ventes en Europe. Tesla pâtit autant du vieillissement de sa gamme que des prises de position de son directeur général. En Allemagne, son soutien à l’AfD s’est accompagné d’un quasi-boycott de la part de nombreux consommateurs. Seuls Meta et Apple résistent au naufrage avec une baisse limitée à 1 %. Depuis le début de l’année, les Sept Magnifiques ont perdu près de 1 570 milliards de dollars de capitalisation boursière.
La bourrasque Trump s’accompagne de doutes sur les retombées de l’intelligence artificielle en matière boursière. Les Sept Magnifiques ont investi et continuent d’investir des centaines de milliards de dollars pour développer leurs modèles d’IA ainsi que l’infrastructure informatique nécessaire à leur déploiement. La rentabilisation de ces investissements sera d’autant plus difficile que la croissance économique reste faible.
Une semaine marquée, une fois de plus, par Donald Trump
Le Cac 40 a terminé la semaine au-dessus des 8 000 points, à 8 028,28 points, lui permettant de réduire sa perte hebdomadaire à 1 %. La guerre commerciale a touché le marché « actions » cette semaine. Les indices européens étaient également en recul. L’euro continue de s’apprécier face au dollar. La devise européenne bénéficie des errements de la politique américaine et des craintes inflationnistes qu’elle inspire. Les plans de réarmement européens incitent les investisseurs internationaux à acheter des actions des entreprises de la défense du Vieux continent ce qui contribue à augmenter la demande en euros. Les taux d’intérêt souverains européens ont continué à augmenter avec la perspective de la fin du frein budgétaire allemand. Les indices américains ont continué, cette semaine, leur repli. Le S&P 500 perd désormais près de 5 % depuis le début de l’année, le Nasdaq, plus de 6 % et le Dow Jones plus de 2 %.
En fin de semaine, les investisseurs ont été soulagé par les nouvelles positives sur le dossier du « shutdown » américain et l’entente trouvée en Allemagne entre le futur chancelier et les députés écologistes sur le programme d’investissements destiné à réarmer et moderniser le pays. Les écologistes ayant affirmé qu’un « accord sur le fonds spécial » avait été conclu, Friedrich Merz devrait disposer de la majorité des deux tiers nécessaire pour faire adopter les changements constitutionnels permettant un assouplissement des règles d’endettement pour les dépenses militaires et les Länder, ainsi qu’un fonds spécial de 500 milliards d’euros sur dix ans pour rénover les infrastructures.
L’épée de Damoclès au-dessus du Congrès des Etats-Unis semble également levée avec la décisions du chef de file des sénateurs démocrates sur le texte budgétaire républicain afin éviter la paralysie de l’administration fédérale. Ce revirement de position réduit la probabilité d’un « shutdown », car des sénateurs démocrates devraient emboiter ses pas. A l’annonce de ce pseudo-accord, les grands indices américains ont enregistré un gain de plus de 1 %. Le moral des ménages américains est pourtant tombé en mars à un point bas inconnu depuis novembre 2022 à 57,9 points, un chiffre inférieur aux estimations de tous les économistes interrogés par Bloomberg. Autre signe d’inquiétude face à la politique de Donald Trump, les anticipations d’inflation se multiplient. Les consommateurs s’attendent à une hausse des prix à un taux annuel de 3,9 % au cours des cinq à dix prochaines années, soit une hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport au mois précédent et le plus élevé depuis plus de trois décennies. Les projections d’inflation sur un an sont passées de 4,3 % à 4,9 %, le plus haut élevé depuis 2022.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 14 mars 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 8 028,28 | -1,05 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 41 488,19 | -2,99 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 638,94 | -2,53 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 19 704,64 | -2,63 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 22 939,39 | -0,16 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 632,33 | -0,49 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | 5 404,18 | -1,21 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
| Nikkei 225 (Japon) | 37 053,10 | -0,74 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 419,56 | +2,77 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,566 % | +0,019 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,873 % | +0,043 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,302 % | +0,077 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0883 | +2,45 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 2 988,81 | +2,24 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 70,42 | -0,03 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 84 598,43 | -6,56 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
L’épineuse question de la saisie des avoirs russes
Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les États occidentaux ont pris des mesures drastiques à l’encontre des actifs russes. Dès les premiers mois du conflit, les États-Unis, l’Union européenne et leurs alliés ont gelé une partie des actifs russes afin de limiter les capacités financières du Kremlin. Environ 300 milliards de dollars d’actifs en devises et obligations ont ainsi été bloqués dans divers pays occidentaux (UE, États-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, Suisse). Ces actifs sont essentiellement placés dans des banques centrales étrangères, principalement sous forme d’obligations d’État (américaines, européennes, etc.). La Russie détenait également des participations dans des entreprises étrangères et des fonds d’investissement, qui ont été gelés.
Le gel des actifs n’implique pas leur confiscation. Ils restent la propriété de la Russie ou des individus concernés. Ils ne peuvent ni être utilisés ni vendus Les revenus qu’ils génèrent ne sont pas distribués aux propriétaires Les Occidentaux réfléchissent depuis plusieurs mois au devenir des actifs russes gelés. Deux options sont étudiées : l’utilisation des seuls revenus ou la saisie pure et simple des actifs.
L’Union européenne (UE) et ses alliés envisagent d’utiliser uniquement les revenus générés par les 300 milliards d’euros d’actifs russes gelés (dont 200 milliards d’euros pour l’UE). Les intérêts et les dividendes pourraient rapporter entre 3 et 5 milliards d’euros par an. Ces revenus pourraient être affectés à l’Ukraine (achat d’armes, reconstruction, aide humanitaire) sans toucher au capital initial. Cette solution permettrait d’éviter une violation frontale du droit international relatif à l’immunité des États. Les actifs, notamment ceux de la Banque centrale russe placés dans les banques centrales occidentales, sont des actifs souverains protégés par le droit international. L’utilisation exclusive des revenus réduirait également le risque de représailles financières de la Russie.
Contrairement au gel, la saisie d’actifs entraînerait un transfert de propriété définitif, permettant leur utilisation au profit de l’Ukraine ou des États appliquant la confiscation. Cette option fait l’objet d’un intense débat juridique et politique. Un tel transfert pourrait financer la reconstruction de l’Ukraine – dont le coût est estimé à plus de 400 milliards de dollars – et sanctionner durablement la Russie en la privant de ressources financières.
Une confiscation sans base juridique claire pourrait toutefois créer un précédent risqué et fragiliser la confiance dans le système financier international. D’autres États, comme la Chine, pourraient réagir en réduisant leurs investissements en Occident, de peur de voir leurs actifs gelés en cas de tensions géopolitiques.
L’idée de la saisie fait son chemin au sein des parlements occidentaux, même si les gouvernements restent prudents. Aux États-Unis, le Congrès a adopté en 2024 un projet de loi facilitant la confiscation des actifs russes pour aider l’Ukraine. Le Canada a également adopté une loi permettant la saisie de certains actifs russes.
En Europe, certains pays (Estonie, Lituanie, Pologne) sont favorables à une saisie totale, tandis que d’autres (France, Allemagne) restent plus prudents en raison des implications juridiques. Néanmoins, en France, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis du gouvernement, une résolution, le 12 mars, en première lecture, visant à permettre la saisie des biens russes. Au Royaume-Uni, un projet similaire pourrait être prochainement discuté. La Russie a menacé de saisir des actifs occidentaux en représailles. Depuis mars 2022, des entreprises étrangères présentes en Russie ont déjà vu leurs participations placées sous contrôle étatique.
Dans l’histoire, les saisies d’actifs financiers sont rares et sont généralement liées à des événements exceptionnels.
Durant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1941, les États-Unis ont saisi des actifs appartenant à des ressortissants allemands, italiens et japonais, notamment des entreprises et des comptes bancaires.
En 1960, après la révolution cubaine, le gouvernement américain a saisi des avoirs cubains en réaction à la nationalisation des entreprises américaines par Fidel Castro. En 1980, lors de la crise des otages américains à Téhéran, certains actifs iraniens ont été définitivement confisqués et utilisés pour indemniser les victimes. En 1982, pendant la guerre des Malouines, le Royaume-Uni, en plus du gel, a saisi certains actifs argentins en représailles.
Des nationalisations d’actifs étrangers ont également eu lieu dans plusieurs pays. Ainsi, au Mexique, en 1938, le gouvernement a nationalisé les compagnies pétrolières étrangères, notamment britanniques et américaines, expropriant leurs actifs. En Libye, en 1970, Mouammar Kadhafi a exproprié les compagnies pétrolières occidentales et confisqué leurs infrastructures. Plus récemment, entre 2007 et 2010, Hugo Chávez a nationalisé plusieurs entreprises étrangères au Venezuela, notamment dans les secteurs pétrolier et industriel, transférant leurs actifs à l’État.
Le Coin des Epargnants du 7 mars : les marchés financiers : entre protectionnisme et effort de guerre
Des marchés à la recherche du Nord
Les premières semaines de la présidence de Donald Trump mettent les investisseurs sous pression. Les ordres et contre-ordres dans la guerre commerciale rendent toute prévision et projection impossibles. Dans le désordre global dans lequel le président américain plonge le monde, l’économie américaine plie sans rompre. Ainsi, au mois de février, elle a créé 151 000 emplois. Ce nombre est légèrement inférieur aux projections, mais ces dernières heures, les investisseurs craignaient qu’il soit encore plus mauvais. Le taux de chômage est en légère hausse, à 4,1 % de la population active. Concernant la rémunération, la croissance du salaire horaire moyen s’est établie à 4 % en rythme annuel, après +3,9 % en janvier (chiffre révisé à la baisse de deux dixièmes de point) et +4,1 % attendu.
Les stratégies de l’administration Trump pour réduire les effectifs du gouvernement fédéral et la guerre commerciale décousue minent le moral des dirigeants d’entreprise et des ménages. La position édulcorée vis-à-vis du Canada et du Mexique – la Maison-Blanche ayant suspendu les droits de douane sur une partie de leurs exportations – n’a pas rassuré les milieux économiques. La suspension ne court que jusqu’au 2 avril, date à laquelle des tarifs réciproques et l’alignement des tarifs américains sur ceux des pays étrangers sont censés entrer en application. D’ailleurs, Donald Trump menace désormais de s’en prendre économiquement à la Russie en relevant le niveau des sanctions et des droits de douane. Donald Trump apparaît de plus en plus difficile à suivre.
Les indices américains ont de nouveau reculé cette semaine. Le S&P 500 a perdu plus de 3 %, tout comme le Nasdaq. Ce dernier est en recul de plus de 5 % depuis le début de l’année. Les indices européens, quant à eux, ont connu cette semaine de faibles variations.
La semaine a été marquée, par ailleurs, par le recul du prix du pétrole malgré les menaces de nouvelles sanctions américaines à l’encontre de la Russie. Le baril de Brent s’échangeait à 70 dollars vendredi 7 mars, son plus bas niveau depuis 2021, en lien avec la progression à venir de la production des pays de l’OPEP et les stocks élevés aux États-Unis. À partir du mois d’avril, la production des pays exportateurs et de leurs alliés (OPEP+) devrait aboutir au retour sur le marché de 2,2 millions de barils quotidiens. Si le programme de hausse est respecté, au vu de la demande actuelle, un baril à 60 dollars n’est pas impossible.
Baisse des taux directeurs par la BCE
La Banque centrale européenne (BCE) a décidé, jeudi 6 mars, une baisse de ses taux directeurs d’un quart de point, la sixième depuis juin. À partir du 13 mars, les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés respectivement à 2,5 %, 2,65 % et 2,9 %.
Ce nouvel assouplissement était anticipé par les investisseurs, d’autant plus que l’inflation de la zone euro s’établit à 2 %, soit la cible que s’est fixée la Banque centrale. L’inflation sur douze mois s’est établie en février à 2,4 %, contre 2,5 % en janvier. L’inflation sous-jacente (hors prix de l’énergie et des produits agroalimentaires non transformés) a également baissé à 2,6 %, après des mois de stagnation. Les nouvelles projections des économistes de la Banque centrale anticipent une hausse des prix limitée à 2 % début 2026.
Au sein du Conseil des gouverneurs, plusieurs voix s’élèvent en faveur d’un ralentissement du rythme des baisses des taux directeurs, compte tenu des annonces de relance des dépenses publiques de plusieurs gouvernements. L’Allemagne aurait l’ambition d’investir 500 milliards d’euros sur cinq ans dans les infrastructures et la modernisation du pays, et de lever le frein constitutionnel à la dette pour financer le réarmement. Le projet de plan de 800 milliards d’euros au niveau européen, destiné au renforcement de la défense sur fond de désengagement américain, pourrait accroître les tensions sur les taux longs et sur l’inflation. La politique de Donald Trump pourrait également avoir des effets négatifs sur les prix : la guerre commerciale risque de s’accompagner d’une hausse des prix des produits importés. Dans ce contexte, une seule baisse des taux directeurs est désormais attendue d’ici la fin de l’année, contre deux auparavant.
Hausse des taux souverains européens
L’augmentation des besoins financiers des États, liée au réarmement, conduit à une hausse des taux des obligations souveraines. Les taux allemands à 10 ans se sont tendus de 40 points de base durant la semaine, évoluant autour de 2,9 % jeudi 6 mars. Les taux français ont grimpé à 3,60 %, leur plus haut niveau depuis 2011, lors de la crise de la zone euro. En parallèle, la réduction du bilan de la Banque centrale, par laquelle la BCE retire de la liquidité du système financier, constitue également une mesure restrictive.
Aux États-Unis, les contrats à terme sur les Fed funds de la Réserve fédérale continuent de projeter trois baisses des taux directeurs d’ici la fin de l’année (en juin, juillet et octobre). Néanmoins, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d’un événement organisé par la Booth School of Business de l’Université de Chicago à New York que les responsables de la Fed n’avaient pas besoin de se précipiter pour ajuster leur politique, malgré l’incertitude accrue des perspectives économiques américaines.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
| Résultats 7 mars 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
| CAC 40 | 8 120,80 | -0,03 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
| Dow Jones | 42 801,72 | -2,50 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
| S&P 500 | 5 770,20 | -3,32 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
| Nasdaq Composite | 18 196,22 | -3,84 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
| Dax Xetra (Allemagne) | 23 001,04 | +2,25 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 679,88 | -1,39 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
| Eurostoxx 50 | -0,21 % | 4 518,28 | 4 895,98 | |
| Nikkei 225 (Japon) | 36 887,17 | -3,53 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
| Shanghai Composite | 3 372,55 | +0,79 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
| Taux OAT France à 10 ans | +3,547 % | +0,403 pt | +2,558 % | +3,194 % |
| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,830387 % | +0,443 pt | +2,023 % | +2,362 % |
| Taux Trésor US à 10 ans | +4,225 % | +0,001 pt | +3,866 % | +4,528 % |
| Cours de l’euro/dollar | 1,0854 | +3,24 % | 1,1060 | 1,0380 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 2 913,75 | -0,03 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 70,33 | -3,65 % | 77,13 | 74,30 |
| Cours du Bitcoin en dollars | 87 042,97 | +5,27 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
Mobilisation générale pour la défense
Les États européens se sont engagés à accroître sensiblement leur effort de défense pour atteindre a minima 2 % du PIB, voire 3 %. La marche à franchir est haute et suppose une forte mobilisation financière.
La réaction de l’Europe face au défi américain
La plan de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présenté, le mardi 4 mars dernier à la presse, a été adopté par le Conseil européen exceptionnel du 6 mars. Ce plan prévoit de mobiliser près de 800 milliards d’euros. « L’Europe est prête à fortement augmenter ses dépenses pour la défense, devant les urgences à court terme, l’urgence à soutenir l’Ukraine, mais aussi à faire face aux besoins à long terme d’assumer une plus grande responsabilité pour notre propre sécurité européenne », a déclaré la présidente de la Commission européenne. Elle a confirmé sa volonté de suspendre les règles du Pacte de stabilité et de croissance afin que les États membres puissent augmenter leurs dépenses pour la défense sans engager un processus de déficit excessif. La France qui est déjà placée sous la contrainte de ce processus n’est, de ce fait, pas concernée.
La Présidente de la Commission a annoncé la création d’un « nouvel instrument permettant de dégager 150 milliards de prêts aux États membres » pour investir « mieux et ensemble » dans la défense antiaérienne, les systèmes d’artillerie, les missiles, les munitions, les drones, les systèmes de défenses anti-drones, mais aussi pour faire face à d’autres besoins dans le domaine cyber et dans la mobilité militaire. L’UE veut aussi proposer « des possibilités et des incitations supplémentaires pour les États membres afin qu’ils puissent décider eux-mêmes s’ils souhaitent utiliser les programmes de politiques de cohésion pour renforcer leurs dépenses en matière de défense ». Des mesures visant à mobiliser les capitaux privés sont également prévu avec une accélération de la mise en place d’un grand marché des capitaux et de l’épargne au niveau européens. Le mandat de la Banque européenne d’investissement devrait évoluer afin qu’elle puisse fournir des prêts en matière de défense.
Mobilisation générale de l’épargne
La loi de finances pour 2025 a prévu 60 milliards d’euros pour la défense, soit 2 % du PIB (dont 9 milliards de contributions aux pensions de retraite des militaires). La Loi de Programmation Militaire prévoit une augmentation des dépenses de 3 milliards d’euros par an jusqu’en 2030. Or, cette montée en puissance devra être accélérée afin de pouvoir relever à 3/3,5 % du PIB l’effort de défense comme le demande le Président de la République. Pour respecter cet objectif, chaque année, les dépenses pour les armées devront donc augmenter d’environ 10 milliards d’euros. Elles atteindraient ainsi 100 milliards d’euros en 2029. Or, dans le même temps, l’État doit ramener le déficit public de 6 à 3 % du PIB.
Les pouvoirs publics espèrent sans nul doute qu’une partie de l’effort puisse reposer sur l’Union européenne. Des fonds de cohésion structurels, des fonds de programmes existants non utilisés pourraient être utilisés. La possibilité pour la Commission de lancer des emprunts communs ou d’avoir recours au Mécanisme européen de stabilité a été évoqué.
La piste de l’appel à l’épargne des Français a été avancée par Emmanuel Macron. Plusieurs pistes sont possibles. La première consisterait à reprendre le fléchage du Livret A vers l’industrie de la défense. Cette proposition a déjà fait l’objet d’amendements dans le cadre de la loi de programmation militaire et de la loi de finances pour 2024, amendements adoptés mais annulés par le Conseil Constitutionnel pour une raison de forme, ils n’avaient pas lieu d’être dans les textes en question (cavaliers législatif et budgétaire). Le sénateur Pascal Allizard a déposé une proposition de loi qui reprend le principe de ce fléchage du Livret A ainsi que du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) en faveur de la défense, proposition qui a été adoptée au Palais du Luxembourg fin 2023 mais qui attend toujours une première lecture à l’Assemblée nationale. Le fléchage proposé est censé de ne pas réduire l’enveloppe de prêts destinés aux bailleurs sociaux. Le Ministère de l’Économie n’est guère favorable à ce fléchage. Il considère que rien n’interdit les banques de prêter à partir des ressources du Livret A aux PME de la défense. Il craint la multiplication des demandes corporatistes et une gestion de plus en plus complexe du Livret A.
Un Livret Bleu Blanc Rouge ou vert kaki
À défaut du fléchage, l’idée de la création d’un Livret d’épargne défense, LED ou Livret Bleu Blanc Rouge à défaut d’être vert kaki a été avancée. Ce Livret pourrait reprendre la philosophie du Livret A. Les ressources collectées pourraient servir de base à des prêts aux entreprises de la défense. Néanmoins, l’équation d’un tel livret n’est pas évidente. Pour attirer les épargnants, un taux de rémunération convenable doit être proposée or plus celui-ci est élevé, plus le coût de la ressource l’est. Or, les entreprises doivent pouvoir bénéficier de prêts avec des taux compétitifs. L’exonération fiscale et sociale qui pourrait être associée à ce type de produit est, de son côté, un manque à gagner pour l’État au moment où il recherche des recettes pour réduire son imposant déficit public.
La création d’un ou plusieurs supports de placement « défense nationale »
La création d’un fonds « défense nationale » qui prendrait la forme d’un Organisme de Placement Collectif. Les investisseurs institutionnels pourraient être appelés à souscrire à ce fonds qui pourrait être également proposé aux épargnants (unités de compte dans l’assurance vie ou le Plan d’Épargne Retraite, parts d’OPC sur les comptes titres ou PEA).
Ce fonds pourrait prendre notamment des participations dans des entreprises de la défense ou souscrire à des obligations émises par ces dernières. Les épargnants bénéficieraient des revenus de ce fonds.
Labellisation « entreprises souveraines »
Au côté du Label ISR pour la protection de l’environnement pourrait être imaginé un label « souveraineté nationale » qui aurait vocation à inciter les épargnants à choisir les fonds concernés.
Actuellement, selon les chiffres de l’Otan seuls les Pays baltes, la Pologne et la Grèce consacrent plus de 3 % de leur richesse nationale aux dépenses militaires. De leur côté, l’Italie ou l’Espagne réalisent un effort inférieur à 1,5 % de leur PIB.
Les grands emprunts « une fausse bonne idée »
Les gouvernements dans les périodes de conflit militaire ont fait appel public à l’épargne. En novembre 1915 fut lancé le Premier emprunt de la Défense nationale (novembre 1915). Un taux de 5 % était alors offert. Un deuxième fut lancé en octobre 1916 et a rapporté 11 milliards de francs à l’État. Le troisième emprunt de la Défense nationale, lancé en novembre 1917 a rapporté près de 15 milliards de francs. Enfin, un quatrième fut lancé en octobre 1918 à la fin de la guerre. Il a permis à l’État de récupérer plus de 20 milliards de francs. Ces emprunts étaient soutenus par des campagnes de communication avec des affiches et des slogans patriotiques destinés à convaincre les Français de soutenir l’effort de guerre. Après la fin de celle-ci, les gouvernements mobilisèrent l’épargne des ménages en faveur de la reconstruction. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy lancé également des grands emprunts notamment pour financer les contributions imposées par l’Allemagne nazie. Après 1945, des emprunts pour la modernisation du pays et de l’armée ont été lancés. En 1952, Antoine Pinay, Président du Conseil, décide la création d’un emprunt pour rassurer les épargnants et stabiliser la monnaie. Cet emprunt est indexé sur l’or, garantissant aux souscripteurs une protection contre l’inflation. La hausse du cours de l’or dans les années suivantes a alourdi le remboursement, rendant cet emprunt très coûteux pour l’État. Il en sera de même avec l’emprunt Giscard d’Estaing de 1973.
Avec l’augmentation de ses besoins financiers et la mutation des marchés financiers avec notamment leur digitalisation, l’État a abandonné le recours aux grands emprunts publics préférant recourir à des émissions d’Obligations assimilables du Trésor qui sont souscrites par les établissements financiers de la place. Ces derniers les replacent sur le marché secondaire. Les particuliers n’accèdent aux obligations d’État que de manière indirecte (fonds euros, parts d’Organismes de Placements Collectifs).
Le lancement d’un grand emprunt national pourrait s’avérer coûteux pour l’État tant au niveau de sa distribution que de sa gestion.
Le gouvernement pourrait avoir l’idée d’un emprunt obligatoire auquel devraient souscrire tous les contribuables. Cette option a été utilisée en 1976 avec l’impôt sécheresse qui était remboursé l’année suivante et en 1983. Ce type d’opération n’est pas, pour le moins, très populaire.
« Effort de défense et épargne » par Philippe Crevel
La loi de finances pour 2025 a prévu 60 milliards d’euros pour la défense, soit 2 % du PIB (dont 9 milliards de contributions aux pensions de retraite des militaires). La Loi de Programmation Militaire prévoit une augmentation des dépenses de 3 milliards d’euros par an jusqu’en 2030. Or, cette montée en puissance devra être accélérée afin de pouvoir relever à 3/3,5 % du PIB l’effort de défense comme le demande le Président de la République. Pour respecter cet objectif, chaque année, les dépenses pour les armées devront donc augmenter d’environ 10 milliards d’euros. Elles atteindraient ainsi 100 milliards d’euros en 2029. Or, dans le même temps, l’État doit ramener le déficit public de 6 à 3 % du PIB.
Les pouvoirs publics espèrent sans nul doute qu’une partie de l’effort puisse reposer sur l’Union européenne. Des fonds de cohésion structurels, des fonds de programmes existants non utilisés pourraient être utilisés. La possibilité pour la Commission de lancer des emprunts communs ou d’avoir recours au Mécanisme européen de stabilité a été évoqué.
La piste de l’appel à l’épargne des Français a été avancée par Emmanuel Macron. Plusieurs pistes sont possibles. La première consisterait à reprendre le fléchage du Livret A vers l’industrie de la défense. Cette proposition a déjà fait l’objet d’amendements dans le cadre de la loi de programmation militaire et de la loi de finances pour 2024, amendements adoptés mais annulés par le Conseil Constitutionnel pour une raison de forme, ils n’avaient pas lieu d’être dans les textes en question (cavaliers législatif et budgétaire). Le sénateur Pascal Allizard a déposé une proposition de loi qui reprend le principe de ce fléchage du Livret A ainsi que du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) en faveur de la défense, proposition qui a été adoptée au Palais du Luxembourg fin 2023 mais qui attend toujours une première lecture à l’Assemblée nationale. Le fléchage proposé est censé de ne pas réduire l’enveloppe de prêts destinés aux bailleurs sociaux. Le Ministère de l’Économie n’est guère favorable à ce fléchage. Il considère que rien n’interdit les banques de prêter à partir des ressources du Livret A aux PME de la défense. Il craint la multiplication des demandes corporatistes et une gestion de plus en plus complexe du Livret A.
Un Livret Bleu Blanc Rouge ou vert kaki
À défaut du fléchage, l’idée de la création d’un Livret d’épargne défense, LED ou Livret Bleu Blanc Rouge à défaut d’être vert kaki a été avancée. Ce Livret pourrait reprendre la philosophie du Livret A. Les ressources collectées pourraient servir de base à des prêts aux entreprises de la défense. Néanmoins, l’équation d’un tel livret n’est pas évidente. Pour attirer les épargnants, un taux de rémunération convenable doit être proposée or plus celui-ci est élevé, plus le coût de la ressource l’est. Or, les entreprises doivent pouvoir bénéficier de prêts avec des taux compétitifs. L’exonération fiscale et sociale qui pourrait être associée à ce type de produit est, de son côté, un manque à gagner pour l’État au moment où il recherche des recettes pour réduire son imposant déficit public.
La création d’un ou plusieurs supports de placement « défense nationale »
La création d’un fonds « défense nationale » qui prendrait la forme d’un Organisme de Placement Collectif. Les investisseurs institutionnels pourraient être appelés à souscrire à ce fonds qui pourrait être également proposé aux épargnants (unités de compte dans l’assurance vie ou le Plan d’Épargne Retraite, parts d’OPC sur les comptes titres ou PEA).
Ce fonds pourrait prendre notamment des participations dans des entreprises de la défense ou souscrire à des obligations émises par ces dernières. Les épargnants bénéficieraient des revenus de ce fonds.
Labellisation « entreprises souveraines »
Au côté du Label ISR pour la protection de l’environnement pourrait être imaginé un label « souveraineté nationale » qui aurait vocation à inciter les épargnants à choisir les fonds concernés.
Actuellement, selon les chiffres de l’Otan seuls les Pays baltes, la Pologne et la Grèce consacrent plus de 3 % de leur richesse nationale aux dépenses militaires. De leur côté, l’Italie ou l’Espagne réalisent un effort inférieur à 1,5 % de leur PIB.
Les grands emprunts « une fausse bonne idée »
Les gouvernements dans les périodes de conflit militaire ont fait appel public à l’épargne. En novembre 1915 fut lancé le Premier emprunt de la Défense nationale (novembre 1915). Un taux de 5 % était alors offert. Un deuxième fut lancé en octobre 1916 et a rapporté 11 milliards de francs à l’État. Le troisième emprunt de la Défense nationale, lancé en novembre 1917 a rapporté près de 15 milliards de francs. Enfin, un quatrième fut lancé en octobre 1918 à la fin de la guerre. Il a permis à l’État de récupérer plus de 20 milliards de francs. Ces emprunts étaient soutenus par des campagnes de communication avec des affiches et des slogans patriotiques destinés à convaincre les Français de soutenir l’effort de guerre. Après la fin de celle-ci, les gouvernements mobilisèrent l’épargne des ménages en faveur de la reconstruction. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy lancé également des grands emprunts notamment pour financer les contributions imposées par l’Allemagne nazie. Après 1945, des emprunts pour la modernisation du pays et de l’armée ont été lancés. En 1952, Antoine Pinay, Président du Conseil, décide la création d’un emprunt pour rassurer les épargnants et stabiliser la monnaie. Cet emprunt est indexé sur l’or, garantissant aux souscripteurs une protection contre l’inflation. La hausse du cours de l’or dans les années suivantes a alourdi le remboursement, rendant cet emprunt très coûteux pour l’État. Il en sera de même avec l’emprunt Giscard d’Estaing de 1973.
Avec l’augmentation de ses besoins financiers et la mutation des marchés financiers avec notamment leur digitalisation, l’État a abandonné le recours aux grands emprunts publics préférant recourir à des émissions d’Obligations assimilables du Trésor qui sont souscrites par les établissements financiers de la place. Ces derniers les replacent sur le marché secondaire. Les particuliers n’accèdent aux obligations d’État que de manière indirecte (fonds euros, parts d’Organismes de Placements Collectifs).
Le lancement d’un grand emprunt national pourrait s’avérer coûteux pour l’État tant au niveau de sa distribution que de sa gestion.
Le gouvernement pourrait avoir l’idée d’un emprunt obligatoire auquel devraient souscrire tous les contribuables. Cette option a été utilisée en 1976 avec l’impôt sécheresse qui était remboursé l’année suivante et en 1983. Ce type d’opération n’est pas, pour le moins, très populaire.
Philippe Crevel
Assurance vie : un début d’année canon !
L’assurance vie démarre sur les chapeaux de roue avec une forte collecte nette et le passage de la barre symbolique des 2 000 milliards d’euros d’encours.
Un mois de janvier en mode « épargne longue »
Si, en janvier, la collecte du Livret A a été à la peine avec 350 millions d’euros, celle de l’assurance vie, à hauteur de 4,5 milliards d’euros, témoigne du retour en force du premier placement des ménages. Il faut remonter à 2010 pour retrouver une collecte nette plus forte au mois de janvier. Ce résultat a été porté par les unités de compte, dont la collecte nette s’est élevée à 5,2 milliards d’euros, tandis qu’en revanche, les fonds en euros ont enregistré une décollecte de 600 millions d’euros.
Le mois de janvier est traditionnellement favorable à l’assurance vie. En janvier 2024, la collecte avait atteint 2,258 milliards d’euros. Depuis 2008, une seule décollecte a été enregistrée au cours du premier mois de l’année, en 2012, avec -1,332 milliard d’euros. Cette année-là fut une annus horribilis pour l’assurance vie en raison des menaces pesant sur l’euro, dans un contexte de crise des dettes souveraines. La moyenne de la collecte en janvier, ces dix dernières années, s’élève à 2 milliards d’euros.
Record historique pour les cotisations
Les ménages restent en mode épargne, comme en témoigne le montant des cotisations, qui a atteint 17,3 milliards d’euros en janvier, soit une hausse de 10 % par rapport à janvier 2024. Ce montant constitue un record pour l’assurance vie. Les Français ont privilégié ce placement en début d’année, notamment après l’annonce des rendements des fonds en euros pour 2024, autour de 2,7 %, qui a renforcé l’attractivité du produit. De plus, la baisse du taux du Livret A, confirmée en janvier, a joué en faveur de l’assurance vie. La hausse des cotisations a été particulièrement marquée pour les fonds en euros (+12 %), tandis que celle des unités de compte s’établit à 6 %.
Des prestations en baisse
En janvier, les ménages ont peu puisé dans leur assurance vie pour financer leurs projets. Les prestations se sont élevées à 12,8 milliards d’euros, en baisse de 6 % par rapport à janvier 2024. Elles diminuent également de 6 % pour les supports en euros, preuve de l’attractivité retrouvée de ce type de placement.
Un encours au-dessus de 2 000 milliards d’euros
Pour la première fois de son histoire, l’assurance vie dépasse les 2 000 milliards d’euros d’encours. Cette augmentation est liée aux bonnes collectes des derniers mois et à la valorisation des actifs, tant en fonds en euros qu’en unités de compte.
Vent porteur pour l’assurance vie
L’assurance vie bénéficie d’un contexte favorable à l’épargne. Les ménages continuent de privilégier l’épargne en raison des nombreuses incertitudes économiques, géopolitiques et politiques. La baisse des rendements des livrets réglementés et des dépôts à terme, conséquence de la diminution des taux directeurs de la Banque centrale européenne et de l’inflation, rend les fonds en euros de l’assurance vie plus compétitifs.
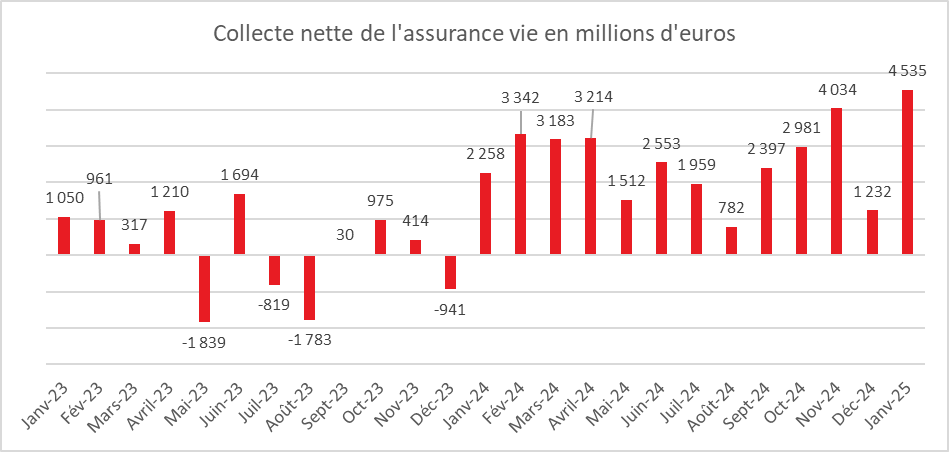
France assureurs
Rémunération des livrets bancaires : 0,88 % en janvier 2025
En janvier 2025, selon la Banque de France, la rémunération globale des encours de dépôts bancaires est inchangée par rapport à décembre 2024 et s’établit à 1,78 %. Si la rémunération moyenne des encours de dépôts bancaires est stable pour les ménages, elle marque une progression de 4 points de base pour les sociétés non financières (SNF). Le taux de rémunération des livrets bancaires est en légère hausse en janvier à 0,90 %. la rémunération des dépôts à terme de moins de deux ans est en légère baisse à 2,98 %
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||
| janv- 2025 (p) | janv- 2024 | nov- 2024 | déc- 2024 (r) | janv- 2025 (p) | |
| Dépôts bancaires (b) | 3 124 | 1,88 | 1,80 | 1,78 | 1,78 |
| dont Ménages | 1 887 | 1,90 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| dont : – dépôts à vue | 540 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| – comptes à terme <= 2 ans (c) | 87 | 3,52 | 3,21 | 3,08 | 2,98 |
| – comptes à terme > 2 ans (c) | 99 | 2,00 | 2,37 | 2,35 | 2,34 |
| – livrets à taux réglementés (d) | 721 | 3,28 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| dont : livret A | 406 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| – livrets ordinaires | 219 | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 0,90 |
| – plan d’épargne-logement | 220 | 2,60 | 2,63 | 2,63 | 2,64 |
| dont SNF | 851 | 1,96 | 1,77 | 1,69 | 1,73 |
| dont : – dépôts à vue | 515 | 0,83 | 0,70 | 0,67 | 0,68 |
| – comptes à terme <= 2 ans (c) | 264 | 3,81 | 3,42 | 3,26 | 3,30 |
| – comptes à terme > 2 ans (c) | 72 | 3,35 | 3,59 | 3,44 | 3,48 |
| Pour mémoire : | |||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 4,50 | 3,40 | 3,15 | 3,15 | |
| Euribor 3 mois (e) | 3,93 | 3,01 | 2,82 | 2,70 | |
| Rendement du TEC 2 ans (e), (f) | 2,65 | 2,34 | 2,21 | 2,42 | |
| Rendement du TEC 5 ans (e), (f) | 2,46 | 2,66 | 2,55 | 2,82 | |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)
c. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
d. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
e. Moyenne mensuelle.
f. Taux de l’Échéance Constante 2 ans et 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
r. Données révisées.
p. Données provisoires.
Données Banque de France
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


