Près de 16 500 milliards d’euros de patrimoine en France
Fin 2019, le patrimoine économique national net s’élève à 16 421 milliards d’euros, soit l’équivalent de 8,3 fois le produit intérieur net de l’année. Ce ratio dépasse les niveaux historiques de 2011 et 2018 (8,1 fois le produit intérieur net de l’année).. La hausse du patrimoine a été de près de 5 % en 2019 (+4,8 % contre, contre +4,4 % en 2018). L’augmentation est largement lié à la valorisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières. Les terrains bâtis ont connu une hausse de 6,6 %. En raison du rebond des cours des actions, le solde du patrimoine financier net s’établit à + 125 milliards d’euros en 2019. Il est à noter qu’avec l’accroissement de l’endettement financier, le passif financier est aussi en hausse.
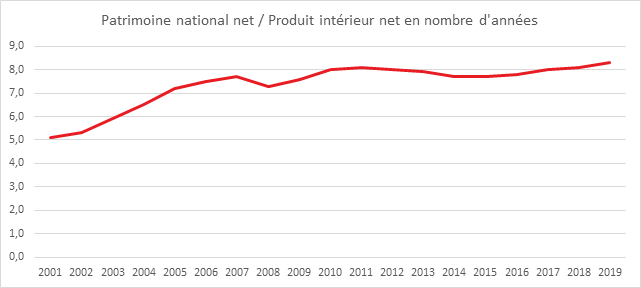
Plus de 12 500 milliards d’euros de patrimoine pour les ménages
Fin 2019, le patrimoine net des ménages s’établit à 12 561 milliards d’euros, soit 8,8 fois le revenu disponible net des ménages. La progression a été de 6,2 % en 2019, contre +2,1 % en 2018.
Le patrimoine non financier des ménages s’élève à 8 451 milliards d’euros. En son sein l’immobilier représente 7 736 milliards d’euros, soit 61 % du patrimoine total. de l’ensemble.
Le patrimoine financier brut des ménages était de 5 872 milliards d’euros en 2019. Le passif financier s’élevait à 1762 milliards d’euros. Le patrimoine financier net était donc de 4 110 milliards d’euros, en augmentation de 10,4 % en 2019, après avoir baissé de 2,6 % en 2018.
Le numéraire et les dépôts représentaient 1650 milliards d’euros en hausse en 2019 de 5,8 %. Les actifs des ménages en assurance-vie et épargne retraite (35 % de leurs actifs financiers totaux) a fortement augmenté en 2019, + 9,0 % après – 1,1 % toujours en lien avec la forte appréciation des cours boursiers.
Au passif des ménages, les crédits continuent de croître (+ 6,1 %, après + 5,1 %), soutenus par la hausse des prix des logements (+ 3,8 %).
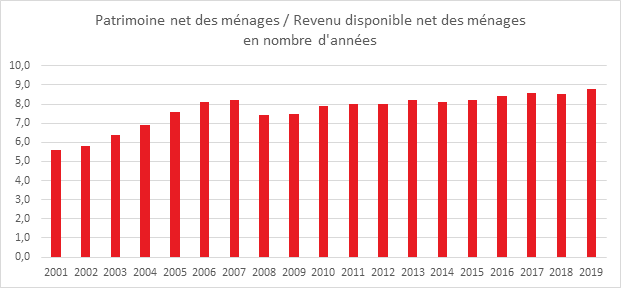
Les fonds propres des sociétés non financières en hausse
Fin 2019, la valeur nette des sociétés non financières (SNF) atteint 2 955 milliards d’euros. Le patrimoine non financier des SNF progresse au même rythme qu’en 2018 (+ 5,0 % après + 5,1 %) et atteint 5 266 milliards d’euros. Cela s’explique principalement par le maintien de l’investissement dans la construction (+ 6,1 % en 2018 et 2019).
Les passifs financiers des sociétés financières en forte hausse
Fin 2019, le patrimoine net des sociétés financières s’élève à 577 milliards d’euros. Il baisse de 12,6 % après une hausse de 19,2 % en 2018. la hausse plus rapide des passifs financiers (+ 7,8 %) que des actifs financiers (+ 7,0 %) qui explique la dégradation de leur situation nette. Au total, l’encours des fonds propres s’élève à 3 270 milliards d’euros en 2019. Il progresse de 6,1 % après un net recul (– 4,1 % en 2018).
Le patrimoine net des administrations publiques en hausse en 2019
Le patrimoine net des administrations publiques s’accroît de 10,3 % malgré la progression de leur endettement, pour atteindre 328 milliards d’euros fin 2019, sous l’effet conjoint de l’investissement en constructions et terrains bâtis et des valorisations boursières.
Le Coin des Epargnants du 12 décembre 2020 : quand le Brexit se rappelle à nous
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 18 décembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 507,55 | -1,81 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 30 046,37 | -0,57 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 12 377,87 | -0,69 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 114,30 | -1,39 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 546,75 | -0,05 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 485,84 | -1,51 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 26 652,52 | -0,37 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 347,19 | -2,83 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,384 % | -0,069 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,637% | -0,087 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,878 % | -0,095 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2111 | -0,06 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 842,143 | +0,20 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 49,900 | +1,75 % | 66,300 |
Quand le Brexit se rappelle à notre bon souvenir
Les marchés ont mis un terme au cycle haussier entamé avec les annonces de commercialisation de plusieurs vaccins et l’élection de Joe Biden. Le CAC 40 baisse de 0,69 % sur cinq jours mettant un terme à cinq semaines consécutives de hausse. Le Brexit, et l’amplification de l’épidémie dans plusieurs pays expliquent le repli général mais modéré des indices actions. Les investisseurs ont également engrangé quelques plus-values avant les fêtes.
Pour le Brexit, le compte à rebours est enclenché. Même si l’Europe nous a habitué à des accords de dernière minute, la possibilité pour l’Union européenne et le Royaume-Uni de signer avant le 31 décembre se réduit de jour en jour. Personne n’a à gagner d’un « hard Brexit » mais, jusqu’à présent, Boris Johnson rejette toute contrepartie en cas d’intégration dans le marché unique. Sans accord de libre-échange avec Bruxelles au 31 décembre, les échanges entre Londres et l’UE, son principal partenaire, se feraient selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas. En 2019, le montant des échanges entre l’Union européenne était de 830 milliards d’euros. Le Royaume-Uni est jusqu’à maintenant le pays d’Europe ayant le déficit commercial le plus élevé. A ce titre, la France dégage un de ses rares excédents commerciaux européens avec ce pays.
Plusieurs points de blocages empêchent, pour le moment, la conclusion d’un accord. Ainsi, le Royaume-Uni n’entend pas se soumettre aux normes techniques, fiscales et environnementales de l’Union. La Commission de Bruxelles considère que le gouvernement britannique entend faire de son pays une porte d’entrée aux marchandises des pays émergents qui ne souhaiteraient pas se soumettre à la réglementation européenne. Le Royaume-Uni se transformerait en Cheval de Troie du commerce européen au profit des pays tiers. Le gouvernement britannique s’oppose également au système d’arbitrage des différends commerciaux. Logiquement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est compétente pour juger les cas de litige dans les prochaines années. Le Royaume-Uni ne se considère désormais plus lié aux lois européennes depuis son départ de l’Union en 2020, et récuse tout pouvoir à la CJUE. Bruxelles serait disposé à trouver sur ce point un compromis. Le dossier de la pêche et des zones réservées est également dans l’impasse. Les eaux britanniques sont parmi les plus riches du monde en poisson et de nombreux pays de l’Union y pêchent 760 000 tonnes de poissons chaque année, soit 636 millions d’euros de marchandises. La France est le pays le plus concerné en y réalisant 30 % de ses prises. Or au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni reprend le contrôle de cette zone économique exclusive et souhaite y imposer un système de droit de pêche et de quotas. Ces derniers seraient mis en place dans trois ans. Un délai estimé trop court par Bruxelles, qui propose plutôt de s’acquitter d’une taxe en reversant une partie des prises effectuées dans les eaux britanniques. Le gouvernement britannique estime les concessions européennes très insuffisantes.
Pétrole, une illusion de hausse
Le baril de pétrole Brent a dépassé les 50 dollars jeudi 10 décembre, pour la première fois depuis le début du mois de mars. La hausse de ces derniers jours fait suite à l’accord intervenu au niveau de l’OPEP et de la Russie la semaine dernière et aux annonces des premiers plans de vaccination Les investisseurs saluent le début des campagnes de vaccination au Royaume-Uni et d’ici quelques jours aux Etats-Unis et au Canada. Le Brent s’apprécie du fait d’un probable nouveau plan d’aide aux ménages et aux entreprises aux Etats-Unis. La demande de pétrole est soutenue en Chine et en Inde, respectivement premier et troisième importateur mondial de brut. Au Brésil, la consommation de carburants a même dépassé son niveau d’avant la pandémie. Enfin, les cours du brut sont tirés par la faiblesse du dollar qui rend l’or noir moins cher pour les grands pays consommateurs. L’optimisme des marchés est d’autant plus remarquable que les stocks de pétrole sont en hausse aux Etats-Unis et que l’Arabie Saoudite a exporté de fortes quantités vers ce pays afin de peser sur les cours et ainsi pénaliser les producteurs locaux. Les stocks américains se situent désormais 11 % au-dessus de leur niveau moyen des cinq dernières années. Cependant, le marché reste convalescent et pourrait encore connaître de fortes variations de cours. En ce milieu de mois de décembre, la demande de pétrole n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise. A 92 millions de barils par jour, elle est de 7,5 % inférieure à son niveau du mois de décembre 2019. Sans la politique de régulation de la production, le prix serait autour de 30 dollars le baril.
La Banque centrale maintient son cap
A l’occasion de sa réunion du 10 décembre, la Banque Centrale Européenne a pris en compte les effets de la deuxième vague de coronavirus et d’un éventuel « hard Brexit » dans ses prévisions et a ajusté, en conséquence, sa politique. Pour 2021, la BCE a ainsi ramené sa prévision de croissance de 5 à 3,9 %. Une accélération est, en revanche, attendue l’année suivante (4,2 %, contre 3,2 % initialement). L’inflation devrait être de 0,2 % en 2020 et atteindrait progressivement 1,4 % en 2023. La BCE n’a pas touché à ses taux directeurs qui restent à leurs niveaux historiquement bas. Le taux de dépôt reste à -0,5 %, le taux de refinancement à 0 % et celui de la facilité de prêt marginal à 0,25 %. La BCE a décidé d’augmenter de 500 milliards d’euros son programme d’achats d’urgence pandémie (PEPP), l’enveloppe totale atteignant 1 850 milliards d’euros. Ce programme se poursuivra au moins jusqu’en mars 2022. Cette extension du programme pourrait toutefois poser des problèmes techniques à la BCE. La BCE ne peut pas détenir plus de 50 % de toute dette souveraine. Or, ce ratio pourrait être atteint pour certains Etats en 2021 ou en 2022. Sur ce sujet, Christine Lagarde a déclaré que « nous avons dit à plusieurs reprises que les limites que nous nous sommes imposées ne doivent pas être un obstacle à l’exécution de notre politique monétaire ». La BCE a, par ailleurs, modifié son programme de financement de long terme à taux négatifs pour les banques, les TLTRO. Ils permettent aux établissements qui maintiennent leurs prêts à l’économie réelle (entreprises et ménages) de se financer auprès de la BCE à –1 %. Cette mesure de soutien à la consommation et à l’investissement a été prolongée jusqu’à la fin juin 2022. Trois nouvelles opérations auront lieu au second semestre 2021. Les mesures annoncées par la BCE ont déçu les investisseurs qui auraient des mesures plus conséquentes. Elles n’ont, par ailleurs, pas freiné l’appréciation de l’euro par rapport au dollar mais celle-ci est avant tout la conséquence de la faiblesse de ce dernier.
La politique monétaire expansive a eu comme conséquence que les Etats du cœur de l’Europe, France comprise, se sont endettés à taux négatifs sur l’ensemble de l’année. Le taux moyen des emprunts français toute duration confondue a été, en 2020, de -0,4 %, contre -0,19 % en 2019. 260 milliards d’euros ont été levés, ce qui constitue un record pour la France et au niveau européen. Logiquement, en 2021, le programme d’émission porte également sur 260 milliards d’euros.
La capitalisation dans toutes ses formes
Le système français de retraite repose avant tout sur la répartition avec des cotisations, des contributions ou des impôts qui sont affectés au financement des pensions. La capitalisation ne fournit que 2,4 % des ressources des retraités en France, plaçant le pays loin derrière ses partenaires de l’OCDE pour lesquels ce ratio est, en moyenne, de 15 %.
Au-delà des suppléments de revenus issus des différents produits d’épargne retraite, les régimes de retraite peuvent être amenés à faire appel aux marchés financiers dans le cadre de la gestion de leurs réserves. De ce fait, le poids du financement assuré par ces marchés est supérieur au seul encours de l’épargne retraite évalué à 240 milliards d’euros en 2018.
Près de 158 milliards d’euros de réserves
Selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), au 31 décembre 2019, les réserves des régimes de retraite par répartition s’élevaient à 157,9 milliards d’euros. Le régime complémentaire des salariés AGIRC/ARRCO détient les réserves les plus importantes avec 84,1 milliards d’euros. Elle devance la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) qui dispose d’un encours de 29,7 milliards d’euros. Ces réserves ont fait l’enjeu d’âpres débats lors de la discussion de la réforme des retraites en 2019, les différents régimes ne souhaitant pas leur disparition dans le cadre du système universel. Il avait été admis qu’elles puissent être affectées à des dépenses de solidarité et des dépenses visant à lisser les effets de la réforme.
A ces réserves qui sont placés sur les marchés immobiliers et financiers, il faut également celles du Fonds de Réserve des Retraites (FRR). Ce dernier possédait un actif de 33,7 milliards d’euros à la fin de l’année 2019. Ce fonds participe au financement de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale qui a notamment repris les dettes de la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse et du Fonds de Solidarité Vieillesse. Le cumul des réserves des régimes par répartition et du FRR atteint 191,6 milliards d’euros, soit 7,9 % du PIB de 2019. Par ailleurs, il convient d’ajouter l’actif financier du Régime Additionnel de le Fonction Publique qui fonctionne par capitalisation. Cet actif atteint 35 milliards d’euros. Enfin, deux régimes par capitalisation doivent être comptabilisés. La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens possède également d’un régime en capitalisation provisionné à hauteur de 5,9 milliards d’euros pour un actif net estimé à 8,8 milliards d’euros en valeur de marché fin 2019. Les agents de la Banque de France bénéficie également d’un fonds de pension dont l’actif en valeur de marché était, toujours fin 2019, de 14,8 milliards d’euros.
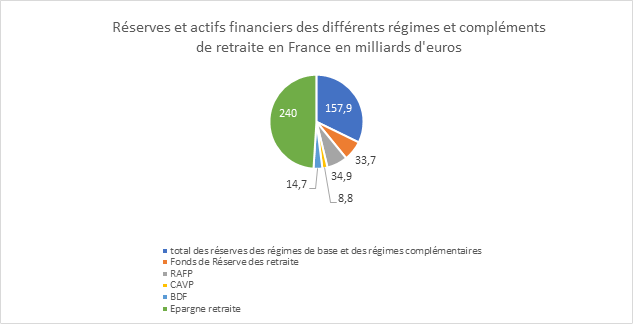
Prise en compte du chômage partiel pour la retraite
Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement, le chômage partiel sera pris en compte pour le calcul des pensions. Cela a été rendu possible par le décret du 1er décembre 2020 pris en application de l’article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions urgentes liées à la crise sanitaire (voir circulaire n°154-2020).
Avant ce décret, l’indemnité perçue par les salariés en chômage partiel n’était pas considéré comme un salaire et n’était pas soumise à cotisations, notamment pour la retraite. Il en résultait que pour les pensions de base du régime général, versées par l’Assurance-retraite, le chômage partiel ne permettait pas de valider des trimestres, contrairement au chômage indemnisé «total».
Le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 permet dorénavant une prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite. Il prévoit qu’un trimestre puisse être validé avec 220 heures d’activité partielle . Il ne sera pas possible de valider plus de quatre trimestres sur l’année 2020.
Logiquement, la validation des trimestres s’effectue non pas en fonction du nombre d’heures travaillées mais en fonction d’un montant soumis à cotisations. Ainsi, pour valider un trimestre, il faut un montant équivalent à 150 fois le Smic horaire (soit 1 522,50 euros bruts, et 6 090 euros pour quatre trimestres).
Pour le régime complémentaire AGIRC / ARRCO, le Conseil d’administration a décidé que les salariés indemnisés au titre de périodes d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée.
Le Coin de l’agenda économique et financier
Lundi 7 décembre
L’indice Sentix relatif à la confiance des investisseurs dans la zone euro sera publié pour le mois de décembre.
La balance commerciale de la Chine pour le mois de novembre sera connue. Les réserves de change de la Chine pour le mois de novembre seront aussi dévoilées.
Mardi 8 décembre
La balance commerciale de la France pour le mois d’octobre sera donnée.
Publication en Allemagne de l’enquête ZEW sur le sentiment économique pour le mois de décembre.
Mercredi 9 décembre
L’indice hors tabac de l’inflation en novembre sera publié par l’Insee.
La balance commerciale de l’Allemagne pour le mois d’octobre sera connue.
La fondation NFIB publiera l’indice de l’optimisme des affaires pour les États-Unis au mois de novembre.
Le niveau des stocks des grossistes en octobre sera publié par le Bureau américain.
Jeudi 10 décembre
Réunion du Conseil européen. Les dirigeants de l’Union européenne se réuniront à Bruxelles pour débattre de la poursuite des mesures de coordination liées à la COVID-19, du changement climatique, du commerce, de la sécurité et des relations extérieures. Cette réunion se prolongera le 11 décembre.
Décision sur les taux d’intérêt de la BCE.
La production industrielle pour le mois d’octobre sera dévoilée en France et au Royaume-Uni.
Vendredi 11 décembre
La Banque d’Angleterre publiera son second rapport sur la stabilité financière pour l’année 2020.
En Italie, la balance commerciale et la production industrielle pour le mois d’octobre seront connues.
L’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre sera donné en Allemagne et en Espagne.
Lundi 14 décembre
La production industrielle dans la zone euro en octobre sera donnée par Eurostat.
Le niveau de la production industrielle en octobre au Japon et le taux d’utilisation des capacités industrielles japonaises en octobre seront connus.
Mardi 15 décembre
Le taux de chômage en novembre au Royaume-Uni sera dévoilé.
L’indice des prix à la consommation en novembre en Italie sera donné par l’institut national italien de la statistique.
Mercredi 16 décembre
Le coût du travail trimestriel dans la zone euro au troisième trimestre sera publié par Eurostat. Il montre l’évolution à court terme des coûts horaires totaux engagés par les employeurs de maintenir leurs employés.
La balance commerciale de la zone euro en octobre sera aussi donnée par Eurostat.
Jeudi 17 décembre
L’indice des prix à la consommation en novembre dans la zone euro sera donné par Eurostat.
Décision sur les taux de la Banque d’Angleterre.
Le nombre de permis de construire ainsi que celui des mises en chantier en novembre aux États-Unis seront dévoilés.
Vendredi 18 décembre
Les indices Markit- PMI manufacturiers et de services pour le mois de décembre seront publiés pour la zone euro, la France et l’Allemagne.
Décision sur les taux de la Banque du Japon.
Le Coin des Epargnants du 5 décembre 2020
« l’épargne française doit être une composante importante du financement des investissements réalisés en France. Il faut qu’elle soit présente, active et participante ». Valéry Giscard d’Estaing
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 4 décembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 609,15 | +0,20 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 30 218,26 | +1,03 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 12 464,23 | +2,12 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 298,96 | -0,28 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 367,58 | +0,25 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 539,27 | +0,33 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 26 751,24 | +0,40 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 444,58 | +1,06 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,31547 % | +0,032 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,550 % | +0,039 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,973 % | +0,121 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2142 | +1,54 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 834,740 | +2,64 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 48,900 | +1,37 % | 66,300 |
Pause en Europe et records à New York
Après plusieurs semaines de fortes hausses, les marchés « actions » se sont mis en mode « pause » cette semaine, du moins en Europe, ballotés entre les résultats décevants de l’emploi américain et les incertitudes sur la mise en place de la vaccination de masse. La bourse de New York continue de battre record sur record, faisant toujours fi des menaces et voulant croire à un vigoureux rebond en 2021.
L’augmentation rapide de l’endettement aux Etats-Unis et la ligne plutôt keynésienne du futur gouvernement de Joe Biden ont favorisé la hausse des taux. Une remontée de l’inflation est également attendue par le marché, ce qui peut conduire à expliquer en partie la hausse des taux de dettes souveraines. L’euro profite de la situation pour s’apprécier et pour passer au-dessus du cap de 1,2 dollar, ce qui n’était plus arrivé depuis la fin du mois d’avril 2018.
Un compromis est intervenu, jeudi 3 décembre, au sein de l’Opep+, rassemblant les Etats membres de l’organisation et plusieurs pays producteurs non-membres comme la Russie, sur une augmentation progressive de sa production. En vertu de cet accord, la production ne sera plus réduite que de 7,2 millions de barils par jour à partir de janvier, contre 7,7 millions de barils par jour actuellement. Cet accord a entraîné le rebond des valeurs pétrolières comme Total. La poursuite de la régulation de la production a contribué à la poursuite de la hausse du prix de pétrole Brent qui sur un mois gagne 22 %.
En Chine, les indices des directeurs d’achat se sont améliorés en novembre, dépassant les attentes des investisseurs. Au Japon, les PMI manufacturier, composite et du secteur des services sont également en hausse tout en demeurant en dessous du seuil critique de 50. Aux États-Unis, en revanche, l’ISM manufacturier a enregistré une baisse significative et plus marquée qu’attendu. Le PMI Markit est resté stable. Dans le secteur des services, l’ISM a fléchi mais le PMI s’est amélioré.
Des créations d’emploi en retrait aux Etats-Unis
En novembre, l’économie américaine a créé 245 000 emplois, contre 648 000 en octobre et 5 millions en juin. L’agence Bloomberg anticipait 460.000 emplois. Malgré tout, le taux de chômage a baissé de 0,2 point, à 6,7 %, en recul de 8 points par rapport à avril. Il demeure toujours supérieur de 3,2 points à ce qu’il était en février (3,5%). Le nombre de chômeurs s’élève à 10,7 millions, soit 4,9 millions de plus par rapport à son niveau de février. Le nombre de chômeurs de longue durée (ceux sans emploi depuis 27 semaines ou plus) a augmenté de 385. 000 à 3,9 millions, soit 36,9 % du total des chômeurs. Le ralentissement intervient dans un contexte de reprise rapide de l’épidémie et de report de l’adoption d’un plan de relance. Plus de 100 000 personnes sont aujourd’hui hospitalisées dans le pays ; le nombre de nouveaux cas par jours atteint près de 250 000.
Les secteurs les plus dynamiques pour la création d’emploi restent la construction résidentielle, la santé ou le transport-logistique, tandis que d’autres sont pénalisés par des mesures de restriction de circulation, qui frappent désormais la moitié des Etats. L’hôtellerie, qui a subi les plus importantes pertes d’emplois durant la pandémie, n’a créé que de 31 000 postes en novembre tandis que le commerce de détail en a perdu 35 000.
Les consommateurs américains semblent réduire fortement les achats dans les commerces en privilégiant le e-commerce. Ainsi, durant le Black Friday, la fréquentation des magasins physiques a chuté de 52 %.
Les taux des livrets stables en octobre
Au mois d’octobre 2020, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est resté stable à celui des deux mois précédents (0,46 %). Le taux des livrets fiscalisés était de 0,12%.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires,
| oct- 2019 | août-2020 | sept- 2020 (e) | oct- 2020 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,58 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Ménages | 0,83 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,74 | 0,57 | 0,57 | 0,55 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,30 | 1,07 | 1,06 | 1,05 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| SNF | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,14 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,41 | -0,48 | -0,49 | -0,51 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,52 | -0,56 | -0,60 | -0,65 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Novembre, un mois haut en couleur pour les marchés financiers
Le mois de novembre 2020 a été exceptionnel sur le plan boursier. La CAC 40 a gagné 20,1 %, ce qui constitue sa deuxième plus forte hausse mensuelle de son histoire. Il faut remonter à février 1988, juste après sa création pour avoir une augmentation plus importante, +24,57 %.Depuis le recul de la mi-mars, après l’annonce du premier confinement, le CAC 40 a regagné 51,9 %. La perte par rapport au 1er janvier n’est plus que de 7,69 %. Le mois de novembre a été marqué par les résultats positifs de plusieurs vaccins anti-covid en phase 3 et par l’élection de Joe Biden à la Présidence des Etats-Unis. Les marchés ne se sont pas inquiétés des confinements décidés par plusieurs gouvernements européens pour endiguer la deuxième vague. Le Dax allemand a augmenté de 15,4 % sur le mois, le FTSE Mib milanais de 24,6 % et le Footsie londonien de 14,2 %.
Durant le mois de novembre, le Dow Jones a dépassé le cap symbolique et historique des 30 000 points avant de légèrement se replier. L’indice américain a gagné 11,18 % en un mois.Quant au S&P 500, avec une progression mensuelle de 10,8%, il connaît le meilleur mois de novembre de son histoire. Le Nasdaq a établi un nouveau record le 27 novembre. Il a progressé de près de 41 % en un mois.
Le baril de pétrole Brent a gagné près de 28 % en un mois et s’est rapproché des 50 dollars, signe manifeste du rebond économique. La progression s’explique par l’anticipation de l’accord de régulation de la production qui devrait être pérennisé par l’OPEP et la Russie.
L’augmentation du nombre de personnes infectées aux Etats-Unis pourrait peser sur les cours au mois de décembre. En Europe, une possible troisième vague après les fêtes de Noël et de fin d’année pourrait également contrarier le mouvement haussier tout comme les négociations sur le Brexit. Les prochains jours seront cruciaux ; un accord serait possible pour la pêche.
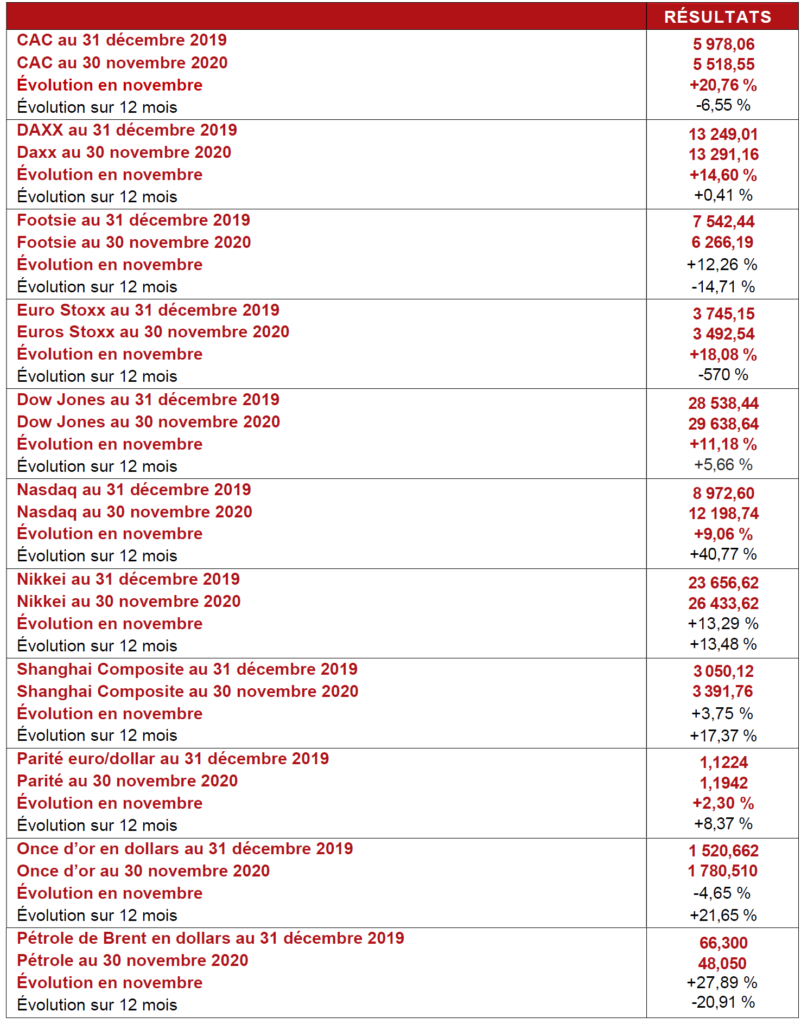
Le Coin des Epargnants du 27 novembre 2020 : les actions en pleine forme
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 27 novembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 598,18 | +1,86 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 29 910,37 | +2,21 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 12 205,85 | +2,96 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 335,68 | +1,51 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 367,58 | +0,25 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 527,79 | +1,74 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 26 644,71 | +4,38 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 408,31 | +0,91 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,347 % | +0,002 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,589 % | -0,004 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,852 % | +0,011 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1956 | +0,84 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 785,610 | -4,54 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 47,960 | +6,46 % | 66,300 |
Le CAC 40 à la frontière des 5600 points
Le Cac 40 a terminé la semaine juste en-dessous des 5600 points (5598). Il a franchi cette barre dans la journée de vendredi (5 612,70 au plus haut du jour) pour la première fois depuis février. Depuis le début du mois de novembre, l’indice a gagné près de 22 % et a enchaîné quatre semaines consécutives de hausse. De son côté, le Nasdaq Composite a franchi un nouveau record à plus de 12 200 points, tiré par Apple, Alphabet et Amazon.
Au-delà des bons résultats des indices boursiers, des signes inquiétants persistent sur le front de la pandémie de Covid-19 avec une remise en cause des essais du vaccin d’AstraZeneca. Aux Etats-Unis, le nombre d’hospitalisations continue de progresser et a dépassé les 89 000 mercredi 25 novembre. Le taux d’incidence de la Covid-19, soit le nombre de contaminations rapporté à la population, augmente rapidement et atteint près de 50 nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants, un rythme désormais nettement plus élevé qu’en Europe. L’épidémie qui était très active dans les États ruraux (Dakota du Nord, Indiana, Kansas, Utah, Colorado, etc.) se propage à nouveau dans les grands centres urbains. A New York, les écoles ont été fermées quand un couvre-feu a été institué en Californie. Les autorités craignent que les réunions liées aux fêtes de fin d’année n’entraînent une résurgence des contaminations. La crainte d’une troisième vague après les fêtes de fin d’année est de plus en plus anticipée d’autant que la vaccination de la population au sein des pays avancés prendra du temps, au moins un an. La Chine semble en revanche se démarquer avec une hausse de 28,2 % sur un an de ses profits industriels en octobre, un résultat inédit depuis neuf ans. Ce dernier a entrainé une progression des cours du pétrole avec un baril de Brent à plus de 48 dollars, au plus haut depuis le mois de mars.
Le Livret A rejoint l’assurance vie dans la décollecte
Le produit d’épargne le plus populaire, le Livret A, et l’assurance vie qui est le numéro 1 en volume, ont connu le même destin en octobre avec deux petites décollectes. Les épargnants ont boudé ces deux placements juste avant le deuxième confinement.
Coup d’arrêt logique pour le Livret A
Au mois d’octobre, le Livret A a mis un terme à neuf mois consécutifs de collecte positive avec une décollecte de 940 millions d’euros. Sur les dix premiers mois de l’année, la collecte reste positive avec plus de 24,8 milliards d’euros.
Octobre est traditionnellement un mois de décollecte pour le Livret A. Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il fallait remonter à celle gargantuesque d’octobre 2012 (+7,35 milliards d’euros) faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. En 2019, la décollecte avait atteint un niveau de 2,13 milliards d’euros. La décollecte du mois d’octobre 2020 reste faible au regard de celles constatées les années précédentes, traduisant de ce fait le maintien d’une forte épargne de précaution. Avec plus de 323 milliards d’euros d’encours et 25 milliards d’euros de collecte depuis janvier, une pause était de toute façon prévisible. Même le Livret A ne monte pas jusqu’au ciel…
Octobre est logiquement un mois de dépenses avec, notamment, la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose n’échappe pas à la règle. Avant le confinement, les ménages ont réalisé des dépenses reportées depuis plusieurs mois. Par ailleurs, privilégiant la liquidité absolue, les ménages ont tendance à laisser de plus en plus d’argent sur leurs comptes sachant, qu’il leur est de plus en plus difficile de prévoir leurs dépenses de consommation qui sont soumises au rythme des restrictions.
L’assurance vie, à petit train de sénateur, revient à l’équilibre
Pour le mois d’octobre, selon la Fédération Française de l’Assurance, l’assurance vie enregistre sa huitième décollecte de rang mais avec -154 millions d’euros. Il s’agit de la plus faible constatée depuis le mois d’avril 2020.
Sur ces dix dernières années, une seule décollecte avait été enregistrée au mois d’octobre. Si, en règle générale, le Livret A termine mal l’année, ce n’est pas le cas pour le premier placement des ménages. Dans les derniers mois de l’année, les épargnants effectuent des arbitrages et décident d’affecter une partie de leurs liquidités sur des placements de long terme comme l’assurance vie ou les produits d’épargne retraite. En 2020, l’affaire est tout autre. L’assurance vie est une des victimes collatérales de la crise sanitaire du fait de sa nature de placement à long terme. La très faible décollecte du mois d’octobre souligne que les ménages reviennent progressivement sur l’épargne de long terme et que le premier produit d’épargne ne souffre d’aucune défiance. Il n’en demeure pas moins que dans l’histoire de l’assurance vie, un tel cycle de décollecte n’avait été jamais enregistré.
Une reprise de la collecte brute en octobre
Au mois d’octobre, la collecte brute a atteint 10,9 milliards d’euros, contre 9,4 en septembre. Pour avoir une collecte plus élevée, il faut remonter au mois de février avant la crise sanitaire. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placé en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. Les prestations sur le mois d’octobre se sont élevées à 11 milliards d’euros, soit un peu plus qu’en septembre (10,1 milliards d’euros).
2020, une année atypique pour l’assurance vie
Avec octobre, la collecte nette reste négative sur les dix premiers mois de l’année à hauteur de 7,3 milliards d’euros, contre une collecte nette positive de 22,3 milliards d’euros sur la même période de 2019. Depuis le début de la crise sanitaire, la décollecte est de 9,3 milliards d’euros (de mars à octobre). La décollecte en 2020 pourrait donc être supérieure à celle de 2012 (-6,3 milliards d’euros) marquée par la crise des dettes souveraines qui avait généré un climat de suspicion à l’encontre des fonds euros des contrats d’assurance vie.
Sur les dix premiers mois de l’année 2020, le cumul des cotisations en assurance vie atteint 93,0 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 28 milliards d’euros. En revanche, les prestations sont stables d’une année sur l’autre, 100,3 milliards d’euros en 2020, contre 99,3 milliards d’euros en 2019.
Dans un contexte de crise sanitaire doublée d’une crise économique, les ménages éprouvent, à juste titre, les pires difficultés pour se projeter et donc s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité absolue ; les dépôts à vue et les livrets sont les principaux réceptacles de l’épargne covid. Les ménages anticipent une baisse de revenus et ont peur des licenciements, ce qui les conduit à accroître le volume de leur épargne de précaution. La baisse des rendements des fonds euros et l’incitation à placer une partie de son épargne en unités de compte dissuadent, à la marge, une partie des épargnants.
Moral des ménages en novembre, l’épargne comme planche de salut
En novembre, la confiance des ménages dans la situation économique est en nette baisse. Le deuxième confinement malgré son caractère moins strict que le premier apparaît sur le plan économique plus inquiétant. Le premier avait tétanisé les Français mais ces derniers estimaient qu’il s’agissait d’une expérience unique. Avec le temps, ils intègrent les conséquences économiques de la pandémie. Le reconfinement traduit son installation dans la durée. Les annonces des plans de licenciements, les difficultés croissantes des commerces pèsent sur le moral des ménages. L’indicateur qui la synthétise perd ainsi quatre points par rapport à octobre et se retrouve en-dessous de son niveau du mois d’avril. À 90, il atteint ainsi son plus bas niveau depuis décembre 2018.
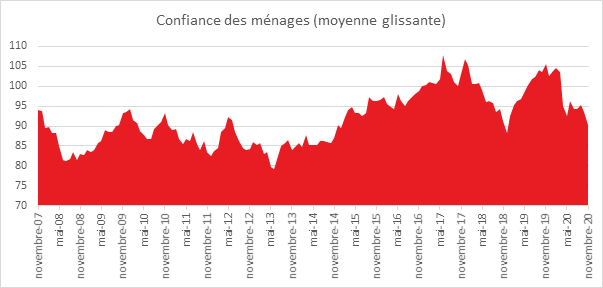
Une inquiétude croissante pour les revenus à venir
En novembre, les ménages sont beaucoup moins optimistes sur leur situation financière future. Le solde de l’indicateur correspondant perd cinq points et est en-dessous de sa moyenne de longue période. En revanche, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée reste stable, au-dessus de sa moyenne, ce qui est en phase avec le fait que les revenus des ménages ont été globalement maintenus depuis le mois de mars. La baisse serait de l’ordre de 5 %, soit bien moins que le recul du PIB.
Une renonciation marquée pour la consommation
De manière assez logique, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants baisse fortement. Le solde correspondant perd huit points et demeure inférieur à sa moyenne de longue période. Il atteint son plus bas niveau depuis mai dernier.
L’épargne comme planche de salut
A contrario, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente à nouveau. Le solde correspondant gagne trois points et demeure bien au-dessus de sa moyenne. Néanmoins, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle baisse de trois points. Il se maintient malgré tout nettement au-dessus de sa moyenne. Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future est stable et se reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
Forte inquiétude sur le pouvoir d’achat
En novembre, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois diminue de nouveau. Le solde correspondant perd neuf points et demeure très en dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages s’attendent à une augmentation des licenciements et à des impôts.
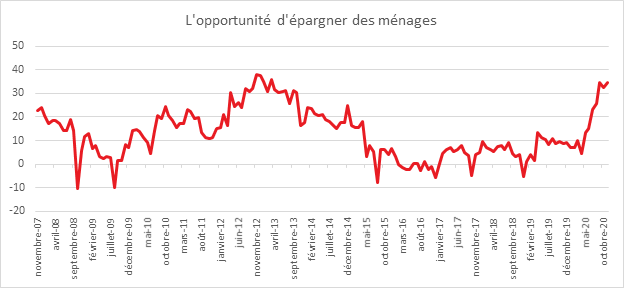
La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois baisse également. Le solde correspondant perd trois points et reste largement en dessous de sa moyenne de longue période.
Sans surprise, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage se dégrade L’indicateur correspondant atteint son plus haut niveau depuis juin 2013, et demeure très au-dessus de sa moyenne de longue période.
En novembre, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont nettement plus nombreux que le mois précédent. À l’inverse, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois continue de baisser.
L’assurance vie stoïque ou presque dans la tourmente sanitaire
Pour le mois d’octobre, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, sa huitième décollecte de rang mais avec -154 millions d’euros, il s’agit de le plus faible constatée depuis le mois d’avril 2020.
Octobre, logiquement un mois traditionnellement faste pour l’assurance vie mais pas en 2020
Sur ces dix dernières années, une seule décollecte avait été enregistrée au mois d’octobre. Si, en règle générale, le Livret A termine mal l’année, ce n’est pas le cas pour le premier placement des ménages. Dans les derniers mois de l’année, les épargnants effectuent des arbitrages et décident d’affecter une partie de leurs liquidités sur des placements de long terme comme l’assurance vie ou les produits d’épargne retraite. En 2020, l’affaire est tout autre. L’assurance vie est une des victimes collatérales de la crise sanitaire du fait de sa nature de placement à long terme. La très faible décollecte du mois d’octobre souligne que les ménages reviennent progressivement sur l’épargne de long terme et que le premier produit d’épargne ne souffre d’aucune défiance. Il n’en demeure pas dans l’histoire de l’assurance vie, un tel cycle de décollecte n’avait été jamais enregistré.
Une reprise de la collecte brute en octobre
Au mois d’octobre, la collecte brute a atteint 10,9 milliards d’euros, contre 9,4 en septembre. Pour avoir une collecte plus élevée, il faut remonter au mois de février avant la crise sanitaire. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placée en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. Les prestations sur le mois d’octobre se sont élevées à 11 milliards d’euros, soit un peu plus qu’en septembre, 10,1 milliards d’euros.
2020, une année atypique pour l’assurance vie
Avec octobre, la collecte nette reste négative sur les dix premiers mois de l’année à hauteur de 7,3 milliards d’euros, contre une collecte nette positive de 22,3 milliards d’euros sur la même période de 2019. Depuis le début de la crise sanitaire, la décollecte est de 9,3 milliards d’euros (de mars à octobre). La décollecte pourrait donc être supérieure en 2020 à celle de 2012 (-6,3 milliards d’euros). L’année 2012 avait été marquée par la crise des dettes souveraines qui avait généré un climat de suspicion à l’encontre des fonds euros des contrats d’assurance vie.
Sur les dix premiers mois de l’année 2020 le cumul des cotisations en assurance vie atteint 93,0 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 28 milliards d’euros. Les prestations sont, en revanche stables d’une année sur l’autre, 100,3 milliards d’euros en 2020, contre 99,3 milliards d’euros en 2019.
Dans un contexte de crise sanitaire doublée d’une crise économique, les ménages éprouvent, à juste titre, les pires difficultés pour se projeter et donc s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité absolue ; les dépôts à vue et les livrets sont les principaux réceptacles de l’épargne covid. Les ménages anticipent une baisse de revenus et ont peur des licenciements, ce qui les conduit à accroître le volume de leur épargne de précaution. La baisse des rendements des fonds euros et l’incitation à placer une partie de son épargne en unités de compte dissuadent, à la marge, une partie des épargnants.
Avec le reconfinement mis en œuvre à partir du 30 octobre, la décollecte pourrait être un peu plus forte en novembre.
A fin octobre 2020, l’assurance vie demeure de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1 753 milliards d’euros.
Contact presse
Philippe Crevel : 06 03 84 70 36
pcrevel@gmail.com
Assurance vie, résultats du mois d’octobre : une petite décollecte avant le deuxième reconfinement
Pour le mois d’octobre, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, sa huitième décollecte de rang mais avec -154 millions d’euros, il s’agit de le plus faible constatée depuis le mois d’avril 2020.
Octobre, logiquement un mois traditionnellement faste pour l’assurance vie mais pas en 2020
Sur ces dix dernières années, une seule décollecte avait été enregistrée au mois d’octobre. Si, en règle générale, le Livret A termine mal l’année, ce n’est pas le cas pour le premier placement des ménages. Dans les derniers mois de l’année, les épargnants effectuent des arbitrages et décident d’affecter une partie de leurs liquidités sur des placements de long terme comme l’assurance vie ou les produits d’épargne retraite. En 2020, l’affaire est tout autre. L’assurance vie est une des victimes collatérales de la crise sanitaire du fait de sa nature de placement à long terme. La très faible décollecte du mois d’octobre souligne que les ménages reviennent progressivement sur l’épargne de long terme et que le premier produit d’épargne ne souffre d’aucune défiance. Il n’en demeure pas dans l’histoire de l’assurance vie, un tel cycle de décollecte n’avait été jamais enregistré.
Une reprise de la collecte brute en octobre
Au mois d’octobre, la collecte brute a atteint 10,9 milliards d’euros, contre 9,4 en septembre. Pour avoir une collecte plus élevée, il faut remonter au mois de février avant la crise sanitaire. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placée en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. Les prestations sur le mois d’octobre se sont élevées à 11 milliards d’euros, soit un peu plus qu’en septembre, 10,1 milliards d’euros.
2020, une année atypique pour l’assurance vie
Avec octobre, la collecte nette reste négative sur les dix premiers mois de l’année à hauteur de 7,3 milliards d’euros, contre une collecte nette positive de 22,3 milliards d’euros sur la même période de 2019. Depuis le début de la crise sanitaire, la décollecte est de 9,3 milliards d’euros (de mars à octobre). La décollecte pourrait donc être supérieure en 2020 à celle de 2012 (-6,3 milliards d’euros). L’année 2012 avait été marquée par la crise des dettes souveraines qui avait généré un climat de suspicion à l’encontre des fonds euros des contrats d’assurance vie.
Sur les dix premiers mois de l’année 2020 le cumul des cotisations en assurance vie atteint 93,0 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 28 milliards d’euros. Les prestations sont, en revanche stables d’une année sur l’autre, 100,3 milliards d’euros en 2020, contre 99,3 milliards d’euros en 2019.
Dans un contexte de crise sanitaire doublée d’une crise économique, les ménages éprouvent, à juste titre, les pires difficultés pour se projeter et donc s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité absolue ; les dépôts à vue et les livrets sont les principaux réceptacles de l’épargne covid. Les ménages anticipent une baisse de revenus et ont peur des licenciements, ce qui les conduit à accroître le volume de leur épargne de précaution. La baisse des rendements des fonds euros et l’incitation à placer une partie de son épargne en unités de compte dissuadent, à la marge, une partie des épargnants.
Avec le reconfinement mis en œuvre à partir du 30 octobre, la décollecte pourrait être un peu plus forte en novembre.
A fin octobre 2020, l’assurance vie demeure de loin le premier placement des ménages avec un encours de1 753 milliards d’euros.
Climat des affaires en baisse sur fond de confinement
Selon les chefs d’entreprise par l’INSEE, au mois de novembre, les perspectives générales d’activité s’assombrissent fortement par rapport au mois dernier. Cette dégradation du climat des affaires s’explique évidemment par la décision des pouvoirs publics de reconfiner le pays. L’indicateur synthétique du climat des affaires en France baisse de 11 points et retrouve son niveau de juin (79), sans toutefois rejoindre le point bas atteint en avril (54).
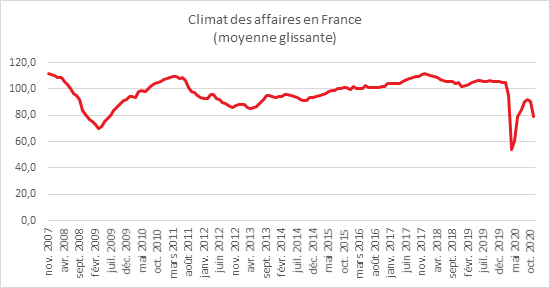
Coup d’arrêt d’automne pour le Livret A
Au mois d’octobre, le Livret A met un terme à neuf mois consécutifs de collecte positive avec une décollecte de 940 millions d’euros. Sur les dix premiers mois de l’année, la collecte reste positive avec plus de 24,8 milliards d’euros.
Octobre est le plus mauvais mois pour le Livret A. Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il fallait remonter à celui de 2012 (+7,35 milliards d’euros), collecte gargantuesque faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. En 2019, la décollecte avait atteint un niveau de 2,13 milliards d’euros. La décollecte du mois d’octobre 2020 reste faible au regard de celles constatées les années précédentes, traduisant de ce fait le maintien d’une forte épargne de précaution.
Avec plus de 323 milliards d’euros d’encours et 25 milliards d’euros de collecte depuis janvier, une pause était de toute façon prévisible. Même le Livret A ne monte pas jusqu’au ciel…
Octobre est logiquement un mois de dépenses avec notamment la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose n’échappe pas à la règle. Les ménages ont, avant le confinement, réalisé des dépenses reportées depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les ménages ont tendance à laisser de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants privilégiant la liquidité absolue, sachant qu’il est de plus en plus difficile de prévoir ses dépenses de consommation qui sont soumises au rythme des restrictions.
Novembre avec cinq semaines de confinement devrait, en revanche, être marqué par le retour d’une collecte positive pour le Livret A. Le Livret A devrait terminer l’année avec une collecte certainement supérieur à 25 milliards d’euros.
Livret A : coup d’arrêt en octobre
Au mois d’octobre, le Livret A met un terme à neuf mois consécutifs de collecte positive avec une décollecte de 940 millions d’euros. Sur les dix premiers mois de l’année, la collecte reste positive avec plus de 24,8 milliards d’euros.
Octobre est le plus mauvais mois pour le Livret A. Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il fallait remonter à celui de 2012 (+7,35 milliards d’euros), collecte gargantuesque faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. En 2019, la décollecte avait atteint un niveau de 2,13 milliards d’euros. La décollecte du mois d’octobre 2020 reste faible au regard de celles constatées les années précédentes, traduisant de ce fait le maintien d’une forte épargne de précaution.
Avec plus de 323 milliards d’euros d’encours et 25 milliards d’euros de collecte depuis janvier, une pause était de toute façon prévisible. Même le Livret A ne monte pas jusqu’au ciel…
Octobre est logiquement un mois de dépenses avec notamment la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose n’échappe pas à la règle. Les ménages ont, avant le confinement, réalisé des dépenses reportées depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les ménages ont tendance à laisser de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants privilégiant la liquidité absolue, sachant qu’il est de plus en plus difficile de prévoir ses dépenses de consommation qui sont soumises au rythme des restrictions.
Novembre avec cinq semaines de confinement devrait, en revanche, être marqué par le retour d’une collecte positive pour le Livret A. Le Livret A devrait terminer l’année avec une collecte certainement supérieur à 25 milliards d’euros.
Le Coin des Epargnants du 20 novembre : sur un air de vaccin…
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 20 novembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 495,89 | +2,15 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 29 263,48 | -0,73 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 11 854,97 | +0,22 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 137,25 | +0,46 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 351,45 | +0,56 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 467,60 | +1,04 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 25 527,37 | +0,56 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 377,73 | +1,60 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,349 % | -0,039 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,585 % | -0,036 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,841 % | -0,045 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1857 | +0,22 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 872,690 | -0,90 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 44,340 | +3,84 % | 66,300 |
Les marchés entre promesses de vaccins et réalités monétaires
Les places boursières européennes ont enregistré une troisième semaine de hausse consécutive. Depuis le début du mois de novembre, le CAC 40 a gagné près de 20 %. Les pertes subies depuis le 1er janvier ont été ainsi ramenées à 8 %. L’action Française des Jeux a fêté sa première année post privatisation en battant un record à 35,6 euros, enregistrant ainsi un gain de 80 % en douze mois. New York s’est montré plus indécis cette semaine du fait de la progression de l’épidémie et de l’absence de nouveau plan de soutien à l’économie.
Les marchés restent dominés par les progrès réalisés sur le front des vaccins, l’évolution de l’épidémie et le soutien des banques centrales. Dans plusieurs pays, les autorités travaillent sur des plans de vaccination en lien avec les annonces de plusieurs laboratoires. Pfizer et BioNTech ont ainsi déclaré avoir déposé auprès de la FDA, l’autorité sanitaire américaine, une demande d’autorisation d’urgence pour leur candidat vaccin contre la Covid-19. L’épidémie semble connaître une décrue en Europe mais reste dynamique aux Etats-Unis. Le gouverneur de Californie a annoncé l’instauration d’un couvre-feu entre 22 heures et 5 heures du matin dans la plupart des comtés à partir du 21 octobre. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies a quant à lui appelé les Américains à limiter leurs déplacements pour la fête de Thanksgiving. Sur le terrain monétaire, la BCE s’apprête à renforcer son programme d’achat d’actifs en décembre, tandis que le Trésor américain a décidé de ne pas prolonger certains des programmes d’aide d’urgence de la FED au-delà de la fin de l’année. Dans un courrier adressé à Jerome Powel, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a annoncé l’arrêt au 31 décembre de certains programmes d’aide mis en place par la Réserve fédérale. Sont notamment visés deux programmes de rachat d’obligations d’entreprises, des prêts aux petites et moyennes entreprises dans le cadre du Main Street Lending Program, des prêts accordés aux Etats et aux autorités locales et un programme de soutien aux titres adossés à des actifs. Les fonds non distribués par la FED seront restitués au Congrès en vue d’une réaffectation. La FED a publiquement indiqué son opposition à cette mesure.
Vers un flux d’épargne de 200 milliards d’euros en 2020
Au deuxième trimestre, sur un an, le flux de placement des ménages a atteint près de 182 milliards d’euros, selon la Banque de France. Soit une hausse de 28 milliards par rapport au trimestre précédent, en raison de l’épargne contrainte accumulée depuis le mois de mars. Dans les prochains mois, la barre des 200 milliards d’euros pourrait être franchi.
En glissement annuel, l’épargne investie en produits de taux augmente nettement (149,7 milliards après 123,2 milliards), en particulier sous forme de dépôts à vue ou de livrets d’épargne (135,6 milliards). Les placements en produits de fonds propres progressent plus modérément (32,6 milliards après 25,4). Ces derniers sont, malgré le contexte boursier volatil, en hausse.
Les premières données disponibles pour le troisième trimestre montrent, avec la reprise, une moindre augmentation du numéraire et des dépôts après le point haut observé au deuxième trimestre (34,1 milliards au 3e après 63,8 au 2e). Ce flux est néanmoins près de deux fois supérieur à la moyenne constatée entre 2017 et 2019. Les flux trimestriels en assurance-vie et épargne retraite en euros rebondissement légèrement, tout en restant peu dynamiques (2,4 milliards d’euros au 3e trimestre après -0,7 au 2e), et ceux en supports unités de compte se réduisent (0,9 milliard d’euros au 3e trimestre, contre 3,1 au 2e).
A la fin du deuxième trimestre, le patrimoine financier des ménages s’élevait à 5431 milliards d’euros, contre 5160 milliards d’euros à la fin du premier trimestre. Avec 3584,1 milliards d’euros, les produits de taux représentaient 66 % du patrimoine financier des ménages. Le numéraire et les dépôts ont atteint 677,1 milliards d’euros, soit 12,5 % du patrimoine financier. Les dépôts bancaires rémunérés ont un encours de 1077,2 milliards d’euros, soit près de 20 % du patrimoine financier. L’épargne réglementée en représente les trois quarts. Les fonds euros de l’assurance vie et des produits d’épargne retraite s’élevaient, toujours à la fin du deuxième trimestre, 1703 milliards d’euros (30 % du patrimoine financier). Les ménages disposaient à la fin juin de 281 milliards d’euros d’actions cotées et de 357 milliards d’euros d’unités de compte. Les actions détenues à travers les Organismes de placement collectif s’élevaient à 102,4 milliards d’euros. Les actions non cotées et autres participations qui comprennent les parts détenues par les entrepreneurs atteignaient 993,2 milliards d’euros.
Le taux d’épargne des ménages au deuxième trimestre était de 18,6 % du revenu disponible brut dont 9,9 % au titre de l’épargne financière. En 2019, ces taux étaient respectivement de 14,8 et 5,3 %.
L’épargne financière, près de 10 % du revenu disponible brut des ménages
Au deuxième trimestre, sur un an le flux de placement des ménages a, selon la Banque de France, atteint près de 182 milliards d’euros, en hausse de 28 milliards par rapport au trimestre précédent, en raison de l’épargne contrainte accumulée depuis le mois de mars. Dans les prochains mois, la barre des 200 milliards d’euros pourrait être franchi.
En glissement annuel, l’épargne investie en produits de taux augmente nettement (149,7 milliards après 123,2 milliards), en particulier sous forme de dépôts à vue ou de livrets d’épargne (135,6 milliards). Les placements en produits de fonds propres progressent plus modérément (32,6 milliards après 25,4). Ces derniers sont, malgré le contexte boursier volatil, en hausse.
Les premières données disponibles pour le troisième trimestre montrent, avec la reprise, une moindre augmentation du numéraire et des dépôts après le point haut observé au deuxième trimestre (34,1 milliards au 3e après 63,8 au 2e). ce flux est néanmoins près de deux fois supérieur à la moyenne constatée entre 2017 et 2019. Les flux trimestriels en assurance-vie et épargne retraite en euros rebondissement légèrement, tout en restant peu dynamiques (2,4 milliards d’euros au 3e trimestre après -0,7 au 2e), et ceux en supports unités de compte se réduisent (0,9 milliard d’euros au 3e trimestre, contre 3,1 au 2e).
A la fin du deuxième trimestre, le patrimoine financier des ménages s’élevait à 5431 milliards d’euros, contre 5160 milliards d’euros à la fin du premier trimestre. Avec 3584,1 milliards d’euros, les produits de taux représentaient 66 % du patrimoine financier des ménages. Le numéraire et les dépôts ont atteint 677,1 milliards d’euros, soit 12,5 % du patrimoine financier. Les dépôts bancaires rémunérés ont un encours de 1077,2 milliards d’euros, soit près de 20 % du patrimoine financier. L’épargne réglementée en représente les trois quarts. Les fonds euros de l’assurance vie et des produits d’épargne retraite s’élevaient, toujours à la fin du deuxième trimestre, 1703 milliards d’euros (30 ù du patrimoine financier). Les ménages disposaient à la fin juin de 281 milliards d’euros d’actions cotées et de 357 milliards d’euros d’unités de compte. Les actions détenues à travers les Organismes de Placement Collectif s’élevaient à 102,4 milliards d’euros. Les actions non cotées et autres participations qui comprennent les parts détenues par les entrepreneurs atteignaient 993,2 milliards d’euros.
Le taux d’épargne des ménages au deuxième trimestre était de 18,6 % du revenu disponible brut dont 9,9 % au titre de l’épargne financière. En 2019, ces taux étaient respectivement de 14,8 et 5,3 %
Saison 2 du confinement, l’économie française plie sans rompre
La saison 2 du confinement devrait être moins violente que la saison 1, l’économie s’adaptant au fil du temps à ces circonstances très particulières. Si en mars, l’arrêt sur image avait été de mise, en novembre, le système économique fonctionne en mode dégradé mais il fonctionne. Le télétravail a été organisé, les entreprises appliquent les protocoles sanitaires, les droits de retrait restent faibles. L’ouverture des écoles a permis a facilité l’acclimatation du confinement pour les activités économiques.
Dans son analyse économique du mois de novembre, l’INSEE estime que la baisse d’activité est en novembre de 15 % quand, en avril dernier, elle atteignait 30 %. La construction et l’industrie enregistrent des pertes moindres qu’au printemps même si la moitié des entreprises industrielles soulignent de fortes pertes de productivité.
Une consommation en recul en novembre mais moins fortement qu’au printemps
La consommation des ménages pourrait reculer plus fortement que le PIB en novembre. Le déficit se situerait, toujours selon l’INSEE, autour de 15 % par rapport au niveau d’avant-crise, soit la moitié de la chute enregistrée au moment du premier confinement. Au troisième trimestre, la consommation des ménages se situait à 2 % de celui d’avant-crise. Ce chiffre surprend au regard du maintien d’un fort taux d’épargne et des restrictions qui pesaient alors sur le secteur des loisirs.
En octobre, la consommation des ménages se serait légèrement dégradée par rapport aux trois mois précédents, s’établissant à 4 % en deçà de son niveau du quatrième trimestre 2019. Les couvre-feu décidés à partir du milieu du mois d’octobre ont réduit les dépenses de restauration des ménages. a consommation de biens manufacturés serait restée dynamique malgré de moindres achats de matériels de transports. Les ventes de véhicules sont en repli depuis le mois d’août. L’éventail des commerces ouverts est un peu plus large qu’au printemps ; la vente à distance et les services de livraison à domicile se sont beaucoup développés, mais ils sont néanmoins loin de compenser les pertes de consommation liées à la fermeture des activités et d’un grand nombre de commerces Preuve que la population s’est familiarisée avec le confinement et que le deuxième est moins strict que le premier, les achats de précaution (alimentation, carburant) n’ont pas donné à un phénomène de stockage.
L’instauration du deuxième confinement le 30 octobre a provoqué une baisse sensible des transactions dans les commerces de détail dès la première semaine de novembre avec un report sur les ventes en ligne. Si la consommation en biens industriels était supérieure depuis le mois de juin à son niveau du quatrième trimestre 2019, elle se situerait nettement en deçà de ce niveau en novembre (–13 %). Cette forte diminution serait due notamment au recul de la consommation de carburant, en lien avec les restrictions de déplacement, et de biens manufacturés tels que l’habillement-chaussure ou l’équipement du foyer, en lien avec la fermeture des commerces dits « non essentiels ». La consommation de produits électriques et électroniques, en revanche, resterait au-dessus de son niveau d’avant-crise, prolongeant la dynamique amorcée depuis mai. La consommation de services principalement marchands serait inférieure de 19 % à son niveau du quatrième trimestre 2019. Le recul des dépenses d’hébergement et de restauration constituerait la principale contribution à cette chute, du fait des mesures de restriction d’activité. Les dépenses de loisirs seraient évidemment fortement réduites, ainsi que les dépenses en services de transport. Dans les services principalement non marchands, le recul de la consommation serait de 8 %. Le maintien de l’accueil dans les établissements scolaires et de l’accès à l’ensemble des soins de ville notamment, permettrait une baisse de la consommation non marchande moins forte que celle observée en avril.
Des situations contrastées au niveau de la production
En novembre, sans surprise, les pertes d’activité les plus fortes sont enregistrées dans le secteur de l’hébergement-restauration (–60 % par rapport au niveau d’avant-crise, après un mois d’octobre déjà affecté par le couvre-feu), dans celui des spectacles et loirs du fait de la fermeture des musées, bibliothèques et des salles de sport et les services de transport (–28 %, du fait des restrictions sur les voyages touristiques et les déplacements professionnels. L’agro-alimentaire est touchée en raison de la disparition des commandes des restaurants et des hôtels. A la différence du premier confinement, les ménages ne se sont pas rués dans les magasins pour constituer des réserves.
Dans le secteur du bâtiment, le deuxième confinement n’a pas donné lieu comme lors du premier à un arrêt des chantiers. La baisse d’activité devrait être mesurée.
Les travaux chez les particuliers seraient en recul en raison des craintes de contamination qu’ils génèrent (–12 %). Les activités scientifiques et techniques ainsi que les services administratifs et de soutien enregistrent une contraction de leur chiffre d’affaires de 16 %. Dans d’autres branches, comme la fabrication d’équipements ou de matériels de transport, l’activité se maintiendrait.
Un PIB en recul de 2 à 4,5 % au dernier trimestre 2020
L’INSEE, en fonction du scénario de déconfinement qui sera choisi par le Gouvernement, l’activité du mois de décembre pourrait se situer entre -4 et -13 % par rapport à son niveau d’avant crise. Dans le scénario le plus optimiste qui serait un retour rapide à la normale, l’économie retrouverait son niveau d’octobre. Si le déconfinement intervenait vers le 10 décembre, l’activité serait en-deçà de 8 %, contre -15 % en cas de poursuite en l’état du confinement. Pour l’INSEE, le PIB au dernier trimestre 2020 pourrait reculer entre – 2 ½ et – 6 %, selon les scénarios (avec – 4 ½ % pour le scénario médian).
L’année 2020 sera donc marquée par trois trimestres de recul du PIB pour un en hausse avec au total une contraction sans précédent. L’INSEE prévoit un recul du PIB de 9 à 10 %. De son côté, le Ministre de l’Economie a révisé sa prévision de croissance à -11 % mais il a déclaré, le 18 novembre, que « cela pourrait être meilleur au final » au vu des premiers retours qui montrent un second confinement moins destructeur pour l’économie que le premier .
2021, en plein doute
Pour 2021, le Ministre de l’Economie a également révisé à la baisse les prévisions officielles, le rebond passant de +8 à +6 % en pariant qu’il n’y aurait pas de troisième confinement. Ce dernier estime toujours qu’un retour fin 2022 du PIB à son niveau d’activité d’avant-crise est possible. L’écart de production fin 2021 avec 2019 serait de -4 %, quand Bercy espérait en septembre dernier pouvoir le ramener à -2,7 %.Pour le moment, le ministère des comptes publics n’a pas réévalué le déficit public pour 2021. Les prévisions pour l’année prochaine dépendent de l’évolution dé l’épidémie, de la capacité à déployer rapidement un vaccin et des effets des différents plans de relance. Le plan européen de 750 milliards d’euros ainsi que celui de la France portant sur 100 milliards d’euros devraient commencer à porter leurs fruits au cours de l’année 2021.
Au niveau des finances publiques, la Commission de Bruxelles commence à souligner les risques de certaines dérives. Elle a ainsi indiqué que « certaines mesures présentées par la France, l’Italie, la Lituanie et la Slovaquie semblent ne pas être temporaires ni compensées par d’autres mesures budgétaires ». Ces dépenses sont ainsi porteuses de déficits structurels. Ces remarques ne remettent pas en cause la position prise au printemps par la Commission de suspendre les règles de discipline budgétaire mais elle invite les gouvernements à une certaine vigilance. En France, la Commission vise notamment les hausses de salaires dans les hôpitaux et la baisse des impôts de production des entreprises. En Italie, une extension des crédits d’impôts pour les particuliers et une réduction des charges sociales dans les régions les plus défavorisées auront « un impact budgétaire au moins jusqu’en 2023 ».
Que faire de son épargne en temps de covid ?
Avec la crise sanitaire, les ménages de manière contrainte et par précaution épargnent des sommes conséquentes. Depuis le début de l’année, l’épargne dite covid-19 dépasse 55 milliards d’euros (épargne supplémentaire qui s’ajoute à celle qui aurait été de toute façon réalisée). Sur l’année, l’épargne des ménages dépassera 200 milliards d’euros contre 143 milliards d’euros en 2019. Cette épargne est essentiellement placée sur les comptes courants et sur les livrets d’épargne réglementés. Les épargnants privilégient la sécurité et la liquidité au détriment du rendement. Afin de favoriser la consommation, certains préconisent d’accroître la taxation de l’épargne au risque d’accentuer la défiance et de générer des comportements contre-productifs, d’autres veulent encourager l’épargne de long terme afin d’accélérer la transition énergétique ou pour augmenter les fonds propres des entreprises françaises. Dans les prochains mois, quels sont les placements qui seront porteurs et utiles pour les ménages et l’économie ? suite de l’étude
Premier bilan du prélèvement forfaitaire unique
Epargne : quelles leçons tirées des réformes fiscales de 2018 ?
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) introduit le 1er janvier 2018 et le Plan d’Épargne Retraite de la loi PACTE constituent les deux principales réformes concernant la sphère de l’épargne depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République. Le PFU, combiné à la suppression de l’impôt sur la fortune sur le patrimoine financier, vise à faciliter la réorientation de l’épargne vers des placements dits productifs et à attirer des capitaux en France. Les résultats, après deux ans d’application, apparaissent globalement positifs tant sur l’attractivité de la France et sur le plan des recettes fiscales. Les pertes fiscales ont été bien moins importantes que celles attendues en raison d’une augmentation des produits financiers (dividendes en hausse) et du retour de certaines exilés fiscaux. Cette réforme semble en l’état actuel prouver une nouvelle fois le bienfondé de la courbe de Laffer qui a mis en évidence le fait qu’à partir d’un certain taux de taxation les recettes fiscales diminuent.
Une attractivité améliorée
La France se classait, en 2019, au 7e rang mondial pour les flux entrants avec 52 milliards d’euros (+40 % en un an), derrière le Royaume-Uni (-6 % en un an) en Europe mais devant l’Allemagne (source : Ministère de l’Économie). Business France souligne que le nombre d’emplois créés ou maintenus en France par les investissements des groupes étrangers a augmenté de 30 % en 2019, à 39 542 contre 30 302 en 2018.
Une évaluation délicate du fait d’un contexte fluctuant
La mesure de l’efficacité des réformes fiscales en faveur de l’épargne, en 2017/2018, est difficile à réaliser en raison de l’évolution du contexte économique et financier. L’instauration du PFU est intervenue dans un climat de hausse de l’épargne des ménages en raison de la multiplication des incertitudes (« gilets jaunes ») et de vieillissement de la population. Les ménages ont, selon la Banque de France, mis de côté 143 milliards d’euros 2019 contre 95 en 2018 et 112 milliards d’euros en 2017.
Les recettes issues du PFU dépendent de l’évolution des marchés. Après une forte chute des cours en 2018 (-10,95 %), ces derniers ont fortement progressé en 2019 (+26,37 % pour le CAC 40). Le PFU est également fonction des taux d’intérêt. Leur recul entraîne une baisse des revenus de taux pour les ménages (4,2 milliards d’euros en 2019, contre 4,7 milliards d’euros en 2018 et 5,3 milliards en 2017). Cette érosion devrait se poursuivre dans les prochaines années notamment avec la baisse du rendement des fonds euros.
Une forte hausse des dividendes perçus
En 2019, les ménages ont déclaré pour 23 milliards d’euros de dividendes au titre de 2018, contre 14 milliards en 2017. Cette hausse est, en volume, comparable à la baisse de 2013 générée par l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu des produits financiers perçus dans le cadre d’un compte titres. Selon les premières données concernant les dividendes de 2019, une nouvelle hausse de 3 milliards d’euros aurait été enregistrée. Les indépendants ont privilégié à nouveau le versement des dividendes à compter de 2018 quand auparavant ils avaient opté pour un accroissement des charges de leurs entreprises. Par ailleurs, de 2013 à 2017, pour échapper aux contraintes fiscales pesant sur les SARL, les indépendants avaient privilégié la forme de la société par actions simplifiée pour la création d’entreprises.
En 2018, 11 % des anciens redevables de l’ISF ont déclaré une valeur de biens immobiliers inférieure à celle de 2017. Le manque de données ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’une réa llocation de leur patrimoine. Par ailleurs, avec la hausse des prix de l’immobilier, les recettes de l’IFI ont progressé en 2019 (1,56 milliard d’euros après 1,25 milliard en 2018, hors contrôle fiscal).
Une baisse du nombre d’expatriations et une hausse du nombre d’impatriations fiscales de ménages français fortunés ont été constatées. Le nombre de départs à l’étranger de redevables à l’ISF est passé de 400 à 150 de 2017 à 2018. Les retours de contribuables français disposant d’un patrimoine élevé sont en augmentation depuis deux ans. Le nombre est passé de 100 à 250. Depuis deux ans, le nombre de retour est supérieur à celui des départs, phénomène qui n’avait été constaté qu’une seule fois en vingt ans.
Des pertes fiscales moins importantes que prévues
Le coût budgétaire du PFU établi au moment de son adoption avait été évalué entre 1,4 et 1,7 milliards d’euros. Du fait de l’accroissement des dividendes, la moins-value fiscale serait, selon France Stratégie, estimée 500 millions d’euros. Des études en cours de finalisation considèrent que la perte de recettes pourrait être nulle (travaux en cours de l’INSEE).
L’IFI, mis en place pour remplacer l’impôt sur la fortune (ISF), a rapporté 2,1 milliards d’euros en 2019, soit 600 millions de plus qu’initialement prévu dans la loi de finances. En 2018, les recettes de cet impôt avaient atteint 1,3 milliard d’euros, contre 800 millions d’euros initialement prévues. En 2017, pour sa dernière année de perception avant sa suppression, l’ISF, avec une assiette bien plus large et donc un nombre de redevables bien plus important avait rapporté 4,1 milliards d’euros. Le nombre de foyers assujettis à l’IFI était, en 2019 de 139 149 alors que près de 358 200 foyers étaient assujettis à l’ISF en 2017.
Le Coin des Epargnants du 14 novembre 2020 : attention aux mirages
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 13 novembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 380,16 | +8,45 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 29 479,81 | +4,08 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 11 829,29 | -0,55 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 076,72 | +4,78 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 316,39 | +6,88 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 432,07 | +7,12 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 25 385,87 | +4,36 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 310,10 | +0,80 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,310 % | +0,047 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,549 % | +0,072 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,886 % | +0,066 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1823 | -0,42 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 891,264 | -3,09 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 42,880 | +8,17 % | 66,300 |
Une euphorie en trompe l’œil
La Bouse de Paris a connu en cette mi-novembre sa meilleure semaine depuis le mois de juin avec un gain de 8,45 %. Les valeurs « actions » ont été portées par l’espoir d’une reprise économique rendue possible par le lancement d’un vaccin contre la Covid-19 et par l’arrivée de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis. Les craintes liées à la dégradation de la situation sanitaire et la prolongation des restrictions en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis sont passées, ces derniers jours, au second plan. Les investisseurs espèrent, par ailleurs, de nouvelles mesures de soutien budgétaires et monétaires. Dans leur communication, les banques centrales appellent au calme en soulignant que la situation économique demeure très compliquée à court terme. Le Président de la FED, Jerome Powell, a ainsi prévenu que « les prochains mois pourraient être difficiles ». La nécessité d’un nouveau plan de soutien du Congrès demeure toujours d’actualité aux Etats-Unis. Les parlementaires républicains ont, une nouvelle fois, rejeté les appels des responsables démocrates à voter un paquet de relance budgétaire. Aux Etats-Unis, la détérioration de la situation sanitaire préoccupe de plus en plus les élus. La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a imposé jeudi un confinement de 30 jours, tandis que les gouverneurs de l’Illinois, du Maryland et de l’Etat de Washington envisagent publiquement de faire de même. Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies a déclaré que quasiment aucun Etat n’était épargné par la recrudescence de la pandémie.
En gagnant plus de 8 % sur la semaine, le baril de pétrole (Brent) est revenu au-dessus de 40 dollars, le prix étant soutenu par les espoirs d’un redémarrage de la croissance grâce à l’éventuel vaccin.
Epargne : quelles leçons tirées des réformes fiscales de 2018 ?
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) introduit le 1er janvier 2018 et le Plan d’Épargne Retraite de la loi PACTE constituent les deux principales réformes concernant la sphère de l’épargne depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République. Le PFU, combiné à la suppression de l’impôt sur la fortune sur le patrimoine financier, vise à faciliter la réorientation de l’épargne vers des placements dits productifs et à attirer des capitaux en France. Les résultats, après deux ans d’application, apparaissent globalement positifs tant sur l’attractivité de la France et sur le plan des recettes fiscales. Les pertes fiscales ont été bien moins importantes que celles attendues en raison d’une augmentation des produits financiers (dividendes en hausse) et du retour de certaines exilés fiscaux. Cette réforme semble en l’état actuel prouver une nouvelle fois le bienfondé de la courbe de Laffer qui a mis en évidence le fait qu’à partir d’un certain taux de taxation les recettes fiscales diminuent.
Une attractivité améliorée
La France se classait, en 2019, au 7e rang mondial pour les flux entrants avec 52 milliards d’euros (+40 % en un an), derrière le Royaume-Uni (-6 % en un an) en Europe mais devant l’Allemagne (source : Ministère de l’Économie). Business France souligne que le nombre d’emplois créés ou maintenus en France par les investissements des groupes étrangers a augmenté de 30 % en 2019, à 39 542 contre 30 302 en 2018.
Une évaluation délicate du fait d’un contexte fluctuant
La mesure de l’efficacité des réformes fiscales en faveur de l’épargne, en 2017/2018, est difficile à réaliser en raison de l’évolution du contexte économique et financier. L’instauration du PFU est intervenue dans un climat de hausse de l’épargne des ménages en raison de la multiplication des incertitudes (« gilets jaunes ») et de vieillissement de la population. Les ménages ont, selon la Banque de France, mis de côté 143 milliards d’euros 2019 contre 95 en 2018 et 112 milliards d’euros en 2017.
Les recettes issues du PFU dépendent de l’évolution des marchés. Après une forte chute des cours en 2018 (-10,95 %), ces derniers ont fortement progressé en 2019 (+26,37 % pour le CAC 40). Le PFU est également fonction des taux d’intérêt. Leur recul entraîne une baisse des revenus de taux pour les ménages (4,2 milliards d’euros en 2019, contre 4,7 milliards d’euros en 2018 et 5,3 milliards en 2017). Cette érosion devrait se poursuivre dans les prochaines années notamment avec la baisse du rendement des fonds euros.
Une forte hausse des dividendes perçus
En 2019, les ménages ont déclaré pour 23 milliards d’euros de dividendes au titre de 2018, contre 14 milliards en 2017. Cette hausse est, en volume, comparable à la baisse de 2013 générée par l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu des produits financiers perçus dans le cadre d’un compte titres. Selon les premières données concernant les dividendes de 2019, une nouvelle hausse de 3 milliards d’euros aurait été enregistrée. Les indépendants ont privilégié à nouveau le versement des dividendes à compter de 2018 quand auparavant ils avaient opté pour un accroissement des charges de leurs entreprises. Par ailleurs, de 2013 à 2017, pour échapper aux contraintes fiscales pesant sur les SARL, les indépendants avaient privilégié la forme de la société par actions simplifiée pour la création d’entreprises.
En 2018, 11 % des anciens redevables de l’ISF ont déclaré une valeur de biens immobiliers inférieure à celle de 2017. Le manque de données ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’une réa llocation de leur patrimoine. Par ailleurs, avec la hausse des prix de l’immobilier, les recettes de l’IFI ont progressé en 2019 (1,56 milliard d’euros après 1,25 milliard en 2018, hors contrôle fiscal).
Une baisse du nombre d’expatriations et une hausse du nombre d’impatriations fiscales de ménages français fortunés ont été constatées. Le nombre de départs à l’étranger de redevables à l’ISF est passé de 400 à 150 de 2017 à 2018. Les retours de contribuables français disposant d’un patrimoine élevé sont en augmentation depuis deux ans. Le nombre est passé de 100 à 250. Depuis deux ans, le nombre de retour est supérieur à celui des départs, phénomène qui n’avait été constaté qu’une seule fois en vingt ans.
Des pertes fiscales moins importantes que prévues
Le coût budgétaire du PFU établi au moment de son adoption avait été évalué entre 1,4 et 1,7 milliards d’euros. Du fait de l’accroissement des dividendes, la moins-value fiscale serait, selon France Stratégie, estimée 500 millions d’euros. Des études en cours de finalisation considèrent que la perte de recettes pourrait être nulle (travaux en cours de l’INSEE).
L’IFI, mis en place pour remplacer l’impôt sur la fortune (ISF), a rapporté 2,1 milliards d’euros en 2019, soit 600 millions de plus qu’initialement prévu dans la loi de finances. En 2018, les recettes de cet impôt avaient atteint 1,3 milliard d’euros, contre 800 millions d’euros initialement prévues. En 2017, pour sa dernière année de perception avant sa suppression, l’ISF, avec une assiette bien plus large et donc un nombre de redevables bien plus important avait rapporté 4,1 milliards d’euros. Le nombre de foyers assujettis à l’IFI était, en 2019 de 139 149 alors que près de 358 200 foyers étaient assujettis à l’ISF en 2017.
Quels regards sur la protection sociale à l’heure de la crise sanitaire ?
Mercredi 18 novembre 2020 à 10 heures, en vous inscrivant (lien ci-dessous) vous pourrez assister à la réunion en ligne organisée par AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’EPARGNE et AMPHITEA avac la participation d’André Renaudin, Jérôme Jaffré, Alain Mergier et Philippe Crevel. Le débat sera animé par Wendy Bouchard

Inscrivez-vous pour la présentation des enquêtes Cercle de l’Épargne /AG2R LA MONDIALE / AMPHITEA sur l’épargne, la retraite et la protection sociale version 2020
Le Cercle de l’Épargne, AG2R LA MONDIALE et AMPHITEA présenteront le mercredi 18 novembre de 10 à 11H30 deux grandes enquêtes afin d’évaluer les besoins et les attentes des ménages et des professionnels en ce qui concerne leur protection sociale et leur épargne. Cette présentation sera animée par la journaliste Wendy Bouchard. André Renaudin, Directeur Général d’AG2R LA MONDIALE, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, Jérôme Jaffré, directeur du CECOP et Alain Mergier, sociologue présenteront et commenteront les principaux résultats des deux enquêtes dont le terrain a été confié à l’IFOP.
Cette présentation en ligne intervient dans un contexte évidemment atypique en raison de la crise sanitaire. L’enquête du Cercle ayant été réalisé en deux temps, avant le premier confinement et juste avant le second permet de mesurer l’évolution des opinions des ménages français.

Quel coût pour le confinement acte II ?
Après un bon troisième trimestre, +18,2 %, la France est, à nouveau, avec un deuxième confinement, à une rechute de son activité économique. La Banque de France estime que le recul d’activité devrait atteindre 12 % en novembre, cette prévision étant un peu plus faible que celle du Ministère de l’Economie (-20 %). L’une comme l’autre ne prennent pas en compte le maintien éventuel d’un confinement en décembre qui aurait des effets bien plus importants par effets cumulatifs et par le fait que la fin d’année est pour de nombreux secteurs cruciale pour la réalisation du chiffre d’affaires.
En octobre, l’activité était en retrait, en France en raison du durcissement des mesures sanitaires et du poids des incertitudes économiques. Au niveau de l’industrie, le taux d’utilisation des capacités de production était, en octobre de 73 %, contre 79 % avant la crise. Avant le confinement, une légère progression est observée dans l’automobile (de 71 à 73 % de septembre à octobre). La fermeture des concessions si elle perdurait devrait provoquer l’arrêt des sites de production et donc se traduire par une forte montée du chômage partiel dans ce secteur. Dès le mois d’octobre, la production chimique était orientée en baisse (de 77 à 75 %), tout comme celles de la métallurgie (de 67 à 66 %) et de l’habillement (de 69 à 68 %).Si l’industrie pharmaceutique fonctionne à plein régime (taux d’utilisation des capacités de production de 81 %), en revanche le secteur aéronautique à 65 de ses capacités. Avant le deuxième confinement, la situation dans les services était très diverse en fonction des secteurs. La restauration et l’hébergement étaient en net sous-activité (47 % de l’activité normale pour l’hébergement et 62 % pour la restauration en octobre), l’édition, les services d’information ou les activités juridiques et comptables avaient retrouvé un niveau normal. Au total, les services marchands fonctionnaient à 87 % en octobre, contre 89 % en septembre. Dans le bâtiment, l’activité était, en octobre, proche de la normale.
Dans le cadre de l’enquête mensuelle de la Banque de France, les chefs d’entreprise ont fait part, en octobre, que leur trésorerie se dégradait et qu’elle était inférieur à son niveau d’avant crise.
Avec le reconfinement, les chefs d’entreprise s’attendent à une chute d’activité pour le mois de novembre. Le repli serait modéré dans l’industrie et le bâtiment et serait beaucoup plus marqué dans les services, à l’exception de certains services aux entreprises. Les effets de ce deuxième confinement seront moindres en raison de l’expérience acquise avec le premier et du fait qu’il est moins strict. Plusieurs secteurs devraient néanmoins être fortement touchés, la restauration, l’hébergement, le commerce de détail (produits non-essentiel), les transports, la location de voitures, etc. Plus le confinement durera, plus la baisse d’activité s’accentuera en raison des difficultés rencontrées pour écouler la marchandise produite.
Le deuxième confinement aura, selon la Banque de France, comme conséquence une contraction d’activité de 12 % pour le mois de novembre. Lors du premier confinement, la perte était de 31 % pour les semaines du mois d’avril.
Le Coin des Epargnants du 7 novembre 2020 : quand une semaine chasse l’autre
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 6 novembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 960,88 | +7,98 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 323,40 | +6,87 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 11 888,97 | +8,96 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 12 480,02 | +7,99 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 910,02 | +5,97 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 204,05 | +8,31 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 24 325,23 | +5,87 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 312,16 | +2,72 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,357 % | -0,012 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,621 % | +0,009 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,820 % | -0,039 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1890 | +2,11 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 953,070 | +4,00 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 39,480 | +3,91 % | 66,300 |
Quand une semaine chasse l’autre
Les indices « actions » ont effacé en grande partie leurs pertes de la semaine dernière. Les hausses atteignent en moyenne plus de 7 %. Le CAC 40 a ainsi gagné près de 7,98 %, revenant à quelques encablures des 5000 points qui constituent pour le moment une barre difficile à franchir sur la durée. En cinq jours, l’indice des valeurs technologies, le Nasdaq, a gagné près de 9 %.
Les marchés semblent plébisciter une victoire mesurée de Joe Biden qui devrait composer avec un Sénat demeuré Républicain. Les investisseurs escomptent que le nouvel exécutif sera contraint de modérer ses ardeurs sur le terrain économique et social.
En Europe, la succession de confinements qui avait fortement marqué les marchés la semaine dernière semble être digérée malgré les conséquences en termes budgétaires et de croissance qu’ils induisent.
L’emploi américain, une baisse qui pourrait s’interrompre
L’épidémie aux Etats-Unis ne connaît pas des courbes aussi sinusoïdales qu’en Europe, ce qui pour le moment favorise la reprise. L’amélioration du marché de l’emploi se poursuit mais à un rythme plus lent. En octobre, 638 000 postes ont été créés après 672 000 en septembre. Le taux de chômage baisse d’un point à 6,9 %. Il s’élevait à 14,7 % en avril et à 3,5 % en février de cette année, taux qui était alors le plus bas jamais enregistré depuis cinquante ans.
Au mois d’octobre, 6,7 millions d’Américains travaillaient en temps partiel contraint en hausse par rapport à septembre. L’arrêt des mesures de soutien à l’économie du fait de l’absence d’accord au Congrès sur un nouveau plan de relance fait craindre une détérioration de la situation à compter du mois de novembre, surtout si l’épidémie s’accélère à nouveau.
Les dépôts à vue dopés par les crises
Lors des dernières crises économiques et financières, les ménages ont accru le montant de leurs liquidités. Avec l’épidémie de covid-19, la progression de l’encours de dépôts à vue est à la hauteur du choc subi. Il a, en effet, augmenté de 50 milliards d’euros entre le début de l’année 2020 et le mois de septembre. Le précédent record datait de la crise financière de 2008/2009 avec une augmentation des dépôts à vue de 26 milliards d’euros. Lors de la récession de 1993 et lors de l’éclatement de la bulle Internet, la progression avait été d’une petite dizaine de milliards d’euros. La crise des dettes souveraines de 2011/2013 avait également donné lieu à une hausse des dépôts à vue de 12 milliards d’euros. En 2020, le contexte est évidemment très différent par rapport aux crises précédentes, les ménages étant amenés à épargner de manière contrainte en raison de la mise en œuvre de confinements.
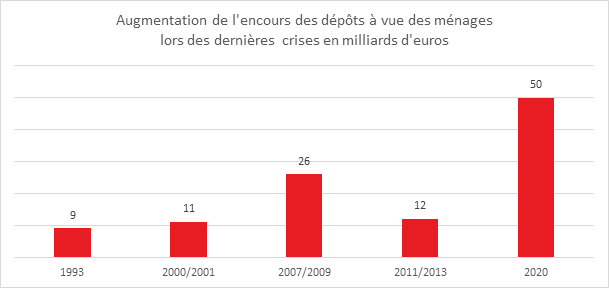
Le PER collectif démarre aussi bien que possible
Malgré la crise sanitaire, le Plan d’Epargne Retraite se fraie son chemin. Selon l’Association Française de Gestion, l’ensemble des produits collectifs d’épargne retraite, PERCO et PER d’entreprise collectifs issus de la Loi
PACTE, bénéficie à plus de 3,1 millions de porteurs de parts. Au total, plus de 274 000 entreprises se sont dotées d’un produit d’épargne retraite collectif, PERCO ou PER. En un an, la progression atteint 11 % en et de près de + 4% sur le premier semestre 2020)

Les encours du PERCO et du PER collectif s’élevaient à fin juin à 20,5 milliards d’euros en hausse de 8,5% sur un an. Les versements sur les dispositifs collectifs d’épargne retraite s’établissent à 1,75 milliard d’euros (+0,5% sur un an) et les rachats sont en baisse de 8%, p
Depuis le 1er octobre 2020, il n’est plus possible pour une entreprise de souscrire un PERCO. Elle doit passer par le PER. En revanche, les anciens contrats restent valides.
Depuis la commercialisation le 1er octobre 2019, des nouveaux PER, plus de 130 000 entreprises et 530 000 salariés en bénéficient. L’encours du seul PER collectif est de 4,8 milliards d’euros à fin juin 2020.
Sur le premier semestre de l’année, selon l’AFG, près de 31 000 entreprises ont transformé leur ancien dispositif PERCO en nouveau PER d’entreprise collectif et près de 7 000 ont mis en place ce nouveau dispositif pour leurs salariés.
Le taux de rémunération des livrets bancaires : 0,12 % en septembre
Selon la Banque de France, au mois de septembre, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est identique à celui du mois d’août (0,46 %). Cette stabilité est le reflet d’une rémunération inchangée pour les dépôts des ménages (0,69%) comme pour ceux des SNF (0,16%). Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés était de 0,12 % contre 0,13 % en août.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| sept-19 | juil-20 | août-20 (e) | sept-20 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,59 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
| Ménages | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,74 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,34 | 1,10 | 1,07 | 1,06 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
| – plan d’épargne-logement | 2,66 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| SNF | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,16 | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,42 | -0,44 | -0,48 | -0,49 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,63 | -0,54 | -0,56 | -0,60 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Le Coin des Epargnants : octobre sans saveur
Un mois d’octobre sur fond de deuxième vague et d’élection américaine
Les indices « actions » des pays occidentaux ont fortement reculé au mois d’octobre malgré la publication de nombreux résultats d’entreprises moins catastrophiques que prévu et l’annonce de taux de croissance record pour le troisième trimestre. La survenue d’une deuxième vague plus massive et rapide que prévue a refroidi les marchés. Les mesures de reconfinement prises en Europe laissent présager un nouveau recul du PIB pour la fin de l’année et un nouveau recours aux dépenses publiques. Les tensions internationales autour de la Turquie, la perspective d’un Brexit dur et les incertitudes concernant l’élection américaine ont également pesé sur les cours. Le recul des principaux indices est important, notamment pour le DAXX allemand, près de 10 %. Le CAC 40 cède près de 5 %. Le Nasdaq perd de son côté 1,57 % en un mois. Dans ce contexte économique peu porteur, le baril de pétrole (BRENT) a perdu plus de 8 % de sa valeur en un mois et passe en-dessous de 40 dollars.
La BCE statu quo avant d’y voir plus clair en décembre
La Banque centrale européenne a décidé de ne pas modifier sa politique monétaire et ses taux malgré la deuxième vague de covid-19 qui frappe l’Europe. Elle a indiqué dans son communiqué de presse que dans un environnement de risques « clairement orientés à la baisse, le conseil des gouverneurs évaluera soigneusement » les informations à venir, et notamment la dynamique de la pandémie et la perspective du déploiement d’un vaccin. Les nouvelles projections économiques de décembre permettront à la banque centrale de « recalibrer ses instruments de façon appropriée ».
Au mois de juin dernier la BCE avait ajouté une rallonge de 600 milliards d’euros au programme d’urgence de 750 milliards d’achat de dettes. Une nouvelle augmentation de ce programme est désormais prévue pour le mois de décembre. Une possible baisse du taux de dépôt, actuellement à -0,5 %, est également envisagée.
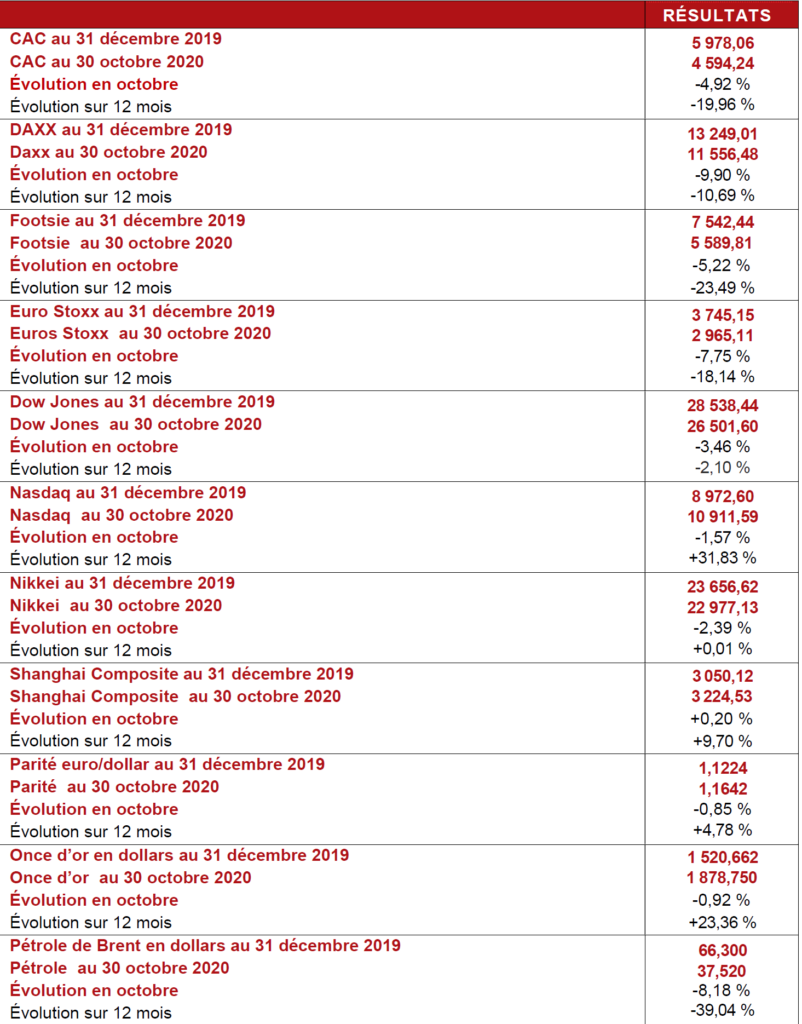
Le PEL l’impossible remise en cause des taux garantis ?
Le Plan d’Epargne Logement n’est pas un livret comme le Livret A et le LDDS. C’est un contrat associant l’Etat, un établissement financier et un épargnant. En vertu du droit des contrats, ce sont les clauses signées au moment qui s’appliquent durant toute la vie du contrat. De ce fait, les modifications relatives au PEL ne peuvent pas être rétroactives. Ainsi, le taux de rémunération est fixé à la signature et court jusqu’à la fin du contrat. Celle-ci n’a été bornée qu’à compter de 2011. Elle ne peut excéder 10 ans pour les versements et 15 ans pour la rémunération au taux initial. Tous les contrats signés avant 2011 sont donc toujours ouverts. Du fait du contexte de taux de l’époque, ils sont bien rémunérés et d’autant plus qu’une prime d’Etat pouvait s’appliquer, prime supprimée en 2018. Hors prime, les contrats d’avant 2011 peuvent être rémunérés entre 2,5 et 4,75 %.
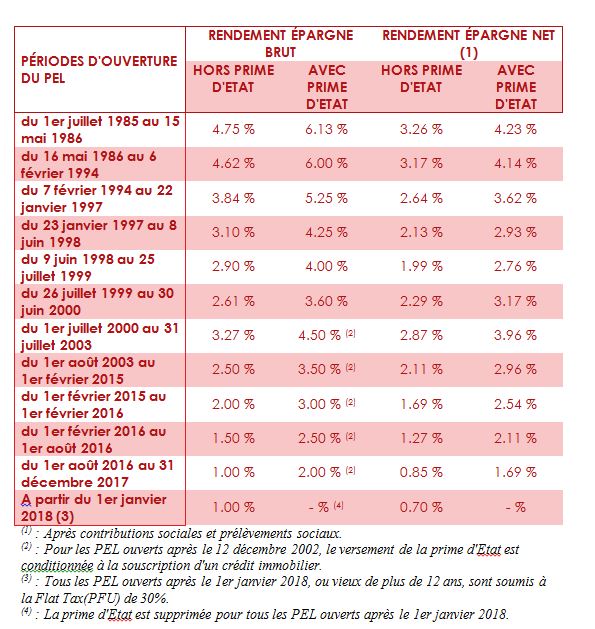
Selon l’Observatoire de l’Epargne Réglementée, le taux moyen de la rémunération des PEL était de 2,65 % en 2019 mais pour ceux ceux des PEL ouverts avant 2011, ce taux est de de 4,4 %. Le rapport 2019 de cet observatoire souligne que « cette rémunération élevée au regard des taux d’intérêt actuels pèse sur l’économie française, en accroissant le coût des ressources disponibles pour le financement de l’économie par les établissements bancaires ».
L’Observatoire indique que l’application d’un taux de 1 % à tous les PEL souscrits avant 2011 pourrait permettre aux banques d’économiser et de reverser dans l’économie 4 milliards d’euros par an.
L’adoption d’une telle réforme est délicate à mener. Elle serait impopulaire et juridiquement osée. Le PEL étant considéré comme un contrat comme l’assurance vie, le législateur a veillé jusqu’à maintenant à ne pas adopter de mesures rétroactives de peur d’une censure du Conseil constitutionnel. La réforme prévue par la loi de finances pour 2011 qui institue une durée de placement de 10 ans pour les PEL en est une des manifestations. Pour modifier les règles rétroactivement, il faudrait donc compter sur la mansuétude du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement pourrait arguer que la remise en cause du contrat se justifie au nom de l’intérêt général. Ce n’est pas évident à plaider. Il pourrait décider l’arrêt des versements à compter d’une date sans fermeture des plans, cela serait néanmoins une modification substantielle du contrat. Il pourrait fiscaliser davantage les PEL mais cela ne serait guère populaire et cela frapperait tous les titulaires. Ce ne serait pas très juste. L’Etat et surtout les banques doivent faire face au problème des taux garantis, ce qui est interdit au niveau des contrats d’assurance vie. En Allemagne, le problème s’est posé pour les contrats d’assurance vie. Le Gouvernement a obtenu l’abandon des taux garantis après validation législative. Le risque était alors très important pour les compagnies compte tenu des encours en jeu, ce qui n’est pas le cas avec le PEL.
Rapport de l’Observatoire de l’Épargne Réglementée
L’Observatoire de l’Épargne Réglementée, qui dépend de la Banque de France, a présenté son rapport annuel 2019, le 27 octobre dernier.
L’épargne réglementée correspond aux produits d’épargne (comptes et livrets) dont les conditions de fonctionnement sont fixées par les pouvoirs publics comme le livret A, le livret de développement durable, le livret d’épargne populaire, le plan épargne logement et le livret jeune. Ces produits ont généralement une fiscalité attractive. Dans le cas du livret A, les intérêts générés par l’argent déposé sur le livret A ne sont pas sujets à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En 2019, l’épargne réglementée des ménages français est en hausse de 2,7%. Elle atteignait à la fin de l’année dernière 772 milliards d’euros
En 2019, l’épargne réglementée représentait près de 14,2 % du patrimoine financier des Français contre environ 15 % les années précédentes. Cet état des lieux sera amené à évoluer en 2020, l’épargne bancaire cumulée par les Français entre le début du mois de mars et la fin du mois de septembre ayant été de 83 milliards d’euros. Sur les neufs premiers mois de l’année, la collecte du Livret A a atteint 25,76 milliards d’euros, ce qui constitue un record.
Malgré un rendement négatif, le livret A a contribué à la hausse de l’épargne règlementée en 2019
Fin 2019, près de 82 % des Français (soit 54,9 millions des Français) détenaient un livret A, soit une légère diminution par rapport à l’année précédente. L’argent déposé sur le livret A est en hausse de 20,3 milliards d’euros (+5,2%) par rapport à 2018. Son encours total était de 298,4 milliards d’euros et son encours moyen de 5 100 euros contre 4 800 euros en 2018.
En 2019, le rendement réel du livret A était négatif pour la troisième année consécutive. Le taux inflation ayant été de 1,1 % en 2019 et le taux du livret A de 0,75 % son rendement réel s’établissait à (-0,35 %) en 2019. Sa rémunération est passé à 0,5 % début 2020.
Ce rendement négatif n’est cependant pas inédit. Comme le souligne Olivier Garnier, directeur général des statistiques, études économiques et internationales de la Banque de France « Depuis sa création, en 1818, le livret A n’a connu que 79 années de rendements réels négatifs ». La banque de France met également en évidence dans son rapport que « le rendement de l’épargne réglementée reste, même dans ce contexte, compétitif relativement aux autres produits d’épargne financière, et représente un équilibre entre des produits de taux très peu rémunérateurs et des produits de fonds propres à la volatilité forte ».
Les encours des livrets de développement durable et solidaire et des plans d’épargne-logement sont en hausse contrairement à ceux des livrets d’épargne populaire
Les sommes déposées sur les livrets de développement durable et solidaire ont progressé de 4% à 111,9 milliards d’euros.
En revanche, les encours des livrets d’épargne populaire (LEP) ont baissé de 9,2 % à 38,7 milliards d’euros. La Banque de France précise que cette baisse tient à « l’arrivée à échéance, en 2019, de la dérogation légale qui a permis à certains détenteurs de conserver un LEP entre 2014 et 2019 alors qu’ils n’en respectaient pas les nouveaux critères d’éligibilité ». Pour la Banque de France, « sans cette évolution réglementaire, le nombre de LEP aurait progressé pour la première fois depuis 2015 ».
Les encours des plans d’épargne logement (PEL) sont en hausse de 2,2 % à 282,5 milliards d’euros malgré un nombre de comptes en baisse en 2019 de 6,1 %.
Dans un contexte de taux structurellement faibles, les PEL sont néfastes pour l’économie française
Dans ce rapport annuel, la Banque de France évoque la problématique du coût du stock de plans épargne logement (PEL) dont l’encours total était presque similaire fin 2019 à celui du livret A. Près de 20 % des français détiennent un PEL.
Le taux moyen de la rémunération des PEL était de 2,65 % en 2019 mais ceux des PEL ouverts avant 2011, ont une rémunération de près de 4,4 %. Pour la banque de France, « Cette rémunération élevée au regard des taux d’intérêt actuels pèse sur l’économie française, en accroissant le coût des ressources disponibles pour le financement de l’économie par les établissements bancaires ».
La banque centrale de la France estime que l’application d’un taux de 1 % à tous les PEL souscrits avant 2011 pourrait permettre aux banques d’économiser et de reverser dans l’économie 4 milliards par an.
Le PEL a été l’objet de plusieurs réformes au cours de la dernière décennie
L’année 2011 avait été marquée par un durcissement des règles avec l’établissement d’une durée de vie maximale fixée à 15 ans et d’une révision annuelle de la rémunération des nouveaux PEL. Les PEL ouverts avant 2011 correspondaient en 2019 à près d’un tiers des encours totaux, avec 115,5 milliards d’euros.
Les taux du PEL ont été modifié en 2016. Le taux appliqué aux nouveaux PEL souscrits depuis 2016 est de 1%. Mais pour la Banque de France, il devrait être de 0,3%. Cette diminution des taux en 2016 a eu des conséquences sur la collecte nette qui est depuis continuellement en baisse et même négative depuis 2018. Cependant les primes acquises et la capitalisation des intérêts ont conduit à une poursuite de l’augmentation des encours.
Une réforme des plus anciens PEL s’annonce toutefois délicate étant donné que les rémunérations sont inscrites dans les contrats. Une modification pourrait conduire à des contentieux.
Les ménages souhaitent toujours épargner
Avant les annonces de reconfinement prononcées par le Président de la République, la confiance des ménages dans la situation économique s’érodait. L’indicateur de l’INSEE mesurant cette confiance a perdu un point, en octobre par rapport à septembre. À 94, il retrouve son niveau de juillet et août et demeure en dessous de sa moyenne de longue période (100).
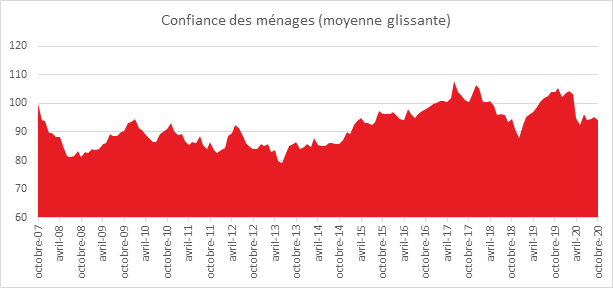
Cercle des Epargne – données INSEE
En octobre, les ménages sont moins optimistes sur leur situation financière future. L’indicateur est en baisse de trois points et repasse en dessous de sa moyenne de longue période. En revanche, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée est stable et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période.
Par ailleurs, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est stable. Le solde correspondant est malgré tout inférieur à sa moyenne de longue période.
En octobre, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est en baisse. Le solde correspondant perd deux points, mais demeure très au-dessus de sa moyenne de long terme. Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future baisse quant à lui légèrement. Il perd un point et se maintient bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
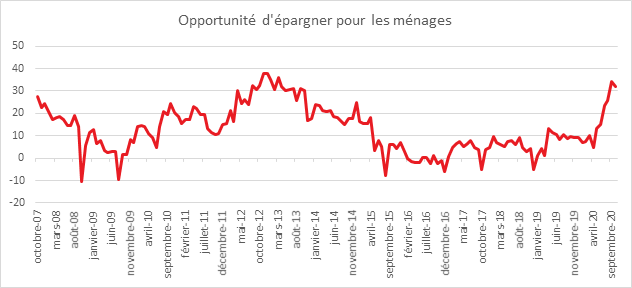
Cercle de l’Epargne – données INSEE
En octobre, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois diminue. En revanche, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois reste stable.
Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage s’accentuent un peu en octobre. Le solde correspondant augmente de deux points et demeure très au-dessus de sa moyenne de longue période.
Après la période l’estivale, les ménages au courant du mois d’octobre commençaient à rendre conscience de l’arrivée de la deuxième vague. Au regard de la situation sanitaire et économique, le moral des Français mesurés par l’INSEE peut apparaître comme relativement correct. Les mesures de soutien décidées par les pouvoirs publics peuvent expliquer cet état d’esprit qui néanmoins s’accompagne d’une forte défiance à l’égard de ces derniers. Quatre fois moins d’a
En septembre, les ménages se sont endettés tout en conservant un oeil sur la crise
Le rythme de constitution de dépôts bancaires par les ménages a de nouveau augmenté, selon la Banque de France en septembre (+ 5,4 milliards d’euros, contre + 3 milliards d’euros en août). Ce montant se rapproche néanmoins de celui qui avait cours avant la phase de confinement du printemps. De janvier 2017 à février 2020, le rythme mensuel de progression était de 5,9 milliards d’euros. Les Français n’ont pas réduit leur poche de liquidités après le premier confinement.
Les flux nets de crédits bancaires, après un mois de faible progression en août, ont repris en septembre le dynamisme observé de mai à juillet pour s’établir à 8,9 milliards d’euros, au-dessus de la moyenne pré-covid, de janvier 2017 à février 2020 (+ 6,2 milliards d’euros. Le crédit à la consommation contribue positivement en septembre (200 milions d’euros aux flux de crédit totaux, qui restent néanmoins portés principalement par le crédit à l’habitat (8,8 milliards d’euros. Au total, le flux net d’épargne bancaire (c’est-à-dire hors placements non bancaires, calculé comme la différence entre les dépôts y compris numéraire et les crédits) est négatif en septembre de 3,3 milliards d’euros pour la première fois depuis mars. Ce flux net entre mars et septembre atteint ainsi 83,3 milliards d’euros, en recul par rapport au cumul à fin août (86,6 milliards d’euros).
Le Coin de l’agenda économique et financier
Lundi 26 octobre
La Commission européenne publiera pour l’Union européenne et la zone euro les indicateurs avancés qui mesurent la confiance des consommateurs et la confiance dans l’industrie pour le mois d’octobre.
Le PIB pour le troisième trimestre en France sera connu.
Les indices IFO d’octobre sur la situation économique en Allemagne seront communiqués.
Publication de l’enquête pour le chômage au troisième trimestre 2020 en Espagne.
Aux États-Unis, il faudra suivre l’indice sur l’activité économique de la FED de Chicago pour le mois de septembre.
Mardi 27 octobre
L’indicateur de la masse monétaire M3 de la zone euro pour le mois de septembre et le troisième trimestre sera connu.
Aux États-Unis, l’indice manufacturier de la FED de Richmond d’octobre sera dévoilé.
Mercredi 28 octobre
Publication du niveau des stocks de gros en septembre aux États-Unis.
Jeudi 29 octobre
Décision sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE). Conférence de presse de la BCE.
Le PIB pour le troisième trimestre dans la zone euro sera dévoilé par Eurostat.
Le taux de chômage pour le mois d’octobre en Allemagne sera connu tout comme le PIB allemand pour le troisième trimestre.
Publication en Italie de l’indice de confiance des consommateurs pour octobre.
Annonce par la Banque du Japon de sa décision sur les taux.
Le Ministère de l’économie, du Commerce et de l’industrie japonais dévoilera le niveau de la production industrielle en septembre.
Vendredi 30 octobre
Le PIB pour le troisième trimestre en Allemagne sera publié.
Le taux de chômage en Italie en septembre sera connu.
Lundi 2 novembre
Aux États-Unis, il faudra suivre les résultats des indices ISM Manufacturier, ISM Manufacturing Employment Index, ISM Manufacturing New Orders Index et ISM prix payés d’octobre.
Publication au Japon du PMI Manufactuier Nikkei pour le mois d’octobre.
La production industrielle en septembre sera publiée par l’Insee.
Mardi 3 novembre
La production industrielle en septembre en Allemagne sera dévoilée.
Election présidentielle américaine.
Mercredi 4 novembre
Les balances commerciales allemandes et américaines pour le mois d’octobre seront dévoilées.
L’indice PMI des services pour le mois d’octobre sera publié dans la zone euro, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
L’indice Markit- PMI composite pour le mois d’octobre sera publié dans la zone euro, en France, en Allemagne et aux États-Unis.
En Chine, le PMI des services Caixin pour le mois d’octobre sera donné.
Jeudi 5 novembre
Publication par la Bundesbank d’Allemagne de l’indicateur des commandes d’usine pour le mois de septembre.
Décision sur les taux de la Fed. Déclaration de la politique monétaire de la Fed et conférence de presse du Federal Open Market Committee (FOMC).
La production industrielle en septembre en Espagne sera dévoilée.
Publication du taux de chômage en octobre aux États-Unis. Le niveau des stocks des grossistes en septembre sera publié par le Bureau américain.
Samedi 7 novembre
La balance commerciale chinoise pour le mois d’octobre sera connue.
Lundi 9 novembre
L’indice Sentix relatif à la confiance des investisseurs dans la zone euro sera publié pour le mois de novembre.
Les réserves de change de la Chine pour le mois d’octobre seront connues.
Le Coin des Epargnants : préférence absolue pour la liquidité
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 23 octobre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4,909.64 | -0,53 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 335,57 | -0,95 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 11 548,28 | -1,06 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 12 645,75 | -2,04 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 852,81 | -1,13 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 198,86 | -1,44 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 516,59 | +0,45 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 276,98 | -0,72 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,300 % | +0,051 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,574 % | +0,052 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,851 % | +0,102 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1839 | +1,05 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 896,585 | -0,12 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 41,880 | -2,10 % | 66,300 |
Les investisseurs de plus en plus hésitants
La bourse de Paris a cédé du terrain les trois premiers jours de la semaine avec la succession de mauvaises nouvelles sur le plan de l’épidémie. La publication de résultats moins dégradés que prévus pour le troisième trimestre et de plusieurs indicateurs européens ainsi qu’américains ont rassuré les investisseurs qui récusent le scénario du pire, une croissance en W sur fond de reconfinement. Le CAC 40 sur la semaine ne lâche que 0,53 %.
L’indice PMI IHS Markit composite (synthèse entre l’industrie et les services) du secteur privé a progressé de 1,6 point 54,5 en octobre outre-Rhin, contre 53,2 attendu. L’accélération de la croissance de l’activité manufacturière à 58 points, au plus haut depuis début 2018, contrebalance en effet la contraction observée dans les services (48,9). Un chiffre supérieur à 50 traduit une croissance de l’activité, tandis qu’un indice inférieur signale une contraction. Aux Etats-Unis, le même indice composite PMI IHS Markit a progressé de 1,2 point à 55,5, soutenu aussi bien par l’activité manufacturière (53,2) que par celle des services (+1,4 point à 56).
Les taux d’intérêt sur les obligations d’Etat ont augmenté de 50 à 100 points de base. Aux Etats-Unis, entre la proximité des élections et l’accroissement attendu de la dette publique en raison de la conclusion d’un nouveau plan de relance, les taux ont vivement augmenté. Le mouvement est identique mais dans une moindre proportion en Europe, toujours en lien avec la reprise de l’épidémie qui devrait se traduire par une moindre croissance. Les investisseurs commencent à regarder avec plus d’attention le risque souverain. François Villeroy de Galhau, le Gouverneur de la Banque de France est alarmiste sur le sujet, « nous ne savons pas si, ni quand la tragédie – un choc de confiance majeur, par exemple – peut se produire. Mais nous savons avec certitude que l’augmentation de la dette publique est un risque croissant qui pèse sur nous, et encore plus sur nos enfants et nos petits-enfants ». Une dette publique élevée accroît mécaniquement la sensibilité des finances publiques à la hausse des taux d’intérêt due à un resserrement de la politique monétaire. L’abaissement du ratio de la dette sera un exercice d’autant plus difficile que le niveau de départ est élevé et que de mauvaises habitudes ont été prises. A un moment ou un autre, les investisseurs demanderont une prime de risque, qui poussera à la hausse les coûts d’emprunt et compliquera la stabilisation de la dette .Le risque n’est pas immédiat en raison des politiques mises en œuvre par les banques centrales. A la fin des processus de rachats, l’appréciation des risques changera. Certes, certains imaginent la poursuite sans fin des mécanismes de rachat ou l’inscription en dette perpétuelle des obligations ainsi rachetées. Quoi qu’il en soit, les Etats seront dans le futur en situation de fragilité en cas de survenue de récession compte tenu des niveaux atteints par l’endettement. Les marges de manœuvre seront réduites pour de nombreuses années.
Epargnants, un potentiel de déduction fiscale important en 2020
Les ménages français, après les vacances et malgré les dépenses de la rentrée scolaire continuent à renforcer leur poche d’épargne de précaution. Le Livret A reste avec les dépôts à vue le principal bénéficiaire de cette propension quand l’assurance vie demeure en retrait sans connaître de réelle remise en cause.
Le Livret A toujours en pointe
Au mois de septembre, pour la neuvième fois consécutive, le Livret A enregistre, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, une collecte positive de 1,26 milliard d’euros. Ce résultat est en retrait par rapport à celui du mois d’août, 2,25 milliards d’euros, mais proche de celui du mois de septembre 2019 (1,06 milliard d’euros). Progressivement, le Livret A retrouve ainsi son rythme normal de collecte. Ce recul intervient après un semestre de forte collecte générée par le confinement et la chute de la consommation qui en a résulté. Ce retour à la normale est encore plus marqué pour le LDDS dont la collecte n’est que de 200 millions d’euros en septembre contre 600 millions en août. L’année dernière, en septembre, ce produit avait connu une décollecte de 40 millions d’euros. Le mois de septembre était traditionnellement un mauvais mois pour l’épargne réglementée. Le Livret A a enregistré cinq décollectes en dix ans. Septembre est synonyme de rentrée scolaire et s’accompagne de dépenses incontournables pour les ménages qui sont donc amenés à puiser dans leur épargne de court terme. Jusqu’en 2018, le versement du dernier tiers de l’impôt sur le revenu pesait également sur les résultats du mois de septembre. Le résultat de cette année souligne le souhait des ménages de disposer d’un montant important de liquidités afin de faire face à toute menace. Cette volonté était déjà l’œuvre en 2019, année post gilets jaunes et année de réforme des retraites. Ces deux évènements déstabilisants pour une partie de l’opinion avaient entraîné un rebond de l’épargne de court terme.
Sur les neufs premiers mois de l’année, la collecte du Livret A a atteint 25,76 milliards d’euros, ce qui constitue un record. Celle du LDDS s’est élevé à 6,98 milliards d’euros. Les encours de ces deux produits restent à des niveaux historiques à 324,3 milliards d’euros pour le Livret A et 119,3 milliards d’euros pour le LDDS. Pour retrouver un tel résultat, il faut remonter en 2012, année du relèvement des plafonds du Livret a et du LDDS ainsi que de la crise des dettes souveraines
L’assurance vie plie mais ne rompt pas
Pour le septième mois consécutif, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, une décollecte au mois de septembre, de 800 millions d’euros. Sur les neufs premiers mois de l’année, la décollecte s’établit à -7,3 milliards d’euros quand, en 2019, la collecte nette était de 20,8 milliards d’euros sur la même période. Depuis le début de la crise sanitaire, l’assurance vie doit faire face à une raréfaction des cotisations, les rachats se maintenant à un niveau classique. Le produit ne souffre pas d’une défiance des épargnants mais de leur préférence absolue pour la liquidité.
En septembre, les cotisations brutes se sont élevées à 9,4 milliards d’euros, soit un montant supérieur à celui d’août (8,0 milliards d’euros). Elles sont, en revanche, nettement inférieures à celles du mois de septembre 2019 (12,4 milliards d’euros). Depuis le début de l’année, la collecte brute a atteint 82,2 milliards d’euros, contre 109,5 milliards d’euros sur la même période en 2019. Le cap est maintenu en ce qui concerne les unités de compte qui représentaient en septembre 33 % de la collecte. Ce taux est conforme à la moyenne observée depuis le début de l’année (34 %). Cette proportion de 33 % correspond aux objectifs que les assureurs se sont assignés. Les assurés acceptent en partie le défi. L’incitation à la souscription d’unités de compte peut expliquer en partie la baisse de la collecte brute.
Le montant des prestations versées a été en légère hausse en septembre à 10,2 milliards d’euros contre 8,1 milliards d’euros en août. L’année dernière, elle avait atteint 9,3 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, les prestations versées par les sociétés d’assurance s’élèvent à 89,5 milliards d’euros (88,8 milliards d’euros sur la même période en 2019).
Le poids des incertitudes
Le haut niveau d’incertitudes sanitaires et économiques dissuade les ménages de s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité totale avec les dépôts à vue et les comptes courants. Par crainte d’une baisse de revenus ou d’une perte d’emploi, l’épargne de précaution est de mise. L’assurance vie placement de moyen et long terme est dans ce contexte délaissé. Elle reste néanmoins de loin le premier placement avec un encours de 1760 milliards d’euros.
Si la consommation de biens a retrouvé, en août, son niveau d’avant crise, celle de services est en retrait en raison des contraintes qui pèsent sur les activités de loisirs et de tourisme. Le déficit de consommation entre mars et mai n’a pas été comblé dans les mois qui ont suivi. Les ménages ne sont pas en mode consommation mais en mode prudence. Ils veillent à ne pas s’engager dans des dépenses importantes en attendant l’évolution de la situation sanitaire et économique. Avec les nouvelles mesures prises pour limiter la diffusion du virus (couvre-feu, fermeture des bars, restrictions sur les évènements sportifs, culturels, etc.), les dépenses de consommation devraient ressortir en baisse à compter du mois d’octobre. Le supplément d’épargne généré par l’épidémie a atteint 55 milliards d’euros selon le Conseil d’Analyse Economique. Au total, les Français pourraient épargner plus de 200 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année. Les ménages auront tout intérêt de se poser la question de la réorientation d’une partie de cette cassette d’ici la fin de l’année en particulier pour bénéficier d’éventuels allègements fiscaux. Les arbitrages en faveur du Plan d’Epargne Retraite, des Fonds d’Investissement de Proximité ou des Fonds Communes de Placement pour l’Innovation devront intervenir d’ici le 31 décembre.
Hausse sans surprise de la dette publique en Europe
À la fin du deuxième trimestre marqué par les confinements ainsi par les réponses économiques apportées à ceux-ci, la dette publique a enregistré une forte progression au sein de l’Union européenne. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB s’est établi à 95,1 % dans la zone euro, contre 86,3% à la fin du premier trimestre. Pour l’ensemble de l’Union, le ratio a augmenté, passant de 79,4 % à 87,8 %. Par rapport au deuxième trimestre 2019, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a augmenté tant dans la zone euro (de 86,2 % à 95,1 %) que dans l’UE (de 79,7 % à 87,8 %). Les augmentations importantes sont imputables à deux facteurs, soit la forte hausse de la dette publique et la diminution du PIB.
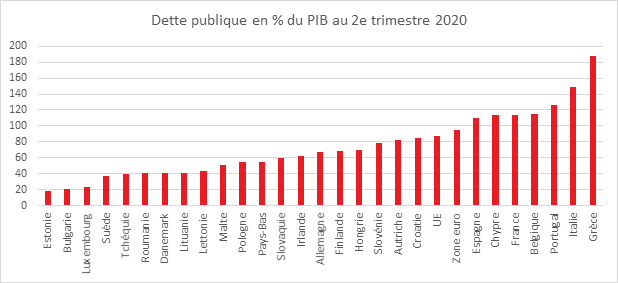
Décollecte en septembre sur fond de covid-19
Pour le septième mois consécutif, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, une décollecte au mois de septembre, de 800 millions d’euros. Sur les neufs premiers mois de l’année, la décollecte s’établit à -7,3 milliards d’euros quand, en 2019, la collecte nette était de 20,8 milliards d’euros sur la même période. Depuis le début de la crise sanitaire, l’assurance vie doit faire face à une raréfaction des cotisations, les rachats se maintenant à un niveau classique. Le produit ne souffre pas d’une défiance des épargnants mais de leur préférence absolue pour la liquidité.
Des cotisations en retrait
En septembre, les cotisations brutes se sont élevées à 9,4 milliards d’euros, soit un montant supérieur à celui d’août (8,0 milliards d’euros). Elles sont, en revanche, nettement inférieures à celles du mois de septembre 2019 (12,4 milliards d’euros). Depuis le début de l’année, la collecte brute a atteint 82,2 milliards d’euros, contre 109,5 milliards d’euros sur la même période en 2019.
Les unités de compte toujours sur la barre des 33 %
Le cap est maintenu en ce qui concerne les unités de compte qui représentaient en septembre 33 % de la collecte. Ce taux est conforme à la moyenne observée depuis le début de l’année (34 %). Cette proportion de 33 % correspond aux objectifs que les assureurs se sont assignés. Les assurés acceptent en partie le défi. L’incitation à la souscription d’unités de compte peut expliquer en partie la baisse de la collecte brute.
Des prestations dans la norme
Le montant des prestations versées a été en légère hausse en septembre à 10,2 milliards d’euros contre 8,1 milliards d’euros en août. L’année dernière, elle avait atteint 9,3 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, les prestations versées par les sociétés d’assurance s’élèvent à 89,5 milliards d’euros (88,8 milliards d’euros sur la même période en 2019).
Un climat peu porteur pour l’assurance vie
Le haut niveau d’incertitudes sanitaires et économiques dissuade les ménages à s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité totale avec les dépôts à vue et les comptes courants. Par crainte d’une baisse de revenus ou d’une perte d’emploi, l’épargne de précaution est de mise. L’assurance vie placement de moyen et long terme est dans ce contexte délaissé. Elle reste néanmoins de loin le premier placement avec un encours de 1760 milliards d’euros.
Avec la multiplication des restrictions dans le cadre de la seconde vague, le cycle de légère décollecte devrait se poursuivre dans les prochains mois, les ménages préférant attendre avant de réorienter l’épargne engrangée depuis le mois de mars.
Assurance vie : décollecte en septembre sur fond de préférence absolue pour la liquidité
Pour le septième mois consécutif, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, une décollecte au mois de septembre, de 800 millions d’euros. Sur les neufs premiers mois de l’année, la décollecte s’établit à -7,3 milliards d’euros quand, en 2019, la collecte nette était de 20,8 milliards d’euros sur la même période. Depuis le début de la crise sanitaire, l’assurance vie doit faire face à une raréfaction des cotisations, les rachats se maintenant à un niveau classique. Le produit ne souffre pas d’une défiance des épargnants mais de leur préférence absolue pour la liquidité.
Des cotisations en retrait
En septembre, les cotisations brutes se sont élevées à 9,4 milliards d’euros, soit un montant supérieur à celui d’août (8,0 milliards d’euros). Elles sont, en revanche, nettement inférieures à celles du mois de septembre 2019 (12,4 milliards d’euros). Depuis le début de l’année, la collecte brute a atteint 82,2 milliards d’euros, contre 109,5 milliards d’euros sur la même période en 2019.
Les unités de compte toujours sur la barre des 33 %
Le cap est maintenu en ce qui concerne les unités de compte qui représentaient en septembre 33 % de la collecte. Ce taux est conforme à la moyenne observée depuis le début de l’année (34 %). Cette proportion de 33 % correspond aux objectifs que les assureurs se sont assignés. Les assurés acceptent en partie le défi. L’incitation à la souscription d’unités de compte peut expliquer en partie la baisse de la collecte brute.
Des prestations dans la norme
Le montant des prestations versées a été en légère hausse en septembre à 10,2 milliards d’euros contre 8,1 milliards d’euros en août. L’année dernière, elle avait atteint 9,3 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, les prestations versées par les sociétés d’assurance s’élèvent à 89,5 milliards d’euros (88,8 milliards d’euros sur la même période en 2019).
Un climat peu porteur pour l’assurance vie
Le haut niveau d’incertitudes sanitaires et économiques dissuade les ménages à s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité totale avec les dépôts à vue et les comptes courants. Par crainte d’une baisse de revenus ou d’une perte d’emploi, l’épargne de précaution est de mise. L’assurance vie placement de moyen et long terme est dans ce contexte délaissé. Elle reste néanmoins de loin le premier placement avec un encours de 1760 milliards d’euros.
Avec la multiplication des restrictions dans le cadre de la seconde vague, le cycle de légère décollecte devrait se poursuivre dans les prochains mois, les ménages préférant attendre avant de réorienter l’épargne engrangée depuis le mois de mars.
Contrats d’épargne retraite non réclamés, le Sénat adopte la proposition de loi de Daniel Labaronne
Le 24 mars 2020, Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues députés, ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire. Leur proposition, modifiée par l’Assemblée, a été transmise le 22 juin 2020 au Sénat. Ce texte propose de confier au groupement d’intérêt public (GIP) Union retraite, à travers son portail en ligne Info retraite, une mission d’information sur les produits de retraite supplémentaire détenus par un assuré. La proposition de loi consacre, pour toute personne, un droit à l’information sur les produits d’épargne retraite détenus par celle-ci. Le texte prévoit la mise en œuvre d’une campagne de communication sur le relevé de situation individuelle récapitulant les droits acquis au titre de l’épargne retraite. Il ajoute au sein de l’état récapitulatif que reçoit le salarié lors de son départ de l’entreprise les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées sur l’un des produits de retraite supplémentaire préexistant à la réforme de 2019 instituant le PER. La proposition de loi créé une expérimentation en matière de recherche de bénéficiaires de contrats en déshérence.
La Commission des affaires sociales du Sénat a souhaité clarifier l’intention du dispositif afin de renforcer l’accès à certaines informations relatives aux contrats de retraite supplémentaire. Elle a également souhaité mieux encadrer les échanges d’informations prévus entre le groupement et les gestionnaires et la mise à disposition de ces informations par le groupement. Elle a supprimé le dispositif expérimental mentionné ci-dessus
Le Sénat en séance publique, le 21 octobre 2020, a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. Les sénateurs ont en séance levé l’interdiction inscrite en commission relative à la transmission au groupement, par les gestionnaires, de données financières sur les contrats de retraite supplémentaire.
Le Livret A : un mois de septembre encore bien fourni
Au mois de septembre, pour la neuvième fois consécutive, le Livret A enregistre, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, une collecte positive de 1,26 milliard d’euros. Ce résultat est en retrait par rapport à celui du mois d’août, 2,25 milliards d’euros, mais proche de celui du mois de septembre 2019 (1,06 milliard d’euros). Progressivement, le Livret A retrouve ainsi son rythme normal de collecte. Ce recul intervient après un semestre de forte collecte générée par le confinement et la chute de la consommation qui en a résulté. Ce retour à la normale est encore plus marqué pour le LDDS dont la collecte n’est que de 200 millions d’euros en septembre contre 600 millions en août. L’année dernière, en septembre, ce produit avait connu une décollecte de 40 millions d’euros.
Le mois de septembre est traditionnellement un mauvais mois pour l’épargne réglementée. Le Livret A a enregistré cinq décollectes en dix ans. Septembre est synonyme de rentrée scolaire et s’accompagne de dépenses incontournables pour les ménages qui sont donc amenés à puiser dans leur épargne de court terme. Jusqu’en 2018, le versement du dernier tiers de l’impôt sur le revenu pesait également sur les résultats du mois de septembre. Le résultat de cette année souligne le souhait des ménages à disposer d’un montant important de liquidités afin de faire face à toute menace. Cette volonté était déjà l’œuvre en 2019, année post gilets jaunes et année de réforme des retraites. Ces deux évènements déstabilisants pour une partie de l’opinion avaient entraîné un rebond de l’épargne de court terme.
En septembre, le contexte sanitaire et économique continue de peser sur les résultats de l’épargne. Ces dernières semaines, les ménages n’ont pas puisé dans la cagnotte constituée depuis le mois de mars. Ils ont, au contraire, continué à mettre de l’argent de côté. L’arrivée de la deuxième vague de l’épidémie et la hausse probable du chômage expliquent ce comportement. Si la consommation de biens a retrouvé, en août, son niveau d’avant crise, celle de services est en retrait en raison des contraintes qui pèsent sur les activités de loisirs et de tourisme. Par ailleurs, le déficit de consommation entre mars et mai n’a pas été comblé dans les mois qui ont suivi. Les ménages ne sont pas en mode consommation mais en mode prudence. Ils veillent à ne pas s’engager dans des dépenses importantes en attendant l’évolution de la situation sanitaire et économique.
Sur les neufs premiers mois de l’année, la collecte du Livret A a atteint 25,76 milliards d’euros, ce qui constitue un record. Celle du LDDS s’est élevé à 6,98 milliards d’euros. Les encours de ces deux produits restent à des niveaux historiques à 324,3 milliards d’euros pour le Livret A et 119,3 milliards d’euros pour le LDDS. Pour retrouver un tel résultat, il faut remonter en 2012, année du relèvement des plafonds du Livret a et du LDDS et de la crise des dettes souveraines.
Avec les nouvelles mesures prises pour limiter la diffusion du virus (couvre-feu, fermeture des bars, restrictions sur les évènements sportifs, culturels, etc.), les dépenses de consommation devraient ressortir en baisse à compter du mois d’octobre. Cette situation associée à un haut niveau d’anxiété au sein de la population devrait se traduire par le maintien d’un fort volant d’épargne de précaution. La cassette covid-19 devrait donc continuer à se remplir.
Résultats du Livret A en septembre : retour presque à la normale
Au mois de septembre, pour la neuvième fois consécutive, le Livret A enregistre, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, une collecte positive de 1,26 milliard d’euros. Ce résultat est en retrait par rapport à celui du mois d’août, 2,25 milliards d’euros, mais proche de celui du mois de septembre 2019 (1,06 milliard d’euros). Progressivement, le Livret A retrouve ainsi son rythme normal de collecte. Ce recul intervient après un semestre de forte collecte générée par le confinement et la chute de la consommation qui en a résulté. Ce retour à la normale est encore plus marqué pour le LDDS dont la collecte n’est que de 200 millions d’euros en septembre contre 600 millions en août. L’année dernière, en septembre, ce produit avait connu une décollecte de 40 millions d’euros.
Le mois de septembre est traditionnellement un mauvais mois pour l’épargne réglementée. Le Livret A a enregistré cinq décollectes en dix ans. Septembre est synonyme de rentrée scolaire et s’accompagne de dépenses incontournables pour les ménages qui sont donc amenés à puiser dans leur épargne de court terme. Jusqu’en 2018, le versement du dernier tiers de l’impôt sur le revenu pesait également sur les résultats du mois de septembre. Le résultat de cette année souligne le souhait des ménages à disposer d’un montant important de liquidités afin de faire face à toute menace. Cette volonté était déjà l’œuvre en 2019, année post gilets jaunes et année de réforme des retraites. Ces deux évènements déstabilisants pour une partie de l’opinion avaient entraîné un rebond de l’épargne de court terme.
En septembre, le contexte sanitaire et économique continue de peser sur les résultats de l’épargne. Ces dernières semaines, les ménages n’ont pas puisé dans la cagnotte constituée depuis le mois de mars. Ils ont, au contraire, continué à mettre de l’argent de côté. L’arrivée de la deuxième vague de l’épidémie et la hausse probable du chômage expliquent ce comportement. Si la consommation de biens a retrouvé, en août, son niveau d’avant crise, celle de services est en retrait en raison des contraintes qui pèsent sur les activités de loisirs et de tourisme. Par ailleurs, le déficit de consommation entre mars et mai n’a pas été comblé dans les mois qui ont suivi. Les ménages ne sont pas en mode consommation mais en mode prudence. Ils veillent à ne pas s’engager dans des dépenses importantes en attendant l’évolution de la situation sanitaire et économique.
Sur les neufs premiers mois de l’année, la collecte du Livret A a atteint 25,76 milliards d’euros, ce qui constitue un record. Celle du LDDS s’est élevé à 6,98 milliards d’euros. Les encours de ces deux produits restent à des niveaux historiques à 324,3 milliards d’euros pour le Livret A et 119,3 milliards d’euros pour le LDDS. Pour retrouver un tel résultat, il faut remonter en 2012, année du relèvement des plafonds du Livret a et du LDDS et de la crise des dettes souveraines.
Avec les nouvelles mesures prises pour limiter la diffusion du virus (couvre-feu, fermeture des bars, restrictions sur les évènements sportifs, culturels, etc.), les dépenses de consommation devraient ressortir en baisse à compter du mois d’octobre. Cette situation associée à un haut niveau d’anxiété au sein de la population devrait se traduire par le maintien d’un fort volant d’épargne de précaution. La cassette covid-19 devrait donc continuer à se remplir.
Le Coin de l’Agenda
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre
Réunion du FMI
Lundi 19 octobre
Le produit intérieur brut chinois pour le troisième trimestre sera dévoilé par le bureau national des statistiques de Chine. La production industrielle chinoise pour le mois de septembre sera aussi connue.
Mardi 20 octobre
Le nombre de permis de construire pour de nouveaux projets de construction aux États-Unis en septembre sera dévoilé.
Annonce par la Banque populaire de Chine de sa décision PboC sur les taux d’intérêt.
Mercredi 21 octobre
Au Royaume-Uni, l’indice des prix à la consommation pour le mois d’octobre sera rendu public.
Publication du livre beige de la FED.
Jeudi 22 octobre
Pour la zone euro, l’indice de confiance des consommateurs pour le mois d’octobre sera publié.
En France, sera connu l’indice sur le climat des affaires du mois d’octobre.
En Allemagne, sera publié l’indice GfK sur la confiance des consommateurs pour le mois de novembre.
L’indice manufacturier de la FED du Kansas d’octobre sera dévoilé.
L’indice des prix à la consommation au Japon pour le mois d’octobre sera connu.
Vendredi 23 octobre
Les indices PMI manufacturiers et de services seront publiés pour le mois d’octobre pour la zone euro, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Le PMI manufacturier Nikkei pour le mois d’octobre sera aussi connu au Japon.
Lundi 26 octobre
La Commission européenne publiera pour l’Union européenne et la zone euro les indicateurs avancés qui mesurent la confiance des consommateurs et la confiance dans l’industrie pour le mois d’octobre.
Le PIB pour le troisième trimestre en France sera connu.
Les indices IFO d’octobre sur la situation économique en Allemagne seront communiqués.
Publication de l’enquête pour le chômage au troisième trimestre 2020 en Espagne.
Aux États-Unis, il faudra suivre l’indice sur l’activité économique de la FED de Chicago pour le mois de septembre.
Mardi 27 octobre
L’indicateur de la masse monétaire M3 de la zone euro pour le mois de septembre et le troisème trimestre sera connu.
Aux États-Unis, l’indice manufacturier de la FED de Richmond d’octobre sera dévoilé.
Mercredi 28 octobre
Publication du niveau des stocks de gros en septembre aux États-Unis.
Mercredi 29 octobre
Décision sur les taux de la Banque centrale européenne.
Le PIB pour le troisième trimestre dans la zone euro sera dévoilé par Eurostat.
Le taux de chômage pour le mois d’octobre en Allemagne sera connu tout comme le PIB allemand pour le troisième trimestre.
Publication en Italie de l’indice de confiance des consommateurs pour octobre.
Annonce par la Banque du Japon de sa décision sur les taux.
Le Ministère de l’économie, du Commerce et de l’industrie japonais dévoilera le niveau de la production industrielle en septembre.
Vendredi 30 octobre
Le PIB pour le troisième trimestre en Allemagne sera connu.
Le Coin des Epargnants : ne pas perdre le moral !
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 16 octobre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 935,86 | -0,22 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 606,31 | +0,07 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 11 671,56 | +0,79 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 12 908,99 | -1,09 % | 13 249,01 |
| Footsie | 5 919,58 | -1,61 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3,245.47 | -0,84 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 410,63 | -0,89 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 336,36 | +1,96 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,351 % | -0,082 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,626 % | -0,092 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,749 % | -0,025 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1716 | -0,95 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 898,790 | -1,59 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 42,780 | +0,05 % | 66,300 |
Des marchés à la recherche du Nord
Les marchés financiers ont cherché leur nord. Entre les mauvaises nouvelles sur le front de l’épidémie et les informations moins négatives que prévues concernant les résultats des entreprises, les investisseurs ne savent pas sur quel pied danser. En fin de semaine, des mauvaises nouvelles ont néanmoins jeté un froid. Les incertitudes entourant un nouvel accord sur des mesures de relance aux Etats-Unis, les craintes sur l’économie induites par les restrictions sanitaires en Europe, sans oublier les discussions commerciales enlisées entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sont autant de points négatifs. Dans ce contexte, les taux d’intérêt ont repris le chemin de la baisse. Le taux de l’emprunt à 10 ans allemand est ainsi passé en-dessous de -0,6 point quand son équivalent français tombait à -0,35 %.
Épargne, le retour de la lutte des classes ?
Depuis le mois de mars, la cassette de la covid-19 – une cinquantaine de milliards d’euros selon le Conseil d’analyse économique d’euros mis de côté – serait le produit des ménages les plus aisés. 70 % de l’épargne supplémentaire aurait été constitué par les 20 % des ménages les plus aisés. Les 10 % les plus riches en termes de revenus auraient été à l’origine de 54 % du supplément d’épargne. Ces résultats ne sont en rien surprenants car, covid ou pas, l’épargne est en France avant tout constituée par le quintile le plus aisé des ménages. Durant le confinement, les ménages ont réduit leurs dépenses, les achats se limitant à l’essentiel : nourriture, abonnements, loyer, etc. Parmi les seules postes de dépenses en augmentation figurait celui des achats de matériels informatiques. Les ménages les plus aisés consacrent, par nature, une part plus importante que les autres à des dépenses non obligatoires, loisirs, tourisme, etc. Ces activités étant rendues impossibles, leurs capacités d’épargne ont automatiquement progressé. Si depuis le déconfinement, la consommation de biens a retrouvé, voire dépassé, son niveau d’avant crise, celle de services demeure encore très en retrait du fait de la forte contraction des activités culturelles, de loisirs, de restauration et d’hébergement.
Pour les économistes du Conseil d’analyse économique, les 10 % les plus pauvres se seraient endettés ou du moins auraient désépargné pour faire face à une baisse de leurs revenus par ailleurs majoritairement constitués de revenus de transferts. Les ménages du premier décile ont été les plus affectés par la forte contraction de l’intérim, des contrats à durée déterminée et de la suppression des heures supplémentaires. En revanche, il convient de souligner que la collecte du Livret d’épargne populaire qui était en baisse depuis plus d’une décennie est de nouveau positive depuis le mois de mars. Ce produit qui ouvre droit à une rémunération de 1 point est réservé aux personnes globalement non imposables à l’impôt sur le revenu. De même, la collecte du Livret jeune est depuis six mois positive.
L’épargne subie qui s’est muée en épargne de précaution n’est pas exclusivement une épargne de riches.
Dans les propos de certains commentateurs et de certains économistes, cette épargne serait illégitime. A demi-mot, les pouvoirs publics devraient punir les épargnants d’avoir épargner, de ne pas consommer et de ne pas contribuer à la relance du pays. Si les Français mettent de l’argent de côté, c’est avant tout par peur des lendemains qui pourraient déchanter. L’absence de visibilité sur le cours de l’épidémie n’incite pas à se lancer dans des achats inconsidérés, la prudence est de mise. Ce phénomène est constaté à chaque crise, que ce soit en 1993, en 2009 ou en 2012. Le Conseil d’analyse économique estime qu’il conviendrait d’accorder des prestations supplémentaires aux plus modestes afin qu’ils puissent consommer davantage. Sans nier la faiblesse de leurs revenus et des difficultés que peuvent rencontrer au quotidien les 10 % des ménages les plus modestes, il convient de se remémorer qu’en 2018/2019, dans le cadre du règlement de la crise des Gilets Jaunes, le gouvernement avait alors prévu 17 milliards d’euros d’aides aux ménages à faibles revenus. Or, ces 17 milliards d’euros n’ont aucun effet sur la consommation ; en revanche, la collecte du Livret A a fortement augmenté. Les Français du premier quintile qui sont menacés de perdre leur emploi sont les premiers à tenter de mettre de l’argent de côté.
L’épargnant est de plus en plus mis au ban de l’empire ; autrefois loué, il est devenu un mauvais patriote. Mettre de l’argent de côté était un signe de bonne gestion, de prévoyance, de bonne santé morale. La fourmi l’emportait sur la cigale à tous les coups. Aujourd’hui, l’épargnant devrait cesser de l’être afin de défendre l’économie. Pour autant, il doit consommer responsable, faire attention à la planète, aux animaux, et ne pas émettre de gaz à effet de serre. Consommer sans le faire peut amener l’épargnant citoyen à l’inaction ou à la schizophrénie.
L’épargne a encore de nombreuses qualités. Elle permet de préparer l’avenir, de financer l’État, les entreprises, le logement social avec le Livret A et l’économie sociale et solidaire avec le livret de développement durable et solidaire (LDDS). Si les Français n’épargnaient en moyenne plus de 15 % de leur revenu disponible brut, la notation de la France et les capacités d’emprunt de l’État seraient tout autres.
Pour certains, le dégonflement de la cagnotte liée à l’épidémie passe par l’augmentation des prélèvements. Puiser dans l’épargne covid de manière fiscale aurait comme conséquence des retraits massifs avec une préférence absolue pour la liquidité immédiate, le compte courant ou la monnaie fiduciaire. Par ailleurs, l’augmentation des prélèvements sur l’épargne a, en règle générale, l’effet inverse, en conduisant les ménages à épargner davantage afin d’effacer la perte subie sur le patrimoine.
La question de la réorientation de l’épargne se pose évidemment. Aujourd’hui, essentiellement liquide, elle pourrait être réorientée vers des placements longs. Le Plan d’épargne retraite lancé le 1er octobre 2019 constitue un outil répondant tout à la fois à la crainte de baisse des revenus après la liquidation des droits à pension et à la nécessité de financer les entreprises en recourant moins aux crédits bancaires. L’assurance vie et le plan d’épargne en action sont les deux autres enveloppes permettant une réelle transformation de l’épargne liquide.
La diabolisation de l’épargne serait une erreur au moment où le rétablissement d’un minimum de confiance en ces temps troublés est une ardente obligation. Les pouvoirs publics doivent accompagner les épargnants afin de les inciter en douceur à surmonter la peur du lendemain. Les injonctions et les menaces ne sont pas de mises en la matière. L’épargne pourrait être mobilisée de manière positive pour contribuer au financement des recherches sur la santé, sur les nouvelles énergies, sur les nouveaux moyens de transports. Les sujets ne manquent pas sous réserve de ne pas rejeter le progrès.
Retraite entre rapport et la réforme, une voie étroite
Lors de la séance du 15 octobre 2020, le Conseil d’Orientation des Retraites présentera un rapport d’étape en vue du rapport annuel qui sera publié en novembre. Ce rapport est attendu car le Gouvernement entend ouvrir à nouveau le dossier de la réforme systémique. Le Président de la République comme le Premier Ministre souhaitent valider la réforme avant la fin du quinquennat. Le calendrier laisse peu de marges. Au printemps prochain sont programmées les élections départementales et régionales. La campagne présidentielle commencera certainement à l’automne prochain. Par ailleurs, le contexte sanitaire et économique a changé la donne. Les 7 milliards d’euros de déficits à combler en 2014 ont été multiplié certainement par deux ou trois. Les partenaires sociaux qui étaient déjà peu enclins à accepter la réforme avant la crise estiment qu’elle n’est plus depuis d’actualité. Ils considèrent que l’emploi est la seule vérité qui vaille.
La Bourse veut croire à un changement aux Etats-Unis
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 9 octobre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 4 946,81 | +2,53 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 28 586,90 | +3,27 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 11 579,94 | +4,56 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 051,23 | +2,85 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 016,65 | +1,94 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 271,50 | +2,52 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 23 619,69 | +2,56 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 272,08 | +1,68 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,269 % | -0,009 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,534 % | +0,002 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,774 % | +0,072 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1824 | +0,94 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 928,825 | +1,46 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 42,720 | +9,01 % | 66,300 |
Quand la promesse d’un accord efface la menace épidémiologique
Les investisseurs ont préféré ignorer les mauvais résultats sanitaires pour croire en un futur accord entre Républicains et Démocrates sur un plan de relance pour les Etats-Unis. Si, mardi 6 octobre, Donald Trump avait écarté l’option du plan global au profit de mesures centrées sur les compagnies aériennes (25 milliards de dollars), les petites entreprises (enveloppe de 135 milliards) et une aide directe aux foyers, via un chèque de 1 200 dollars. Le Congrès a néanmoins poursuivi son travail pour l’élaboration sur un paquet budgétaire. Les investisseurs estiment que l’élection présidentielle du 3 novembre prochain devrait se conclure par une large victoire de Joe Biden ce qui faciliterait l’adoption de ce plan au Congrès. Ce regain d’optimisme a contribué à la hausse du cours du pétrole qui est repassé au-dessus de 40 dollars le baril en hausse de 9 % en une semaine.
L’envolée de l’épargne de précaution
Au premier semestre 2020, le revenu disponible brut des ménages a atteint 734 milliards d’euros. Malgré la contraction de l’activité et grâce à l’appui de l’État, la baisse n’a été que de 7 milliards d’euros comparé à celui du second semestre 2019. Depuis le début du confinement, les ménages ont réduit leurs dépenses de consommation. Ils ont dépensé ainsi 562 milliards d’euros premier semestre 2020 contre 631 milliards d’euros au second semestre 2019, soit une baisse de 69 milliards d’euros. De ce fait, leur épargne a connu un bond sans précédent atteignant en montant brut 173 milliards d’euros. En outre, les ménages ont réduit leurs investissements depuis le mois de mars, de près de 13 milliards d’euros par rapport au second semestre 2019. L’épargne financière est donc en forte hausse passant de 33 milliards d’euros au second semestre 2019 à 110 milliards d’euros au premier semestre 2020, soit une augmentation de 77 milliards d’euros. De subie, l’épargne est devenue de précaution. Les ménages par peur du chômage et des faillites ont continué à épargner après le confinement. Le taux d’épargne est ainsi passé de 15 % du revenu disponible brut à la fin de l’année 2019 à 27 % à la fin du second trimestre. Il devrait diminuer entre 17 et 20 % au troisième trimestre.
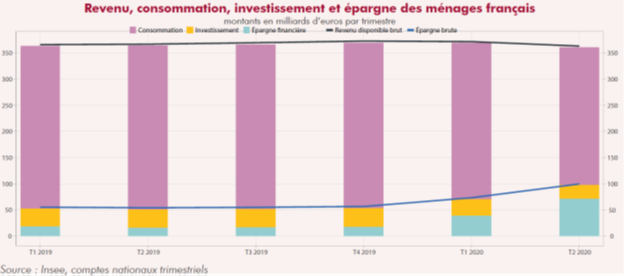
La dette des entreprises toujours en hausse
En août, selon la Banque de France, l’endettement des entreprises continue à augmenter rapidement. La hausse a atteint 13,1 % contre +12,8 % en juillet. L’endettement s’élevait à 1187 milliards d’euros en augmentation de 137 milliards d’euros en un mois. Le financement de marché a atteint 698 milliards d’euros en progrès de 83 milliards d’euros sur un mois.
Le coût moyen du financement des entreprises à 5 ans diminue de 22 points de base en août.
Le temps est toujours à l’épargne
Au premier semestre 2020, le revenu disponible brut des ménages a atteint, selon l’INSEE, 734 milliards d’euros. Malgré la contraction de l’activité et grâce à l’appui de l’Etat, la baisse n’a été que de 7 milliards d’euros comparé à celui du second semestre 2019. Depuis le début du confinement, les ménages ont réduit leurs dépenses de consommation. Ils ont dépensé ainsi 562 milliards d’euros premier semestre 2020 contre 631 milliards d’euros au second semestre 2019, soit une baisse de 69 milliards d’euros. De ce fait, leur épargne a connu un bond sans précédent atteignant en montant brut 173 milliards d’euros. En outre, les ménages ont réduit leurs investissements depuis le mois de mars, de près de 13 milliards d’euros par rapport au second semestre 2019. L’épargne financière est donc en forte hausse passant de 33 milliards d’euros au second semestre 2019 à 110 milliards d’euros au premier semestre 2020, soit une augmentation de 77 milliards d’euros. De subie, l’épargne est devenue de précaution. Les ménages par peur du chômage et des faillites ont continué à épargner après le confinement. Le taux d’épargne est ainsi passé de 15 % du revenu disponible brut à la fin de l’année 2019 à 27 % à la fin du second trimestre. Il devrait diminuer entre 17 et 20 % au troisième trimestre.
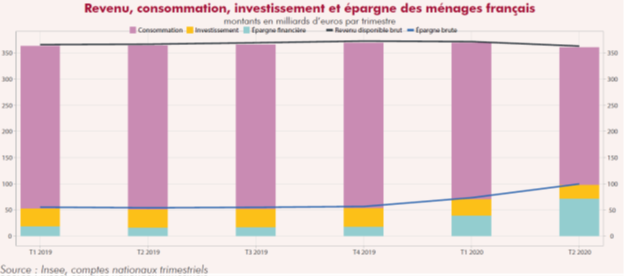
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


