Le Coin des Epargnants du 20 mars 2021
« Epidémieflation »
Dans les années 1970, nous avions connu une diminution de la croissance et l’inflation qui donna lieu au mot « stagflation ». Depuis quelques semaines, la crainte d’un retour de l’inflation, du fait de la multiplication des plans de relance, inquiète les investisseurs qui craignent également la poursuite de l’épidémie qui retarde d’autant le retour de la croissance, d’où une menace « d’épidémieflation »
Le CAC 40 est repassé au-dessous des 6000 points du fait des annonces de reconfinement de 16 départements sur fond de reprise de l’épidémie. La baisse du CAC 40 est également imputable aux nouvelles tensions observées sur le marché obligataire. La Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle ne prolongera pas les mesures d’assouplissement accordées aux banques en termes d’exigences de réserves obligatoires. Le taux d’intérêt de l’emprunt américain à 10 ans est repassé, par voie de conséquence, au-dessus de 1,7 %. La baisse des indices « actions » demeure néanmoins modeste tant en France qu’aux Etats-Unis. En Allemagne, l’indice Daxx est, de son côté, en très légère hausse.
La FED anticipe que le plan de relance de Joe Biden devrait accroître rapidement et fortement l’activité, rendant non nécessaire le maintien de soutien monétaire dans un contexte qui serait plus inflationniste. La FED a, en effet, relevé sa prévision de croissance du PIB américain à 6,5 % pour 2021 avec une inflation qui pointera temporairement, selon elle, à 2,4 %. Avec un taux d’intérêt supérieur à 1,7 %, les investisseurs sont enclins à privilégier les obligations.
Le pétrole a connu sa plus forte baisse cette semaine depuis le mois de novembre. Le baril de Brent a perdu 7 % et est repassé en-dessous de 65 dollars. Le cours du pétrole a été pénalisé par la reprise de l’épidémie en Europe. Les experts du marché pétrolier estiment néanmoins que l’or noir pourrait connaître une forte hausse de son prix dans le courant de l’été.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 19 mars 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 997,96 | -0,80 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 32 627,97 | -0,46 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 215,24 | -0,79 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 14 621,00 | +0,82 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 708,71 | -0,78 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 837,02 | +0,10 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 29 717,83 | +2,96 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 453,08 | -3,46 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,045 % | +0,022 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,292 % | +0,011 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,721 % | +0,102 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1906 | -0,38 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 743,170 | +0,92 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 64,270 | -7,00 % | 51,290 |
Simplification et contrôle de l’épargne réglementée
Le décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d’épargne réglementée publié au Journal officiel du samedi 13 mars simplifie grandement la souscription et la conservation d’un Livret d’épargne populaire (LEP). Ce décret comprend deux parties : la première concerne le Livret d’Épargne Populaire et traduit réglementairement un engagement pris par le ministre de l’Économie en 2019 ; la seconde vise à lutter contre la possession de plusieurs livrets d’épargne réglementée du même type.
Pour le LEP, l’épargnant n’a plus besoin chaque année de présenter à la banque son avis d’imposition. L’établissement gestionnaire du compte sur livret d’épargne populaire, ou auprès duquel une demande d’ouverture d’un tel compte a été formulée, peut interroger l’administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions pour son ouverture sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l’ouverture.
Pour rappel, pour pouvoir détenir un LEP, un contribuable doit justifier, lors de la demande d’ouverture puis, chaque année, que ses revenus de la dernière ou avant-dernière année ne dépassent pas certains montants. Ces derniers atteignent, en 2021, 20 017 euros pour un célibataire (plus 5 344 euros par demi-part fiscale supplémentaire). En cas de non-respect du seuil pendant deux années consécutives, le livret doit être clôturé.
Cette simplification vise à inciter les ayants-droits à ouvrir un LEP. Selon la Banque de France, au 31 décembre 2019, seuls 7,3 millions de LEP étaient ouverts. Seuls 14,3 % des Français ont un LEP quand près d’un sur deux y a potentiellement droit. Le LEP est actuellement rémunéré à 1 % net, soit deux fois plus que le Livret A qui compte 55 millions de souscripteurs.
Le décret précise « quand l’administration fiscale n’est pas en mesure d’indiquer si ce titulaire ou cette personne remplit les conditions (…), ou quand l’établissement de crédit ne sollicite pas l’administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d’épargne populaire ou par le contribuable demandant l’ouverture d’un tel compte, de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l’établissement de s’assurer ». La banque pourra ainsi continuer à demander l’avis d’impôt chaque année.
Comme en 2020, la date à laquelle les banques sont tenues de clôturer les comptes dont les titulaires ne respectent plus les plafonds de revenus est reportée du 31 mars au 30 novembre 2021. Le décret modifie également la date limite pour procéder à cette clôture pour les années à venir, celle-ci interviendra alors au 30 avril.
Interdiction de la multi-détention des livrets d’épargne réglementée
Les pouvoirs publics renforcent les dispositifs de contrôle pour éviter la multi-détention de livrets d’épargne réglementée. Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif en vigueur pour le Livet A. Pour chaque catégorie (Livret A, LDDS, Compte Épargne Logement, Plan d’Épargne Logement, Livret d’Épargne Populaire et Livret Jeune), il n’est possible que d’en posséder qu’un par personne. Lors d’une demande d’ouverture d’un tel livret, l’établissement bancaire doit rappeler au déposant à l’origine de la demande qu’il ne peut détenir qu’un seul produit de la même catégorie. L’établissement doit également interroger l’administration fiscale afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d’épargne réglementée de la même catégorie.
Si le client a refusé que les informations relatives à d’autres produits d’épargne réglementée de la même catégorie qu’il détiendrait déjà soient communiquées à l’établissement de crédit par l’administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d’un ou plusieurs produits d’épargne réglementée de la même catégorie, l’établissement de crédit ne procède pas à l’ouverture demandée et informe le client des motifs du refus. Les personnes ayant plusieurs livrets d’épargne réglementée d’une même catégorie a deux mois pour régulariser sa situation. En l’absence d’une telle régularisation, les produits d’épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d’office par l’établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d’attente.
Epargne réglementée, le gouvernement simplifie et améliore le dispositif de contrôle
Epargne réglementée, des mesures en faveur du Livret d’Epargne Populaire et contre la multi-détention
Le décret publié n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d’épargne réglementée a été publié au Journal officiel du samedi 13 mars simplifie grandement la souscription et la conservation d’un Livret d’épargne populaire (LEP). Ce décret comprend deux parties. La première concerne le Livret d’Epargne Populaire et traduit législativement un engagement pris par le Ministre de l’Economie en 2019. La seconde vise à lutter contre la possession de plusieurs livrets d’épargne réglementée du même type.
Pour le LEP, l’épargnant n’a plus besoin chaque année de présenter à la banque son avis d’imposition. L’établissement gestionnaire du compte sur livret d’épargne populaire, ou auprès duquel une demande d’ouverture d’un tel compte a été formulée, peut interroger l’administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions pour son ouverture sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l’ouverture »,
Pour rappel, pour pouvoir détenir un LEP, un contribuable doit justifier, lors de la demande d’ouverture puis chaque année, que ses revenus de la dernière ou avant-dernière année ne dépassent pas certains montants. Ces derniers atteignent, en 2021, 20 017 euros pour un célibataire (plus 5 344 euros par demi-part fiscale supplémentaire). En cas de non-respect du seuil pendant deux années consécutives, le livret doit être clôturé.
Cette simplification vise à inciter les ayants-droits à ouvrir un LEP. Selon la Banque de France, au 31 décembre 2019, seuls 7,3 millions de LEP étaient ouverts. Seuls 14,3 % des Français ont un LEP quand la moitié y a potentiellement droit. Le LEP est actuellement rémunéré à 1 % net, soit deux fois plus que le Livret A qui compte 55 millions de souscripteurs.
Le décret précise quand l’administration fiscale n’est pas en mesure d’indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions (…), ou quand l’établissement de crédit ne sollicite pas l’administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d’épargne populaire ou par le contribuable demandant l’ouverture d’un tel compte, de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l’établissement de s’assurer. La banque pourra ainsi continuer à demander l’avis d’impôt chaque année.
Comme en 2020, la date à laquelle les banques sont tenues de clôturer les comptes dont les titulaires ne respectent plus les plafonds de revenus est reportée du 31 mars au 30 novembre 2021. Le décret modifie également la date limite pour procéder à cette clôture pour les années à venir, celle-ci interviendra alors au 30 avril.
Interdiction de la multi-détention des livrets d’épargne réglementée
.Les pouvoirs publics renforcent les dispositifs de contrôle pour éviter la multi-détention de livrets d’épargne réglementée. Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif en vigueur pour le Livet A. Pour chaque catégorie de livrets, Livret A, LDDS, Compte Epargne Logement, Plan d’Epargne Logement, Livret d’Epargne Populaire et Livret Jeune, il n’est possible que d’en posséder un par personne. Lors d’une demande d’ouverture d’un tel livret, l’établissement bancaire doit rappeler au déposant à l’origine de la demande qu’il ne peut détenir qu’un seul produit de la même catégorie. L’établissement doit également interroger l’administration fiscale afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d’épargne réglementée de la même catégorie.
Si le client a refusé que les informations relatives à d’autres produits d’épargne réglementée de la même catégorie qu’il détiendrait déjà soient communiquées à l’établissement de crédit par l’administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d’un ou plusieurs produits d’épargne réglementée de la même catégorie, l’établissement de crédit ne procède pas à l’ouverture demandée et informe le client des motifs du refus. Les personnes ayant plusieurs livrets d’épargne réglementée d’une même catégorie a deux mois pour régulariser sa situation. En l’absence d’une telle régularisation, les produits d’épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d’office par l’établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d’attente.
Le Coin de l’Epargne du 13 mars 2021 : les taux d’intérêt au coeur de l’actualité
La semaine aura été marquée par l’évolution des taux et par l’adoption du plan de Joe Biden. Tous les grands indices « actions » ont gagné du terrain avec des gains importants. L’indice des valeurs technologiques américain, le Nasdaq, qui avait pâti, au début du mois de mars, de la hausse des taux d’intérêt et de sa forte progression des mois passés, a augmenté de plus de 3 %. Le pétrole après avoir atteint 71 dollars le 8 mars s’est stabilisé autour de 69 dollars le baril.
Le BCE joue les taux à la baisse
Face à la légère augmentation des taux d’intérêt provoquée, en grande partie, par le plan de relance de Joe Biden qui génère des anticipations inflationnistes, la Banque Centrale Européenne n’a pas modifié, lors de sa réunion du 11 mars dernier, ses taux et le montant des programmes d’achat d’obligations. Néanmoins, le Conseil des Gouverneurs a annoncé que la réalisation de ce programme serait accélérée.au cours du trimestre à venir par rapport aux premiers mois de l’année. Le programme, PEPP, de 1 850 milliards d’euros, n’a été utilisé jusqu’ici que pour la moitié de son montant. L’augmentation des rachats est censée faire baisser la pression sur les taux longs. Christine Lagarde a, écarté la perspective d’un retour en force de l’inflation. Cette annonce a suffi pour provoquer un léger fléchissement des taux européens et une hausse du cours des actions. Le CAC 40 a ainsi dépassé les 6 000 points, jeudi 11 mars, pour la première fois depuis le 21 février 2020. A 6 033,76 points en clôture, il n’est plus qu’à 1,3 % de son pic de 6 111 points du mois de février 2020. Depuis le 1er janvier 2021, il a gagné près de 9 % rattrapant légèrement son retard sur les autres places qui ont compensé bien plus rapidement les pertes enregistrées en mars et avril de l’année dernière. La bourse de Paris a longtemps été pénalisée par le poids des valeurs du secteur du tourisme et de celui de la finance. Ces dernières se sont appréciées ces derniers jours avec la hausse des taux. La bourse de Paris aura été également agitée par le devenir du groupe RTL/M6 qui est tout à la fois un enjeu économique et politique.
L’adoption du plan de relance de Joe Biden, portant sur 1900 milliards de dollars a eu l’effet inverse des annonces de Christine Lagarde et a amené les taux américains au-dessus de 1,6 %. A partir de ce week-end, les ménages américains commenceront à toucher les 400 milliards de dollars qui leurs sont destinés. Le plan prolonge, par ailleurs, jusqu’en septembre les allocations au chômage exceptionnelles. Le seuil de 1,6 % est considéré par de nombreux investisseurs comme une ligne de partage, les actions devenant moins attractives par rapport aux obligations. Les derniers indicateurs américains confirment la petite tendance à la hausse des prix. Ceux de la production aux Etats-Unis ont ainsi augmenté de +0,5 % le mois dernier et de +2,8 % sur un an, ce qui n’était plus arrivé depuis octobre 2018. La hausse des prix de l’énergie, notamment du gaz, explique cette accélération.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 12 mars 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 046,55 | 4,56 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 32 778,64 | +4,07 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 316,63 ( | +3,07 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 14 502,39 | +4,18 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 761,47 | +1,97 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 833,36 | +4,46 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 29 717,83 | +2,96 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 453,08 | -3,46 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,067 % | -0,012 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,303 % | +0,007 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,619 % | +0,060 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1951 | +0,35 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 717,800 | +1,11 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 69,640 | +0,09 % | 51,290 |
La dette des entreprises françaises toujours en forte hausse
En janvier, le taux de croissance annuel de l’endettement des sociétés non financières atteint 12,8 % après 13,0 % le mois précédent. La croissance de l’encours des crédits bancaires est de 13,2 % et celle des titres de marchés de 12,0 %. L’encours total atteint 1900 milliards d’euros au mois de janvier 2021, contre 1695 milliards d’euros au mois de janvier 2020. En un an, la hausse s’élève à 12 %. Le financement par crédits bancaires est en hausse de 13 % et celui par le marché de 11 %.. La hausse de l’endettement des sociétés non financières depuis mars 2020 s’est accompagnée d’une progression de leur trésorerie. La progression de la dette des entreprises est toujours soutenue par les prêts garantis par l’Etat.
Le coût moyen du financement des entreprises est stable à 1,0 %. Le repli du taux actuariel des financements de marché est compensé par le léger renchérissement des crédits bancaires.
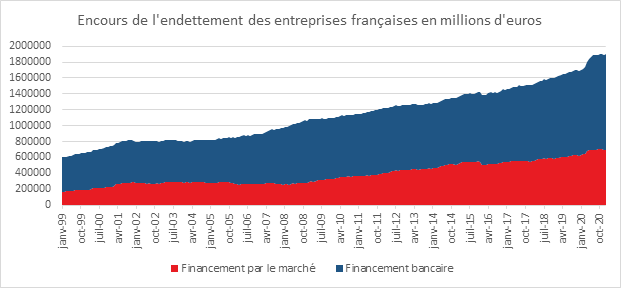
Le Coin de l’Epargne du 6 mars 2021 : amélioration de l’emploi et de la situation sanitaire aux Etats-Unis
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 5 mars 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 782,65 | +1,39 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 31 496,30 | +1,82 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 12 922,49 | -2,05 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 13 920,69 | +0,97 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 630,52 | +2,27 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 669,54 | +0,91 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 864,32 | -0,35 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 501,99 | -0,20 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,055 % | -0,030 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,310 % | -0,049 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,549 % | +0,049 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1916 | -1,28 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 698,870 | -2,01 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 69,340 | +7,64 % | 51,290 |
Les marchés « actions » à la recherche d’une ligne
Si le Nasdaq poursuit son mouvement de correction, cette semaine, les grands indices « actions » ont regagné du terrain. Le regain de forme s’explique par les bons résultats économiques et sanitaires, en particulier aux Etats-Unis. L’augmentation des taux d’intérêt semble faire une pause en attendant des données plus précises sur l’inflation et la reprise de l’activité. La hausse des matières premières et de l’énergie pourrait conduire à une reprise du processus dans les prochains jours.
Aux Etats-Unis, le Bureau of Labour Statistics a annoncé, vendredi 6 mars, la création de 379 000 postes dans le secteur non agricole, contre 200 000 anticipées par le consensus établi par Bloomberg. L’amélioration sensible sur le front sanitaire conduisant à la levée progressive des contraintes a conduit à des créations d’emplois dans les secteurs des loisirs et de l’accueil. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 6,2 %.
Les investisseurs sont dubitatifs face aux résultats de l’emploi américain qui tout en soulignant la résilience de l’économie accroissent le risque inflationniste. L’amélioration sur le marché peut inciter la Réserve fédérale à réduire son soutien à l’économie et accentuer les tensions sur les taux longs américains. Le rendement des Treasuries a dépassé brièvement 1,6 % vendredi 5 mars dans l’après-midi. Le parti pris en faveur du statu quo par Jerome Powell, ne les a pas rassurés. Le Président de la Réserve fédérale (Fed) a, en effet confirmé le maintien d’une politique monétaire accommodante tant que l’économie et le marché de l’emploi aux Etats-Unis ne se seraient pas remis des répercussions de la pandémie de coronavirus. Il estime qu’avec les moyens déployés, les objectifs de plein emploi et d’inflation à 2 % seront atteints mais que cela prendra du temps. Il a souligné que la hausse récente des rendements obligataires américains était « notable » et qu’elle « a attiré attention ». Il ne considère pas néanmoins que ces taux aient atteint un niveau tel que la Fed se doive d’intervenir sur les marchés pour les faire baisser, en augmentant par exemple les achats d’obligations.
Si elle inquiète certains, la repentification de la courbe des taux profite à d’autres dont les banques et les assureurs. La hausse du pétrole a de son côté contribué à l’appréciation des cours des actions des compagnies pétrolières.
Le baril de pétrole, un retour de flamme
Jeudi 4 mars, les vingt-trois États de l’OPEP+ (dont la Russie) qui représentent plus de la moitié de la production mondiale de pétrole, ont décidé, de maintenir leurs volumes de production inchangés pour le mois prochain. Cette décision initiée par l’Arabie Saoudite a provoqué une hausse du cours du baril de pétrole qui est passé pour le Brent au-dessus de 69 dollars pour la première fois depuis janvier 2020. Le prix du pétrole a ainsi retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire.
Riyad continuera également de s’imposer la réduction supplémentaire d’un million de barils par jour, qui représente à elle seule une restriction de 1 % de la production mondiale. Ces décisions sont valables au moins jusqu’au 7 avril, date de la prochaine réunion du cartel et de ses alliés. L’Arabie saoudite estime que le redressement du marché est encore fragile. « L’incertitude qui entoure le rythme de la reprise n’a pas diminué », a déclaré le prince Abdelaziz ben Salmane, ministre de l’Énergie saoudien, à l’ouverture de la réunion jeudi. Il a ajouté qu’il est « difficile de faire des prévisions dans un environnement aussi imprévisible » et « en appelle donc une fois de plus à la prudence et à la vigilance ».
Le maintien des dispositifs de régulation de la production est justifié par l’importance des stocks accumulés l’an dernier qui restent nettement supérieurs à la normale. Ils s’élèveraient à plus de 3,6 milliards de barils, soit 200 millions au-dessus de la moyenne historique.
La position de Ryad qui a prévalu n’était pas partagée par la Russie qui est le deuxième producteur mondial. Ce pays souhaitait un assouplissement des quotas afin de pouvoir augmenter ses ventes, les cours actuels étant suffisamment élevés au regard du Kremlin. À défaut d’avoir obtenu une augmentation des quotas de production, Moscou a obtenu une dérogation. La Russie pourra relever sa production à hauteur de 130 000 barils par jour au mois de mars. Dans les prochaines semaines, le prix du baril pourrait dépasser 70 dollars compte tenu de la progression plus rapide de la demande par rapport à l’offre. Cette augmentation des cours du baril est une bonne nouvelle pour les producteurs américains dont les coûts sont élevés. Comme la production américaine n’est pas concernée par les quotas, une reprise des forages est attendue dans les prochaines semaines.
L’assurance vie sur la voie de la normalisation
Au mois de janvier, l’assurance vie signe une deuxième collecte nette mensuelle positive faisant suite à neuf mois consécutifs de décollecte. En janvier, selon la Fédération Française de l’Assurance, la collecte nette s’est élevée à 2 milliards d’euros, supérieure à celle du même mois de 2020 (600 millions d’euros). Le mois de janvier est traditionnellement porteur pour l’assurance vie. Une seule décollecte a été enregistrée ces dix dernières années, en 2012 avec -1,3 milliard d’euros. En moyenne, la collecte nette sur cette période a été de 1,8 milliard d’euros.
En début d’année, les ménages effectuent des arbitrages sur leur épargne. Ils y sont notamment incités par le versement, en décembre, des 13èmes mois et des primes de fin d’année. En 2021, ils ont pu puiser dans leur cagnotte « Covid » plus de 80 milliards d’euros essentiellement placés en produits liquides et sûrs. L’amélioration des résultats d’assurance vie depuis la fin du premier confinement s’explique également par l’adaptation à la crise des professionnels de l’épargne qui ont développé les rendez-vous téléphoniques ou les réunions en visioconférence. Les épargnants recourent également de plus en plus à Internet pour réaliser leurs arbitrages.
Malgré la persistance de l’épidémie et le niveau élevé des incertitudes économiques, les ménages semblent disposés à réorienter en partie leur épargne liquide. L’assurance vie demeure le placement de long terme de référence qui permet de mixer sécurité (avec les fonds euros) et prise de risques (avec les unités de compte). Les faibles rendements des produits de taux, en particulier pour l’épargne réglementée, conduisent les épargnants à se repositionner sur l’épargne de long terme. Cette réorientation est encouragée par les pouvoirs publics.
Le montant des cotisations en janvier a été particulièrement élevé, soit 13,6 milliards d’euros contre 12,1 milliards d’euros en 2020 et 12,7 milliards d’euros en 2019. Il faut remonter au mois de décembre 2015 pour relever un montant de cotisations supérieur (13,7 milliards d’euros). La souscription d’unités de compte reste stable à 34 % et conforme à la moyenne de l’année dernière. Les consignes des assureurs, au minimum 33 % d’unités de compte, sont appliquées et en grande partie acceptées par les assurés, aidées en cela par la bonne tenue des marchés « actions ».
Les prestations se sont élevées, au mois de janvier à 11,6 milliards d’euros, contre 12,3 en décembre et 11,5 en janvier 2020. Sur un an, elles sont stables, la crise sanitaire n’a pas réellement modifié le comportement des assurés en la matière. L’encours de l’assurance vie a atteint, à la fin du mois de janvier 2021, 1 786 milliards d’euros.
Le Plan d’Epargne Retraite trace sa route
Entre le mois octobre 2019 et la fin janvier 2021, selon les statistique de la Fédération Française de l’Assurance, 1,24 million de Plans d’Épargne Retraite (PER) ont été souscrits soit à titre individuel, soit par l’intermédiaire d’un employeur. Fin janvier, l’encours du PER a atteint 13,4 milliards d’euros dont la moitié en unités de compte. En janvier, 88 400 nouveaux assurés ont ouvert un PER, soit une hausse de 185 % par rapport à la même période l’année dernière. 147 220 personnes ont, par ailleurs, transféré leurs anciens contrats vers des nouveaux PER.
Le taux de rémunération des livrets ordinaires toujours au point mort
Selon la Banque de France, au mois de janvier, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires s’établit à 0,45 %, comme en décembre. Pour les livrets bancaires fiscalisés, le taux de rémunération est passé de 0,12 à 0,11 % de décembre à janvier. Il y a un il s’élevait à 0,16 %.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| janv-20 | nov-20 | déc-20 (e) | janv-21 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,58 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| Ménages | 0,83 | 0,68 | 0,67 | 0,68 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,68 | 0,53 | 0,51 | 0,47 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,21 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,62 | 2,61 | 2,61 |
| SNF | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,08 | 0,93 | 0,92 | 0,88 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,39 | -0,52 | -0,54 | -0,55 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,41 | -0,65 | -0,66 | -0,63 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
L’assurance vie démarre l’année 2021 du bon pied
Au mois de janvier, l’assurance vie signe une deuxième collecte nette mensuelle positive faisant suite à neuf mois consécutifs de décollecte. En janvier, la collecte nette s’est, en effet, élevée, selon la Fédération Française de l’Assurance, à 2 milliards d’euros, supérieure à celle du même mois de 2020 (600 millions d’euros). Le mois de janvier est traditionnellement porteur pour l’assurance vie. Une seule décollecte a été enregistrée ces dix dernières années, en 2012 avec -1,3 milliard d’euros. En moyenne, la collecte nette a été, sur cette période, de 1,8 milliard d’euros.
Les ménages effectuent, en début d’année, des arbitrages sur leur épargne. Ils y sont notamment incités par le versement, en décembre, des 13e mois et des primes de fin d’année. En 2021, ils ont pu puiser dans leur cagnotte « covid », plus de 80 milliards d’euros essentiellement placés en produits liquides et sûrs. L’amélioration depuis la fin du premier confinement des résultats d’assurance vie s’explique également par l’adaptation à la crise des professionnels de l’épargne qui ont développé les rendez-vous téléphoniques ou les réunions en visioconférence. Les épargnants recourent également de plus en plus à Internet pour réaliser leurs arbitrages.
Malgré la persistance de l’épidémie et le niveau élevé des incertitudes économiques, les ménages semblent disposés à réorienter en partie leur épargne liquide. L’assurance vie demeure le placement de long terme de référence qui permet de mixer sécurité avec les fonds euros et la prise de risque avec les unités de compte. Les faibles rendements des produits de taux, en particulier pour l’épargne réglementée, conduisent les épargnants à se repositionner sur l’épargne de long terme. Cette réorientation est encouragée par les pouvoirs publics.
Le montant des cotisations a été, en janvier, particulièrement élevé, 13,6 milliards d’euros, contre 12,1 milliards d’euros en 2020 et 12,7 milliards d’euros en 2019. Il faut remonter au mois de décembre 2015 pour relever un montant de cotisations supérieur (13,7 milliards d’euros). La souscription d’unités de compte reste stable à 34 % conforme à la moyenne de l’année dernière. Les consignes des assureurs, au minimum 33 % d’unités de compte, sont appliquées et en grande partie acceptées par les assurés aidés en cela par la bonne tenue des marchés « actions ».
Les prestations se sont élevées, au mois de janvier à 11,6 milliards d’euros, contre 12,3 en décembre et 11,5 en janvier 2020. Sur un an, elles sont stables, la crise sanitaire n’a pas réellement modifié le comportement des assurés en la matière.
L’encours de l’assurance vie a atteint, à la fin du mois de janvier 2021, 1 786 milliards d’euros.
Le Coin des Epargnants du 27 février 2021 : changement de cycle ?
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 26 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 703,22 | -1,22 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 30 932,37 | -1,78 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 192.34 | -4,92 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 13 786,29 | -1,48 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 483,43 | -2,12 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 636,44 | -2,07 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 966,01 | -3,50 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 509.08 | -5,06 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,025 % | +0,044 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,261 % | +0,046 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,500 % | +0,162 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2089 | -0,22 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 718,584 | -3,60 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 65,040 | +3,86 % | 51,290 |
Les marchés face à la remontée des taux
Le mois de février avait commencé sur les chapeaux de roues avec un CAC 40 qui avait progressé de 4,82 % lors de la première semaine. Sur l’ensemble du mois, la progression dépasse 4 % mais depuis quinze jours, la tendance s’est inversée avec la remontée des taux longs. Si les investisseurs anticipent une reprise de l’économie à la faveur de la campagne de vaccination, certains craignent une remontée de l’inflation qui inciterait les banques centrales a durcir leur politique monétaire. L’accumulation des plans de relance dont celui de Joe Biden portant sur 1900 milliards de dollars pourrait, en effet, provoquer une surchauffe générale de l’économie où des goulets d’étranglement se font jour. Face à ces menaces, des dégagements ont été observés sur les marchés en fin de semaine avec une augmentation sensible des volumes d’échanges de titres. L’indice du CAC 40 a ainsi abandonné 1,22% sur la semaine. Tous les grands indices ont enregistré une baisse cette semaine laissant présager un mois de mars compliqué. Un an après le début de la crise sanitaire, un nouveau cycle s’amorcerait-il ? A New York, les valeurs technologiques après de nombreux mois de hausse connaissent une correction accentuée par la hausse des taux. Le Nasdaq a abandonné cette semaine près de 5 % entrainant une baisse de plus de 3 % pour le mois de février. Le taux de l’obligation de l’Etat américain à 10 ans a atteint 1,5 %. Il a même franchi brièvement la barre de 1,60% jeudi 25 février. Le rendement à 10 ans avait atteint un plus bas pour l’année 2020, en août, à 0,52 %.
Le marché obligataire est redevenu plus attractif que le marché actions, considéré plus risqué en raison du niveau atteint par les cours. Le rendement des actions du S&P 500 s’établit à 1,47%. Pour le moment, aucun décrochage en Bourse n’est attendu dans les prochaines semaines sauf si un emballement sur les taux se produisait. Si le taux américain était amené à dépasser 2 %, une action concertée des banques centrales pourrait se produire.
Marché immobilier, quelques fissures se font jour
Dans les grandes villes et en particulier à Paris, des panneaux d’appartements à louer ou à vendre sont de retour aux fenêtres des immeubles. Ces panneaux avaient presque totalement disparu en raison d’un marché très tendu, les biens proposés disparaissant en quelques jours. Que ce soit pour les ventes ou les locations, les délais s’allongent. Avec la disparition des touristes, les locations saisonnières restent vides incitant leur propriétaire à les mettre en location classique ou à les vendre. Or la demande est plus faible, les ménages ne souhaitant pas engager des dépenses importantes dans une période de fortes incertitudes. Par ailleurs, des résidents du cœur des grandes agglomérations souhaitent déménager pour des villes de taille moyenne ou trouver des maisons en périphérie. Les prix de l’immobilier augmentent désormais plus rapidement en première et deuxième couronnes qu’au cœur des grandes agglomérations.
À Paris, selon le Groupe « SeLoger », les montants des loyers sont orientés à la baisse et les délais de location s’allongent. Sur l’ensemble de la France, la situation est plus contrastée. Ainsi, sur un an, les délais de location se seraient contractés de 37 % et est désormais de 30 jours. L’écart avec Paris tend ainsi à se réduire Dans cette ville le délai est de 19 jours en hausse d’un jour sur un an. Les loyers ont baissé de 1,5 % de 2019 à 2020. Les arrondissements les plus huppés connaissent des allongements des délais de location et les baisses de loyers les plus importants. Ainsi, les délais atteignent 33 jours dans le 1er arrondissement (+67 % en un an) et 24 jours dans le 7e (+23 % en un an). Les arrondissements plus populaires connaissent toujours une forte demande avec à la clef une réduction des délais de location.
Le marché des locations est déstabilisé dans certaines villes par l’arrêt des locations saisonnières. Paris et Bordeaux sont les plus exposées à ce problème. De nombreux propriétaires de ces deux villes ont décidé de reporter leurs offres de locations saisonnières sur le marché des locations meublées. Ainsi, à Bordeaux, le taux de meublés est passé en un an de 37,6 à 63,8 % pour l’ensemble des biens loués, ce qui est le taux le plus élevé de France. À Paris, selon le « Baromètre des Loyers – SeLoger », le taux de meublés atteint 52,5 %.
Le nombre de meublés proposés à la location aurait augmenté en douze mois de 90 %. La hausse est de 350 % à Bordeaux, de 185 % à Paris et de 176 % à Boulogne-Billancourt. Dans plusieurs villes, les loyers demandés pour des locations meublées peuvent être désormais plus faibles que ceux des locations vides.
Les Français préservés de la crise épargnent
Sur l’ensemble de l’année 2020, le revenu disponible brut (RDB) des ménages a été en hausse de +1,1 %, après +3,1 % en 2019. Le RDB a continué de progresser au quatrième trimestre malgré la baisse de la masse salariale brute (−0,5 % après +12,2 %) en lien avec la contraction de l’activité et la baisse des heures travaillées.
Les ménages ont bénéficié en fin d’année de l’allègement de la taxe d’habitation et du maintien à un niveau élevé des prestations sociales en espèces. Ces dernières ont progressé de +2,3 % après −7,1 % (chômage partiel, aides exceptionnelles de solidarité liées à l’urgence sanitaire). Les entrepreneurs individuels ont également pu stabiliser leur excédent brut d’exploitation grâce au aidées allouées par le Fonds de solidarité.
Le pouvoir d’achat des ménages a progressé de +0,6 % en 2020 après +2,1 % en 2019, malgré la baisse historique du PIB (−8,2 %). Pour le quatrième trimestre, la hausse a été de +1,5 % après +2,7 %). Mesuré par unité de consommation pour être ramené à un niveau individuel, le pouvoir d’achat est stable en 2020, après +1,5 % en 2019. Pour le quatrième trimestre, il a augmenté de +1,3 % après +2,5 %.
Avec le deuxième confinement qui s’est traduit par une baisse de dépenses de consommation de 5,4 % au quatrième trimestre et le maintien du pouvoir d’achat, le taux d’épargne a augmenté. Il s’est élevé à 22,2 % après 16,5 % au troisième trimestre. En moyenne sur l’année, le taux d’épargne des ménages augmente de 6,4 points (21,3 % en 2020 après 14,9 % en 2019). Le taux d’épargne financière est passé de 4,6 à 12,1 % du revenu disponible brut. Les Français ont consacré 111 milliards d’euros de plus à leur épargne financière en 2002.
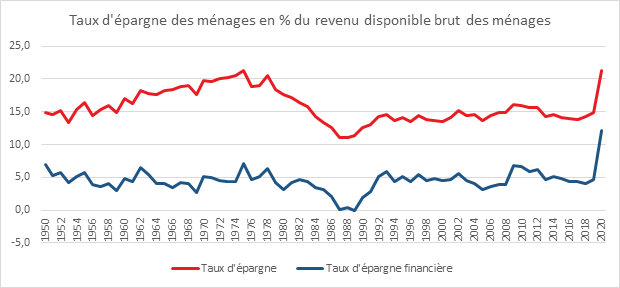
Français, « épargne toute » en février
Au mois de février, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique est quasi stable. À 91, l’indice calculé par l’institut statistique perd un point et demeure sous sa moyenne de longue période.
En février, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants reste stable. Le solde correspondant demeure sous sa moyenne de longue période.
Les ménages estiment que leur situation financière ne s’est pas dégradé. Ainsi, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée augmente légèrement. Il gagne un point et demeure supérieur à sa moyenne de longue période. En revanche, ils restent inquiets en ce qui concerne leur situation financière future. L’indice qui le mesure demeure en dessous de sa moyenne de longue période mais est stable en février.
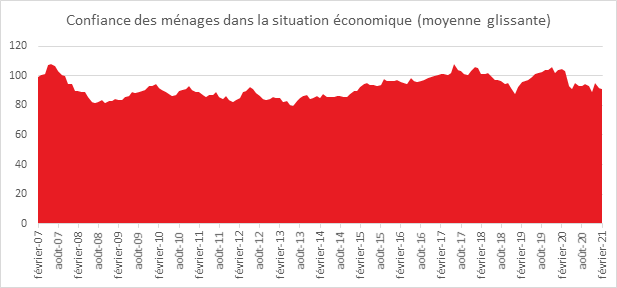
Cercle de l’Epargne – données INSEE
Les ménages pensent que leur capacité d’épargne sera en hausse dans les prochaines semaines. Le couvre-feu voire le confinement réduit le volume des dépenses et accroit par ricoche leurs marges pour épargner. L’indice sur le sujet gagne trois points. Le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle est quant à lui stable. Ces deux soldes s’établissent à leur plus haut niveau historique. La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est stable. Le solde correspondant reste à son plus haut niveau historique.
Cette volonté d’épargner à tout prix n’est pas sans lien avec la crainte des Français sur l’évolution de leurs revenus. En février, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois baisse de nouveau. Le solde correspondant perd trois points et s’éloigne encore de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois perd également trois points. Le solde correspondant demeure bien en dessous de sa moyenne de longue période.
Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage augmentent de nouveau en février. Le solde correspondant gagne trois points et se rapproche de son niveau historique de juin 2009.
En février, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont un peu moins nombreux qu’en janvier : le solde correspondant perd un point, mais se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période.
En revanche, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois augmente légèrement. Le solde correspondant gagne un point tout en restant nettement en dessous de sa moyenne de longue période.
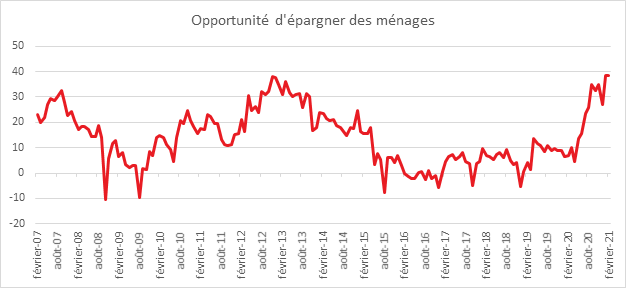
Livret A en janvier, un départ sur les chapeaux de roues
Un départ en trombe du Livret A
Le Livret A ne connait, au mois de janvier, pas la crise avec une collecte positive de 6,32 milliards d’euros. Il faut remonter à janvier 2013, en pleine période de relèvement du plafond du Livret A, pour avoir une collecte plus élevée (8,21 milliards d’euros). Même en plein confinement, la collecte avait été plus faible, 5,47 milliards d’euros en avril dernier.
Ce résultat est la conjonction de deux facteurs ; l’un est d’ordre structurel lié aux flux des revenus et l’autre est de nature conjoncturelle en lien avec la persistance de la crise sanitaire.
Traditionnellement, le premier mois de l’année réussit assez bien au Livret A avec des collectes qui s’élèvent en moyenne à près de 3 milliards d’euros. Seulement deux décollectes ont été enregistrées lors de ces dix dernières années (en janvier 2015 et 2016). Les détenteurs de Livret A versent traditionnellement en janvier une partie de leurs primes et des étrennes reçues à la fin de l’année précédente.
L’année 2021 débute sur un rythme élevé avec la persistance de la crise sanitaire. Au mois de décembre dernier, une décollecte de 840 millions d’euros avait été constatée. Les ménages après un mois de confinement et en vue fêtes de fin d’année s’étaient fait plaisir comme l’ont prouvé les résultats de la consommation de biens. En janvier, l’instauration du couvre-feu à 18 heures et le maintien des fermetures de bars, des restaurants ainsi que de nombreuses activités de loisirs réduisent mécaniquement le montant des dépenses des ménages. Ces derniers ont arbitré en faveur du Livret A qui offre, à défaut d’un réel rendement, la sécurité et la liquidité, eux valeurs clefs en période de crise . Ce choix pour un placement de court terme témoigne aussi de la prégnance de l’inquiétude au sein de la population comme l’ont souligné la dernière étude du CEVIPOF et l’enquête de l’INSEE sur la confiance des ménages de février. Les Français, par crainte de l’avenir, entendent maintenir un fort taux d’épargne de précaution. Le maintien des revenus qui ont baissé de moins de 5 % depuis un an grâce aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, permet aux Français de mettre de l’argent de côté.
Le Livret A a de ce fait battu un nouveau record d’encours à 332,9 milliards d’euros. Celui a augmenté de 10 % en un an. De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré une collecte de 870 millions d’euros au mois de janvier portant son encours à 122,6 milliards d’euros.
La persistance de la crise sanitaire, sans nul doute, jusqu’à l’été devrait conduire au maintien d’une forte collecte dans les prochains mois, sachant qu’en temps normal, le premier semestre est plutôt favorable au Livret A. Ce n’est qu’au cours du second semestre, qu’une inversion de tendance pourrait se profiler.
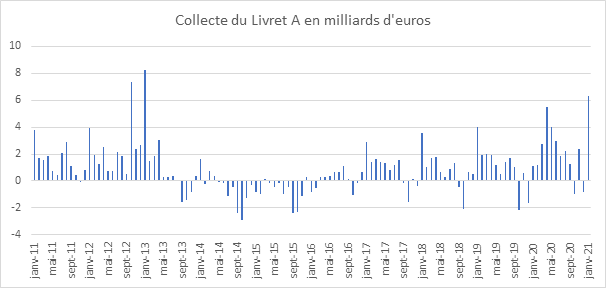
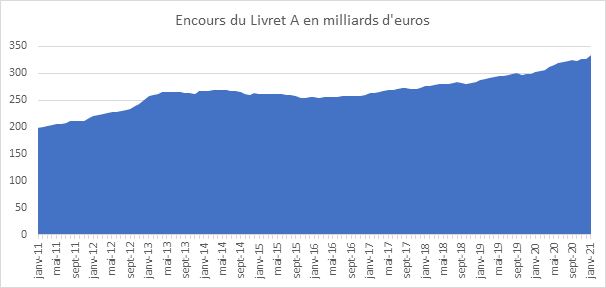
Le Coin des Epargnants du 20 février 2021 : remontée des taux par crainte de surchauffe
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 19 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 773,55 | +1,23 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 31 494,32 | +0,11 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 874,46 | -1,57 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 13 993,23 | -0,40 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 624,02 | +0,52 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 713,46 | +0,48 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 30 017,92 | +1,69 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 696,17 | +1,12 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,059 % | +0,139 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,307 % | +0,120 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,338 % | +0,151 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2135 | +0,15 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 783,630 | -2,24 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 63,210 | +1,12 % | 51,290 |
Après l’arrêt sur image, la crainte de la surchauffe
L’arrivée prochaine des plans de relance associée à la multiplication des demandes d’aides de la part de secteurs en extrême difficulté, comme celui de l’aérien, conduit à un mouvement général de hausse des taux d’intérêt sur les obligations d’Etat. Le taux de l’OAT à 10 ans est ainsi revenu proche de zéro. Le taux américain équivalent est passé au-dessus de 1,3 %. Les investisseurs craignent une résurgence de l’inflation qui serait occasionnée par une surchauffe de l’économie et par une augmentation du cours des matières premières et de l’énergie. L’augmentation des taux est également alimentée par des rumeurs de resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis. La nouvelle administration Biden a confirmé sa volonté de relancer massivement l’économie. Dans un entretien accordé jeudi soir à CNBC, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a souligné l’importance d’un plan d’ampleur pour contrecarrer les conséquences économiques de la pandémie. Elle estime qu’une réaction timide « aurait un coût bien plus élevé que celui de faire les choses en grand ». A la question de savoir si la mise en place de toutes les mesures de ce plan était nécessaire après des ventes au détail bien plus dynamiques que prévu en janvier et des niveaux records sur les actions, Janet Yellen a répondu par l’affirmative, ajoutant que la Fed avait les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. La hausse des taux s’est fait ressentir sur le cours des actions. Les indices américains ont marqué le pas. En Europe, la tendance n’était pas uniforme. Paris porté par les résultats du secteur du luxe était en hausse à la différence de Francfort.
Evolution du taux de l’OAT à 10 ans
Dans le compte-rendu de sa réunion de janvier, la Banque centrale européenne a, de son côté, indiqué que si le conseil des gouverneurs surveille la hausse de l’euro, par nature déflationniste, il ne s’alarme pas de la hausse des rendements obligataires.
Aux Etats-Unis, les indicateurs restent bien orientés. La croissance de l’activité du secteur privé américain a ainsi accéléré en février ; l’indice préliminaire PMI composite (synthèse entre l’industrie et les services) établi part IHS Markit a atteint un sommet de près de six ans à 58,8 points, tiré à la fois par les services (+0,6 point à 58,9) et le secteur manufacturier qui marque cependant un léger ralentissement à 58,5 après 59,2 en janvier (le seuil des 50 points marque la frontière entre contraction et expansion de l’activité). Au sein de la zone euro, les restrictions sanitaires pèsent sur l’activité. L’activité du secteur des services s’inscrit toujours à la baisse ; l’indice PMI Markit a reculé à 47,7 points, un plus bas de trois mois. En revanche, l’indice composite s’est redressé de 0,3 point à 48,1 grâce à la forte progression de la composante manufacturière qui a atteint un sommet de trois ans à 57,7.
Volatilité et futilité
La volatilité est devenue de mise sur les marchés. Le prix de certains actifs connait des hausses brutales suivies de baisses rapides. Dernièrement, les cours boursiers de GameStop ou de AMC, le prix de l’argent ou celui du Bitcoin ont donné lieu à des mouvements erratiques. Ces derniers ne sont pas assimilables à des bulles car il s’agit avant tout d’oscillations violentes. Ils se différencient ainsi de la situation qui prévaut par exemple pour les valeurs technologiques américaines. Le cours d’AMC a été multiplié par six entre mars 2020 et janvier 2021 avant de perdre la moitié de sa valeur. Celui de GameStop a été multiplié par 28 de décembre à janvier avant d’être divisé par près de six en février. Le cours de l’argent a gagné en six mois 80 % et celui du Bitcoin a été multiplié par six.
Avec la croissance rapide de l’offre de monnaie et les taux d’intérêt négatifs ou très faibles, un groupe d’investisseurs constitué avec l’appui des réseaux sociaux peut facilement opérer des achats ainsi que des ventes coordonnées sur un actif et provoquer de fortes variations. La base monétaire est, en effet, passée de 14 000 à plus de 22 000 milliards de dollars à l’échelle internationale.
Si ces phénomènes se généralisent, les marchés des matières premières, de l’énergie et des « small caps » pourraient devenir spéculatifs et donner lieu à des scandales financiers dignes de ceux qui ont prévalus au XIXe siècle ou dans les années 1930, surtout sur les marchés acceptant les achats à découvert.
Le Coin des Epargnants du 13 février 2021 – Wall Street toujours plus haut
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 12 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 703.67 | +0,78 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 31 458,40 | +1,00 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 095,47 | +1,73 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 14 049,89 | -0,05 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 589,79 | +1,55 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 695,61 | +1,09 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 29 520,07 | +2,57 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 655,09 | +4,54 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,198 % | +0,031 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,427 % | +0,023 pt | -0,550% |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,187 % | +0,042 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2127 | +0,66 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 824,600 | +0,60 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 62,400 | +4,87 % | 51,290 |
En attendant d’y voir plus clair
Après plusieurs semaines de forte volatilité, les marchés « actions » se sont calmés cette semaine, du moins en Europe. Après des résultats trimestriels meilleurs que prévus, l’attentisme a été de mise chez les investisseurs, les petits signes d’amélioration sur le front de l’épidémie ayant été largement anticipés. En Italie, les membres du mouvement 5 Etoiles, le premier parti au Parlement, ont apporté leur soutien à l’ancien Président de la BCE, Mario Draghi, lui permettant de devenir Président du Conseil. Ce dernier s’est engagé à faire adopter des mesures de relance budgétaires et à accélérer les réformes structurelles. L’absence de consensus parlementaire sur le contenu de ces dernières, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement, rend leur adoption hypothétique.
Aux Etats-Unis, de nouveaux records ont été battus à Wall Street dans l’espoir d’une reprise de l’économie américaine grâce au plan de relance adopté la semaine dernière. Les investisseurs sur-anticipent les effets des mesures de Joe Biden tout comme l’amélioration attendue des résultats des entreprises. Les flux vers les fonds en actions ont atteint 58 milliards de dollars sur la semaine au 10 février, niveau jamais atteint, selon les données publiées par Bank of America qui prévient qu’une correction pourrait intervenir dans les prochaines semaines. En attendant, le Nasdaq a franchi la barre des 14 000 points contre moins de 10 000 points il y a un an. La hausse sur ces douze derniers mois atteint 46 %.
Le prix du baril de pétrole Brent a poursuivi sa progression en franchissant la barre des 60 dollars. La diminution des stocks américains explique la progression du prix du pétrole. Cette hausse est intervenue au moment où Total est devenu Total Energies, ce changement de nom marquant la fin du tout pétrole pour cette société. L’entreprise anglo-néerlandaise, Shell, tout en conservant son nom, se prépare à sortir du pétrole.
Les taux d’intérêts des titres publics continuent de leur côté à augmenter. La crainte d’une surchauffe des économies avec la multiplication des plans de relance contribue à cette légère pression à la hausse.
Le Coin des Epargnants du 6 février 2021 : le temps des espoirs
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 5 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 659,26 | +4,82 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 31 148,24 | +3,89 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 856,30 | +6,01 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 14 056,72 | -3,18 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 489,33 | +1,28 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 655,77 | +5,01 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 779,19 | +4,03 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 483,07 | -3,43 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,229 % | +0,035 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,450 % | +0,068 pt | -0,550% |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,145 % | +0,069 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2035 | -0,81 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 813,530 | -1,88 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 59,300 | +7,85 % | 51,290 |
Retour de l’optimisme en février
Après un mois de janvier chafouin, le début du mois de février commence sur les chapeaux de roues pour les marchés « actions ». En cinq jours, le CAC a gagné près de 5 %, signant sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-novembre. Les cours ont été dopés par les résultats satisfaisants compte tenu de la situation économique de BNP Paribas, de Sanofi ou de Vinci. L’Eurostoxx progresse de son côté de plus de 5 % et le Nasdaq de plus de 6 %.
Les marchés ont continué d’être agités par les opérations liées à l’affaire GameStop. Les investisseurs se sont également réjouis des autorisations données à de nouveaux vaccins et de la levée progressive des restrictions sanitaires dans certains pays. La volonté du gouvernement français de ne pas confiner a été également bien reçu.
Aux Etats-Unis, les résultats de l’emploi en janvier ont déçu mais marquent malgré tout un changement de cap. Après 227 000 destructions d’emploi en décembre, l’économie américaine en a créé 49 000 en février. Le consensus espérait mieux avec 100 000. L’industrie manufacturière a détruit 10 000 postes en janvier quand il était attendu 30 000 créations. Le taux de chômage est néanmoins ressorti en forte baisse à 6,3%, en baisse de 0,4 point en un mois. Le taux de participation à l’emploi de janvier s’élevait à 61,4 %. Le salaire horaire moyen n’a progressé que de 0,2 %. La hausse est de 5,4 % sur un an.
Le pétrole retrouve des couleurs
Le baril de pétrole de Brent a flirté avec la barre des 60 dollars, retrouvant son plus haut niveau depuis un an. Il a gagné plus de 7 % en une semaine et 14 % en un mois. Son cours a été multiplié par trois par rapport à leur point bas du mois d’avril 2020, en pleine crise sanitaire. Le redémarrage de l’économie mondiale et l’accord de régulation l’Opep+ qui rassemble les Etats membres de l’Opep et la Russie ainsi que ses alliés ont permis de résorber en partie les stocks. Dans un communiqué publié après la e-réunion de l’organisation, le mardi 2 février dernier, l’Arabie saoudite et Moscou « ont souligné l’importance d’accélérer le rééquilibrage du marché sans délai ». Cela signifie que le dispositif de régulation sera maintenu dans les prochains mois. La production cumulée de l’alliance est aujourd’hui inférieure d’un peu plus de 7 millions de barils par jour par rapport à avant la crise, quand le monde en consommait environ 100 millions en une journée. La réduction était de 9,7 millions de barils par jour en mai avant d’être ramenée à 7,7 millions en août. En janvier, elle devait être réduite à 5,8 millions de barils par jour, mais, entre-temps, un nouvel accord a été trouvé et l’Arabie saoudite a choisi, individuellement, de faire un effort supplémentaire en février et mars en réduisant sa production d’encore 1 million par rapport à son quota de 9,1 millions. Les réserves de pétrole baissent aux Etats-Unis et sont au plus bas en Chine depuis un an.
La hausse continue des prix du pétrole depuis quatre mois commence à se faire ressentir sur l’évolution des prix. Dans la zone euro, le taux de croissance des prix en rythme annuel est redevenu positif en janvier, à +0,9% (+0,2% sur un mois), après cinq mois négatifs. Cette remontée de l’inflation n’est pas exclusivement imputable au prix du pétrole. L’inflation sous-jacente ou de base (hors énergie, produits alimentaires non transformés, tabac et alcool), s’élève désormais à 1,4 % sur un an quand elle ne dépassait pas 0,2 % depuis trois mois Plusieurs experts estiment néanmoins que l’augmentation de l’énergie et des matières premières devrait avoir comme conséquence d’élever l’inflation au sein de la zone euro à 2 %, le taux cible de la BCE.
Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés
Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés reste toujours à un niveau historiquement bas, 0,12 % au mois de décembre 2020, contre 0,16 % un an auparavant. Le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires s’établit à 0,46 %. Ce taux a diminué de 12 points de base entre décembre 2019 (0,58%) et août 2020 (0,46%), puis est resté inchangé depuis. Ce repli sur un an s’explique par la baisse du taux du livret A en février 2020 (0,75% à 0,5%) ainsi que par une moindre rémunération servie sur les comptes à terme (pour les ménages comme pour les SNF).
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| déc- 2019 | oct- 2020 | nov- 2020 (e) | déc- 2020 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,58 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Ménages | 0,82 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,71 | 0,54 | 0,53 | 0,51 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,26 | 1,04 | 1,03 | 1,01 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,62 | 2,62 | 2,61 |
| SNF | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,15 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,09 | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,40 | -0,51 | -0,52 | -0,54 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,40 | -0,65 | -0,65 | -0,66 |
Statuquo pour le taux du Livret A au 1er février 2021
Le taux du Livret A peut être révisé le 1er février et le 1er août de chaque année.
Depuis le 1er février 2020, le taux du livret A est égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %.
Le taux d’inflation sur les six derniers mois connus a été de 0,23 % et les taux interbancaires ont été négatifs de 0,5 point. Dans ces conditions, c’est la valeur plancher de 0,5 point qui joue soit le taux actuel. En l’état actuel des choses, le rendement réel du taux du Livret A est positif.
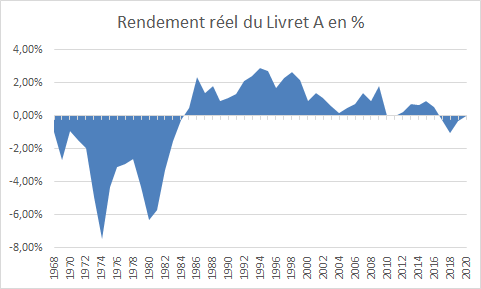
Le Coin des Epargnants du 30 janvier 2021, le retour à la réalité
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 29 janvier 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 399,21 | -2,88 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 29 982,62 | -3,27 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 070,69 | -3,49 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 13 432,87 | -3,18 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 407,46 | -4,30 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 481,44 | -3,36 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 27 663,39 | -3,38 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 483,07 | -3,43 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,264 % | +0,017 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,518 % | -0,004 pt | -0,550% |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,076 % | -0,015 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2136 | -0,27 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 858,282 | +0,18 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 55,330 | +0,45 % | 51,290 |
Les marchés financiers au milieu du gué
Le lancement des campagnes de vaccination est logiquement synonyme de retour prochain à la normale. Cet espoir, largement anticipé par les investisseurs, a été enrayé par l’essor des variants du coronavirus qui contraint de nombreux pays à se claquemurer à nouveau. Ce contexte peu favorable à l’activité a pesé sur le cours des actions qui ont abandonné, pour l’ensemble du mois de janvier, du terrain (plus de 2 % pour le CAC 40), cette légère correction s’est construite dans les derniers jours de janvier. Aux Etats-Unis, si le Nasdaq progresse sur l’ensemble du mois de janvier mais le Dow Jones recule. En revanche, les indices « actions » asiatiques ont enregistrés des hausses.
En cette fin de janvier, le CAC 40 a connu son plus mauvais résultat hebdomadaire depuis octobre en cédant 2,88 %. L’ensemble des indices actions, asiatiques compris, ont baissé cette semaine. Le Daxx allemand baisse de plus de 3 % et le Footsie britannique de plus de 4 %. Les résultats du PIB de 2020 moins mauvais que prévu n’ont pas eu d’incidences. Les mouvements spéculatifs opérés par des investisseurs individuels autour de certains titres « shortés » par les hedge funds ont déstabilisé les marchés. Le FMI s’est inquiété du décalage entre les cours des actions et la situation économique qui demeure très complexe, ce qui peut conduire certains investisseurs à opter pour la prudence. A New York, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent plus de 3 %.
Croissance de la France en 2020, grave mais moins grave que prévu
Les prévisionnistes tablaient sur une contraction du PIB de l’économie française, en 2020, entre 9 et 10 %. Selon les premiers résultats de l’INSEE publiés vendredi 29 janvier, la baisse n’a été que de 8,3 %. Elle constitue, malgré tout, la plus forte diminution, en France, du PIB enregistrée depuis 1950. En soixante-dix, trois baisses du PIB dont la plus importante datait de 2009 avec un recul de 2,9 % avaient été enregistrées. La moindre contraction du PIB que prévu en France est liée à la solidité de la consommation qui trouve son origine dans la relative stabilité du pouvoir d’achat des ménages.
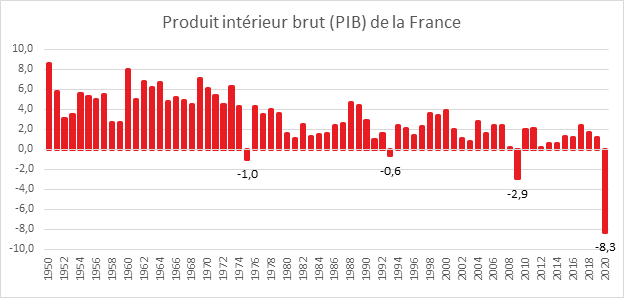
Le recul du PIB en 2020 est imputable avant tout au premier confinement qui a été marqué par un arrêt brutal de l’activité. La fermeture des écoles doublée de la peur de la contagion ont amené de nombreuses entreprises à restreindre fortement leurs activités. Le deuxième confinement a eu des effets moindres, son intensité étant moindre. Les entreprises se sont, par ailleurs adaptées.
Après une baisse de près de 6 % au premier trimestre, le PIB a connu une contraction de 13,7 % au deuxième, suivi d’un net rebond au troisième de 18,5 %. Le confinement du mois de novembre et les couvre-feux se sont traduits par un nouveau recul du PIB de 1,3 %.
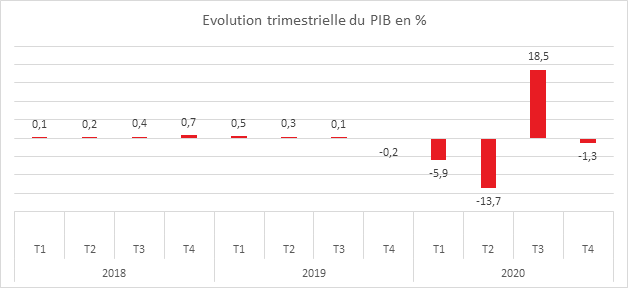
Au quatrième trimestre 2020, le PIB est inférieur de 5,0 % à son niveau un an auparavant alors que le recul sur un an s’élevait à 18,8 % au deuxième trimestre.
Des dépenses de consommation en dents de scie avec un record battu au mois de décembre
Sur l’ensemble de l’année 2020, la consommation des ménages diminue de 7,1 %, après une hausse de +1,5 % en 2019. La consommation en produits alimentaires a progressé de 1 % quand celle des services est en nette baisse, -7,1 %. La consommation en produits énergétiques recule de 7,4 % et celle en produits manufacturés de 8,9 %.
L’évolution de la consommation des ménages est calquée sur celle de l’épidémie. En phase de confinement, elle recule mais rebondit rapidement dès que ce dernier s’arrête. Si les Français ont augmenté de manière importante leur effort d’épargne, ils ont tant durant l’été qu’en décembre retrouvé le chemin des magasins.
En décembre, les ménages ont souhaité se faire plaisir dans la perspective des fêtes de fin d’année. Après le recul de 18 % en novembre, les dépenses de consommation des ménages en biens ont progressé de 23 % en décembre. Elles ont ainsi battu un nouveau record et battu de 3,7 % leur niveau de décembre 2019. Ce surcroit de dépenses est imputable en grande partie aux biens fabriqués avec des achats en hausse de +9,8 % sur un an. Les achats de biens durables ont progressé de +6,9 % et ceux en habillement-textile de +17,8 %. Cette forte hausse s’explique par la réouverture des magasins à partir du 29 novembre et par le report de « Black Friday » en décembre. Avec les confinements, les Français dépensent davantage pour l’équipement de leur logement. En décembre, les achats en la matière ont augmenté de 38,3 % sur un an. Les Français ont, en particulier, acheté des appareils ménagers et des produits électroniques. En revanche, les achats de matériels de transport restent nettement en retrait (–10,0 % par rapport à décembre 2019).
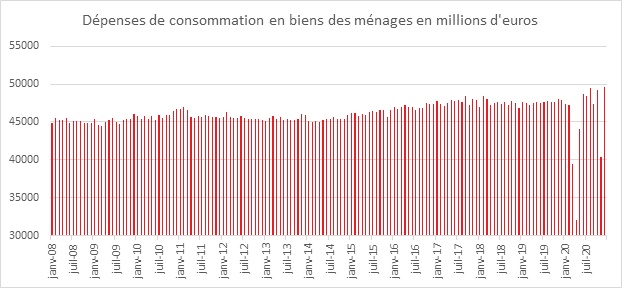
Au quatrième trimestre, les dépenses de consommation des ménages ont néanmoins baissé de 5,4 % au quatrième trimestre après une hausse de 18,2 % au trimestre précédent. Si la consommation de biens alimentaires a connu une progression de +1,1 % au quatrième trimestre après –3,3 % au troisième, les biens fabriqués ont enregistré une baisse de 8,5 %, contre une augmentation 39,3 % au troisième trimestre. La consommation de services a baissé de 7,4 % après une progression de +21,0 %. La consommation en énergie a diminué de 3,9 % après une hausse de 15,9 % en lien avec la diminution des déplacements.
Une production qui relève la tête en fin d’année sauf pour les services
La production s’est contractée en France 8,6 % en 2020. La chute a été de 13,1 % pour l’industrie manufacturière et de 8,2 % pour les services. La construction a de son côté connu un recul de 13,2 %.
Pour le seul quatrième trimestre, la production totale (biens et services) a diminué de 0,7 %, après le rebond de +18,0 % au troisième trimestre. Néanmoins, la production de biens poursuit sa hausse ce trimestre (+2,3 % après +19,0 %), portée notamment par l’industrie manufacturière qui semble peu affectée par le deuxième confinement. En raison des fermetures, la production baisse nettement dans les services marchands (–2,2 % après +15,6 %). In fine, la production de biens poursuit ce trimestre son rapprochement vers son niveau d’avant-crise (–4,6 % en glissement annuel après –8,2 % au troisième trimestre), tandis que les services s’en éloignent à nouveau (–5,0 % en glissement annuel, après –3,4 % au troisième trimestre).
Fort recul de l’investissement en 2020
Sur l’ensemble de l’année 2020, l’investissement enregistre une contraction de 9,8 % après une hausse de 4,3 % en 2019. Il a baissé de 12,4 % pour l’industrie manufacturée, de 14,7 % pour la construction et de 2,4 % pour les services marchands.
La chute est essentiellement intervenue lors du premier confinement. Ainsi, la formation brute de capital fixe (FBCF) a continué à augmenter au quatrième trimestre (+2,4 % après +24,0 %). L’investissement dans les secteurs des services marchands est resté bien orienté en fin d’année (+7,1 % au quatrième trimestre après +5,7 %), portée par un nombre particulièrement élevé de transactions immobilières. De même l’investissement en construction se maintient ce trimestre (+0,2 %) : bien que demeurant inférieur de 6,3 % à son niveau d’avant crise. Au deuxième trimestre, la chute avait atteint 32,4 % en glissement annuel.
Amélioration progressive de la situation du commerce extérieur
Pour le second trimestre consécutif, les exportations ont augmenté plus vite que les importations. Au dernier trimestre 2020, les exportations ont augmenté de 4,8 % quand les importations ne progressaient que de 1,3 %.
Avec les restrictions de circulation, la France importe moins de pétrole, ce qui contribue au rééquilibrage partiel de la balance commerciale. En revanche, l’absence du tourisme international pèse lourdement sur la balance des paiements courants. Le déficit du solde s’est réduit de moitié au quatrième trimestre par rapport à son point bas observé au deuxième (–9,4 Md€ ce trimestre, contre –18,8 Md€ au deuxième). Les échanges extérieurs restent inférieurs à leur niveau d’avant-crise ,–11,0 % en glissement annuel en volume pour les exportations ce trimestre, et –8,1 % pour les importations. Au quatrième trimestre, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance, +0,9 point, après +0,8 point au trimestre précédent. Sur l’ensemble de l’année 2020, la contribution du commerce extérieur à l’évolution du PIB est largement négative (–1,5 point).
Les variations de stock ont joué en faveur de la croissance
Les variations de stocks ont contribué positivement à l’évolution du PIB au dernier trimestre (+0,4 point après –1,7 point). Sur l’année 2020, les variations de stocks contribuent pour +0,2 point à l’évolution du PIB.
Ce recul historique du PIB en France s’est accompagné par une augmentation sans précédent de l’endettement public. Avec le chômage partiel et les mesures de soutien aux entreprises et à certaines catégories de la population, les pouvoirs publics ont pris une très grande partie à leur charge les effets de la crise. Les dépenses publiques ont du représenter plus de 60 % du PIB, ce qui constitue un record. Le retour à la normale débutera avec le recul de l’épidémie attendu au cours du deuxième trimestre 2021.
Les ménages en mode épargne en janvier
Avec la généralisation du couvre-feu et la menace d’un nouveau reconfinement, les Français sont un peu mois confiant, en janvier qu’en décembre vis-à-vis de la situation économique. En janvier , l’indice de l’INSEE qui mesure la confiance des ménages dans la situation économique se contracte de trois points après le net rebond de décembre. Replie. Cet indice qui la synthétise perd trois points et demeure sous sa moyenne de longue période.
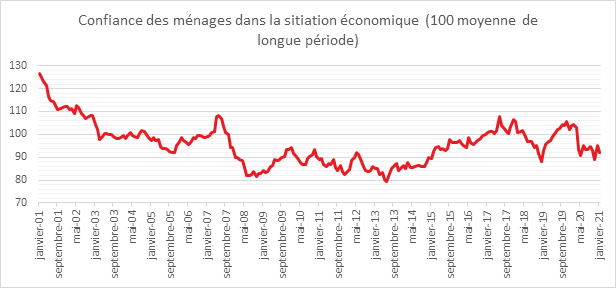
Moins d’achats, plus d’épargne
En janvier, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminue. L’indice perd six points et repasse sous sa moyenne de longue période. Ce repli s’explique par une crainte accrue d’une baisse des revenus dans les prochains mois. Le solde d’opinion des ménages relatif à la situation financière future des ménages est en baisse aussi de cinq points. Cet indice repasse en dessous de sa moyenne. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée baisse quant à lui de deux points, mais demeure supérieur à sa moyenne de longue période.
Les ménages souhaitent avant tout épargne, signe manifeste d’une dégradation attendue de la situation économique. En janvier, l’indicateur mesurant la proportion des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente de onze points. Il rejoint son niveau de décembre 2012, très proche de son plus haut historique.
Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle gagne deux points. En revanche, le solde relatif à leur capacité d’épargne future perd un point. Ces deux soldes se maintiennent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.
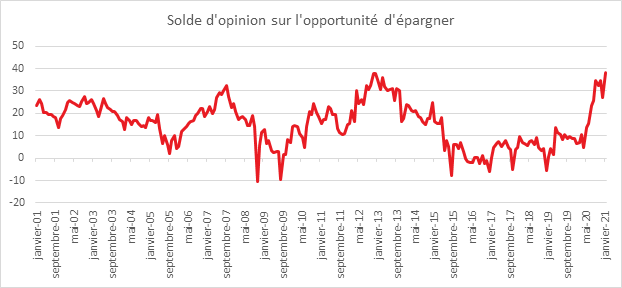
Les Français pessimistes pour le niveau de vie
En janvier, la part des ménages estimant que le niveau de vie en France s’améliorera au cours des douze prochains mois diminue après avoir nettement rebondi en décembre. Le solde correspondant perd neuf points et s’éloigne à nouveau de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente, en revanche, d’un point. Le solde correspondant demeure malgré tout bien en dessous de sa moyenne de longue période.
Assez logiquement au vu des résultats précédents, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage progressent en janvier. Le solde correspondant gagne huit points et demeure depuis avril 2020 très au-dessus de sa moyenne de longue période.
En janvier, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont aussi nombreux qu’en décembre, le solde correspondant est inchangé et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est inchangée aussi. Le solde correspondant se situe nettement en dessous de sa moyenne de longue période.
L’enquête du mois de janvier 2021 de l’INSEE sur le moral des ménages souligne que celui-ci reste conditionné aux flux et reflux de l’épidémie. Le renforcement de l’épargne de précaution traduit la montée des inquiétudes au sein des ménages qui craignent un troisième confinement. Si les pouvoirs publics ont réussi jusqu’à maintenant à préserver le pouvoir d’achat des Français, ces derniers doutent sur la capacité à pérenniser cette situation.
Dépendance, une nouvelle mission pour Dominique Libault
Dominique Libault s’est vu confier une mission par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie. Cette mission a été lancé a lancé, jeudi 21 janvier dans le cadre d’une réunion avec l’Association des départements de France (ADF), les directeurs d’administration centrale du ministère des Solidarités et de la Santé, la CNSA, la CNAM et l’ARS d’Île-de-France. Dominique Libault avait déjà mis à contribution en ayant été à l’origine du rapport sur la concertation du grand âge et autonomie remis en 2019. Il avait alors présenté 175 propositions sur la dépendance. Dans l’attente de la présentation du projet de loi devant définir le contenu de la nouvelle branche de la Sécurité sociale dédiée à la dépendance, Dominique Libault est appelé à élaborer des solutions à plusieurs problèmes concrets qui se posent aux personnes dépendantes et à leur famille.
L’objectif de cette nouvelle mission est de simplifier l’accès à l’information pour les personnes âgées et leurs proches concernés par la dépendance, mais aussi de fluidifier leurs parcours en encourageant les synergies entre les acteurs de l’accompagnement et du soutien à l’autonomie».
Le président du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFi-PS), devra travailler sur la généralisation d’un guichet unique pour les personnes en perte d’autonomie «dédié à l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement dans les démarches et l’accès aux droits».
La mission devra également réfléchir sur l’articulation des professionnels de santé et du grand âge sur les territoires «en s’appuyant sur les bonnes pratiques de coopération pour simplifier la vie des personnes». Enfin, la troisième priorité porte sur la création et l’animation d’un comité «autonomie et parcours de soins» visant à décloisonner les différents secteurs, favoriser les échanges et renforcer les dynamiques territoriales en faveur du parcours.
L’assurance vie a plié sans rompre en 2020 : retour sur une année difficile pour le premier placement des Français
Après neuf mois consécutifs de décollecte, l’assurance vie termine, selon la Fédération Française de l’Assurance, l’année 2020, dans le vert avec un résultat positif de 500 millions d’euros. Si le premier produit d’épargne des Français a été fortement touché par le premier confinement, il était, depuis, sur une tendance ascendante. Les Français ont commencé à affecter, de manière mesurée, en fin d’année une partie des importantes liquidités mises de côté depuis le mois de mars. Le résultat de décembre confirme ainsi le processus de normalisation engagé depuis trois mois. Il est d’autant plus significatif qu’en règle générale, le mois de décembre réussit peu à l’assurance vie avec quatre décollectes en dix ans. Le dernier mois de l’année est, en effet, traditionnellement consacré plus aux dépenses qu’à l’épargne.
La deuxième décollecte de l’histoire de l’assurance vie
Sur l’ensemble de l’année, la collecte nette de l’assurance vie est négative de 6,5 milliards d’euros, ce qui constitue le plus mauvais résultat enregistré, par ce produit, depuis 1990. En 2012, la décollecte avait été de 6,34 milliards d’euros. Le résultat 2020 est évidemment la conséquence de la préférence donnée par les ménages à la sécurité et à la liquidité en pleine période de crise. Il n’est pas également sans lien avec la montée en puissance des unités de compte. Certains épargnants ont préféré ne pas investir dans leur contrat d’assurance vie du fait de la nécessité de supporter un peu plus de risques qu’auparavant en devant souscrire des unités de compte.
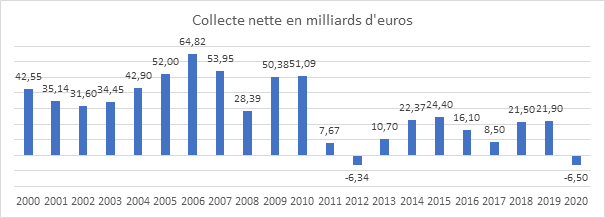
Les unités de compte maintiennent le cap
En décembre, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 12,8 milliards d’euros, contre 10,4 milliards d’euros en novembre. Cette collecte brute est supérieure à celle de décembre 2019, 11,8 milliards d’euros. Sur l’ensemble de l’année, le montant des cotisations est en net retrait par rapport aux années précédentes, 116,3 milliards d’euros contre 144,6 milliards d’euros en 2019.
Au mois de décembre, la proportion des unités de compte dans la collecte a été de 37 % en légère hausse par rapport au mois de novembre (33 %). Sur l’ensemble de l’année, le montant investi sur les supports en unités de compte s’est élevé à 40,1 milliards d’euros, soit 34 % des cotisations (28 % en 2019). Ce résultat est le plus élevé de ses vingt dernières années, le précédent record datant de 2000, en pleine bulle Internet avec 40 %. Les consignes des assureurs, au minimum 33 % d’unités de compte, sont appliquées et en grande partie acceptées par les assurés.
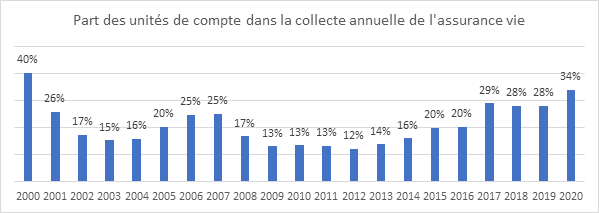
Des prestations stables malgré la crise
Au niveau des prestations, la collecte de décembre a atteint 12,3 milliards d’euros en hausse par rapport aux mois précédents (10,4 milliards d’euros en novembre). Elles sont, en revanche, en retrait par rapport au mois de décembre 2019 (13,2 milliards d’euros). Sur l’ensemble de l’année, les prestations versées ont atteint 122,8 milliards d’euros, contre 122,7 milliards d’euros en 2019. La crise n’a pas réellement modifié le comportement des assurés qui ont maintenu constants leurs retraits, traduisant l’absence de défiance à l’encontre de l’assurance vie.
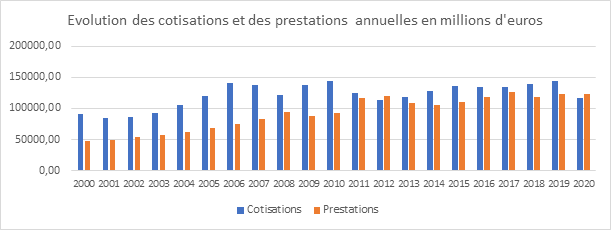
Un encours stable en 2020
L’encours de l’assurance vie a atteint à la fin de l’année 2020, 1 789 milliards d’euros. Ce produit d’épargne demeure de loin le premier placement des ménages. Cet encours est resté stable sur l’année, la décollecte étant compensée par les rendements de l’épargne placée.
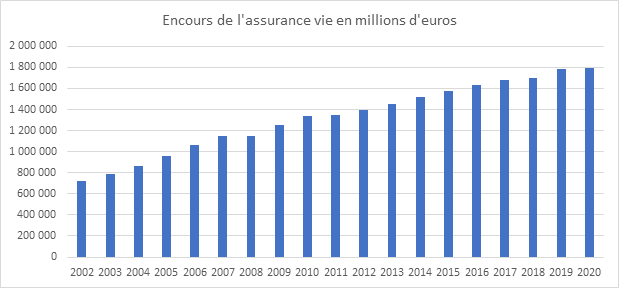
2021, la prudence de mise
Dans un contexte peu porteur pour l’épargne de long terme et de taux, l’assurance vie a fort logiquement connu, en 2020, une décollecte. Celle-ci s’est construite surtout au moment du premier confinement. L’ouverture des établissements financiers durant le deuxième confinement a permis de limiter la décollecte au mois de novembre. La réorganisation des réseaux commerciaux avec le recours à la visioconférence et au téléphone explique le processus de normalisation qui s’est engagé à partir de l’été. L’année 2020 a été également marquée pour l’assurance vie par le maintien d’une forte souscription d’unités de compte. Lors des précédentes crises, la proportion d’unités de compte chutait fortement. Cette année, les épargnants ne sont pas sortis massivement des produits dits risqués ; ils ont diminué leurs versements mais n’ont pas effectuer des retraits.
En 2021, la prudence devrait rester de mise au cours du premier semestre en raison de la persistance de l’épidémie. Les ménages joueront toujours la carte de l’épargne de précaution. La réorientation d’une partie de l’épargne liquide, de précaution, vers l’assurance vie interviendra certainement au second semestre. La baisse des taux de rendement des fonds euros qui est un peu moins forte que prévu ne devrait pas avoir de lourdes incidences sur la collecte, les unités de comptes devraient maintenir le cap d’autant plus que les marchés « actions » demeurent pour le moment bien orientés.
Contact presse
Philippe Crevel : 06 03 84 70 36
pcrevel@gmail.com
L’assurance vie retour en territoire positif en décembre
Après neuf mois consécutifs de décollecte, l’assurance vie termine, selon la Fédération Française de l’Assurance, l’année 2020, dans le vert avec un résultat positif de 500 millions d’euros. Si le premier produit d’épargne des Français a été fortement touché par le premier confinement, il était, depuis, sur une tendance ascendante. Les Français ont commencé à affecter, de manière mesurée, en fin d’année une partie des importantes liquidités mises de côté depuis le mois de mars. Le résultat de décembre confirme ainsi le processus de normalisation engagé depuis trois mois. Il est d’autant plus significatif qu’en règle générale, le mois de décembre réussit peu à l’assurance vie avec quatre décollectes en dix ans. Le dernier mois de l’année est, en effet, traditionnellement consacré plus aux dépenses qu’à l’épargne.
La deuxième décollecte de l’histoire de l’assurance vie
Sur l’ensemble de l’année, la collecte nette de l’assurance vie est négative de 6,5 milliards d’euros, ce qui constitue le plus mauvais résultat enregistré, par ce produit, depuis 1990. En 2012, la décollecte avait été de 6,34 milliards d’euros. Le résultat 2020 est évidemment la conséquence de la préférence donnée par les ménages à la sécurité et à la liquidité en pleine période de crise. Il n’est pas également sans lien avec la montée en puissance des unités de compte. Certains épargnants ont préféré ne pas investir dans leur contrat d’assurance vie du fait de la nécessité de supporter un peu plus de risques qu’auparavant en devant souscrire des unités de compte.
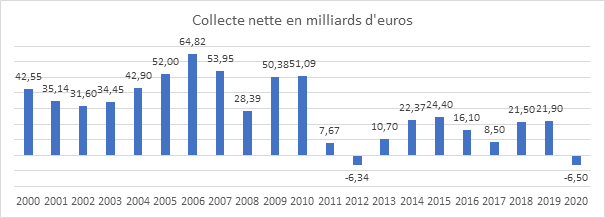
Les unités de compte maintiennent le cap
En décembre, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 12,8 milliards d’euros, contre 10,4 milliards d’euros en novembre. Cette collecte brute est supérieure à celle de décembre 2019, 11,8 milliards d’euros. Sur l’ensemble de l’année, le montant des cotisations est en net retrait par rapport aux années précédentes, 116,3 milliards d’euros contre 144,6 milliards d’euros en 2019.
Au mois de décembre, la proportion des unités de compte dans la collecte a été de 37 % en légère hausse par rapport au mois de novembre (33 %). Sur l’ensemble de l’année, le montant investi sur les supports en unités de compte s’est élevé à 40,1 milliards d’euros, soit 34 % des cotisations (28 % en 2019). Ce résultat est le plus élevé de ses vingt dernières années, le précédent record datant de 2000, en pleine bulle Internet avec 40 %. Les consignes des assureurs, au minimum 33 % d’unités de compte, sont appliquées et en grande partie acceptées par les assurés.
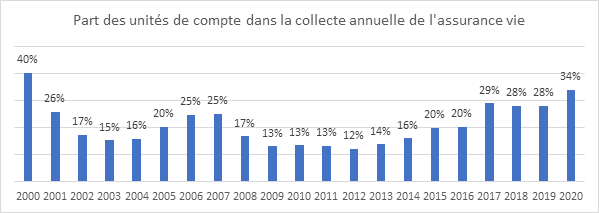
Des prestations stables malgré la crise
Au niveau des prestations, la collecte de décembre a atteint 12,3 milliards d’euros en hausse par rapport aux mois précédents (10,4 milliards d’euros en novembre). Elles sont, en revanche, en retrait par rapport au mois de décembre 2019 (13,2 milliards d’euros). Sur l’ensemble de l’année, les prestations versées ont atteint 122,8 milliards d’euros, contre 122,7 milliards d’euros en 2019. La crise n’a pas réellement modifié le comportement des assurés qui ont maintenu constants leurs retraits, traduisant l’absence de défiance à l’encontre de l’assurance vie.
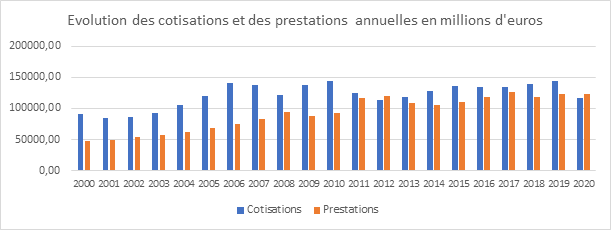
Un encours stable en 2020
L’encours de l’assurance vie a atteint à la fin de l’année 2020, 1 789 milliards d’euros. Ce produit d’épargne demeure de loin le premier placement des ménages. Cet encours est resté stable sur l’année, la décollecte étant compensée par les rendements de l’épargne placée.
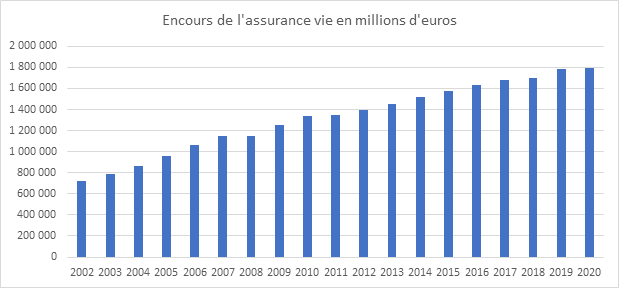
2021, la prudence de mise
Dans un contexte peu porteur pour l’épargne de long terme et de taux, l’assurance vie a fort logiquement connu, en 2020, une décollecte. Celle-ci s’est construite surtout au moment du premier confinement. L’ouverture des établissements financiers durant le deuxième confinement a permis de limiter la décollecte au mois de novembre. La réorganisation des réseaux commerciaux avec le recours à la visioconférence et au téléphone explique le processus de normalisation qui s’est engagé à partir de l’été. L’année 2020 a été également marquée pour l’assurance vie par le maintien d’une forte souscription d’unités de compte. Lors des précédentes crises, la proportion d’unités de compte chutait fortement. Cette année, les épargnants ne sont pas sortis massivement des produits dits risqués ; ils ont diminué leurs versements mais n’ont pas effectuer des retraits.
En 2021, la prudence devrait rester de mise au cours du premier semestre en raison de la persistance de l’épidémie. Les ménages joueront toujours la carte de l’épargne de précaution. La réorientation d’une partie de l’épargne liquide, de précaution, vers l’assurance vie interviendra certainement au second semestre. La baisse des taux de rendement des fonds euros qui est un peu moins forte que prévu ne devrait pas avoir de lourdes incidences sur la collecte, les unités de comptes devraient maintenir le cap d’autant plus que les marchés « actions » demeurent pour le moment bien orientés.
Contact presse
Philippe Crevel : 06 03 84 70 36
pcrevel@gmail.com
Le Coin des Epargnants du 22 janvier 2021 : la mer se creuse
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 22 janvier 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 559,57 | -0,93 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 30 996,98 | +0,58 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 550,09 | +4,24 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 13 906,67 | +0,86 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 695,07 | -0,60 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 602,41 | +0,08 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 631,45 | +0,39 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 606,75 | +1,13 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,281 % | +0,039 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,514 % | +0,030 pt | -0,550% |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,091 % | -0,003 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2167 | +0,78 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 857,000 | +1,65 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 55,390 | +1,04 % | 51,290 |
La mer se creuse
Si les indices ont faiblement évolué durant la semaine, une certaine nervosité point chez les investisseurs face à l’accumulation des mauvaises nouvelles. La multiplication et la diffusion des variants fait craindre un prolongement de l’épidémie et surtout la remise en cause de son éradication par la vaccination. La menace d’une nouvelle récession au cours du premier semestre est de plus en plus prise au sérieux. Les valeurs liés aux loisirs et aux transports pâtissent du couvre-feu, des menaces de reconfinements et de la non-réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski. Les difficultés de Pfizer dans la distribution des vaccins est également un sujet d’inquiétude. Les chefs d’Etats et de gouvernements européens, réunis hier soir en téléconférence, ont prévenu qu’à cause des souches mutantes du virus, plus contagieuses, les restrictions allaient durer plus longtemps. Ils ont par ailleurs mis en garde contre un durcissement des mesures actuelles.
Les indicateurs économiques PMI composite (industrie et services) sont orientés pour la zone euro à la baisse et sont nettement repassés en-dessous de 50 qui marque la frontière entre récession et expansion. Ces indicateurs réalisés par sondages dans les entreprises auprès des directeurs d’achat sont ainsi tombés à 47,5 points en janvier, contre 49,1 en décembre. « Une récession en double creux pour l’économie de la zone euro paraît de plus en plus inévitable, le renforcement des mesures de restriction face au Covid-19 ayant continué de peser sur les entreprises en janvier », a souligné Chris Williamson, l’économiste d’IHS Markit.
Aux Etats-Unis, malgré l’amplification de l’épidémie, l’économie maintient le cap. Les indices PMI traduisent une accélération de la croissance en janvier tant dans l’industrie (59,1) que dans les services (57,5). Aux Etats-Unis, les doutes concernent l’avenir du plan de 1900 milliards de dollars de Joe Biden. Son adoption nécessite au Sénat une majorité des deux tiers or, les Républicains sont de plus en plus nombreux à ne pas faciliter le travail de la majorité démocrate. Pour contourner l’obstruction, le nouveau Président risque de devoir se résoudre à enclencher le processus de réconciliation qui ne peut être utilisé qu’une seule fois par an concernant les questions relatives aux dépenses, recettes fiscales et au dépassement du plafond de la dette.
L’indice Nasdaq des valeurs technologiques a fait cette semaine cavalier seul en progressant de plus de 4 %, preuve que le contexte demeure porteur pour les GAFAM et consœurs.
BCE, statuquo monétaire sur fond de politique accommodante
Depuis le début de la pandémie, la Banque Centrale Européenne a décidé la mise en place d’une enveloppe d’intervention de 2 500 milliards d’euros (1 850 milliards d’euros liés à la crise de la covid619, le reste provenant de programmes préexistants). Cette enveloppe est censée être dépenses d’ici le mois de mars 2022. Au début du mois de janvier, un peu moins de la moitié a été utilisée, essentiellement à travers l’achat de titres obligataires des Etats européens. Lors de sa réunion du 21 janvier, le conseil de politique monétaire n’a pas décidé de nouvelles mesures estimant que la situation, pour le moment, ne l’exigeait pas. Lors de la conférence de presse, Christine Lagarde, la Présidente de la BCE, a rappelé que toute l’enveloppe n’avait pas vocation à être dépensée. Néanmoins, l’objectif de la BCDE est de maintenir des « conditions de financement favorables ». Les taux restent toujours à des niveaux historiquement bas. Ainsi, l’Etat a pu, en France, émettre une obligation à un an à -0,6 %. La région Auvergne – Rhône – Alpes a également réalisé une émission obligataire de 20 millions d’euros un taux négatif sur dix ans. En moyenne, les entreprises empruntent à un taux de 1,5 %, et les ménages à 1,35 %. De quoi leur permettre de s’endetter pendant la crise, sans ajouter un trop lourd fardeau sur leurs épaules.
En ce début d’année, le contexte économique demeure pour Christine Lagarde déflationniste avec un taux d’inflation pour la zone euro de -0,3 %. Une possible longue période de faible inflation doublée d’une stagnation économique est crainte par les autorités monétaires. Face à ce risque, la présidente de la BCE demande aux gouvernements de maintenir leurs plans de soutien à l’économie. Elle souhaite également l’accélération de la mise en œuvre du plan européen de 750 milliards d’euros, intitulé « Next Generation ». Les modalités d’application de ce plan n’ont été approuvées qu’en décembre 2020, en raison de l’opposition de la Hongrie et de la Pologne.
Chine, un petit résultat qui en dit long
Ironie de l’histoire, la Chine est le seul grand pays à avoir enregistré une augmentation de son PIB en 2020 tout en étant à l’origine de la plus grande épidémie de ces cent dernières années. Selon les premiers résultats communiqués par les autorités chinoises, le taux de croissance a atteint, en 2020, 2,3 %. Bien que positif, ce taux est néanmoins le plus faible de ces 40 ans dernières années. Au cours du premier trimestre 2020, le PIB s’était contracté de 6,8 %. Quand les pays occidentaux étaient en plein confinement, au deuxième trimestre, la Chine a connu une vive reprise avec une croissance de plus de 11 %. La croissance au troisième avait été plus faible, +2 %, mais avait suffi à effacer les stigmates économiques de l’épidémie. Au dernier trimestre, le taux de croissance a atteint 6,5 % soit son niveau de pré-pandémie.
Le Livret A, 2020, une année en or sur fond de crise sanitaire
Avec une collecte de 26,39 milliards d’euros, le Livret A signe sa deuxième plus forte collecte de son histoire après celle de 2012 (28,16 milliards d’euros). Si en 2012, le relèvement du plafond du Livret A et la crise des dettes souveraines expliquaient cette collecte record, en 2020, l’épidémie de la covid-19 en est évidemment à l’origine.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a bénéficié du même engouement avec une collecte de 8,82 milliards d’euros sur l’année, ce qui constitue également son deuxième meilleur résultat après celui de 2012.
L’encours du Livret A a atteint, en 2020, un nouveau record avec 326,5 milliards d’euros. Il en est de même pour le LDDS avec 121,8 milliards d’euros.
En 2020, les Français ont plébiscité la liquidité et la sécurité dans un contexte de crise exceptionnelle. Ils ont épargné contraint et forcé ne pouvant pas consommer librement. Ils ont également épargné par crainte d’une perte d’emploi ou de revenus. Le Livret A a ainsi joué son rôle traditionnelle de valeur refuge.
Le choix du Livret A ou du LDDS n’obéit pas une logique de rendement mais à une logique de sanctuarisation d’une partie des revenus non consommés. Les Français ont opté pour des placements de court terme. Avec la crise sanitaire, la projection sur le long terme est difficile. L’assurance vie a pâti ainsi de cette priorité donnée au court terme.
Le livret A et le LDSS battus par les dépôts à vue
Le Livret A et le LDDS, malgré leur forte collecte, sont dépassés par un non-placement, les dépôts à vue, pour l’affectation de l’épargne « covid ». Les Français ont, en effet, laissé sur leurs comptes courants, une grande partie de l’argent non consommé. Ce choix est lié toujours à une recherche absolue de liquidité et de sécurité. Il s’explique également par la faible rémunération que procure les placements comme le Livret A et le LDDS.
Un rendement réel nul pour le Livret A en 2020
En 2020, les Français n’ont pas gagné de l’argent avec le Livret A mais ils n’en ont pas perdu contrairement aux trois années précédentes. En effet, le taux moyen de l’inflation a été de 0,5 %, soit le rendement du Livret A. Il en résulte un rendement réel de 0 % !
Décembre, une décollecte de compensation
Après un mois de novembre confiné qui s’était traduit par une forte collecte, +2,4 milliards d’euros, les Français ont puisé, en décembre, dans leur Livret A afin de financer une partie de leurs dépenses de fin d’année. Pour oublier les contraintes imposées par la crise sanitaire, les ménages se sont fait plaisir, de manière néanmoins raisonnée, car la décollecte est modeste au regard des versements effectués les mois précédents. La décollecte n’a été que de 840 millions d’euros. Par ailleurs, le LDDS a bénéficié, de son côté, d’une collecte positive de 1,01 milliard d’euros. Ce dernier étant souvent associé à un compte courant, il a pu compter sur le versement des primes de fin d’année ou du treizième mois.
Le résultat du Livret A pour le mois de décembre 2020 est assez proche de celui constaté les années précédentes. En règle générale, la collecte du dernier mois de l’année est relativement faible en raison des dépenses de fin d’année. Lors de ces dix dernières, trois décollectes ont été enregistrées. En 2019, une décollecte de 1,6 milliard d’euros avait été constatée pour le Livret A.
2021, le Livret A toujours en pointe
Le Livret A restera une valeur refuge de premier choix tant que l’épidémie sera la maitre des horloges. La consommation demeure entravée par les restrictions imposées afin de limiter la diffusion de la covid-19, ce qui conduit les Français à épargner de manière subie. Par ailleurs, le contexte reste anxiogène sur le plan économique favorisant le renforcement de l’épargne de précaution. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne/Amphitéa/AG2R LA MONDIALE réalisée par l’IFOP-CECOP, 68 % Français pensent conserver ou renforcer leur épargne dans les prochains mois. Ce taux atteint 84 % chez les jeunes actifs (25/34 ans) ce qui traduit leur forte inquiétude vis-à-vis de la situation sanitaire et économique.
Un relâchement de l’effort d’épargne de précaution n’interviendra qu’avec le recul de l’épidémie qui sera facilité avec la vaccination de la population. Attendu au cours du second semestre 202, le risque économique conduira néanmoins les Français à conserver un fort volant d’épargne liquide.
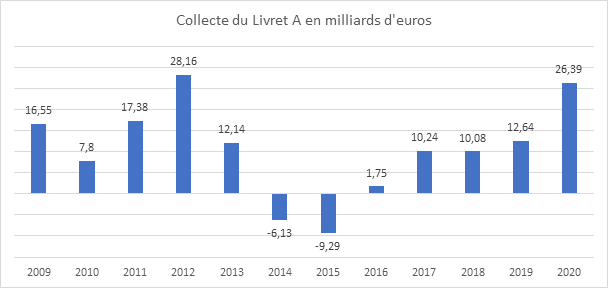
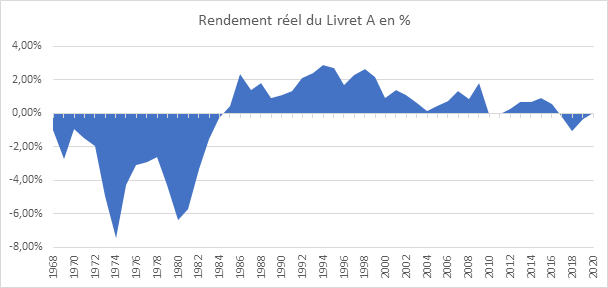
2020, le Livret A plébiscité
Une année en or pour le Livret A sur fond de crise sanitaire
Avec une collecte de 26,39 milliards d’euros, le Livret A signe sa deuxième plus forte collecte de son histoire après celle de 2012 (28,16 milliards d’euros). Si en 2012, le relèvement du plafond du Livret A et la crise des dettes souveraines expliquaient cette collecte record, en 2020, l’épidémie de la covid-19 en est évidemment à l’origine.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a bénéficié du même engouement avec une collecte de 8,82 milliards d’euros sur l’année, ce qui constitue également son deuxième meilleur résultat après celui de 2012.
L’encours du Livret A a atteint, en 2020, un nouveau record avec 326,5 milliards d’euros. Il en est de même pour le LDDS avec 121,8 milliards d’euros.
En 2020, les Français ont plébiscité la liquidité et la sécurité dans un contexte de crise exceptionnelle. Ils ont épargné contraint et forcé ne pouvant pas consommer librement. Ils ont également épargné par crainte d’une perte d’emploi ou de revenus. Le Livret A a ainsi joué son rôle traditionnelle de valeur refuge.
Le choix du Livret A ou du LDDS n’obéit pas une logique de rendement mais à une logique de sanctuarisation d’une partie des revenus non consommés. Les Français ont opté pour des placements de court terme. Avec la crise sanitaire, la projection sur le long terme est difficile. L’assurance vie a pâti ainsi de cette priorité donnée au court terme.
Le livret A et le LDSS battus par les dépôts à vue
Le Livret A et le LDDS, malgré leur forte collecte, sont dépassés par un non-placement, les dépôts à vue, pour l’affectation de l’épargne « covid ». Les Français ont, en effet, laissé sur leurs comptes courants, une grande partie de l’argent non consommé. Ce choix est lié toujours à une recherche absolue de liquidité et de sécurité. Il s’explique également par la faible rémunération que procure les placements comme le Livret A et le LDDS.
Un rendement réel nul pour le Livret A en 2020
En 2020, les Français n’ont pas gagné de l’argent avec le Livret A mais ils n’en ont pas perdu contrairement aux trois années précédentes. En effet, le taux moyen de l’inflation a été de 0,5 %, soit le rendement du Livret A. Il en résulte un rendement réel de 0 % !
Décembre, une décollecte de compensation
Après un mois de novembre confiné qui s’était traduit par une forte collecte, +2,4 milliards d’euros, les Français ont puisé, en décembre, dans leur Livret A afin de financer une partie de leurs dépenses de fin d’année. Pour oublier les contraintes imposées par la crise sanitaire, les ménages se sont fait plaisir, de manière néanmoins raisonnée, car la décollecte est modeste au regard des versements effectués les mois précédents. La décollecte n’a été que de 840 millions d’euros. Par ailleurs, le LDDS a bénéficié, de son côté, d’une collecte positive de 1,01 milliard d’euros. Ce dernier étant souvent associé à un compte courant, il a pu compter sur le versement des primes de fin d’année ou du treizième mois.
Le résultat du Livret A pour le mois de décembre 2020 est assez proche de celui constaté les années précédentes. En règle générale, la collecte du dernier mois de l’année est relativement faible en raison des dépenses de fin d’année. Lors de ces dix dernières, trois décollectes ont été enregistrées. En 2019, une décollecte de 1,6 milliard d’euros avait été constatée pour le Livret A.
2021, le Livret A toujours en pointe
Le Livret A restera une valeur refuge de premier choix tant que l’épidémie sera la maitre des horloges. La consommation demeure entravée par les restrictions imposées afin de limiter la diffusion de la covid-19, ce qui conduit les Français à épargner de manière subie. Par ailleurs, le contexte reste anxiogène sur le plan économique favorisant le renforcement de l’épargne de précaution. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne / Amphitéa / AG2R LA MONDIALE réalisée par l’IFOP-CECOP, 68 % Français pensent conserver ou renforcer leur épargne dans les prochains mois. Ce taux atteint 84 % chez les jeunes actifs (25/34 ans) ce qui traduit leur forte inquiétude vis-à-vis de la situation sanitaire et économique.
Un relâchement de l’effort d’épargne de précaution n’interviendra qu’avec le recul de l’épidémie qui sera facilité avec la vaccination de la population. Attendu au cours du second semestre 202, le risque économique conduira néanmoins les Français à conserver un fort volant d’épargne liquide.
Démographie, 2020, une année hors norme
L’INSEE, dans une étude, a publié, le 19 janvier dernier, les premiers résultats 2020 de la démographique française. Le pays, au 1er janvier 2021 comptait 67 422 000 habitants (65 250 000 résident en métropole et 2 172 000 dans les cinq départements d’outre-mer). La population a augmenté, malgré l’épidémie, de 0,3 % en 2020, comme en 2019. Cette progression est inférieure à la moyenne de 0,4 % par an des années 2014 à 2018.
En 2020, le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, a été de 82 000, ce qui constitue un nouveau point bas sur la période 1945/2020. Il est ne baisse constante depuis 2016. Du fait de la progression du nombre de décès, le solde naturel est pour la première fois inférieur au solde migratoire qui a atteint en 2020, 87 000.Cercle de l’Epargne – données INSEE
Une nouvelle petite baisse des naissances en 2020
Pour la sixième année consécutive, le nombre de naissances a baissé l’année dernière. Il s’est établi à 740 000 bébés, soit 13 000 naissances de moins qu’en 2019 (– 1,8 %). Par rapport à 2014, le recul atteint 79 000 naissances.
Si entre 1990 et 2016, la réduction du nombre de femmes de 20 à 40 ans expliquait, en grande partie, la diminution du nombre de naissances, depuis, le facteur numéro un est la baisse du taux de fécondité. En 2020, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) s’élevait à 1,84 enfant par femme, contre 1,86 en 2019. Cet indicateur est en baisse depuis 2014. Il était proche de 2 entre 2006 et 2014. En étant inférieur à 2,1, cet indicateur souligne que le remplacement des générations n’est plus assuré en France sans l’apport des migrations.
La mortalité infantile reste stable en France à 3,5 pour mille. Depuis 2009, elle ne diminue et oscille entre 3,5 et 3,9.
L’âge moyen à la maternité a atteint 30,8 ans en 2020, contre 29,3 ans vingt ans plus tôt. Le taux de fécondité des femmes de moins de 30 ans baisse depuis les années 2000 et cette diminution s’accentue depuis 2015. En 2020, 100 femmes âgées de 25 à 29 ans donnent naissance à 10,6 enfants, contre 12,9 en 2010 et 13,4 en 2000. La baisse du taux de fécondité des femmes de 30 à 34 ans est plus récente : 12,5 enfants pour 100 femmes en 2020 contre 13,3 en 2010.
La France demeure le pays de l’Union européenne ayant le plus fort taux de fécondité. Ainsi, en 2018, elle devance avec un taux de 1,87 la Suède (1,76), la Roumanie (1,76) et l’Irlande (1,75). Trois pays ont des taux de fécondité inférieurs à 1,3, principalement des pays méditerranéens (Malte, l’Espagne et l’Italie). L’Allemagne, qui appartenait aux pays ayant les plus faibles taux de fécondité dans les années 2000, figure désormais dans la moyenne (ICF de 1,57, contre 1,56 pour l’ensemble de l’UE).
Une progression sans précédent de la mortalité
En 2020, 658 000 personnes sont décédées en France (selon les estimations arrêtées fin novembre 2020, soit 45 000 de plus qu’en 2019.la progression est de 7,3 %. Ce sont les plus de 65 ans qui connaissent un nombre de décès en forte augmentation, +43 000 par rapport à 2019, soit une hausse de 8,3 %.
Avec l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité, le nombre de décès a tendance à augmenter depuis 2014. Ainsi, la hausse annuelle moyenne est de 1,9 % entre 2014 et 2020, contre +0,7 % entre 2004 et 2014.
L’augmentation en 2020 est atypique en raison de la survenue de l’épidémie. Le nombre de décès supplémentaires est supérieur à 40 000 (ce nombre est inférieur aux victimes de la covid-19 car un certaines eussent été amenées à décéder dans l’année d’une autre cause). A titre de comparaison, la canicule de 2003 a provoqué 19 000 décès, la grippe de 2018/2019 10 000 et celle de 2019/2020 4000.
Une baisse de l’espérance de vie en France
En 2020, la pandémie a entraîné une diminution de 0,4 an d’espérance de vie aux femmes et 0,5 an aux hommes. Ainsi, l’espérance des femmes s’lève à 85,2 ans et celle des hommes à 79,2 ans. Cette baisse est deux fois plus marquée qu’en 2015 (respectivement – 0,3 an et – 0,2 an), année qui avait été marquée par une grippe hivernale très meurtrière. Ces dernières années, les gains d’espérance de vie s’étaient ralentis pour les hommes comme pour les femmes : entre 2010 et 2019, soit avant 2020, les femmes avaient gagné 1,0 an contre 1,7 an entre 2001 et 2010 ; pour les hommes, les gains étaient de 1,7 an après 2,6 ans.
En 2020, les espérances de vie à 60 ans baissent également par rapport à 2019 de la même durée que les espérances de vie à la naissance : – 0,4 an pour les femmes, passant de 27,8 ans à 27,4 ans ; et – 0,5 an pour les hommes, passant de 23,4 ans à 22,9 ans.
L’espérance de vie à 80 ans diminue mais dans une moindre proportion, -0,3 an pour les femmes comme pour les hommes. En 2015, la baisse était un peu moins forte et plus marquée pour les femmes (– 0,3 an à 60 comme à 80 ans pour les femmes, – 0,2 an pour les hommes).
Grâce à un taux de fécondité plus élevé que ses partenaires, la France se classe, au sein de l’Union européenne, en deuxième juste après l’Irlande pour le poids des jeunes de moins de 15 ans au sein de la population (respectivement 18,0 % et 20,5 %). Cette part est inférieure à 14 % dans quatre pays (Allemagne, Italie, Malte, Portugal) et elle est de 15,5 % pour l’ensemble de l’Union.
Au 1ᵉʳ janvier 2021, plus d’une personne sur cinq (20,7 %) en France a 65 ans ou plus. Cette part augmente depuis plus de 30 ans et le vieillissement de la population s’accélère depuis le milieu des années 2010, avec l’arrivée à ces âges des premières générations nombreuses nées après-guerre. La France se situe dans la moyenne européenne (20,0 %). Ce ratio varie de 14,1 % en Irlande à 22,8 % en Italie.
L’épidémie a eu raison des mariages
En 2020, de nombreux Français ont renoncé à se marier en raison de l’épidémie. Les restrictions pesant sur les cérémonies ont conduit un nombre important de ménages à annuler ou à reporter leur mariage.
148 000 mariages ont été ainsi célébrés, dont 144 000 entre personnes de sexe différent et 4 000 entre personnes de même sexe. La baisse par rapport à 2019 est de 34,1 %, ce qui constitue un record. Entre mars et avril, presque aucun mariage n’a été célébré. Après le premier confinement, la reprise des célébrations n’a pas permis de compenser la chute ; le nombre de mariages restant inférieur, à la même époque à celui des années précédentes.
En 2020, les femmes se marient en moyenne à 36,4 ans et les hommes à 38,9 ans. Pour les couples de même sexe, l’âge au mariage est de 38,3 ans pour les femmes et de 44,3 ans pour les hommes. Pour la première fois depuis la promulgation de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, le nombre de mariages de femmes est supérieur au nombre de mariages d’hommes.
En 2019, 196 000 pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus, soit 13 000 de moins qu’en 2018. Le nombre de Pacs a augmenté chaque année de 2002 à 2018 à l’exception de 2011, année depuis laquelle les couples ne peuvent plus signer trois déclarations de revenus différentes l’année de leur union. À partir de novembre 2017, la possibilité de contractualiser un Pacs en mairie plutôt qu’au tribunal a pu entraîner un report calendaire de 2017 à 2018 expliquant la forte progression du nombre de Pacs en 2018, tant pour les couples de sexe différent que pour les couples de même sexe.
Le Coin des Epargnants du 16 janvier 2021 : patience, patience
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 15 janvier 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 611,69 | -1,67 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 30 818,68 | -0,90 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 12 998,50 | -1,54 % | 12 870,00 |
| Dax Allemand | 13 787,73 | -1,86 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 735,71 | -2,00 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 599,55 | -1,25 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 519,18 | +1,35 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 566.38 | -0,10 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,320 % | 0,000 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,544 % | -0,022 pt | -0,550% |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,094 % | -0,025 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2081 | -1,14 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 828,370 | -1,11 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 55,040 | -2,08 % | 51,290 |
Des marchés chafouins
Le CAC 40 a perdu 1,7 % cette semaine, après deux semaines consécutives de hausse. Tous les autres grands indices ont également cédé du terrain, y compris le Dow Jones et le Nasdaq. Si le plan de relance de 1900 milliards de dollars dévoilé par Joe Biden a été bien accueilli, il avait été largement intégré dans les cours. Ce plan est apparu d’autant plus justifié avec la diminution des ventes au détail aux Etats-Unis de 0,7 % en décembre, la contraction inattendue de l’indice Empire Manufacturing de la Fed de New York, ainsi que la baisse de confiance du consommateur.
Le plan de Joe Biden comprend de nombreuses dépenses supplémentaires dont, l’aide directe aux Américains portée de 600 à 2 000 dollars, et le montant du salaire minimum fédéral plus que doublé à 15 dollars de l’heure. Un autre plan de soutien, centré sur le changement climatique et les infrastructures, devrait être présenté au mois de février.
Cette semaine, les cours « actions » ont été eux aussi orientés à la baisse en raison de la résurgence de la pandémie de coronavirus en Chine et du durcissement des restrictions sanitaires en Europe, notamment en Allemagne et en France.
L’écart entre les taux d’intérêt allemand et ceux des Etats-Unis pour les titres de dettes souveraines reste important, plus de 1,3 point. Cet écart peut révéler un pessimisme des investisseurs vis-à-vis de l’économie allemande et plus globalement européenne. Il peut être aussi la traduction d’une baisse de la prime de risque en Europe en raison du soutien apporté par la Banque centrale et d’une plus grande maitrise budgétaire qu’aux Etats-Unis.
Pourquoi les États-Unis l’emportent sur l’Europe ?
Le marché des actions est soutenu par les taux d’intérêt bas, l’augmentation des liquidités générée par les rachats d’obligations par les banques centrales, ainsi que par les plans de relance des gouvernements censés doper la croissance et donc les résultats des entreprises. Par ailleurs, dans le cadre des plans de soutien à l’économie, ces dernières ont bénéficié d’un accès privilégié à des ressources à faibles coûts (Prêts Garantis par l’État).
Les taux d’intérêt des obligations d’État à 10 ans sont passés en-dessous de 0 % en 2020 pour l’ensemble de la zone euro quand ils s’élevaient à 5 % en 2002. Sur la même période, la base monétaire est passée de 500 à 5 000 milliards d’euros, provoquant un important flux de liquidités réinvesti en partie dans les actions. La diminution de l’aversion aux risques avec les annonces concernant les vaccins et les plans de relance, contribue à l’envolée du cours des actions. Ces différents facteurs ainsi que l’anticipation du retour de la croissance ont permis aux indices d’effacer la chute du mois de mars dernier. L’indice européen Eurostoxx 50 n’est plus qu’à 4 % de son niveau de l’année dernière. Le Daxx allemand est près de 4 points au-dessus de son niveau de 2020. Les indices français, espagnol et italien sont en retrait (respectivement -6 %, -12 % et -5,6 % au 12 janvier 2021) en raison de la plus forte exposition des économies de ces pays à la crise sanitaire. Néanmoins, ils ont comblé une grande partie des pertes enregistrées lors du premier confinement.
Même si depuis le mois d’avril dernier, les marchés européens ont connu une vive progression, elle demeure faible par rapport à ceux des autres marchés, à savoir américains et émergents. En un an, l’indice des valeurs technologiques américaines a gagné plus de 40 %, le S&P 500, plus de 15 % et le Dow Jones, plus de 7 %. Depuis 2009, l’indice Nasdaq a été multiplié par plus de 6, celui de S&P 500 par plus de 3 quand l’Eurostoxx n’a progressé que de 0,3 %. Les indices chinois progressent également plus que. les indices européens. Les résultats décevants en Europe proviennent de deux handicaps de la zone euro par rapport aux États-Unis ou aux pays émergents. Par rapport aux États-Unis ou à la Chine, les sociétés technologiques jouent un moindre rôle. Or ces sociétés sont celles dont la valeur boursière augmente le plus vite. Les entreprises technologiques représentent plus de 27 %,des indices américains contre 10 % au sein de la zone euro. A contrario, les valeurs financières, sous-appréciées depuis la crise financière de 2009, ont un poids plus élevé en Europe qu’aux États-Unis. Les valeurs liées au secteur touristique et aux transports sont également plus importantes dans les indices européens que dans ceux des pays émergents ou aux États-Unis. Or, ces dernières valeurs sont évidemment à la peine depuis le mois de mars 2020. Les indices européens sont également pénalisés par la faiblesse de la croissance potentielle. Celle-ci est de 4 % au sein des pays émergents, de 2 % aux États-Unis contre 1 % pour la zone euro (ces données ayant été calculés avant l’épidémie). L’écart de croissance incite les investisseurs à opter pour des placements hors d’Europe. La croissance potentielle de la zone euro est handicapée par les faibles gains de productivité et par la diminution depuis 2012 de sa population active, baisse qui se poursuivra et s’amplifiera jusqu’en 2040.
Sans rebond de la productivité, l’écart entre les actions européennes et celles des États-Unis ou des pays émergents devrait s’accroître d’autant plus quand le soutien monétaire s’estompera. L’Europe a donc l’obligation de restaurer assez rapidement sa croissance potentielle en investissant sur les prochains secteurs porteurs.
Quand les taux d’intérêt sont inférieurs à la croissance
94 % des titres de dettes émises avant la crise sanitaire avaient des taux inférieurs à la croissance. Les obligations souveraines, les obligations d’entreprises Investment grade, et les crédits aux entreprises et aux ménages sont concernés. Seules échappent à ce phénomène les obligations High Yield (obligation à haut rendement). Quand les taux sont inférieurs à la croissance, la solvabilité des emprunteurs s’améliore étant donné que la dette croît moins vite que les revenus. Il est également impossible de calculer la valeur fondamentale d’un actif, puisque la somme actualisée des revenus futurs procurés par la détention de l’actif tend vers l’infini quand la prime de risque correspondant à l’actif n’est pas suffisamment élevée. Cela rend complexe l’échelonnage de tous les actifs, actions comprises. La première des conséquences est une forte augmentation de la dette publique qui est passée, au sein de l’OCDE, de 75 % à 130 % du PIB de 2002 à 2020 avec une hausse de 20 points sur la dernière année. La dette privée a connu une évolution similaire. Elle atteint 165 % du PIB au sein de l’OCDE contre 135 % du PIB en 2002. Les dettes privées avaient connu une forte expansion entre 2002 et 2008 avant la crise financière en dépassant 150 % du PIB avant de revenir à 140 % du PIB en 2018. Les pouvoirs publics sont ainsi incités à accroître leur déficit public.
Avec la crise sanitaire, les entreprises se sont fortement endettées en lien avec les programmes de soutien mis en œuvre par les pouvoirs publics. En revanche, la dette High Yield est stable autour de 17 % du PIB au sein de l’OCDE. Un taux d’intérêt faible aboutit à une surcapitalisation de l’économie conduisant à une productivité marginale du capital trop faible. Cette situation encourage les investissements non rentables pénalisant ainsi la croissance. Néanmoins, il est à noter que l’augmentation de l’endettement n’a pas d’effet sur l’investissement qui reste étale autour de 21 % du PIB depuis 2012. Au sein de l’OCDE, le taux d’épargne depuis 2008 est constamment supérieur de deux ou trois points à celui de l’investissement. L’excès d’épargne permet le financement des déficits publics et les investissements en-dehors des États membres de l’OCDE où le taux de rendement y est supérieur. Par voie de ricochet, les taux d’intérêt inférieurs à la croissance provoquent une forte hausse des indices boursiers ; ces derniers ont été multipliés par trois au sein de l’OCDE de 2002 à 2020, avec un risque de constitution d’une bulle, les cours des actions apparaissant décorrélés de la croissance économique.
Le Coin de l’Epargne du 8 janvier 2021 : toujours plus haut
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 8 janvier 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 5 706,88 | +2,80 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 31 097,97 | +1,61 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 13 201,98 | +2,43 % | 12 870,00 |
| Dax Allemand | 14 049,53 | 2,41 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 873,26 | +6,39 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 3 645,05 | +2,60 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 139,03 | +2,53 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 570,11 | +1,92 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,320 % | -0,016 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,522 % | +0,028 pt | -0,550% |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,114 % | +0,188 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2257 | +0,35 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 858,060 | -1,15 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 55,350 | +7,08 % | 51,290 |
Les marchés sentent le vent du large
Les marchés « actions » avec l’accélération des plans de vaccination, l’arrivée prochaine de Joe Biden à la Présidence des Etats-Unis et la mise en place des plans de relance ont connu une semaine de fortes hausses. Les indices américains ont battu de nouveaux records. Le CAC 40 a dépassé pour la première fois depuis le premier confinement les 5 700 points. La remontée des taux d’intérêt a entraîné celle des valeurs financières L’indice londonien, le Footsie, a gagné, de son côté, plus de 6 % grâce à la signature de l’accord commercial avec l’Union européenne.
Aux Etats-Unis, l’envahissement du Congrès par des partisans de Donald Trump n’a pas eu de conséquences négatives sur les marchés « actions ». Les investisseurs ont plutôt plébiscité la victoire des démocrates en Géorgie offrant à ces derniers une courte majorité au Sénat. Le basculement de la chambre haute facilitera la mise en œuvre du programme de relance de Joe Biden. Ce programme devant se traduire par une augmentation des dépenses publiques et donc de l’endettement a conduit à une hausse des taux d’intérêt américains. Le taux de l’obligation de l’Etat américain à 10 ans est ainsi repassé au-dessus de 1 %. Pour retrouver un tel taux, il fallait remonter au 1er mars dernier. Le pétrole a enregistré de son côté une progression de plus de 7 % porté par les espoirs d’une reprise prochaine de l’économie mondiale et par la décision de l’Arabie saoudite de réduire sa production.
Plus de 40 000 dollars le bitcoin
En ce début du mois de janvier, en quelques jours, le bitcoin a franchi la barre des 30 000 puis des 40 000 dollars (41 550 dollars vendredi 8 janvier à 18 heures). Le bitcoin est la plus célèbre des cryptomonnaies. En 2019, plus de 2400 cryptomonnaies étaient en circulation parmi lesquelles figuraient l’etherum, le ripple, le cardano, le litecoin, le NEM, le NEO, ou le Stellar.
Le bitcoin est, selon la Banque de France, « un actif virtuel stocké sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs l’acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale ». L’idée de bitcoin est née lors de la crise de 2008. Elle fut présentée pour la première fois en novembre 2008 par une personne, ou un groupe de personnes, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le code source de l’implémentation de référence fut quant à lui publié en 2009. La création et la gestion des bitcoins utilisent des techniques issues des blockchain. Les bitcoins sont créés conformément à un protocole qui rétribue les agents (appelés « mineurs »). Ces agents mettent à contribution la puissance de calcul de leurs ordinateurs afin de vérifier, de sécuriser et d’inscrire les transactions dans un registre virtuel. Le coût de minage augmente au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de bitcoins en circulation. Les mineurs reçoivent en dédommagement une partie de bitcoins qu’ils ont contribué à créer. Le nombre de bitcoin a été plafonné à 21 millions. Il en resterait trois millions à produire mais le coût de production est croissant avec l’émission.
Les bitcoins peuvent être achetés en ligne sur des plateformes spécialisées et sur des bornes physiques. Ils peuvent être obtenus dans le cadre d’échanges de biens ou de services. Le bitcoin fait l’objet par ailleurs d’une cotation en temps réel. Les crypto-monnaies sont acceptés comme moyen de paiement sur certains sites Internet. Des commerçants dans des pays d’Europe du Nord acceptent d’être pays en bitcoins. A Vancouver, à Berlin sur la côte Ouest des États-Unis, le paiement des loyers en bitcoins est possible pour certains logements.
Le bitcoin n’est pas une monnaie. Il n’a pas de cours légal et il évolue sur un marché non réglementé par une banque centrale. Les agents économiques peuvent le refuser comme moyen de paiements. Pour ses initiateurs, le fait d’être en-dehors des circuits monétaires classiques est un atout et un gage d’indépendance par rapport aux pouvoirs publics et au secteur financier. Son caractère hautement spéculatif, l’absence de transparence l’empêche tout à la fois d’être une réelle valeur de réserve et un étalon monétaire.
Les montagnes russes du bitcoin
Le cours du bitcoin ressemble aux montagnes russes. En un an, son cours a progressé de plus de 250 % passant de 8000 à plus de 40 000 dollars. De 2012 à 2016, le bitcoin s’échangeait autour de 500 dollars avant de connaître une appréciation en 2017, 19 500 dollars en décembre 2017. La cryptomonnaie connût alors une chute au point qu’en janvier 2019, son cours était d’un bitcoin contre 3900 dollars.
En 2020, les marchés de cryptomonnaies ont été portés par la crise sanitaire et de la défiance que génère la monétisation des dettes publiques. Face à l’augmentation de la masse monétaire, multipliée par deux en dix ans, certains estiment qu’il convient de se protéger de l’inflation et d’une dépréciation monétaire. D’autres considèrent que les cryptomonnaies permettent de s’affranchir des Etats et des banques centrales. La dépréciation du dollar de ces derniers mois joue en faveur de la progression du cours du bitcoin. Par ailleurs, le lancement d’un service d’achat, de vente et de paiement par cryptomonnaie par l’entreprise des paiements en ligne PayPal a conforté la première des cryptomonnaies qui en 2019 avait été déjà accepté comme moyen de paiement par Airbnb. Dernièrement, certains institutionnels ont annoncé avoir investi sur le bitcoin, favorisant sa hausse. Sur un marché étroit, l’arrivée de quelques banques influent sur les cours. L’encours du bitcoin ne représente que 600 milliards de dollars quand la capitalisation boursière de l’or dépasse 9000 milliards de dollars et la masse monétaire de l’OCDE plus de 25 000 milliards de dollars. La rareté du bitcoin et le plafonnement des émissions sont évidemment un facteur qui contribue à la progression de son cours.
Le bitcoin, un mirage ou un nouvel eldorado
Le bitcoin tend à se parer des habits d’une valeur refuge. Pour autant, il souffre de son mode de création plafonné et exogène aux évolutions économiques. Il est un actif hautement spéculatif. Son instabilité l’empêche de jouer pour le moment un rôle d’étalon et de monnaies. L’émission d’une monnaie est logiquement corrélée à l’activité. Dans le passé, les arrivées soudaines d’or en provenance des Indes ont ruiné l’Espagne et le Portugal.
L’idée que le bitcoin pourrait jouer le rôle de la bonne monnaie si la monétisation des dettes publiques se perpétuait est néanmoins avancée par certains. En vertu du théorème de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Quand deux monnaies dans un pays circulent, l’une considérée comme bonne par le public et l’autre comme mauvaise, les agents économiques préfèrent thésauriser la bonne monnaie et utiliser la mauvaise pour payer leurs échanges dans le but de s’en défaire au plus vite. Ce phénomène aboutit alors à une inflation généralisée et à une dépréciation de la mauvaise monnaie. Quand la mauvaise monnaie est fuie par un nombre croissant d’agents économiques, elle est abandonnée au profit de la bonne.
Face à ce danger, les banques centrales surveillent avec attention le développement des cryptomonnaies. Elles ont réussi avec l’aide des gouvernements à bloquer l’essor du libra de Mark Zuckerberg qui s’inspirait des droits de tirage spéciaux du FMI. Les banques centrales réfléchissent également à la mise en place de monnaies digitales pour éviter d’être dépossédées, le moment venu, de leurs pouvoirs.
La moitié des salariés du privé ont accès à l’épargne salariale en France
En 2018, 50,9 % des salariés du secteur privé (hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales) ont eu accès à au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise – PEE, ou plan d’épargne retraite collectif – Perco). Par rapport à 2017, la hausse est de 1 %. La progression de l’épargne salariale était, ces dernières années faibles. Le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a pris ou fait adopter plusieurs mesures visant à relancer en particulier au sein des PME l’épargne salariale. Parmi ces mesures figurent l’allègement ou la suppression du forfait social.
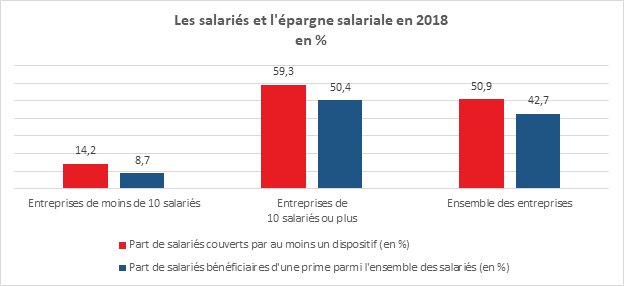
Le PEE reste le dispositif le plus répandu avec 42,9 % des salariés couverts en 2018 qui est alimenté à 68 % par l’intéressement et la participation. 38,2 % des salariés ont bénéficié de versements issus de la participation et 32,6 % dans le cadre de l’intéressement. 4,1 millions de salariés (23 % de l’ensemble des salariés) avaient un PERCO en 2018.
Stabilité pour la rémunération des livrets en France
Au mois de novembre, selon la Banque de France, le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés s’élevait à 0,12 % comme en octobre. Le taux moyen de rémunération de l’ensemble des dépôts bancaires est de 0,46%. Il est inchangé depuis août 2020.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires,
| nov- 2019 | sep-2020 | oct- 2020 (e) | nov- 2020 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,58 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Ménages | 0,83 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,71 | 0,57 | 0,55 | 0,54 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,28 | 1,06 | 1,05 | 1,03 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,63 | 2,62 | 2,62 |
| SNF | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,16 |
| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,13 | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,40 | -0,49 | -0,51 | -0,52 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,43 | -0,60 | -0,65 | -0,65 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Amélioration du moral des ménages avec le déconfinement
Avec la réouverture des commerces non essentiels, le moral des ménages s’est grandement amélioré. L’indicateur de l’INSEE qui le mesure a gagné, en décembre dernier, six points par rapport à novembre, et retrouve son niveau de septembre. À 95, il demeure néanmoins en dessous de sa moyenne de longue période (100).
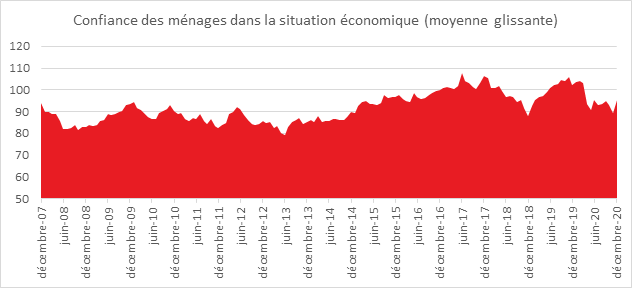
Les achats dopés par les fêtes de fin d’année
En décembre, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants a augmenté. Le solde correspondant gagne quinze points par rapport au mois précédent. Il dépasse sa moyenne de longue période, pour la première fois depuis février 2020. Après un mois de confinement, les ménages ont été amené à concentrer sur décembre leurs achats pour les fêtes de fin d’année.
Des ménages confiants sur leur situation financière
Contrairement à quelques idées reçues, les ménages estiment que leur situation financière actuelle et à venir est plutôt bonne. Le soutien des pouvoirs publics semble ainsi payé ses fruits. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future a ainsi augmenté de neuf points et dépasse sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée gagne quant à lui deux points et demeure supérieur à sa moyenne de longue période.
La part des ménages considérant que le niveau de vie en France s’améliorera au cours des douze prochains mois augmente très fortement, après avoir chuté en octobre et novembre, le solde correspondant gagne vingt points mais demeure néanmoins très en dessous de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois est stable. Le solde correspondant se situe en dessous de sa moyenne de longue période.
En 2020, le pouvoir d’achat des Français serait à peine érodé par la crise malgré un recul de 10 points de PIB.
Plus de dépenses et donc moins d’épargne
En décembre, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est en baisse. L’indicateur de l’INSEE perd huit points mais reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période. Les ménages en fin d’année sont en règle générale en mode « dépenses » et donc moins portés à épargner. Néanmoins, l’objectif de maintenir un volant d’épargne pour faire face à d’éventuelles difficultés demeure. Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future gagne quatre points. Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle est également en hausse (+2 points). Les deux soldes se maintiennent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.
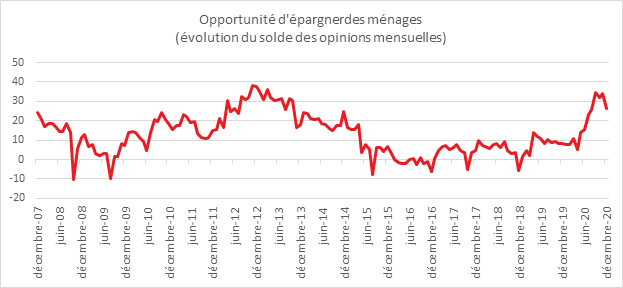
La crainte du chômage est en baisse
Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage baissent nettement en décembre. Le solde correspondant perd neuf points mais demeure depuis avril 2020 très au-dessus de sa moyenne de longue période.
La peur de l’inflation est en recul
En décembre, les ménages estimant que les prix augmenteront au cours des douze prochains mois sont nettement moins nombreux qu’en novembre.
Vive 2021 !
L’équipe du Cercle vous souhaite une très belle année 2021 !

2020, les marchés en mode yo-yo face à la crise sanitaire centennale
Les marchés « actions », valeurs refuges ?
Les indices « actions » ont connu une évolution inattendue en 2020 au regard du contexte économique. Après le choc provoqué au mois de mars dernier par l’instauration des confinements dans la grande majorité des Etats occidentaux, entraînant une chute des cours de 30 %, les investisseurs ont repris le chemin des actions assez rapidement. L’annonce des plans de relance, le soutien inconditionnel des banques centrales et la découverte des vaccins ont conduit à un solide rebond boursier. Dans un monde de taux négatifs, les actions sont devenues un pôle de rendements. Les pertes du printemps ont été ainsi progressivement compensées. Les indices américains ont, à plusieurs reprises, battu leur record historique.
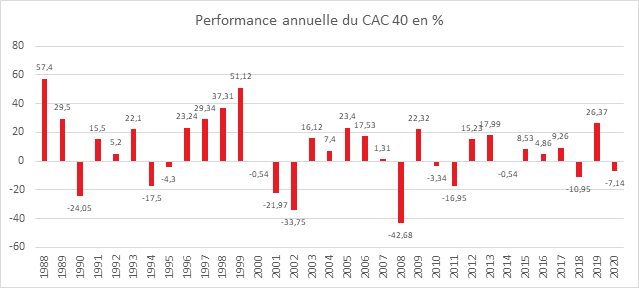
La France, l’Italie et l’Espagne étant les pays les plus touchés sur le plan économique avec la mise en sommeil des activités touristiques, leurs indices « actions » n’ont pas réussi à repasser en territoire positif. Le CAC 40 a cédé sur l’année 7,2 % quand le DAXX allemand en gagnait plus de 3 %. L’indice milanais FTSE MIB Index a perdu 6,2 % sur l’ensemble de l’année. L’indice de référence espagnol a, de son côté, reculé, sur un an de 15,17 %. L’indice Footsie londonien a connu également un net recul, plus de 14 %, cumulant les effets de l’épidémie et du Brexit. Il s’agit de son plus fort recul de la récession de 2008.
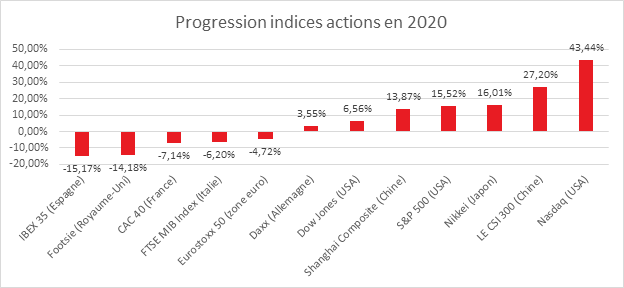
Le marché parisien a été pénalisé par le poids des valeurs dépendant de l’aéronautique et du tourisme et le nombre réduit des valeurs technologiques au sein des quarante premières capitalisations Par ailleurs, les valeurs financières sont toujours à la peine en raison des taux négatifs. Même si la deuxième vague de l’épidémie est plus sévère en Allemagne, ce pays s’en est mieux sortie au niveau économique que la France, en maintenant un bon niveau d’exportation.
Les valeurs technologiques ont été les grandes gagnantes avec celles du secteur de la santé. Le NASDAQ a accumulé les records durant l’année. Sur un an, cet indice a gagné plus de 40 %.
Le bitcoin supplantera-t-il l’or ?
La bitcoin qui avait pris son envol après la crise de 2008 a connu une appréciation sans précédent en 2020 en gagnant par rapport au dollar plus de 250 %. Il s’échangeait en fin d’année à plus de 28 000 dollars (contre 8000 dollars début janvier 2020). Des investisseurs ont misé sur cette cryptomonnaie soit pour réaliser des gains rapides, soir pour se prémunir d’un éventuel retour de l’inflation ou dans la perspective de son essor comme moyen de paiement courant. La hausse du bitcoin a coïncidé avec la baisse de l’or et du dollar lors du dernier trimestre 2020. L’or a malgré tout joué son rôle de valeur refuge en 2020 en dépassant 2060 dollars l’once. Sur l’année, il a gagné plus de 25 %. Depuis le mois d’août, le métal précieux est en baisse. Les annonces concernant les vaccins et les perspectives de croissance ont joué en sa défaveur. Il convient de souligner que le marché du bitcoin reste modeste avec un encours de 500 milliards de dollars quand la capitalisation boursière de l’or dépasse 9000 milliards de dollars.
Le dollar en recul par rapport à l’euro
Sur le marché des changes, l’euro s’est apprécié par rapport au dollar de plus de 9 % en un an. Malgré des taux d’intérêt bien plus faibles en Europe, l’euro a gagné des points face au dollar. Les tergiversations des autorités américaines face à l’épidémie et le recours massif à l’endettement avec un déficit budgétaire de plus de 15 % du PIB ont contribué à cette baisse du dollar.
Des taux une nouvelle fois historiquement bas et des dettes publiques historiquement élevées
L’année 2020 aura été marquée par une nouvelle baisse des taux d’intérêt qui, une nouvelle fois, en Europe ont battu des niveaux historiques en territoire négatif. L’Etat français s’est endetté à taux négatif sur l’ensemble de l’année, ce qui a lui permis de réduire le coût de la dette tout en empruntant un montant sans précédent, 260 milliards d’euros. En 2021, le Ministère de l’Economie prévoit d’emprunter à nouveau 260 milliards d’euros sur les marchés. Ce montant permettra de financer un déficit qu dépassera 152,8 milliards d’euros, en recul de 54 milliards par rapport à 2020. A ce déficit s’ajoutent 127,3 milliards de remboursements d’obligations d’Etat arrivant à échéance, et 1,3 milliard de dette de la SNCF reprise par l’Etat. La dette de l’Etat qui était de 98 % du PIB fin 2019 est désormais proche de 120 % du PIB. La plupart des pays occidentaux ont accru leur dette publique de 15 à 25 points de PIB pour faire face à la crise économique générée par l’épidémie.
Le pétrole en mode montagnes russes
Le baril de pétrole (BRENT) a connu les montagnes russes en 2020 passant de 65 à 17 dollars de janvier à avril pour terminer en fin d’année au-dessus de 50 dollars. Sur les marchés à terme, son prix a été durant la première vague de covid négatif. L’accord de régulation de la production associant l’OPEP et la Russie ainsi que les espoirs de reprises expliquent le rebond du second semestre. Sur l’année, le baril de BRENT cède néanmoins plus de 20 %.
Les changements en 2021 pour la retraite
Revalorisation des pensions de 0,4 %
Au 1er janvier 2021, les pensions de base versées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse sont revalorisées de 0,4 %. Cette revalorisation concerne à la différence de 2020 toutes les pensions quels que soit leur montant.
La valeur d’un trimestre en 2021
Dans le secteur privé, pour valider un trimestre, il faut gagner l’équivalent de 150 heures payées au SMIC. En valeur horaire ce dernier passe à 10,25 euros bruts à compter du 1er janvier 2021 (hausse de 0,99%). Ainsi, un salaire de 1.537,50 euros bruts permet de valider un trimestre de cotisation vieillesse en 2021, contre 1.522,50 euros bruts en 2020. Pour se voir octroyer une annuité complète de cotisation, soit quatre trimestres dans l’année, une rémunération annuelle brute d’au moins 6 150 euros (1.537,50 x 4) est nécessaire en 2021.
Les plafonds de réversion actualisés
Les pensions de réversion sont attribuées aux conjoints survivants sous condition de ressources dans les régimes de retraite de base du secteur privé. Les revenus annuels du veuf ou de la veuve ne doivent pas excéder 2 080 fois le SMIC horaire, soir 21 320 euros en 2021, contre 21 112 euros en 2020). Si le veuf ou la veuve vit en couple, le plafond annuel de ressources du ménage ne peut dépasser 1,6 fois le plafond exigé pour une personne seule, soit 34 112 euros en 2021.
Le plafond du minimum contributif
Dans le secteur privé, les assurés qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) et qui disposent du nombre de trimestres de cotisation demandé dans leur génération bénéficient du minimum contributif (ou MICO). Ce dispositif garantit aux retraités un montant plancher de pensions. Si le revenu cumulé des pensions de base et complémentaires n’atteint pas ce plafond, le minimum contributif vient le compléter a du concurrence. En 2021, le montant plafond est de 1203,35 euros, contre 1 191,57 euros en 2020. Ce montant est indexé sur le SMIC.
Le cumul minimum vieillesse-activité
Depuis le 1er janvier 2015, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), qui a remplacé le minimum vieillesse, sont autorisés à la cumuler avec un revenu d’activité. Le montant cumulé ne peut être supérieur à 0,9 fois le SMIC pour un célibataire et à 1,5 fois le SMIC pour une personne vivant en couple, soir respectivement, pas mois à compter du 1er janvier 2021, 1 399,12 euros et 2 331,87 euros.
L’assurance volontaire des parents au foyer
Les pères ou les mères qui ne travaillent pas pour élever leurs enfants ont la possibilité de cotiser volontairement à la retraite via l’Assurance volontaire des parents au foyer (AVPF). La cotisation due au titre de l’AVPF est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente, soit 10,25 euros. L’assiette forfaitaire mensuelle applicable en 2021 au titre de l’AVPF s’élève donc à 1 715,35 euros.
L’assurance volontaire des chargés de famille
Les parents chargés de famille qui ne sont pas affiliés à un régime de retraite obligatoire peuvent, sous certaines conditions, s’assurer contre ce risque. Leur assiette trimestrielle de cotisation est égale à 507 fois le SMIC horaire , soit 5 197 euros en 2021.
Le montant de déduction fiscale pour l’épargne pour 2021
Les plafonds de déduction pour l’épargne retraite dépendent du plafond annuel de la Sécurité sociale. Pour le calcul de la formule de 2021, c’est le montant de 2020 qui est pris en compte. Il est à signaler que ce montant restera également en vigueur en 2022 du fait que le plafond annuel de la Sécurité sociale n’a pas été actualisé en 2021. Son montant est de 41 136 euros.
Les cotisations versées en 2021 sur les produits d’épargne retraite peuvent être déduites des revenus perçus en 2021 et déclarés au printemps 2022 dans la limite, au choix, de :
- Dans la limite de 10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale de l’année N-1 soit 4 113 euros ;
- Dans la limite de 10 % des revenus professionnels pris dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale de l’année N-1 soit 32 909 euros.
Le Coin des Epargnants : même en 2020, la trêve des confiseurs est au rendez-vous
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 24 décembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 522,01 | +2,39 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 30 199,87 | -0,05 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 12 804,73 | +0,49 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 587,23 | +2,57 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 502,11 | +0,76 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 543,28 | +2,74 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 26 656,61 | -0,40 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 363.11 | -0,94 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,304 % | +0,031 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,550% | +0,025 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,926 % | -0,012 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2183 | -0,56 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 878,970 | -0,10 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 51,290 | -1,91 % | 66,300 |
Des marchés en pleine trêve des confiseurs
Les investisseurs ont reçu comme cadeau de Noël, l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne mais ils étaient peu nombreux à intervenir jeudi après-midi. La tradition de la trêve de fin d’année est respectée en 2020 malgré la crise sanitaire. Le CAC 40 a néanmoins gagné près de 2,4 % sur la semaine. Le début des campagnes de vaccination en Europe a certainement joué, cette semaine, en faveur des marché actions
Le retour en force de l’épargne subie
Le Livret A, le gagnant du confinement
En novembre, selon la Caisse des Dépôts et Consignations, le Livret A renoue avec une collecte positive qui s’élève à 2,4 milliards d’euros sur fond de deuxième confinement, après la décollecte de 940 millions d’euros en octobre dernier. L’année dernière, la collecte avait été de 610 millions.
Avec le livret de développement durable et solidaire (LDDS), la collecte nette atteint 3,31 milliards d’euros. Ce résultat reproduit ceux constatés durant le premier confinement. Le Livret A bat ainsi son record d’encours datant de septembre dernier à 325,8 milliards d’euros quand celui du LDDS franchit la barre des 120 milliards d’euros (120,2).
Un mois de novembre évidemment atypique
Avec la proximité des fêtes, les paiements des impôts locaux et l’absence de primes, novembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, la collecte avait été négative à six reprises et nulle en 2019. Celle de 2020 égale la collecte de 2012 avec 2,4 milliards d’euros. Il y a huit ans, le relèvement du plafond du Livret A intervenu le 1er octobre expliquait le niveau élevé des versements.
Pour 2020, avec une renonciation forcée à la consommation, le deuxième confinement explique la forte collecte nette. Avec la fermeture des commerces dits non essentiels et la limitation des déplacements, la consommation a baissé, dégageant ainsi des marges en faveur de l’épargne. Cependant, cette collecte a été moins élevée qu’en avril lors du premier confinement (2,4 milliards d’euros contre 5,47 milliards d’euros). La baisse de la consommation a été moins importante en novembre qu’en avril, -15 % au lieu de -30 %, réduisant d’autant les liquidités disponibles.
Une collecte abracadabrantesque, une préférence absolue pour la liquidité et la sécurité
Depuis le début de l’année, les ménages ont placé plus 27,23 milliards d’euros sur leur Livret A (plus de 35,04 milliards d’euros avec le LDDS). Cette collecte abracadabrantesque marque la préférence absolue dans la liquidité et la sécurité. Elle constitue un record absolu sur onze mois d’une même année. Cette collecte est aussi le signe d’une forte anxiété. En mettant sciemment leur argent sur leurs livrets d’épargne, les ménages flèchent et sécurisent une partie de leurs revenus à la différence de ceux laissés sur les comptes courants. Il y a une volonté manifeste à se constituer une réserve pour faire face à la survenue de problèmes d’emploi ou de revenus. Il n’en demeure pas moins que, depuis le début de l’année, les comptes courants sont les grands gagnants de l’épargne « covid » avec un encours qui a progressé de plus de 50 milliards d’euros.
Dans le contexte exceptionnel de 2020, les ménages ne veulent pas s’engager sur le long terme et privilégient donc des produits liquides. Cette priorité pénalise le premier produit d’épargne français, l’assurance vie. Néanmoins, si pour les flux d’épargne, la préférence est donnée au court terme, il n’y a pas de défiance sur le stock, sur les encours d’épargne à long terme. Les sorties, les rachats sur les contrats d’assurance sont dans la moyenne de ces dernières années. Au niveau des actions, à la différence de 2000 (bulle Internet) et de 2009 (crise de subprimes), les épargnants français font preuve de stoïcisme et se sont gardés de toute sortie précipitée. Les faits leur ont donné pour le moment raison, les indices « actions » ayant compensé tout ou partie des pertes subies en mars.
L’assurance vie, un retour à l’équilibre malgré des vents contraires
L’assurance vie signe sa neuvième décollecte de rang en novembre avec -30 millions d’euros. Cette dernière est néanmoins la plus faible enregistrée depuis le début de l’épidémie. Malgré le deuxième confinement, l’assurance vie revient calmement mais sûrement à l’équilibre. Elle fait mieux qu’en octobre qui avait été marqué par une décollecte de 200 millions d’euros.
Lors du premier confinement, les décollectes mensuelles avaient atteint plus de 2 milliards d’euros. Or, en novembre, contrairement à la période mars-mai 2020, les agences n’ont pas fermé, facilitant les opérations sur les contrats. Par ailleurs, le recours à la visioconférence et au téléphone pour réaliser des arbitrages s’est généralisé, expliquant la bonne tenue de l’assurance vie en novembre.
Sur ces dix dernières années, trois décollectes avaient été, enregistrées au mois de novembre, 2011, 2012 et 2017.
Une collecte brute et des prestations stables
La collecte brute reste pour le deuxième mois consécutif au-dessus des 10 milliards d’euros, soit 10,4 milliards contre 10,9 milliards en octobre et 9,4 en septembre. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % ont été placés en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. A la différence des précédentes crises, la part des unités de compte n’a pas varié depuis le mois de mars. Les ménages acceptent de prendre une part de risques supplémentaires dans le cadre de leurs versements effectués sur leur contrat d’assurance
Les prestations sur le mois de novembre sont en léger retrait à 10,5 milliards d’euros, contre 11 milliards d’euros en octobre. Depuis le début de la crise, les prestations évoluent peu, preuve que les assurés restent confiants à l’égard de leur placement.
2020, une année de décollecte pour l’assurance vie
Depuis le début de l’année, le cumul des cotisations en assurance vie s’est élevé, à 103,5 milliards d’euros, soit un recul de près de 30 milliards d’euros (132,8 milliards d’euros sur la même période en 2019). Le montant total des prestations versées est très stable à 110,8 milliards d’euros (109,5 milliards d’euros sur la même période en 2019).
Sur onze mois, la décollecte atteint 7,3 milliards d’euros quand la collecte dépassait 23,3 milliards d’euros sur la même période en 2019. Sauf surprise en décembre, l’assurance vie connaîtra sa plus mauvaise année en 2020. En 2012, la précédente annus horribilis, la décollecte était de 6 milliards d’euros.
L’assurance plie sans rompre
Dans un contexte peu porteur pour les produits d’épargne de long terme, l’assurance vie résiste honorablement. Depuis le début de la crise sanitaire, les ménages privilégient la sécurité et la liquidité, conduisant à une hausse sans précédent du Livret A et des comptes courants. L’assurance vie qui est, par nature, un placement de moyen et de long terme a été naturellement délaissée. En outre, la contrainte d’un versement minimal d’unités de compte peut dissuader certains épargnants. En revanche, la grande stabilité des prestations et des rachats prouve l’absence de défiance à l’encontre du premier placement des ménages dont l’encours a atteint en novembre 1785 milliards d’euros.
Décembre, un tout autre mois
Le dégonflement de la cassette « covid » aura-t-elle lieu en décembre avec les fêtes de fin d’année ? Les premiers indicateurs soulignent une bonne tenue de la consommation. Pour le Livret A, il pourrait en résulter une légère décollecte en décembre mais qui devrait rester modérée, les ménages demeurant prudents. Le niveau élevé des incertitudes ne les incite pas à desserrer fortement et durablement les cordons de la bourse. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne/Amphitéa/AG2R LA MONDIALE réalisée par l’IFOP-CECOP, 68 % Français pensent conserver ou renforcer leur épargne dans les prochains mois. Ce taux atteint 84 % chez les jeunes actifs (25/34 ans), ce qui traduit leur forte inquiétude vis-à-vis de la situation sanitaire et économique. À la question sur ce qu’il faut faire de l’épargne emmagasinée depuis le mois de mars, près des deux tiers des Français (65 %) affirment qu’il faut la conserver en vue de faire face à des difficultés à venir quand seulement 35 % préconisent la consommation. Les ménages français disposant d’importantes liquidités pourraient néanmoins, dans les prochains mois, réaliser des arbitrages surtout si la situation sanitaire et économique se stabilise. L’assurance vie devrait bénéficier de cette normalisation avec une progression de la collecte brute peut être en décembre et plus sûrement en 2021.
L’assurance vie résiste bien au deuxième confinement
L’assurance vie signe sa neuvième décollecte de rang en novembre avec -30 millions d’euros. Cette dernière est néanmoins la plus faible enregistrée depuis le début de l’épidémie. Malgré le deuxième confinement, l’assurance vie revient calmement mais surement à l’équilibre. Elle fait mieux qu’en octobre qui avait été marqué par une décollecte de 200 millions d’euros.
Lors du premier confinement, les décollectes mensuelles avaient atteint plus de 2 milliards d’euros. Or, en novembre, contrairement à la période mars-mai 2020, les agences n’ont pas fermé facilitant les opérations sur les contrats. Par ailleurs, le recours à la visioconférence et au téléphone pour réaliser des arbitrages s’est généralisé expliquant la bonne tenue de l’assurance vie en novembre.
Novembre, un mois traditionnellement calme pour l’assurance vie
Sur ces dix dernières années, trois décollectes avaient été, jusqu’à maintenant, enregistrées au mois de novembre, 2011, 2012 et 2017. Les collectes positives sont durant ce mois tourne autour du milliard d’euros. En 2019, elle avait atteint 1,1 milliard d’euros. Novembre est pour l’assurance vie un mois moyen mais important, les ménages commençant traditionnellement à réaliser leurs arbitrages financiers de fin d’année.
Une collecte brute et des prestations stables
La collecte brute reste pour le deuxième mois consécutif au-dessus des 10 milliards d’euros, 10,4 milliards contre 10,9 milliards en octobre et 9,4 en septembre. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placée en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. A la différence des précédentes crises, la part des unités de compte n’a pas varié depuis le mois de mars. Les ménages acceptent de prendre une part de risques supplémentaires dans le cadre de leurs versements effectués sur leur contrat d’assurance
Les prestations sur le mois de novembre sont en léger retrait à 10,5 milliards d’euros, contre 11 milliards d’euros en octobre. Depuis le début de la crise, les prestations évoluent peu, preuve que les assurés restent confiants à l’égard de leur placement.
2020, une année atypique
Le cumul des cotisations en assurance vie s’est élevé, depuis le début de l’année, à 103,5 milliards d’euros, soit un recul de près de 30 milliards d’euros (132,8 milliards d’euros sur la même période en 2019). Le montant total des prestations versées est très stable à 110,8 milliards d’euros (109,5 milliards d’euros sur la même période en 2019).
Sur onze mois, la décollecte atteint 7,3 milliards d’euros quand la collecte dépassait 23,3 milliards d’euros sur la même période en 2019. Sauf surprise en décembre, l’assurance vie connaîtra sa plus mauvaise année en 2020. En 2012, la précédente année horribilis, la décollecte était de 6 milliards d’euros.
L’assurance plie sans rompre
Dans un contexte peu porteur pour les produits d’épargne de long terme, l’assurance vie résiste honorablement. Depuis le début de la crise sanitaire, les ménages privilégient la sécurité et la liquidité conduisant à une hausse sans précédent du Livret A et des comptes courants. L’assurance vie qui est, par nature, un placement de moyen et de long terme a été naturellement délaissée. En outre, la contrainte d’un versement minimal d’unités de compte peut dissuader certains épargnants. En revanche, la grande stabilité des prestations et des rachats prouve l’absence de défiance à l’encontre du premier placement des ménages dont l’encours a atteint en novembre 1785 milliards d’euros.
Les ménages français disposant d’importantes liquidités devraient dans les prochains mois réaliser des arbitrages surtout si la situation sanitaire et économique se stabilise. L’assurance vie devrait bénéficier de cette normalisation avec une progression de la collecte brute peut être en décembre et plus sûrement en 2021.
L’Assurance vie résiste bien au deuxième confinement
L’assurance vie signe sa neuvième décollecte de rang en novembre avec -30 millions d’euros. Cette dernière est néanmoins la plus faible enregistrée depuis le début de l’épidémie. Malgré le deuxième confinement, l’assurance vie revient calmement mais surement à l’équilibre. Elle fait mieux qu’en octobre qui avait été marqué par une décollecte de 200 millions d’euros.
Lors du premier confinement, les décollectes mensuelles avaient atteint plus de 2 milliards d’euros. Or, en novembre, contrairement à la période mars-mai 2020, les agences n’ont pas fermé facilitant les opérations sur les contrats. Par ailleurs, le recours à la visioconférence et au téléphone pour réaliser des arbitrages s’est généralisé expliquant la bonne tenue de l’assurance vie en novembre.
Novembre, un mois traditionnellement calme pour l’assurance vie
Sur ces dix dernières années, trois décollectes avaient été, jusqu’à maintenant, enregistrées au mois de novembre, 2011, 2012 et 2017. Les collectes positives sont durant ce mois tourne autour du milliard d’euros. En 2019, elle avait atteint 1,1 milliard d’euros. Novembre est pour l’assurance vie un mois moyen mais important, les ménages commençant traditionnellement à réaliser leurs arbitrages financiers de fin d’année.
Une collecte brute et des prestations stables
La collecte brute reste pour le deuxième mois consécutif au-dessus des 10 milliards d’euros, 10,4 milliards contre 10,9 milliards en octobre et 9,4 en septembre. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placée en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. A la différence des précédentes crises, la part des unités de compte n’a pas varié depuis le mois de mars. Les ménages acceptent de prendre une part de risques supplémentaires dans le cadre de leurs versements effectués sur leur contrat d’assurance
Les prestations sur le mois de novembre sont en léger retrait à 10,5 milliards d’euros, contre 11 milliards d’euros en octobre. Depuis le début de la crise, les prestations évoluent peu, preuve que les assurés restent confiants à l’égard de leur placement.
2020, une année atypique
Le cumul des cotisations en assurance vie s’est élevé, depuis le début de l’année, à 103,5 milliards d’euros, soit un recul de près de 30 milliards d’euros (132,8 milliards d’euros sur la même période en 2019). Le montant total des prestations versées est très stable à 110,8 milliards d’euros (109,5 milliards d’euros sur la même période en 2019).
Sur onze mois, la décollecte atteint 7,3 milliards d’euros quand la collecte dépassait 23,3 milliards d’euros sur la même période en 2019. Sauf surprise en décembre, l’assurance vie connaîtra sa plus mauvaise année en 2020. En 2012, la précédente année horribilis, la décollecte était de 6 milliards d’euros.
L’assurance plie sans rompre
Dans un contexte peu porteur pour les produits d’épargne de long terme, l’assurance vie résiste honorablement. Depuis le début de la crise sanitaire, les ménages privilégient la sécurité et la liquidité conduisant à une hausse sans précédent du Livret A et des comptes courants. L’assurance vie qui est, par nature, un placement de moyen et de long terme a été naturellement délaissée. En outre, la contrainte d’un versement minimal d’unités de compte peut dissuader certains épargnants. En revanche, la grande stabilité des prestations et des rachats prouve l’absence de défiance à l’encontre du premier placement des ménages dont l’encours a atteint en novembre 1785 milliards d’euros.
Les ménages français disposant d’importantes liquidités devraient dans les prochains mois réaliser des arbitrages surtout si la situation sanitaire et économique se stabilise. L’assurance vie devrait bénéficier de cette normalisation avec une progression de la collecte brute peut être en décembre et plus sûrement en 2021.
Comité de Suivi des Retraites : des adaptations nécessaires
Si la réforme des retraites instituant le système universel avait été adopté, le Comité de Suivi des retraites aurait du disparaître. Or, la discussion du projet de loi ayant été suspendue pour raison sanitaire, ce comité a rendu, avec quelques mois de retard, ses préconisations. Prenant acte de la dégradation des comptes des régimes retraite et de la situation de l’économie à court et long terme, il conseille au Gouvernement de réfléchir à des mesures d’adaptation qui pourraient concerner des points sensibles comme l’âge de la retraite à taux plein, les règles d’indexation et l’harmonisation du pilotage du régime de retraite
Le Comité de Suivi des Retraites est un organisme indépendant qui, à partir des rapports établis par le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), propose des recommandations aux pouvoirs publics visant à ce que le pilotage du système demeure équitable et soutenable. Logiquement, il doit rendre public ses recommandations avant la fin de juillet afin qu’elles puissent le cas échéant être retenues dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le Covid a bousculé l’agenda. Le COR ayant rendu son rapport au mois de novembre afin d’intégrer les conséquences de la crise sanitaire, le Comité a du décaler la présentation de ses recommandations.
Le Comité de Suivi n’a pas à juger de l’opportunité ou pas d’instituer un régime par points. En revanche, il a pouvoir pour indiquer si au vu de la situation économique et financière des mesures doivent être prises.
En raison de la crise sanitaire, les déficits seront plus importants que prévu jusqu’en 2040. A. Ils dépendront certes de la façon dont l’Etat abondera son propre régime de retraite et les régimes spéciaux, mais quelle que soit la convention comptable retenue, le système sera sous-financé sur la période. le Comité de suivi a souligné que les hypothèses de croissance retenues par le COR étaient optimistes, ce qui pourrait en cas de non-réalisation amener des déficits encore plus élevés.
Pour redresser les comptes, le Comité de suivi rejette le principe d’une augmentation du taux de cotisation, car il est déjà très proche de la limite légale de 28 % chez les salariés. Il préconise de sous-indexer les pensions comme cela a été pratiqué à plusieurs reprises depuis 2008. Il indique qu’il faudra certainement agir sur l’âge du départ à la retraite. Aux yeux de ses membres, une marge d’ajustement subsiste sans réduction de la durée espérée de la retraite.
Le comité estime qu’une harmonisation des règles de fonctionnement serai t souhaitable afin de faciliter le pilotage des régimes vieillesse, ce qui revient à signifier que l’idée du système universel avait du sens.
Le Livret A : rebond sans surprise en novembre
Après la décollecte d’octobre dernier de 940 millions d’euros, le Livret A renoue, selon la Caisse des Dépôts et Consignations, en novembre, sur fond de deuxième confinement, avec une collecte positive qui s’élève à 2,4 milliards d’euros. L’année dernière, la collecte avait été de 610 millions.
Avec le LDDS, la collecte nette atteint 3,31 milliards d’euros. Ce résultat reproduit ceux constatés durant le premier confinement. Le Livret A bat ainsi son record d’encours datant de septembre dernier à 325,8 milliards d’euros quand celui du LDDS franchit la barre des 120 milliards d’euros (120,2).
Un novembre évidemment atypique
Avec la proximité des fêtes, les paiements des impôts locaux et l’absence de primes, novembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, la collecte avait été négative à six reprises et nulle en 2019. Celle de 2020 égale la collecte de 2012 avec 2,4 milliards d’euros. Il y a huit ans, le relèvement du plafond du Livret A intervenu le 1er octobre expliquait le niveau élevé des versements.
Pour 2020, le deuxième confinement, avec une renonciation forcée à la consommation, explique la forte collecte nette. Avec la fermeture des commerces dits non essentiels et de la limitation des déplacements, la consommation a baissé dégageant ainsi des marges en faveur de l’épargne. Cette collecte a été néanmoins moins élevée qu’en avril lors du premier confinement (2,4 milliards d’euros contre 5,47 milliards d’euros). La baisse de la consommation a été moins importante en novembre qu’en avril, -15 % au lieu de -30 %, réduisant d’autant les liquidités disponibles.
Une collecte abracadabrantesque, une préférence absolue pour la liquidité et la sécurité
Depuis le début de l’année, les ménages ont placé plus 27,23 milliards d’euros sur leur Livret A (plus de 35,04 milliards d’euros avec le LDDS). Cette collecte abracadabrantesque marque la préférence absolue dans la liquidité et la sécurité. Elle constitue un record absolu sur onze mois d’une même année. Cette collecte est aussi le signe d’une forte anxiété. En mettant sciemment leur argent sur leurs livrets d’épargne, les ménages flèchent et sécurisent une partie de leurs revenus à la différence de ceux laissés sur les comptes courants. Il y a une volonté manifeste à se constituer une réserve pour faire face à la survenue de problèmes d’emploi ou de revenus. Il n’en demeure pas moins que ce sont les comptes courants qui sont, depuis le début de l’année, les grands gagnants de l’épargne « covid » avec un encours qui a progressé de plus de 50 milliards d’euros.
Dans le contexte anormal de 2020, les ménages ne veulent pas s’engager sur le long terme et privilégient donc des produits liquides. Cette priorité pénalise le premier produit d’épargne français, l’assurance vie. Néanmoins, si pour les flux d’épargne, la préférence est donnée au court terme, il n’y a pas de défiance sur le stock, sur les encours d’épargne à long terme. Les sorties, les rachats sur les contrats d’assurance sont dans la moyenne de ces dernières années. Au niveau des actions, à la différence de 2000 (bulle Internet) et de 2009 (crise de subprimes), les épargnants français font preuve de stoïcisme et se sont gardés de toute sortie précipitée. Les faits leur ont donné pour le moment raison, les indices « actions » ayant compensé tout ou partie les pertes subies en mars.
Décembre, un tout autre mois
Le dégonflement de la cassette « covid » aura-t-elle lieu en décembre avec les fêtes de fin d’année ? Les premiers indicateurs soulignent une bonne tenue de la consommation. Il pourrait en résulter, en décembre, pour le Livret A, une légère décollecte mais qui devrait rester modérée, les ménages demeurant prudents. Le niveau élevé des incertitudes ne les incite pas à desserrer fortement et durablement les cordons de la bourse. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne/Amphitéa/AG2R LA MONDIALE réalisée par l’IFOP-CECOP, 68 % Français pensent conserver ou renforcer leur épargne dans les prochains mois. Ce taux atteint 84 % chez les jeunes actifs (25 / /34 ans) ce qui traduit leur forte inquiétude vis-à-vis de la situation sanitaire et économique. À la question de ce qu’il faut faire de l’épargne emmagasinée depuis le mois de mars, près des deux tiers des Français (65 %) affirment qu’il faut la conserver en vue de faire face à des difficultés à venir quand seulement 35 % préconisent la consommation.
Livret A : le retour de l’épargne « covid » en novembre
Après la décollecte d’octobre dernier de 940 millions d’euros, le Livret A renoue, selon la Caisse des Dépôts et Consignations, en novembre, sur fond de deuxième confinement, avec une collecte positive qui s’élève à 2,4 milliards d’euros. L’année dernière, la collecte avait été de 610 millions.
Avec le LDDS, la collecte nette atteint 3,31 milliards d’euros. Ce résultat reproduit ceux constatés durant le premier confinement. Le Livret A bat ainsi son record d’encours datant de septembre dernier à 325,8 milliards d’euros quand celui du LDDS franchit la barre des 120 milliards d’euros (120,2).
Un novembre évidemment atypique
Avec la proximité des fêtes, les paiements des impôts locaux et l’absence de primes, novembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, la collecte avait été négative à six reprises et nulle en 2019. Celle de 2020 égale la collecte de 2012 avec 2,4 milliards d’euros. Il y a huit ans, le relèvement du plafond du Livret A intervenu le 1er octobre expliquait le niveau élevé des versements.
Pour 2020, le deuxième confinement, avec une renonciation forcée à la consommation, explique la forte collecte nette. Avec la fermeture des commerces dits non essentiels et de la limitation des déplacements, la consommation a baissé dégageant ainsi des marges en faveur de l’épargne. Cette collecte a été néanmoins moins élevée qu’en avril lors du premier confinement (2,4 milliards d’euros contre 5,47 milliards d’euros). La baisse de la consommation a été moins importante en novembre qu’en avril, -15 % au lieu de -30 %, réduisant d’autant les liquidités disponibles.
Une collecte abracadabrantesque, une préférence absolue pour la liquidité et la sécurité
Depuis le début de l’année, les ménages ont placé plus 27,23 milliards d’euros sur leur Livret A (plus de 35,04 milliards d’euros avec le LDDS). Cette collecte abracadabrantesque marque la préférence absolue dans la liquidité et la sécurité. Elle constitue un record absolu sur onze mois d’une même année. Cette collecte est aussi le signe d’une forte anxiété. En mettant sciemment leur argent sur leurs livrets d’épargne, les ménages flèchent et sécurisent une partie de leurs revenus à la différence de ceux laissés sur les comptes courants. Il y a une volonté manifeste à se constituer une réserve pour faire face à la survenue de problèmes d’emploi ou de revenus. Il n’en demeure pas moins que ce sont les comptes courants qui sont, depuis le début de l’année, les grands gagnants de l’épargne « covid » avec un encours qui a progressé de plus de 50 milliards d’euros.
Dans le contexte anormal de 2020, les ménages ne veulent pas s’engager sur le long terme et privilégient donc des produits liquides. Cette priorité pénalise le premier produit d’épargne français, l’assurance vie. Néanmoins, si pour les flux d’épargne, la préférence est donnée au court terme, il n’y a pas de défiance sur le stock, sur les encours d’épargne à long terme. Les sorties, les rachats sur les contrats d’assurance sont dans la moyenne de ces dernières années. Au niveau des actions, à la différence de 2000 (bulle Internet) et de 2009 (crise de subprimes), les épargnants français font preuve de stoïcisme et se sont gardés de toute sortie précipitée. Les faits leur ont donné pour le moment raison, les indices « actions » ayant compensé tout ou partie les pertes subies en mars.
Décembre, un tout autre mois
Le dégonflement de la cassette « covid » aura-t-elle lieu en décembre avec les fêtes de fin d’année ? Les premiers indicateurs soulignent une bonne tenue de la consommation. Il pourrait en résulter, en décembre, pour le Livret A, une légère décollecte mais qui devrait rester modérée, les ménages demeurant prudents. Le niveau élevé des incertitudes ne les incite pas à desserrer fortement et durablement les cordons de la bourse. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne/Amphitéa/AG2R LA MONDIALE réalisée par l’IFOP-CECOP, 68 % Français pensent conserver ou renforcer leur épargne dans les prochains mois. Ce taux atteint 84 % chez les jeunes actifs (25 / /34 ans) ce qui traduit leur forte inquiétude vis-à-vis de la situation sanitaire et économique. À la question de ce qu’il faut faire de l’épargne emmagasinée depuis le mois de mars, près des deux tiers des Français (65 %) affirment qu’il faut la conserver en vue de faire face à des difficultés à venir quand seulement 35 % préconisent la consommation.
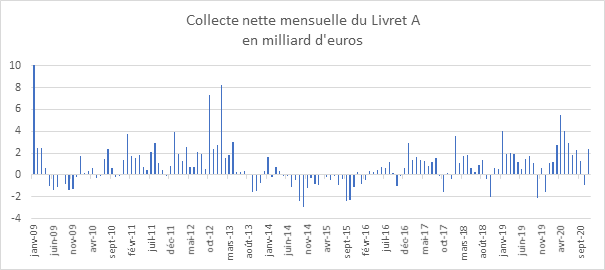
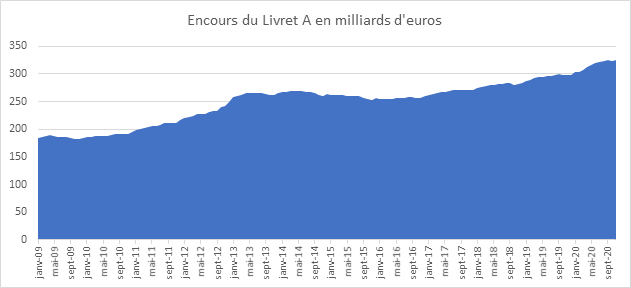
Le Coin des Epargnants du 18 décembre 2020
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 18 décembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 527,84 | +0,37 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 30 179,05 | +0,44 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 12 729,80 | +2,84 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 630,51 | +3,94 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 529,18 | -0,27 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 545,74 | +1,72 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 26 763,39 | +0,42 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 394,90 | +1,43 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,335 % | +0,049 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,575% | +0,062 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,938 % | +0,060 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2235 | +1,03 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 883,540 | +2,39 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 52,010 | +4,23 % | 66,300 |
En attendant la diffusion du vaccin, la prudence reste de mise
Les indices boursiers sont restés relativement stables, à l’exception du Daxx allemand. Ce dernier a bénéficié de l’amélioration, en décembre, du climat des affaires en Allemagne. Le CAC 40 n’a augmenté que de 0,37 % sur cinq jours. Il a été pénalisé par la chute vendredi de Saint Gobain de 4,3 % en raison d’une possible implication de l’entreprise dans l’incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017.
De multiples facteurs incitent à l’attentisme. Ainsi, Aux États-Unis, les investisseurs attendent toujours la finalisation d’un accord entre Démocrates et Républicains sur le plan de soutien budgétaire. En Europe, l’issu des négociations sur le Brexit sont plus qu’incertaines. « Il nous reste très peu de temps, quelques heures utiles dans cette négociation », a prévenu, vendredi, le négociateur de l’Union européenne, Michel Barnier. Le poker menteur en cours pourrait aboutir à un « no deal » qui pourtant iraient à l’encontre des intérêts des parties prenantes. Les négociations achoppent notamment sur la question des quotas de pêche et de l’accès aux eaux britanniques. Sans accord, les échanges entre Londres et Bruxelles obéiront dès le 1er janvier aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, synonymes de droits de douane et de quotas
Les États occidentaux éprouvent toujours les pires difficultés à juguler l’épidémie. Le premier trimestre 2021 sera sur le plan économique et sanitaire difficile. L’arrivée d’un deuxième vaccin sur le marché américain constitue une bonne nouvelle. La Food and Drug administration (FDA), l’autorité de contrôle sanitaire américain, a émis un avis favorable au candidat-vaccin de Moderna. Le rapport de la FDA souligne que l’efficacité de ce vaccin dépasse 94% sur un panel de 30 000 personnes.
Près de 16 500 milliards d’euros de patrimoine en France
Fin 2019, le patrimoine économique national net s’élève à 16 421 milliards d’euros, soit l’équivalent de 8,3 fois le produit intérieur net de l’année. Ce ratio dépasse les niveaux historiques de 2011 et 2018 (8,1 fois le produit intérieur net de l’année).. La hausse du patrimoine a été de près de 5 % en 2019 (+4,8 % contre, contre +4,4 % en 2018). L’augmentation est largement lié à la valorisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières. Les terrains bâtis ont connu une hausse de 6,6 %. En raison du rebond des cours des actions, le solde du patrimoine financier net s’établit à + 125 milliards d’euros en 2019. Il est à noter qu’avec l’accroissement de l’endettement financier, le passif financier est aussi en hausse.
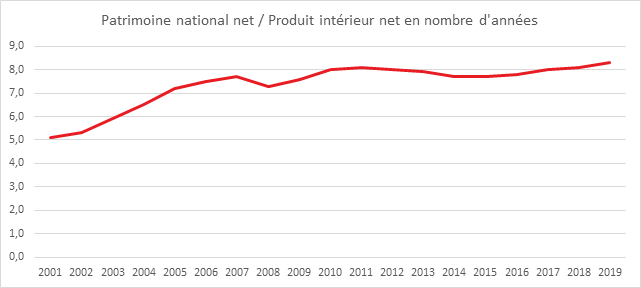
Plus de 12 500 milliards d’euros de patrimoine pour les ménages
Fin 2019, le patrimoine net des ménages s’établit à 12 561 milliards d’euros, soit 8,8 fois le revenu disponible net des ménages. La progression a été de 6,2 % en 2019, contre +2,1 % en 2018.
Le patrimoine non financier des ménages s’élève à 8 451 milliards d’euros. En son sein l’immobilier représente 7 736 milliards d’euros, soit 61 % du patrimoine total. de l’ensemble.
Le patrimoine financier brut des ménages était de 5 872 milliards d’euros en 2019. Le passif financier s’élevait à 1762 milliards d’euros. Le patrimoine financier net était donc de 4 110 milliards d’euros, en augmentation de 10,4 % en 2019, après avoir baissé de 2,6 % en 2018.
Le numéraire et les dépôts représentaient 1650 milliards d’euros en hausse en 2019 de 5,8 %. Les actifs des ménages en assurance-vie et épargne retraite (35 % de leurs actifs financiers totaux) a fortement augmenté en 2019, + 9,0 % après – 1,1 % toujours en lien avec la forte appréciation des cours boursiers.
Au passif des ménages, les crédits continuent de croître (+ 6,1 %, après + 5,1 %), soutenus par la hausse des prix des logements (+ 3,8 %).
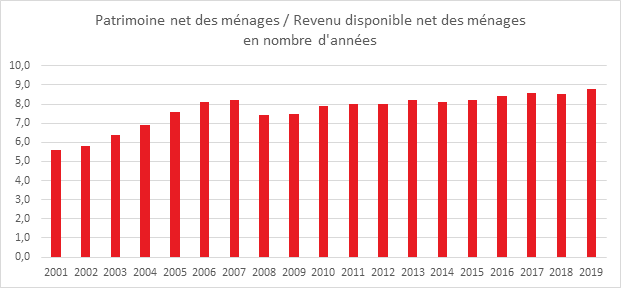
Les fonds propres des sociétés non financières en hausse
Fin 2019, la valeur nette des sociétés non financières (SNF) atteint 2 955 milliards d’euros. Le patrimoine non financier des SNF progresse au même rythme qu’en 2018 (+ 5,0 % après + 5,1 %) et atteint 5 266 milliards d’euros. Cela s’explique principalement par le maintien de l’investissement dans la construction (+ 6,1 % en 2018 et 2019).
Les passifs financiers des sociétés financières en forte hausse
Fin 2019, le patrimoine net des sociétés financières s’élève à 577 milliards d’euros. Il baisse de 12,6 % après une hausse de 19,2 % en 2018. la hausse plus rapide des passifs financiers (+ 7,8 %) que des actifs financiers (+ 7,0 %) qui explique la dégradation de leur situation nette. Au total, l’encours des fonds propres s’élève à 3 270 milliards d’euros en 2019. Il progresse de 6,1 % après un net recul (– 4,1 % en 2018).
Le patrimoine net des administrations publiques en hausse en 2019
Le patrimoine net des administrations publiques s’accroît de 10,3 % malgré la progression de leur endettement, pour atteindre 328 milliards d’euros fin 2019, sous l’effet conjoint de l’investissement en constructions et terrains bâtis et des valorisations boursières.
Le Coin des Epargnants du 12 décembre 2020 : quand le Brexit se rappelle à nous
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 18 décembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |
| CAC 40 | 5 507,55 | -1,81 % | 5 978,06 |
| Dow Jones | 30 046,37 | -0,57 % | 28 538,44 |
| Nasdaq | 12 377,87 | -0,69 % | 8 972,60 |
| Dax Allemand | 13 114,30 | -1,39 % | 13 249,01 |
| Footsie | 6 546,75 | -0,05 % | 7 542,44 |
| Euro Stoxx 50 | 3 485,84 | -1,51 % | 3 745,15 |
| Nikkei 225 | 26 652,52 | -0,37 % | 23 656,62 |
| Shanghai Composite | 3 347,19 | -2,83 % | 3 050,12 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,384 % | -0,069 pt | 0,121 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,637% | -0,087 pt | -0,188 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,878 % | -0,095 pt | 1,921 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2111 | -0,06 % | 1,1224 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 842,143 | +0,20 % | 1 520,662 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 49,900 | +1,75 % | 66,300 |
Quand le Brexit se rappelle à notre bon souvenir
Les marchés ont mis un terme au cycle haussier entamé avec les annonces de commercialisation de plusieurs vaccins et l’élection de Joe Biden. Le CAC 40 baisse de 0,69 % sur cinq jours mettant un terme à cinq semaines consécutives de hausse. Le Brexit, et l’amplification de l’épidémie dans plusieurs pays expliquent le repli général mais modéré des indices actions. Les investisseurs ont également engrangé quelques plus-values avant les fêtes.
Pour le Brexit, le compte à rebours est enclenché. Même si l’Europe nous a habitué à des accords de dernière minute, la possibilité pour l’Union européenne et le Royaume-Uni de signer avant le 31 décembre se réduit de jour en jour. Personne n’a à gagner d’un « hard Brexit » mais, jusqu’à présent, Boris Johnson rejette toute contrepartie en cas d’intégration dans le marché unique. Sans accord de libre-échange avec Bruxelles au 31 décembre, les échanges entre Londres et l’UE, son principal partenaire, se feraient selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas. En 2019, le montant des échanges entre l’Union européenne était de 830 milliards d’euros. Le Royaume-Uni est jusqu’à maintenant le pays d’Europe ayant le déficit commercial le plus élevé. A ce titre, la France dégage un de ses rares excédents commerciaux européens avec ce pays.
Plusieurs points de blocages empêchent, pour le moment, la conclusion d’un accord. Ainsi, le Royaume-Uni n’entend pas se soumettre aux normes techniques, fiscales et environnementales de l’Union. La Commission de Bruxelles considère que le gouvernement britannique entend faire de son pays une porte d’entrée aux marchandises des pays émergents qui ne souhaiteraient pas se soumettre à la réglementation européenne. Le Royaume-Uni se transformerait en Cheval de Troie du commerce européen au profit des pays tiers. Le gouvernement britannique s’oppose également au système d’arbitrage des différends commerciaux. Logiquement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est compétente pour juger les cas de litige dans les prochaines années. Le Royaume-Uni ne se considère désormais plus lié aux lois européennes depuis son départ de l’Union en 2020, et récuse tout pouvoir à la CJUE. Bruxelles serait disposé à trouver sur ce point un compromis. Le dossier de la pêche et des zones réservées est également dans l’impasse. Les eaux britanniques sont parmi les plus riches du monde en poisson et de nombreux pays de l’Union y pêchent 760 000 tonnes de poissons chaque année, soit 636 millions d’euros de marchandises. La France est le pays le plus concerné en y réalisant 30 % de ses prises. Or au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni reprend le contrôle de cette zone économique exclusive et souhaite y imposer un système de droit de pêche et de quotas. Ces derniers seraient mis en place dans trois ans. Un délai estimé trop court par Bruxelles, qui propose plutôt de s’acquitter d’une taxe en reversant une partie des prises effectuées dans les eaux britanniques. Le gouvernement britannique estime les concessions européennes très insuffisantes.
Pétrole, une illusion de hausse
Le baril de pétrole Brent a dépassé les 50 dollars jeudi 10 décembre, pour la première fois depuis le début du mois de mars. La hausse de ces derniers jours fait suite à l’accord intervenu au niveau de l’OPEP et de la Russie la semaine dernière et aux annonces des premiers plans de vaccination Les investisseurs saluent le début des campagnes de vaccination au Royaume-Uni et d’ici quelques jours aux Etats-Unis et au Canada. Le Brent s’apprécie du fait d’un probable nouveau plan d’aide aux ménages et aux entreprises aux Etats-Unis. La demande de pétrole est soutenue en Chine et en Inde, respectivement premier et troisième importateur mondial de brut. Au Brésil, la consommation de carburants a même dépassé son niveau d’avant la pandémie. Enfin, les cours du brut sont tirés par la faiblesse du dollar qui rend l’or noir moins cher pour les grands pays consommateurs. L’optimisme des marchés est d’autant plus remarquable que les stocks de pétrole sont en hausse aux Etats-Unis et que l’Arabie Saoudite a exporté de fortes quantités vers ce pays afin de peser sur les cours et ainsi pénaliser les producteurs locaux. Les stocks américains se situent désormais 11 % au-dessus de leur niveau moyen des cinq dernières années. Cependant, le marché reste convalescent et pourrait encore connaître de fortes variations de cours. En ce milieu de mois de décembre, la demande de pétrole n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise. A 92 millions de barils par jour, elle est de 7,5 % inférieure à son niveau du mois de décembre 2019. Sans la politique de régulation de la production, le prix serait autour de 30 dollars le baril.
La Banque centrale maintient son cap
A l’occasion de sa réunion du 10 décembre, la Banque Centrale Européenne a pris en compte les effets de la deuxième vague de coronavirus et d’un éventuel « hard Brexit » dans ses prévisions et a ajusté, en conséquence, sa politique. Pour 2021, la BCE a ainsi ramené sa prévision de croissance de 5 à 3,9 %. Une accélération est, en revanche, attendue l’année suivante (4,2 %, contre 3,2 % initialement). L’inflation devrait être de 0,2 % en 2020 et atteindrait progressivement 1,4 % en 2023. La BCE n’a pas touché à ses taux directeurs qui restent à leurs niveaux historiquement bas. Le taux de dépôt reste à -0,5 %, le taux de refinancement à 0 % et celui de la facilité de prêt marginal à 0,25 %. La BCE a décidé d’augmenter de 500 milliards d’euros son programme d’achats d’urgence pandémie (PEPP), l’enveloppe totale atteignant 1 850 milliards d’euros. Ce programme se poursuivra au moins jusqu’en mars 2022. Cette extension du programme pourrait toutefois poser des problèmes techniques à la BCE. La BCE ne peut pas détenir plus de 50 % de toute dette souveraine. Or, ce ratio pourrait être atteint pour certains Etats en 2021 ou en 2022. Sur ce sujet, Christine Lagarde a déclaré que « nous avons dit à plusieurs reprises que les limites que nous nous sommes imposées ne doivent pas être un obstacle à l’exécution de notre politique monétaire ». La BCE a, par ailleurs, modifié son programme de financement de long terme à taux négatifs pour les banques, les TLTRO. Ils permettent aux établissements qui maintiennent leurs prêts à l’économie réelle (entreprises et ménages) de se financer auprès de la BCE à –1 %. Cette mesure de soutien à la consommation et à l’investissement a été prolongée jusqu’à la fin juin 2022. Trois nouvelles opérations auront lieu au second semestre 2021. Les mesures annoncées par la BCE ont déçu les investisseurs qui auraient des mesures plus conséquentes. Elles n’ont, par ailleurs, pas freiné l’appréciation de l’euro par rapport au dollar mais celle-ci est avant tout la conséquence de la faiblesse de ce dernier.
La politique monétaire expansive a eu comme conséquence que les Etats du cœur de l’Europe, France comprise, se sont endettés à taux négatifs sur l’ensemble de l’année. Le taux moyen des emprunts français toute duration confondue a été, en 2020, de -0,4 %, contre -0,19 % en 2019. 260 milliards d’euros ont été levés, ce qui constitue un record pour la France et au niveau européen. Logiquement, en 2021, le programme d’émission porte également sur 260 milliards d’euros.
La capitalisation dans toutes ses formes
Le système français de retraite repose avant tout sur la répartition avec des cotisations, des contributions ou des impôts qui sont affectés au financement des pensions. La capitalisation ne fournit que 2,4 % des ressources des retraités en France, plaçant le pays loin derrière ses partenaires de l’OCDE pour lesquels ce ratio est, en moyenne, de 15 %.
Au-delà des suppléments de revenus issus des différents produits d’épargne retraite, les régimes de retraite peuvent être amenés à faire appel aux marchés financiers dans le cadre de la gestion de leurs réserves. De ce fait, le poids du financement assuré par ces marchés est supérieur au seul encours de l’épargne retraite évalué à 240 milliards d’euros en 2018.
Près de 158 milliards d’euros de réserves
Selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), au 31 décembre 2019, les réserves des régimes de retraite par répartition s’élevaient à 157,9 milliards d’euros. Le régime complémentaire des salariés AGIRC/ARRCO détient les réserves les plus importantes avec 84,1 milliards d’euros. Elle devance la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) qui dispose d’un encours de 29,7 milliards d’euros. Ces réserves ont fait l’enjeu d’âpres débats lors de la discussion de la réforme des retraites en 2019, les différents régimes ne souhaitant pas leur disparition dans le cadre du système universel. Il avait été admis qu’elles puissent être affectées à des dépenses de solidarité et des dépenses visant à lisser les effets de la réforme.
A ces réserves qui sont placés sur les marchés immobiliers et financiers, il faut également celles du Fonds de Réserve des Retraites (FRR). Ce dernier possédait un actif de 33,7 milliards d’euros à la fin de l’année 2019. Ce fonds participe au financement de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale qui a notamment repris les dettes de la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse et du Fonds de Solidarité Vieillesse. Le cumul des réserves des régimes par répartition et du FRR atteint 191,6 milliards d’euros, soit 7,9 % du PIB de 2019. Par ailleurs, il convient d’ajouter l’actif financier du Régime Additionnel de le Fonction Publique qui fonctionne par capitalisation. Cet actif atteint 35 milliards d’euros. Enfin, deux régimes par capitalisation doivent être comptabilisés. La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens possède également d’un régime en capitalisation provisionné à hauteur de 5,9 milliards d’euros pour un actif net estimé à 8,8 milliards d’euros en valeur de marché fin 2019. Les agents de la Banque de France bénéficie également d’un fonds de pension dont l’actif en valeur de marché était, toujours fin 2019, de 14,8 milliards d’euros.
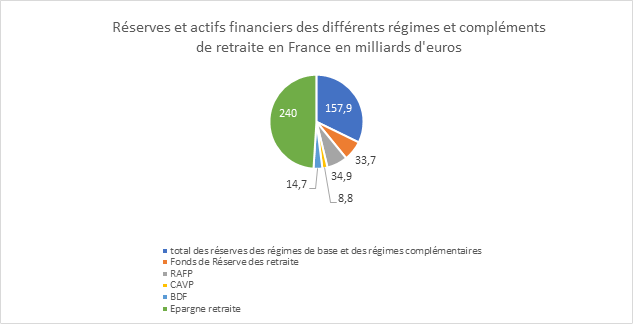
Prise en compte du chômage partiel pour la retraite
Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement, le chômage partiel sera pris en compte pour le calcul des pensions. Cela a été rendu possible par le décret du 1er décembre 2020 pris en application de l’article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions urgentes liées à la crise sanitaire (voir circulaire n°154-2020).
Avant ce décret, l’indemnité perçue par les salariés en chômage partiel n’était pas considéré comme un salaire et n’était pas soumise à cotisations, notamment pour la retraite. Il en résultait que pour les pensions de base du régime général, versées par l’Assurance-retraite, le chômage partiel ne permettait pas de valider des trimestres, contrairement au chômage indemnisé «total».
Le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 permet dorénavant une prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite. Il prévoit qu’un trimestre puisse être validé avec 220 heures d’activité partielle . Il ne sera pas possible de valider plus de quatre trimestres sur l’année 2020.
Logiquement, la validation des trimestres s’effectue non pas en fonction du nombre d’heures travaillées mais en fonction d’un montant soumis à cotisations. Ainsi, pour valider un trimestre, il faut un montant équivalent à 150 fois le Smic horaire (soit 1 522,50 euros bruts, et 6 090 euros pour quatre trimestres).
Pour le régime complémentaire AGIRC / ARRCO, le Conseil d’administration a décidé que les salariés indemnisés au titre de périodes d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée.
Le Coin de l’agenda économique et financier
Lundi 7 décembre
L’indice Sentix relatif à la confiance des investisseurs dans la zone euro sera publié pour le mois de décembre.
La balance commerciale de la Chine pour le mois de novembre sera connue. Les réserves de change de la Chine pour le mois de novembre seront aussi dévoilées.
Mardi 8 décembre
La balance commerciale de la France pour le mois d’octobre sera donnée.
Publication en Allemagne de l’enquête ZEW sur le sentiment économique pour le mois de décembre.
Mercredi 9 décembre
L’indice hors tabac de l’inflation en novembre sera publié par l’Insee.
La balance commerciale de l’Allemagne pour le mois d’octobre sera connue.
La fondation NFIB publiera l’indice de l’optimisme des affaires pour les États-Unis au mois de novembre.
Le niveau des stocks des grossistes en octobre sera publié par le Bureau américain.
Jeudi 10 décembre
Réunion du Conseil européen. Les dirigeants de l’Union européenne se réuniront à Bruxelles pour débattre de la poursuite des mesures de coordination liées à la COVID-19, du changement climatique, du commerce, de la sécurité et des relations extérieures. Cette réunion se prolongera le 11 décembre.
Décision sur les taux d’intérêt de la BCE.
La production industrielle pour le mois d’octobre sera dévoilée en France et au Royaume-Uni.
Vendredi 11 décembre
La Banque d’Angleterre publiera son second rapport sur la stabilité financière pour l’année 2020.
En Italie, la balance commerciale et la production industrielle pour le mois d’octobre seront connues.
L’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre sera donné en Allemagne et en Espagne.
Lundi 14 décembre
La production industrielle dans la zone euro en octobre sera donnée par Eurostat.
Le niveau de la production industrielle en octobre au Japon et le taux d’utilisation des capacités industrielles japonaises en octobre seront connus.
Mardi 15 décembre
Le taux de chômage en novembre au Royaume-Uni sera dévoilé.
L’indice des prix à la consommation en novembre en Italie sera donné par l’institut national italien de la statistique.
Mercredi 16 décembre
Le coût du travail trimestriel dans la zone euro au troisième trimestre sera publié par Eurostat. Il montre l’évolution à court terme des coûts horaires totaux engagés par les employeurs de maintenir leurs employés.
La balance commerciale de la zone euro en octobre sera aussi donnée par Eurostat.
Jeudi 17 décembre
L’indice des prix à la consommation en novembre dans la zone euro sera donné par Eurostat.
Décision sur les taux de la Banque d’Angleterre.
Le nombre de permis de construire ainsi que celui des mises en chantier en novembre aux États-Unis seront dévoilés.
Vendredi 18 décembre
Les indices Markit- PMI manufacturiers et de services pour le mois de décembre seront publiés pour la zone euro, la France et l’Allemagne.
Décision sur les taux de la Banque du Japon.
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


