Troisième rapport du Comité d’Evaluation des réformes de la fiscalité du capital – un bilan encourageant
Le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du patrimoine qui est placé sous l’autorité de France Stratégie (Commissariat général au plan) a publié son troisième rapport le jeudi 14 octobre dernier. Il a ainsi établi le bilan des premières années d’application de la transformation de l’ISF en IFI et de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique.
Ce rapport souligne qu’il n’y a pas eu effondrement des recettes fiscales issues des impôts sur le capital. Ils sont restés stable à 11 % du PIB de 2017 à 2019. En volume, ils sont passés de 252 à 266 milliards d’euros. Il mentionne que le versement des dividendes ont retrouve le niveau qu’il avait avant l’assujettissement de ces derniers à l’impôt sur le revenu entre 2013 et 2018.
.
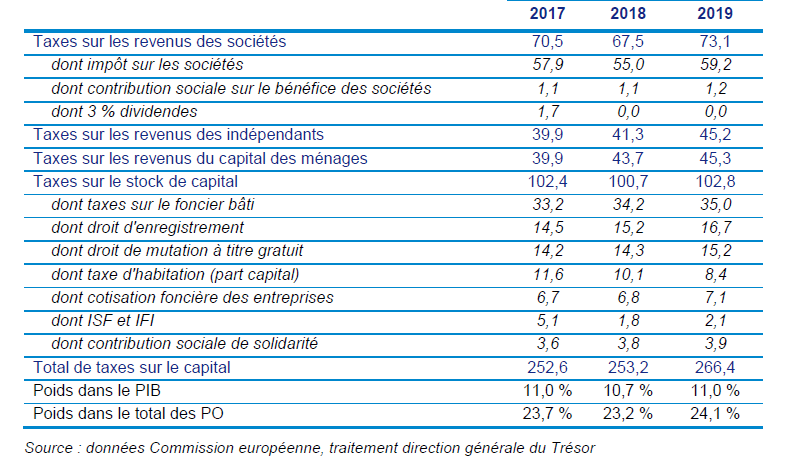
Le Comité note que les flux de placements financiers des ménages ont fortement augmenté en 2020 à 205 milliards d’euros, soit une hausse de 75 milliards, après celle de 28 milliards enregistrée en 2019. Des facteurs extérieurs expliquent évidemment cette augmentation dont la crise sanitaire. Au sein de ce total, les placements en actions (détenues directement ou indirectement) et en assurance-vie en unités de compte se montent à 47 milliards en 2020, soit 22 % des placements financiers des ménages, une part bien supérieure à celle de 2019 (9 %), mais similaire à celle de 2017. Pour les sociétés non financières, les flux de financement en actions sont en forte hausse en 2020, de 55 à 95 milliards d’euros, dans un contexte où la dette brute des entreprises a fortement augmenté (+ 140 milliards, en premier lieu via le mécanisme de prêt garanti mis en place par l’État durant la crise), mais pas la dette nette.
Les levées de fonds de capital-investissement auprès des investisseurs particuliers français plafonnent depuis 2016, après une forte progression lors des six années précédentes. La chute des levées de fonds pour les FCPI/FIP est lié, probablement à la suppression de la niche ISF PME.
La forte progression des dividendes déclarés par les ménages au titre de 2018 (23 milliards d’euros, après 14 milliards en 2017), s’est confirmée en 2019 augmentation supplémentaire de l’ordre de 1 milliard) et en 2020 (stabilité par rapport à 2019). Elle est comparable par son ampleur à la chute enregistrée en 2013, au moment où les revenus mobiliers ont été intégrés au barème progressif de l’IR. Il y a un retour à la normale. Les plus-values « de droit commun » réalisées par les ménages sont plus élevées de 4 milliards d’euros en 2019 qu’en 2017, mais celles avec abattement renforcé sont en baisse de 2 milliards (et sont au niveau de 2016). De leur côté, les intérêts reçus par les ménages s’inscrivent en baisse, dans un contexte de baisse régulière des taux d’intérêt (4,5 milliards d’euros en 2019 après 5,3 milliards en 2017), alors même que leur taux d’imposition a de facto été plus fortement réduit que celui sur les dividendes.
En 2019, tout comme en 2018, les dividendes ont été encore plus concentrés qu’en 2017. En 2019, 62 % ont été reçus par 39 000 foyers (0,1 % des foyers), dont 31 % par 3900 foyers (0,01 % des foyers), alors qu’en 2017 la moitié avait été reçue par 38 000 foyers, dont 22 % par 3 800 foyers.
Le taux d’imposition moyen des revenus au titre de l’IR est resté stable entre 2017 et 2019 à l’exception du dernier centile, pour lesquels il a baissé. Pour autant, l’imposition des revenus (hors prélèvements sociaux) reste progressive, à l’exception du dernier millime de revenus . Le taux moyen d’imposition est de 7 % au seuil du dernier décile, de 17 % au seuil du dernier centile, de 22,5 % pour l’avant-dernier millime, et de 21 % pour le dernier millime (soit 39 000 foyers). Le taux d’imposition des ménages les plus aisés en 2019 reste supérieur à son niveau de 2011, c’est-à-dire avant la mise au barème des revenus du capital, alors que sur la même période les prélèvements sociaux sur les revenus du capital ont par ailleurs été augmentés de 2,5 points (dont 1,7 point de hausse dans le cadre du PFU à 30 %).
Depuis le passage de l’ISF à l’IFI, une baisse du nombre d’expatriations et une hausse du nombre d’impatriations fiscales de ménages français fortunés, est constaté. En 2018 et 2019, le nombre de retours de foyers taxables à l’IFI dépasse le nombre de départs (340 versus 280 en 2019), alors qu’on constatait l’inverse pour les flux de contribuables à l’ISF (470 versus 1 020 en 2016). Le taux de départ est en baisse depuis le point haut de 2013, sans inflexion particulière en 2017, et le taux de retour est en hausse marquée à partir de 2017, alors qu’il était stable auparavant.
Revalorisation des pensions complémentaires AGIRC/ARRCO de 1 % au 1er novembre 2021
le 1er novembre 2021, les pensions complémentaires servies par l’AGIRC/ARRCO seront revalorisées de 1% après avoir été maintenu en 2020.
L’AGIRC/ARRCO en raison de la crise sanitaire qui a réduit les recettes avec la diminution du nombre d’emploi et le chômage partiel a enregistré un déficit technique de 4,1 milliards d’euros. Ce solde négatif a interrompu le processus d’amélioration des comptées engagé en 2015. Il a remis en en cause la trajectoire d’équilibre du régime définie par les partenaires sociaux dans l’Accord national interprofessionnel du 10 mai 2019. Cet accord prévoyait une règle d’or visant à maintenir constamment sur 15 ans, un niveau de réserves pour le régime au moins égal à six mois de versement de pensions. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont décidé d’élaborer un avenant à l’accord de 2019, donnant au conseil d’administration une marge de manœuvre plus importante (+/- 0,5 point) que celle prévue initialement dans l’accord (+/-0,2 point) pour déterminer l’évolution des pensions de retraite complémentaire par rapport à l’indice des prix à la consommation.
Selon la dernière note de conjoncture publiée par l’INSEE le 6 octobre 2021, le taux d’inflation prévisionnel a été fixé de 1,5 %. Au vu de l’objectif de maintien des réserves, le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a décidé d’appliquer un écart de 0,5 point inférieur au dernier taux prévisionnel d’inflation fourni par l’INSEE, soit 1 point. La valeur de service du point augmentera ainsi de 1% au 1er novembre 2021 et s’élèvera à 1,2841€. Le coût de l’actualisation est de 850 millions d’euros. L’accord prévoit un rattrapage automatique au 1er novembre de l’année suivante, en fonction de l’inflation réelle constatée sur l’année 2021.
Les partenaires sociaux sociaux ont souhaité maintenir les moyens alloués à l’action sociale de l’Agirc-Arrco pour 2021 et 2022 et annuler la baisse de dotation de 2% prévue dans l’accord de 2019.
Concomitamment à la valeur de service du point, le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco fixe la valeur d’achat
du point, à effet du 1er janvier de l’année suivante. Indexée sur la progression du salaire moyen, elle permet de
calculer le nombre de points acquis grâce aux cotisations versées pour l’année.
En 2021, les partenaires sociaux ont souhaité figer sa valeur, compte-tenu de la baisse du salaire moyen
observée l’année précédente, du fait du recours important à l’activité partielle.
Pour l’exercice 2022, la valeur d’achat est fixée sur la base de l’évolution cumulée du salaire annuel moyen des
ressortissants du régime en 2020 et 2021. Ainsi, la valeur d’achat évoluera de +0,2 % à compter du 1er janvier
prochain, soit 17,4316€.
Le Coin des Epargnants su 9 octobre 2021
L’emploi déçoit malgré ou à cause d’un chômage en baisse aux Etats-Unis
Cette semaine, les indices « actions » ont très légèrement augmenté dans un contexte marqué tout à la fois par l’affirmation de la croissance et de l’inflation. Les taux d’intérêt en phase avec l’accélération de la hausse des prix sont restés orientés à la hausse. Symbole de l’augmentation des cours de l’énergie et des matières premières, le cours du baril Brent est passé au-dessous des 80 dollars. Vendredi, avec l’annonce de l’emploi américain, les marchés ont penché à la baisse. Selon le Département du Travail, l’économie américaine n’a créé que 194 000 emplois au mois de septembre, quand les économistes en attendaient 500 000. Le mois d’août avait déjà été jugé décevant. Le rythme des créations d’emplois s’est nettement infléchi par rapport au début de l’année. Sur les sept premiers mois de 2021, c’est une moyenne de 636 000 emplois qui étaient créés tous les mois (et un million il y a un an).
Les économistes estimaient que la réouverture des écoles et des bureaux, en septembre, dans une grande partie du pays allaient doper l’emploi. Comme en Europe, les Américains sont toujours réticents à reprendre une activité nécessitant des interactions physiques. Le secteur touristique demeure toujours en retrait d’autant que le variant Delta a connu une recrudescence du nombre de cas, au début de septembre, recrudescence qui s’est depuis quelques jours interrompue. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a ainsi créé moins de 100 000 emplois pour le deuxième mois consécutif. Par ailleurs, de nombreuses aides fédérales destinées aux travailleurs touchés par la crise du Covid ont pris fin au début du mois de septembre, mais les Américains ont pu épargner pendant la crise, leur permettant de reporter leur retour sur le marché de l’emploi de quelques mois. Dans ce contexte qui reste atypique, le taux de chômage continue sa baisse en passant sur un mois de 5,2 à 4,8 % Il est de 1,3 point au-dessus de son niveau d’avant-crise. Dans le même temps, le nombre de postes non-pourvus est très élevé, supérieur à 11 millions. Dans ce contexte de pénurie relative de main d’œuvre, en septembre, le salaire horaire moyen des salariés du privé a augmenté de 4,6 % en rythme annuel.
Ces chiffres en demi-teinte pourront être exploités par l’équipe de Joe Biden afin de convaincre un Congrès réticent à adopter son projet de rénovation des infrastructures. Les adversaires de ce plan pourront néanmoins souligner qu’il ne fera qu’accroître la pénurie de main d’œuvre et l’inflation. De son côté, la banque centrale américaine attendait, « un rapport sur l’emploi sensiblement bon » pour commencer à réduire son programme d’achats d’obligations. Censée intervenir à la prochaine réunion prévu au début du mois de novembre, la présentation du calendrier pourrait être différée. La remontée des taux, envisagée l’an prochain, pourrait également faire les frais de cette situation ambiguë du marché de l’emploi.
Si sur le front économique, entre inflation et pénurie de main d’œuvre, la lecture des statistiques est un art délicat, une bonne nouvelle pour les investisseurs est intervenue, avec l’accord au Congrès sur le relèvement de 480 milliards de dollars du plafond de la dette fédérale américaine jusqu’à début décembre, comme le souhaitait le département du Trésor.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 8 octobre 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 559,99 | +0,65 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 34 746,25 | +1,22 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 579,54 | +0,09 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 206,13 | +0,33 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 095,55 | +0,97 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 073,29 | +0,94 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 076,19 | -2,42 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 568,17 | +0,00 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,184 % | +0,060 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,156 % | +0,070 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,598 % | +0,114 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1573 | -0,21 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 759,248 | +0,002 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 82,360 | +4,08 % | 51,290 |
Le patrimoine des ménages en hausse en 2020
Fin 2020, le patrimoine économique de la France s’élevait 17 682 milliards d’euros en France, soit 9,6 fois le produit intérieur net de l’année. En raison de la crise sanitaire qui a entraîné une contraction de 7,4 % du produit intérieur net et de la bonne tenue des marchés « actions » ainsi que des prix de l’immobilier (+6,9 % en pour ces deux classes d’actifs), ce ratio augmenté de 1,3 point. Le patrimoine non financier, qui progresse de 6,6 % (après 5,6 % en 2019), est le premier et principal facteur de croissance du patrimoine total. Cette hausse est en lien avec le dynamisme du prix des terrains bâtis, en particulier pour l’immobilier résidentiel. En 2020, le patrimoine financier net (solde des actifs et des passifs financiers) est stable, les actifs et les passifs financiers évoluant à des rythmes proches (respectivement + 8,7 % et + 8,6 %, après + 9,1 % et + 9,0 %). Avec l’augmentation de l’endettement public qui est passé de 98 à 118 % du PIB, le patrimoine financier net des administrations publiques se dégrade nettement quand celui des sociétés non financières est quasi stable. Ceux des sociétés financières et des ménages augmentent.
Le patrimoine des ménages, au plus haut
Fin 2020, le patrimoine des ménages s’établit à 13 440 milliards d’euros, soit 9,3 fois le revenu disponible net des ménages, après 8,8 fois en 2019. Il progresse de 6,4 %, soit un peu moins qu’en 2019 (+ 7,0 %)
Le patrimoine non financier des ménages a, en 2020, selon l’INSEE, augmenté de 6,6 % (après + 5,5 % en 2019) pour atteindre 9 095 milliards d’euros. 91 % de ce patrimoine non financier est constitué de biens immobiliers. L’augmentation des prix de l’immobilier fin 2020 (+ 6,1 %, après + 4,5 % en 2019) explique cette progression même si la crise sanitaire a perturbé la dynamique des ventes immobilières en provoquant une contraction de l’investissement (– 8,8 % après + 3,9 %).
Le patrimoine financier net des ménages a, de côté, augmenté de 6,0 % en 2020 pour atteindre 4 345 milliards d’euros, après une hausse de 10,3 % en 2019. Cette progression est imputable à un effet flux (la cagnotte covid) et à un effet appréciation (bonne tenue des marchés). La diminution de la consommation pendant les confinements ainsi que le maintien du pouvoir d’achat depuis le début de la crise ont provoqué une augmentation des flux d’épargne financière. Les cours « actions » ont rapidement surmonté la baisse des mois de mars/avril. Les placements bruts des ménages ont augmenté de 5,7 %, soit 6 200 milliards d’euros à fin 2020. L’encours en numéraire et dépôts a connu une hausse de 9,8 %, soit + 162 milliards d’euros, après + 5,7 % en 2019. Les placements sous forme d’actions et de parts de fonds d’investissement ont néanmoins progressé en 2020 moins vite qu’en 2019 (+ 3,1 %, après + 13,7 %), les ménages préférant la liquidité et la sécurité. Les actifs des ménages en assurance-vie continuent de progresser, mais à un rythme moins élevé qu’en 2019 (+ 2,8 %, après + 8,5 %).
Au passif des ménages, les crédits continuent de croître, mais à un rythme moins soutenu (+ 4,5 %, après + 6,1 % en 2019). Leur progression est la conséquence de l’appétence des particuliers pour l’immobilier. Durant le premier confinement, les transactions immobilières se sont arrêtées réduisant le besoin en crédits mais un rattrapage est intervenu en sortie de confinement. Pour les crédits à la consommation, la progression est, de même que celle des années précédentes.
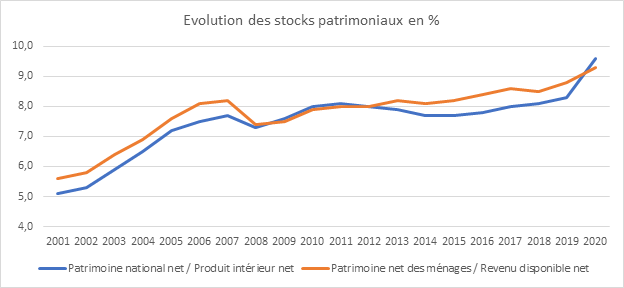
Lente décrue du taux d’épargne
Avec les déconfinements, le taux d’épargne des ménages, au sein de la zone euro, est redescendu au cours du deuxième trimestre. Il s’élevait à 19 % du revenu disponible brut contre 21,5 % le trimestre précédent. Au deuxième trimestre 2020, il avait atteint le niveau record de 25,0 %.
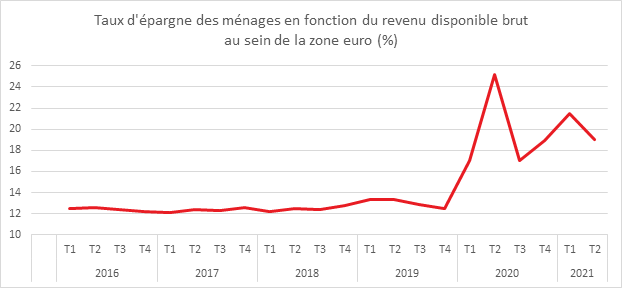
La diminution du taux d’épargne des ménages dans la zone euro s’explique par une augmentation de leurs dépenses de consommation de 4,4 %, tandis que le revenu disponible brut des ménages a augmenté de 1,3 % entre le premier et le deuxième trimestre. Sur la même période, le taux d’investissement des ménages dans la zone euro a augmenté de 9,2 % à 9,4 %, valeur la plus élevée depuis 2011.
Le Coin des Epargnants du 2 octobre 2021 : les premiers frimas de l’hiver
Marchés, les frimas de l’hiver sont en avance
Après un mois d’août durant lequel le CAC 40 a failli battre son record de 6 922 points vieux de 21 ans, septembre a été marqué par les craintes d’un retour de la stagflation. Les premiers résultats d’inflation pour le mois de septembre ont confirmé cette crainte. En Allemagne, les prix à la consommation ont, en effet, augmenté de 4,1 % sur un an en lien avec la progression de 14 % des prix de l’énergie. Le prix du baril de pétrole Brent a franchi la barre des 80 dollars à la fin du mois de septembre. En France, la hausse est de 2,7 % par rapport à septembre 2020, du jamais vu depuis 10 ans, tandis qu’elle a atteint 3 % en Italie. Le CAC 40 a perdu près de 2,5 % sur un mois. Le repli est encore plus net pour le Dow Jones (-4,29 %) et le Nasdaq (-5,31 %). Sur la semaine, les indices reculent sur toutes les grandes places. Vendredi 1er octobre, la baisse a été freinée par l’annonce du laboratoire américain Merck d’un traitement contre le Covid-19. Le groupe pharmaceutique et son partenaire RidgeBack Biotherapeutics ont indiqué que leur traitement antiviral expérimental contre le coronavirus sous forme de comprimés, le molnupiravir, réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 50 % chez les patients atteints de formes légères ou modérées. La mise sur le marché pourrait intervenir dans les prochaines semaines.
Aux États-Unis, la croissance du PIB du deuxième trimestre a été confirmée à 6,6 % en rythme annualisé, selon la dernière estimation du département du Commerce. A contrario, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 11 000 à 362 000, leur niveau le plus élevé en sept semaines, contre un repli à 33 000 anticipé par le consensus formé par Bloomberg, témoignant d’un ralentissement de la croissance dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire outre-Atlantique. Le Sénat américain puis la Chambre des représentants ont voté, jeudi 30 septembre, en faveur d’un court projet de loi qui prolonge le budget jusqu’au 3 décembre permettant d’éviter le « shutdown ». Un autre texte sera nécessaire d’ici le 18 octobre pour relever le plafond de dettes. Les Républicains refusent pour le moment d’adopter un tel texte. Sans accord, les États-Unis ne pourraient plus lever de nouvelle dette pour financer les programmes fédéraux ni même rembourser leurs emprunts. Il s’agirait d’un défaut de paiement juridique. Le Président américain Joe Biden a été mis, par ailleurs, en difficulté pour faire passer ses deux projets de loi pluriannuels sur les infrastructures. Le premier plan doit consacrer 1 200 milliards de dollars à la reconstruction des ponts et des routes, tandis que le second prévoit de financer de nouvelles mesures de protection sociale, à hauteur de 3 500 milliards de dollars. Le vote de ces deux plans donne lieu à de délicates négociations au sein du camp démocrate, les modérés voulant limiter les dépenses, tandis que l’aile la plus progressiste demande des assurances sur l’ampleur et la nature des mesures. Parmi les mauvaises nouvelles figurent la baisse des ventes d’automobiles américaines, baisse provoquée par la pénurie de microprocesseurs. L’augmentation des coûts de l’énergie et des conteneurs gênent de plus en plus les constructeurs automobiles. En France, le marché automobile français a reculé de 20,5 % en septembre par rapport à l’année dernière, avec 133 835 immatriculations de voitures neuves.
Dans ce contexte, les taux d’intérêt des obligations d’État sont orientés à la hausse. L’euro poursuit sa baisse du fait de la préférence donnée à la devise américaine dans la perspective d’une augmentation rapide des taux dans ce pays.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 1er octobre 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 517,69 | -1,82 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 34 326,46 | -1,36 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 566,70 | -3,20 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 156,44 | -2,42 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 027,07 | -0,35 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 035,30 | -2,96 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 771,07 | -4,89 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 568,17 | -1,24 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,124 % | +0,012 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,226 % | +0,001 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,484 % | +0,033 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1597 | -1,03 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 759,200 | +0,774 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 78,760 | +0,95 % | 51,290 |
Bon anniversaire au PER
Le Plan d’Epargne Retraite est né un 1er octobre 2019. et fête son deuxième anniversaire. Malgré la crise sanitaire, il connaît un réel succès. Selon le Ministère de l’Economie, l’encours de ce nouveau produit aurait atteint 45 milliards d’euros avec 3,7 millions de titulaires. Selon l’Association Française de Gestion (AFG), plus de 1,4 million de salariés ont épargné dans des PER Collectifs proposés aujourd’hui par 107 000 entreprises pour y placer leur participation ou leur intéressement et réaliser des versements volontaires. Le segment 2 dédié aux versements collectifs issus de l’épargne salariale représente près près de 13 milliards d’euros d’encours. Le PER individuel compte plus de deux millions de Français avec un encours dépassant 23 milliards d’euros. Le solde est issu du segment 3, le PER collectif obligatoire (ex article 83).
Livrets bancaires, rendement historiquement bas
Selon la Banque de France, le taux moyen des livrets bancaires fiscalisés a encire baissé en août pour s’établir à 0,09 %. Les taux demeurent historiquement bas malgré la hausse de l’inflation.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| août-2020 | juin-2021 | juil- 2021 | août-2021 | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,41 |
| Ménages | 0,69 | 0,65 | 0,64 | 0,64 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,57 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,08 | 0,89 | 0,85 | 0,84 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| – plan d’épargne-logement | 2,62 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| SNF | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| dont : – dépôts à vue | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,98 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,48 | -0,54 | -0,55 | -0,55 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,56 | -0,41 | -0,51 | -0,59 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Marchés financiers : petit coup de froid en septembre
Après un mois d’août durant lequel le CAC 40 a failli battre son records de 6922 points vieux de 21 ans, septembre a été marqué par les craintes d’un retour de la stagflation. Les premiers résultats d’inflation pour le mois de septembre ont confirmé cette crainte. En Allemagne, les prix à la consommation ont, en effet, augmenté de 4,1 % sur un an en lien avec la progression de 14 % des prix de l’énergie. prix du baril de pétrole Brent a franchi la barre des 80 dollars à la fin du mois de . En France, la hausse est de 2,7% par rapport à septembre 2020, du jamais vu depuis 10 ans, tandis qu’elle a atteint 3% en Italie. Le CAC 40 a perdu près de 2,5 % sur un mois. Le repli est encore plus net pour le Dow Jones, -4,29 % et le Nasdaq, -5,31 %.
Aux Etats-Unis, la croissance du PIB du deuxième trimestre a été confirmée à 6,6% en rythme annualisé, selon la dernière estimation du département du Commerce. A contrario, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 11 000 à 362 000, leur niveau le plus élevé en sept semaines, contre un repli à 33 000 anticipé par le consensus formé par Bloomberg témoignant d’un ralentissement de la croissance dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire outre-Atlantique.
Dans ce contexte, les taux d’intérêt des obligations d’Etat sont orientés à la hausse. L’euro poursuit sa baisse du fait de la préférence donnée à la devise américaine dans la perspective d’une augmentation rapide des taux dans ce pays.
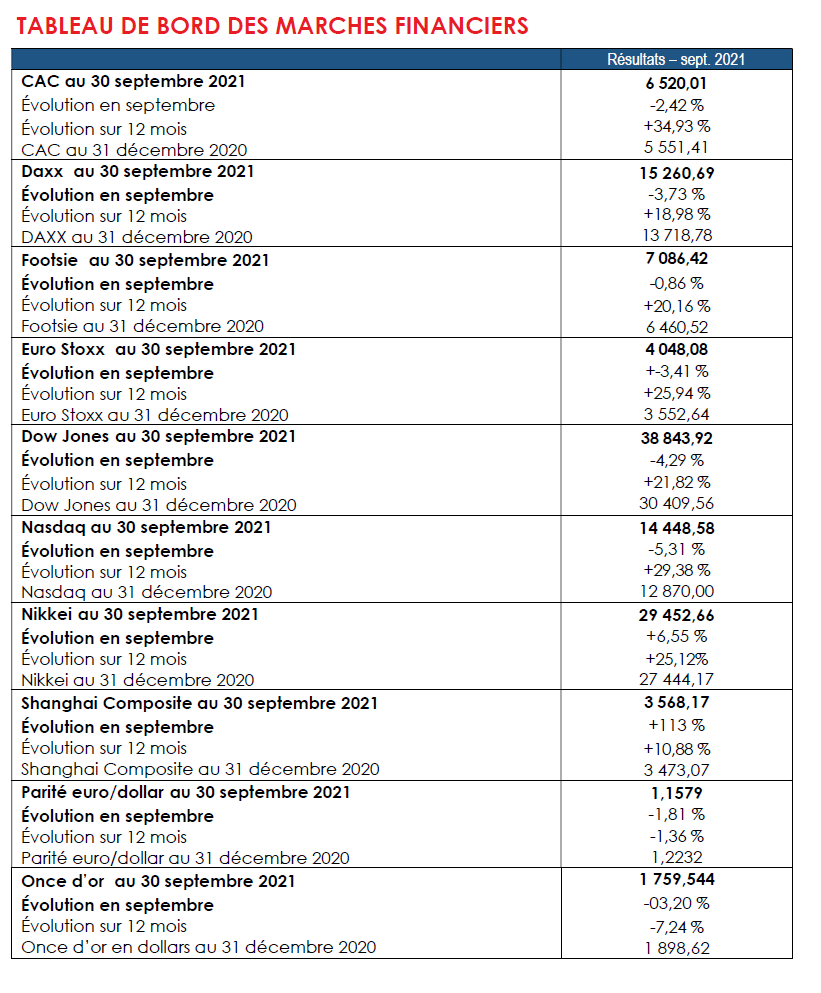
Les taux d’usure pour le 4e trimestre 2021
la Banque de France a publié les taux d’usure qui s’appliquent à compter du 1er octobre 2021.
| Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 3ème trimestre 2021 | Taux d’usure applicable au 1er octobre 2021 |
| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,87 | 21,16 |
| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,42 | 9,89 |
| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 3,74 | 4,99 |
| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,82 | 2,43 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,79 | 2,39 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 1,81 | 2,41 |
| Prêts à taux variable | 1,72 | 2,29 |
| Prêts relais | 2,16 | 2,88 |
| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,29 | 1,72 |
| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,13 | 1,51 |
| Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 1,51 | 2,01 |
| Découverts en compte | 11,45 | 15,27 |
| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,05 | 1,40 |
| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Découverts en compte | 11,45 | 15,27 |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants assoc
Le PER continue sur sa lancée
Commercialisé depuis le 1er octobre 2019, malgré un contexte plus qu’agité avec la crise sanitaire, selon la Fédération Française de l’Assurance, en pleine trêve estivale, 40 000 Plans d’Epargne Retraite ont été souscrits.26 000 correspondent à des nouveaux plans (+54 % par rapport à août 2020) et 14 000 sont issus de contrats transférés (+257 %). 847 millions d’euros de versements supplémentaires ont été enregistrés sur un mois dont 361 millions d’euros pour les nouveaux assurés (+167 % par rapport à août 2020) et 486 millions d’euros issus de contrats transférés (+255 %).
La collecte nette des PER s’élève à +303 millions d’euros sur le mois d’août et +2,3 milliards d’euros depuis le début de l’année. À la fin du mois d’août, plus de deux millions de Français détenaient un PER commercialisé par un assureur auxquels s’ajoutent ceux distribués par les banques et les mutuelles non affiliées à la FFA. L’encours des PER dépasse désormais 23 milliards d’euros.
L’assurance vie, un come back sans étincelle
L’assurance vie a enregistré, au mois d’août 2021, sa 11e collecte nette positive avec un gain, selon la Fédération Française de l’Assurance, de 2,2 milliards d’euros témoignant du processus de normalisation engagé après le premier confinement du printemps 2020. Cette collecte est supérieure à celle de 2019, avant la crise sanitaire, qui s’était élevée à 1,9 milliards d’euros. En 2020, la collecte nette avait été positive de 200 millions d’euros. Le mois d’août est en règle générale un mois correct pour l’assurance vie qui, lors de ces dix dernières années, a connu deux décollectes (2012, 2011). Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint +14,0 milliards d’euros, en forte hausse par rapport à 2020, mais en retrait par rapport à 2019 (+20 milliards d’euros).
Au mois d’août, avec les vacances, la collecte brute et les prestations sont traditionnellement faibles. Ainsi, cette année, les cotisations se sont élevées à 10,3 milliards d’euros, contre 12,5 milliards d’euros en juillet et 13,7 milliards d’euros en juin. Elles sont en phase avec celles de 2019 (10,1 milliards d’euros). Les unités de compte ont représenté, en août, 35 % de la collecte, contre 39 % en juillet. La proportion des unités de compte, depuis le début de l’année, atteint 38 %. Comme pour les cotisations, les prestations sont en recul en août par rapport à juillet, 8,1 contre 11,5 milliards d’euros. Elles sont proches de celles de 2019 (8,2 milliards d’euros). En 2020, elles avaient été en août de 7,8 milliards d’euros. À la fin du mois d’août 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignaient 1 854 milliards d’euros, en croissance de +5 % sur un an.
Les ménages reviennent progressivement vers l’assurance vie mais, pour le moment, le processus de réallocation de l’épargne « covid » n’a pas commencé. Cette épargne demeure placée principalement sur les comptes courants et sur les livrets d’épargne, réglementée ou pas. Malgré la normalisation de la situation sanitaire et économique, l’assurance vie n’a pas rattrapé le retard accumule en 2020. Il n’y a pas eu de rebond. Les ménages sont prudents et privilégient toujours la liquidité et la sécurité au détriment du rendement. Les épargnants optant pour l’assurance vie acceptent, en revanche, le jeu des unités de compte d’autant plus facilement que les marchés « actions » se portent bien.
Le processus de normalisation de la collecte devrait se poursuivre dans les prochains mois sauf reprise mal-maitrisée de l’épidémie. L’absence de rebond pour l’assurance vie restera sans nul doute de mise en raison notamment de la préférence actuelle des ménages pour l’immobilier qui demeure le placement préféré des Français.
L’épargne avant tout l’épargne pour les ménages français
Au mois de septembre, selon l’Insee, la confiance des ménages a augmenté. À 102, l’indicateur qui la synthétise gagne trois points et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période (100). L’amélioration de la situation sanitaire explique cette augmentation. La bonne tenue du marché de l’emploi y contribue également.
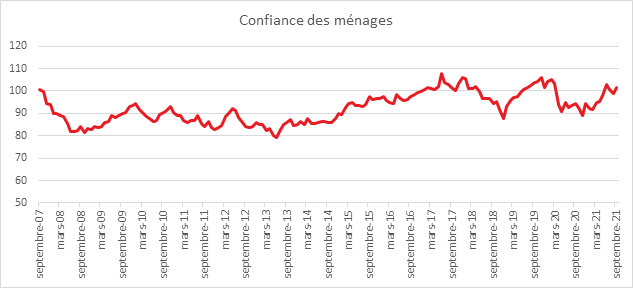
L’épargne toujours l’épargne
En septembre, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future gagne un point. Celui relatif à leur situation financière personnelle passée est stable. Ces deux soldes demeurent au-dessus de leur moyenne de longue période. La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants baisse en septembre perd trois points mais reste au-dessus de sa moyenne. En contrepartie, le solde d’opinion des ménages relatif à leur capacité d’épargne future rebondit de trois points. En revanche, celui relatif à leur capacité d’épargne actuelle se replie d’un point, tout comme celui sur l’opportunité d’épargner. Ces trois soldes restent très au-dessus de leur moyenne de longue période. Les ménages restent très prudents et privilégient toujours l’épargne.
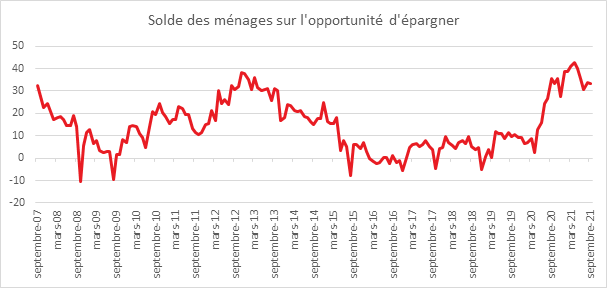
Pas de pessimisme pour le niveau de vie
Contrairement à certaines enquêtes d’opinion, selon l’INSEE, la proportion des ménages considérant que le niveau de vie en France s’améliorera au cours des douze prochains mois est en nette hausse. Le solde correspondant gagne onze points et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente aussi. Le solde correspondant gagne sept points mais reste en dessous de sa moyenne.
L’emploi, l’embellie
Avec l’amélioration de la situation du marché de l’emploi, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage sont en baisse. En dessous de sa moyenne de longue période depuis juin, le solde correspondant s’en éloigne davantage en perdant treize points ce mois-ci.
L’inflation, un sujet de préoccupation croissant pour les ménages
En septembre, la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois augmente légèrement. Le solde correspondant gagne quatre points et se situe bien au-dessus de sa moyenne, franchie en juillet après une nette hausse. Les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont un peu plus nombreux en septembre. Le solde correspondant gagne deux points et reste au-dessus de sa moyenne de longue période.
Le Coin des Epargnants du 25 septembre 2021 – La Chine avant la FED
Quand l’immobilier chinois inquiète plus que les annonces de la FED
La crainte d’un défaut de paiement du deuxième promoteur immobilier chinois, Evergrande, a inquiété les investisseurs. A la veille du week-end, le groupe n’a fait aucune annonce sur le versement attendu des 84 millions de dollars d’intérêt d’obligations. Evergrande, qui a accumulé l’équivalent de 300 milliards de dollars de dette, dispose d’un délai de grâce de 30 jours pour honorer ses échéances, avant d’être déclaré en défaut de paiement. La Présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a tenu à indiquer que l’exposition directe de l’Europe, en général, et de la zone euro, en particulier, est « limitée » face aux risques de faillite du promoteur chinois. Son homologue de la Fed, Jerome Powell, avait fait de même concernant l’économie américaine tout en reconnaissant que la situation pourrait avoir un impact sur les conditions financières au niveau mondial. Les autorités chinoises interviennent pour éviter une crise financière. La banque centrale a ainsi procédé à une injection de liquidités dans le système financier vendredi 24 septembre, portant le total de ses interventions à 460 milliards de yuans (60,5 milliards d’euros) sur les cinq derniers jours. Les investisseurs ont dû également composer avec la nouvelle dégradation du climat des affaires en Allemagne. L’indice calculé par l’institut Ifo est tombé à un plus bas de cinq mois en septembre à 98,8 points à deux jours des élections fédérales qui sont très incertaines. Ce troisième repli semble prouver que la croissance commence à s’essouffler outre-Rhin.
De son côté, les prix du pétrole continue sa progression, poussant l’inflation vers le haut. Cette augmentation du prix du baril s’explique par une offre restreinte notamment aux États-Unis après l’ouragan du mois dernier, et par une demande toujours forte. Selon l’Agence américaine d’information sur l’Énergie (EIA), les stocks américains reculent pour la septième fois consécutive. Les travaux de maintenance au Kazakhstan, ainsi que des perturbations imprévues de l’offre au Nigeria, au Mexique et en Libye, pèsent par ailleurs sur la production de l’Opep+», cartel de pays producteurs emmené par l’Arabie saoudite et la Russie. Le prix du baril de Brent qui atteint près de 78 dollars n’a jamais été aussi élevé depuis trois ans.
La persistance des menaces inflationnistes ont conduit à une vive hausse des taux d’intérêt cette semaine. Le taux de l’OAT à 10 ans est repassé au-dessus de 0,1 % et son équivalent américain s’est rapproché de 1,5 %. Les taux sont également portés par les annonces du mercredi 22 septembre de la Réserve Fédérale américaine. Elle a laissé entendre hier soir qu’elle entamerait son « tapering », c’est-à-dire la diminution progressive des rachats d’obligations, certainement vers la fin de l’année ou au début de l’année prochaine, et suggéré que la première hausse des taux interviendrait plus tôt qu’attendu. Jerome Powell a déclaré que si le rapport sur l’emploi de septembre se révélait « décent », une annonce concernant la réduction des achats d’actifs pourrait intervenir bientôt, ajoutant qu’un « achèvement du tapering vers le milieu de l’année prochaine semble être approprié ». Ces déclarations qui étaient anticipées par les marchés n’ont guère eu de conséquences sur le cours des actions qui sont en légère hausse sur la semaine, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 24 septembre 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 638,46 | +1,04 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 34 798,00 | +0,62 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 15 047,70 | +0,02 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 531,75 | +0,27 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 051,48 | +1,26 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 158,51 | +0,67 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 30 248,81 | -0,82 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 613.07 | -0,02 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,112 % | +0,158 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,227 % | +0,055 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,451 % | +0,081 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1719 | -0,08 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 751,650 | -0,10 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 77,920 | +3,31 % | 51,290 |
Le Livret A ne prend pas de vacances en 2021
Au mois d’août, le Livret A a enregistré une collecte positive de 1,67 milliard d’euros faisant suite à celle du mois de juillet (1,15 milliard d’euros). Au mois d’août 2020, elle s’était élevée à 2,25 milliards d’euros. La collecte moyenne pour le huitième mois de l’année s’élevait, pour ces dix dernières années à 1,2 milliard d’euros.
Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte cumulée a atteint 19,55 milliards d’euros, contre 24,5 milliards d’euros sur la même période en 2020. Pour l’année 2019, avant la crise sanitaire, la collecte cumulée s’était élevée à 14,71 milliards d’euros. La collecte, en août, pour le LDDS a été de 230 millions d’euros. Sa collecte depuis janvier a atteint 4,5 milliards d’euros.
La normalisation aperçue en juillet est donc toute relative, les ménages maintenant un effort élevé d’épargne de précaution. La collecte moyenne depuis le début de l’année est de deux milliards d’euros avec un pic en début d’année autour de 3 milliards d’euros. Depuis le mois de mai, la collecte moyenne avoisine les 1,25 milliard d’euros. Les ménages n’ont pas encore décidé de puiser dans leur cagnotte covid pour consommer ou pour réorienter leurs liquidités vers des placements à plus long terme. La quatrième vague a pu également les inciter à la prudence et les dissuader de réaliser certains achats La prudence reste de mise en attendant la suite de l’évolution de la situation sanitaire. Un autre facteur a joué en faveur du Livret A. Au mois d’août, les ménages ont pu bénéficier du versement du solde des réductions d’impôt qui a concerné près de 13 millions de contribuables et porté sur un montant de 10 milliards d’euros. Le Livret A n’est pas pénalisé par son rendement réel négatif du fait de la remontée de l’inflation. Les ménages perdent plus d’un point avec ce placement du fait que l’inflation qui était de 0,5 % en 2020 remonte progressivement. Elle atteint 1,2 % en juillet et 1,9 % en août en rythme annuel. La question du relèvement du taux du Livret A pourrait se poser au mois de février prochain si l’inflation reste autour de de 2 points. Il pourrait alors passer de 0,5 à 0,75 % voire à 1 %. L’augmentation du taux du Livret A qui est une décision éminemment politique pose néanmoins plusieurs problèmes économiques. Elle renchérirait le coût des emprunts pour le logement social et n’inciterait pas les ménages à consommer. Le gouvernement, à quelques semaines de l’élection présidentielle, aura un choix cornélien à effectuer. L’insensibilité des épargnants au rendement réel du Livret A s’explique par leur recherche absolue de sécurité et de liquidité.
Si l’épidémie poursuit son reflux, les flux d’épargne devrait s’amoindrir légèrement d’ici la fin de l’année qui est marquée par les dépenses de rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année. En revanche, en cas de rebond automnal du coronavirus, le Livret A devrait renouer avec de fortes collectes. Il demeure la valeur refuge par excellence dans un contexte de taux bas. Quoi qu’il en soit, en août, le Livret A a battu un nouveau record d’encours avec 346,1 milliards d’euros, tout comme le LDDS avec 126,3 milliards d’euros.
Le Coin des Epargnants du 17 septembre 2021 – quand les banques centrales font la pluie et le beau temps
La deuxième quinzaine de septembre réussit rarement aux marchés « actions ». Les vacances s’éloignent et le retour aux réalités économiques reprend le dessus. En 2021 ? les investisseurs sont, par ailleurs, sur la défensive compte tenu les données contradictoires en provenance de part et d’autre de l’Atlantique. La confiance du consommateur américain s’est légèrement améliorée en septembre, l’indice de l’Université du Michigan gagnant 0,7 point à 71 en première estimation, mais il reste en deçà des 72 anticipés par le consensus formé par Bloomberg. La composante des anticipations d’inflation à l’horizon d’un an augmente de 0,1 point à 4,7 %, comme prévu.
Le frein majeur à la prise de risque sur les marchés est le rendez-vous, mardi et mercredi prochains, du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine Celle-ci prépare la mise en place de la fin progressive des rachats d’obligations. La Fed devrait annoncer, en septembre que le tapering se rapproche, préparant ainsi le terrain à une à une décision en novembre pour une mise en œuvre en décembre. La BCE avait auparavant apporté un démenti aux propos prêtés par le Financial Times à son chef économiste, Philip Lane qui pouvaient laisser croire que la BCE était décidée à augmenter les taux en en 2023. Pablo Hernandez de Cos, membre du Conseil des gouverneurs a, pour éviter tout débat indiqué que la BCE n’avait prévu aucune augmentation des taux pour 2023. Cette agitation autour des banques centrales a contribué à la hausse des taux, celui de l’OAT à dix ans redevenant positif à +0,046 %.
Dans ce contexte, le CAC 40 est passé en-dessous des 6600 points en baisse de 1,40 % sur la semaine. Les grandes indices internationaux ont fait de même à l’exception du Nikkei japonais qui a légèrement progressé. Le pétrole a gagné près de 2,5 % du fait des perturbations que connaissent les gisements du Golfe du Mexique.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 17 septembre 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 570,19 | -1,40 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 34 584,88 | -0,07 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 15 043,97 | -0,47 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 490,17 | -0,77 % | 13 718,78 |
| Footsie | 6 963,64 | -0,93 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 130,84 | -0,95 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 30 500,05 | +0,39 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 613,97 | -2,59 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,046 % | +0,050 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,282 % | +0,049 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,370 % | +0,022 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1731 | -0,72 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 753,450 | -2,10 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 74,780 | +2,47 % | 51,290 |
Le Coin des Epargnants du 10 septembre 2021
La semaine a été marquée par les annonces de Christine Lagarde, la Présidente de la Banque Centrale Européenne et par la reprise du dialogue entre la Chine et les Etats-Unis. Les marchés restent dans l’expectative des évolutions des politiques monétaires et de la croissance dans un contexte sanitaire connaissant des phases de dégradation et d’amélioration assez rapides.
Tout le monde est conscient que les politiques de rachats d’obligations publiques par les banques centrales ne sont pas éternelles. Toute évocation de ce sujet n’en donne pas moins des sueurs froides au sein des marchés. Jeudi 9 septembre, la Présidente de la Banque Centrale Européenne a joué à l’équilibriste en annonçant une réduction légère des rachats dans le cadre du PEPP (son programme « urgence pandémie » de 1 850 milliards d’euros) mais qu’il ne s’agissait en aucun cas d’entamer un « tapering », c’est à dire un début d’extinction progressive du programme. Elle a précisé que « ce que nous avons décidé aujourd’hui, à l’unanimité, c’est de calibrer le rythme de nos achats de manière à atteindre notre objectif en matière de conditions de financement favorables. Nous n’avons pas discuté de la suite ». Les partisans de l’orthodoxie monétaire -, dont l’Allemand Jens Weidmann, le Néerlandais Klaas Knot et l’Autrichien Robert Holzmann souhaitaient une baisse du rythme des achats du PEPP, voire une fin anticipée du programme. La BCE doit tenir compte de la remontée de l’inflation, 5 % aux États-Unis et 3 % en zone euro même si, pour certains experts, celle-ci serait temporaire. De son côté, la Réserve fédérale américaine a confirmé sa volonté de commencer prochainement la réduction progressive de ses achats obligataires tout en la différant dans le temps.
i le taux français à 10 ans est repassé en territoire positif mardi, il est retourné en territoire négatif après les annonces de Christine Lagarde. La Banque Centrale Européenne a, à l’occasion de sa réunion de jeudi 9 septembre, révisé à la hausse ses prévisions de croissance. Le PIB de la zone euro progresser de 5 % cette année, alors qu’en mars, les experts de l’institution basée à Francfort ne tablaient que sur une croissance de 4 %. Ce qui signifie qu’au quatrième trimestre, la zone euro aura retrouvé son niveau de 2019. Selon les prévisions de la BCE, fin 2023, le PIB de la zone euro sera toujours inférieur de 4,1 % à ce qu’il aurait été sans Covid en retenant les taux de croissance des années 2014/2019. La zone euro aura perdu près de trois années de croissance. Les États-Unis, eux, devraient retrouver le PIB qu’ils auraient eu sans la pandémie dès la fin de cette année ou le début de l’année 2022. Pour la zone euro, le taux de croissance serait, en 2022, de 4,7 %. La Présidente de la BCE s’est félicitée de l’amélioration rapide du marché du travail. Elle a reconnu cependant que les pressions inflationnistes sous-jacentes ont augmenté. Sur les douze derniers mois, en août, l’inflation a atteint 3 % dans la zone euro et les économistes de la BCE tablent sur une hausse des prix à la consommation de 2,2 % sur l’année en cours. Pour 2022, elle estime qu’elle repasserait en-dessous de 2 % (1,7 %).
La Bourse de Paris a perdu 0,39 % sur la semaine en finissant à 6 654,30 points. Les autres indices européens ont également cédé un peu de terrain. Le marchés sont à la fois freiné par les craintes concernant la croissance mondiale et rassuré par l’annonce de l’entretien téléphonique entre Joe Biden et Xi Jinping, le premier depuis près de six mois. Toute reprise de contacts entre les deux grandes puissances économiques est toujours perçue favorablement par les investisseurs. Ces derniers ont accueilli favorablement les précisions parues dans la presse chinoise selon lesquelles Pékin a ralenti et non gelé l’octroi des autorisations réglementaires pour les éditeurs de jeux. L’accélération Sur le plan macro-économique, l’accélération des prix se poursuit aux Etats-Unis. Les prix à production ont augmenté de 0,7 % aux Etats-Unis en août, contre +0,6% anticipé par les analystes, et de 8,3% sur un an (+7,8% en juillet). Hors alimentation et énergie, les prix se sont renchéris de 0,6 %, comme prévu, et de 6,7 % par rapport à août 2020 (+6,2 % le mois précédent).
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 10 septembre 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 663,77 | -0,39 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 34 607,72 | -2,15 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 15 115,49 | -1,61 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 609,81 | -1,09 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 028,94 | -1,53 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 170,35 | -0,75 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 30 381,84 | +4,30 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 703,11 | +3,39 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,004 % | +0,017 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,331 % | +0,033 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,348 % | +0,024 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1818 | -0,60 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 793,026 | -2,04 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 72,920 | +0,61 % | 51,290 |
Épargne, retour sur une année atypique
Selon le rapport annuel de l’Observatoire de l’Épargne Réglementée rendu public le 7 septembre 2021, le patrimoine financier des ménages résidant en France s’élevait, fin 2020, à 5 685 milliards d’euros. L’année dernière, le flux d’épargne des ménages avait atteint 205 milliards d’euros à comparer aux 130 milliards d’euros de 2019 (+58 %). Par rapport au flux de ces dix dernières années, l’augmentation a été de 119 %.
Les versements sur les produits de taux ont atteint 159 milliards d’euros en 2020, contre 122 milliards en 2019. Ils ont capté 80 % des flux. Pour comparaison ces placements représentaient 68 % des flux en 2019 et 67 % en 2018. Le montant net des placements vers les produits de fonds propres (actions et unités de compte) s’est élevé à 47 milliards d’euros, contre 12 milliards en 2019. 47 % des sommes épargnées l’ont été en numéraire ou sur les dépôts à vue, 20 % sur des produits d’épargne réglementée, 12 % sur d’autres dépôts rémunérés. Au niveau des encours, les produits de taux atteignent 65 %, contre 34 % pour les produits de fonds propres.
L’assurance vie a conservé, en 2020, sa première place pour les placements financiers des ménages (38 % du patrimoine financier, dont 31 points en fonds euros et 7 points en unités de compte). Les dépôts bancaires dépôts à vue, épargne réglementée, PEL, livrets ordinaires et numéraire) représentaient 32 % du patrimoine financier, contre 24 % pour les actions et assimilées. Les dépôts à vue et le numéraire ont progressé de 15 % en 2020, contre +5 % pour l’ensemble du patrimoine financier. Sur ces dix dernières années, la hausse des dépôts à vue a été importante (+10 % en moyenne annuelle). Ils ont été le premier point d’accueil de l’épargne « covid ». Fin juin 2021, leur encours avait atteint le montant historique de 500 milliards d’euros.
800 000 titulaires supplémentaires ont atteint le plafond du Livret A et du LDDS en 2020
Le nombre de Livrets A était, en France, en 2020, 55,7 millions dont 54,9 millions de personnes physiques. Le taux de détention est de 81,5 % pour ces dernières. 2,6 millions de livrets ont été ouverts et 2,5 millions ont été fermés par des personnes physiques. 34 % ont été ouverts par des moins de 25 ans. 57 % des Livrets A ont plus de dix ans. L’encours total du Livret A fin 2020 était de 326,4 milliards d’euros dont 303,8 milliards d’euros pour les personnes physiques. L’encours a progressé de 27,8 milliards d’euros (+9,3 %), soit la cinquième plus forte hausse de son histoire. En 2020, 167 milliards d’euros ont été versés et près de 140 milliards d’euros ont été retirés.
L’encours moyen du Livret A est de 5 500 euros pour une personne physique, contre 5 100 en 2019 et 4800 en 2018. 7 % des Livrets A dépassent le plafond. Les livrets concernés représentent 30 % de l’encours. Les titulaires de plus de 65 ans détiennent 34 % de l’encours quand leur poids de la population totale était au 1er janvier 2021 de 21 %. 6,5 millions de détenteurs de Livret A ou de LDDS sont au plafond. Ce nombre a augmenté de 800 000 en 2020. 5 millions de Livrets A sont inactifs depuis au moins cinq ans dont 3,8 millions ont moins de 150 euros. Le nombre moyen de versements réalisés par an était, en 2020, de 5,2 quand celui des retraits était de 5.
Le nombre de Livret de Développement Durable et Solidaire s’élevait fin 2020 à 24,3 millions. Le taux de détention est de 43 %. 1,7 million ont été ouverts l’année dernière et 1,5 million ont été fermés. L’encours a atteint, au 31 décembre 2020, 121,5 milliards d’euros en hausse de 9,2 milliards d’euros en un an, ce qui constitue sa sixième progression la plus importante de son histoire. Les versements se sont élevés à 53 milliards d’euros et les retraités à 43 milliards d’euros. L’encours moyen des LDDS était de 5 000 euros en 2020, contre 4 600 en 2019. 20 % des LDDS dépassaient, au 31 décembre 2020, le plafond de 12 000 euros représentant 50 % des encours. Les détenteurs de plus de 65 ans détiennent 35 % des livrets et 41 % de l’encours. 1,3 million de LDDS sont inactifs depuis au moins cinq ans.
Le Livret d’Épargne Populaire, un produit qui ne trouve toujours pas son public
Le nombre de Livrets d’Épargne Populaire (LEP) a atteint 7 millions à la fin 2020, en baisse de 248 000 sur l’année. Le taux de détention des LEP qui est de 13,3 % reste faible, quand 50 % des personnes y ont potentiellement droit. La rémunération de 1 % n’attire pas les épargnants modestes qui continuent à privilégier le Livret A. Les mesures de simplification prises par le Gouvernement pour la vérification des conditions de ressources pour bénéficier d’un LEP n’ont pas conduit à une augmentation du nombre de titulaires. En revanche, à la différence des années précédentes, la diminution de l’encours s’est ralentie. Il a baissé de 60 millions d’euros pour s’établir 39,3 milliards d’euros. Les versements ont atteint 11,9 milliards d’euros quand les retraits se sont élevés à 11 milliards d’euros. les fermetures de plans expliquent la baisse de l’encours. Le montant moyen des LEP était de 5 600 euros. 43 % des LEP dépassent le plafond fixé à 7 700 euros. Ces LEP représentent 69 % de l’encours. Les plus de 65 ans détiennent 53 % de l’encours.
Les Plans d’Épargne Logement dans le collimateur de la Banque de France
Les Plans d’Épargne Logement (PEL) sont au nombre de 12,8 millions en repli de 500 000 en un an. Le taux de détention est de 19 %, contre 20 % en 2019. L’encours des PEL s’élevait à la fin de l’année 2020 à 294,2 milliards d’euros, en hausse de 12 milliards d’euros en un an. Les versements se sont élevés à 28 milliards et les retraits à 27 milliards d’euros. La baisse du nombre de PEL s’explique par le moindre engouement pour ce produit depuis sa fiscalisation et la baisse du rendement intervenus le 1er janvier 2018. Le taux moyen de rendement des PEL était, en 2020, de 2,62 %. 43 % des PEL, représentant 45 % de l’encours, ont un taux d’intérêt égal à 2,5 %. 5 % des PEL représentant 11 % de l’encours, sont rémunérés à un taux égal à 5,25 %. 3,35 millions ayant un encours global de 111 milliards d’euros sont concernés. L’encours moyen des PEL est de 22 900 euros. 11 % des PEL ont un encours dépassant le plafond de 61 200 euros (34 % de l’encours). Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 37 % de l’encours. La Banque de France souligne le coût élevé des PEL pour les banques et demande, à demi-mot, une réforme au gouvernement qui craint, sur ce sujet, une annulation par le Conseil constitutionnel, en cas d’adoption de mesures rétroactives touchant des clauses substantielles du contrat.
Prolongeant le bilan de 2020, la Banque de France a indiqué que depuis le mois de mars 2020, les sommes épargnées au-delà du niveau habituel ont atteint 157 milliards d’euros. Fin 2020, elles s’élevaient à 111 milliards d’euros. Cette épargne est loin d’être inutile. Elle permet, selon l’économiste en chef de la direction du Trésor, Agnès Bénassy-Quéré, de financer le déficit des administrations publiques (212 milliards d’euros en 2020) et le besoin de financement résiduel des entreprises françaises (30 milliards d’euros en 2020), sachant que malgré tout la France a eu besoin d’un apport extérieur de 60 milliards d’euros. Les banques et les assureurs ont utilisé l’argent déposé pour prêter et souscrire des obligations ou des actions.
Résultats de l’assurance vie en juillet, du qualitatif avant tout
En juillet, l’assurance vie a enregistré, selon la Fédération Française de l’Assurance, sa dixième collecte nette positive avec 1,1 milliard d’euros. Cette collecte s’érode depuis le mois de mars où elle s’élevait à 1,9 milliard d’euros. En règle générale, le mois de juillet réussit bien à l’assurance vie qui a, lors de ces dix dernières années, connu une seule décollecte, en 2020. Le montant de la collecte moyenne était supérieur à 2 milliards d’euros. Le résultat du mois de juillet témoigne du fait que les épargnants restent prudents. Il n’y a pas eu, pour le moment, de rattrapage par rapport à la période de décollecte de l’année 2020. Depuis le début de l’année, la collecte nette a été de 12 milliards d’euros, contre -4 milliards d’euros en 2020. En 2019, avant la crise sanitaire, sur les sept premiers mois de l’année, la collecte avait été 17 milliards d’euros.
Au mois de juillet, les cotisations brutes se sont élevées à 12,7 milliards d’euros, en retrait d’un milliard d’euros par rapport au mois de juin 2021. Elles sont inférieures à celles du mois de juillet 2019 (13,4 milliards d’euros). Les unités de compte ont représenté 38,5 %, en juillet, de la collecte brute. Le montant des prestations versées sur le mois de juillet 2021 s’est élevé à 11,6 milliards d’euros contre 12,3 milliards d’euros en juin et 10,8 milliards d’euros en juillet 2020.
Fin juillet 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 848 milliards d’euros, en progression de +5 % sur un an.
L’assurance vie devient un produit plus sélectif et qualitatif, les assurés devant accepter une part de risque plus élevée. Avec la baisse de leur rendement, les fonds euros sont moins attractifs. Certains assurés refusent de prendre des risques sur 30 ou 40 % de leurs versements et préfèrent y renoncer. Ces épargnants optent alors pour les livrets d’épargne réglementée et les livrets bancaires fiscalisés qui bénéficient de la garantie en capital voire les dépôts à vue dont l’encours a dépassé 500 milliards d’euros en juin. L’assurance vie est de plus en plus un concurrent du compte titre ou du Plan d’Épargne en Actions. Cependant, elle bénéficie toujours d’un volet sécurisé avec les fonds euros et d’avantages fiscaux ainsi que de la possibilité de déroger au droit de la succession. Après avoir épargné, essentiellement en liquidités de 120 à 140 milliards d’euros de plus qu’en période normale, depuis le mois de mars, les ménages n’ont pas encore décidé de les réaffecter. La cassette « covid » reste pleine. Les ménages souhaitent, pour le moment, conserver un fort volume d’épargne de précaution afin de parer à toutes les éventualités, le niveau élevé d’incertitudes sur le plan sanitaire et économique expliquant cette prudence. Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, les crises successives ont amené les Français à maintenir un niveau plus élevé de liquidités.
Les réserves de l’Etat fin août 2021
Selon le Ministère de l’Economie, les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises de l’Etat s’élèvaient à la fin du mois d’août 2021 à 213,9 milliards d’euros contre 190,654 milliards d’euros à la fin du mois de juillet 2021, soit une augmentation de 23, 276 milliards d’euros. Cette augmentation est liée notamment aux variations de cours et de change. Les réserves de l’Etat se répartissent comme suit :
- 120 milliards d’euros de réserves en or
- 53 milliards d’euros de réserves en devises
- 39 milliards d’euros de créances sur le FMI
- 1,5 milliards d’euros en autres avoirs de réserve
Une cassette bien utile 157 milliards d’euros épargnés depuis le début de la crise sanitaire
A la fin juin, selon la Banque de France, les sommes épargnées au-delà du niveau habituel ont atteint 157 milliards d’euros, à la fin de l’année dernière, elles s’élevaient à 111 milliards d’euros. Cette épargne est loin d’être inutile. Elle permet, selon l’économiste en chef de la direction du Trésor, Agnès Bénassy-Quéré, de financer le déficit des administrations publiques (212 milliards d’euros en 2020) et le besoin de financement résiduel des entreprises françaises (30 milliards d’euros en 2020) sachant que malgré tout la France a eu besoin d’un apport extérieur de 60 milliards d’euros. Les banques et les assureurs ont utilisé l’argent déposé pour prêter et souscrire des obligations ou des actions.
L’année exceptionnelle de l’épargne en 2020
La Banque de France a rendu public, le 7 septembre 2021, le rapport annuel de l’Observatoire de l’Epargne Réglementée. L’année 2020 est par définition une année hors norme pour l’épargne avec un flux de 205 milliards d’euros à comparer avec les 130 milliards d’euros de 2019 (+58%). Par rapport au flux de ces dix dernières années, l’augmentation est de 119 %.
En 2020, les produits de taux représentent 65 % des encours de placements des ménages, et les produits de fonds propres 34 %.
Les flux nets de placements en produits de taux ont représenté 159 milliards d’euros en 2020, contre 122 milliards en 2019.. Les flux nets de placement vers les produits de fonds propres ont atteint en 2020 47 milliards d’euros, contre 12 milliards en 2019. Ces flux nets sont la conséquence d’une montée en puissance des placements tant sur les actions
que sur les contrats d’assurance-vie en unités de compte.
En 2020 près de 80% des flux de placements financiers concernent le numéraire et les dépôts à vue (47%), l’épargne réglementée (20 %) et les autres dépôts rémunérés (12 %). Pour comparaison ces placements représentaient 68% des flux en 2019 et 67% en 2018 : la prédilection des ménages pour ces placements était donc préexistante mais la crise pandémique l’a nettement
accentuée.
Les épargnants et les assureurs au service de la reprise économique
Depuis le début de l’année, les unités de compte représentent 38 %% de la collecte de l’assurance vie. Ces dernières contribuent au financement de l’économie. Elles sont investies à hauteur de 83 % en actifs d’entreprises (57 % en actions, 17 % en obligations et 9 % en immobilier). Par ailleurs, les les placements des assureurs vie en fonds labellisés « Relance » ont atteint 5,4 milliards d’euros au 30 juin 2021, dont 3,8 milliards d’euros au titre des supports en unités de compte. Le label « Relance », lancé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance en octobre 2020, est accordé à des fonds d’investissement mobilisant rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises. L’assurance vie soutient également le capital investissement, à hauteur de 23,3 milliards d’euros.
L’assurance vie, un produit d’épargne plus sélectif et qualitatif
En juillet, l’assurance vie a enregistré, en juillet, selon la Fédération Française de l’Assurance, sa dixième collecte nette positive avec 1,1 milliard d’euros. Cette collecte s’érode depuis le mois de mars où elle s’élevait à 1,9 milliard d’euros. En règle générale, le mois de juillet réussit bien à l’assurance vie qui, a lors de ces dix dernières années, connu une seule décollecte, en 2020. Le montant de la collecte moyenne était supérieur à 2 milliards d’euros. Le résultat du mois de juillet témoigne que les épargnants restent prudents. Il n’y a pas eu pour le moment de rattrapage par rapport à la période de décollecte de l’année 2020. Depuis le début de l’année, la collecte nette a été de 12 milliards d’euros, contre -4 milliards d’euros en 2020. En 2019, avant la crise sanitaire, sur les sept premiers mois de l’année, la collecte avait été 17 milliards d’euros
Au mois de juillet, les cotisations brutes se sont élevées à 12,7 milliards d’euros en retrait d’un milliard d’euros par rapport au mois de juin 2021. Elles sont inférieures à celles du mois de juillet 2019 (13,4 milliards d’euros). Les unités de compte ont représenté 38,5 %, en juillet, de la collecte brute. Le montant des prestations versées sur le mois de juillet 2021 s’est élevé à 11,6 milliards d’euros contre 12,3 milliards d’euros en juin et 10,8 milliards d’euros en juillet 2020.
Fin juillet 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 848 milliards d’euros, en progression de +5 % sur un an.
Dans un contexte anxiogène sur l’avenir des retraites, le Plan d’Epargne Retraite continue sa montée en puissance. Il bénéficie d’un avantage fiscal à l’entrée et d’une sortie en capital fortement appréciée par les ménages. En juillet, selon la Fédération Française de l’Assurance, 100 000 personnes supplémentaires ont souscrit un PER (dont 60 000 nouveaux assurés et 40 000 issus de contrats transférés). Les versements sur les PER ont atteint 844 millions d’euros, dont 370 millions d’euros de cotisations et 474 millions d’euros au titre de transferts d’autres contrats d’épargne retraite. Sur les sept premier mois de l’année, les PER ont bénéficié de 2,7 milliards d’euros de cotisation. Au 31 juillet 2021, le nombre d’assurés ayant un PER avoisine les 2 millions. Les encours s’élèvent à plus de 22 milliards d’euros dont la moitié en unités de compte grâce notamment à la gestion pilotée.
L’assurance vie devient un produit plus sélectif et qualitatif, les assurés devant accepter une part de risque plus élevée. Avec la baisse de leur rendement, les fonds euros sont moins attractifs. Certains assurés refusent de prendre des risque sur 30 ou 40 % de leurs versements et préfèrent y renoncer. Ces épargnants optent alors pour les livrets d’épargne réglementée et les livrets bancaires fiscalisés qui bénéficient de la garantie en capital voire les dépôts à vue dont l’encours a dépassé 500 milliards d’euros en juin. L’assurance vie est de plus en plus un concurrent du compte titre ou du Plan d’Epargne en Actions. Elle offre certes toujours d’un volet sécurisé avec les fonds euros et d’avantages fiscaux ainsi que de la possibilité de déroger au droit de la succession.
Après avoir épargné, essentiellement en liquidités de 120 à 140 milliards d’euros de plus qu’en période normale, depuis le mois de mars, les ménages n’ont pas encore décidé de les réaffecter. La cassette « covid » reste pleine. Les ménages souhaitent, pour le moment, conserver un fort volume d’épargne de précaution afin de parer à toutes les éventualités, le niveau élevé d’incertitudes sur le plan sanitaire et économique expliquant cette prudence. Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, les crises successives ont amené les Français à maintenir un niveau plus élevé de liquidités.
Marchés, une rentrée toute en douceur et en prudence
Les Etats-Unis n’ont créé que 235 000 emplois au mois d’août, contre 733 000 attendus et 1,05 million en juillet. L’analyse de ce résultat est délicat car le nombre d’emplois non pourvus atteindrait 10,5 millions. Est-ce une inadéquation entre offre et demande qui aboutit à ralentir les créations d’emploi, les hausses de salaire ou la diffusion du variant delta ? L’ensemble de ces facteurs ont pu jouer en août qui est rarement un bon mois pour l’emploi aux Etats-Unis. Au-delà de ce mauvais chiffre, les investisseurs s’inquiètent des pressions inflationnistes générées par la progression des salaires américains. Ils ont augmenté de 4,3 % sur un an en août, contre 4 % attendu et 3,9 % en juillet. Sur un mois, ils montent de 0,6 %, deux fois plus qu’escompté. Faible création et inflation est le plus mauvais scénario pour la Réserve Fédérale qui pourrait être contrainte d’arbitrer entre inflation et activité. Pour voir plus clair sur ce sujet, il faudra attendre la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale est programmée pour les 21 et 22 septembre.
Les signes de ralentissement en Chine et les doutes concernant l’orientation de l’économie américaine ont conduit les investisseurs à se réfugier dans l’attentisme. Les indices européens ont été globalement stables sur la semaine. Au Japon, en revanche, l’indice Nikkei 225, a connu une forte progression du fait de l’annonce de la démission du Premier Ministre, Yoshihide Suga, critiqué pour sa gestion de la pandémie. Les prétendants ont annoncé un plan de relance de plusieurs centaines de milliards de dollars (dizaines de milliers de milliards de yens) pour lutter contre la crise sanitaire. Aux Etats-Unis, il convient également de signaler la poursuite des valeurs technologiques.
Un mois d’août correct pour les marchés « actions »
Le CAC 40 a en août enchainé son septième mois consécutif de hausse. Il a surtout failli battre son record du 4 septembre 2000 qui est toujours de 6 922,33 points. Ce record devrait donc franchir le cap inédit pour les grands marchés financiers internationaux des 21 ans. Les tensions de la fin du mois ont empêché son dépassement. La menace inflationniste, les annonces d’une sortie progressive des politiques monétaire expansionnistes, la quatrième vague de l’épidémie ont ralenti, à la fin du mois d’août, la marche en avant des marchés. Il n’en demeure pas moins que le mouvement de hausse se poursuit dans un contexte de faibles taux et de reprise économique. Les valeurs technologiques ont continué de battre des records, le Nasdaq progressant de 4 % en août.
Le prix du baril de pétrole d’est effrité tout en dépassant fin août les 70 dollars. L’augmentation possible dans les prochains mois de la production des membres de l’OPEP commence à peser sur les cours.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 3 septembre 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 689,99 | +0,12 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 35 369,09 | -0,24 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 15 363,52 | +1,55 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 781,20 | -0,28 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 138,35 | -0,14 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 201,98 | +0,26 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 29 128,11 | +5,38 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 581,73 | +1,69 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,021 % | +0,047 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,364 % | +0,058 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,324 % | +0,008 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1885 | +0,79 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 814,080 | +1,77 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 72,710 | +0,22 % | 51,290 |
En route vers un patrimoine public nul
La dette publique française a atteint 118 % du PIB en 2020, en progression de vingt points en raison, en grande partie, de la crise sanitaire. En prenant en compte le passif et l’actif, le patrimoine net des administrations publiques représentait 8,2 % du PIB l’année dernière, contre 12,9 % en 2019. Cette appréciation par rapport au PIB peut être sujette à question car le patrimoine qui est un stock est comparé à un flux censé évaluer la création de richesses en France durant une année. Or, en 2020, celle-ci a diminué de 8 points. La faible contraction du patrimoine net de l’État s’explique également par la bonne tenue des actifs financiers qui ont gagné 12,8 points de PIB par rapport à 2019. Ils représentaient 69 % du PIB, du fait d’une hausse des liquidités détenues par les administrations. La hausse de la valeur des biens immobiliers augmente la valeur du patrimoine de l’État. Les actifs non financiers ont, selon le cabinet Fipeco, leur valeur augmenté de 11,2 points sur un an, représentant 102,8 % du PIB fin 2020.
De 1995 à 2020, le patrimoine net de l’État est passé 28 % à 8 % du PIB. Compte tenu de l’évolution de la dette publique, un patrimoine nul d’ici 2030 est probable sauf reprise vive de la croissance.
La bourse de Paris tout près d’un record en août
Le CAC 40 a en août enchainé son septième mois consécutif de hausse. Il a surtout failli battre son record du 4 septembre 2000 qui est toujours de 6 922,33 points. Ce record devrait donc franchir le cap inédit pour les grands marchés financiers internationaux des 21 ans. Les tensions de la fin du mois ont empêché son dépassement. La menace inflationniste, les annonces d’une sortie progressive des politiques monétaire expansionnistes, la quatrième vague de l’épidémie ont ralenti, à la fin du mois d’août, la marche en avant des marchés. Il n’en demeure pas moins que le mouvement de hausse se poursuit dans un contexte de faibles taux et de reprise économique. Le prix du baril de pétrole est en légère décrue tout en dépassant fin août les 70 dollars.
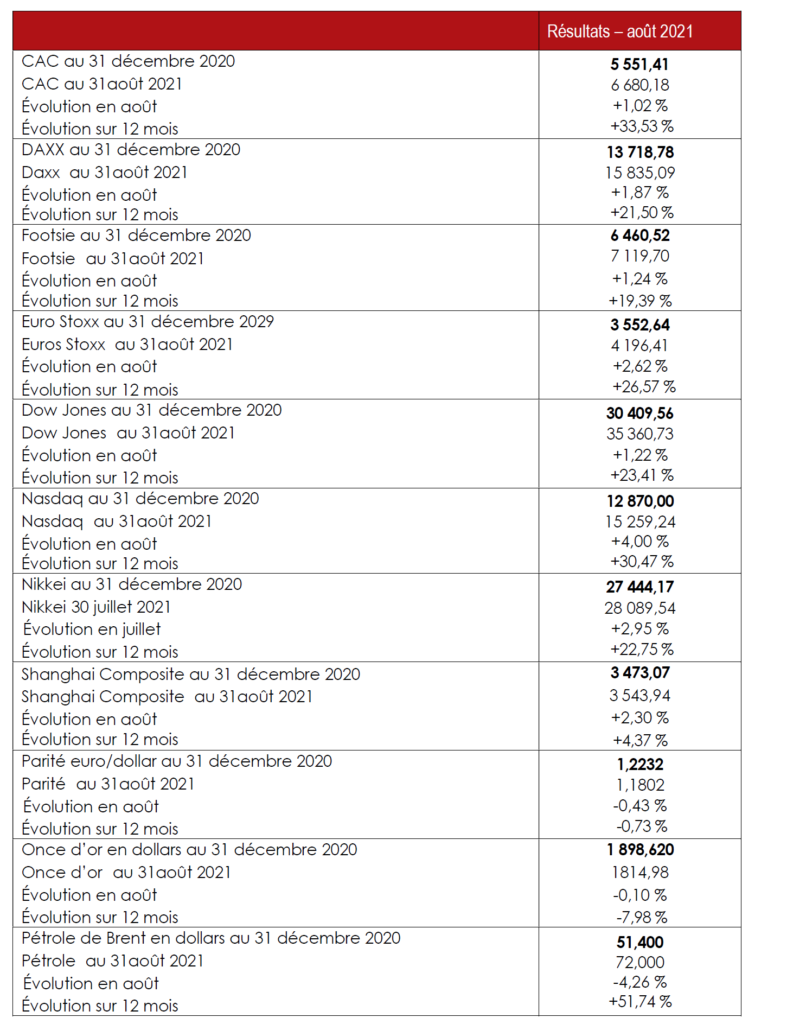
Taux de rémunération de l’argent de court terme, de plus en plus bas
Selon la Banque de France, en juillet, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaire a continué de baisser, deux points de base en moins par rapport au mois précédent, pour s’établir à 0,41 %. Cette diminution s’explique par une moindre rémunération des dépôts à vue, tant des ménages que des sociétés non-financières en lien avec un changement de réglementation et dans un contexte baissier pour les taux. Le taux de rémunération des consignations et versements est désormais de 0,30% contre 0,75% précédemment. Ces sommes représentent au 31 juillet moins de 2% des dépôts bancaires des ménages et des dépôts des offices HLM classés en dépôts à vue et comptes à terme des SNF. Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés est de 0,10 stable par rapport à juin.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| juil- 2020 | mai-2021 | juin-2021 (e) | juil- 2021 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
| Ménages | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,56 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,12 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| – plan d’épargne-logement | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| SNF | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| dont : – dépôts à vue | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,00 | 0,74 | 0,72 | 0,69 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,44 | -0,54 | -0,54 | -0,55 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,54 | -0,38 | -0,41 | -0,51 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Les Français n’ont pas commencé à puiser dans leur cassette « covid »
Avec le maintien de leur pouvoir d’achat, les ménages ont pu maintenir un fort taux d’épargne au cours du deuxième trimestre. Le troisième confinement les a, en effet, conduits à renoncer de manière forcée à certaines dépenses. La levée des contraintes sanitaires à partir du mois de mai a certes permis un rebond des dépenses de la consommation à la fin du trimestre, expliquant la légère décrue du taux d’épargne qui est passé du premier au deuxième trimestre 2021 de 21,6 à 21,4 % du revenu disponible brut. Il reste plus de cinq points au-dessus de son niveau moyen de 2019 (15 %).
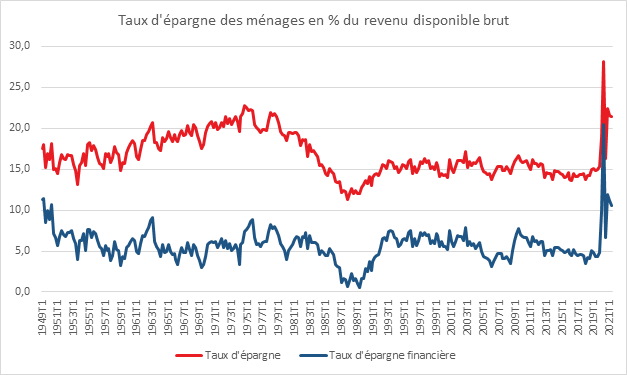
Les Français n’ont pas durant le deuxième trimestre puisé dans leur bas de laine. Ils ont simplement réduit, de manière très modérée, leur effort d’épargne. Ils demeurent prudents et attentistes face à un contexte économique et sanitaire incertain. Le retour au taux d’épargne de longue tendance, autour de 15 % suppose une normalisation de la situation.
Les ménages ont durant le premier semestre privilégié la liquidité et la sécurité au rendement, les premiers placements étant les dépôts à vue, les livrets d’épargne réglementée et les livrets bancaires fiscalisés. La bonne tenue des actions et des unités de compte reste marginale par rapport à la tendance de fond. Elle dénote néanmoins l’acceptation d’une prise de risques en contrepartie d’un rendement potentiel plus élevé de la part de certains épargnants.
Le Coin des Epargnants du 27 août 2021 : nouveaux records à New York
Lors du symposium de Jackson Hole aux Etats-Unis, Jerome Powell, le Président de la FED, a confirmé que, conformément aux prévisions, les achats d’actifs de la banque centrale (actuellement 120 milliards de dollars par mois) seraient réduits dès cette année. En revanche, il a souligné que du chemin restait à parcourir pour la hausse des taux directeurs. Il a indiqué que « nous continuerons nos achats d’actifs au rythme actuel jusqu’à ce que nous voyions de nouveaux progrès substantiels vers nos objectifs maximaux d’emploi et de stabilité des prix, mesurés depuis décembre dernier, lorsque nous avons formulé cette orientation pour la première fois. Mon point de vue est que des progrès substantiels ont été constatés pour l’inflation. Il y a également eu des progrès évidents en ce qui concerne l’emploi ». Le Président de la FED n’a fait que reprendre le contenu du compte-rendu de la réunion du mois de juillet du Conseil de politique monétaire (FOMC). Les tenants de la ligne dure d’une réduction rapide des rachats d’obligations peuvent apparaître déçus car le Président de la FED n’a pas fixé de calendrier. Compte tenu de la menace du variant Delta, il semble vouloir gagner du temps, certainement jusqu’en novembre.
Les indices « actions » ont été peu touchés par les propos du Président de la FED. Ils sont restés globalement stables sur la semaine, à l’exception du Nasdaq qui a progressé de près de 3 %. La bourse de New York a battu de nouveaux records vendredi 27 août pour le Nasdaq et le S&P500. Les différents indices économiques (PMI, indices INSEE sur le climat des affaires ou la confiance des ménages) traduisent un effritement de l’activité sans tomber dans un pessimisme excessif. Les indices « actions » évoluent en fonction du sac et du ressac de l’épidémie et des déclarations sur la politique monétaire. De son côté, le baril de pétrole a gagné plus de 10 % cette semaine dopé par la future réunion de l’OPEP.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 27 août 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 681,92 | +0,84 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 35 455,80 | +0,96 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 15 129,50 | +2,82 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 851,75 | +0,28 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 148,01 | +0,85 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 190,98 | +1,05 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 27 641,14 | +2,32 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 522,16 | +2,77 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,068 % | +0,081 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,422 % | +0,073 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,316 % | +0,063 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1792 | +0,83 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 814,080 | +1,77 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 72,460 | +11,37 % | 51,290 |
Confiance en baisse, épargne en hausse
Au mois d’août, avec la montée en puissance de la quatrième vague de Covid, la confiance des ménages, en France, a, selon l’INSEE légèrement diminué. A 99, l’indicateur qui la synthétise perd un point et repasse en-dessous de sa moyenne de longue période (100).
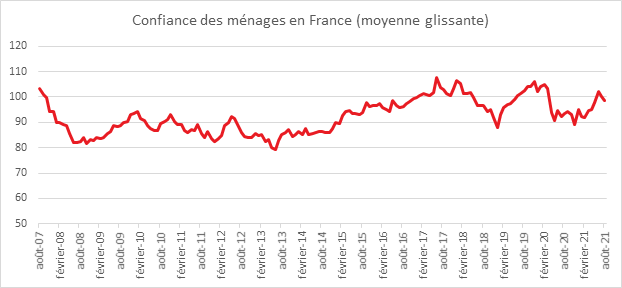
En août, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future a diminué de deux points. Celui relatif à leur situation financière personnelle passée perd également un point. Ces deux soldes demeurent néanmoins bien au-dessus de leur moyenne de longue période.
La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est stable, au-dessus de sa moyenne de longue période. En août, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente à nouveau, après trois mois consécutifs de baisse. Le solde correspondant gagne trois points, et reste très au-dessus de sa moyenne. Cette remontée de l’opportunité d’épargner traduit la crainte d’une détérioration de la situation dans les prochains mois. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur capacité d’épargne actuelle augmente de trois points. Preuve d’une inquiétude en augmentation, le solde d’opinion relatif à leur capacité d’épargne future perd deux points. Ces deux soldes restent très au-dessus de leur moyenne de longue période.
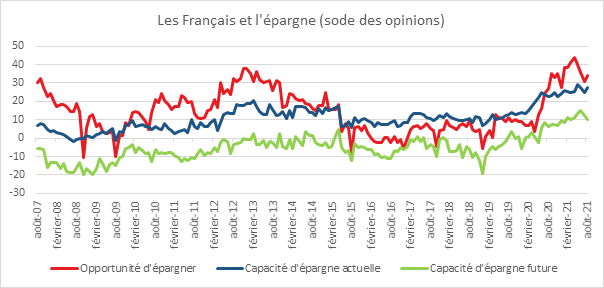
En août, dans le prolongement des résultats précédents, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’améliorera au cours des douze prochains mois est en nette baisse pour le deuxième mois consécutif. Le solde correspondant perd neuf points et passe en dessous de sa moyenne. À l’inverse, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente très légèrement. Le solde correspondant gagne un point mais reste très en dessous de sa moyenne de longue période.
Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage sont stables en août. Le solde correspondant se maintient en dessous de sa moyenne de longue période.
En août, la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois augmente légèrement. Le solde correspondant gagne deux points et se situe au-dessus de sa moyenne, franchie en juillet après une nette hausse.
Les ménages estimant que les prix augmenteront au cours des douze prochains mois sont un peu plus nombreux en août. Le solde correspondant gagne deux points et reste au-dessus de sa moyenne de longue période.
L’enquête de l’INSEE souligne que les Français restent très sensibles à l’évolution de la situation sanitaire. La crainte d’une dégradation au moment de la rentrée est partagée par un nombre croissant de ménages. Le retour de l’attentisme pourrait peser sur la consommation en septembre. En revanche, les Français restent globalement optimistes en ce qui concerne l’emploi.
Le Livret A – résultats du mois de juillet 2021
Le Livret A reste le point d’ancrage de l’épargne des ménages en période covid. En juillet, en début de saison estivale, la collecte a été positive de 1,15 milliard d’euros. Avec le Livret de Développement Durable, la collecte atteint 1,39 milliard d’euros. Lors de ces dix dernières années, la collecte du Livret A a toujours été positive sauf en 2014 et 2015. L’année dernière, après le premier confinement, la collecte avait été supérieure en s’élevant à 1,85 milliard d’euros. En 2019, elle avait été de 1,44 milliard d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du Livret A a atteint 39 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros). L’encours du Livret A reste toujours à un niveau historique de 344,4 milliards d’euros quand celui du LDDS s’élève désormais à 126 milliards d’euros.
Effet impôt, effet covid
De multiples facteurs ont contribué à favoriser la collecte positive du mois de juillet du Livret A. 12,7 millions de Français ont, en effet, reçu, à partir du 20 juillet, de la part de l’administration fiscale, un remboursent d’impôt pour un montant de plus de 10 milliards d’euros. Cet argent est, en partie, mis de côté en vue de la rentrée. Par ailleurs, fin juin, certaines entreprises versent des chèques vacances ou des primes qui sont du moins partiellement épargnés. La persistance de la crise sanitaire est évidemment l’autre explication du résultat positif de la collecte. L’annonce de l’instauration, le 12 août, par le Président de la République, du « pass sanitaire » sur fond de quatrième vague a certainement incité des ménages à maintenir leur effort d’épargne à un niveau assez élevé.
Contrairement à de nombreuses prévisions, les Français ne puisent pas dans leur cassette « covid ». Ils conservent un stock d’épargne liquide sans précédent, 500 milliards d’euros en dépôts à vue et 200 milliards d’euros en livrets bancaires fiscalisés. Ils ont simplement arrêté les versements exceptionnels qui ont été constatés lors des confinements. Pour la fin de l’année, la prudence restera de mise dans un contexte économique et sanitaire encore incertain même si traditionnellement, le second semestre est moins favorable à l’épargne du fait des dépenses de rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année. 2021.
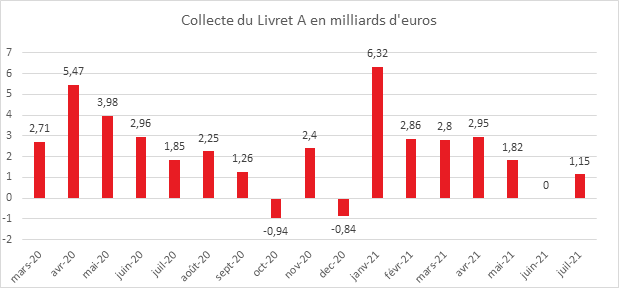
Le Livret A n’en finit pas d’étonner
Le Livret A reste le point d’ancrage de l’épargne des ménages en période covid. En juillet, en début de saison estivale, la collecte a été positive de 1,15 milliard d’euros. Avec le Livret de Développement Durable, la collecte atteint 1,39 milliard d’euros. Lors de ces dix dernières années, la collecte du Livret A a toujours été positive sauf en 2014 et 2015. L’année dernière, après le premier confinement, la collecte avait été supérieure en s’élevant à 1,85 milliard d’euros. En 2019, elle avait été de 1,44 milliard d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du Livret A a atteint 39 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros). L’encours du Livret A reste toujours à un niveau historique de 344,4 milliards d’euros quand celui du LDDS s’élève désormais à 126 milliards d’euros.
Effet impôt, effet covid
De multiples facteurs ont contribué à favoriser la collecte positive du mois de juillet du Livret A. 12,7 millions de Français ont, en effet, reçu, à partir du 20 juillet, de la part de l’administration fiscale, un remboursent d’impôt pour un montant de plus de 10 milliards d’euros. Cet argent est, en partie, mis de côté en vue de la rentrée. Par ailleurs, fin juin, certaines entreprises versent des chèques vacances ou des primes qui sont du moins partiellement épargnés. La persistance de la crise sanitaire est évidemment l’autre explication du résultat positif de la collecte. L’annonce de l’instauration, le 12 août, par le Président de la République, du « pass sanitaire » sur fond de quatrième vague a certainement incité des ménages à maintenir leur effort d’épargne à un niveau assez élevé.
Contrairement à de nombreuses prévisions, les Français ne puisent pas dans leur cassette « covid ». Ils conservent un stock d’épargne liquide sans précédent, 500 milliards d’euros en dépôts à vue et 200 milliards d’euros en livrets bancaires fiscalisés. Ils ont simplement arrêté les versements exceptionnels qui ont été constatés lors des confinements. Pour la fin de l’année, la prudence restera de mise dans un contexte économique et sanitaire encore incertain même si traditionnellement, le second semestre est moins favorable à l’épargne du fait des dépenses de rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année. 2021.
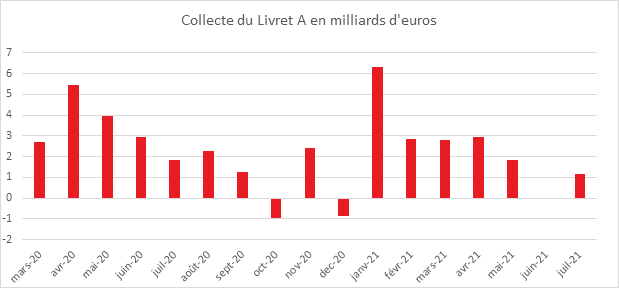
Le Coin des Epargnants : le record du CAC 40 fait de la résistance
Un sommet trop loin
A quelques encablures de son record du 4 septembre 2000 (6944 points), le CAC 40 n’aura pas réussi à le dépasser malgré la dynamique du début du mois d’août. Ce record, vieux de vingt et un an, attendra encore, la faute au variant delta et aux banques centrales qui souhaitent sortir des politiques ultra-accommodantes. Près de dix-huit mois après le début de l’épidémie, les banques centrales commencent, en effet, à réfléchir en ordre dispersé à l’arrêt des mesures exceptionnelles de l’économie et des Etats. Les incertitudes sur l’évolution de l’épidémie les poussent néanmoins à la prudence. Les intentions ne se traduisent pas pour le moment en acte. Ainsi, la Banque centrale de Nouvelle Zélande ou celle d’Angleterre ont renoncé à relever leur taux en raison de la quatrième vague. Les minutes de la dernière réunion de la Réserve Fédérale américaine indiquent que celle-ci souhaiterait réduire d’ici la fin de l’année les rachats d’obligations. Cette semaine, cette annonce a suffi pour entraîner un recul des marchés. La virulence de la quatrième vague et les résultats en demi-teinte de l’économie chinoise ont conduit les investisseurs au pessimisme. Ces derniers resteront méfiants jusqu’au symposium de Jackson Hole réunissant du 26 au 28 août les banquiers centraux. Après quelques semaines euphoriques, la fin du mois d’août, avec la préparation de la rentrée, s’annonce difficile, ce qui est assez traditionnel, ces dernières années.
Les signaux de ralentissement de l’économie chinoise ont amené à une forte baisse des cours des matières premières et de l’énergie. Le cours du baril de pétrole Brent a perdu sur la semaine plus de 6 %, baisse également provoquée par la hausse du dollar et l’annonce de stocks plus importants aux Etats-Unis. Les métaux industriels ont connu également une diminution sensible de leurs cours. Le cuivre est retombé sous la barre des 9 000 dollars la tonne. Depuis son record historique à 10 460 dollars atteint en mai dernier, ce métal a perdu 15 %. Le zinc, le nickel et l’aluminium sont orientés à la baisse. Le minerai de fer a connu une contraction de près de 40 % sur le marché à terme de Singapour. Les actions des compagnies minières ont, de ce fait, chuté cette semaine. La résurgence de l’épidémie en Asie conduit les investisseurs à craindre de nouveaux confinements et un ralentissement de la croissance. Par ailleurs, les autorités chinoises ont décidé de plafonner la production d’acier afin de limiter ses émissions de gaz à effet de serre.
Si le dollar s’est apprécié face à l’euro dans la perspective à terme d’une augmentation des taux aux Etats-Unis, les taux d’intérêt des obligations d’Etat à dix ans étaient orientés à la baisse cette semaine, la crainte du ralentissement de la croissance ayant primé sur le changement de pied des banques centrales. Les investisseurs ont souhaité se protéger en acquérant des obligations en lieu et place des actions. En cette semaine post 15 août, le CAC 40 a enregistré sa plus forte baisse de l’année (-3,91 %). La bourse de Paris qui avait fortement augmenté ces dernières semaines a connu une des plus fortes chutes de la semaine avec la place de Tokyo. Au-delà du CAC 40 et du Nikkei, tous les grands indices ont cédé du terrain cette semaine.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 20 août 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 626,11 | -3,91 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 35 120,08 | -1,11 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 714,66 | -0,73 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 808,04 | -1,06 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7,087,90 | -1,81 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4,147.50 | -1,94 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 27 013,25 | -3,45 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 427,33 | -2,53 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,149 % | -0,022 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,495 % | -0,028 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,253 % | -0,045 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1696 | -0,82 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 785,440 | +0,50 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 65,420 | -6,54 % | 51,290 |
Les ménages français, l’épargne avant tout
Le taux d’épargne des ménages s’est élevé au premier trimestre 2021 à 21,7 % du revenu disponible brut contre 21 % au cours du dernier trimestre 2020. Ce taux était de 15 % avant la crise sanitaire. Le taux d’épargne financière est à l’origine de cette progression. Il est, en effet, passé de 5 à 12,9 % de 2019 au premier trimestre 2021. De manière forcée et par précaution, les ménages ont accru leur épargne. Les produits de taux, le numéraire et les dépôts à vue sont les grands gagnants de la période atypique dans laquelle nous évoluons depuis le mois de mars 2020.
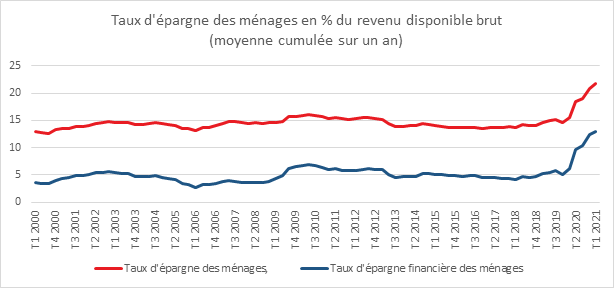
A la fin du premier trimestre 2021, les placements financiers des ménages, en France atteignaient 5755,8 milliards d’euros, contre 5665,5 milliards d’euros à la fin de l’année dernière. Cette progression s’explique par le taux d’épargne qui demeure élevé en lien avec le confinement qui s’est appliqué jusqu’au mois de mai et également par la bonne tenue des marchés financiers.
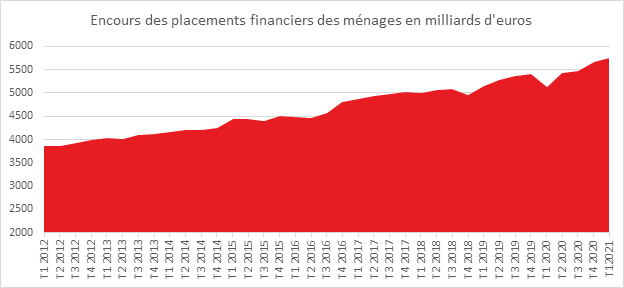
Cercle de l’Epargne – données Banque de France
L’encours des produits de taux représentait au premier trimestre 2021 3667 milliards d’euros, soit 63 % des placements financiers. Le numéraire et les dépôts à vue à fin mars 2021 s’élevaient à 724,4 milliards d’euros. Les dépôts bancaires rémunérés ont atteint 1125 milliards d’euros dont 825,9 milliards d’euros pour l’épargne réglementée. L’encours de l’assurance vie et de l’épargne retraite en fonds euros était de 1678,8 milliards d’euros. Les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite ont atteint, de leur côté 436 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2021.
Au premier trimestre 2021, le flux de placements financiers a atteint 42 milliards d’euros, contre 36,9 milliards d’euros au dernier trimestre 2020. Le premier confinement avait donné lieu au deuxième trimestre 2020 à un flux d’épargne de 79,8 milliards d’euros. Pour l’ensemble de l’année 2020, les flux de placement avaient atteint 205,2 milliards d’euros, contre 129,7 milliards d’euros en 2019.
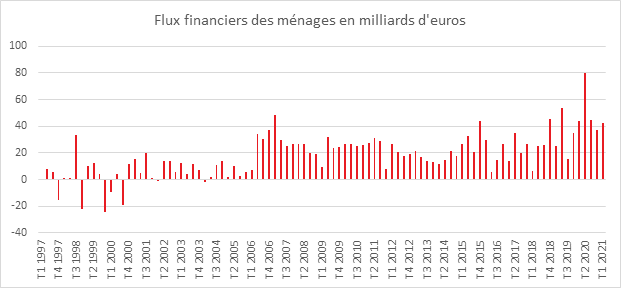
Sur un an, les flux de placements des ménages restent toujours à des niveaux historiques, 202,9 milliards d’euros. Ils sont toujours orientés très majoritairement vers les actifs sous forme de produits de taux (162,9 milliards d’euros), ce qui constitue un nouveau record.
Les ménages ont, au cours du premier trimestre, continué à privilégier le numéraire, les dépôts à vue et sur livrets d’épargne réglementée (26,9 milliards d’euros après 25,5 milliards au quatrième trimestre 2020). Les flux d’actifs sous forme de produits de fonds propres sont portés par l’accroissement des flux en actions non cotées et autres participations et surtout par une progression des placements d’assurance-vie en unités de compte (7,6 milliards après 4,1 milliards au quatrième trimestre).
Au deuxième trimestre, les ménages ont continué d’augmenter leurs liquidités, les dépôts à vue atteignant près de 500 milliards d’euros à la fin du mois de juin. Avec le déconfinement intervenu à partir du mois de mai, les livrets réglementés ont connu une moindre collecte, voire une décollecte pour certains d’entre eux (Livrets Jeunes, Plan d’Epargne Populaire). L’assurance vie a renoué avec son rythme de croisière d’avant crise sans pour autant compenser les pertes enregistrées en 2020. En revanche, la proportion des unités de compte au sein de la collecte brute a atteint des niveaux sans précédent depuis l’éclatement de la bulle Internet.
CAC 40, un sommet si près, si loin
En cette semaine estivale, le CAC 40 n’a pas réussi à battre son record qui date de 21 ans ; du 4 septembre 2000, pour être précis. Il a manqué 48 points vendredi. Paris n’a pas été aidé par la bourse de New York qui a pâti de l’indice en demi-teinte de la confiance des ménages calculé par l’Université du Michigan. A 70,2 points en août, il est en deçà des 81,2 points espérés par le consensus, qui constituaient également son niveau de référence de juillet. Les Américains comme les Européens commencent à s’inquiéter de la nouvelle vague de Covid-19 en plein été. Plusieurs Etats ont imposé l’annulation de spectacles. La crainte d’une baisse de la consommation à la rentrée commence à prendre forme. L’agence fédérale de la santé américaine préconise le port du masque dans les lieux publics fermés dès l’âge de deux ans. Entre les Etats du nord et ceux du Sud peu enclins à prendre des mesures contraignantes malgré la dégradation de leur situation sanitaire, les divergences Outre-Atlantique sont de plus en plus marquées. Au Japon, le Premier ministre Yoshihide Suga a demandé à la population de réduire ses déplacements devant l’augmentation inquiétante du nombre de cas de contamination. La pandémie continue par ailleurs de perturber l’offre et de freiner l’approvisionnement. En Chine, le port de Ningbo-Zhoushan, le troisième plus important au niveau mondial en termes d’activité, a été partiellement fermé du fait de la présence d’un foyer de coronavirus. Le déroutage des navires vers le port de Shanghai y accroit sa congestion. Cette situation pourrait provoquer une hausse des prix des produits importés de Chine.
L’inflation reste un sujet d’inquiétude. Si l’indice des prix à la consommation du mois de juillet n’a pas révélé une nouvelle accélération dans la hausse aux Etats-Unis, les prix à la production américains rendus publics, jeudi 12 août, ont surpris par leur dynamisme soulignant les pressions inflationnistes continues dues à la hausse constante des coûts des matières premières et aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.
Plusieurs points positifs sont néanmoins à noter. Les grandes entreprises de part et d’autre de l’Atlantique ont enregistré des résultats record au deuxième trimestre continuant à porter les marchés d’actions. De même, les doutes sur l’évolution de l’épidémie n’empêchent pas, pour le moment, les marchés de l’emploi de s’améliorer que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Les taux de chômage reculent et les taux d’emploi retrouvent leur niveau d’avant-crise.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 13 août 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 896,04 | +1,16 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 35 515,38 | +0,87 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 822,90 | -0,09 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 977,44 | +1,37 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 218,71 | +1,34 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 7 218,71 | +1,32 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 27 977,15 | +0,56 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 516,30 | +1,68 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,127 % | -0,006 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,467 % | +0,013 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,298 % | +0,003 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1803 | +0,41 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 778,290 | +0,83 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 70,720 | -+0,43 % | 51,290 |
Le Coin des Epargnants du 6 août 2021 : Paris toujours plus haut
Paris tout près de son record absolu
L’indice a gagné plus de 3 % sur la semaine et n’est plus qu’à 128 points, soit un peu moins de 2 % de son pic historique du 4 septembre 2000 à 6 944,77 points en séance. Les bons résultats des entreprises cotées ainsi que l’emploi américain portent le cours des actions dans un contexte de faible taux d’intérêt. En un an, le CAC 40 a progressé de plus de 38 %. Depuis le 1er janvier, la hausse est de 22,8 %. Le résultat net publié des 37 membres du CAC 40 ayant dévoilé leurs comptes semestriels dépasse les 58 milliards d’euros en 2021, contre 44 milliards d’euros en 2019, selon le cabinet de conseil et d’audit PwC. La crise sanitaire semble avoir été effacée pour les grands groupes. Les prévisions sont très positives avec notamment 26 sociétés qui rehaussent leurs prévisions pour 2021, tandis qu’une seule société (Atos) les revoit à la baisse. Les principaux risques évoqués par les responsables des entreprises du CAC40 pour le prochain semestre concernent, sans surprise, les conditions sanitaires ainsi que l’approvisionnement et le coût des matières premières. L’étude de PwC souligne que les grandes entreprises françaises entendent renforcer leurs investissements dans le digital et le cloud mais aussi pour répondre aux impératifs de la transition énergétique.
Au mois de juillet, l’économie américaine a créé 943 000 postes (non agricoles), soit son meilleur niveau depuis août 2020, quand le consensus tablait sur 870 000. C’est également mieux que prévu du côté du taux de chômage, en repli de 0,5 point par rapport à juin, à 5,4 %. En outre, cette amélioration du front de l’emploi a été obtenu sans réelle poussée inflationniste. Les salaires ont progressé de 0,4 % par rapport à juin, contre 0,3 % estimés, et de 4% sur un an, contre 3,9% anticipés par les analystes.
Ces résultats encourageants de l’économie américaine pourraient amener le Président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a préciser, un calendrier plus précis pour l’arrêt des rachats d’obligations lors de la conférence de Jackson Hole, fin août. Certes, ces résultats ne prennent pas en compte la nouvelle vague de covid-19 liée aux variants delta.
Les taux d’intérêt des obligations d’Etat étaient encore orientés à la baisse en Europe quand ils ont légèrement remonté aux Etats-Unis. La persistance de l’épidémie en Europe et le faible niveau de l’inflation sont deux éléments favorables au maintien de faibles taux d’intérêt.
Les barils de Brent et de WTI ont perdu 5 dollars sur une semaine du fait des craintes liées à la propagation du variant Delta et au ralentissement des économies américaines et chinoises. La publication de réserves de brut plus importantes que prévues aux Etats-Unis a accentué la tendance.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 6 août 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 816,96 | +3,09 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 35 208,51 | +0,78 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 835,76 | +1,11 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 761,45 | +1,40 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 122,95 | +1,29 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 109,10 | +1,82 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 27 820,04 | +1,97 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 458.23 | +1,79 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,121 % | -0,014 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,480 % | -0,017 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,295 % | +0,068 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1756 | -0,84 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 759,650 | -2,87 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 70,820 | -5,82 % | 51,290 |
Taux de rémunération des livrets bancaires stables en juin
Le taux de rémunération des livrets bancaires est resté stable en juin à 0,1 %.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| mai-2020 | avr- 2021 | mai-2021 (e) | juin-2021 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,43 |
| Ménages | 0,70 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,58 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,12 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| dont : livret A | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| – livrets ordinaires | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| – plan d’épargne-logement | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| SNF | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| dont : – dépôts à vue | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,04 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,38 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,46 | -0,48 | -0,38 | -0,41 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Le Coin des Epargnants du 31 juillet 2021 : la période des vacances commence bien
Le CAC 40 maintient le cap dans un contexte délicat
Le Cac 40 a réussi à repasser au-dessus des 6600 points à la fin du mois de juillet. Sur ce dernier mois, il progresse plus vite que la majorité des indices européens comparables. Il enregistre une sixième hausse mensuelle consécutive, série la plus longue depuis la période allant de septembre 2004 à mars 2005. Le mois de juillet a été marqué par la quatrième vague de covid qui a pesé sur les cours. Cette nouvelle vague a eu comme conséquence un recul des taux d’intérêt sur les obligations. Le taux de l’OAT à 10 ans est repassé en territoire négatif (-0,1 %). Malgré la hausse des prix en Allemagne comme aux Etats-Unis, les taux d’intérêt ont baissé ces trente derniers jours. Les investisseurs parient toujours sur le caractère temporaire de l’augmentation de l’inflation.
Pour cette dernière semaine de mai, les bons résultats de la croissance en Europe et l’augmentation des revenus des ménages américains (+0,1% en juin, au-dessus des prévisions qui tablaient sur un recul de 0,3 point ont porté les marchés) ont eu peu d’incidence sur les cours des actions. Il en est de même pour les dépenses des ménages américains qui ont progressé de 1 %, soit plus que les +0,7 % attendus, tandis que l’indice PCE des dépenses de consommation personnelle, mesure de l’inflation la plus surveillée par la Fed, est ressorti comme en juin à 3,5% sur un an hors alimentation et énergie. Le marché prévoyait une accélération à 3,7 %.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 30 juillet 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 612,76 | +0,67 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 34 935,47 | -0,36 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 672,68 | -1,11 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 544,39 | -0,80 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 032,30 | +0,07 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 109,10 | +1,82 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 27 283,59 | -0,96 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 397,36 | -4,31 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,107 % | -0,022 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,463 % | -0,046 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,227 % | -0,058 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1861 | +0,76 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 822,620 | +1,14 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 75,280 | +1,69 % | 51,290 |
Résultats de l’assurance vie juin 2021 : le retour de la force tranquille
La collecte nette de l’assurance vie a été, en juin, selon la Fédération Française de l’Assurance, positive de 1,4 milliard d’euros. Elle est en repli par rapport à celle du mois de mai (1,7 milliard d’euros). Il s’agit néanmoins de la septième collecte nette consécutive.
En juin, les cotisations brutes ont été dynamiques avec un total de 13,7 milliards d’euros, contre 9,9 milliards d’euros en juin 2020 et 12,1 milliards d’euros en juin 2019. Au mois de mai, elles s’étaient élevées à 11,4 milliards d’euros. La collecte en unités de compte reste très soutenue. Elle a représenté 41 % de la collecte au mois de juin. Depuis le mois de janvier, ce taux est de 38 % supérieur à la moyenne de 35 % de l’année 2020. La progression des unités de compte est portée par la bonne tenue des marchés « actions ».
Le montant des prestations versées par les assureurs à leurs clients a s’est élevé à 12,3 milliards d’euros, soit un montant également supérieur à celui du mois de juin 2020 (10,3 milliards) et à celui de juin 2019 (10,1 milliards). Pour le mois de mai 2021, elles avaient représenté 10,1 milliards d’euros. À fin juin, l’encours des contrats d’assurance vie s’est établi à 1.840 milliards d’euros, en progression de +4,4 % sur un an.
Le mois de juin est traditionnellement moyen pour l’assurance avec une collecte nette qui tourne autour de 1,3 milliard d’euros sur moyenne période. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistré au cours du sixième mois de l’année.
Depuis le mois de décembre 2020, l’assurance vie a retrouvé un rythme de croisière qui le rapproche de la croissance qu’elle connaissait avant crise. En revanche, pour le moment, la période de mars à novembre 2020 qui avait été marquée par un recul de la collecte nette n’a pas été compensée. Il n’y a pas eu d’effet rebond. Les ménages n’ont pas encore décidé d’arbitrer leur épargne covid placée sur les comptes courants et sur les livrets en faveur de l’assurance vie. L’attentisme demeure de mise en raison du fort niveau d’incertitudes qui prédomine. Pour le moment, les ménages entendent se faire plaisir en réduisant leur effort d’épargne de précaution (collecte nulle du Livret A en juin) tout en ne touchant pas trop à leur cagnotte. L’arrivée de la quatrième vague les incite à rester prudents. Une normalisation sur le plan de l’épargne ne pourra intervenir qu’avec le recul sur la durée de l’épidémie. Malgré tout, le second semestre devrait être plus « dépenses » qu’épargne comme cela est le cas traditionnellement. Ce semestre est en effet marqué par les dépenses de vacances, de rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année.
L’assurance vie doit faire face à la concurrence du Plan d’Epargne Retraite, en particulier chez les épargnants ayant plus de 50 ans. La montée des inquiétudes concernant le niveau de vie à la retraite et la possibilité offerte de sortir en capital avec ce nouveau produit conduit un nombre croissant de ménage à le privilégier par rapport à l’assurance vie d’autant plus qu’il est assortie d’un avantage fiscal à l’entrée.
La croissance est de retour en France
Le PIB de la France a augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre après avoir reculé au cours du dernier trimestre 2020 et être resté stable au cours du premier de l’année 2021.
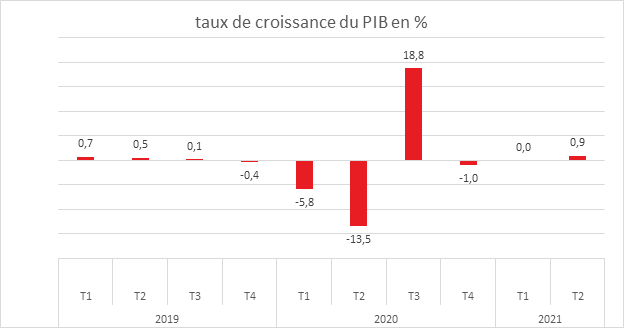
Le PIB comble ainsi plus d’un cinquième de l’écart restant fin 2020 par rapport à son niveau d’avant-crise : il est inférieur de 3,3 % au niveau du quatrième trimestre 2019, contre 4,2 % aux deux trimestres précédents. La demande intérieure finale (hors stocks) contribue positivement à l’évolution du PIB ce trimestre (+0,9 point, après +0,1 point au trimestre précédent). L’investissement et la consommation ont été les moteurs de la croissance. En revanche, le commerce extérieur y a contribué négativement.
Les ménages avec le déconfinement ont accru leurs dépenses en particulier de loisirs. Les dépenses de consommation des ménages ont ainsi augmenté de nouveau ce trimestre (+0,9 % après +0,2 % au trimestre précédent). La consommation des ménages en services d’hébergement-restauration a progressé de +42,8 % après –22,1 %. La consommation en services de transports a connu une hausse de +11,4 % après +2,8 %, sous l’effet de la reprise des déplacements. En revanche, la consommation des ménages en biens fabriqués se contracte nettement (–4,7 % après +0,3 %), du fait notamment des fermetures de commerces « non essentiels » durant le troisième confinement national. La consommation des ménages reste inférieure de 5,9 % à son niveau du 4e trimestre 2019. L’écart était de 6,7 % à la fin du premier trimestre.
L’investissement a accéléré ce trimestre (+1,1 %, après +0,4 % au trimestre précédent), sous l’effet du dynamisme de la construction (+1,8 %, après +1,1 %), et des services marchands (+1,3 % après –0,6 %). En revanche, la formation brute de capital fixe en produits manufacturés se replie (–0,4 %) après le rebond enregistré au premier trimestre (+0,8 %). Au deuxième trimestre 2021, l’investissement a dépassé légèrement son niveau d’avant-crise : +0,3 % par rapport au niveau du 4e trimestre 2019, contre un écart de 0,8 point au trimestre précédent.
Au deuxième trimestre, les importations ont augmenté plus vite que les exportations, respectivement +1,9 % et +1,5 %. Le commerce extérieur a ainsi contribué négativement à la croissance. Les importations ont été dynamique pour les biens industriels (+2,0 % après +1,3 % au 1er trimestre) ainsi que pour les produits pharmaceutiques (vaccins). Les exportations qui avaient reculé au 1er trimestre ont renoué avec la hausse notamment grâce aux matériels de transports (+5,5 % après –9,0 %), et aux produits agro-alimentaires accélèrent (+5,6 % après +3,3 %).
Malgré leur progression ce trimestre, les échanges extérieurs demeurent nettement inférieurs à leur niveau d’avant-crise. L’écart atteint 8,9 % par rapport au niveau du ‘E trimestre 2019 pour les exportations, contre –10,2 % au trimestre précédent ; –5,7 % pour les importations, après –7,5 %.
Les variations de stocks ont, de leur côté, contribué faiblement à la croissance du PIB ce trimestre (+0,2 point, après +0,4 point au premier trimestre 2021).
La production totale (biens et services) a connu une augmentation de +1,3 % au deuxième trimestre, après +0,1 % au trimestre précédent. Avec la réouverture des bars et restaurants ainsi que des lieux de loisirs, la production de services marchands a accéléré au deuxième trimestre (+2,0 % après +0,1 %). La production de services d’hôtellerie-restauration a augmenté de +29,1 % après –14,0 %. La construction poursuit sa hausse avec une augmentation de +1,5 % après +1,0 %. La production de biens rebondit avec un gain de +0,6 % après –0,2 %, notamment dans l’industrie manufacturière (+0,5 % après +0,1 %). La production de services non marchands se replie légèrement (–0,2 % après +0,2 %).
Au deuxième trimestre 2021, la production totale comble une partie de son écart à son niveau d’avant-crise. Il n’est plus que d 3 points par rapport à son niveau du dernier trimestre 2019, après –4,3 points au trimestre précédent. Les disparités sectorielles demeurent encore importantes, mais se réduisent. L’écart est de 3,9 points pour les services marchands, de 5,3 points pour l’industrie manufacturière et de 1,8 point pour la construction.
L’acquis de croissance atteint près de 5 % rendant possible une croissance de 6 % d’autant plus que le début du troisième trimestre a été marqué par une forte activité. le rebond de la croissance pourrait être néanmoins entravé par la quatrième vague qui contraint à l’adoption de nouvelles mesures de restriction.
Le moral des ménages entamé par la quatrième vague
Au mois de juillet, la confiance des ménages régresse certainement en lien avec la résurgence de l’épidémie de covid-19. À 101, l’indicateur de l’INSEE qui la synthétise perd deux points mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100).
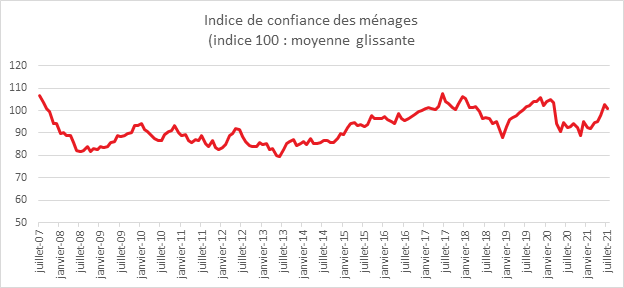
Signe d’une montée de l’inquiétude, en juillet, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants baisse nettement, après une vive hausse en juin. Le solde correspondant perd cinq points mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période. De même, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future se contracte de trois points. Celui relatif à leur situation financière personnelle passée perd quant à lui un point. Ces deux soldes restent toutefois bien au-dessus de leur moyenne de longue période.
En juillet, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner baisse pour le troisième mois consécutif. Le solde correspondant perd quatre points, mais reste très au-dessus de sa moyenne. La période des vacances est toujours synonyme de dépenses et d’une moindre épargne. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur capacité d’épargne actuelle baisse de trois points. Celui relatif à leur capacité d’épargne future perd quant à lui deux points. Ces deux soldes restent très au-dessus de leur moyenne de longue période.
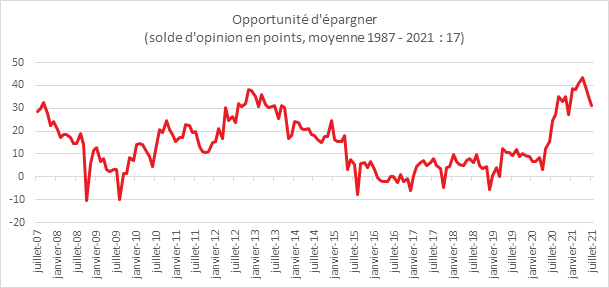
Les ménages sont plus pessimistes concernant l’évolution de leur niveau de vie.En juillet, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois baisse nettement. Le solde correspondant perd huit points mais reste au-dessus de sa moyenne de long terme.
La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois progresse un peu. Le solde correspondant gagne deux points mais reste très en dessous de sa moyenne de longue période.
Avec l’arrivée de la quatrième vague, Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage remontent un peu en juillet après une série de baisses au premier semestre. Le solde correspondant gagne trois points mais reste en dessous de sa moyenne de longue période.
L’inflation devient un sujet d’inquiétude pour les Français. En juillet, les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont beaucoup plus nombreux. Le solde correspondant gagne quatorze points et passe au-dessus de sa moyenne de long terme. Les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont aussi un peu plus nombreux. Le solde correspondant gagne trois points, et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période
Complémentaires, à la recherche de l’équilibre
Les comptes du régime complémentaire AGIRC/ARRCO, éraient revenus, en 2019, à l’équilibre avec la mise en place de l’accord national interprofessionnel de 2015. Avec la crise sanitaire, ils sont sans surprise repassé dans le rouge avec une perte de plus de 4 milliards d’euros. Si la progression des versements des pensions s’est poursuivie, les recettes ont diminué avec le développement du chômage partiel et la réduction de l’activité. Le déficit technique a été de 4,5 milliards d’euros en 2020. Or, le régime AGIRC/ARRCO, à la différence du régime général, ne peut pas recourir à l’endettement. L’année dernière, pour apurer les pertes, il a puisé dans ses réserves qui sont passées de 65 à 61 milliards d’euros. Afin de rétablir la situation financière, les partenaires sociaux en charge de l’AGIR/ARRCO ont mené des négociations qui se sont achevées le jeudi 22 juillet dernier. Il se sont entendus sur un avenant à l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2019 qui prévoir de sous-valoriser les pensions des complémentaires retraite du privé jusqu’à 0,5 point par rapport à l’inflation, contre 0,2 point actuellement. Cette mesure vise à réduire autant que possible les ponctions dans les réserves qui, statutairement, ne peuvent pas passer en-dessous de la barre des six mois de prestations.
Logiquement, les pensions complémentaires sont indexées sur l’inflation mais ces dernières années, plusieurs dispositifs ont réduit leur revalorisation. Compte tenu du taux prévisible de l’inflation à l’automne, entre 1,4 et 1,5 point, avec la marge de manœuvre de 0,5 point, les pensions pourraient n’être revalorisées que de 0,9 point au 1er novembre.
L’avenant prévoit par ailleurs de préserver le budget du fonds d’action sociale, qui vient en soutien des retraités les plus modestes, et de l’abonder de 13 millions supplémentaires.
Ce texte devrait être entériné par les partenaires sociaux. Il est soutenu par le Medef ainsi que la CFTC et la CFDT. En revanche, FO, la CGT et la CFE-CGC y seraient a priori, opposés. Si cette opposition ne devrait pas empêcher son adoption, sa mise en œuvre, à l’automne prochain, par le Conseil d’administration qui rassemble les partenaires sociaux sera sans nul doute complexe.
Le Coin de l’Epargne du 24 juillet 2021 : cohabitons avec le virus
La bourse reprend des couleurs
Après trois semaines consécutives de recul, le CAC 40 a regagné 1,68 %cette semaine et cela malgré une contraction de 2,54 % lundi dernier. L’indice parisien a terminé à quelques encablures de la ligne des 6600 points (6 568,82 points). Ce regain de forme a été rendu possible par la publication de bons résultats de la part de plusieurs entreprises et d’indices d’activité ainsi que par le discours très accommodant de la Présidente de la Banque centrale européenne. La baisse rapide de la fin de semaine dernière et du début de cette semaine a conduit des investisseurs à réaliser des achats provoquant un rebond.
En juillet, l’indice composite calculé par IHS Markit, qui mesure l’activité manufacturière comme celle des services, a battu un record vieux de 21 ans, à 60,6 points, en version préliminaire. La situation diffère néanmoins entre l’Allemagne où la reprise se confirme, et la France qui connaît un ralentissement en raison d’une pénurie de matériaux et de retards de livraisons. Si en fin de semaine, les investisseurs ont voulu oublier la menace du variant delta, elle reste néanmoins présente et pourrait entraîner une nouvelle rechute des marchés « actions ». Ces derniers ont par ailleurs compris que la politique monétaire dans la zone euro devrait rester ultra-accommodante, pour reprendre la tonalité du communiqué de la BCE. Cette dernière semble désormaisaccepter une inflation au-dessus de l’objectif de 2 %. Les prévisions d’inflation pour la zone euro prévoit que celle-ci restera assez faible à la sortie de la période de normalisation. Elle pourrait n’être que de 1,4 % en 2023. Les investisseurs suivront avec attention la réunion de la Réserve Fédérale prévue mercredi prochain. La question d’une réduction du montant des achats d’actifs, actuellement de 120 milliards de dollars par mois, devrait être largement débattue. Dans ce contexte, les taux d’intérêt des obligations d’Etat ont continué de baisser, le taux de l’OAT étant désormais de -0,085 %.
Malgré l’accord OPEP + prévoyant une augmentation de l’offre, le prix du baril de pétrole Brent est resté au-dessus des 70 dollars grâce à une bonne tenue de la demande. Les responsables de plusieurs compagnies aériennes américaines ont déclaré que le redémarrage de l’activité aérienne était plus soutenu que prévu.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 23 juillet 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 568,82 | +1,68 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 35 061,55 | +1,08 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 836,99 | 2,84 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 669,29 | +0,83 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 027,58 | +0,28 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 109,10 | +1,82 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 27 548,00 | -1,63 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 550,40 | +1,00 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,085 % | -0,066 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,417 % | -0,062 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,285 % | -0,022 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1768 | -0,35 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 802,240 | -0,61 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 73,970 | +0,83 % | 51,290 |
Le Livret A entre deux eaux
Au mois de juin, la collecte nette du Livret A a été nulle, les versements ont parfaitement équilibré les retraits. La collecte de juin est inférieure à celle du mois de mai (1,81 milliard d’euros) et à celle de juin 2020 (2,96 milliards d’euros). Le mois de juin est traditionnellement médiocre pour le Livret A avec des collectes qui sont, en moyenne, inférieures à 1 milliard d’euros lors de ces dix dernières années. Le résultat de juin 2021 tranche avec les cinq mois précédents qui avaient été marqués par les mesures sanitaires et le troisième confinement. Les Français se sont fait plaisir en investissant les restaurants, les bars et les lieux de loisirs. Ils ont retrouvé le chemin de la consommation et ont préparé leurs vacances. Malgré tout, ils n’ont pas touché à leur cagnotte Covid, preuve qu’ils demeurent prudents face à une situation sanitaire et économique hautement instable. Compte tenu du niveau historique atteint par le Livret A, un mouvement de décollecte n’aurait pas été surprenant si les conditions économiques et sanitaires s’y étaient prêtées.
Lors du premier semestre 2021, la collecte du Livret A s’est élevée à 16,74 milliards d’euros, soit légèrement moins que sur la même période de 2020 (20,41 milliards d’euros). Le premier confinement avait entraîné un afflux important sur les livrets défiscalisés.
Depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du Livret A a atteint 37,75 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros).
De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a connu une collecte nette positive de 40 millions d’euros en juin, contre 510 millions d’euros en mai dernier et 730 millions en juin 2020. Pour le premier semestre, la collecte a été de 4,03 milliards d’euros sur ce produit.
L’encours du Livret A reste toujours à un niveau historique de 343,3 milliards d’euros quand celui du LDDS s’élève désormais à 125,8 milliards d’euros.
Si les Français devraient continuer à se faire plaisir durant la saison estivale en consommant, la recrudescence de l’épidémie devrait cependant les inciter à conserver un niveau élevé d’épargne de précaution. La collecte du Livret A devrait donc se situer autour de zéro dans les prochains mois. Les Français attendront la suite de l’histoire avant de toucher réellement à leur cassette. En cas de durcissement des mesures sanitaires, une remontée de la collecte n’est pas impossible.
Dans le passé, le second semestre est davantage axé sur les dépenses que sur l’épargne. La rentrée scolaire et les fêtes de fin d’années conduisent généralement les ménages à puiser dans leurs produits d’épargne. Il en sera certainement de même en 2021 mais les Français conserveront un regard sur l’évolution de la situation sanitaire.
Cercle de l’Épargne – données CDC
Comment lutter contre la hausse de l’immobilier ?
Aux États-Unis comme au sein de la zone euro, de plus en plus de voix s’élèvent pour souligner les dangers de l’augmentation des prix de l’immobilier. Eric Rosengren, le Président de la Réserve fédérale de Boston, et James Bullard, Président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, ont ainsi réclamé une évolution de la politique monétaire qui évite les hausses excessives des prix des logements.
Depuis 1998, le prix des logements a été multiplié par plus de trois aux États-Unis et par plus de deux au sein de la zone euro. Sur la même période, la base monétaire a été multipliée par huit aux États-Unis et par six au sein de la zone euro. La hausse s’accélère avec la baisse des taux d’intérêts et le recours massif des banques à des rachats d’obligations. L’abondance de liquidités et les faibles taux se traduisent automatiquement par une hausse des prix et cela d’autant plus que l’offre de logements est contrainte par une réglementation de plus en plus stricte.
Jusqu’à maintenant, les banques centrales ne se préoccupent pas de l’évolution des prix de l’immobilier. Elles ont pour objectif la lutte contre l’inflation ou la déflation et, de manière plus ou moins explicite, le retour au plein emploi. Elles visent à garantir la pérennité du système financier. À ce titre, elles doivent éviter la constitution de bulles spéculatives qui pourraient se transformer en crise. Or, dans le passé, les hausses excessives des prix de l’immobilier se terminent toujours en crises financières, comme en 2008. Lors de la crise des subprimes, le taux de défaut des ménages, en raison des emprunts immobiliers, avait atteint 10 %. Ce taux était revenu à 4 % en 2019. Il remonte depuis pour atteindre 6 % en 2021. La zone euro n’a pas connu la même croissance du taux de défaut grâce à un système de financement de l’immobilier différent se caractérisant par un moindre recours aux prêts hypothécaires.
La hausse de l’immobilier génère une forte tension sociale avec des difficultés croissantes d’accès au logement pour les classes moyennes ainsi que pour les jeunes qui ne disposent pas d’apport.
Plus l’application des politiques monétaires expansionnistes perdure, plus les prix augmentent. La progression est vive en cas de remontée de la croissance qui conduit les ménages disposant d’une épargne suffisante à se positionner sur le marché de l’immobilier.
Les banques centrales ont de plus en plus de mal à s’émanciper des politiques monétaires accommodantes du fait du niveau de l’endettement des États et de la pression des gouvernements qui craignent un ralentissement de la croissance en cas de hausse des taux. Les banques centrales pourraient restreindre le crédit immobilier pour éviter un emballement des prix mais cela se retournerait dans un premier temps contre les ménages souhaitant s’endetter pour acheter un logement. Elles pourraient appeler de leurs vœux une taxation accrue des plus-values pour dissuader la hausse des prix. L’autre voie consisterait à augmenter l’offre mais cela exige du temps et entre en opposition avec la volonté de préserver le foncier.
Sortie en capital pour les petits PERP améliorée
Si avec le Plan d’Épargne Retraite créé par la loi PACTE du 22 mai 2019, les titulaires peuvent désormais sortir soit en rente ou en capital, tel n’était pas le cas avec les anciens produits d’épargne retraite individuels comme le PERP ou le Contrat Madelin.
Pour ces produits qui ne sont plus commercialisés depuis le 1er octobre 2020, l’épargne constituée est reversée sous forme de rente. Les titulaires de PERP pouvaient néanmoins demander, à la retraite, une sortie en capital pour l’acquisition de la résidence principale. Ils avaient par ailleurs la possibilité demander une sortie partielle en capital, dans la limite de 20 % de la valeur de rachat du contrat. Enfin, une sortie en capital avait été autorisée quand la rente mensuelle n’excède pas 40 ou 80 euros selon le contrat. Le ministère de l’Économie a porté ce montant, par un arrêté du 7 juin 2021, à 100 euros. Les contrats concernés par ces seuils peuvent selon le ministre atteindre jusqu’à 30 000 ou 40 000 euros. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la loi PACTE, qui permet une sortie en capital des PER. Elle permet également une sortie anticipée avant la retraite dans le but de financer l’acquisition d’une résidence principale.
Le Livret A entre deux eaux
Au mois de juin, la collecte nette du Livret A a été nulle, les versements ont équilibré parfaitement les retraits. Elle est inférieure à celle du mois de mai (1,81 milliard d’euros) et de l’année dernière (2,96 milliards d’euros). Le mois de juin est traditionnellement médiocre pour le Livret A avec des collectes qui ont, en moyenne, inférieures à 1 milliard d’euros lors de ces dix dernières années. Il tranche avec les cinq mois précédents qui avaient été marqués par les mesures sanitaires et le troisième confinement. En juin, les Français se sont fait plaisir en investissant les restaurant, les bars et les lieux de loisirs. Ils ont retrouvé le chemin de la consommation et ont préparé leurs vacances. Malgré tout, ils n’ont pas touché à leur cagnotte Covid, preuve qu’ils demeurent prudents face à une situation sanitaire et économique hautement instable. Compte tenu du niveau historique atteint par le Livret A, un mouvement de décollecte n’aurait pas été surprenant si les conditions économiques et sanitaire s’y étaient prêtées ?
Lors du premier semestre 2021, la collecte du Livret A s’est élevé à 16,74 milliards d’euros, soit légèrement moins que sur la même période de 2020 (20,41 milliards d’euros). Le premier confinement avait entraîné un afflux important sur les livrets défiscalisés.
Depuis le début de la crise sanitaire (mars 202), la collecte du Livret A a atteint 37,75 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros).
Le LDDS a connu, de son côté, en juin, une collecte nette positive de 40 millions d’euros, contre 510 millions d’euros en mai et 730 millions en juin 2020. Pour le premier semestre, la collecte a été de 4,03 milliards d’euros.
L’encours du Livret A reste toujours à un niveau historique de 343,3 milliards d’euros quand celui du LDDS s’élève désormais à 125,8 milliards d’euros
Si durant la saison estivale, les Français devraient continuer à se faire plaisir en consommant , la recrudescence de l’épidémie devrait les inciter à conserver un niveau élevé d’épargne de précaution. La collecte du Livret A devrait donc se situer autour de zéro. Ils attendront la suite de l’histoire avant de toucher réellement à leur cassette. En cas de durcissement des mesures sanitaires, une remontée de la collecte n’est pas impossible.
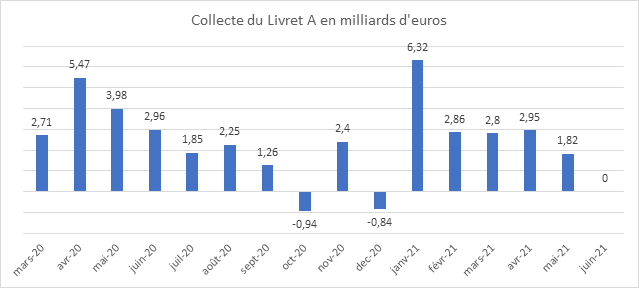
Plan d’Epargne Retraite : amélioration du régime fiscal pour la sortie en capital
Depuis le 6 juillet 2021, les détenteurs d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) qui choisissent la sortie en capital bénéficient d’un délai supplémentaire pour solliciter la dispense de l’impôt forfaitaire de 12,8 % prélevé sur leurs intérêts. Jusqu’à maintenant, la demande de dispense de l’acompte sur les intérêts devait être réalisée avant le 30 novembre de l’année précédant le rachat. L’administration fiscale a décidé que désormais, la date limite pour agir court jusqu’à la réception des revenus. Cette nouvelle règle est avantageuse pour les titulaires à faible revenus de PER. Elle est la traduction d’un amendement adopté lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2021.
En cas de sortie en capital, le titulaire d’un PER doit s’acquitter, au moment des rachats, des prélèvements obligatoires. La partie « capital » correspondant aux versements, est soumise au barème de l’impôt sur le revenu, si les versements ont fait l’objet d’une déductibilité fiscale. Les revenus des versements sont quant à eux soumis à un impôt forfaitaire de 12,8 % et aux prélèvements sociaux de 17,2 %. Le contribuable peut néanmoins opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu qui peut, dans certains cas, être plus avantageux. C’est en particulier le cas pour les contribuables peu ou pas imposés au titre de l’impôt sur le revenu. Le prélèvement fiscal de 12,8 % est acquitté directement, au moment du rachat du contrat amenant le contribuable, assujetti à 0 % ou à 11 % au titre de l’impôt sur le revenu, à faire une avance d’impôt. Le remboursement du trop versé étant effectué l’année suivante. En effet, le contribuable ne pourra opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu qu’au moment de la déclaration de revenus. Il ne récupèrera son acompte jusqu’à un an après sa déclaration. .
Pour bénéficier de ce dispositif, le revenu fiscal de référence du demandeur doit être inférieur à 25 000 euros pour un célibataire et à 50 000 euros pour un couple. Le contribuable doit adresser sa demande de dispense à l’établissement payeur, en y faisant figurer ses nom, prénom, adresse, la date et le lieu de signature et attestant sur l’honneur respecter les conditions de revenu fiscal de référence. Le Bulletin officiel des finances publiques met à disposition des contribuables un modèle de dispense.
Le Coin des Epargnants du 16 juillet 2021 : quand le variant delta dicte sa loi
Quand le variant delta impose sa loi
Le sujets d’inquiétude se multiplient, de la montée en puissance du variant delta aux menaces d’inflation en passant par le ralentissement de l’économie chinoise. Vendredi 16 juillet, l’indice parisien est revenu sous la barre des 6500 points et a perdu en cinq jours, 1,06 %. Il accuse ainsi une troisième semaine consécutive de repli, ce qui n’était plus arrivé depuis le mois de janvier. Les indices américains sont également en baisse sur cette semaine.
L’économie chinoise a connu une croissance plus faible que prévu au deuxième trimestre 7,9 % quand les économistes tablaient sur une augmentation de 8,5 %. Les exportations chinoises ont continué à tirer la croissance, mais la hausse des prix des matières premières a pesé sur les profits des entreprises et la consommation des ménages reste timide. Cette moindre croissance est également imputable à un effet base, l’économie chinoise avait fortement rebondi au deuxième trimestre 2020 quand le reste du monde était à l’arrêt.
Aux Etats-Unis, les résultats économiques sont en demi-teinte. Les ventes au détail ont néanmoins enregistré un rebond surprise de 0,6 % le mois dernier, quand le marché anticipait une contraction de 0,3 %, après une baisse de 1,7 % en mai. L’amélioration serait en trompe l’œil car elle est due à la hausse de 0,9 % des prix à la consommation en juin. Par ailleurs, l’augmentation de 2,3 % des ventes de vêtements et de matériel électronique pourrait encore résulter des chèques de soutien reçus en avril, En revanche, la confiance du consommateur s’est dégradée en juillet, l’indice établi par l’Université du Michigan se contractant de 4,7 points (80,8 en première estimation de juillet, contre 86,5 anticipés par le consensus formé par Bloomberg). Dans ce contexte anxiogène, les taux des obligations d’Etat sont en recul, le taux de l’OAT à 10 ans repassant même en territoire négatif.
Les cours du pétrole étaient, cette semaine, également orientés à la baisse après la publication des chiffres de stocks américains montrant un affaiblissement de la demande d’essence. La perspective d’un accord à l’Opep+ pourrait provoquer une forte augmentation de l’offre, plus de 850 000 baris jours seraient remis sur le marché.
Le tableau financier de la semaine
| Résultats 16 juillet 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
| CAC 40 | 6 460,08 | -1,06 % | 5 551,41 |
| Dow Jones | 34 687,85 | -0,52 % | 30 409,56 |
| Nasdaq | 14 427,24 | -1,87 % | 12 870,00 |
| Dax Xetra Allemand | 15 540,31 | -0,97 % | 13 718,78 |
| Footsie | 7 008,09 | -1,60 % | 6 460,52 |
| Euro Stoxx 50 | 4 035,77 | -0,79 % | 3 552,64 |
| Nikkei 225 | 28 003,08 | +0,22 % | 27 444,17 |
| Shanghai Composite | 3 539,30 | +0,43 % | 3 473,07 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,019 % | -0,072 pt | -0,304 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,355 % | -0,064 pt | -0,550 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,307 % | -0,044 pt | 0,926 % |
| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1804 | -0,60 % | 1,2232 |
| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 815,430 | +0,17 % | 1 898,620 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 73,64 | -2,57 % | 51,290 |
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


