Le Coin des Epargnants du 6 août 2022 : l’emploi américain n’en finit pas de surprendre
L’emploi américain défie la récession
L’emploi américain défie la récession
Malgré la récession en cours aux États-Unis, les créations de postes non-agricoles du mois de juillet 2022 ont atteint 528 000, soit plus du double du consensus qui s’établissait à 250 000. Le taux de chômage américain a reculé à 3,5 %, contre 3,6% un mois avant. Cette bonne tenue de l’emploi américain devrait inciter la banque centrale à poursuivre ses relèvements de taux directeurs. Les résultats de l’emploi américain semblent confirmer l’analyse de la Maison Blanche sur la nature technique de la récession. Dans ce contexte, les taux d’intérêt des obligations d’Etat se sont appréciés. L’euro de son côté demeure faible et a perdu 0,5 % par rapport au dollar sur la semaine. Les marchés actions sont restés assez étales, les bons résultats des entreprises compensant les anticipations de hausse des taux d’intérêt. A noter, l’augmentation du Nasdaq de plus de 2 %. L’indice américain a été porté par les bons résultats semestriels des entreprises technologiques.
Pétrole en baisse sur fond de ralentissement de l’économie mondiale
Les treize pays de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et leurs dix alliés, dont la Russie, se sont accordés, mercredi 3 août, sur une hausse a minima de la production d’or noir de 100.000 barils par jour en septembre. En juin et en juillet, les 23 pays s’étaient engagés à augmenter la production de 432.000 puis 648.000 barils supplémentaires. Ils étaient ainsi revenus au rythme de production d’avant la pandémie de Covid.
Si cette décision a déçu, le prix du baril (BRENT) après un petit accès de hausse est repassé en-dessous de 100 dollars. En une semaine, il a perdu plus de 8 % et a terminé vendredi à 95 dollars
Le cours du pétrole est orienté à la baisse en raison des anticipations de ralentissement de la croissance de l’économie mondiale et en particulier de la Chine qui est le deuxième consommateur mondial derrière les Etats-Unis. La décision des pays occidentaux de puiser dans leur réserve joue également en faveur de la baisse des cours.
La détente sur le marché pétrolier se traduit pas une baisse du prix des carburants en France. Entre le 13 juin et le 25 juillet, le litre de sans-plomb 95 est passé de 2,09 euros à 1,80 euro en moyenne, soit une réduction de 29 centimes. La baisse est un peu plus modérée pour le gazole, en moyenne 26 centimes. Sur un plein d’essence au SP 95 de 40 litres, les usagers ont donc gagné presque 12 euros. Les consommateurs français bénéficient toujours d’une ristourne de la part des pouvoirs publics de 18 centimes effective sur chaque litre d’essence depuis le 1er avril. Une nouvelle réduction gouvernementale devrait intervenir en septembre, pour faire baisser une nouvelle fois le litre d’essence de 30 centimes auquel pourra s’ajouter des gestes de la part des distributeurs comme celui de Total Energie qui a prévu d’abaisser de 20 centimes d’euros le litre de carburant en septembre et octobre.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 5 août 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 472,35 | +0,37 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 803,47 | -0,13% | 36 338,30 |
| Nasdaq | 12 657,55 | +2,15 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 573,93 | +0,67 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 439,74 | +0,22 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 725,39 | +0,47 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 28 175,87 | +1,35 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 227,03 | -0,81 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,478 % | +0,109 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +0,943 % | +0,133 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,851 % | +0,215 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0171 | -0,47 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 772,790 | +0,52 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 95,510 | -8,35 % | 78,140 |
Le déblocage anticipé de l’épargne salariale
Après 2014, 2008 et 2003, l’épargne salariale fera l’objet en 2022 d’une nouvelle procédure de déblocage. Cette mesure, en permettant aux salariés de sortir sans contrainte fiscale, leur argent de leur plan d’épargne entreprise, vise à soutenir le pouvoir d’achat et la consommation. Dans le passé, l’effet de ce dispositif avait tendance à s’émousser, les salariés préférant conserver leur épargne que bénéficier du bon de sortie.
Pour bénéficier de l’exonération fiscale sur l’épargne salariale, le salarié est censé de pas effectuer de retrait durant les 5 ans suivant son versement.
Le législateur a prévu une série de déblocage dits anticipés :
- Mariage ou conclusion d’un PACS ;
- Violence conjugale ;
- Naissance ou adoption du 3ème enfant ;
- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
- Cessation du contrat de travail ;
- Divorce, dissolution du PACS avec résidence d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
- Surendettement du bénéficiaire ;
- Création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à un PACS, l’exercice d’une profession non salariée ou l’acquisition de parts d’une SCOP ;
- Invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
- Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée par un PACS Les Perco exclus du déblocage.
Un déblocage temporaire à l’effet incertain
De manière temporaire, pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, un déblocage a été institué sous la forme d’un amendement présenté par les sénateurs lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. En vertu du texte adopté, tout salarié qui le souhaite pourra débloquer sa participation ou son intéressement dans la limite d’un plafond global de 10 000 euros sans que cette somme soit soumise à l’impôt sur le revenu ni à cotisations sociales. Pour éviter une réallocation sur d’autres produits d’épargne, comme cela avait été constaté lors de précédents déblocages, les sommes issues de l’épargne salariale ainsi débloquées devront être consacrées à « l’acquisition de biens ou la fourniture de services ». Les sommes seront déclarées par l’organisme gestionnaire ou à défaut par l’employeur à l’administration fiscale et il est simplement prévu que le salarié tienne « à la disposition de cette dernière les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées ».Cette contrainte avait été retenue lors du déblocage de 2013.
Ne sont pas concernées les sommes placées dans un Plan d’épargne retraite collectif (PERECO ET PERCO) ou en fonds solidaires. Pour l’épargne salariale investie en titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, un accord collectif sera nécessaire pour que cette épargne puisse être mobilisée.
En 2013, le déblocage avait porté sur environ 2 milliards d’euros pour une dizaine de milliards d’euros potentiellement utilisables. En 2008, 1,6 million de salariés avaient débloqués avec à la clef 3,5 milliards d’euros sortis de l’épargne salariale sur 8 projetés. 80 % avaient été replacés sur d’autres supports d’épargne. 4 % de l’encours avaient été débloqués contre 10 % espéré. En 2004, 7 milliards avaient été débloqués, mais seuls 1,5 à 2,5 milliards avaient été réinjectés dans l’économie.
Les 11,5 millions de personnes qui ont un produit d’épargne salariale ne sont pas obligatoirement celles qui sont les plus entravées dans leur consommation étant souvent issues de grandes entreprises qui proposent des salaires plus élevés que la moyenne.
En 2022, le taux d’épargne des ménages est élevé. Or, malgré l’inflation, ils puisent peu ou pas dans leur épargne covid-19. La collecte du Livret A comme de l’assurance vie est positive depuis le début de l’année.
Le déblocage de l’épargne salariale a pour conséquence de remettre en cause un produit d’épargne de long terme. D’un côté, les pouvoirs publics demandent aux Français de placer leur épargne sur des produits en actions et de l’autre, ils incitent à une sortie anticipée d’un placement qui fait la part belle aux actions.
Le retour du déblocage de l’épargne salariale
Après 2014, 2008 et 2003, l’épargne salariale fera l’objet au mois de décembre d’une nouvelle procédure de déblocage. Cette mesure, en permettant aux salariés de sortir sans contrainte fiscale, leur argent de leur plan d’épargne entreprise, vise à soutenir le pouvoir d’achat et la consommation. Dans le passé, l’effet de ce dispositif avait tendance à s’émousser, les salariés préférant conserver leur épargne que bénéficier du bon de sortie.
Pour bénéficier de l’exonération fiscale sur l’épargne salariale, le salarié est censé de pas effectuer de retrait durant les 5 ans suivant son versement. Des cas de déblocage anticipés ont néanmoins été prévus par le législateur :
- Mariage ou conclusion d’un PACS
- Violence conjugale
- Naissance ou adoption du 3ème enfant
- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
- Cessation du contrat de travail
- Divorce, dissolution du PACS avec résidence d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire
- Surendettement du bénéficiaire
- Création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à un PACS, l’exercice d’une profession non salariée ou l’acquisition de parts d’une SCOP
- Invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, du conjoint ou de la personne liée par un PACS
- Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée par un PACS Les Perco exclus du déblocage
Selon la proposition retenue par les sénateurs lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, tout salarié qui le souhaite pourra débloquer sa participation ou son intéressement dans la limite d’un plafond global de 10 000 euros sans que cette somme soit soumise à l’impôt sur le revenu ni à cotisations sociales. Pour éviter une réallocation sur d’autres produits d’épargne, comme cela avait été constaté lors de précédents déblocages, les sommes issues de l’épargne salariale ainsi débloquées devront être consacrées à « l’acquisition de biens ou la fourniture de services ». Les sommes seront déclarées par l’organisme gestionnaire ou à défaut par l’employeur à l’administration fiscale et il est simplement prévu que le salarié tienne « à la disposition de cette dernière les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées ».Cette contrainte avait été retenue lors du déblocage de 2013.
Ne sont pas concernées les sommes placées dans un Plan d’épargne retraite collectif (PERECO ET PERCO) ou en fonds solidaires. Pour l’épargne salariale investie en titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, un accord collectif sera nécessaire pour que cette épargne puisse être mobilisée.
En 2013, le déblocage avait porté sur environ 2 milliards d’euros pour une dizaine de milliards d’euros potentiellement utilisables. En 2008, 1,6 million de salariés avaient débloqués avec à la clef 3,5 milliards d’euros sortis de l’épargne salariale sur 8 projetés. 80 % avaient été replacés sur d’autres supports d’épargne. 4 % de l’encours avaient été débloqués contre 10 % espéré. En 2004, 7 milliards avaient été débloqués, mais seuls 1,5 à 2,5 milliards avaient été réinjectés dans l’économie.
Les 11,5 millions de personnes qui ont un produit d’épargne salariale ne sont pas obligatoirement celles qui sont les plus entravées dans leur consommation étant souvent issues de grandes entreprises qui proposent des salaires plus élevés que la moyenne.
En 2022, le taux d’épargne des ménages est élevé. Or, malgré l’inflation, ils puisent peu ou pas dans leur épargne covid-19. La collecte du Livret A comme de l’assurance vie est positive depuis le début de l’année.
Le déblocage de l’épargne salariale a pour conséquence de remettre en cause un produit d’épargne de long terme. D’un côté, les pouvoirs publics demandent aux Français de placer leur épargne sur des produits en actions et de l’autre, ils incitent à une sortie anticipée d’un placement qui fait la part belle aux actions.
Les livrets bancaires toujours aussi peu rémunérés
Pour le moment, la hausse des taux d’intérêt n’a pas d’effet sur la rémunération des livrets bancaires fiscalisés qui était de 0,09 % en juin selon la Banque de France.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| juin -2021 | avr – 2022 | mai -2022 (e) | juin- 2022 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Ménages | 0,65 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,91 | 0,72 | 0,70 | 0,69 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| dont : livret A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| – livrets ordinaires | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| – plan d’épargne-logement | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| SNF | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| dont : – dépôts à vue | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,72 | 0,61 | 0,61 | 0,62 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,54 | -0,45 | -0,39 | -0,24 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,41 | 0,79 | 0,94 | 1,50 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.
Les nouveaux taux du Livret A et du LEP entrent en vigueur le 1er août
Comme annoncé, le taux du Livret passe de 1 à 2 % le 1er août et celui du LEP de 2,2 à 4,6 %. Ces augmentations sont la conséquence de la hausse des prix enregistrés ces derniers mois. Le taux de 2 % pour le Livret A est l’application de la formule
Depuis le 1er février 2020, le taux du livret A est fixé comme la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %. Pour le LEP, le taux est égal au chiffre le plus élevé entre le taux des livrets A majoré de un demi-point et le taux d’inflation.
Pour un Livret A au plafond de 22 950 euros, le gain annuel sera de 459 euros contre 229,5 euros quand le taux était de 1 %. 8 % des titulaires d’un Livret A ont atteint le plafond. L’encours moyen est de 5800 euros. Le rendement annuel pour un Livret A moyen sera de 116 euros avec un taux de 2 %
Pour un LEP au plafond de 7 700 euros, le gain sera de 354,2 euros contre 169,4 euros quand le taux était de 2,2%. L’encours moyen d’un LEP est de 5600 euros. Avec un taux de 4,6%, le gain annuel sera de 257,6 euros. 43% des LEP ont atteint le plafond.
Au 31 décembre 2021, le nombre de LEP s’élève à 6,9 millions en repli de 170 000 unités (– 2,4 %) par rapport à 2020. Les dispositions prises afin de favoriser la diffusion de ce produit n’ont pas encore produit leurs effets. Le Ministère de l’Economie a modifié les modalités de vérification d’éligibilité au LEP. Désormais, les banques communiquent directement avec Bercy quand auparavant les épargnants devaient eux-mêmes fournir les preuves de leur éligibilité. Les premières données pour 2022 laissent augurer d’un retournement de tendance. Le Ministre de l’Economie a continué à enjoindre aux banques à proposer aux ayant droits ce produit. Les capacités réduites d’épargne de la clientèle du LEP explique en partie sa faible appétence pour ce produit qui est mieux rémunéré que le Livret A.
Le LEP peine à séduire son public
Avec un taux de 4,6 %, le LEP devient un des produits les mieux rémunérés sur la place surtout qu’il offre une sécurité totale et une parfaite liquidité. Pour autant, ce produit peine à séduire son public. Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, en 2021 0,7 million de LEP ont été ouverts 0,9 ont été fermés. Depuis 2016, le solde est négatif. Le taux de détention des personnes physiques par rapport à la population majeure s’établit à 12,9 % en 2021, contre 13,3 % en 2020. Selon la Direction générale des finances publiques, le nombre d’individus éligibles au LEP à fin 2021 est de près de 18,6 millions. 37 % des personnes éligibles détenaient un LEP en décembre 2021. Le faible succès du LEP s’explique par le fait qu’il s’adresse à des ménages à faibles revenus ayant des capacités limitées d’épargne. Il est peu mis en avant par les banques en raison de son coût de gestion. Jusqu’en 2018, il était complexe d’usage, les titulaires devaient annuellement fournir annuellement leur avis d’imposition à la leur banque.
Pour ouvrir un LEP, il ne faut pas dépasser un certain montant de revenu fiscal de référence.
| Nombre de parts de quotient familial | Revenus maximum |
|---|---|
| 1 | 20 296 € |
| 1,5 | 25 716 € |
| 2 | 31 135 € |
| 2,5 | 36 554 € |
| 3 | 41 973 € |
| 3,5 | 47 392 € |
| 4 | 52 811 € |
| Demi-part supplémentaire | 5 420 € |
Le Coin des Epargnants du 29 juillet 2022 : les marchés en mode optimiste avant les vacances
Les marchés partent sur une note positive en vacances
La Bourse de Paris et Wall Street ont, en juillet progressé. Le Cac 40 comme le S&P 500 ont enregistré leur meilleur mois depuis novembre 2020. Les résultats solides annoncés par des grands noms de la « tech », du luxe, de la banque et du pétrole permettent en effet de contrecarrer les craintes de récession de part et d’autre de l’Atlantique. La progression du CAC 40, près de 6 % en juillet, dépasse de loin celle des autres indices européens. Le poids des banques, du secteur du luxe et du tourisme explique cette belle performance. Le Nasdaq a connu une forte croissance, près de 5 % sur la semaine.
Aux Etats-Unis, le coût du travail a augmenté de 2,3 % au deuxième trimestre, gonflé par la hausse continue des traitements et salaires, tandis que la consommation réelle des ménages a timidement augmenté de 0,1 % en juin après son repli du mois précédent, toujours freinée par la hausse des prix. L’indice de confiance du consommateur américain de l’Université du Michigan a été révisé en hausse de 0,4 point à 51,5 en données définitives de juillet, tandis que la composante des anticipations d’inflation à un an a été confirmée à 5,2%, contre 5,3% en juin. Dans la zone euro, l’inflation a atteint un nouveau plus haut historique à 8,9 % sur un an en juillet, ce qui contraindra, sans nul doute, la BCE à relever de 50, voire 75 points de base ses taux directeurs. Le marché a salué l’accélération surprise de 0,7% de la croissance dans la région au deuxième trimestre, après 0,5% au premier, et ce en dépit de la stagnation de l’économie allemande.
La FED toujours en mode attaque
La Banque centrale américaine a mercredi 27 juillet annoncé la quatrième hausse de ses taux directeurs depuis le mois de mars. Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a décidé à l’unanimité d’augmenter ses taux d’intérêt de trois quarts de point, pour les porter entre 2,25 % et 2,50 %. Elle a aussi confirmé la réduction de son bilan, comme annoncé en mai. Le plafond de cette réduction sera porté en septembre à 95 milliards de dollars par mois, contre 47,5 milliards prévus jusqu’ici. De nouvelles hausses sont attendues dans les prochains mois. Les décisions de la Fed reflètent sa volonté d’endiguer l’inflation qui a atteint 9,1 % en juin.
Les taux de la Fed atteignent leur niveau neutre, selon les économistes de la banque centrale américaine, le niveau au-delà duquel ils cessent de soutenir l’activité.
l’inflation. La croissance américaine commence à s’essouffler avec un taux de chômage au plus bas, à 3,6 %. Certains analystes, comme ceux de Wells Fargo et Bank of America, considèrent que les États-Unis pourraient entrer en récession avant la fin de l’année.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 29 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6,448.50 | +3,73 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 845,13 | +2,97 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 12 390,69 | +4,70 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 484,05 | +1,74 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 423,43 | +2,02 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 596,49 | +3,45 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27,801.64 | -0,40 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 253,24 | -0,51 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,369% | -0,249 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +0,810 % | -0,220 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,636 % | -0,144 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0203 | +0,08 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 766,010 | +2,52 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 105,200 | +1,81 % | 78,140 |
Loyer, l’indice d’actualisation en forte hausse avant le plafonnement
L’indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2022 a, selon l’INSEE, progressé de 3,6 %. Cette hausse est la plus forte jamais observée depuis l’introduction de la nouvelle formule en 2008. Au premier trimestre, l’augmentation avait été de 2,48 %. Au dernier trimestre 2021, elle n’avait été que de +1,61 % Cet indice, calculé à partir de l’inflation hors tabac des 12 derniers mois, sert de base à la révision annuelle des loyers. À chaque date anniversaire du bail, le loyer peut être revu à la hausse en fonction du dernier indice connu. La révision se fait sur le loyer hors charges. Dans le cadre du projet de loi de mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les prochaines hausses de l’indice devraient cependant être plafonnées à +3,5 % pour une durée temporaire d’un an. Ce plafonnement concernerait les contrats de location dont la date anniversaire se situe entre la mi-octobre 2022 et la mi-octobre 2023. Sans ce mécanisme exceptionnel, la hausse de l’IRL qui répercute l’évolution des prix à la consommation avec environ 12 mois de décalage, se serait située entre 5 et 6 %.
Les influenceurs financiers encadrés
Avec les réseaux sociaux, les influenceurs jouent un rôle croissant dans les pratiques commerciales. Ils sont devenus incontournables que ce soit au niveau de la mode, de la musique mais aussi au niveau des produits financiers. L’Autorité des Marchés Financiers s’inquiète des conséquences de ce nouveau type de promotion qui, jusqu’à maintenant, ne fait pas l’objet d’une réglementation. Si pour être courtier, agent d’assurance, des conditions sont exigées, tout le monde peut devenir influenceur et promouvoir des cryptomonnaies, des livrets d’épargne, des contrats d’assurance sachant que les publications ou vidéos font l’objet de rémunération dont le montant dépend du nombre des abonnés ou de du nombre de clics. Ces pratiques ont cours sur Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook ou Twitter. L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation de la publicité professionnelle (ARPP) ont annoncé étendre leur partenariat pour travailler sur une responsabilisation des influenceurs financiers, avec une attention particulière sur les cryptomonnaies et la publicité autour de ces produits. Les deux organismes souhaitent établir une certification de l’influence responsable consacrée au domaine de l’investissement. En 2021, l’ARPP a créé un premier certificat de l’influence responsable afin de protéger les marques et les consommateurs. Compte tenu des enjeux, le dispositif devrait être adapté à la finance. Pour mettre en place ce certificat, l’ARPP se concentrera sur les aspects publicitaires, tandis que l’AMF travaillera davantage sur les produits financiers promus par les influenceurs. La mise en avant de produits financiers ne serait possible que pour les personnes ayant suivi un minimum de formation et qui auraient obtenu une certification, cette dernière devant faire l’objet de renouvellements réguliers. Actuellement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut poursuivre des influenceurs pour pratiques commerciales trompeuses. L’ancienne star de la téléréalité Nabilla Benattia-Vergara, a été ainsi condamnée à acquitter 20 000 euros d’amende pour avoir en 2018, sur son compte Snapchat, fait la promotion d’une offre de trading en ligne, sans préciser qu’elle était rémunérée pour cela. De même Julien Bert, un influenceur issu de la téléréalité a créé sa propre société de trading en ligne, encourageant des prestations douteuses et mettant en valeur des rendements élevés. Des investisseurs, jeunes pour la plupart, n’ont pas récupéré leur mise. Pour éviter la multiplication des procédures contentieuses après la survenue d’un préjudice, l’AMF souhaite limiter les pratiques douteuses en amont.
La divine surprise de la croissance au deuxième trimestre ?
Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance de +0,5 % en volume faisant suite à un repli de 0,2 % au premier trimestre. Le commerce extérieur, une fois n’est pas coutume, a porté la croissance à la différence de la consommation. L’investissement est également resté dynamique. Épargne : la sécurité et l’épargne de précaution. Le taux de croissance de la France est supérieure aux attentes mais est inférieur à la moyenne de la zone euro.
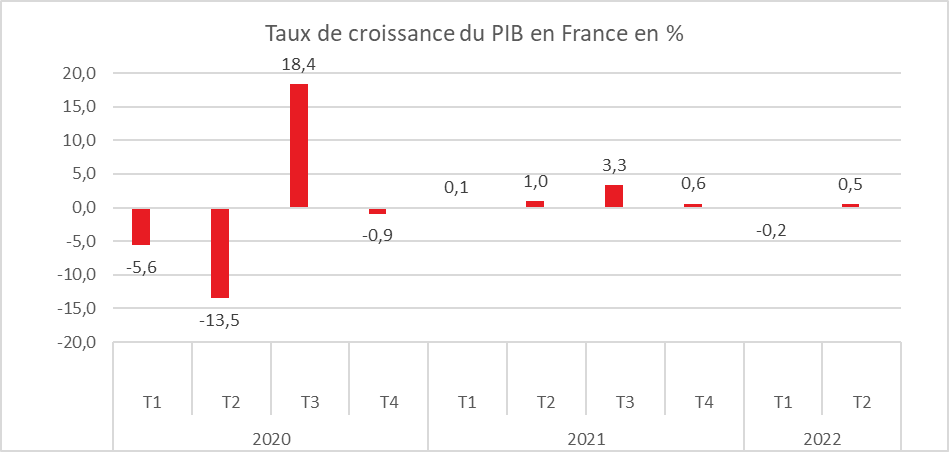
La consommation des ménages s’est contractée au deuxième trimstre de 0,2 % après un recul de 1,3 % au premier. Compte tenu de l’inflation et de ses conséquences sur le pouvoir d’achat, la diminution de la consommation est mesurée et cela d’autant plus que les ménages rechignent à puiser dans leur épargne « covid ».
Si les achats de biens reculent pour le deuxième trimestre consécutif (–1,3 % après –2,1 %), la consommation en services augmente de +1,5 % après +0,0 %). Ce sont les services d’hébergement-restauration qui connaissent un essor important (+8,9 % après –2,5 %) tout comme les services de transport (+4,8 % après +4,0 %). Les Français consomment moins de biens industriels mais partent en week-end ou en vacances. Par ailleurs, le retour des touristes internationaux permet une reprise du secteur du tourisme. Il augmente de +0,6 % dans le secteur des services après +1,0 %, notamment en information-communication (+1,8 % après +2,7 %) et en services aux entreprises (+1,7 % après –0,4 %). À l’inverse, l’investissement en produits manufacturés est stable ce trimestre (+0,0 % après –1,2 %), tandis que la celui en construction diminue (–0,5 % après +1,0 %).
La contribution du commerce extérieur est nettement positive ce trimestre (+0,4 point, après +0,1 point au trimestre précédent). Les exportations progressent de nouveau (+0,8 % après +1,6 %), tirées notamment par les services de transport (+6,3 % après +5,0 %) et les dépenses des voyageurs étrangers en France (+8,6 % après + 5,0 %). En revanche, en lien avec les difficultés que rencontrent le secteur industriel depuis de nombreux mois, les exportations de biens se replient (–0,6 % après +1,4 %), notamment dans les matériels de transport (–3,8 % après +11,5 %) et l’agro-alimentaire (–1,7 % après + 0,1 %).
Les importations ont diminué au deuxième trimestre de –0,6 % après +1,2 % au trimestre précédent. Les importations de biens diminuent (–0,4 % après +1,2 %), notamment celles de pétrole raffiné (–9,9 % après –22,2 %) et celles d’autres biens manufacturés (–1,5 % après +2,8 %), et malgré le rebond des importations de matériels de transport (+3,7 % après –5,1 %). Les importations de services (hors tourisme) se replient également, de manière plus modérée (–0,2 % après +1,6 %). Enfin, les dépenses des touristes français à l’étranger se contractent nettement (–2,0 % après –2,2 %). La baisse des importations signifie que la hausse de la demande globale (extérieure et intérieure) ce trimestre a été satisfaite par une augmentation de de la production, ce qui est encourageant.
La contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est faiblement positive au deuxième trimestre 2022 (+0,1 point).
La production totale (biens et services) a progressé de +0,7 % au deuxième trimestre, après +0,2 % au trimestre précédent), notamment dans les services marchands (+1,4 % après +0,3 %). La production en services d’hébergement-restauration est particulièrement dynamique avec une hausse de +6,7 % après –2,1 % au trimestre précédent. La production en services de transport a atteint +3,8 % après +1,3 %. Les services aux entreprises (+1,2 % après +0,6 %) et les services aux ménages (+1,5 % après +0,4 %) sont également progression. En revanche, la production dans la construction baisse ce trimestre (–0,5 % après +0,6 %).
La production de biens progresse plus modérément que la production de services ce trimestre (+0,2 %, comme au trimestre précédent). En particulier, la production des branches manufacturières ralentit après le rebond enregistré au premier trimestre (+0,6 % après +1,3 %).. La production de matériels de transport rebondit (+4,9 % après –2,3 %) mais reste très dégradée par rapport à son niveau d’avant la crise sanitaire.
La France a réussi à échapper à la récession à la différence des Etats-Unis. Le soutien apporté par les pouvoirs publics au pouvoir d’achat des ménages n’y est pas pour rien. L’Etat via l’endettement prend en charge une grande partie des effets générés par l’inflation. Le troisième trimestre 2022 devrait s’inscrire dans la même ligne que le deuxième porté par les activités de tourisme et le retour des étrangers en France. La France devient de plus en plus un pays à dominante touristique, l’industrie peinant à regagner les parts de marché perdus depuis 2019. La fin de l’année dépendra de l’évolution des cours du pétrole et du gaz à la rentrée.
Rebond de croissance en zone euro
Au cours du deuxième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,7 % dans la zone euro et de 0,6 % dans l’UE, par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Au cours du premier trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et 0,6% dans l’Union. Parmi les États membres pour lesquels les données pour le premier trimestre 2022 sont disponibles, la Suède (+1,4%) a enregistré la hausse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivi de l’Espagne (+1,1%) et de l’Italie (+1,0%). Des baisses ont été enregistrées en Lettonie (-1,4%), en Lituanie (-0,4%) et au Portugal ( 0,2%). Les taux de croissance par rapport à l’année précédente ont été positifs pour tous les pays. La France se classe en-dessous de la moyenne de la zone euro mais au-dessus de l’Allemagne qui est toujours affectée par la faiblesse des exportations de biens industriels.
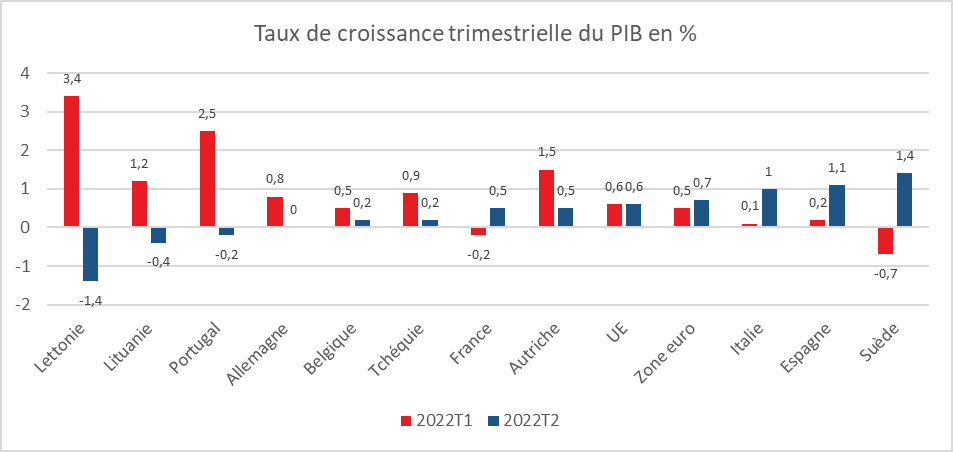
Etats-Unis, deuxième baisse consécutive du PIB
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a diminué de 0,9 % en rythme annualisé, après avoir reculé de 1,6 % au premier trimestre selon les chiffres publiés jeudi 28 juillet par le département du commerce. Si sur un point de vue théorique, deux trimestres de recul du PIB signifie la survenue d’une récession, la Maison Blanche en rejette vigoureusement l’idée. La proximité des élections de mi-mandat, le 8 novembre, peut justifier cette communication. Pour expliquer sa position, le Président, Joe Biden, met en avant la bonne tenu de l’emploi et des investissements. La croissance de l’emploi aux Etats-Unis a été en moyenne de 456 700 postes par mois au cours du premier semestre de l’année, ce qui a entraîné une forte hausse des salaires. La consommation des ménages s’est, elle, maintenue grâce aux dépenses dans les services.
Le département du commerce précise que le recul du PIB reflète des baisses d’investissement des entreprises et d’achats de logement de la part des ménages. Le gouvernement fédéral, les Etats et les administrations locales ont également freiné leurs dépenses. L’administration américaine et la FED suivent avant tout l’inflation et l’emploi et non la croissance pour opérer leurs choix de politiques monétaires et économiques. Pour le moment, la récession serait avant tout technique et ponctuel ne nécessitant pas une intervention de la part des pouvoirs publics. La hausse des taux devrait néanmoins se traduire par un ralentissement des prêts aux ménages et freiner leurs dépenses d’investissement et de consommation dans les prochains mois.
Coup de froid en juin pour l’assurance vie
En juin, la collecte nette de l’assurance vie progresse de +0,6 milliard d’euros, contre 1,9 milliard d’euros au mois de mai et 2,2 milliards d’euros en avril. La collecte du mois de juin est la plus faible enregistrée depuis le mois de décembre 2020. L’année dernière, en juin 2021, la collecte nette avait atteint 1,7 milliard d’euros. Elle a été de +3,2 milliards d’euros en unités de compte (UC) et à de −2,6 milliards d’euros en fonds euros. L’encours des contrats d’assurance vie s’établit à 1 821 milliards d’euros à fin juin.
Juin est, pour l’assurance vie, un mois moyen. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées, en 2012, 2013 et 2020. Hors décollecte, la collecte nette moyenne se situe autour de 1,7 milliard d’euros.
Une rupture en juin 2022
Le mois de juin 2022 marque donc une réelle rupture, sachant que depuis août 2021, la collecte nette moyenne était supérieure à 2 milliards d’euros. La dégradation du contexte économique a amené les ménages à privilégier l’épargne de précaution et notamment le Livret A dont le taux a été et sera réévalué. Le rendement des fonds euros est en valeur réelle négatif. En prenant en compte les prélèvements obligatoires, il est inférieur à celui du Livret A et du LDDS. Cette situation sans précédent explique, sans nul doute, la décollecte enregistrée sur les fonds euros. Malgré la baisse des cours des actions, la collecte demeure positive pour les unités de compte. Les épargnants continuent à placer leur épargne en partie sur les marchés financiers et à accepter une prise de risque accrue.
Au mois de juin 2022, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 11,9 milliards d’euros, en baisse de −1,4 milliard d’euros par rapport à juin 2021. Elles diminuent de −1,0 milliard d’euros sur les supports en euros, à 6,9 milliards d’euros, et de −0,4 milliard d’euros en unités de compte (UC), à 5,0 milliards d’euros. La part des cotisations en unités de compte reste néanmoins élevé à 42 % en juin. Les prestations sont également en baisse sur le mois par rapport à l’année dernière, à 11,3 milliards d’euros (−0,7 milliard d’euros par rapport à juin 2021).
Malgré tout un bon premier semestre 2022
Sur les six premiers mois de l’année 2022, les cotisations en assurance vie ont 76,4 milliards d’euros (+0,7 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021. La part des cotisations en UC s’établit à 41 % sur le 1er semestre, à comparer à 39 % pour l’ensemble de l’année 2021. Le montant global des prestations a été de 64,3 milliards d’euros ont été versés (−1,1 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021).
Pour le premier semestre, la collecte nette s’établit à +12,1 milliards d’euros, supérieure de +1,8 milliard d’euros à celle des 6 premiers mois de l’année 2021. Elle a été de +20,9 milliards d’euros pour les UC et de −8,8 milliards d’euros pour les fonds euros.
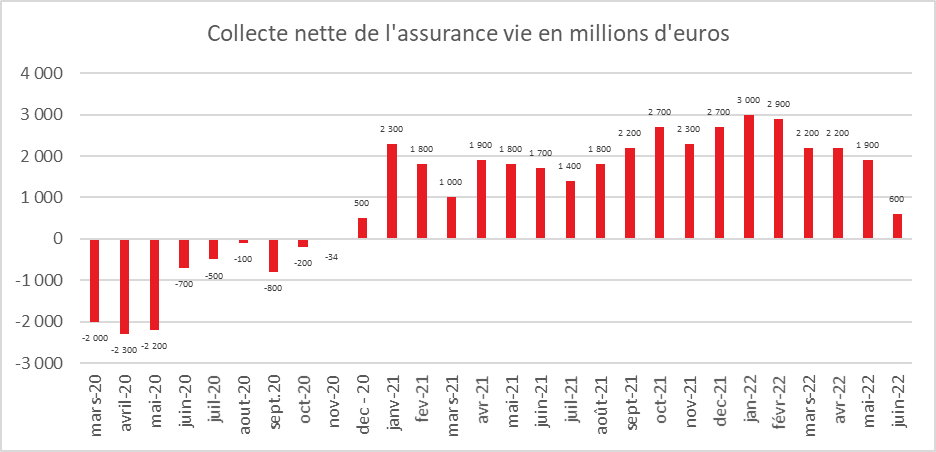
Epargne, mise à mal par l’inflation
La résurgence de l’inflation, les annonces de l’arrivée d’une prochaine récession conduisent, en France, à une perte de confiance chez les ménages. Malgré les aides de l’Etat, les Français sont inquiets. Ils estiment que leur pouvoir d’achat est en baisse et qu’ils peuvent moins épargner qu’auparavant.
En juillet, l’indice de l’INSEE qui mesure la confiance des ménages continue de diminuer, pour le septième mois consécutif. À 80, l’indicateur qui la synthétise perd deux points et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).
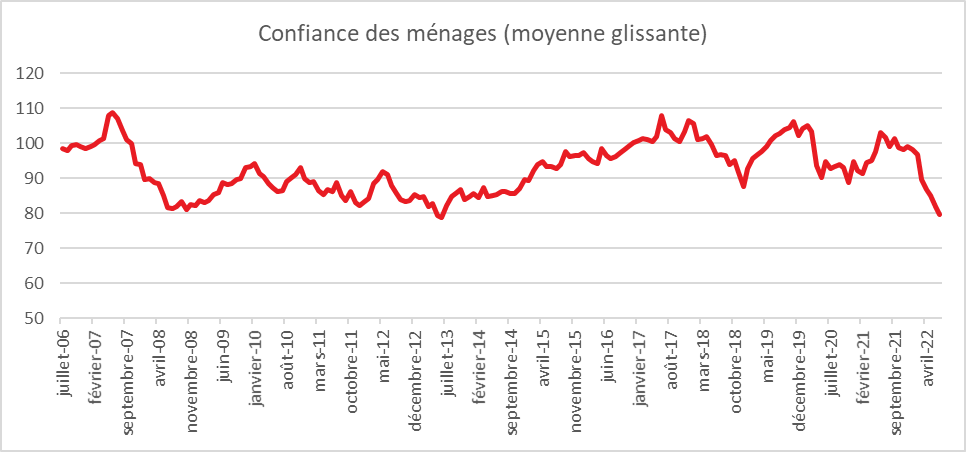
En juillet, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée perd un point, tout comme celui relatif à leur situation financière personnelle future. Le solde associé à l’opportunité de faire des achats importants recule lui aussi de nouveau : il perd trois points ce mois-ci. Cette appréciation est en lien avec celle sur l’inflation. En juillet, la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois a, de nouveau, augmenté. Le solde correspondant gagne un point et se situe au plus haut niveau depuis l’été 2008. La part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois continue de baisser : le solde diminue d’un point, demeurant néanmoins bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Toujours en lien avec l’inflation, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois diminue de nouveau. Le solde correspondant perd cinq points et reste nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois baisse également. Le solde correspondant perd trois points et reste lui aussi nettement inférieur à sa moyenne
Même si dans les faits, les ménages continuent à mettre de l’argent de côté, ils sont plus nombreux en juillet qu’en juin, à indiquer que leur capacités actuelle et future d’épargne diminuent. Le solde sur l’opportunité d’épargner perd quant à lui deux points. Ces trois soldes demeurent cependant au-dessus de leur moyenne de longue période.
Avec les tensions économiques qui augmentent et malgré les bons résultats en matière de chômage, en juillet, les craintes des ménages concernant son évolution augmentent légèrement. Le solde correspondant augmente de trois points mais demeure à un niveau très bas.
Immobilier : pour une réforme de la fiscalité
Au sein de l’OCDE et tout particulièrement en France, le logement constitue le principal actif pour la plupart des ménages. Il représente en moyenne plus de 60 % du patrimoine de ces derniers. Avec l’augmentation sans précédent des prix de l’immobilier au cours des trois dernières décennies, les ménages les plus aisés ont concentré une part croissante de l’immobilier. Il est, en revanche, de plus en plus difficile pour les jeunes ménages d’accéder à la propriété immobilière.
L’OCDE a publié un rapport qui procède à une comparaison et à une évaluation détaillées des taxes sur l’immobilier dans les Etats membres de l’organisation. Il révèle que de nombreux pays recourent à des impôts sur la propriété immobilière reposant sur des valeurs cadastrales obsolètes comme en France avec la taxe foncière. Ces impôts ont un faible rendement tout en générant d’importantes inégalités. De nombreux pays disposent également d’impôts sur les transactions immobilières (droits de mutation et plus-values). L’OCDE les juge peu performant en freinant la mobilité résidentielle. L’organisation internationale souligne que la plupart des pays exonèrent totalement les plus-values sur la résidence principale. Certains pays ont institué des dispositifs d’allégement fiscal en faveur des résidences principales, notamment la déductibilité des intérêts d’emprunt, alors même que ces incitations n’ont pas de réel effet sur l’accession à la propriété. Comme l’a souligné également la Cour des Comptes, les incitations fiscales nourrissent plus qu’elles ne les combattent les hausses de prix.
L’OCDE souligne qu’il est nécessaire d’appréhender les réformes dans le contexte de l’ensemble des politiques fiscales. Pour accroître l’efficacité du marché du logement et améliorer l’équité, le rapport suggère aux pays de renforcer le rôle des impôts récurrents sur la propriété immobilière, notamment en veillant à ce qu’ils reposent sur des valeurs cadastrales régulièrement mises à jour, et d’abaisser les impôts sur les transactions immobilières. Elle recommande de réduire ou de plafonner certaines incitations fiscales afin de limiter les distorsions et de freiner les tensions sur les prix de l’immobilier. Elle propose de privilégier les dispositifs incitant à la rénovation énergétique des bâtiments et favorables aux ménages à revenus modestes. Elle rappelle que le secteur résidentiel génère 17 % des émissions de CO2.
Le rapport souligne que pour être menées avec succès, les réformes de la fiscalité immobilière doivent être planifiées avec soin et s’adapter aux évolutions macroéconomiques, en particulier dans un contexte d’inflation élevée et de hausse des taux d’intérêt.
La France qui souffre d’un manque de logements depuis des années devrait sans nul doute s’inspirer des recommandations de l’OCDE. L’immobilier bénéficie dans notre pays d’importantes aides, près de 40 milliards d’euros, qui n’ont pas permis de relancer la construction et de faciliter l’accès à la propriété des jeunes ménages. Le taux de possession de la résidence principale plafonne, en France, depuis des années autour de 58 %.
Le Coin des Epargnants du 22 juillet 2022 : les taux directeurs à la hausse
Zone euro, un nouveau cycle monétaire ?
Le 21 juillet, pour la première fois depuis 2011, la Banque centrale européenne a remonté ses taux directeurs de 50 points de base, soit plus que ce qui était attendu. Après sept ans en territoire négatif, le taux de dépôt, qui rémunère les sommes placées par les banques auprès de la BCE, passe ainsi à 0 %. Le taux pour la facilité de refinancement est désormais de 0,5 % et la facilité de prêt marginale à 0,75 %. Cette augmentation est la plus forte jamais réalisée depuis la création de l’euro. La BCE s’aligne avec retard sur la FED et la Banque d’Angleterre qui ont relevé leurs taux depuis plusieurs mois pour endiguer l’inflation.
La surprise est venue de l’ampleur du relèvement des taux qui atteint 50 points de base quand une hausse de 25 points de base était attendue. Avec une inflation qui a atteint 8,6 % au mois de juin au sein de la zone euro et qui dépasse plus de 20 % dans certains États membres, la BCE a décidé de marquer le coup. Elle a longtemps différé cette décision car elle estimait que l’arme des taux était en partie inefficace face à une inflation essentiellement importée. En ce mois de juillet, elle a voulu marquer les esprits face aux risques d’emballement. Elle estime que désormais les risques de transmissions sur les prix des produits de consommation, les services et les salaires étaient élevés et qu’il était nécessaire de refroidir l’économie.
L’augmentation des taux directeurs qui constitue en soi une mesure récessive intervient en parallèle aux politiques de soutien du pouvoir d’achat engagées par les Etats, politiques qui sont, de leur côté, plutôt inflationnistes.
La décision du relèvement des taux directeurs est intervenue le jour de la démission de Mario Draghi de son poste de Premier Ministre de l’Italie après l’échec d’un vote de confiance. Cette démission a immédiatement provoqué une augmentation des taux italiens. L’écart de taux entre l’Italie et l’Allemagne pour les obligations à 10 ans était de 240 points vendredi 22 juillet. Face aux risques d’une divergence des taux pouvant mettre en danger la stabilité financière de la zone euro, la BCE a travaillé sur l’élaboration d’un bouclier anti-fragmentation, baptisé Transmission protection instrument (Instrument de protection de la transmission de la politique monétaire). Les investisseurs pourraient éprouver le nouveau dispositif de la BCE avec la crise italienne.
Les marchés européens ont plutôt bien réagi aux décisions de la BCE et cela malgré la crise politique en Italie. Le CAC 40 comme le Daxx allemand ont gagné 3 % en une semaine. La reprise des flux de gaz russe vers l’Europe a rassuré les investisseurs. La contraction annuelle du CAC est désormais inférieure à 13 %, contre environ 18 % fin juin. Il a signé cette semaine sa meilleure performance de ces trente derniers jours. Les indices américains ont également progressé. Le gain du Nasdaq a été de 3,33 %.
Sur la semaine, les taux d’intérêt des obligations d’Etat ont reculé en Europe (sauf pour l’Italie) comme aux Etats-Unis. Avec la décision de la BCE, l’euro s’est légèrement apprécié remontant à 1,02 dollar en hausse de près de 1,5 % sur la semaine. Les cours du pétrole ont été orientés à la hausse cette semaine en lien avec la communication d’une baisse plus importante des réserves américaines que prévue.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 22 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 216,82 | +3,00 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 899,29 | +1,95 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 834,11 | +3,33 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 253,68 | +3,02 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 276,37 | +1,64 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 596,49 | +3,45 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27 914,66 | +4,20 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 269,97 | +1,30 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,618 % | -0,033 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,020% | -0,107 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,780 % | -0,141 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0218 | +1,37 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 729,200 | +1,44 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 105,180 | +3,89 % | 78,140 |
Le Livret A en mode résilient en juin
Pour le premier semestre, la collecte du Livret A a atteint 16,5 milliards d’euros, soit un montant équivalent à celui cd la période équivalente de 2021 (16,74 milliards d’euros) qui avait été marquée par le troisième confinement. La collecte 2022 a été dopée par l’augmentation du taux de 0,5 à1 % intervenue le 1er février et par le contexte économique anxiogène. Les ménages ont continué à placer une partie de leurs liquidités sur le Livret A malgré l’inflation voire à cause de l’inflation. Ils mettent de l’argent de côté afin de se constituer un matelas de précaution. La crainte d’une dégradation de la situation économique les conduit au maintien d’un effort important d’épargne. Ils renforcent leur épargne de précaution par crainte et aussi pour pouvoir réaliser des achats qui, à terme, coûteront plus chers.
Malgré son rendement réel négatif, le Livret A demeure donc la valeur refuge par excellence pour les 54,9 millions de Français qui en ont un. Ces derniers mois, les ménages ont privilégié la sécurité, la liquidité et le zéro fiscalité du Livret A sur le rendement. L’absence de placements associant sécurité et rendements les conduit également à opter pour le Livret A. Il convient également de souligner que les ménages continuent à maintenir un niveau de liquidités sur leurs comptes courants inédits, plus de 520 milliards d’euros, soit plus de 17000 euros par ménage.
Au mois de juin, la collecte du Livret A a été de 1,04 milliard d’euros en légère diminution par rapport à celle du mois de mai (1,7 milliard d’euros) mais supérieur à celle de juin 2020 (0). La hausse du taux intervenue au 1er février dernier continue à se faire sentir mais son effet se réduit. L’annonce du passage de 1 à 2 % au 1er août devrait conduire à une reprise de la collecte entre les mois de juillet et septembre même si traditionnellement le second semestre connaît un ou plusieurs mois de décollecte en lien avec les vacances, les achats de rentrée scolaire ou ceux de la fin d’année.
En juin, l’encours du Livret A a battu un nouveau record à 359,8 milliards d’euros, contre 298,6 milliards d’euros en décembre 2019. Il a depuis le début de la crise sanitaire progressé de 20 %.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire a également enregistré une collecte positive en juin de 250 millions d’euros euros portant son encours à 128,9 milliards d’euros, nouveau record pour ce placement. Sur les six premiers mois de l’année, la collecte a été de 2,57 milliards d’euros.
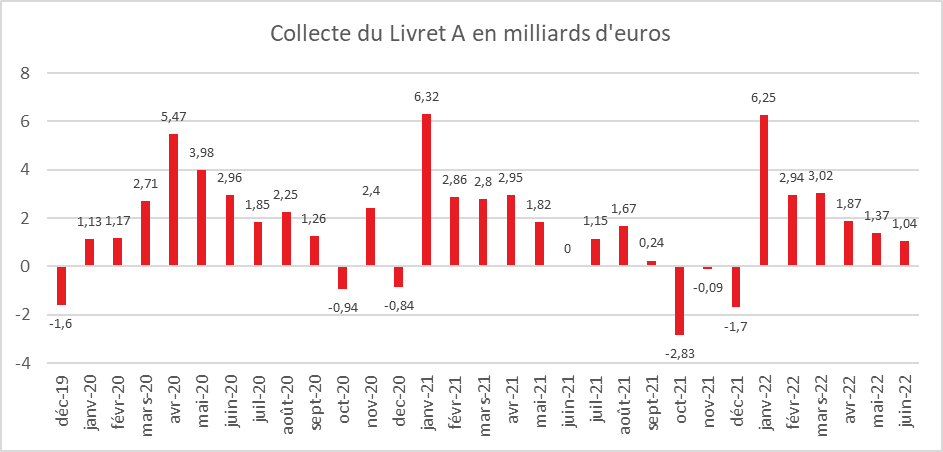
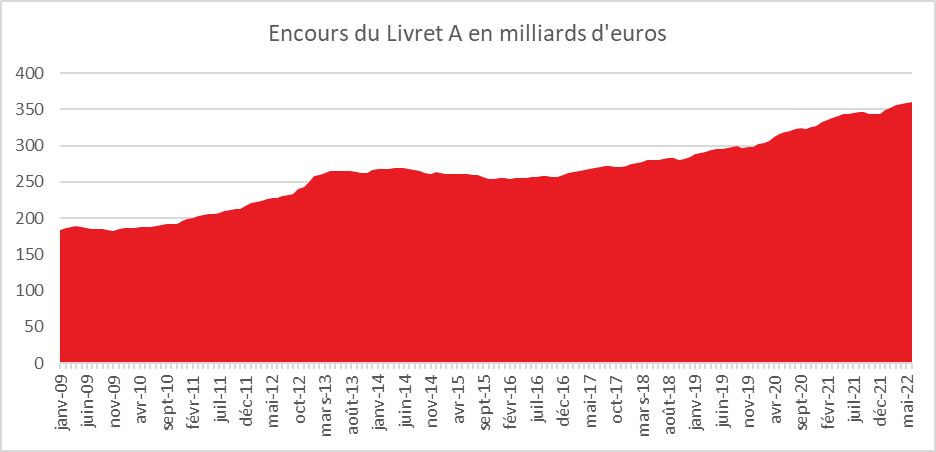
Le Coin des Epargnants du 15 juillet 2022
Dans l’angoisse de la future rentrée
L’annonce de l’inflation américaine du mois de juin, +9,1 % en rythme annuel a laissé craindre dans un premier temps à un durcissement de la politique monétaire avec une augmentation de 100 points de base des taux directeurs. La communication des autorités américaines laissant entendre que la hausse des prix n’avait pas pris en compte la décrue intervenue sur le marché pétrolier a rassuré les investisseurs. Il en a résulté une détente sur les taux d’intérêt, aidés en Europe par la menace, à l’automne, d’un fort ralentissement de la croissance.
Aux Etats-Unis, les indicateurs économiques sont meilleurs que prévu. Les ventes au détail ont augmenté de 1 % le mois dernier (+0,9 % attendu), tandis que l’activité manufacturière a rebondi en juillet dans la région de New York, l’indice calculé par la succursale locale de la Fed ayant enregistré une progression surprise à 11,1 points, contre -2 attendus après -1,2 en juin. L’indice de confiance des consommateurs, calculé par l’Université du Michigan, est en hausse en juillet à 51,1, contre 50 en juin et 49,9 attendu par le consensus.
Dans ce contexte encore confus, le CAC 40 est resté stable sur la semaine tout en connaissant durant des fluctuations journalières importantes. Le Daxx allemand a, de son côté, reculé de plus 1 %. L’économie allemande est fragilisée par sa forte exposition au gaz russe. Les indices américains ont également légèrement reculé.
Le prix du baril de pétrole a continué de baisser revenant vendredi 15 juillet à 101 dollars.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 15 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6,036.00 | +0,05 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 288,26 | -0,16 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 452,42 | -1,57 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 12 864,72 | -1,16 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 159,01 | -0,52 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 477,20 | -0,84 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 26 788,47 | +1,02 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 228,06 | -3,81 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,651 % | -0,211 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,127 % | -0,296 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,921 % | -0,165 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0086 | -0,86 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 704,620 | -2,15 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 101,450 | -5,28 % | 78,140 |
L’euro à parité avec le dollar, pourquoi et quelles conséquences ?
En ce mois de juillet, un euro vaut un dollar, un phénomène sans précédent depuis 20 ans. Depuis le début de l’année, l’euro a perdu 12 % de sa valeur. Il faut remonter à septembre 2002 pour retrouver un taux de change encore plus faible.
La dépréciation de l’euro, en ce début d’été, est imputable aux écarts de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique. La banque centrale américaine a engagé, depuis le mois de mars, un relèvement de ses taux quand la BCE ne devrait le faire que ce mois-ci. Les taux directeurs américains évoluent actuellement dans la fourchette 1,5/1,75 % quand ceux de la BCE se situent entre -0,5 et 0 %. D’ici la fin de l’année, cette fourchette pourrait être de 2,75/3 %. L’écart avec les taux européens pourrait être de 2,5 points. Les politiques monétaires différentes se traduisent par des écarts de taux sur les obligations d’Etat. Ainsi pour celles à dix ans, le taux américain est proche de 3 % quand il est de 1,3 pour son équivalent allemand. Les investisseurs privilégient ainsi les obligations américaines au détriment de celles de la zone euro ce qui contribue à la dépréciation de la monnaie commune. Les anticipations de croissance sont plus mauvaises pour l’Europe qui est plus exposée que les Etats-Unis à la guerre en Ukraine et à ses répercussions sur le plan énergétique. La perspective d’un fort ralentissement économique en zone euro incite les investisseurs à opter pour les titres américains. Les Etats-Unis sont, par ailleurs, considérés comme un pays refuge pour les détenteurs de capitaux en période de crise.
La dépréciation de l’euro face au dollar n’a pas commencé avec la guerre en Ukraine mais avec la crise financière de 2008. Juste avant sa survenue, un euro s’échangeait contre 1,5 dollar. Les stigmates de cette crise ont été plus longs à se résorber qu’aux Etats-Unis. La crise des dettes souveraines en 2011 avec le problème de la Grèce a également affaibli l’euro. La mise en place à compter de 2015 d’une politique monétaire ultra-accommodante a conforté le mouvement de baisse de l’euro. La Banque centrale européenne a décidé l’application de taux directeurs nuls voire négatifs pour le taux de dépôts. La dépréciation de l’euro trouve également sa source dans le dilemme auquel est confrontée la BCE. Si pour lutter l’inflation, elle augmente rapidement et fortement ses taux directeurs, elle risque tout à la fois de provoquer une récession et une crise des dettes souveraines. Le risque d’écarts de taux entre les Etats membres limite ses marges de manœuvre ce qui la met dans une position différente de celle de la FED.
Le poids de l’euro comme monnaie de réserve tend à se réduire. En 2008, la monnaie commune représentait près de 28 % des réserve, En 2022, le poids de l’euro dans les actifs des banques centrales a reculé de 28 % à 24 % selon le sondage du Forum officiel des institutions monétaires et financières. Le dollar représente toujours autour de 60 % des réserves de change. L’euro est devenue la deuxième monnaie mondiale grâce avant tout aux échanges internes des Etats membres de l’Union européenne et des Etats qui sont associés au marché commun comme la Turquie. L’Europe est la deuxième zone d’investissement, principalement des achats de dette, pour les institutions monétaires étrangères, mais dans les prochains mois, seulement 15 % des banques centrales comptent accroître leurs investissements obligataires en Europe.
La faiblesse de l’euro devrait se poursuivre tant que l’écart de taux restera substantiel entre les Etats-Unis et l’Union européenne et tant que les anticipations de croissance resteront négatives pour cette dernière. Pour renouer avec une appréciation, les craintes de pénurie d’énergie pour l’hiver devront être levées.
Livret A, vers un taux à 2%
L’INSEE a confirmé que l’inflation avait atteint au mois de juin +0,7 % en juin et en rythme annuel, +5,8 %.
Quel taux du du Livret A au 1er août 2022
En vertu de l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementé, le taux des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire est égal, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :
a) La moyenne arithmétique entre :
– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée
(UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;
– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages ;
b) 0,5 %.
Sur le premier semestre 2022, le taux d’inflation moyen a été de 4,46 % en rythme annuel. Le taux moyen sur six mois de l’€STR a été -0,58. La moyenne de ces deux valeurs est de 1,94 % ce qui mettrait le taux du Livret A à 1,9 ou à 2 %.
| Taux du Livret A | |
| 22 mai 1818 | 5,00% |
| 1er janvier 1851 | 4,75% |
| 1er janvier 1881 | 3,50% |
| 1er janvier 1905 | 3,00% |
| 1er janvier 1916 | 3,50% |
| 1er janvier 1929 | 3,50% |
| 1er janvier 1946 | 1,50% |
| 1er janvier 1960 | 3,25% |
| 1er janvier 1966 | 3,00% |
| 1er janvier 1968 | 3,50% |
| 1er juin 1969 | 4,00% |
| 1er janvier 1970 | 4,25% |
| 1er janvier 1974 | 6,00% |
| 1er janvier 1975 | 7,50% |
| 1er janvier 1976 | 6,50% |
| 16 octobre 1981 | 8,50% |
| 1er août 1983 | 7,50% |
| 16 août 1984 | 6,50% |
| 1er juillet 1985 | 6,00% |
| 16 mai 1986 | 4,50% |
| 1er mars 1996 | 3,50% |
| 16 juin 1998 | 3,00% |
| 1er août 1999 | 2,25% |
| 1er juillet 2000 | 3,00% |
| 1er août 2003 | 2,25% |
| 1er août 2005 | 2,00% |
| 1er février 2006 | 2,25% |
| 1er août 2006 | 2,75% |
| 1er août 2007 | 3,00% |
| 1er février 2008 | 3,50% |
| 1er août 2008 | 4,00% |
| 1er février 2009 | 2,50% |
| 1er mai 2009 | 1,75% |
| 1er août 2009 | 1,25% |
| 1er août 2010 | 1,75% |
| 1er février 2011 | 2,00% |
| 1er août 2011 | 2,25% |
| 1er février 2013 | 1,75% |
| 1er août 2013 | 1,25% |
| 1er août 2014 | 1,00% |
| 1er août 2015 | 0,75% |
| 1er février 2020 | 0,50% |
| 1er février 2022 | 1,00 % |
| 1er août 2022 | 2 % ? |
Depuis le début des années 1980, il n’y avait jamais eu de relèvement d’un point. Le plus important avait réalisé le 1er juillet 2000 avec une hausse de 0,75 point.
Pour un épargnant ayant 10 000 euros sur son Livret A, le gain sera de 100 euros de plus, soit un total de 200 euros, l’inflation étant prévu pour l’ensemble de l’année 2022 à 5,5 % (prévision INSEE juin 2022), la perte réelle pour l’épargnant sera de 350 euros en euros constants.
Le relèvement du taux du Livret A d’un point coûtera pour ce seul produit 3,6 milliards d’euros aux banques et à la Caisse des Dépôts.
Compte tenu des règles de centralisation, le coût des banques sera de 1,44 milliard d’euros et de 2,16 milliards d’euros pour la Caisse des Dépôts. En diminuant la rentabilité de cette dernière, le relèvement du taux du Livret A réduit le montant des dividendes qu’elle verse à l’Etat son actionnaire.
L’augmentation du taux pourra se traduire par une hausse de taux pour les emprunts des bailleurs sociaux, des entreprises (à partir des ressources du LDDS) et des collectivités locales. A défaut de pouvoir jouer sur les taux, les banques pourraient accroître le montant des frais supportés par les clients.
L’augmentation du taux du Livret A devrait conduire à une augmentation de la collecte ce qui pénaliser, en période d’inflation, la consommation. Ce phénomène a été constaté lors du relèvement intervenu au 1er février 2022. Depuis le début de l’année, la collecte du Livret A est dynamique avec plus de 15 milliards d’euros, l’encours du Livret A ayant battu un nouveau record fin mai avec 358,8 milliards d’euros.
Le taux du Livret A sera deux fois supérieur à celui du taux moyen net d’impôt des fonds euros, ce qui est sans précédent. Il sera nettement supérieur aux taux des livrets bancaires fiscalisés (0,09 % au mois de mai selon la Banque de France).
Le taux du Livret d’Epargne Populaire à 4,5 %
Le gouvernement pourrait décider de relever le taux du Livret d’Epargne Populaire à 4,5 % (taux de l’inflation arrondi au dixième supérieur). Il faut remonter à 1998 pour avoir un taux du LEP identique (4,5 %). Le LEP sera ainsi de loin le placement de court terme le mieux rémunéré permettant de compenser l’inflation. 7 millions de Français ont un LEP quand une vingtaine de millions pourraient potentiellement en ouvrir un.
| Taux du LEP | |
| 14-janv-83 | 8,50 % |
| 16-août-84 | 7,50 % |
| 1er juillet 1985 | 7,00 % |
| 16-mai-86 | 5,50 % |
| 1er mars 1996 | 4,75 % |
| 16-juin-98 | 4,75 % |
| 1er août 1999 | 4,00 % |
| 1er juillet 2000 | 4,25 % |
| 1er août 2003 | 4,25 % |
| 1er août 2004 | 3,25 % |
| 1er août 2005 | 3,00 % |
| 1er février 2006 | 3,25 % |
| 1er août 2006 | 3,75 % |
| 1er août 2007 | 4,00 % |
| 1er février 2008 | 4,25 % |
| 1er août 2008 | 4,50 % |
| 1er février 2009 | 3,00 % |
| 1er mai 2009 | 2,25 % |
| 1er août 2009 | 1,75 % |
| 1er août 2010 | 2,25 % |
| 1er février 2011 | 2,50 % |
| 1er août 2011 | 2,75 % |
| 1er août 2012 | 2,75 % |
| 1er février 2013 | 2,25 % |
| 1er août 2013 | 1,75 % |
| 1er août 2014 | 1,50 % |
| 1er août 2015 | 1,25 % |
| 1er février 2020 | 1,00 % |
| 1er février 2022 | 2,20 % |
Les pensions de base et les minimas sociaux revalorisés depuis le 1er juillet 2022
Le Gouvernement a décidé la revalorisation des pensions de base de retraite de 4 % à compter du 1er juillet dernier. Cette mesure ne sera effective qu’après l’adoption du projet de loi sur le pouvoir d’achat. Les retraités devraient bénéficier de cette majoration qui sera rétroactive à partir du 9 août prochain.
La revalorisation de 4 % s’appliquera également à toutes les prestations sociales et familiales. Celles-ci sont logiquement revalorisées chaque année en fonction de l’évolution de la moyenne des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers mois, conformément à l’article L161-25 du Code de la Sécurité sociale. Pour ces dernières, la hausse du mois de juillet s’ajoute ) celles de 1,8 % intervenue le 1er avril dernier.
La revalorisation anticipée concernera les bénéficiaires de minima sociaux, c’est-à-dire :
- les 1,9 millions de foyers bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ;
- les 1,2 millions d’allocataires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- les 600 000 bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou minimum vieillesse ;
- les 300 000 bénéficiaires des allocations de solidarité versées par Pôle emploi, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation équivalent retraite (AER) et l’allocation temporaire d’attente (ATA) ;
- les titulaires de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;
- les titulaires de l’Allocation veuvage (AV).
Exemples de nouveaux montants :
| Prestation sociale | Montant mensuel au 1er avril 2022 | Montant mensuel probable au 1er juillet 2022 |
| RSA | 575,52 euros (maximum pour une personne seule) | 598,54 euros |
| AAH | 919,86 euros (maximum) | 956,65 euros |
| ASPA | 916,78 euros (maximum pour une personne seule) | 953,45 euros |
| ASS | 516,30 euros (à taux plein) | 537 euros |
La prime d’activité, versée aux travailleurs modestes, est également revalorisée par anticipation de 4 %. Cette hausse bénéficiera à 4,5 millions de foyers.

Les pensions d’invalidité et rentes d’accidents du travail ou de maladies permanentes (AT-MP) augmenteront, aussi, de 4 % en juillet. 2,4 millions de personnes en sont bénéficiaires.
Les prestations familiales versées par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) seront enfin revalorisées de 4 %, après 1,8 % en avril dernier.
Sont concernées :
- les allocations familiales ;
- le complément familial ;
- la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), qui comprend la prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de base, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et le complément de libre choix du mode de garde (CMG) ;
- l’allocation de soutien familial (ASF) ;
- l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
6 millions de familles profiteront de cette hausse anticipée/
Des particuliers toujours présents sur le marché actions
Selon l’Autorité des Marchés Financiers, au 2e trimestre 2022, 931 000 particuliers ont acheté ou vendu des actions. Depuis le 4e trimestre 2019, le nombre de particuliers réalisant des opérations sur les actions est élevé en France. Il avoisinait 500 000 par trimestre en 2018. L’augmentation du nombre d’actionnaires après une longue période de baisse enter 2008 et 2018 ainsi que leur rajeunissement expliquent cette évolution. Le développement de la gestion pilotée des Plans d’Epargne en Actions ou des contrats d’assurance vie ou des Plans d’Epargne Retraite favorise également la multiplication des arbitrages.
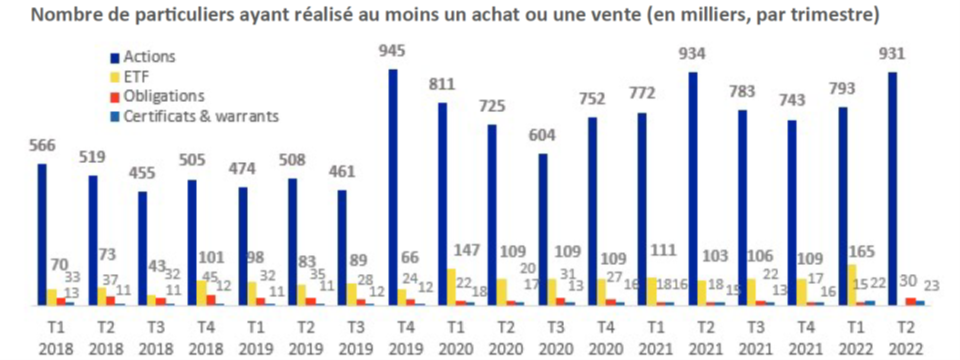
Malgré un contexte de baisse du cours des actions depuis le début de l’année, l’arrivée de nouveaux actionnaire se maintient à un haut niveau. Au 1er trimestre, 91 000 nouveaux actionnaires ont été enregistrés et 64 000 au 2e. Au total, 599 000 particuliers ont acheté au 2e trimestre des actions, contre 606 000 au premier. Le nombre de vendeurs a été légèrement supérieur à celui des acheteurs. Compte tenu de la forte baisse des indices, plus de 15 points pour le CAC 40 sur le premier semestre, ce résultat est assez logique d’autant plus que l’année 2021 avait été marquée par une progression historique des indices, +29 %. Des actionnaires ont souhaité engrangé des plus-values en début d’année d’autant plus que les marchés se sont retournés assez rapidement. L’arrivée de jeunes actionnaires et le développement des comptes en ligne contribuent à la réalisation rapide de plus-values. Les Français sont plus opportunistes que dans le passé face aux actions en achetant en période de baisse et sachant solder leurs positions.
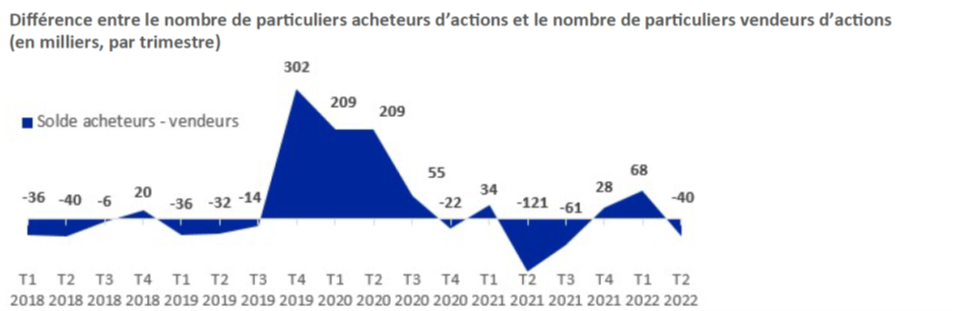
Le Coin des Epargnants du 8 juillet 2022 : vérité en deçà de l’Atlantique, erreur au-delà ?
L’euro à parité ou presque avec le dollar
Les anticipations de divergence des politiques monétaires européenne et américaine ainsi que les craintes d’une récession au sein de la zone euro sur fond de pénurie de pétrole et de gaz à l’automne, ont contribué à affaiblir l’euro par rapport au dollar. L’euro a terminé la semaine à 1,01 dollar, son plus bas niveau de ces vingt dernières années, en baisse de 10 % sur un mois. L’écart de taux de part et d’autre de l’Atlantique tend à s’accroître, ce qui amène des ventes d’euros au profit du dollars. Les résultats de l’emploi américain confortent cet arbitrage. Au mois de juin, l’économie américaine a créé, en effet, 372 000 postes en juin après 384 000 (révisé de 390 000) le mois précédent, selon les chiffres publiés par le Bureau of Labor Statistics (BLS), contre 265 000 anticipés par le consensus formé par Bloomberg. Le taux de chômage est resté stable à 3,6 % comme prévu, tandis que la croissance du salaire horaire moyen a ralenti à 5,1 % sur un an, après 5,3 % en mai. La bonne tenue de l’emploi américain pourrait se traduire par une nouvelle hausse des taux de 75 points de base à l’occasion de la réunion de la Fed à la fin du mois, même si les signes d’un tassement de la croissance des salaires et la récente chute des prix des matières premières suggèrent que les perspectives d’inflation pourraient s’améliorer plus rapidement que prévu par les responsables de la banque centrale. Les investisseurs parient sur un relèvement substantiel. Le taux de l’obligation de l’Etat américain a 10 ans est repassé en fin de semaine au-dessus de 3 %.
Un euro faible renchérit le coût des importations et alimente de ce fait l’inflation. Pour la première fois depuis 1991, juste après la réunification, l’Allemagne a enregistré un déficit commercial en mai. L’augmentation du coût de l’énergie et les difficultés du secteur automobile expliquent la dégradation du solde commercial. Par ailleurs, l’Allemagne, premier fournisseur européen de la Russie avant la guerre en Ukraine, a vu ses exportations vers ce pays diminuer de plus de 30 % en quelques mois.
En milieu de semaine, le baril de pétrole Brent est repassé furtivement en-dessous de 100 dollars avant de se redresser légèrement en fin de semaine. Le ralentissement attendu de la croissance en 2022 à l’échelle mondiale est supposé peser sur la demande du pétrole, ce qui concourt à la baisse du cours du baril. Sur un mois, le baril de Brent a perdu 10 %.
Les marchés « actions » après une fin du mois de juin difficile ont, cette semaine, enregistré des hausses. Le CAC40 s’est valorisé de 1,72 % et le Nasdaq de 4,56 %. Les fortes baisses des dernières semaines ont incité les investisseurs à revenir sur le marché à la recherche de plus-values potentielles.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 8 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 033,13 | +1,72 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 338,15 | +0,77 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 635,31 | +4,56 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 015,23 | +1,58 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 196,24 | +0,38 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 506,55 | +1,79 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 26 517,19 | +2,14 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 356,08 | -0,77 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,862 % | +0,062 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,333 % | +0,105 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +3,086 % | +0,097 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0174 | -2,40 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 742,090 | -3,71 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 107,100 | -3,84 % | 78,140 |
La difficile introduction en bourse de Deezer
L’action de Deezer, un fournisseur français de musique en ligne a, dans un contexte de marché difficile, baissé de 15 % lors de son introduction en bourse. Celle-ci était la deuxième tentative de la société après avoir essuyé un échec en 2015. Les dirigeants de cette start-up ont opté pour la cotation afin d’accéder aux capitaux nécessaires à son développement. Le marché de la musique en ligne est en plein essor mais demeure fragile, les internautes s’étant habitués à la gratuité. Par ailleurs, le marché est dominé par des grandes entreprises qui laissent peu de place aux seconds rôles.
En 2021, au niveau mondial, 523,9 millions de personnes sont abonnés à différentes offres payantes de musique en ligne. le nombre d’abonnés s’est accru de 109,5 millions l’année dernière, soit une hausse de +26,4 %. En France, une dizaine de millions de personnes auraient souscrit à un abonnement de musique en ligne. En comptant les utilisateurs sans abonnement (qui contribuent au chiffre d’affaires par la publicité des plateformes), la France compterait 22 millions d’utilisateurs.
Le marché de la musique en ligne est dominé par Spotify qui détient 31 % de parts de marché, suivie d’Apple Music (15 %), d’Amazon Music, Tencent Music (13 %) et YouTube Music (8 %). Le service musical de Google connait une forte croissance avec une progression de 50 % du nombre d’abonnés en 2021, une majorité étant de jeunes utilisateurs.
Les applications de musique en ligne chinoises sont également en forte croissance tout en restant cantonnées sur le marché de leur pays d’origine et des pays limitrophes. Tencent Music et NeatEase ont ainsi accumulé 35,7 millions de nouveaux abonnés en l’espace d’un an alors qu’ils ne sont disponibles qu’en Chine.
Le Français Deezer ne détient que 2 % du marché du streaming avec 9,6 millions d’abonnés. Il reste franco-français avec un taux de pénétration faible dans les autres pays. Deezer a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et a comme objectif d’atteindre le milliard d’euros d’ici à 2025, ainsi que la rentabilité opérationnelle. Le streaming est une activité peu rentable en raison des coûts informatiques et des coûts de diffusion croissants. Les compagnies de musique, « les majors » comme Universal ou Sony, négocient de plus en plus âprement l’accès à leur catalogue. Pour accroître leur pouvoir de négociation, elles achètent les portefeuilles musicaux aux artistes. Springsteen (500 millions de dollars), Bob Dylan (300 millions de dollars), Sting ou encore les héritiers de Bowie ont ainsi vendu les droits de leurs albums à des majors. Les Rolling Stones ont choisi un système différent. Ils concèdent pour une durée déterminée leur portefeuille musical et tous les droits afférents (e-commerce, merchandising) en contrepartie d’une certaine somme. Dans tous les cas, les compagnies sont appelées à rentabiliser leurs investissements, ce qui passe par des négociations serrées avec les diffuseurs que les applications de musique en ligne. Deezer a, lors de son introduction en bourse, également souffert du contexte, les investisseurs privilégiant les produits de taux sur les actions.
Taux de rémunération des livrets bancaires stable en mai
Le taux de rémunération des livrets d’épargne ordinaires est resté stable au mois de mai à 0,09% malgré le début de remontée des taux.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| mai-2021 | mars-2022 | avr- 2022 (e) | mai-2022 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Ménages | 0,65 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,34 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,92 | 0,73 | 0,72 | 0,71 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| dont : livret A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| – livrets ordinaires | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| – plan d’épargne-logement | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| SNF | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| dont : – dépôts à vue | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,73 | 0,61 | 0,61 | 0,60 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,54 | -0,50 | -0,45 | -0,39 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,38 | 0,23 | 0,79 | 0,94 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
Le Coin des Epargnants : mobilisation générale contre l’inflation
Inflation toujours en hausse
Au mois de juin, l’inflation en France a atteint 5,8 % en rythme annuel, toujours en hausse. En Allemagne, elle a légèrement ralenti à 8,2 %. Outre-Rhin, elle s’était élevée à 8,7 % en mai. Pour l’ensemble de la zone euro, l’inflation a été de 8,6 % au mois de juin, contre 8,1 % en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, l’énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en juin (41,9 %, comparé à 39,1 % en mai), suivie de l’alimentation, alcool & tabac (8,9 %, comparé à 7,5 % en mai), des biens industriels hors énergie (4,3 %, comparé à 4,2 % en mai) et des services (3,4 %, comparé à 3,5% en mai).
Des marchés dominés par la peur de la récession
Lors du premier semestre 2022, le CAC 40 a connu sa troisième plus forte baisse de son histoire avec un recul de 17,20 %. Les deux baisses plus importantes avaient été enregistrées en 2020 avec -17,43 % et en 2008 avec -21 %. Les autres places occidentales connaissent des évolutions comparables. L’indice allemand, le Daxx a perdu 19,52 % et l’Eurostoxx, 19,62 % en six mois. Le Nasdaq a perdu près du tiers de sa valeur en six mois (-29,51 %). Le Dow Jones a de son côté baissé de 15,31 %.
La résurgence de l’inflation, le relèvement des taux d’intérêt et la crainte de récession qui en résulte, avec en toile de fond la guerre en Ukraine et la menace persistante de l’épidémie, expliquent cette contraction qui fait suite à la progression exceptionnelle de 2021.
La peur de la récession induit une baisse des taux d’intérêt sur les obligations d’Etat, les investisseurs privilégiant les placements sans risque.
Les banques centrales en mode combattant
Le président de la Fed, Jerome Powell, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et le gouverneur de la BoE anglaise, Andrew Bailey, ont tous réaffirmé leur intention de ramener l’inflation à son objectif lors d’un panel organisé au Forum de la BCE, le 29 juin dernier. Jerome Powell a admis qu’il y avait un risque que la Fed aille trop loin dans la hausse des taux, pouvant provoquer un réel ralentissement de l’activité, mais que ce risque n’était pas le plus important. Le pire des scénarios pour l’économie serait que la banque centrale échoue à restaurer la stabilité des prix. Jerome Powell et Christine Lagarde ont également mis en garde, hier, contre l’augmentation des risques liés à une inflation qui s’annonce durablement élevée, préparant ainsi les investisseurs à des moments « douloureux ».
En France, la hausse des prix à la consommation a atteint un nouveau record ce mois-ci, à 6,5 % sur un an en données préliminaires harmonisées de l’Union européenne. D’après les chiffres publiés le 1er juin, l’Allemagne a connu un répit temporaire de l’inflation (grâce à deux mesures gouvernementales : la réduction de la taxe sur les carburants et la mise en place d’un ticket de transport à prix réduit). En Espagne, l’inflation a atteint 10 % en juin (+1,5 point par rapport à mai).
L’inflation reste portée par les cours de l’énergie. Le pétrole a augmenté de 42 % depuis le 1er janvier 2022. La réduction des exportations de gaz russe amplifie le mouvement de hausse de cours, aidée en cela par une panne de compresseur dans le champ norvégien de Martin Linge qui a amputé la production.
Dans ce contexte difficile, Christine Lagarde a confirmé que la première hausse, depuis onze ans des taux directeurs de la BCE interviendra au mois de juillet et qu’elle sera de 25 points de base. La présidente de la BCE ne s’interdit pas d’effectuer des relèvements plus importants par la suite. En cas d’augmentation des anticipations d’inflation, elle a indiqué que « nous devrions alors retirer nos mesures accommodantes plus rapidement afin d’éliminer le risque d’une spirale autoréalisatrice ». Si l’inflation continuait à progresser rapidement, le recours à des hausses de 50 points de base – voire plus – est envisageable dès septembre. En parallèle, la BCE travaille à la création d’un nouvel outil anti-fragmentation pour limiter les écarts de taux au sien de la zone. Une première solution qui avait été évoquée passait par une sorte d’arbitrage. La BCE pourrait acheter des titres émis par l’Italie pour faire baisser le coût de financement de l’État italien et cèderait, pour un montant équivalent, des obligations allemandes qu’elle détient. Difficilement réalisable, cette idée ne semble pas avoir été retenue. Les obligations allemandes sont, en effet, logées à la Bundesbank qui les détient pour le compte de la BCE. Compte tenu de la hausse des taux, la Bundesbank aurait été amenée à les vendre à perte. Le mécanisme à l’étude viserait à neutraliser les achats des obligations des États périphériques en proposant aux banques de déposer un montant équivalent auprès de la BCE, en bénéficiant d’une rémunération plus attractive que le simple taux de dépôt actuel. La liquidité excédentaire ne serait pas détruite, mais elle serait durablement neutralisée.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 1er juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 5 931,06 | -2,34 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 097,26 | -1,28 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 127,85 | -4,13 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 12 813,03 | -2,33 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 168,65 | -0,56 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 448,31 | -2,40 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 25 935,62 | -2,10 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 387,64 | +1,07 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,800 % | -0,164 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,228 % | -0,210 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,889 % | -0,237 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0411 | -1,33 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 802,130 | -1,45 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 111,070 | -1,58 % | 78,140 |
Relèvement des taux d’usure pour le 3e trimestre
L’Etat a publié les taux d’usure pour le 3e trimestre. Ces taux sont les plafonds de taux d’intérêt (assurance comprise) que les établissements financiers ne peuvent pas dépasser pour les emprunts proposés à leurs clients. Depuis quelques semaines, une polémique s’est engagé au sujet de personnes qui ne pourraient pas accéder à des prêts du fait que les taux d’usure seraient trop faibles et ne prendraient pas en compte la remontée des taux. La Banque de France a démenti l’existence d’un grand nombre de rejets de dossiers sur cette base. Avec le nouveau barème entrant en vigueur au 1er juillet, pour un crédit immobilier à vingt ans, le seuil est passé de 2,40 % à 2,57 %.
| Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 2ème trimestre 2022 | Taux d’usure applicable au 1er juillet 2022 |
| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,83 | 21,11 |
| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,40 | 9,87 |
| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 3,70 | 4,93 |
| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,95 | 2,60 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,95 | 2,60 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 1,93 | 2,57 |
| Prêts à taux variable | 1,84 | 2,45 |
| Prêts relais | 2,24 | 2,99 |
| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 2,06 | 2,75 |
| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,12 | 2,83 |
| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,27 | 3,03 |
| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,96 | 2,61 |
| Découverts en compte | 11,54 | 15,39 |
| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,92 | 2,56 |
| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
| Découverts en compte | 11,54 | 15,39 |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.
Définition du TEG
En vertu de l’article L. 314-6 du code de la consommation, « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».
Pour la détermination du taux effectif global du prêt, « sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées » (article L. 314-1 du code de la consommation).
Ainsi, l’article R. 314-4 du code de la consommation dispose que « sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier ;
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. »
Législation française relative aux seuils de l’usure
3,2 millions de titulaires de PER individuels
Selon France Assureurs, en mai, les cotisations sur un PER assurantiel ont atteint 524 millions d’euros. Depuis le début de l’année, les cotisations versées s’élèvent à 2,7 milliards d’euros, en hausse de +44 % par rapport à la même période de 2021. Dans le même temps, 413 millions d’euros ont été transférés d’anciens contrats vers un PER.
Au total, le marché des PER commercialisés par les entreprises d’assurance enregistre ainsi 937 millions d’euros
de versements sur le mois de mai 2022 et 10,2 milliards d’euros de versements depuis le début de l’année 2022.
Fin mai 2022, 3,2 millions d’assurés détiennent un PER pour un encours de 39,4 milliards d’euros.
L’assurance vie assure en mai
En mai, la collecte nette de l’assurance, au mois de mai s’est élevée, selon France Assureurs, à +1,9 milliard d’euros, en retrait par rapport à celle du mois d’avril (2,2 milliards d’euros). Elle est en revanche en légère hausse par rapport à celle du mois de mai 2021 (+0,2 milliard d’euros). La collecte de cette année est comparable à celle de l’année 2019 (1,8 milliard d’euros) et supérieur à la moyenne de ces dix dernières années.
Par rapport à la fin de l’année dernière et aux premiers mois de l’année, la collecte se tasse tout en restant relativement abondante. La chute du cours des actions n’a pas induit un recul de la collecte en unités de compte. SI les fonds euros sont moins plébiscités avec une décollecte nette, il n’ y a pas de mouvement important de retrait dans un contexte de hausse des prix et de faibles rendements. Les Français qui maintiennent un important effort d’épargne privilégient les placements les plus connus que sont l’assurance vie et les livrets réglementés. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à +12,4 milliards d’euros, en hausse de +2,8 milliards d’euros comparé aux 5 premiers mois de l’année 2021. Cette collecte est inférieure à celle du Livret A sur la même période (+15,45 milliards d’euros)
Pour le seul mois de mai, les cotisations brutes en assurance vie ont atteint 11,8 milliards d’euros, en légère hausse de +0,2 milliard d’euros par rapport à mai 2021. Elles augmentent sur la partie en euros, de +0,2 milliard d’euros à 7,0 milliards d’euros, et restent stables en unités de compte (UC). Ces dernières représentent 40,6 % de la collecte, soit le taux moyen constaté depuis le début de l’année.
Les prestations sont stables par rapport à mai 2021, à 9,9 milliards d’euros en mai 2022. Depuis janvier, 53,2 milliards d’euros ont été versés, en baisse de −0,5 milliard d’euros comparé à la même période en 2021.
L’encours des contrats d’assurance vie atteint 1 847 milliards d’euros à fin mai, en croissance de +0,6 % sur un an. La faible progression s’explique par l’évolution des cours de marché en recul depuis le début de l’année.
Dans un contexte marqué par de fortes incertitudes, les ménages devraient continuer à privilégier les placements liquides et offrant une garantie. Un léger tassement de la collecte nette de l’assurance vie pourrait intervenir. La baisse des cours des actions pourrait néanmoins attirer certains épargnants souhaitant engranger des plus-values dans les prochains mois.
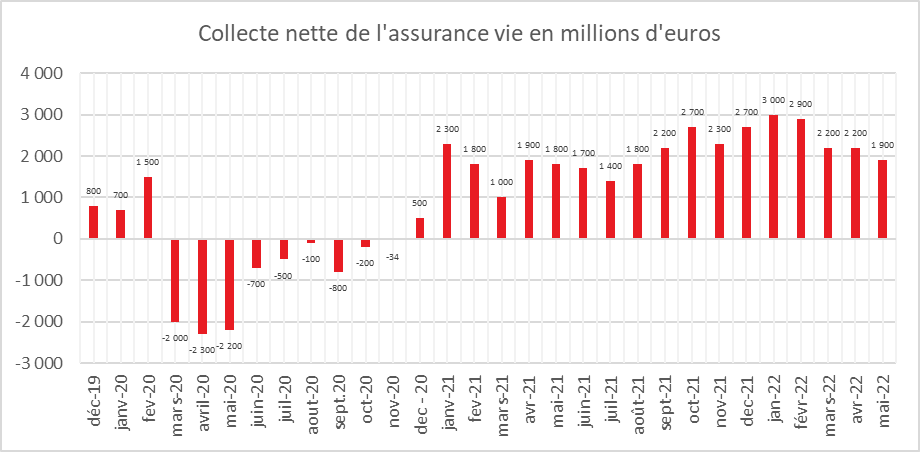
Le taux du Livret à 2 % au 1er août 2022 ?
Avec la publication du taux d’inflation (indice provisoire) du mois de juin, le taux du Livret A pourrait être porté à 2 % au 1er août 2022. La Banque de France communiquera une préconisation de taux au milieu du mois de juillet après la publication définitive du taux d’inflation du mois de juillet.
En vertu de l’arrêté du 27 janvier 2021, le taux des livrets A, est égal, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :
a) La moyenne arithmétique entre :
– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) ;
– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages
b) 0,5 %.
Les données utilisées sont celles relatives au dernier mois pour lequel ces données sont connues.
L’écart entre deux fixations successives du taux est limité de manière transitoire à 0,5 point de pourcentage maximum jusqu’à ce que le calcul ci-dessus donne deux résultats successifs dont l’écart est inférieur à 0,5 point de
Avec un taux de 5,8 % au mois de juin, le taux moyen de ces six derniers mois s’est élevé à 4,46 %. Le taux moyen de l’€str est de -0,58 donnant pour les deux composantes une moyenne arithmétique de 1,94 % ouvrant droit à un taux de rendement pour le Livret A de 2 % à compter du 1er août 2022. Ce taux s’appliquera également au Livret de Développement Durable et Solidaire.
Pour le Livret d’Epargne Populaire, le gouvernement pourrait opter pour un taux de 4,5 %.
Une augmentation d’un point du taux du Livret A ne permettrait pas de compenser les effets de l’inflation. Le rendement réel du Livret A serait négatif sur l’année de plus de trois points.
Avec un taux de 2 %, le Livret A offrira une rémunération nettement supérieur à celle des livrets bancaires fiscalisés (autour de 0,1 % en moyenne) et même des fonds euros de l’assurance vie (1,2 % avant fiscalité).
Pour un épargnant ayant 10 000 euros sur son Livret A, le gain sera de 100 euros de plus, soit un total de 200 euros, l’inflation étant prévu pour l’ensemble de l’année 2022 à 5,5 % (prévision INSEE juin 2022), la perte réelle pour l’épargnant sera de 361 euros en euros constants.
Le relèvement du taux du Livret A d’un point coûtera pour ce seul produit 3,6 milliards d’euros aux banques et à la Caisse des Dépôts. L’augmentation du taux pourra se traduire par une hausse de taux pour les emprunts des bailleurs sociaux, des entreprises (à partir des ressources du LDDS) et des collectivités locales.
L’augmentation du taux du Livret A devrait conduire à une augmentation de la collecte ce qui pénaliser, en période d’inflation, la consommation. Ce phénomène a été constaté lors du relèvement intervenu au 1er février 2022. Depuis le début de l’année, la collecte du Livret A est dynamique avec plus de 15 milliards d’euros. L’encours du Livret A a battu un nouveau record fin mai avec 358,8 milliards d’euros.
Confiance en berne pour les ménages français
En juin, la confiance des ménages continue, selon l’INSEE de baisse, pour le sixième mois consécutif sur fond de résurgence de l’inflation. À 82, l’indicateur qui la synthétise perd trois points en un mois et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).
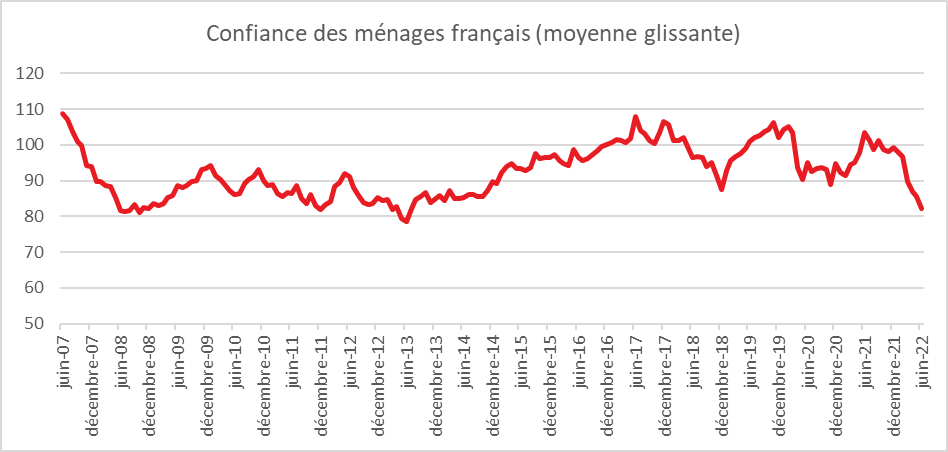
En juin, la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois augmente de nouveau. Le solde correspondant gagne six points et se situe au plus haut depuis l’été 2008. La part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois continue de baisser : le solde diminue de quatre points, demeurant néanmoins bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
Sentiment de baisse du pouvoir d’achat
En juin, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée perd deux points. Le solde relatif à leur situation financière personnelle future baisse aussi, d’un point. Ces deux soldes sont au-dessous de leur moyenne de longue période. Les Français craignent un réel recul de leur pouvoir d’achat dans les prochains mois. En juin, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois diminue. Le solde correspondant perd sept points et reste nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois baisse également. Le solde correspondant perd quatre points et reste lui aussi nettement inférieur à sa moyenne.Dans ce contexte anxiogène, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminue. Le solde correspondant perd cinq points et se situe nettement au-dessous de sa moyenne de longue période.
Capacités d’épargne en recul
En juin, le solde d’opinion concernant la capacité d’épargne future diminue de cinq points. Celui sur la capacité d’épargne actuelle baisse également. Il perd trois points, tout comme celui sur l’opportunité d’épargner. Ces trois soldes demeurent néanmoins au-dessus de leur moyenne de longue période. Cette appréciation ne se traduit pas encore dans les faits. Les ménages continue à verser de l’argent sur leurs Livrets A.
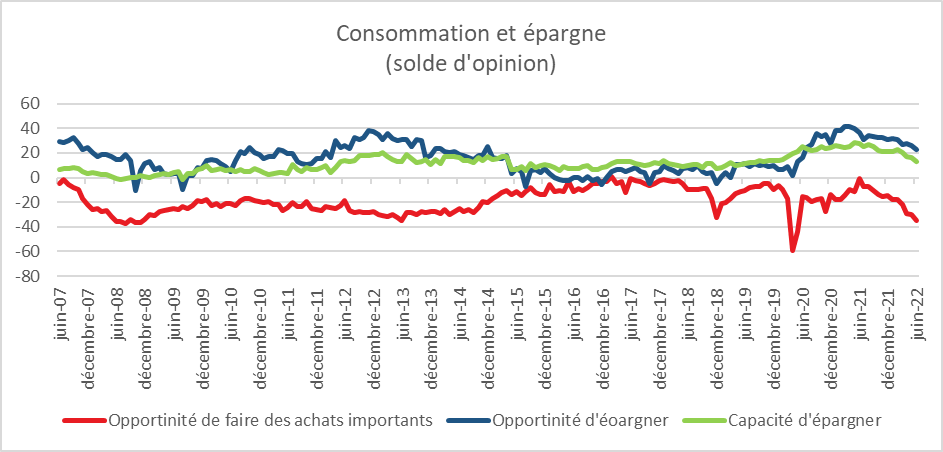
Chômage, retour des craintes
En juin, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage rebondissent légèrement. Le solde correspondant augmente de trois points mais demeure à un niveau très bas.
Le Coin des Epargnants du 24 juin 2022 : laisser le temps au temps
L’INSEE optimiste malgré tout
Selon la note de conjoncture de l’INSEE pour le mois de juin, l’inflation devrait se rapprocher des 6 % en juin (5,9 %) pour atteindre 7 % en septembre et se stabiliser autour de ce taux d’ici la fin de l’année. Sur l’ensemble de l’année, l’inflation devrait être de 5,5 %, soit un niveau inconnu depuis 1985. Sans les mesures prises par les pouvoirs publics l’inflation serait supérieure de deux points à son niveau constaté actuellement.
Le taux de croissance devrait être, en 2022, de 2,3 % grâce à l’acquis de 2021. Le PIB qui a diminué de 0,2 % au premier trimestre augmenterait de 0,2 point au deuxième et de 0,3 % au troisième comme au quatrième. L’économie française retrouverait ainsi une croissance proche de celle d’avant la crise du Covid-19. Le marché du travail résisterait : 200.000 emplois seraient créés dans le secteur privé cette année.
Pour l’INSEE, le revenu brut disponible des ménages qui avait diminué au premier trimestre, en lien avec le versement de la prime inflation de 100 euros à la fin de l’année dernière, devrait se redresser sur la seconde moitié de l’année. En 2022, il augmenterait de 4,1 % en euros courants. L’institut statistique estime que l’augmentation des prix ne se transmet pas intégralement aux salaires, limitant les risques de spirale inflationniste. L’augmentation des prix provoquerait une baisse du pouvoir d’achat des ménages d’un point, ce qui constituerait une première depuis 2013, année durant laquelle il avait diminué de 1,8 %.
Les ménages les plus touchés par la hausse des prix sont ceux constitués de retraités et ceux vivant en milieu rural.
La consommation des ménages, qui s’est contractée au cours du premier trimestre, pourrait enregistrer un rebond de 0,4 % au deuxième trimestre suivi d’une hausse de 0,2 % au cours des deux suivants. L’INSEE estime que le taux des ménages restera supérieur à son niveau d’avant-crise sanitaire (16,3 % contre 15 % du revenu disponible brut).
Lors du premier trimestre, l’économie française a créé 80 000 emplois malgré le recul du PIB. Pour le deuxième trimestre, l’INSEE prévoit la création de 37 000 emplois, puis 44 000 au troisième et 41 000 au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, l’emploi salarié augmenterait donc de 200 000, retrouvant son rythme de progression d’avant la crise sanitaire. 60 000 emplois non-salariés seront également créés portant le total à 260 000. Fin 2022, la France devrait compter un million d’emplois de plus qu’en 2019. L’INSEE table sur un taux de chômage de 7 % à la fin de l’année.
Rebond boursier en trompe l’œil ?
Après trois semaines de repli, le CAC 40 a enregistré une hausse cette semaine et en a profité pour repasser au-dessus des 6000 points. Le Dow Jones a, de son côté, gagné plus de 5 % et le Nasdaq plus de 7 %. Ce rebond est avant tout lié à un effet d’opportunité, les investisseurs ayant acheté des valeurs qui avaient fortement baissé, en particulier celles du secteur du luxe et celles de la « tech ». Le climat n’en demeure pas moins lourd. Les indicateurs restent mal orientés avec la poursuite de la hausse des prix en zone euro. Les indices PMI publiés de part et d’autre de l’Atlantique ont souligné un ralentissement de la croissance dans le secteur privé et une contraction des commandes pour la première fois en deux ans. L’indice allemand Ifo de juin traduit une dégradation du climat des affaires. L’économie allemande est fortement exposée à l’arrêt des exportations russes de gaz. Aux Etats-Unis, l’indice de l’Université du Michigan sur le moral des consommateurs est tombé au plus-bas historique en juin. En revanche, les attentes d’inflation sur 12 mois reculeraient à 5,3 % selon l’étude de cette université américaine. Il n’en demeure pas moins qu’Outre Atlantique, le mot « récession » est de moins en moins un tabou. La crainte d’une récession a pesé sur les cours des matières premières et a provoqué la baisse du rendement des emprunts d’Etat. Le taux d’intérêt de l’OAT à dix ans est repassé en-dessous de 2 % quand il avait dépassé 2,3 % en début de semaine. L’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale n’a pas eu d’effets notables sur le cours des actions françaises, les entreprises du CAC40 opérant à l’échelle mondiale. Si l’écart de taux avec l’Allemagne s’est accru les jours suivants l’élection, il est revenu à 0,5 point, son niveau traditionnel depuis plusieurs semaines. La baisse des taux sur fond de ralentissement de la croissance a profité par ricochet aux actions, une moindre activité pouvant conduire les banques centrales à temporiser leur politique de relèvement de leurs taux directeurs.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 24 juin 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 073,35 | +3,24 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 500,68 | +5,39 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 607,62 | +7,49 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 118,13 | -0,06 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 208,81 | +2,74 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 533,17 | +2,75 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 26 491,97 | +2,04 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 349,75 | +1,13 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,964 % | -0,247 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,438 % | -0,227 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +3,126 % | -0,103 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0545 | +0,50 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 826,871 | -0,52 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 112,020 | -0,79 % | 78,140 |
Les rachats d’actions sont-ils anti-économiques ?
Depuis plusieurs années, les entreprises cotées pratiquent le rachat d’actions afin de soutenir leur cours. Cette politique donne lieu à d’importantes critiques. Elle nuirait aux intérêts des salariés et freinerait l’investissement. Elle favoriserait à court terme les actionnaires tout en privant les entreprises de capitaux pour préparer l’avenir.
L’augmentation des résultats des entreprises cotées les a incitées à effectuer des nombreux rachats d’actions afin d’améliorer la rémunération des actionnaires. En 2021, les rachats ont porté sur 166,52 milliards d’euros aux États-Unis quand ce montant a atteint 44,36 milliards d’euros pour la zone euro.
Les rachats d’actions sont réalisés essentiellement en utilisant les bénéfices de l’entreprises. Ils s’effectuent donc au détriment des salariés. Depuis la crise des subprimes, les entreprises recourent de moins en moins à l’endettement pour financer leur plan de rachats d’actions. Cette pratique a été facilitée par l’augmentation des profits. Après impôts et intérêts mais avant dividendes, leur poids au sein du PIB est passé, au sein de l’OCDE, de 12 à 18 % de 1995 à 2021. Sur cette même période, la productivité par tête s’est accrue de 40 %, contre 20 % pour les salaires réels par tête.
Pour certains, les rachats d’actions sont accusés de réduire les capacités d’investissement. Pour d’autres, cet argument peut être relativisé. Si une entreprise juge ne pas avoir de projets d’investissement rentable, il vaut mieux qu’elle rende l’argent aux actionnaires afin que ces derniers puissent effectuer une réallocation des capitaux plus efficace. Ce choix permet ainsi de réorienter le capital vers des investissements à plus forte rentabilité et d’éviter son gaspillage. Lors de ces vingt-cinq dernières années, l’investissement global est néanmoins en recul, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, semblant donner raison aux adversaires des rachats d’autant plus que les gains de productivité ont tendance à baisser.
Les procédures de rachat ont, en revanche, favorisé l’augmentation des cours des actions. De 1995 à mars 2022, l’indice Nasdaq a été multiplié par 15, celui de Standard and Poors par 9 et celui de l’Eurostoxx par 4. Les États-Unis qui ont pratiqué les rachats avec gourmandise ont enregistré les augmentations de cours les plus importantes.
Les rachats d’actions ont a priori pénalisé l’investissement et joué, contre les augmentations de salaires, les entreprises privilégiant les actionnaires aux salariés, surtout aux États-Unis. Compte tenu des besoins d’investissement notamment en lien avec la transition énergétique, un ralentissement de cette pratique serait souhaitable.
Livret A : Toujours au sommet malgré une érosion de la collecte en mai
Pas de déstockage de l’épargne covid malgré l’inflation
Si les ménages ont moins placé sur leurs Livret A en mai que les mois précédents, ils n’ont pas puisé dans leur épargne de précaution qui se situe toujours à des niveaux historiquement élevés et cela malgré l’inflation qui érode leur pouvoir d’achat. Le rendement réel négatif du Livret A n’a pas, pour le moment, d’effet réel sur la collecte.
Au mois de mai 2022, la collecte du Livret A s’est élevée à 1,37 milliard d’euros en retrait par rapport aux collectes des mois précédents. Elle avait atteint 1,87 milliard d’euros au mois d’avril 2022 et 3,02 milliards d’euros au mois de mars 2022. La collecte de cette année est également inférieure à celle du mois de mai 2021, 1,82 milliard d’euros mais assez proche de celle de 2019 avant la crise sanitaire (1,22 milliards d’euros).
La collecte du mois de mai 2022 traduit un retour à la normale après plusieurs mois exceptionnels marqués par le relèvement du taux intervenu le 1er février dernier et par la crise ukrainienne. Le cru 2022 se situe néanmoins légèrement au-dessus de la moyenne décennale. Lors de ces dix dernières années, le montant moyen de la collecte en mai est, en effet, d’un milliard d’euros (2012/2021). Lors de ces dix dernières années, le Livret A a connu deux décollectes en mai, en 2014 et en 2015, années qui se caractérisaient par une baisse du taux de rendement.
Depuis le début de l’année 2022, la collecte a été de 15,45 milliards d’euros, soit légèrement moins que pour la période de 2021, 16,74 milliards d’euros. Elle demeure néanmoins supérieure à celle de l’année 2020 (11,06 milliards d’euros de janvier à mai 2021). Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire, la collecte du mois de mai a été positive de 160 millions d’euros la portant sur les cinq premiers mois de l’année à 2,32 milliards d’euros. La collecte se réduit plus nettement pour le LDDS qui est plus en lien avec les comptes courants. Elle demeure néanmoins positive.
Retour à la normale en pleine période de hausse des prix
Si un retour à la normale est constatée, les ménages restent, malgré tout, en mode épargne. Ils ne puisent pas dans leur Livret A pour faire face à la hausse des prix. Cette appréciation est une moyenne. Les ménages les plus modestes sont contraints de réduire leur effort d’épargne quand ceux plus aisés continuent de mettre de l’argent de côté.
A la différence des consommateurs américains, les Français réduisent leur consommation en maintenant leur stock d’épargne dont celui constitué depuis le début de la crise sanitaire.
Dans ce contexte, l’encours du Livret A bat record sur record et atteint désormais 358,8 milliards d’euros, contre 298,6 milliards d’euros en décembre 2019. L’encours a ainsi progressé de 20 %. Sur la même période, l’encours du Livret de Développement Durable et Solidaire est passé de 112,4 à 128,6 milliards d’euros.
La sécurité, la liquidité avant le rendement
Avec un inflation en forte hausse, le rendement réel du Livret A est négatif de plus de quatre points. Il faut remonter aux années 1980 pour trouver un tel écart entre le taux d’inflation et le taux de rendement du Livret A (en 1980, inflation à 13,60 % et taux du Livret A à 7,25%). Le rendement réel négatif ne dissuade pas les ménages d’y placer leurs économies. La sécurité et la liquidité priment toujours sur le rendement. Cette priorité donnée aux deux premières valeurs est, en période de crise, traditionnelle.
Les équations difficiles de la revalorisation du taux
Le gouverneur de la Banque de France a confirmé le 22 juin, qu’il préconiserait une augmentation du taux du Livret A pour le 1er août prochain. Il formulera sa préconisation après la communication, à la mi-juillet, du taux d’inflation du mois de juin. Avec un taux d’inflation moyen sur six mois qui devrait avoisiner 5 % et avec des taux monétaires autour de -0,5 %, le taux du Livret A devrait, selon la formule en vigueur, se situer entre 2 et 2,2 %.
Le surcoût généré par ce potentiel relèvement, pour les banques et la Caisse des Dépôts, en charge d’une centralisation d’une grande parte de la collecte, serait d’au moins 3,5 milliards d’euros, en rythme annuel, pour le seul Livret A. Compte tenu du niveau des taux monétaires et des taux des emprunts, la rentabilité de la collecte du Livret A devrait être nulle voire négative. La hausse du taux du Livret A devrait également se traduire par celle des taux d’emprunt pour les bailleurs sociaux, les PME et les collectivités locales qui se financent en partie à partir de ce placement.
L’augmentation du taux du Livret A, le 1er août prochain, devrait avoir comme conséquences une augmentation de la collecte comme cela a été constaté entre janvier et mars de cette année. Le maintien d’un fort taux d’épargne de précaution pénalise la consommation qui est déjà touchée par l’inflation. Le gouvernement qui entend éviter la récession ne souhaite certainement pas encourager ce type d’épargne. Pour cette raison, il ne devrait pas aller au-delà du taux résultant de la formule. Le taux du Livret d’Epargne Populaire qui suit logiquement l’inflation devrait être relevé à 4 voire 5 %.
La hausse des taux de l’épargne réglementée du 1er août devrait retarder la traditionnelle baisse de la décollecte qui intervient au second semestre marqué par les dépenses de rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année.
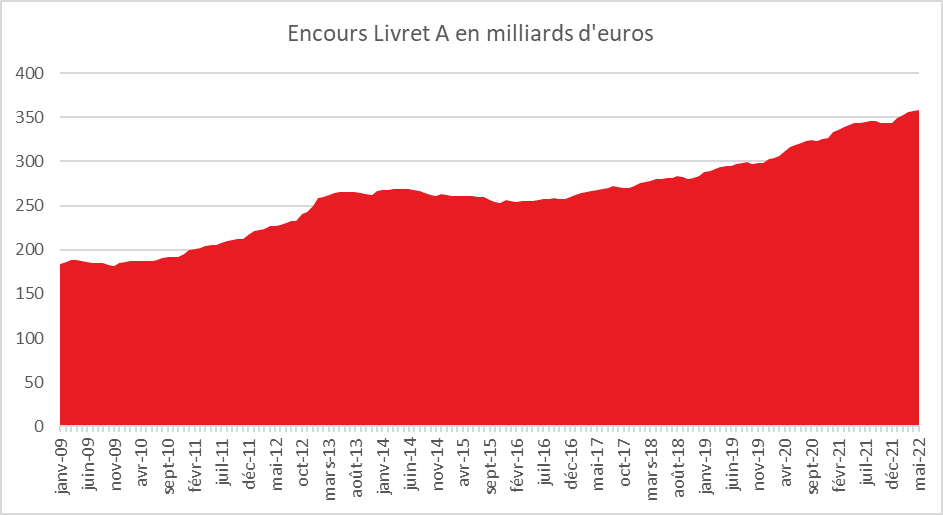
Résultats du Livret A du mois de mai 2022 : érosion de la collecte avec un encours au sommet
Pas de déstockage de l’épargne covid malgré l’inflation
Si les ménages ont moins placé sur leurs Livret A en mai que les mois précédents, ils n’ont pas puisé dans leur épargne de précaution qui se situe toujours à des niveaux historiquement élevés et cela malgré l’inflation qui érode leur pouvoir d’achat. Le rendement réel négatif du Livret A n’a pas, pour le moment, d’effet réel sur la collecte.
Au mois de mai 2022, la collecte du Livret A s’est élevée à 1,37 milliard d’euros en retrait par rapport aux collectes des mois précédents. Elle avait atteint 1,87 milliard d’euros au mois d’avril 2022 et 3,02 milliards d’euros au mois de mars 2022. La collecte de cette année est également inférieure à celle du mois de mai 2021, 1,82 milliard d’euros mais assez proche de celle de 2019 avant la crise sanitaire (1,22 milliards d’euros).
La collecte du mois de mai 2022 traduit un retour à la normale après plusieurs mois exceptionnels marqués par le relèvement du taux intervenu le 1er février dernier et par la crise ukrainienne. Le cru 2022 se situe néanmoins légèrement au-dessus de la moyenne décennale. Lors de ces dix dernières années, le montant moyen de la collecte en mai est, en effet, d’un milliard d’euros (2012/2021). Lors de ces dix dernières années, le Livret A a connu deux décollectes en mai, en 2014 et en 2015, années qui se caractérisaient par une baisse du taux de rendement.
Depuis le début de l’année 2022, la collecte a été de 15,45 milliards d’euros, soit légèrement moins que pour la période de 2021, 16,74 milliards d’euros. Elle demeure néanmoins supérieure à celle de l’année 2020 (11,06 milliards d’euros de janvier à mai 2021). Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire, la collecte du mois de mai a été positive de 160 millions d’euros la portant sur les cinq premiers mois de l’année à 2,32 milliards d’euros. La collecte se réduit plus nettement pour le LDDS qui est plus en lien avec les comptes courants. Elle demeure néanmoins positive.
Retour à la normale en pleine période de hausse des prix
Si un retour à la normale est constatée, les ménages restent, malgré tout, en mode épargne. Ils ne puisent pas dans leur Livret A pour faire face à la hausse des prix. Cette appréciation est une moyenne. Les ménages les plus modestes sont contraints de réduire leur effort d’épargne quand ceux plus aisés continuent de mettre de l’argent de côté.
A la différence des consommateurs américains, les Français réduisent leur consommation en maintenant leur stock d’épargne dont celui constitué depuis le début de la crise sanitaire.
Dans ce contexte, l’encours du Livret A bat record sur record et atteint désormais 358,8 milliards d’euros, contre 298,6 milliards d’euros en décembre 2019. L’encours a ainsi progressé de 20 %. Sur la même période, l’encours du Livret de Développement Durable et Solidaire est passé de 112,4 à 128,6 milliards d’euros.
La sécurité, la liquidité avant le rendement
Avec un inflation en forte hausse, le rendement réel du Livret A est négatif de plus de quatre points. Il faut remonter aux années 1980 pour trouver un tel écart entre le taux d’inflation et le taux de rendement du Livret A (en 1980, inflation à 13,60 % et taux du Livret A à 7,25%). Le rendement réel négatif ne dissuade pas les ménages d’y placer leurs économies. La sécurité et la liquidité priment toujours sur le rendement. Cette priorité donnée aux deux premières valeurs est, en période de crise, traditionnelle.
Les équations difficiles de la revalorisation du taux
Le gouverneur de la Banque de France a confirmé le 22 juin, qu’il préconiserait une augmentation du taux du Livret A pour le 1er août prochain. Il formulera sa préconisation après la communication, à la mi-juillet, du taux d’inflation du mois de juin. Avec un taux d’inflation moyen sur six mois qui devrait avoisiner 5 % et avec des taux monétaires autour de -0,5 %, le taux du Livret A devrait, selon la formule en vigueur, se situer entre 2 et 2,2 %.
Le surcoût généré par ce potentiel relèvement, pour les banques et la Caisse des Dépôts, en charge d’une centralisation d’une grande parte de la collecte, serait d’au moins 3,5 milliards d’euros pour le seul Livret A. Compte tenu du niveau des taux monétaires et des taux des emprunts, la rentabilité de la collecte du Livret A devrait être nulle voire négative. La hausse du taux du Livret A devrait également se traduire par celle des taux d’emprunt pour les bailleurs sociaux, les PME et les collectivités locales qui se financent en partie à partir de ce placement.
L’augmentation du taux du Livret A, le 1er août prochain, devrait avoir comme conséquences une augmentation de la collecte comme cela a été constaté entre janvier et mars de cette année. Le maintien d’un fort taux d’épargne de précaution pénalise la consommation qui est déjà touchée par l’inflation. Le gouvernement qui entend éviter la récession ne souhaite certainement pas encourager ce type d’épargne. Pour cette raison, il ne devrait pas aller au-delà du taux résultant de la formule. Le taux du Livret d’Epargne Populaire qui suit logiquement l’inflation devrait être relevé à 4 voire 5 %. La hausse des taux de l’épargne réglementée du 1er août devrait retarder la traditionnelle baisse de la décollecte qui intervient au second semestre marqué par les dépenses de rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année.
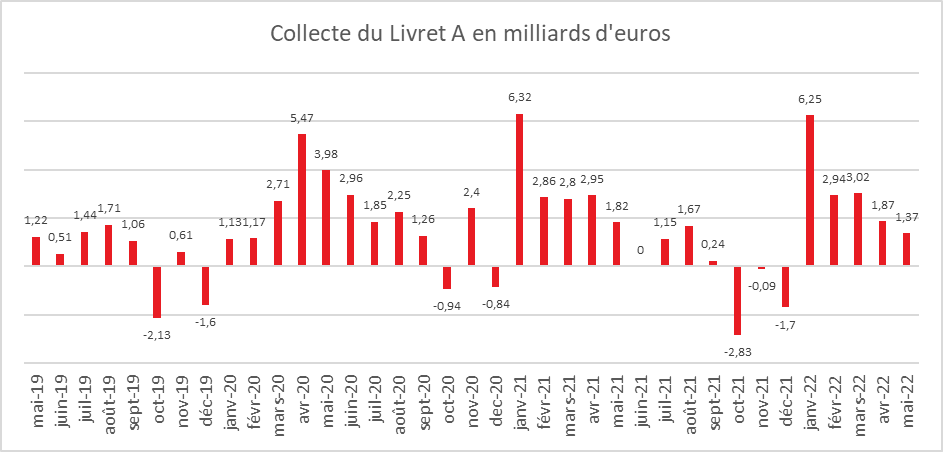
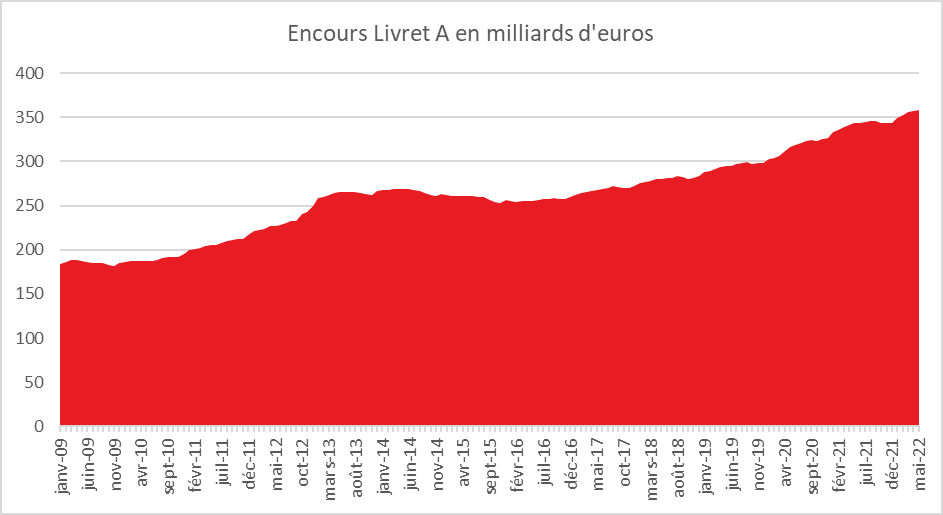
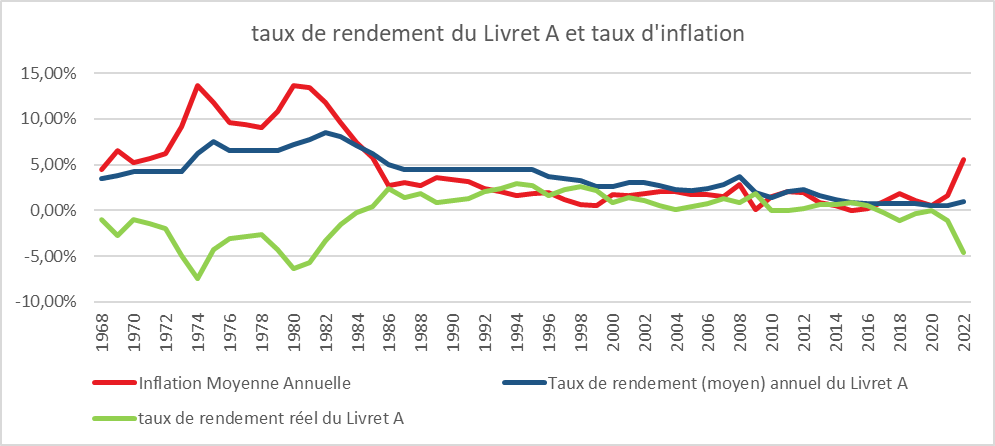
Le Coin des Epargnants du 18 juin 2022 : le retour du risque souverain ?
Les marchés, une affaire de taux et de banques centrales
La semaine a laissé des traces. Les tensions sur les taux en lien avec l’incrustation de l’inflation ont provoqué un repli massif des cours. L’indice japonais Nikkei a perdu plus de six points. Le CAC 40 a abandonné près de 5 % portant le total depuis le début de l’année à près de 18 %. Les indices américains ont subi une deuxième semaine de fort recul. Le Dow Jones a baissé de près de 5 % tout comme le Nasdaq. Ce dernier indice a perdu près du tiers de sa valeur depuis le 1er janvier. Les investisseurs anticipent un série de hausses des taux directeurs de la part des banques centrales et réallouent une partie des actifs qui avaient été placés sur les actions. Par ailleurs, ce mouvement est amplifié par la crainte de la survenue d’une récession en lien avec l’augmentation des taux. Le différentiel de taux entre les Etats-Unis et l’Europe joue toujours contre les euros et les places boursières du Vieux continent. Seul l’indice chinois « Shangaï Composite » est ressorti en légère hausse cette semaine.
Les taux d’intérêt ont fortement augmenté en début de semaine avant de se détendre avec les annonces de la BCE face à la menace de la fragmentation financière de la zone euro et le retour du risque souverain sur le devant de la scène.
Le taux de l’OAT à 10 ans après avoir atteint 2,3 % au milieu de la semaine s’est replié vendredi à 2,2 %. Les écarts de taux (spreads) qui s’étaient accrus avec le taux allemand tant pour ceux de la France que de l’Italie se sont resserrés. Le taux de l’obligation de l’Etat italien qui avait dépassé 4 % mardi s’élevait en vendredi, en fin de journée à 3,672 %. Après la décision de la FED de relever ses taux directeurs de 0,75 point, les taux américains se sont légèrement appréciés, la hausse ayant été anticipée.
La Fed donne la priorité à la lutte contre l’inflation
Mercredi 15 juin, la Réserve fédérale américaine a décidé de remonter ses taux d’intérêt de 0,75 point à l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire. Une telle augmentation n’avait plus été pratiquée depuis 1994. Les taux de la Fed se situent désormais entre 1,5 et 1,75 %. Cette décision témoigne de la volonté de la Banque centrale de lutter plus fortement contre l’inflation. Le processus de remontée des taux devrait se poursuivre dans les prochains mois. La médiane des prévisions des membres du comité de politique monétaire de la Fed donne un taux directeur moyen à 3,4 % en fin d’année et à 3,8 % en 2023 quand les prévisions de mars le plaçaient à 1,9 % en décembre de cette année. Cette révision est en lien avec l’évolution de l’inflation. La hausse des prix a atteint 8,6 % en rythme annuel en mai quand, il y a un an, les économistes de la Fed prévoyaient une inflation de 2,1 % à la fin de cette année. Les dernières prévisions tablent sur une inflation sur l’année de 5,2 %. Le retour à un taux de 2 % n’est pas prévu avant 2025. Le taux d’inflation devrait être de 2,6 % en 2023 et de 2,2 % en 2024.
Pour la Fed, le taux de chômage pourrait augmenter avec la hausse des taux pour s’établir à 3,7 % d’ici à la fin de l’année, et 3,9 % fin 2023, contre 3,6 % en mai. Le taux de croissance serait de 1,7 % en 2022, les projections de mars derniers prévoyaient un taux de 2,8 %. La Fed ne retient pas pour le moment le scénario d’une récession aux États-Unis dans les prochains mois.
La BCE face à l’inflation et à la solvabilité des États du Sud de l’Europe
Mercredi 15 juin, le Conseil des gouverneurs de la BCE a été réuni en urgence pour trouver des réponses à la montée rapide des taux et des écarts de taux entre les États membres. Mardi 14 juin, le rendement de la dette italienne à 10 ans avait dépassé 4 % pour la première fois depuis 2014. Son écart avec le taux à 10 ans allemand avait atteint 240 points de base, ravivant la crainte d’une nouvelle crise des dettes publiques. En jouant les taux à la hausse, les investisseurs doutent de la capacité de la BCE à répondre à l’inflation. Ils testent également la détermination de la banque centrale à soutenir les États les plus endettés.
La Banque centrale européenne doit faire face à des défis majeurs. Elle doit tenter de maîtriser l’inflation au sein de la zone euro tout en ne provoquant pas une récession ni des problèmes de solvabilité pour les États le plus endettés. Sa tâche est d’autant plus compliquée que le taux d’inflation au sein de la zone varie du simple au double et que les niveaux d’endettement diffèrent également.
Les responsables de la banque centrale craignent une fragmentation de la zone euro avec à la clef une augmentation des taux pour les États d’Europe du Sud qui pourraient les mettre en difficulté.
Lors de sa réunion de mercredi 16 juin, la BCE a confirmé que les tombées des obligations d’État qu’elle a acquises ces dernières années, seront réinvesties sous forme de rachats de nouvelles obligations d’États en privilégiant ceux qui ont des problèmes de financement. Les rachats jusqu’à maintenant s’effectuaient, sauf dans le cadre du plan de relance, en fonction du PIB. La BCE a également annoncé la création d’un dispositif spécifique de lutte contre la fragmentation. Les modalités précises de ce dispositif n’ont pas été encore communiquées. Les équipes de l’Eurosystème (qui rassemble la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro) travaillent sur le sujet afin que le dispositif soit prêt pour le prochain Conseil des gouverneurs des 21 et 22 juillet. A priori, il serait prévu que la BCE puisse acheter des obligations souveraines italiennes en vendant en parallèle des titres allemands ou néerlandais pour un montant similaire. Ce mécanisme permettrait de soutenir un Etat en difficulté sans pour autant accroître le bilan de la banque centrale. Cette solution éviterait le réenclenchement d’un programme d’achat d’actifs et permettrait de lutter contre l’accroissement des écarts de taux. En revanche, elle pourrait soulever un problème d’ordre juridique. La BCE a fixé la part de chaque Etat dans ses achats en fonction de sa participation au capital de la banque centrale, qui correspond à son poids au sein de l’économie de la zone euro. Cette condition a toujours été considérée intangible par les Allemands et a été validée par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Pour se conforter à cette règle, la BCE serait condamnée, à terme, à revendre ses titres italiens et à racheter de la dette allemande. Ces opérations sont des sources d’incertitudes pour les investisseurs et pourraient donc amoindrir l’efficacité du dispositif anti-fragmentation. Les Allemands et les Néerlandais pourraient imposer que les Etats endettés s’engagent dans des plans d’assainissement et de réformes, ce qui pourrait alimenter des tensions au sein des Etats membres et au sein des populations concernées.
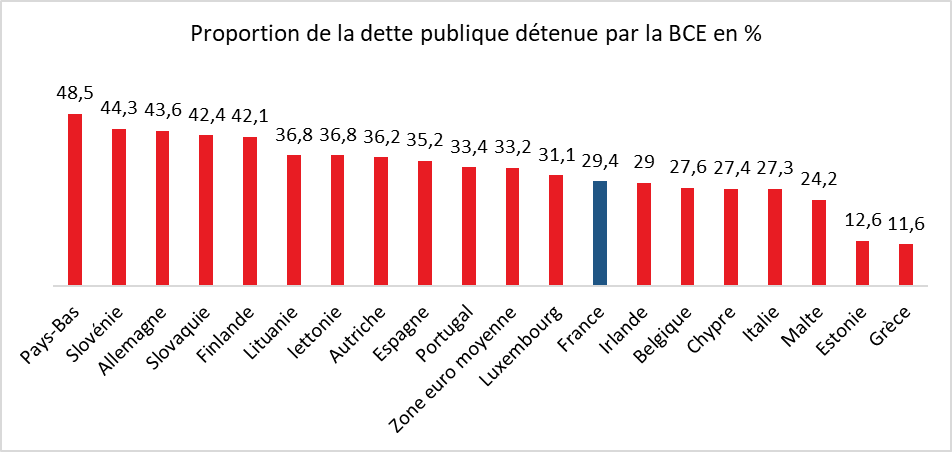
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 17 juin 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 5 882,65 | -4,92 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 29 888,78 | -4,79 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 10 798,35 | -4,78 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 126,26 | -4,62 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 016,25 | -4,12 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 438,46 | -4,47 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 25 963,00 | -6,69 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 316,79 | +0,97 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +2,201 % | +0,111 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,665 % | +0,151 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +3,229 % | +0,072 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0493 | -0 ?25 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 836,510 | -1,95 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 112,910 | -7,32 % | 78,140 |
Pétrole, les réserves mises à contribution
Avec la réduction des achats européens à la Russie et le début de la campagne de reconstitution des stocks, les craintes d’une augmentation du cours du baril s’amplifient. Pour contrecarrer ce mouvement, le département américain de l’énergie a annoncé mardi 14 juin qu’il mettait sur le marché jusqu’à 45 millions de barils de pétrole issus de la réserve stratégique de pétrole. Les livraisons de brut devraient avoir lieu du 16 août au 30 septembre. L’administration Biden avait déjà annoncé, fin mars, qu’elle libérerait pendant six mois un volume d’un million de barils de pétrole par jour.
La libération du pétrole décidée par Washington conduit le niveau de la réserve stratégique à son point le plus bas depuis 1987. Cette situation inquiète le marché car les États-Unis seraient exposés en cas d’accident d’approvisionnement majeur. Même si le niveau de réserves demeure supérieur au minimum légal, leur baisse provoque par ricochet des tensions sur les cours. Malgré tout, sur la semaine, le pétrole a chuté de 7 % et est revenu autour de 110 dollars. Cette baisse est en partie imputable à la crainte de la récession qui ferait baisser la demande dans les prochains mois.
Le Coin des Epargnants du 10 juin 2022 : l’inflation dicte sa loi
L’inflation dicte sa loi
Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 1 % sur le seul mois de mai et de 8,6 % sur un an, contre respectivement 0,7% et 8,3% anticipés par le consensus formé par Bloomberg. Hors alimentation et énergie, la hausse des prix a atteint 0,6 % sur un mois et 6 % sur un an (0,5 % et 5,9 % estimés).
L’annonce des résultats de l’inflation aux Etats-Unis a fait chuter les indices « actions ». Le CAC 40 a subi un repli sur la semaine de 4,60 %, le Daxx Allemand a perdu de son côté plus de 4,8 %, le Dow Jones 4,6 % et le Nasdaq 5,6 %. Depuis le début de l’année, ce dernier indice a reculé de plus de 27 %. La hausse des prix qui demeure vive conforte les banques centrales dans leur volonté de durcissement de leur politique monétaire. La Fed pourrait être amenée à prolonger sa série de resserrements de 50 points de base durant l’automne. Une augmentation de 0,75 point est même envisagée désormais. Avec, par ailleurs, les déclarations de la BCE sur le futur durcissement de sa politique monétaire, les taux d’intérêt ont augmenté sensiblement sur la semaine. Le taux de l’OAT à dix ans de la France est passé au-dessus de 2 % tout comme celui de son homologue américain. La hausse des taux en Europe s’accompagne d’un accroissement des spreads entre l’Allemagne et les pays d’Europe périphérique, France comprise. L’écart du taux à 10 ans entre l’Allemagne et la France est de 0,5 point de pourcentage. Celui de l’Allemagne avec l’Italie est de 2,3 points de pourcentage.
Les indices américains ont également perdu du terrain en raison du pessimisme qui gagne les consommateurs. Le moral des ménages américains est lui aussi à des plus bas depuis plus de 40 ans. Selon les premières données pour le mois de juin, l’indice de confiance du consommateur, tel que calculé par l’Université du Michigan, a chuté à 50,2 points, contre 58,4 en mai et 58 attendus par le consensus.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 10 juin 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 187,23 | -4,60 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 392,79 | -4,58 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 340,02 | -5,60 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 761,83 | -4,83 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 317,52 | -2,86 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 599,20 | -4,88 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27 824,29 | +0,23 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 284,83 | +0,08 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +2,090 % | +0,312 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,514 % | +0,254 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +3,157 % | +0,216 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0522 | -1,86 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 869,740 | +1,04 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 121,120 | +0,66 % | 78,140 |
Durcissement de la politique monétaire de la BCE, quelles conséquences ?
La Banque Centrale Européenne figurait parmi les dernières grandes banques centrales à ne pas avoir mis un terme à la politique ultra-accommodante qui est en vigueur depuis 2015. Cette politique reposait à la fois sur des importants rachats d’obligations essentiellement publiques et sur des taux historiquement bas. Elle avait été instituée afin de lutter contre les menaces de déflation en cours après la crise des subprimes et la crise des dettes souveraines. Dès le début de l’épidémie, elle avait été amplifiée afin de faciliter le financement des mesures de soutien de la part des États.
À nouveau contexte, nouvelle politique ?
Jeudi 9 juin, à l’occasion d’un Conseil des gouverneurs, la BCE a annoncé la fin du programme d’achats d’actifs (APP) ainsi qu’une première hausse de ses taux directeurs le 1er juillet prochain. Les taux directeurs de la BCE qui sont actuellement de -0,5 % pour le taux de dépôt, 0 % pour le taux de refinancement et 0,25 % pour la facilité de prêt marginal seront relevés de 25 points de base.
Ces annonces interviennent dans un contexte de résurgence de l’inflation qui a atteint au sein de la zone euro, au mois de mai, 8,1 %. Un tel taux n’avait jamais été rencontré depuis la création de la zone euro. Il faut remonter aux années 1980 pour retrouver une inflation aussi élevée en Europe. Si en France, l’inflation s’est élevée à 5,8 % en mai, elle a dépassé 20 % en Estonie. Ces taux sont éloignés de l’objectif retenu par la banque centrale qui est de 2 %.
La Banque centrale européenne a temporisé au maximum son annonce de changement de cap monétaire. Considérant que l’inflation était essentiellement importée, elle ne voulait pas, en augmentant rapidement les taux, casser la croissance déjà mise à mal par les pertes de pouvoir d’achat des ménages. Elle a longtemps espéré une désescalade des prix. Face à une inflation qui s’installe et qui augmente, elle s’est résignée à s’engager dans une politique de durcissement de sa politique monétaire.
Un resserrement tout relatif
Compte tenu du niveau d’inflation atteint, la réponse de la Banque centrale européenne est graduée, mesurée. Avec une inflation, autour de 8 % et qui dépasse 10 % au sein de nombreux États de la zone euro, les taux directeurs devraient être plus proches de 5 ou 6 %, voire plus, que de 0 %. Ils devraient avoisiner le taux d’inflation sous-jacente. La Banque centrale tout en affirmant qu’elle entend maîtriser la hausse des prix demeure prudente. Ses marges de manœuvre sont limitées par les risques que cette hausse sur les dettes souveraines des pays dits périphériques. Elle pourrait entraîner des écarts de taux croissants mettant ainsi en difficulté les États fortement endettés (Italie, Espagne, Portugal, Grèce, voire France).
Quelles conséquences pour l’économie, les ménages, les emprunteurs et les épargnants ?
Une hausse de taux a pour objectif de freiner l’inflation. Cela passe par un refroidissement de l’économie en limitant la croissance de la consommation et de l’investissement. Une telle politique peut être jugée contre-intuitive au moment même où l’économie souffre des pertes de pouvoir d’achat des ménages. Or, pour stabiliser le pouvoir d’achat des ménages, il faut empêcher l’enclenchement de spirales inflationnistes qui dégénèrent, en règle générale, en stagflation. La hausse des taux directeurs « c’est un mal pour un bien. ».
La hausse des taux devrait freiner la hausse du dollar qui avait gagné plus de 12 % en un an sur l’euro. La dépréciation de l’euro en renchérissant le prix des importations libellées en dollars était également une source d’inflation importée. Compte tenu de la politique de hausse des taux prévue par la banque centrale américaine, une appréciation de l’euro n’est pas attendue.
Les taux d’emprunt qui avaient atteint des niveaux historiquement bas en 2021 devraient poursuivre la hausse entamée depuis le début de l’année. Pour les emprunts immobiliers, d’ici la fin de l’année, une hausse d’au moins un point est envisageable. Il convient de souligner que les taux d’intérêts réels demeurent fortement négatifs. Les emprunteurs dont les revenus sont indexés sur l’inflation sont dans ces conditions encore gagnants.
L’État qui, cette année, devrait emprunter plus de 300 milliards d’euros est le premier concerné par l’augmentation des taux. Le taux de l’Obligation Assimilable du Trésor est passé de 0,2 à 2 % de fin décembre 2021 au 9 juin 2022. Sur trois ans, une augmentation d’un point équivaut à un surcroît de dépenses pour le service de la dette de 10 milliards d’euros. L’inflation a, en revanche, l’avantage d’éroder la valeur du capital à rembourser. Par ailleurs, certaines recettes de l’État dont notamment la TVA sont indexées sur l’inflation.
Pour les épargnants, la hausse des taux présage une meilleure rémunération de l’épargne investie en obligations, sur les livrets ou sur les fonds euros. Pour le moment, le rendement réel de ces placements est négatif de plus de quatre points, ce qui constitue un record depuis le début des années 1980. La hausse décidée par la Banque centrale européenne ne compensera qu’une partie de la perte liée à l’inflation. les fonds euros dont le rendement est à la baisse depuis plusieurs années ne devraient pas augmenter dans l’immédiat en raison d’un important phénomène d’inertie. Au niveau des actions, la hausse des taux devrait peser sur le cours des actions comme cela est constatée depuis le début de l’année. En revanche, les actions, à travers leurs dividendes, restent le meilleur rempart face à l’inflation.
L’évolution des taux d’intérêt dépendra du calendrier de la Banque centrale européenne. Après l’augmentation du mois de juillet qui devrait être de 25 points de base, une autre hausse étantprévue en septembre. Elle pourrait être de 50 points de base comme le souligne le BCE dabs son communiqué, « si les perspectives d’inflation à moyen terme persistent ou se détériorent, une augmentation plus importante sera nécessaire lors de la réunion de septembre ».
Le Coin des Epargnants du 4 juin 2022
Forte création d’emplois aux Etats-Unis et inflation en hausse en Europe
Cette semaine, les indices « actions » ont reculé sur la grande majorité des places occidentales en lien avec la publication des résultats de l’emploi américain et des taux d’inflation du mois de mai.
Aux Etats-Unis, en mai, 390 000 emplois ont été créés dans le secteur non agricole, d’après les chiffres officiels publiés par le département du Travail, soit davantage que prévu par les économistes (le consensus Bloomberg prévoyait 320 000 embauches, après 436 000 en avril, révisé de 428 000). Ces fortes créations d’emploi s’accompagnant toujours de vives augmentations de salaires conforteront la FED dans son intention d’augmenter ses taux directeurs de 0,50 point à l’occasion de ses prochaines réunions. En anticipation de ces hausses et avec la poursuite de l’accélération de l’inflation en Europe, les taux d’intérêt des obligations d’Etat ont fortement augmenté sur la semaine. Le taux de l’OAT française a ainsi atteint 1,788 %, soit le taux le plus élevé constaté depuis le mois de mai 2014.
Sur le front du pétrole, le baril de Brent est repassé au-dessus des 120 dollars malgré la décision de l’OPEP + d’augmenter leur production de 650 000 barils par jour en juillet, et encore du même montant en août. Ce montant est supérieur à celui de 430 000 par mois qui avait été initialement prévu. Si cette décision était attendue, elle traduit également la poursuite de l’accord qui lien les Etats membres de l’OPEP et la Russie. L’Arabie Saoudite a réussi à concilier à la fois les Etats-Unis et la Russie. Certains experts estiment que le pétrole pourrait se rapprocher de son cours record, autour de 140 dollars le baril au mois de septembre prochain.
.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 3 juin 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6,485.30 | -0,47 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 899,70 | -0,94 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 12 012,73 | -0,98 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 14 460,09 | -0,01 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 532,95 | -0,88 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 783,66 | -0,66 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27 761,57 | +3,66 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 195,46 | +1,89 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,788 % | +0,313 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,260 % | +0,300 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,941 % | +0,210 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0721 | -0,11 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 850,480 | -0,14% | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 120,320 | +1,10 % | 78,140 |
Épargne et inflation
Selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages en France s’est établi à 18,7 % du revenu disponible brut en 2021, contre 21 % en 2020. Le taux d’épargne des ménages reste supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire (15 %).
Au cours du premier trimestre 2022, le taux d’épargne a continué son mouvement de baisse pour représenter 16,7 % du revenu disponible brut. La baisse du pouvoir d’achat pour les ménages les plus modestes les contraint à puiser dans leur épargne.
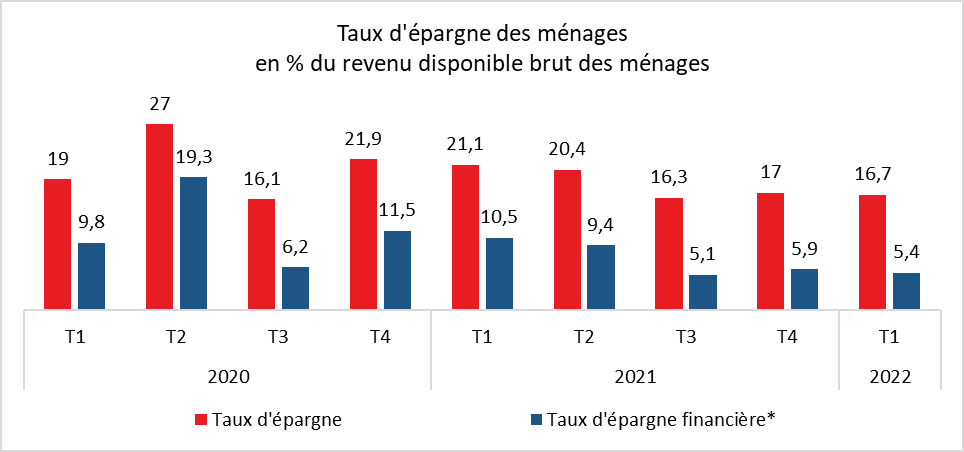
Cercle de l’Épargne – données INSEE
Selon une enquête réalisée par l’IFOP présentée au mois de mai 2022, 72 % des Français épargnent au moins une fois tous les six mois ; les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes tout comme ceux du Centre-Val-de-Loire sont 81 % dans ce cas. C’est le chiffre le plus élevé au niveau national, tandis qu’il tombe à 65 % dans la région PACA et en Corse. Dans le Sud de la France, la priorité est donnée à l’immobilier au détriment de l’assurance vie.
Toujours selon cette enquête, 71 % des Français privilégient les produits sans risque. Les épargnants estiment que l’immobilier est le meilleur placement pour se protéger de l’inflation (46 %). Il devance l’assurance vie (26 %), l’or (19 %) et les actions (9 %). Le mauvais positionnement des actions s’explique sans nul doute par la baisse des cours constatée ces dernier mois. Pour autant, en prenant en compte les dividendes, les actions demeurent le placement qui protège le mieux les épargnants des effets de l’inflation.
Les livrets bancaires fiscalisés toujours en hausse
Malgré une très faible rémunération, en moyenne 0,09 % en avril 2022 selon la Banque de France, l’encours des livrets bancaires fiscalisés continue d’augmenter. Sur les trois premiers mois de l’année, il a progressé de 4 milliards d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire, la progression atteint 54 milliards d’euros. Certains organismes financiers mettent à nouveau en avant des taux promotionnels valables sur de courtes périodes. Or, un taux de 3 % sur un trimestre aboutit, dans les faits à un taux de moins de 1 % sur l’année.
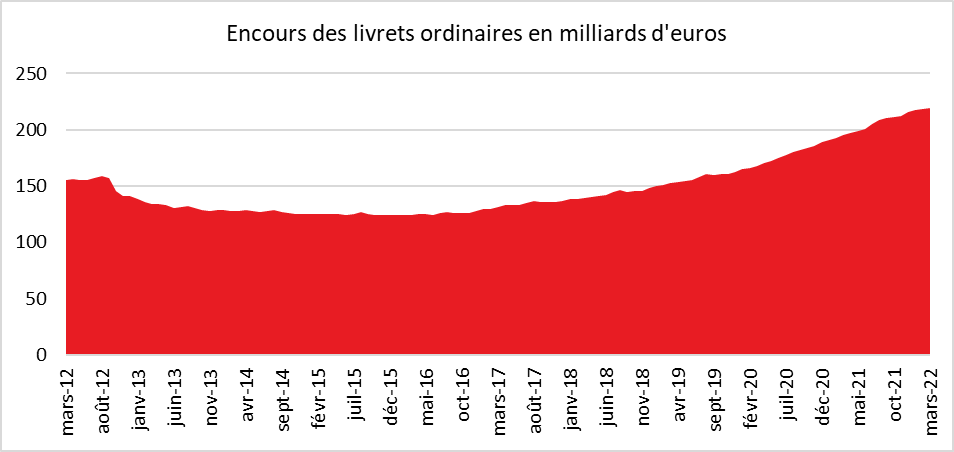
La rémunération des livrets bancaires restent toujours aussi faible
Selon la Banque de France, le taux de rémunération des livrets ordinaires est resté en avril à 0,09% malgré la hausse du taux du Livret A et de l’inflation. Le rendement réel est négatif de plus de 4 points.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)
| avr- 2021 | févr- 2022 | mars- 2022 (e) | avr- 2022 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,44 | 0,51 | 0,50 | 0,50 |
| Ménages | 0,66 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,43 | 0,37 | 0,40 | 0,40 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,93 | 0,78 | 0,73 | 0,72 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| dont : livret A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| – livrets ordinaires | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| – plan d’épargne-logement | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| SNF | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| dont : – dépôts à vue | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,09 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,78 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,54 | -0,53 | -0,50 | -0,45 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,48 | 0,16 | 0,23 | 0,79 |
Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.
b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
c. Moyenne mensuelle.
d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.
e. Données révisées.
f. Données provisoires.
g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés
L’assurance vie surfe entre inflation et baisse des actions
L’assurance vie surfe entre inflation et baisse des cours boursiers
L’assurance vie, premier placement financier des ménages a, depuis la fin de l’année 2020, repris son rythme de croisière avec des collectes nettes, en moyenne, de deux milliards d’euros. Il n’y a pas de rattrapage par rapport à la décollecte enregistrée en 2020 et de réallocation de l’épargne covid liquide. Il y a un retour à la normale portée par une belle collecte brute qui s’accompagne, par ailleurs, d’un niveau élevé de rachats (prestations).
Les assurés acceptent le jeu des unités de compte dont le poids au sein de la collecte avoisine les 40 % et cela malgré la baisse des cours boursiers. Le CAC 40 a ainsi chut de plus de 10 % depuis le début de l’année. Les fonds euros sont, de leur côté, en pénitence. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette diminue en fonds euros qui subissent de plein fouet les affres de l’inflation. Le rendement réel des fonds euros est en territoire négatif (-4 points sur une base annuelle). Les fonds euros pourraient être deux fois moins rémunérés que le Livret A quand le taux de celui-ci sera relevé le 1er août prochain, ce qui constituera une première.
Une collecte nette positive
Au mois d’avril, selon France Assureurs, la collecte nette de l’assurance s’est élevé à à +2,2 milliards d’euros, soit le même montant qu’au mois de mars 2022 et +0,3 milliard d’euros par rapport à avril 2021. Cette collecte nette est la 17e positive consécutive depuis le mois de décembre 2020. .Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à 10,5 milliards d’euros, supérieure de +2,7 milliards d’euros à celle du premier quadrimestre de l’année 2021. Depuis le début de l’année la collecte nette en unités de compte (UC) a atteint +13,9 milliards d’euros ce qui signifie qu’il y a une décollecte nette en fonds euros.
Des cotisations brutes en légère baisse
En avril 2022, cotisations brutes en assurance vie se sont élevées à 12,5 milliards d’euros, en baisse par rapport à celles du mois de mars (14,3 milliards d’euros) et par rapport à celles du mois d’avril 2021 (12,7 milliards d’euros). En avril 2022, elles diminuent sur la partie en euros, de −0,5 milliard d’euros à 7,7 milliards d’euros, et restent stables en unités de compte, à 4,9 milliards d’euros. Les unités de compte ont représenté 39 % de la collecte brute. Depuis le début de l’année, les cotisations en assurance vie s’élèvent à 53,7 milliards d’euros,
Les prestations se sont élevées à 10,3 milliards d’euros en avril en baisse par rapport à mars 2022 (12,1 milliards d’euros). Elles sont aussi en baisse de −0,8 milliard d’euros par rapport à avril 2021. Sur les quatre premiers mois de l’année, 43,2 milliards d’euros ont été versés depuis le début de l’année, en baisse de −0,6 milliard d’euros.
L’encours des contrats d’assurance vie atteint 1 847 milliards d’euros à fin avril, en croissance de +1,1 % sur un an.
Avec la résurgence de l’inflation et un marché « actions » volatil, l’assurance vie est confrontée à un contexte moins porteur qui pourrait amener à une diminution de la collecte dans les prochains mois. Cette tendance pourrait être contrariée par l’effet d’encaisse en vertu duquel les ménages souhaitent conserver constante la valeur réelle de leur épargne.
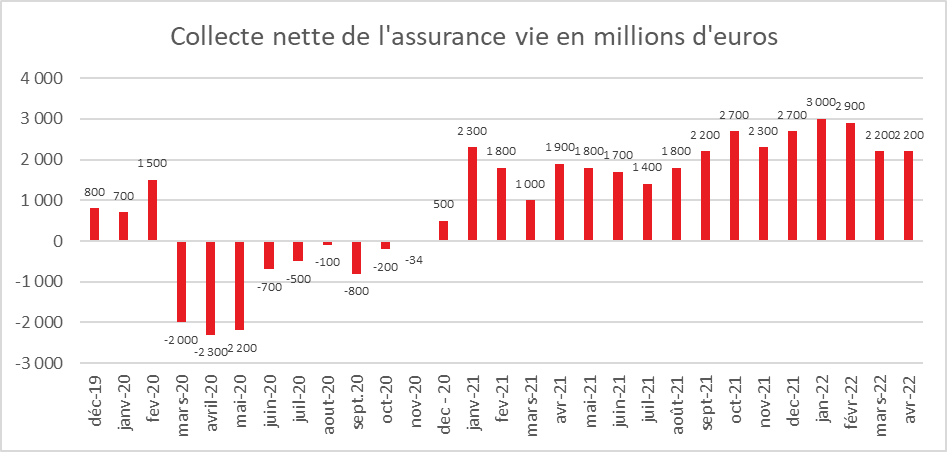
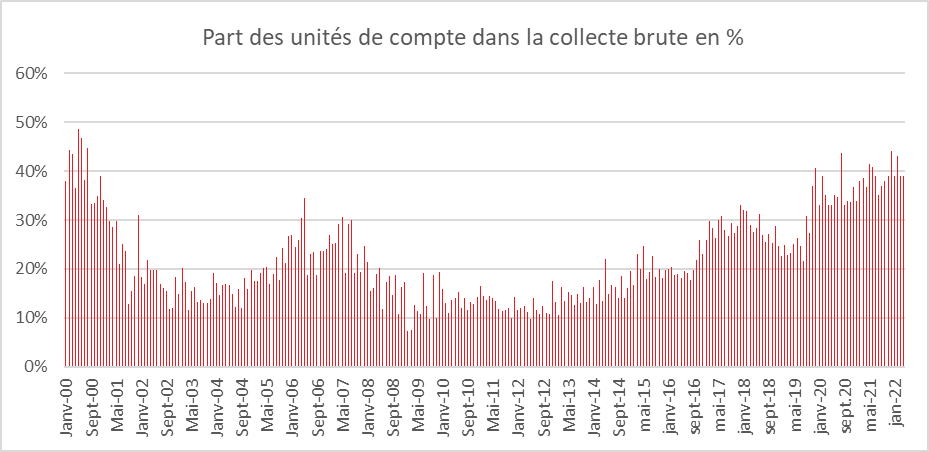
Epargne et inflation
Selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages en France s’est établi à 18,7 % du revenu disponible brut en 2021, contre 21 % en 2020. Le taux d’épargne des ménages reste supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire (15 %).
Au cours du premier trimestre 2022, le taux d’épargne a continué son mouvement de baisse pour représenter 16,7 % du revenu disponible brut. La baisse du pouvoir d’achat pour les ménages les plus modestes les contraint à puiser dans leur épargne.
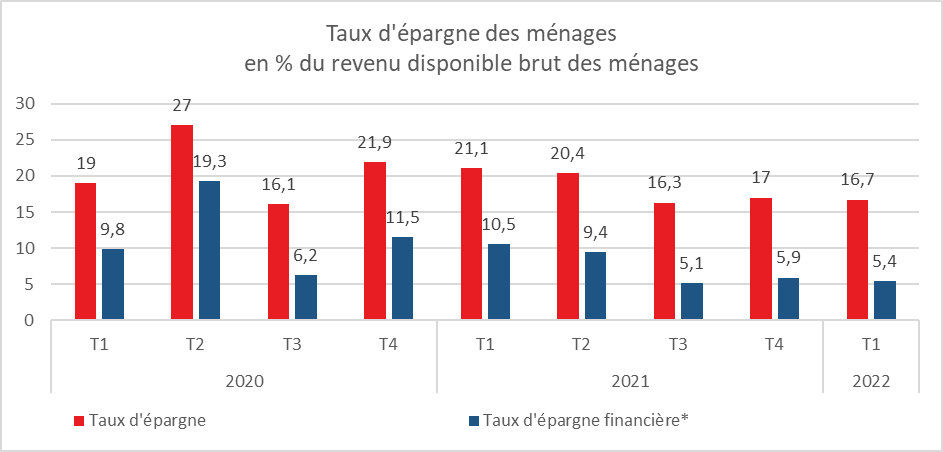
Selon une enquête réalisée par l’Ifop présentée au mois de mai 2022, 72 % des Français épargnent au moins une fois tous les six mois, les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes tout comme ceux du Centre-Val-de-Loire sont 81 % dans ce cas. C’est le chiffre le plus élevé au niveau national, tandis qu’il tombe à 65 % dans la région PACA et en Corse. Dans le Sud de la France, la priorité est donnée à l’immobilier au détriment de l’assurance vie.
Toujours selon cette enquête, 71 % des Français privilégient les produits sans risque. Les épargnants estiment que l’immobilier est le meilleur placement pour se protéger de l’inflation (46 %). Il devant l’assurance-vie (26 %), l’or (19 %) et les actions (9 %). Le mauvais positionnement des actions s’explique sans nul doute par la baisse des cours de ces dernier mois. Pour autant, en prenant en compte les dividendes, les actions demeurent le placement qui protège le mieux les épargnants des effets de l’inflation.
Le Coin des Epargnants du mois de mai 2022
Tableau de bord des marchés financiers
| Résultats – Mai 2022 | |
| CAC au 31 décembre 2021 CAC au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 7 153,03 6 468,80 -0,99 % -0,34 % |
| Daxx au 31 décembre 2021 DAXX au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 15 884,86 14 388,35 +2,06 % -7,29 % |
| Footsie au 31 décembre 2021 Footsie au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 7 384,54 7 607,66 +0,84 % +8,33% |
| Euro Stoxx au 31 décembre 2021 Eurostoxx au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 4 298,41 3 789,21 -0,36 % -6,91 % |
| Dow Jones au 31 décembre 2021 Dow au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 36 338,30 32 990,12 -0,44 % -4,46 % |
| Nasdaq au 31 décembre 2021 Nasdaq au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 15 644,97 12 081,39 -2,05 % -12,13 % |
| Nikkei au 31 décembre 2021 Nikkei au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 28 791,71 27 279,80 +1,61 % -6,41 % |
| Shanghai Composite au 31 décembre 2021 Shanghai au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois s | 3 639,78 3 186,43 +4,25 % -12,14 % |
| Parité euro/dollar au 31 décembre 2021 Parité au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 1,1378 1,0721 +1,44 % -12,08 % |
| Once d’or au 31 décembre 2022 au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 1 825,350 1 842,040 -3,44 % -3,13 % |
| Pétrole au 31 décembre 2021 au 31 mai 2022 Évolution en mai 2022 Évolution sur 12 mois | 78,140 118,170 +10,89 % +71,71 % |
Le Coin des Epargnants : les marchés en mode optimiste
Sursaut boursier
Le CAC 40 a gagné plus de 3 % en une semaine dopé par les bons résultats américains. L’Eurostoxx a progressé de plus de 4 %. Les marchés américains ont connu une semaine en or avec un gain de plus de 6 % pour le Dow Jones et le Nasdaq. Pour New York, cette hausse met fin à deux mois de reculs hebdomadaires. Ce rebond est imputable à la publication de certains résultats économiques encourageants. Aux Etats-Unis, en avril, la hausse des prix a été de 6,3 % sur un an et de 4,9 % hors alimentation et énergie. Sur un mois, les prix ont progressé de 0,2% en données brutes et de 0,3% en excluant les éléments volatils. L’inflation marque le pas après des mois de hausse, permettant d’espérer une décrue dans les prochains mois. Par ailleurs, La consommation reste forte outre-Atlantique avec une augmentation en avril de 0,7 %, comme attendu, et plus que le gain de mars +0,2 %. La consommation au deuxième trimestre pourrait augmenter de près de 5 % en rythme annualisé, avec une croissance globale du PIB de l’ordre de 4 %, en hausse par rapport à notre précédente estimation de 3 % ». Aux Etats-Unis, les ménages puisant dans leur épargne, ce qui pourrait amener une moindre progression au second semestre.
Le pétrole a augmenté de près de 5 % sur la semaine en lien avec les menaces d’embargo des Européens à l’encontre de la Russie. Le cours du pétrole est orienté à la hausse en raison du début de la saison des déplacements estivaux synonymes de regain de consommation de carburants. Les effets de la décision américaine de puiser dans les réserves stratégiques s’estompent du fait d’une demande en augmentation. Les membres de l’OPEP devraient annoncer un nouveau relèvement de leur production identique aux mois précédents, soit 432 000 de barils par jour supplémentaires en juillet, selon l’agence Reuters. Les Etats membres refusent d’aller au-delà. Par ailleurs, ils sont loin d’avoir atteint leur plafond de production. Deux millions de barils jour manqueraient à l’appel faute de capacités suffisantes au sein de plusieurs Etats membres.
Les taux d’intérêt sont restés stables, l’euro continuant à s’apprécier légèrement par rapport au dollar.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 27 mai 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 515,75 | +3,67 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 33 212,96 | +6,24 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 12 131,13 | +6,84 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 14 462,19 | +3,44 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 585,46 | +2,65 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 808,86 | +4,15 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 26 781,68 | +0,16 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 130,24 | -0,52 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,475 % | +0,013 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +0,960 % | +0,027 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,731 % | -0,066 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0704 | +1,52 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 854,740 | +0,65% | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 118,180 | +4,92 % | 78,140 |
Récession ou pas récession ?
Si plusieurs signaux témoignent d’un réel ralentissement de l’activité de la zone euro, d’autres indiquent que les agents économiques ne croient pas un effondrement de l’activité. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré dans le cadre du forum de Davos que « pour le moment, nous ne voyons pas de récession pour la zone euro ». En France, les chefs d’entreprise sont sur la même longueur d’onde comme en témoigne l’enquête mensuelle de l’INSEE sur le climat des affaires (voir ci-dessous). Un ralentissement est indéniablement à l’œuvre mais il ne prouve pas l’économie se dirige immanquablement vers la récession. L’indice des directeurs d’achat (PMI) composite global est ressorti à 54,9 contre 55,8 le mois précédent, soit un plus bas depuis deux mois mais au-dessus de 50 qui est la ligne de démarcation entre récession et croissance. L’indice de l’industrie manufacturière s’est replié à 54,4 contre 55,5 en avril pour s’établir au plus bas depuis dix-huit mois.
Dans l’industrie, la hausse de la production s’est légèrement renforcée au cours du mois mais a conservé un rythme très modéré. L’activité des fabricants ayant plus ou moins stagné en avril, le secteur manufacturier affiche sa plus faible croissance trimestrielle depuis les confinements sanitaires du deuxième trimestre 2020. Des difficultés d’approvisionnement continuent de peser sur la production. Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement engendrées par la pandémie ont été accentuées par la guerre en Ukraine et les confinements sanitaires en Chine. Dans les services, en revanche, bien qu’en repli aussi à 56,3 contre 57,7 en avril, l’indice révèle une expansion soutenue. En mai, en zone euro, ce secteur a enregistré sa deuxième plus forte croissance des huit derniers mois. La demande reste forte de la part des consommateurs. Depuis la levée des mesures contre le variant Omicron et la réouverture de l’économie, les activités touristiques connaissent un rapide essor de bon aloi dans la perspective de la période estivale.
Dans les prochains mois, la zone euro devrait échapper à la récession. Les chiffres laissent augurer d’une croissance du PIB de la zone de l’ordre de 0,6 % au deuxième trimestre 2022. Pour certains experts, le rebond des services pourrait ne pas dépasser l’été. La faiblesse du secteur manufacturier est jugée préoccupante et les difficultés des fabricants semblent déjà se propager à une partie du secteur des services. Dans ces conditions, la fin de l’année pourrait être difficile surtout si les tensions sur les marchés de l’énergie et des matières premières perdurent.
En Allemagne, première économie de la zone euro, la légère amélioration de l’activité industrielle ne doit pas occulter le fait que l’inflation et les problèmes d’approvisionnement commencent à peser sur la demande. Pour la France, la croissance de l’activité du secteur privé a légèrement ralenti en mai en raison des pressions inflationnistes. L’indice PMI composite ressort à 57,1 après 57,5 en avril. L’indice du secteur des services s’est lui aussi replié à 58,4 après 58,9 le mois dernier.
En dehors de l’Union européenne, le net ralentissement de l’activité britannique fait craindre une récession. L’indice composite a chuté à 51,8 en mai, son plus bas niveau depuis février 2021, après 58,2 en avril. Celui des services a reculé à 51,8 après 58,9 et celui de l’industrie manufacturière a fléchi à 54,6, au plus bas depuis janvier 2021, après 55,8.
Moral en baisse en mai et capacité d’épargne élevée pour les ménages en France
Au mois de mai, la confiance des ménages continue, selon l’INSEE, de diminuer, mais moins fortement qu’en mars et avril. À 86, l’indicateur qui la synthétise baisse d’un point et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021). La guerre en Ukraine et la résurgence de l’inflation continue de peser sur le moral des ménages.
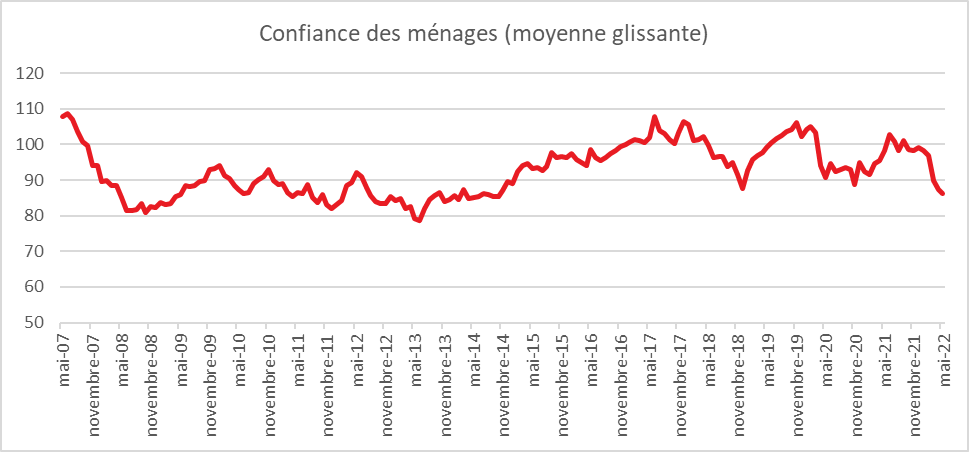
En mai, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée perd deux points et reste au-dessous de sa moyenne de longue période. Le solde relatif à la situation financière personnelle future des ménages est stable et demeure lui aussi nettement au-dessous de sa moyenne.
La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants progresse légèrement après une forte baisse en avril. Le solde correspondant gagne un point mais se situe nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. En mai, le solde d’opinion concernant l’opportunité d’épargner perd trois points ; ceux relatifs à la capacité d’épargne passée et future des ménages sont stables. Ces trois soldes demeurent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.
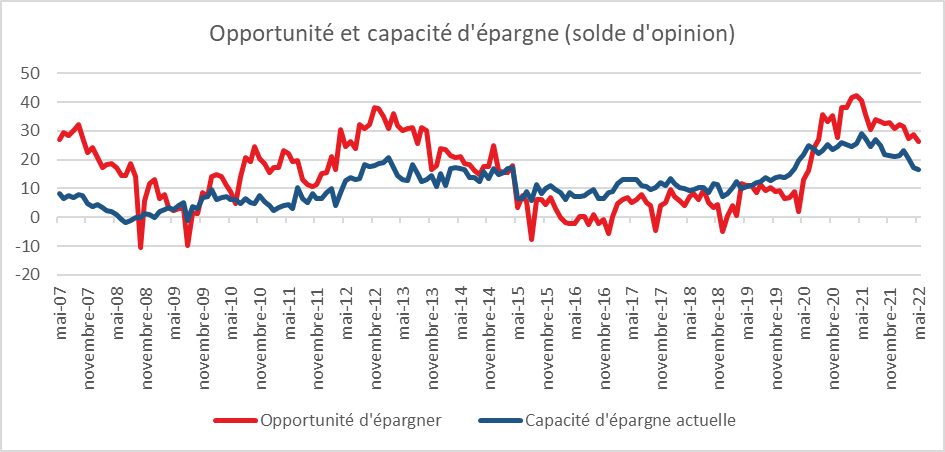
Faut-il encore épargner en période d’inflation ?
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne était l’invité mardi 24 mai de BFM Business et est intervenu sur le thème de l’épargne en période d’inflation.
Philippe Crevel sur France 2 au sujet de l’épargne des ménages en période d’inflation
Alors que les prix continuent d’augmenter, mardi 24 mai, de plus en plus de Français piochent dans leurs économies pour faire face à leurs dépenses.
Avec 1 000 euros par mois et au chômage, Patricia Boulot ne peut pas payer ses dépenses quotidiennes et doit piocher dans son livret A. « J’ai pas le choix (…), j’ai 58 ans, je ne veux pas vous cacher qu’une banque ne veut pas me faire un prêt« , explique-t-elle. Les Français mettent moins de côté : s’ils épargnaient 6 milliards d’euros sur leur livret A en janvier 2022, c’est moins de 2 milliards en avril 2022. (lire la suite)
CP – Résultats du mois d’avril 2022 du Livret A : Recul normal de la collecte
Retour aux fondamentaux
Au mois d’avril, la collecte du Livret A a été de 1,87 milliard d’euros en retrait par rapport à celles des deux mois précédents qui avaient été dopées par le relèvement du rendement de 0,5 à 1 point. En avril 2020, elle s’était élevée à 5,47 milliards d’euros et en avril 2021 à 2,95 milliards d’euros. Pour les quatre premiers mois de l’année 2022, la collecte atteint 14 milliards d’euros, soit un peu moins que sur la même période de 2021 (14,93 milliards d’euros) qui avait donné lieu à un confinement. Le résultat du mois d’avril témoigne le retour en territoire connu du premier produit d’épargne des ménages. La collecte demeure élevé mais plus en phase avec les années d’avant crise sanitaire. L’effet « hausse des taux » s’estompe après deux mois de forte collecte.
Le mois d’avril est, en règle générale, un mois correct pour le Livret A. En dix ans, une seule décollecte a été constatée (en avril 2015, en pleine période de baisse du taux de rendement). Avec le tassement constaté en 2022, la collecte du Livret A retrouve le niveau d’avant la crise sanitaire (1,94 milliard d’euros en avril 2019). Il y a un retour à la normale après un début d’année de forte collecte portée par la hausse du taux, la vague omicron et par la guerre en Ukraine qui a généré un fort climat d’incertitudes et d’anxiété.
Des ménages toujours en mode « prudence »
Les ménages maintiennent, depuis le début de l’année, un effort important d’épargne de précaution. Ils mettent de l’argent de côté pour se protéger des augmentations de prix à venir et donc de la baisse potentielle de leur pouvoir d’achat. Ils épargnent également pour maintenir constant la valeur réelle de leur épargne (effet Pigou). Dans le passé, en début de période d’inflation, le taux d’épargne a légèrement tendance à augmenter. Si les ménages les plus modestes qui traditionnellement épargnent peu ont pu commencer à puiser dans leurs livrets, la grande majorité des ménages continuent à les alimenter. Au mois d’avril, l’encours du Livret A a battu un nouveau record à 357,4 milliards d’euros. Les ménages n’ont pas commencé de puiser dans le stock d’épargne constitué depuis le début de la crise sanitaire. Pour mémoire, l’encours du Livret A était de 298 milliards d’euros fin 2019. Le tassement de la collecte du mois de mars après trois mois atypiques est un retour à la normale et non un changement de direction pour le Livret A.
Le rendement réel négatif du Livret A ne dissuade pas les ménages d’y placer leurs économies. Avec une inflation qui sur les six derniers mois dépasse 4 %, le rendement réel est négatif de plusieurs points. Le capital n’est plus ainsi préservé. Il faut remonter aux années 1980 pour avoir un tel écart entre taux d’inflation et taux de rendement du Livret A. Avec les livrets réglementés, les ménages ne cherchent pas le rendement mais la sécurité.
En appliquant la formule du Livret A, son taux pourrait être relevé, durant l’été, à 1,8 voire 2 %, ce qui ne permettrait pas de compenser les effets de l’inflation. Les taux faibles des marchés monétaires tirent le taux du Livret A vers le bas. Le relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne pourrait atténuer légèrement cet effet dans le courant du second semestre 2022.
Le premier semestre 2022 devrait, au vu des quatre premiers mois, être marqué par une forte collecte. Comme les années précédentes, celle-ci devrait s’affaiblir au second semestre. Avec les dépenses liées aux vacances, de rentrées scolaires et de fin d’année, ce semestre est plus axé « dépenses » que le premier. Avec la hausse des prix, les ménages seront sans nul doute amenés à diminuer leur effort d’épargne.
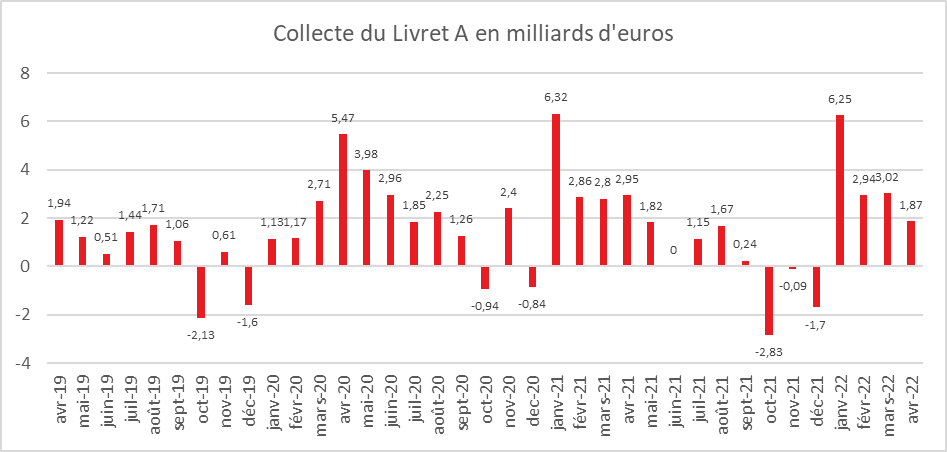
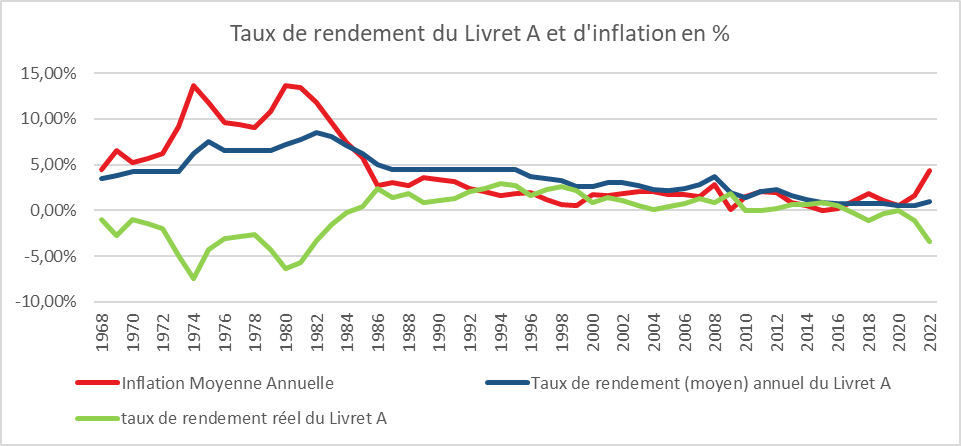
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
Livret A, retour en territoire connu
Retour aux fondamentaux
Au mois d’avril, la collecte du Livret A a été de 1,87 milliard d’euros en retrait par rapport à celles des deux mois précédents qui avaient été dopées par le relèvement du rendement de 0,5 à 1 point. En avril 2020, elle s’était élevée à 5,47 milliards d’euros et en avril 2021 à 2,95 milliards d’euros. Pour les quatre premiers mois de l’année 2022, la collecte atteint 14 milliards d’euros, soit un peu moins que sur la même période de 2021 (14,93 milliards d’euros) qui avait donné lieu à un confinement.
Le mois d’avril est, en règle générale, un mois correct pour le Livret A. En dix ans, une seule décollecte a été constatée (en avril 2015, en pleine période de baisse du taux de rendement). Avec le tassement constaté en 2022, la collecte du Livret A retrouve le niveau d’avant la crise sanitaire (1,94 milliard d’euros en avril 2019). Il y a un retour à la normale après un début d’année de forte collecte portée par la hausse du taux, la vague omicron et par la guerre en Ukraine qui a généré un fort climat d’incertitudes et d’anxiété.
Des ménages toujours en mode prudence
Les ménages maintiennent, depuis le début de l’année, un effort important d’épargne de précaution. Ils mettent de l’argent de côté pour se protéger des augmentations de prix à venir et donc de la baisse potentielle de leur pouvoir d’achat. Ils épargnent également pour maintenir constant la valeur réelle de leur épargne (effet Pigou). Dans le passé, en début de période d’inflation, le taux d’épargne a légèrement tendance à augmenter. Si les ménages les plus modestes qui traditionnellement épargnent peu ont pu commencer à puiser dans leurs livrets, la grande majorité des ménages continuent à les alimenter. Au mois d’avril, l’encours du Livret A a battu un nouveau record à 357,4 milliards d’euros.
Le rendement réel négatif du Livret A ne dissuade pas les ménages d’y placer leurs économies. Avec une inflation qui sur les six derniers mois dépasse 4 %, le rendement réel est négatif de plusieurs points. Le capital n’est plus ainsi préservé. Il faut remonter aux années 1980 pour avoir un tel écart entre taux d’inflation et taux de rendement du Livret A. Avec les livrets réglementés, les ménages ne cherchent pas le rendement mais la sécurité.
En appliquant la formule du Livret A, son taux pourrait être relevé, durant l’été, à 1,8 voire 2 %, ce qui ne permettrait pas de compenser les effets de l’inflation. Les taux faibles des marchés monétaires tirent le taux du Livret A vers le bas. Le relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne pourrait atténuer légèrement cet effet dans le courant du second semestre 2022.
Le premier semestre 2022 devrait, au vu des quatre premiers mois, être marqué par une forte collecte. Comme les années précédentes, celle-ci devrait s’affaiblir au second semestre. Avec les dépenses liées aux vacances, de rentrées scolaires et de fin d’année, ce semestre est plus axé « dépenses » que le premier. Avec la hausse des prix, les ménages seront sans nul doute amenés à diminuer leur effort d’épargne.
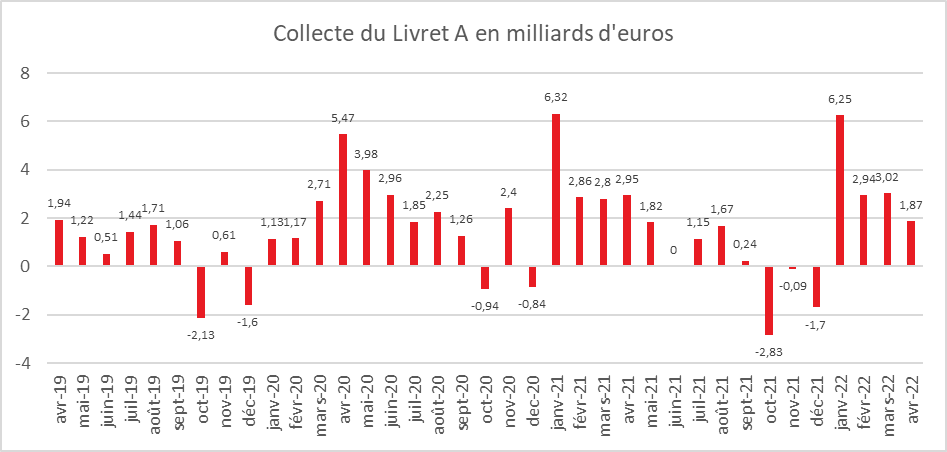
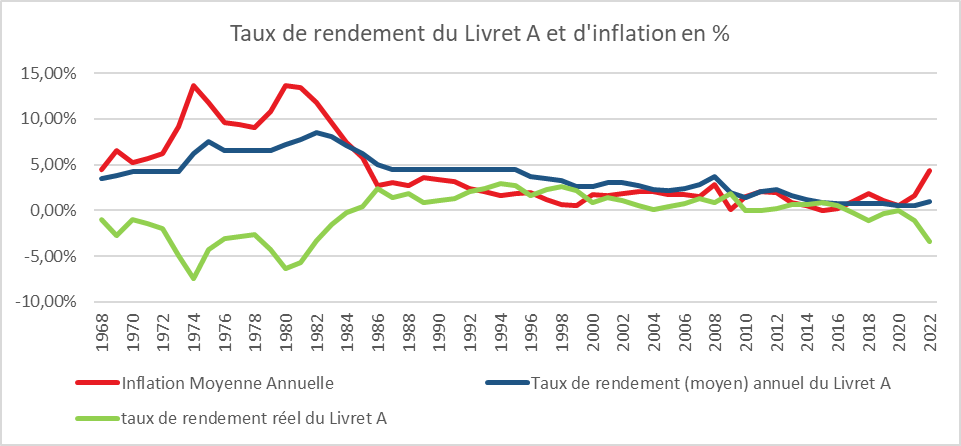
Le Coin de l’épargne du 21 juin 2022
Les marchés et la peur de la récession
Le CAC 40 n’a pas réussi la passe de deux. Il a renoué cette semaine avec la baisse après un gain de 1,67 % sur cinq jours la semaine précédente, la faute aux menaces qui pèsent sur la croissance. Le Nasdaq a perdu près de 4 % sur la semaine portant les pertes à plus de 27 % depuis le début de l’année. Le Dow Jones a perdu près de 3 % sur la semaine et près de 14 % depuis le 1er janvier.
En pleine gestion de son zéro covid contraignant à de stricts confinements à Shanghai et à Shenzhen, la Chine est en proie à un ralentissement de son activité. Face à cette dégradation de la croissance, la Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé une baisse marquée de l’un de ses principaux taux directeurs. Le taux préférentiel de prêt à cinq ans, qui sert de référence au marché chinois du crédit immobilier, a été abaissé de 15 points de base, à 4,45%. D’autres baisses seraient à prévoir.
La survenue d’une récession dans les prochains mois n’est pas le scénario majoritaire mais ce dernier gagne des adeptes. Après la surchauffe, l’économie mondiale pourrait connaître un refroidissement. Les hausses en cascade effilochent le pouvoir d’achat des ménages et contraignent les banques centrales à réagir. Le moteur chinois n’entraîne plus comme auparavant l’économie mondiale et n’a pas réellement de moteur de secours , l’Inde n’ayant pas encore le poids critique.
Cette semaine, le prix du pétrole est resté stable autour de 110 dollars. Le ralentissement de l’activité pourrait peser sur la demande de pétrole dans les prochains mois.
Les taux d’intérêt sur les obligations d’Etat ont peu évolué cette semaine, l’écart entre le taux français et allemand s’est néanmoins accru.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 20 mai 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 285,24 | -1,22 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 31 261,90 | -2,90 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 354,62 | -3,82 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 981,91 | -0,33 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 389,98 | -0,38 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 657,03 | -1,25 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 26 739,03 | +1,18 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 146,57 | +1,87 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,462 % | +0,003 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +0,933 % | -0,017 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,797 % | -0,127 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0551 | +1,40 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 840,749 | +1,67 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 111,500 | +0,80 % | 78,140 |
Les Français en mode épargne
Les flux financiers des ménages pour l’année 2021 ont atteint 165,8 milliards d’euros contre 203,4 milliards d’euros en 2020 et 108,8 milliards d’euros en 2019. Avant la crise sanitaire, le flux d’épargne était voisin de 100/110 milliards d’euros. Depuis 1996, la collecte est la deuxième la plus élevée après celle de 2020.
La constitution de cette épargne financière reste investie majoritairement vers les actifs sous forme de produits de taux (114,9 milliards en 2021). Les flux de placements vers les produits de fonds propres restent néanmoins à des niveaux exceptionnels (54,3 milliards en 2021 après 53,9 en 2020).
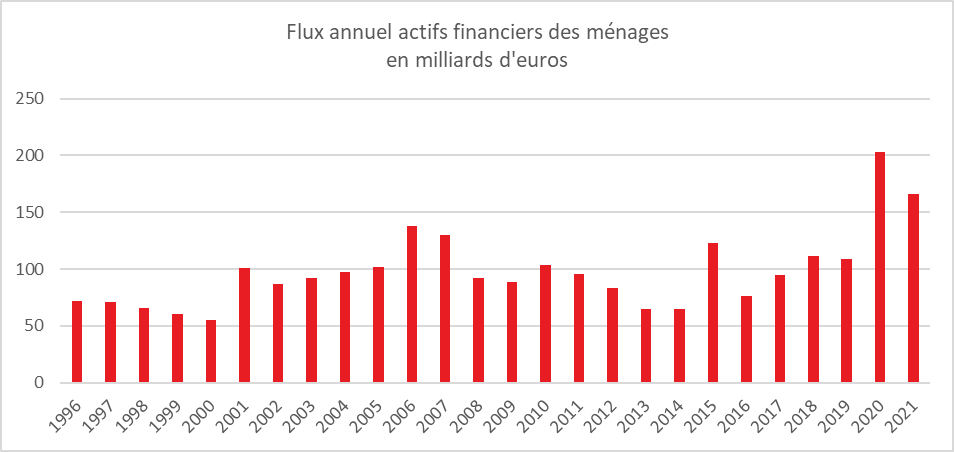
Au quatrième trimestre 2021, avec la levée des restrictions sanitaires et les fêtes de fin d’année, les ménages ont réduit leur effort d’épargne. Les flux nets des principaux placements financiers des ménages sont ainsi revenus à des niveaux proches de ceux d’avant pandémie (31 milliards après 41,2 milliards au troisième trimestre). Les ménages placent des montants plus faibles en numéraire et dépôts à vue (6,3 milliards contre 19,6 milliards au troisième trimestre) et procèdent à des retraits sur leurs livrets d’épargne réglementée (-0,2 milliards au quatrième trimestre). En revanche, les flux en assurance-vie et épargne retraite sont en hausse, tant pour les supports en euros que pour ceux en unités de compte (12,5 milliards après 7,6 milliards).
Le patrimoine financier brut des ménages a atteint le niveau record de 6025 milliards d’euros au quatrième trimestre contre 5662,2 milliards d’euros au quatrième trimestre 2020. Cette hausse est imputable au maintien d’un fort taux d’épargne et d’une augmentation importante de la valeur des actions.
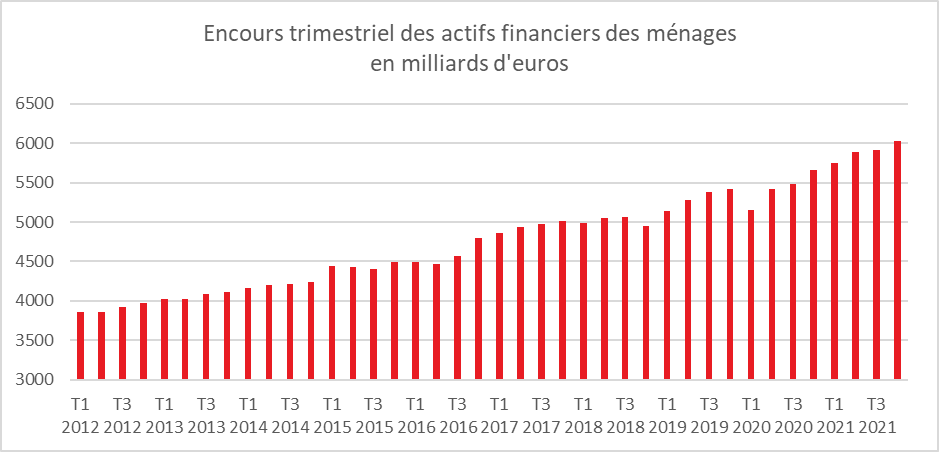
Pour le premier trimestre 2022, les informations de la Banque de France comme celles en provenance de la Caisse des Dépôts et de France Assureurs soulignent qu’après un léger repli au dernier trimestre 2021, l’effort d’épargne est à nouveau en hausse.
Les placements en numéraire et sous forme de dépôts auprès des banques, y compris l’épargne réglementée, (23,7 milliards d’euros contre 13,6 milliards au quatrième trimestre), sont en augmentation. Le flux des contrats d’assurance-vie demeure positif grâce aux unités de compte. Le relèvement du taux du Livret A le 1er février 2022 et les incertitudes liées à la résurgence de l’inflation et à la guerre en Ukraine conduisent les ménages à renforcer leur épargne de précaution.
Fin 2021, l’Allemagne et la France sont les deux principaux pays de l’OCDE ayant les taux d’épargne les plus élevés. Dans aucun des grands Etats de l’OCDE, le taux d’épargne a retrouvé son niveau d’avant crise.
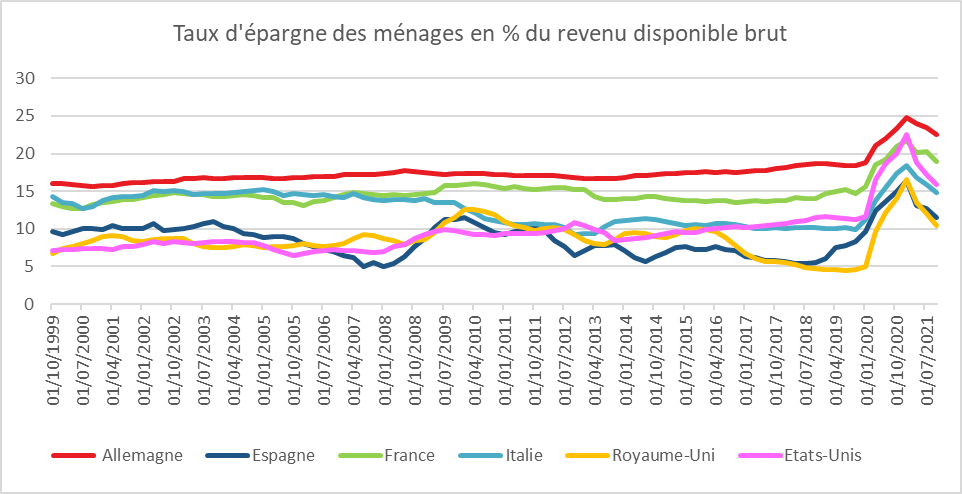
Le Coin des Epargnants du 13 mai 2022
Les investisseurs inquiets face à un éventuel ralentissement de l’économie mondiale
La semaine aura connu deux temps : le premier marqué par un recul important des cours « actions » sur fond de mauvais chiffres économiques ; puis un second temps caractérisé par le rebond des valeurs technologiques à l’exception de Twitter. Ce rebond a permis à la bourse de Paris d’échapper à une quatrième semaine consécutive de baisse. En revanche, il n’a pas été suffisant aux Etats-Unis pour empêcher une nouvelle semaine de baisse. Depuis le début de l’année, l’indice Nasdaq a perdu le quart de sa valeur. Il est à noter que l’envolée du cours du pétrole a permis à la compagnie pétrolière saoudienne Aramco de ravir à Apple la place de première capitalisation mondiale.
Les inquiétudes concernant l’inflation se doublent désormais de craintes sur la croissance économique. De plus en plus d’analystes en particulier aux Etats-Unis estiment que la bataille contre l’inflation passera par une récession. Le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu que la possibilité d’un atterrissage en douceur dépendait de facteurs échappant au contrôle des banquiers centraux et que le retour de l’inflation à l’objectif de 2% se fera dans la douleur.
Dans un contexte porteur pour les valeurs obligataires, les taux d’intérêt se sont légèrement repliés sur la semaine. Le taux de l’obligation d’Etat allemand est repassé en-dessous de 1 % quand celui de son homologue américain est repassé au-dessous de 3 %. Le pétrole s’est également inscrit en baisse tout comme l’or et l’euro.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 13 mai 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 362,68 | +1,67 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 196,66 | -2,14 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 11 805,00 | -2,80 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 14 027,93 | +2,59 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 418,15 | +0,41 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 703,42 | +2,05 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 26 427,65 | -2,13 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 084,28 | +2,76 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,459 % | -0,197 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +0,950 % | +0,184 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,924 % | -0,167 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0405 | -1,33 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 811,740 | -3,76 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 110,495 | -1,65 % | 78,140 |
La hausse des taux aux quatre coins du monde
Après une certaine léthargie, les banques centrales ont décidé de réagir face à l’inflation qui semble prendre ses quartiers. En quelques semaines, les politiques monétaires non-conventionnelles reposant sur des rachats d’obligations et des taux bas sont progressivement abandonnées. Au début de l’année 2021, la FED ne prévoyait que des relèvements modérés de ses taux jusqu’au moins 2024. La BCE avait signifié alors que les premières décisions d’augmentation n’interviendraient pas avant la fin de 2023 voire 2024. Depuis, la FED a relevé de 0,75 point ses taux et la BCE pourrait s’engager dans cette voie dès l’été 2022.
La Reserve Bank of Australia qui prévoyait également de maintenir ses taux proches de zéro jusqu’en 2024 a surpris les investisseurs en les augmentant le 3 mai dernier d’un quart de point. La Banque d’Angleterre a également relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution des taux directeurs commence à se faire ressentir sur les taux des obligations d’État. Le rendement du Trésor américain à dix ans a atteint 3 %, soit près du double de son niveau du début de l’année. Le taux de l’OAT à 10 ans est passé de 0,690 à 1,650 de fin décembre à mi-mai. Celui de son homologue allemand s’élevait toujours mi-mai à 1,134 % contre -0,180 % fin décembre. Dans le même temps, les cours des actions sont orientés à la baisse, les investisseurs privilégiant les produits de taux en dollars. La baisse sur les marchés occidentaux atteint près de 15 % depuis le début de l’année. L’une des conséquences du resserrement des conditions financières est une réévaluation des devises dont profite le dollar. La monnaie américaine s’est appréciée de 7 % contre un panier de devises au cours de l’année écoulée. L’Amérique a besoin de taux d’intérêt plus élevés que tout autre grand pays riche pour financer ses déficits extérieurs comme intérieurs sur fond d’épargne faible. La demande de dollars augmente en période d’incertitudes, les agents économiques souhaitant réduire leur exposition aux risques. La plus forte appréciation du dollar s’effectue par rapport au yen en raison de la volonté de la banque centrale japonaise de maintenir des taux bas aussi longtemps que possible. En termes réels, le yen est au plus bas par rapport au dollar depuis les années 1970. L’euro glisse de son côté progressivement vers la parité, ce qui favorise les exportations mais renchérit les importations en particulier de pétrole, de gaz et de matières premières.
Au niveau européen, le durcissement des politiques monétaires induit une augmentation de l’écart de taux entre les pays périphériques et l’Allemagne. La question des dettes souveraines qui avait disparu depuis le milieu de la décennie 2010 pourrait apparaître à nouveau en générant des tensions au sein de la zone euro. Les conséquences de la remontée des taux sont encore mal appréciées, que ce soit au niveau du rendement des portefeuilles financiers ou pour l’évolution de l’investissement. Avec la remontée des taux, le rendement des actions dépendra davantage des dividendes. Avec les faibles gains de productivité de ces dernières années, la stagnation de la consommation, l’augmentation des coûts provoquée par l’inflation, les dividendes pourraient s’éroder. La hausse des taux pourrait conduire à une diminution de l’investissement. Pour le moment, ce dernier est dopé par les plans de relance et par la demande qui a été forte après les confinements. Un retournement pourrait néanmoins intervenir si l’épisode inflationniste perdurait. L’investissement immobilier des ménages est traditionnellement très sensible à l’évolution des taux. A contrario, l’investissement immobilier est jugé assez résilient face à l’inflation.
Le resserrement de la politique monétaire est une source d’inquiétude pour les pays émergents et en développement qui sont également exposés, pour un grand nombre d’entre eux, à la crise ukrainienne. Leurs dettes souvent exprimées en dollars seront plus difficiles à rembourser. Ces pays pourraient éprouver des difficultés à acquérir des dollars pour s’acquitter de leurs importations.
Le Coin des Epargnants, de l’emploi et des taux
L’emploi américain mine les marchés
Les bons résultats de l’emploi américain du mois d’avril ont entrainé un repli des indices « actions ». Ces résultats sont le signe que l’économie des Etats-Unis se portent bien et peut encaisser des hausses de taux de la part de la FED.
En avril, elle a créé 428 000 emplois dans le secteur non agricole, au-delà des 380 000 attendus. Ce résultat est identique à celui de mars (431 000). Le taux de chômage est resté stable à 3,6 % de la population active tandis que le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % sur un mois et de 5,5 % sur un an, globalement dans la lignée des anticipations. Dans une économie où les gains de productivité sont faibles, une croissance des salaires aussi élevée ne permet pas de revenir à l’objectif d’inflation de 2 %. Au premier trimestre, la productivité du secteur non agricole américain a en effet chuté de 7,5%, un rythme inédit depuis 1947. Le CAC 40 a abandonné sur la semaine plus de 4 % portant les pertes depuis le début de l’année à 12 %. Si les indices américains ont été moins touché que leurs homologues européens, il est à souligner que le Nasdaq, depuis le début de l’année, a perdu plus de 22 %.
Sur la semaine, les taux d’intérêt ont continué leur mouvement de hausse. Le taux de l’obligation du Trésor américain est désormais au-dessus de 3 % et celui de son homologue allemand a dépassé 1 %. Le pétrole, après les annonces d’embargo progressif sur celui en provenance de Russie, est à la hausse. Cette dernière a été alimentée par l’annonce de l’OPEP de ne pas compenser les effets de cet embargo sur le marché.
La hausse raisonnable des taux de la FED
Mercredi 4 mai, la Banque centrale américaine (FED) a décidé une hausse de ses taux directeurs d’un demi-point, à l’issue de son comité de politique monétaire. Après les la hausse d’un quart de point du mois de mars, les taux d’intérêt directeurs se situeront désormais entre 0,75 % et 1 %. Cette décision avait été anticipée par les marchés financiers qui craignaient même une hausse plus forte. Une nouvelle augmentation d’un demi-point est prévue pour les deux prochaines réunions (mi-juin et fin juillet). Le Président de la FED a indiqué qu’il n’envisageait pas d’augmentation de 0,75 point. La banque centrale a également décidé d’entamer, à compter du 1er juin prochain, la réduction de la taille de son bilan qui atteint près de 9 000 milliards de dollars après des achats massifs pendant la pandémie. Il sera d’abord réduit jusqu’à 47,5 milliards de dollars par mois pendant trois mois, puis jusqu’à 95 milliards mensuels.
La baisse surprise du PIB américain au premier trimestre, de 1,4 %, en rythme annualisé, n’a pas modifié l’analyse de fond des gouverneurs du Comité de politique monétaire. Ils estiment que la contraction du PIB est essentiellement due au solde de la balance commerciale, la consommation des ménages restant vive. Le Président de la FED estime que les ménages américains et les entreprises sont dans une situation financière solide. Le marché de l’emploi est jugé capable d’absorber un resserrement monétaire. À 3,6 % de la population active, le taux de chômage est revenu à son niveau d’avant-pandémie. Le rythme des créations d’emploi est, par ailleurs, soutenu. Les Américains sortis du marché du travail pendant la pandémie ont, en outre, commencé à y revenir. L’économie américaine doit néanmoins toujours faire face à un manque de main-d’œuvre ce qui alimente des hausses de salaires.
Le tableau des marchés de la semaine
| Résultats 6 mai 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |
| CAC 40 | 6 258,36 | -4,22 % | 7 153,03 |
| Dow Jones | 32 899,37 | -0,24 % | 36 338,30 |
| Nasdaq | 12 144,66 | -1,54 % | 15 644,97 |
| Dax Xetra allemand | 13 674,29 | -3,00 % | 15 884,86 |
| Footsie | 7 387,94 | -2,08 % | 7 384,54 |
| Euro Stoxx 50 | 3 629,17 | -4,57 % | 4 298,41 |
| Nikkei 225 | 27 003,56 | +0,58 % | 28 791,71 |
| Shanghai Composite | 3 001,56 | -1,49 % | 3 639,78 |
| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,656 % | +0,195 pt | +0,193 % |
| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,134 % | +0,194 pt | -0,181 % |
| Taux du Trésor US à 10 ans | +3,091 % | +0,190 pt | +1,505 % |
| Cours de l’euro / dollar | 1,0571 | +0,02 % | 1,1378 |
| Cours de l’once d’or en dollars | 1 889,360 | -0,95 % | 1 825,350 |
| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 112,333 | +5,42 % | 78,140 |
Suivez le cercle
recevez notre newsletter
le cercle en réseau
contact@cercledelepargne.com


